 ---à Plan du temple étrusque du Capitole.
---à Plan du temple étrusque du Capitole.L'ÉVOLUTION DE L'HUMANITÉ
===== SYNTHÈSE COLLECTIVE —— Dirigée par HENRI BERR
LE GENIE ROMAIN
DANS
LA RELIGION, LA PENSÉE ET L'ART
PAR
albert GRENIER
ancien membre de l'école française de rome
professeur a la faculté des lettres
de l'université de strasbourg
LA RENAISSANCE DU LIVRE
78, BOULEVARD SAINT-MICHEL, PARIS 1925
AVANT-PROPOS
ROME ET LA GRÈCE
Rome et la Grèce, — tel devait être primitivement le litre de ce volume. A la réflexion, il a semblé préférable d'adopter comme titre le sous-titre, légèrement modifié: le Génie romain dans la religion, la pensée et l'art (1).
Sans doute, en étudiant la vie de l'esprit à Rome, on rencontre la Grèce. Mais l'influence grecque est à la fois plus diffuse et moins dominatrice qu'on ne se la représente souvent. Elle s'est infiltrée, longtemps, par l'intermédiaire de l'Etrurie, puis de la Campanie et de la Sicile. Plus tard, lorsque, conquise, la Grèce parut avoir « conquis son vainqueur », peut-être les séductions de l'Asie et de l'Egypte ont-elles été plus puissantes encore que les siennes.
Pour ces pages d'Avant-Propos le titre de Rome et la Grèce est sans inconvénient : nous y reprenons un problème traditionnel — dont la solution nous est fournie, précisément, par la lumineuse enquête d'Albert Grenier. Si le livre, lui, avait porté ce titre, il aurait été rapetissé à ce seul problème.
(1) Ce volume fait pendant à trois de la série grecque, les tomes XI, XII el XIII. Par contre, la série romaine a deux volumes pour les institutions, la série grecque un seul. Cette répartition semble répondre à la nature des choses,
Or l'objet de noire collaborateur, singulièrement plus large, consiste à déterminer, d'après ses premières et très humbles manifestations, un germe psychique, — qui, sans doute, résulte lui-même de mélanges ethniques et de certaines conditions de vie, mais qui apparaît à un moment donné dans l'histoire et sans lequel on ne saurait parler de « génie romain », — puis à suivre ce génie de peuple dans son évolution (1). L'intérêt particulier et le grand mérite de cet ouvrage, c'est, sans idée préconçue, sans théorie philosophique, sans croyance à un Volksgeisf, de réaliser une pénétrante étude de psychologie historique. Avec d'autres volumes de la même série, le caractère du peuple romain est étudié, implicitement, dans sa vie politique, dans l'organisation sociale qu'il a créée: ici, il l'est, explicitement, dans les oeuvres de l'esprit. Le travail de A. Grenier constitue une contribution importante à l’éthologiecollective.
Nous avons essayé, ailleurs (2), de montrer— et l’Evolution de l'Humanité prouvera, croyons-nous, — que les recherches d'éthologie collective, qui s'attachent à ce qu'on peut appeler les « races psychologiques », ont plus de portée pour l'explication historique que n'en peut avoir l'anthropologie, qui cherche à retrouver les races zoologiques. De cette discipline nous avons marqué les formes diverses : descriptive, comparée, génétique. La présente étude est génétique, comme il convient. A. Grenier le dit avec insistance, « le génie romain n'est pas, il s'est fait peu à peu »; ou du moins il s'est développé, non seulement sous l'empire des circonstances, mats par l'exercice d'une « merveilleuse faculté d'assimilation » qui caractérise le Romain au point de vue intellectuel.
(1) Pour un peuple, les mots caractère et génie peuvent-ils être employés indifféremment? Nous ne le croyons pas. Il nous semble que le mot génie n'est applicable que lorsqu'un peuple, parmi les traits de son caractère, en présente de nettement accusés qui lui donnent une originalité forte. On a tendance à l'appliquer particulièrement quand il s'agit des créations de l'esprit; pourtant on dira d'un peuple qu'il a le génie de la guerre ou celui du négoce,
(2) La Synthèse en Histoire, pp. 84-87,
Nous l'avons vu précédemment (1), les traits dominateurs ici sont le sens pratique et la volonté. Le Grec est porté à la spéculation et au jeu esthétique : le Romain agit. Longtemps la vie active, extérieure, — travaux de l'agriculture, obligations civiques, conduite ou préparation de la guerre, — lui semblera seule digne d'un homme libre. La vie pleine est au grand jour, in luce. Umbra, umbratilis secessus, la vie close, la retraite, c'est bon pour la femme, tout au plus, ou pour le malade. Ce qui fait l'intérêt de l'existence, ce sont les affaires, negotium. Toutes les formes de l'inaction physique et civique, le loisir, otium, fût-il studieux, jettent quelque discrédit sur l'individu qui s'y complaît. De durs paysans, qui ont mené une dure vie, qui ont connu une « longue pauvreté », soutenu des luttes constantes, grandi et prospéré par l’exacte discipline, par le sens des réalités : voilà ce que montre d'abord A. Grenier en un vigoureux raccourci ; et dans le portrait saisissant d'un Caton il résume la physionomie morale de la vieille Rome (2).
Une partie de ce livre fait voir comment la vie de l'esprit — religion, pensée et art — parle originellement la marque de ce pragmatisme ; comment la préoccupation spéculative dans la religion, comment la préoccupation esthétique sous toutes ses formes sont ici réduites au minimum.
Nous renvoyons à l'Avant-Propos du tome XI, le Génie grec dans la religion, pour l'étude de la nature des religions et de leur rôle dans la vie humaine. Bien entendu, en Italie comme ailleurs, l'être humain, par la religion, interprète le monde extérieur, pour se relier à lui. On peut rapprocher le Romain des premiers temps du primitif qu'étudie la sociologie (3).
(1) Avant-Propos du t. XVI; cf. Avant-Propos du t. XIX.
(2) Voir pp. 173 et suiv,
(3) Voir p. 104,
Mais il faut se mettre en garde contre une conception trop schématique et absolue de ce « primitif », Même chez les peuples « inférieurs » d'aujourd'hui, à plus forte raison chez les peuples anciens qui ont progressé et qui, donc, avaient le mouvement pour aller plus loin, on ne peut concevoir la fameuse « mentalité prélogique » comme imperméable à l'expérience (1). La vie ne s'est consolidée que par une certaine prévision, un certain pouvoir sur les choses, qui reposent sur un certain savoir. La mentalité dite prélogique est d'autant plus accusée dans une société que celle-ci se cristallise, que les esprits s'y nouent, — comme on le constate chez ces soi-disant primitifs qui sont, en réalité, des relégués de la civilisation, des isolés, des dégénérés.
D'excellents chapitres de A. Grenier mettent en lumière le caractère très particulier de la religion des Romains. Faute d'imagination, soit poétique, soit plastique, soit métaphysique, ils doublent le réel d'une infinité de puissances, numina, nettement définies dans leur rôle, mais mal définies dans leur nature, leurs formes, leurs rapports. « L'instinct qui personnifie les concepts, dit Renouvier dans son Introduction à la Philosophie analytique de l'Histoire, est poussé ici aussi loin que possible et au point d'engendrer plus de divinités que les Grecs si féconds n’en ont eux-mêmes connu. Mais une fois ces dieux produits, ils demeurent sans histoire, sans légendes ; leurs adorateurs se mettent en rapport de culte avec eux et s'attachent à se les rendre favorables et à interpréter leurs volontés, plutôt qu'à s'informer de leurs affaires privées. Quant aux attributs qui définissent le divin, on les tire tantôt des phénomènes naturels, tantôt et plus souvent de la suite innombrable des usages, des conditions et des accidents de la vie humaine. »
S'il manque de facultés créatrices pour une théogonie, le Romain applique aux pratiques religieuses dont toute son activité, privée ou publique, est enveloppée l'esprit juridique qui est un de ses caractères dominants.
(1) Voir les Avant-Propos des tomes 111. p. 33, VI, pp. 8-12.
Le culte est l'exécution d'un contrai : do ut des. Le rituel est minutieux; le formalisme absolu : ni trop peu ni trop ; trop, c'est la superstitio. Les prêtres sont les jurisconsultes de la religion; les Pontifes en sont les Prudents. Point d'élan, nulle émotion, — sinon la crainte, quand on ne s'acquitte pas de son dû.
Si les Romains sont religieux, si même ce sont eux qui ont créé ce terme, c'est que le sens originel du mot est non point mystique, mais juridique et social. La Religio, a dit encore Renouvier, « est tout ce qui lient et enchaîne l’âme » (1).
Cette religion, sans système, toute pratique, devait être hospitalière aux dieux étrangers : elle a accueilli les dieux étrusques et grecs pour en faire des dieux supérieurs, établir dans la foule des numina quelque ordre et quelque hiérarchie; elle en a accueilli bien d'autres dans l'intérêt de la res publica ; elle a annexé les empereurs, pour diviniser l'empire. Rome « faisait servir la religion à son agrandissement » et « elle s'attachait autant à conquérir les dieux que les villes (2) ». La catholicité, qui consistera plus tard à réunir tous les peuples dans le culte du même Dieu consiste alors à réunir les cultes de tous les dieux dans une même religion.
Quoiqu'elle réponde, nous le savons (3), à un besoin individuel et non social, partout la religion s'institutionnalise. A Rome elle est institutionnalisée si fortement que la vie intérieure se trouve étouffée par cette armature. Il n'y a quelques croyances vivaces que dans les campagnes; quelques inquiétudes que dans une élite cultivée qui demande à la philosophie grecque de satisfaire sa raison. Mais, à diverses reprises, l'invasion de cultes exaltés, orgiaques, de ce mysticisme oriental si opposé au formalisme romain montrera qu'il existe dans les âmes un vide à remplir.
(1) Ouvrage cité, p. 382.
(2) fustel de coulangbs, la Cité Antique, p. 431 (14" éd.).
(3) Voir t. I, Introduction générale, p. 11
Du caractère primitif de la religion romaine il ressort que connaître pour connaître n'est pas la préoccupation des Romains. Spontanément ils ne cultivent ni là philosophie ni là science» Non seulement ils sont indifférents « à la Vertu Spéculative purement désintéressée que Pythagoriciens et Platoniciens exaltaient dans là recherche mathématique », mais ils « méprisent» là science pure et « Cicéron les loue de ce que, grâce aux dieux, ils ne sont pas comme les Grecs et savent limiter l'étude des mathématiques au domaine dès applications utiles (Tusculanes, 1-, 5) (1) ». Qu'il s'agisse de la nature ou qu'il s'agisse de l'homme, ils n'ont d'attention que pour ce qui servira là vie pratique : // n'y a jamais eu, il ne pouvait y avoir à Rome de milieu scientifique. L'homme toutefois, les intéresse plus que la nature : ils ont acquis en psychologie et en morale des connaissances qui font d'eux les Créateurs des « humanités ». Et voilà pourquoi ils apparaissent non seulement comme organisateurs de la vie sociale, mais — avec les Grecs — comme instituteurs du genre humain.
Ici, de nécessité, la littérature et l'art eux-mêmes devaient être lies à la pratique; et c'est ce que A. Grenier montre avec force. L'esprit positif des Romains leur à fait produire de bonne heure dans la législation, l'éloquence, l'histoire, des œuvres qui par leurs qualités de précision, de vigueur, d'utilité même, —d'utilité accomplie-- prennent un caractère de beauté, mais qui sont militantes et n'ont pas en vue la beauté. Nous rappelons ici là distinction capitale que nous avons établie (2) entre ce qui tend au plaisir esthétique et ce qui le procure sans le chercher — Ou du moins sans avoir pour objet propre de le procurer (3).
// faut pourtant reconnaître dans la satire et le dialogue des germes modestes d'art littéraire.
(1) arnold reymond, Histoire des sciences exactes et naturelles dans l'antiquité gréco-romaine, préface de L. brunschvicg, 1924, pp. VII, 91.
(2) Voir t. XII, l'Art en Grèce, Avant-Propos, p. xxviii.
(3) Artes quœ efficiant ut civitati usui simus, voilà ce que doit apprendre le Romain (cicéron, De Rep. I, 4). — Poesis est un mot grec.
Ces produits du terroir, apparus dans les ébats grossiers de fêtes variées; traduisent le réalisme romain : esprit d'observation, penchant au sarcasme, — qui se manifeste par tant de sobriquets, — aptitude à la riposte. Ce qu'auraient donné ces promesses, indépendamment de l'influence grecque, on ne saurait que le conjecturer.
Il faut constater enfin que sur les beaux-arts, inspires des Etrusques, les Romains ont mis leur marque, aux débuts : c'est le réalisme — ici encore — dans les scènes de là vie et dans le portrait; c'est la préoccupation pratique de fixer l'histoire et ses héros, de constituer un témoignage du passe — utile au présent.
En Grèce, l'utile est beau; en Italie, le beau même est utile.
Mais voici la contre-partie. Dans tout le cours de son livre, A. Grenier montré fortement que ce sens pratiqué était trop avisé, trop curieux même, pour repousser tout ce qui pouvait venir du dehors, et qu'indépendamment des actions subies ou des influences diffuses, il y eût une assimilation consciente, voulue, d'éléments intellectuels empruntés à l'étranger, — surtout à là Grèce et à l'Orient.
Nulle part, dans l’histoire antérieure, on ne pouvait étudier de façon aussi précise et instructive ce phénomène que nous appelons réception. Nous avons observé que le principe logique qui fonde la société et qui explique ses transformations internes préside aussi aux rapports des sociétés et y explique des phénomènes variés: réception, renaissance, coopération répondent diversement a une «volonté de culture» qui, pour les peuples, est une des formée du besoin d'être plus.
La crise qui transforme le génie romain se produit, ou plutôt les crises commencent, quand la civilisation grecque, au lieu de s'infiltrer, pénètre directement et de façon pour ainsi dire massive, et quand elle agît sur l'éducation même de la jeunesse. Ce que la Grèce introduit à Rome, c'est le jeu. Toute l'activité du Romain était utilitaire; péniblement, gravement, il accomplissait sa tâche de paterfamilias, de citoyen et de soldai; ses joies étaient rares et sévères ; il les trouvait surtout dans le devoir accompli et la réussite matérielle. Il apprend à fleurir la vie de jouissances. L'art, la littérature, la spéculation lui offrent tous leurs délices à la fois. Ce qui était divertissement, — au sens chrétien du mot— détournement du devoir, oisiveté, devient besoin.
Mais l'origine de la crise, il ne faut pas la chercher simplement dans l'importation de tout ce que le génie grec a créé. Les causes en sont multiples. Les circonstances générales de la vie romaine se sont modifiées. Des changements politiques et économiques résultent de ces transformations de la structure sociale: empire sans cesse élargi, population de la Ville sans cesse accrue, et qui peu à peu devient de plus en plus hétérogène. A. Grenier a insisté précédemment sur l'apport du paysan latin, sur les vertus et les étroitesses que Rome doit à la glèbe, et montré que, malgré la suprématie habituelle des villes dans toute l’histoire de l'antiquité, la campagne a joué ici un rôle primordial. Il fait voir, maintenant, le rôle de la grande ville que Rome est devenue, l’importance de la plèbe urbaine et, par le commerce, de l’élément étranger, de cet hostis que la masse campagnarde était disposée à mépriser ou à haïr. Dans la cité agrandie, les préoccupations humaines entrent en lutte avec les préoccupations civiques. Les arts inspirés de la Grèce et de l'Orient sont une cause d'évolution morale; mais l'accueil fait à cette inspiration est aussi l'effet des circonstances nouvelles. A. Grenier, avec beaucoup de finesse, a démêlé ces rapports complexes, ces actions réciproques des œuvres et des mœurs dans la poussée de croissance; il a précisé les rôles de la masse et de l'élite, des penseurs, des artistes, de la femme, dans cette évolution psychologique.
Période de vie intense où Rome reçoit de toutes paris et assimile, avant de réagir par un choc en retour de son pragmatisme. — En Italie, comme dans tout le bassin méditerranéen, les beaux-arts se sont hellénisés. La réception grecque a tué l'art italien, comme la renaissance de l'antiquité tuera l'art gothique. Mais ce qu'il y a eu de particulier dans le cas de Rome, — A. Grenier le remarque bien justement, —c'est la possession, sans effort, de beautés étrangères. La richesse romaine fait naître le goût des antiquités, entraîne le faste des collections qui, s'il développe le sens esthétique, favorise l'éclectisme et ne fortifie pas le génie créateur. Sur certaines œuvres, cependant, — statues, médailles, scènes historiques, — Rome continuera à mettre sa forte empreinte.
Pour la littérature, la réception eut des effets moins négatifs. Par les infiltrations italiennes, c'est le grand art de la Grèce, la tragédie, l'épopée, — où Rome pouvait trouver des inspirations assez conformes à son idéal de force morale,—qui d'abord avait pénétré chez elle. Plus tard, à la suite d'un contact direct, les Romains s'éprennent de ce que l'art grec, dans sa décadence raffinée, a de plus subtil : ils y gagnent des qualités d'élégance el d'ingéniosité qui leur étaient étrangères. Mais sous la forme alexandrine s'exprime souvent une ardeur passionnée. L'art pour l’art, le pur dilettantisme répugne à l'âme romaine. Et si de patients efforts assouplissent, enrichissent une langue primitivement pauvre et raide, le latin tirera ses plus heureuses réussites de sa concision, de sa fermeté : son triomphe sera dans le raccourci impératif de la sententia. // vient un moment, d'ailleurs, où s'établit un heureux alliage des qualités grecques et des tendances romaines. On conçoit que le jeu peut servir les fins les plus graves et les plus nobles. Auguste rehausse tous les arts en les employant à la grandeur de Rome. Avec lui, l'Empire prend pleine conscience de son passé et de sa mission ; ce qui inspire les chefs-d'œuvre, c'est la Ville impériale, — la terre, les dieux et les hommes qui l'ont faite.
Mais dans la Ville, ouverte au monde qu'elle domine, dans la mêlée des races, des appétits, des idées, la sensibilité individuelle s'est développée : tourmentée dans l'élite, grossière et violente dans la masse, elle cherchera bientôt, elle trouvera de plus en plus ses plaisirs et ses croyances en dehors de la tradition romaine — comme de l'idéal grec. Malgré la forte armature de l'État et de la religion d'Étal, la crise morale du monde antique se prépare.
Ainsi, longue prédominance de là raison pratique, souplesse d'esprit jointe à la rigidité morale et à l'énergie de la volonté; puis développement de la sensibilité, de l'imagination, du goût; puis équilibre des facultés, bientôt rompu au profit de la sensibilité:voilà ce que fait apparaître A. Grenier dans cette étude nuancée du génie romain.
Les problèmes nettement posés au début — de la formation de ce génie, de ses transformations, des facteurs internes et externes qui les produisent — sont traités avec une remarquable sûreté. Notre collaborateur, pour les résoudre, réalise la synthèse de connaissances proprement historiques et de ces « spécialités » que le « pur » historien souvent ignore ou néglige. On sent chez lui le désir de ne pas faire l'histoire trop simple et de ne pas oublier, en considérant des problèmes abstraits, la complexité de la réalité vivante. Il a de pénétrantes analyses et des portraits saisissants. L'histoire est science, on ne saurait trop le répéter. L'histoire n'est pas un art. Mais l'historien le plus scientifique peut être artiste.
henri berr.
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE La cité romaine et les civilisations italiennes.
chapitre premier. — La fondation de la ville..................
I. Le Latium et les Latins, — II. Les Sabins. — III. Les Etrusques. IV. Le synœcisme romain.
chapitre II. — L'art et la civilisation étrusques à Rome......
I. La civilisation ionienne et l'art étrusque. — II. Les monuments étrusques de Rome : le temple capitolin et la Louve du Capitole. — III. L'introduction de l'écriture à Rome. . — IV. La tradition légendaire étrusco-romaine. — V. Survivances diverses de la période étrusque dans la civilisation romaine. — VI. La population et les noms propres romains.
chapitre III. — Rome et l'Italie..............................
I. La réaction indigène : Latins et Sabins. II. Rome et les Grecs d’Italie. III. La conquête des civilisations italiennes. IV. Le développement artistique à Rome du ve au III 6 siècle. V. La monnaie romaine. VI. Appius Claudius Caecus.
chapitre IV. — L'ancienne religion romaine.................
I. La conception romaine de la divinité et les dieux principaux. II. L'organisation religieuse et les collèges sacerdotaux. III. La religion et les débuts de la littérature.
— conclusion de la première partie : Rome, l'Italie et la Grèce.
DEUXIÈME PARTIE Rome, capitale méditerranée.
chapitre premier. — Les premiers poètes....................
I. Livius Andronicus et Naevius. — II. Ennius. — III. Plaute.
chapitre II. — L'esprit nouveau et l'idéal ancien. Scipion l'Africain et Caton le Censeur. ...........................
I. Scipion l’Africain. — II. Caton le Censeur.
chapitre III. — Les transformations de l'esprit religieux.....
I. L'inquiétude religieuse à Rome pendant la seconde guerre punique.
— II. Les cultes orientaux. La Grande Mère des dieux de Pessinonte.
— III. L'affaire des Bacchanales. La réaction pontificale.
chapitre IV. — Le cercle de Scipion Emilien. Térence et Lucilius...................................................
I. Térence. — II. Lucilius.
chapitre V. — Des Gracques à Lucrèce. L'action et la pensée. -. Le stoïcisme et la révolution sociale. — II. Lucrèce.
chapitre VI. — La science et l'érudition.....................
I. La philosophie et les sciences. — II. L'astronomie et le calendrier romain. — III. La médecine. — IV. Les sciences historiques et philologiques.
chapitre VII. — La technique oratoire. Cicéron et la prose littéraire..................................................
I. L'éloquence et la rhétorique. — II. Les écoles de rhétorique. — III. La prose littéraire.
chapitre VIII. — La poésie, 268. Catulle.
chapitre IX. — L'art grec à Rome............
I. L'invasion des œuvres d'art et des artistes grecs. — II. L'art asiatique. Pergame. — III. Alexandrine. — IV. L'École néo-attique. — V. Les Écoles d'art hellénistiques à Rome. — VI. La peinture. — VII. Les premiers essais d'un art romain. Pasitelès et son école. - VIII. L'autel de Domitius Ahenobarbus. — IX. L'architecture.
conclusion du la seconde PARTIE.
TROISIÈME PARTIE Le siècle d'Auguste.
chapitre premier. — La poésie et les mœurs.................
I. La fin de l’alexandrinisme. — II. Tibulle. — III. Properce. — IV. Ovide.
chapitre II. — Auguste et la réaction nationale. Horace et Virgile....................................................
I. César et Auguste. — 11. Horace. — III. Les Géorgiques. — IV. L'Enéide. — V. Les Jeux séculaires.
chapitre III. — La connaissance et l'idée impériale. La géographie et l'histoire à Rome................................
I. La géographie. — II. La carte d’Agrippa. — III. La Germanie de Tacite. — IV. L'Histoire de Tite-Live.
chapitre IV. — L'Art augustéen.....
I. L'idéal augustéen et l'art officiel. III. L'autel de la Paix.
II. La statue d’Auguste. —
chapitre V. — La religion impériale.........................
I. La religion populaire. — II. La pensée et l'oeuvre religieuse d’Auguste. — III. Le culte de Rome et d’Auguste. — IV. Les effets de la restauration augustéenne.
CONCLUSION
Le Génie romain.............................................
I. Les dieux. II. La Cité. — III. Le Jeu. — IV. La connaissance de l’homme. — V. L'originalité romaine.
LE GÉNIE ROMAIN
PREMIÈRE PARTIE
LA CITÉ ROMAINE ET LES CIVILISATIONS ITALIENNES
CHAPITRE I LA FONDATION DE LA VILLE
J'ignore absolument, en commençant ce travail, ce qu'est le Génie romain et ne me propose pas d'autre objet que d'examiner quelques-uns des aspects successifs de la vie religieuse, intellectuelle et artistique du peuple romain. Cette revue demeurera nécessairement fort incomplète ; elle laissera de côté en particulier toute l'activité juridique qui fait l'objet d'un volume à part de cette collection (1). Peut-être cependant s'en dégagera-t-il en fin de compte quelques idées générales pouvant justifier dans une certaine mesure le titre du livre. Mais que l'on n'attende pas une théorie systématique des facultés ni même du développement romain. Ce n'est pas dans l'abstrait, c'est dans la réalité vivante des œuvres et des hommes que, suivant un plan rigoureusement historique, nous chercherons le Génie de Rome.
(1) Vol. 19 : declaheuil, Rome el l'organisation du droit.
Pour le détail des faits je me permets de renvoyer le lecteur au volume qui précède le mien (1). Sans crainte de double emploi, j'ai cru cependant devoir prendre mon sujet au jour même de la fondation de Rome. Avant de décrire l'épanouissement de la civilisation romaine, ne convient-il pas, en effet, de considérer les racines qui l'ont nourrie et de discerner autant que possible, les couches profondes où en fut puisée la sève ?
Dès son origine, le peuple romain manque d'unité. Il n'est pas une race, pas même un groupement naturel. Nous le voyons se former de la fusion d'éléments ethniques divers, artificiellement réunis suivant une formule politique et religieuse qui leur est étrangère. La matière dont il fut constitué était en majeure partie latine et sabine. Mais les Étrusques lui ont imposé la forme et ont véritablement créé le peuple.
I
le latium et les latins.
Autour de Rome, la campagne étend aujourd'hui, à perte de vue, ses landes désolées. Une herbe maigre, de bonne heure brûlée par le soleil, prête à tout le paysage une teinte grisâtre sur laquelle quelques pins parasols posent ça et là leur tache noire. Les longues files des aqueducs, des buissons d'épines poussant sur des ruines enterrées, parfois une ostérie ou un groupe de maisons avec leurs tonnelles et quelques champs, une charrette légère courant sur une route droite et blanche, animent seules cette solitude (2). L'abandon de l'homme a laissé le désert se créer aux portes d'une capitale.
Les ruines innombrables de la campagne romaine témoignent cependant que cette terre fut autrefois peuplée et florissante (3).
(1) L. homo, LXXXVI.
(2) Sur la géographie de l'Italie et du Latium, en particulier, cf. fischer, LXXIV, et H. nissen, CXV, I, p, 254 sq.; Il, 2, 1902, p. 555 sq.
(3) G. tomassetti, CLX.
Hors des murs de la ville s'alignait tout d'abord, le long des routes, la succession des tombeaux. La plupart de ces monuments sont aujourd'hui détruits ; il n'en subsiste plus guère que ceux qui au moyen âge ont pu servir de forteresse, comme le mausolée célèbre de Cecilia Metella, au bord de la Voie Appienne. Puis venaient les villas de l'aristocratie romaine entourées de parcs aux beaux vergers et aux bosquets ombreux. Plus loin, se rencontrent les ruines de petites villes, comme Gabies, grand souvenir des temps anciens, presque rivale de Rome et, par la suite, modeste municipe suburbain. A chaque pas, le long des anciennes voies, se dresse ainsi un témoin de la vie intense qui, aux temps impériaux, faisait de la campagne un vaste jardin aux portes de la ville (1). Plus anciennement encore, jusque vers le Ier siècle avant notre ère, ces espaces aujourd'hui stériles avaient été les champs qui nourrirent le peuple romain.
La terre, en effet, ne peut en cette région se passer du travail de l'homme. Seul, un labeur intense et âpre, une lutte constante, impose la fécondité à la nature. Le sol est un tuf volcanique friable dont la surface, décomposée par les agents atmosphériques, fournit une mince couche d'humus. La charrue fait l'épaisseur de la couche arable. C'est l'homme qui, véritablement, crée la terre.
Vue de loin et dans son ensemble, la campagne romaine paraît presque parfaitement plane et unie. Au sud de l'Anio, aucun cours d'eau de quelque importance n'y creuse sa vallée. Rares et modestes y sont les éminences que couronne un boqueteau. Le sol, cependant, est extrêmement tourmenté. Là où le travail humain ne l'a pas nivelé, des boursouflures succèdent à des dépressions. Des déchirures se sont fréquemment produites dans le tuf, montrant à nu la couleur rouille du sous-sol.
(1) th. ashby, The classical lopography of thé Roman Campagna, dans XIX, I, sq.
Dans ce chaos, l'eau ne trouve pas d'écoulement naturel ; elle séjourne en flaques dans les creux et, surtout, elle suinte partout au flanc de falaises minuscules. La région est, aujourd'hui encore, malsaine (1). Elle se défend par la fièvre contre les tentatives de colonisation qui, cependant, entament peu à peu sa stérilité. Pour qu'on pût y vivre autrefois, pour que cette terre fût productrice, il fallait que la volonté tenace et sans relâchement d'une population assez nombreuse ait imposé une règle aux eaux en canalisant les plus minces ruisseaux et en drainant toute la surface des champs.
Dominée par l'homme, cette terre d'apparence ingrate devient heureuse. Les établissements humains qui se risquent dans ce désert y font rapidement figure d'oasis. On en peut citer comme exemple l'abbaye de Tre Fonlane à quelques kilomètres au sud de la Porte Saint-Paul. De magnifiques eucalyptus qui absorbent l'humidité du sol et chassent les moustiques porteurs dus germes fébriles abritent les clôtures monacales derrière lesquelles se devine l'ampleur de profonds vergers. Le travail l'emporte sur l'hostilité de la nature.
Pour qu'elle devînt une nourricière que se disputèrent les hommes, la campagne romaine dut tout d'abord bénéficier des efforts colonisateurs de nombreuses générations. Les premiers occupants eurent à la conquérir sur elle-même. Leurs successeurs, durant toute l'antiquité, se trouvèrent contraints de continuer sans relâche leur rude surveillance.
L'une des découvertes archéologiques les plus surprenantes de la fin du sixième siècle a été celle de tout un système de drainage développé sous toute la surface de la campagne romaine et dans la majeure partie du Latium jusqu'aux Marais Pontins. Ces canaux, à vrai dire, étaient connus de tout temps. Bon nombre sont aujourd'hui à ciel ouvert, leur voûte s'étant effondrée.
(1) La malaria semble cependant ne dater, en Italie, que du III éme siècle avant notre ère. Elle serait d'origine africaine et aurait été introduite dans la péninsule par les soldais d'Hannibal. Cette maladie ne serait pas étrangère à la dépression des foules de la Rome impériale et à leurs sursauts de méchanceté. Cf. H. stuart jones, R. Ross,G. Ellet CLIII.
Tous paraissent a voir été creusés en tunnels, au moins dans la partie moyenne et supérieure de leur cours; beaucoup sont encore souterrains, soit en entier, soit dans des portions plus ou moins longues, et leurs regards excitent chez les paysans une curiosité mêlée de peur. Des savants les avaient examinés, des ingénieurs en avaient dessiné quelques relevés ; la destination en demeurait incertain. Un membre de l'Ecole française de Rome, de la Blanchère, y reconnut un travail de canalisation, certainement antique, poursuivi au cours de l'époque romaine, mais dont l'origine semble remonter beaucoup plus haut que la période historique. L'entreprise de ces drainages daterait de la plus ancienne occupation du sol latin (1). Ces étranges galeries,- hautes d'environ lm,50, larges de Om,70à 1 mètre, voûtées mais non maçonnées, taillées à même dans le tuf, s'enfoncent sous terre, en certains points, jusqu'à plus de 15 mètres. Elles ne suivent jamais le fond des vallées, mais sont toujours adossées à l'une des pentes, passant fréquemment de l'une à l'autre, parce que les gens qui les ont creusées se préoccupaient de suivre les veines d'eau du côté où elles se présentaient les plus riches. L'ensemble, croisé, superposé quelquefois en deux étages, ramifié et branchu comme le système veineux d'un mammifère, embrasse toute la région des tufs latins, le bassin inférieur du Tibre, celui de l'Anio et toutes les pentes inférieures des Monts Albains jusqu'aux Marais Pontins. « Tout est fait, remarque de la Blanchère, avec une unité d'ensemble, une sûreté de conception, une justesse d'exécution qui font ressembler ce grand travail à l'œuvre instinctive et parfaite d'une colonie de castors ou d'une république de fourmis... Et je ferai la remarque qu'une telle œuvre ne saurait être le produit d'efforts individuels ; tout s'y tient, tout montre un plan d'ensemble. C'est un travail qui n'a pu être fait que tout à la fois pour chaque bassin général. »
(1) de la blanchère, La malaria de Rome et le drainage antique, dans X, II, 1882, p, 94 sq. ; XXXII.
Privé de tout système naturel d'écoulement, le pays latin, à l'origine, n'était pas habitable. Ce vaste drainage a été fait pour qu'il le devînt. C'est lui qui, à l'époque antique, assainissait la campagne et la maintenait dans un état de fertilité et de salubrité sinon remarquable, du moins suffisant. C'est ce travail, aussi, qui dut fixer au sol et y maintenir la plus ancienne population, celle qui l'avait entrepris et qui, seule, en vertu d'une expérience atavique, était capable de l'entretenir et de le poursuivre. Le bas pays latin demeura, vraisemblablement de tout temps, la propriété des autochtones qui en avaient créé la fertilité. Cette lutte perpétuelle contre la nature, poursuivie durant des millénaires, a formé la race, dure, patiente et attentive, perpétuellement en éveil contre le danger caché, recommençant sans connaître le découragement l'œuvre abîmée par l'orage ou l'accident, soumise, parce que l'intérêt et la vie de chacun en dépendent, à la discipline du groupe social. Si l'homme a fait sa terre, la terre aussi a créé les qualités de ses hommes.
Mais la plaine qui nourrissait le Latium ne le commande pas. La montagne la domine. Du côté de l'est, de tous les points de la campagne romaine, s'aperçoit la masse des Monts Albains fermant l'horizon. C'est sur ces hauteurs que les peuples latins avaient leur centre politique et religieux. La montagne d'Albe est leur Ida. Jupiter y résidait. Chaque année les représentants des trente peuples de la plaine se rendaient à son sanctuaire du haut lieu pour y célébrer la fête fédérale et, en signe de communion, recevaient une part de la chair des victimes. Le dieu national avait donné la suprématie sur tout le peuple à la ville située le plus près de lui. Albe la Longue fut longtemps la capitale du Latium. Elle n'a laissé aucune trace matérielle. Mais, dans la mémoire des hommes, son souvenir survit à sa ruine.
Le contraste est profond entre l'austère nudité de la plaine et l'aspect de la montagne. Volcans éteints, les Monts Albains ont toute la fécondité naturelle des terres; jadis brûlées. La végétation couvre leurs flancs; arbres fruitiers, olivier, vigne encadrent la blancheur des villages. De vastes prairies et des bois couvrent leur sommet. De grands lacs, les lacs d'Albano et de Némi, occupent d'anciens cratères, l'un clair et dégagé, l'autre assombri par les forêts qui l'enserrent. L'eau, bien séparée des terres, s'écoule des sources en frais ruisseaux. Autant la nature est sévère au pied des monts, autant elle se fait accueillante dès qu'on les aborde. La montagne représente le pays heureux du Latium.
Lorsque, du haut des Monts Albains, on contemple l'étendue des terres jusqu'à la mer, on comprend la signification vraie de l'indication conservée par Denys d'Halicarnasse sur le peuplement du pays.
Aussi loin que remonte la mémoire des hommes, le territoire de Rome fut occupé par les Sicules, race barbare et autochtone. Mais plus tard, après de longues guerres, les Sicules furent repoussés par les Aborigenes qui s'emparèrent de tout le territoire entre le Tibre et le Liris. Ils y établirent leurs stations aux points les plus forts et y sont toujours demeurés sans avoirjamais été chassés par d'autres. Il leur est seulement arrivé de changer de nom. Sous le roi Latinus, vers le temps de la guerre de Troie, les Aborigènes, commencèrent à s'appeler Latins. Seize générations plus tard, lorsque Romulus eut fondé Rome, ils prirent le nom de Romains (1).
Les lieux les plus forts et les plus attrayants, les Monts Albains, furent l'acropole d'où ces Aborigènes envahisseurs commandaient aux autochtones de la plaine.
Si les gens du bas pays étaient de patients agriculteurs, les conquérants étaient, ajoute Denys, surtout des pâtres et des brigands. La population du Latium primitif résulte de la fusion de ces deux éléments. Les uns avaient besoin des autres. Les laboureurs de la plaine étaient seuls capables d'en entretenir la fertilité ; les seigneurs de la montagne étaient seuls en mesure de défendre les travailleurs. Les deux régions se complétaient.
(1) dion. halic., I, 9.
Le peuple latin nous apparaît donc comme l'union de la patience paysanne et de l'esprit d'aventure et de violence de pâtres batailleurs.
Un de ces bergers des Monts Albains aurait été, selon la légende, le fondateur de Rome. Mis au ban de sa patrie, Romulus aurait réuni d'autres fugitifs et, aux confins du Latium, sur les bords du Tibre, se serait établi avec eux sur l'un des sommets du Palatin. Cette colline était sans doute un pâturage dès longtemps fréquenté, au moins pendant l'hiver, par les troupeaux d'Albe : elle doit son nom au dieu ou à la déesse des troupeaux, Palès. Elle devint un jour le siège d'un village, modeste colonie de la capitale fédérale de la nation latine.
II
les sabins.
Au nord et à l'est du massif Albain, séparées de lui par la dépression où passe la route qui conduit vers l'Italie du Sud, s'élèvent les montagnes de la Sabine. Les hauteurs de Tivoli continuent, à l'est, le cercle qui terme l'horizon romain. Puis vient le sommet de Palombara sabina; enfin, au nord même de Rome, le Soracte imposant. Au pied de ces montagnes et en arrière d'elles s'étend la Sabine, pays de coteaux accidentés et de Irais vallons, excellente terre de culture qui nourrît de tout temps une forte race de paysans.
Comme les Latin», les Sabins appartenaient à la grande famille des envahisseurs indo-européens. Qu'ils aient été, comme les Latins eux-mêmes, plus ou moins mélangés d'autochtones, qu'ils se soient trouvés en rapports plus ou moins suivis avec les peuples de la côte adriatique et, par eux, contaminés d'influences balkaniques, peu importe (1). Ce que
(1) Sur les Sabins, cf. A. PiGASiOL, CX.XX, particulièrement p. 33 sq. M. Piganiol attribue aux Sabins une origine illyrienne qui ne paraît pas confirmée par ce que l'on sait de leur langue.
l'on sait de leur parler en fait des cousins des Latins et des frères des Samnites, qui portent d'ailleurs le même nom qu'eux : Safini. Le dialecte de tous ces peuples, que les Grecs de Campanie désignaient du nom commun et impropre d’Osques, tient le milieu entre le latin, le plus ancien, semble-t-il, des parlers italiques de la Péninsule, et l'ombrien, le plus récent (1).
Comme les bergers d'Albe, ceux de la Sabine devaient, pendant l'hiver, venir chercher en plaine des pâturages pour leurs troupeaux. La tradition mentionne des habitants de Cures en Sabine qui auraient eu un établissement sur l'une des collines voisines du Tibre, le Quirinal, ainsi nommé en souvenir de leur patrie. Les Sabins se trouvaient ainsi tout voisins des Latins du Palatin. Une dépression marécageuse parcourue par un petit ruisseau les séparait; c'était celle qui fut plus tard le Forum. Le lacus Curtius y conservait le souvenir du marais primitif. Quant au ruisseau, il fut capté plus tard par la Cloaca Maxima, canal de drainage analogue à ceux de toute la campagne latine. C'est là que la légende place les combats épiques entre les Romains de Romulus et les Sabins de Tatius. Il ne s'agissait, fort probablement, que de querelles de pâtres pour des bêtes volées ou quelque enlèvement de femmes.
En face des Latins du Palatin, les Sabins du Quirinal paraissent représenter un élément d'ordre et de régularité. Les premiers ne seraient que des fugitifs, un ramassis de forbans ayant rompu tout lien avec leur peuple, sans autre tradition que celles qu'ils se créaient à eux-mêmes. Les autres apportaient sur le Quirinal le souvenir et les cultes de leur patrie sabine. Ils étaient le populus Quiritium, les fidèles de Mars sabin. Ils avaient leurs coutumes et leurs lois. C'est ce contraste que symbolise l'opposition entre Romulus et Numa, l'un exclusivement guerrier, l'autre prêtre des dieux, inspiré par Egérie et sage législateur du peuple.
(1) Cf. J. vbndryes, La place du latin parmi les langues indo-européennes, XXIV, 2, p. 90-103.
Avec lui, semble-t-il, une communauté équitable réunit les deux villages d'origine diverse. Les voisins devenaient frères.
Des villages même fraternellement unis ne font cependant pas une cité (1). Entre l'établissement de Romulus sur le Palatin, l'union avec les Sabins de Tatius et l'existence de Rome, il faut admettre une série de faits nouveaux dont la légende ne nous a conservé qu'un souvenir confus mais qui semble correspondre à la prise de possession de l'emplacement de Rome par les Etrusques et à la fondation de la ville suivant les rites de l'Etrurie. Cette fondation est la véritable origine de Rome.
III
les étrusques.
Autour de Rome, nous trouvons les Etrusques installés dès le VIIIème siècle à Caere (Cervetri), port actif et ancien, fondé jadis, nous dit-on, par les Pélasges, et à Veies, entre la mer et le Tibre. Un peu au nord, dominant le Tibre, ils occupent Faléries et Narcé. A l'est de Rome, sur la bordure des montagnes sabines, Préncale (Palestrina) apparaît soumise à leur influence. Dans les monts Albaius, Tusculum, comme l'indique son nom, est une fondation étrusque. Il en est de même de Velletri au sud des montagnes. A la fin du VIIIème siècle l'Etrurie enserre le Latium de toute part et, par le Janicule, touche Rome.
C'est à Rome même que la route unissant l'Italie du centre à celle du sud franchit le Tibre (.2).
(1) Sur l'emplacement des anciens villages romains, cf. homo, LX.XXVI, chap II §2.
(2) Sur l'importance du pont du Tibre, dans tout 1e cours de l'histoire de Rome jusqu'aux temps modernes, on lira avec intérêt le brillant article de M. V. BERARD : Rome intangible, dans la Revue de Paris, oct. 1903; particulièrement p. 887-888.
Les relations entre les Étrusques et l'Italie méridionale animèrent bientôt ce passage d'une circulation de plus en plus intense. La voie de mer, le long des côtes fut, sans aucun doute, la première fréquentée. Elle demeura en usage pour les marchandises pondéreuses. Les minerais, les lingots de métal, les céréales de l'Etrurie durent, de tout temps, voyager par eau ; les bateaux pouvaient charger, comme fret de retour, les grands vases remplis de vin ou d'huile qui abondent à Caeré dès le début du VIIe siècle. Mais pour les objets de peu de poids et de grande valeur, bronzes laminés, bijoux ou autres, il y avait tout avantage à éviter les risques nombreux et divers de la mer (1). Bien des caravanes étrusques durent donc s'acheminer par terre et se présenter au pont du Tibre.
Le pont Sublicius, le premier et longtemps le seul des ponts de Rome, en vint ainsi à jouer un rôle capital dans la vie italienne. On sait le caractère sacré que lui conserva l'âge classique. Construit en bois, il n'admettait aucun clou de fer; on ne devait, même pour le réparer, employer aucun instrument de métal. Ces survivances de temps très anciens paraissent lui attribuer une antiquité supérieure à celle de Rome et des Etrusques eux-mêmes. Mais son importance date de l'époque qui développa le commerce. Autour de lui, sur la rive gauche du fleuve, durent s'établir des gîtes d'étape, des caravansérails, des dépôts de marchandises, tous les menus négoces et les petites industries qui vivent du roulage. L'emplacement de Rome devenait ainsi une tête de pont commerciale de l'Etrurie.
Du haut de leurs villages, au sommet des collines romaines, les indigènes, agriculteurs ou bergers, durent s'intéresser peu à peu à ce mouvement qui se déroulait à leurs pieds et pouvait contribuer à les enrichir. Puis, à mesure qu'elle s'intensifiait, la vie commerciale prit la prépondérance jusque chez eux. Des rives du fleuve, l'influence étrusque gagnait peu à peu les hauteurs.
(1) L«s pirates d'Antium ont eu longtemps fâcheuse réputation. Le cap Circé l'a toujours conservée.
Un jour vint où l'élément étranger se sentit assez puissant pour commander. Il transforma les agglomérations de hasard constituées sur les collines en une ville régulière soumise à son autorité. Il en fit une cité calquée sur le modèle des siennes.
IV
le synoecisme romain.
La fondation des villes marque, dans la civilisation antique, un moment capital. La cité a dominé toute la vie sociale et politique, on peut même dire, jusqu'à un certain point, la vie intellectuelle et morale de l'antiquité. Sa civilisation a été une civilisation urbaine. L'âge classique commence au moment où apparaissent les villes ; le monde antique meurt lorsque les invasions barbares les ruinent et donnent la prépondérance aux campagnes.
Une ville, dans l'antiquité, n'est pas une agglomération de hasard ou qu'ont déterminée seulement des circonstances topographiques et des conditions matérielles. Elle naît, en un jour, d'un acte de volonté précis, d'une pensée à la fois politique et religieuse. Cette pensée en fixe la forme, elle règle tous les traits de son organisation, elle s'exerce de façon profonde et constante sur les habitants de la cité. La vie de la cité est leur vie, sa puissance fait leur prospérité et cette idée s'impose à eux dans les moindres détails de l'existence. Le citoyen tient de la ville et de ses dieux tous ses droits, il leur doit en retour toute son existence. Comme la ville dresse son acropole au-dessus des campagnes, comme elle se trouve séparée par ses murailles du territoire environnant, de même le citoyen se trouve séparé des non-citoyens et élevé au-dessus d'eux. Nulle part ce sentiment n'apparaît plus puissant qu'à Rome ; il occupe dans l'âme du Romain une place éminente qui fait l'ardeur mais aussi l'orgueil et l'étroitesse de son patriotisme. D'où lui vient cette conception si fortement caractérisée de l'organisation politique et sociale?
Les Grecs ont connu eux aussi le régime de la cité. Fustel de Coulanges a décrit le processus normal de sa formation (1). A l'origine, montre-t-il, la plupart des villes furent habitées par bourgs séparés et certaines d'entre elles, Sparte, Delphes, par exemple, en sont toujours demeurées à ce stade primitif. Mais d'autres, comme Athènes, prirent soin de réunir dans une acropole commune les divinités protectrices des bourgades anciennes et de faire de cette citadelle le centre d'une agglomération d'un type nouveau. Autour du sanctuaire commun, les villages jadis indépendants ne furent plus que les quartiers d'un même tout obéissant à la même loi. L'acte qui créait ainsi la ville s'appelait le synœcisme.
Sur les côtes de Sicile et de l'Italie méridionale, les colonies grecques, dès la fin du VIIIe siècle et surtout au cours du VII6 siècle, introduisirent la forme urbaine. Mais à la même époque, peut-être même un peu antérieurement et en tout cas hors du cercle de leur influence, dans l'Italie centrale occupée par les Etrusques, nous voyons se constituer des cités. La plupart semblent résulter d'un groupement de villages primitifs autour d'une acropole nouvelle et à l'intérieur d'une enceinte commune (2). Est-ce là un type d'établissement italique dont on devrait reconnaître les premiers exemples dès l'âge du bronze dans les stations sur pilotis en terre ferme de la plaine de Pô? Nous n'en croyons rien. Comme la tradition romaine, qui a conservé intacts jusqu'à l'époque impériale les vieux rites de fondation des villes, les prétend empruntés aux Etrusques,
(1) LXXVIII, 3, 3, p. 157.
(2) Les cimetières primitifs relevant de ces anciens villages se trouvent dispersés parfois à assez grande distance du centre postérieur. La topographie de Corneto-Tarquinies et de ses nécropoles est typique à cet égard. Cf. von duhn, CLXXII, p. 310-312.
nous préférons reconnaître dans la forme urbaine le type même de la civilisation introduite en Italie par les Étrusques (1). Ces rescapés des vieux empires orientaux de l'Asie antérieure et les Grecs de la période ionienne auraient, indépendamment les uns des autres et avec des variantes notables, emprunté la conception de la ville aux traditions asiatiques. C'est bien suivant le rite étrusque que fut fondée Rome.
Suivons le récit que, d'après Denys d'Halicarnasse et Plutarque, Fustel de Coulanges fait de la cérémonie (2). Après avoir purifié le peuple en le faisant sauter à travers la flamme légère d'un feu de broussailles, le héros fondateur vêtu de la lourde chape brodée que nous montrent les peintures étrusques, tenant en main le lituus, bâton à crosse recourbée, insigne de ses fonctions sacerdotales, a consulté les dieux. Debout au sommet de l'une des collines, il a observé le vol des oiseaux. Les augures ont été favorables ; les dieux approuvent son dessein. Au milieu du silence religieux de ses compagnons, il a accompli les sacrifices aux dieux du ciel, à ceux de la terre et de l'eau et à ceux du sous-sol, consacrant l'acropole où vont désormais résider les divinités protectrices de la cité. Cette acropole, à Rome, ce n'est ni la colline latine du Palatin ni la colline sabine du Quirinal; c'est le Capitole. Les dieux qui y règnent ne sont ni les dieux latins ni les dieux sabins ; c'est la triade étrusque, Jupiter trônant entre Junon et Minerve. Les Étrusques, nous apprend la tradition, ne considéraient une ville comme régulièrement fondée que si elle possédait les trois temples de Jupiter, de Junon et de Minerve (3). Le Capitole avec son temple à triple demeure est donc bien une acropole étrusque.
(1) nissen, CXVI, p. 79-108; thulin, CLVIII, 3, p. 3-41; greniei LXXXI, p. 91 sq.
(2) LXXVIII, 3, 4, p. 151 sq.
(3) serv., ad Aen., 1, 422. Cf. mueller-deecke, CXIV, 2, p. 150.
Du haut de leur acropole, les dieux à qui est confiée la garde de la ville doivent pouvoir contempler tout leur domaine, et
l'enceinte sacrée des remparts, et le fleuve au fond de la vallée, et la plaine jusqu'aux montagnes (1). Sous l'œil des dieux, le fondateur va donc déterminer le périmètre de la ville et séparer rigoureusement son sol de la terre étrangère. Il attelle d'une vache et d'un taureau blancs, la vache étant placée du côté de l'intérieur de la ville, la charrue au soc de bronze et, la tête voilée, récitant des formules, suivi de ses compagnons silencieux, il trace le sillon primordial. A mesure que le soc soulève les mottes, on les rejette soigneusement à l'intérieur de l'enceinte pour qu'aucune parcelle de cette terre sacrée ne reste hors du pomœrium. Le sillon est interrompu à l'emplacement marqué pour les portes, car nul ne devra oser le franchir, nul ne pourra toucher aux murailles qui lui succéderont; pour les réparer, il faudra des sacrifices expiatoires et la permission expresse des dieux.
De l'emplacement ainsi délimité, le fondateur a pris possession au nom des dieux. Il l'a consacré en orientant suivant les points cardinaux les artères principales de la ville future. A cet effet il a planté vers le point central la baguette dont la première ombre, au lever du soleil, doit donner la direction exacte delà voie est-ouest, du decumanus. Avec le lituus il a tracé sur le sol une ligne parallèle au cours du soleil, puis une perpendiculaire, qui a donné la ligne cardinale parallèle à l'axe nord-sud du firmament. La découverte récente d'un membre de l'Ecole française de Rome, M. A. Piganiol, a reconnu au Forum, parmi le chaos des fondations superposées, les traces de ce decumanus et de ce cardo primitifs. Le decumanus partait, à l'ouest, du temple de Saturne au pied du Capitale ; traversant la basilique de Constantin, il aboutissait, à l'est, au Tigillum sororium, cet arc d'expiation légendaire sous lequel on avait fait passer Horace vainqueur des Curiaces mais meurtrier de sa sœur. Le cardo prenait son origine, au nord, à la Porta Janualis, dans le voisinage du Forum de Nerva, et venait finir à la Porta Romanula, au pied du Palatin.
(1)Vitruv., de Arch., 1, 7 ; 4, 5.
Les deux voies se croisaient a l'emplacement marqué plus tard par le mystérieux puteal Libonis, tout près du temple de Vesta (1). C'est en ce point qu'avait été plantée la baguette d'orientation du fondateur. Les trois portes correspondent bien au chiffre fixé par le rituel étrusque (2).
La consécration du sol par l'orientation représente une idée spécifiquement étrusque, parallèle à celle qui inspire l'haruspicine, c'est-à-dire la lecture des volontés des dieux dans les entrailles des animaux immolés. En voici la substance.
La consécration en général est censée imprimer matériellement l'image de la pensée divine dans la chose consacrée. La victime, au moment du sacrifice, porte ainsi dans la partie la plus sensible de son corps, dans ses entrailles et particulièrement dans son foie, l'ordre et comme la figure de l'univers. L'haruspice qui sait l'y apercevoir peut donc, d'après l'état des organes, découvrir la volonté des dieux et donner aux hommes d'utiles conseils. De même la cité, séjour des dieux et espace de terre qui leur est consacré, doit reproduire dans ses traits essentiels le plan divin du monde (3).
Ce plan apparaît, clairement manifesté aux yeux des hommes, dans le cours du soleil et par les quatre points cardinaux. Séjour des dieux, comme le ciel, la terre consacrée devait donc elle aussi être divisée en quatre régions. Toutes ces doctrines, l'haruspicine comme l'orientation, viennent aux Etrusques du plus ancien Orient. On connaît la formule babylonienne exprimant emphatiquement la puissance du souverain: roi des quatre régions.
(1)A. piganiol, Les origines du Forum, dans X, 38, 1908, p. 233-282; cf. CXXX, p. 298,
(2)Serv.. ad Aen., I, 422. Cf. mueller-.deecke:, CX1V, 2. p. 43. Les Etrusques exigeaient dans une fondation régulière trois temples et trois portes.
(3) G. Blecher, XXXII; G. thullin, CLX et CLVIII.
Babylone, d'après la description d'Hérodote, était divisée en quatre régions par deux grandes voies rectilignes (1). A l'époque impériale, le culte des quatre vents est un apport des religions orientales. En Etrurie, l'orientation suivant les points cardinaux se reconnaît au moins dans les villes neuves créées de toutes pièces par les Etrusques (2) ; dans les autres, elle doit se trouver cachée comme elle l'était à Rome, en quelque point particulier de la cité. A l'époque classique, l'établissement du decumanus, voie principale courant de l'est à l'ouest à travers la cité et son territoire, et du cardo, voie nord-sud, reste le principe de tout arpentage; il est le premier acte de l'établissement d'un camp militaire ou d'une colonie (3).
Un autre rite d'origine étrusque et orientale se trouve encore mentionné à l'occasion de la fondation de Rome ; c'est l'aménagement du mundus. Romulus, dit Fustel de Coulanges, creuse une petite fosse de forme circulaire ; il y jette une motte de terre qu'il a apportée de la ville d'Albe. A son exemple, chacun de ses compagnons vient y jeter un peu de terre apportée de son pays d'origine, « pour que chacun pût dire en montrant la place nouvelle adoptée par le fondateur : ceci encore est la terre de mes pères : terra patrum, patria, ici est ma patrie car ici sont les mânes de ma famille ». Le mundus, en réalité, est une bouche d'enfer, une communication établie entre la surface du sol, séjour des vivants, et le monde souterrain, demeure des morts. En l'ouvrant, le fondateur appelle la foule des mânes ancestraux et tous les esprits quels qu'ils soient qui occupent le sous-sol à reconnaître la ville qui s'installe, il leur demande leur agrément et cherche leur bienveillance pour sa création. Dans la suite, le mundus est ouvert chaque année à certains jours : mundus patet, jours néfastes durant lesquels les mânes invisibles des hommes qui ont autrefois vécu et qui reposent dans le sol se répandent parmi les vivants ; les portes des maisons doivent rester ouvertes afin
(1) herodote, 1,180.
(2) grenier, LXXXI, p. 95, 112.
(3) nissen, CXVI.
qu'ils puissent entrer et se réchauffer aux foyers ; il faut se garder de les irriter, puis à la fin du jour les morts regagnent leur demeure souterraine et le mundus est fermé à nouveau (1).
Certaines peintures de tombes étrusques (2) et de nombreux vases peints de même provenance nous offrent des représentations du mundus. C'est un puits dont on voit parfois sortir une forme humaine à tête de loup et aux mains crochues figure du dieu étrusque de la mort, qui se saisit d'un vivant. On croit pouvoir reconnaître des mundus dans certains puits voûtés en forme d'entonnoir renversé trouvés dans quelques villes étrusques (3). « Autant que je puis savoir par ceux ont pénétré dans un mundus, disait Caton, la construction en rappelle la voûte du ciel qui est au-dessus de nous. » Italie, on verse dans le mundus le sang des victimes, car les morts sont avides du sang qui leur infuse un semblant de vie, on exécute devant leur bouche des danses pour réjouir les mânes, en prenant soin, à l'aide d'une ombrelle, que le soleil ne pénètre pas dans leur sombre séjour; on y entasse comme offrande des fragments de métaux précieux (5). Ainsi, de nos jours, nous avons conservé l'habitude d'insérer quelque monnaie dans les fondations de nos édifices, survivance incomprise des offrandes propitiatoires aux esprits infernaux du mundus. Ces rites, en partie au moins, viennent de l'Orient. Une inscription chaldéenne de Khorsabad, relatant la fondation du palais de Sargon, mentionne qu'à la base du futur édifice « le peuple jette ses amulettes » (6).
Tous les dieux ainsi évoqués et pris à témoins, la triade capitoline contemplant du haut de son acropole les habitations
(1) macrob., d'après varron, Sat., 1, 16, 18; festus, 154, 157.
(2) Tombe Stackelberg; à Corneto.
(3) Par exemple à Marzabotto dans l'Apennin, non loin de Bolo grenier, LXXXI, p, 102.
(4) Ap. festus, 157.
(5) tac., Hist., 4, 53.
(6) thulin, CLVIII, p. 9.
et l'enceinte dont la garde lui était confiée, les mânes infernaux répandus en foule hors du mundus béant, le plan intérieur tracé conformément au plan divin du monde, le territoire de la ville séparé du pays environnant par la coupure nette du sillon, la cité se trouvait régulièrement fondée. Elle était un organisme complet et une chose sainte. L'accomplissement des rites lui conterait la vie et le droit de commander aux hommes. Les hasards confus des temps anciens étaient périmés, un âge nouveau commençait sous les auspices d'une civilisation nouvelle.
La date, au moins approximative, de cet événement capital nous est fournie par le sol même du Forum, Le synœcisme fut marqué, nous l'avons vu, par l'occupation de cette dépression, primitivement marécageuse, qui formait le centre des principales collines : Capitole, Palatin et Quirinal. Jusque-là, elle avait servi de cimetière aux villageois des hauteurs voisines. Le moment où le Forum cessa d'être une nécropole correspond évidemment à son inauguration comme centre de la ville.
Les tombes primitives, découvertes au Forum dans les dernières années du xixe siècle devant le temple d'Antonin et de Faustine (1), se classent en deux groupes chronologiquement bien distincts. Les plus anciennes contiennent des cendres enfermées dans un ossuaire de terre grossière. Le mobilier funéraire se compose de un ou deux petits vases de fabrication locale et de quelques fragments de bronze. La poterie, analogue à celle des Monts Albains et des plus anciennes tombes à puits de Toscane, date des Xe et VIIIe siècles avant notre ère. Ces premières sépultures marquent le début de l'occupation des collines romaines. Le second groupe est caractérisé par des fosses plus vastes contenant les restes de cadavres inhumés.
(1) G. pinza, X.IV, 15 (,1905)) col. 274 sq. La necropoli dell ‘Argileto.
Les squelettes sont parfois enfermés dans un cercueil rudimentaire formé des deux moitiés évidées d'un tronc de chêne. Ce mode de sépulture est plus récent que le premier. Il est daté par la présence de quelques vases d'importation grecque appartenant aux séries anciennes, géométriques et protocorinthiennes. Les dernières tombes du Forum sont donc postérieures au début, de la colonisation grecque en Italie et des relations commerciales entre la Campanie et l'Etrurie. Elles ne sauraient remonter au delà du VIIesiècle; elles datent même plutôt de la seconde que de la première moitié de ce siècle.
En fixant à l'an 754, exactement au 21 avril de cette année, la fondation de Rome, la chronologie traditionnelle est donc en retard ou en avance. Elle est certainement en retard d'au moins un siècle s'il s'agit de l'établissement du village du Palatin et en avance d'à peu près autant si elle entendait dater le synœcisme des villages romains. S'il est dans l'histoire romaine une date qui puisse concorder à peu près avec cet événement, c'est celle de 614 à laquelle la tradition place l'arrivée à Rome de l'Étrusque Tarquin, fils de Démarate Corinthien. Mais il est vain de demander à la légende des précisions de ce genre.
L'occupation des collines romaines par de petits groupes de bannis, de bergers ou de cultivateurs, ne représente en somme qu'un épisode médiocrement significatif de la préhistoire italienne. Le fait important, celui qui marque vraiment le début d'une ère nouvelle c'est l'apparition sur ces collines d'une cité conforme au type que le progrès général multiplie à ce même moment sur tous les rivages de la Méditerranée.
Des rites religieux constitués, entre autres éléments, d'idées empruntées aux plus anciennes traditions de l'Orient consacrent sa fondation. Une pensée politique étrangère, l'expansion étrusque, groupe les forces ethniques indigènes et les organise. Les conditions économiques, le développement de la richesse italienne par l'industrie et le grand commerce, prêtent au pont du Tibre une importance qui ne fera que croître. Les citoyens de la ville nouvelle se trouvent ainsi arrachés à l'isolement des temps anciens; un horizon plus large s'ouvre à leurs yeux; ils vont être amenés à prendre conscience d'eux-mêmes et à se mêler de façon de plus en plus active à la vie et au mouvement de la civilisation dans toute la péninsule.
La synœcisme des villages, c'est véritablement l'éclosion du peuple romain et comme le premier chaînon de la tradition religieuse, politique et intellectuelle qui va se poursuivre désormais jusqu'à la fin des temps antiques. Le jour où la triade étrusque fut installée au Capitole, où le Forum fut marqué par l'orientation de ses artères comme le centre sacré de la ville, où, suivant un plan méthodique, fut tracée la première enceinte, où des cérémonies solennelles sanctionnèrent pour les dieux et les hommes l'image raisonnée et voulue d'une cité, ce jour-là fut vraiment celui de la naissance de Rome; il marque l'origine du développement et du génie romain.
CHAPITRE II
L'ART ET LA CIVILISATION ÉTRUSQUES A ROME
I
la CIVILISATION IONIENNE ET L'ART ÉTRUSQUE.
Le VIème siècle avant notre ère est l'époque du plein développement de la civilisation ionienne. En Asie Mineure et dans les îles de la mer Egée, de grandes villes, enrichies par le commerce et l'industrie, donnent aux arts, aux lettres et aux sciences un essor qui marque le début du rayonnement grec (1). En Occident, l'éclat de la civilisation étrusque reflète la lumière qui vient d'Ionie. De grandes villes industrielles et commerçantes emploient leur richesse à embellir la vie. L'architecture, la sculpture, la peinture, la ciselure et les bijoux, les beaux vases de terre ou de bronze, les parfums, le vin, les riches vêtements, les jeux, la musique, transforment, en Italie, la rudesse indigène. Les vaisseaux ioniens fréquentent les ports étrusques, comme les marins étrusques, commerçants et pirates, sillonnent les mers d'Ionie (2). Les produits importés se mêlent en Etrurie aux fabrications indigènes, si bien qu'il est la plupart du temps difficile de distinguer les uns des au très. D'ailleurs des artistes grecs viennent couramment s'installer chez les Étrusques et travailler pour eux, chez eux (3).
(1) A. Jardé, LXXX.VII, p. 233 sq. P. ducati, LXV, p. 138 sq.
(2) MUELLER-DEBCKE, CXIV 1, p. 27l Sq.
(3) kortE, art. Etrusker, CXXVII, p. 745. plin,, N.h-, XXXV, 152,
Plus lourde, moins délicate et de moindre envergure, sans doute, que la civilisation ionienne, celle de l'Étrurie à cette époque apparaît tout aussi riche et peut-être encore plus luxuriante. Jamais peut-être l'Italie n'a ressemblé d'aussi près à la Grèce.
Rome est à ce moment une grande ville, fondée par les Étrusques et gouvernée, en tout cas, par des tyrans étrusques. Si l'on en croit ses historiens, c'est durant cette période, la période royale, qu'auraient été fixées ses lois civiles, militaires et religieuses; c'est à ce temps que remonterait l'origine de la prépondérance romaine dans le Latium. Dans ces traditions, il est difficile, faute de documents, de faire la part de la vérité et celle des exagérations dues à l'orgueil d'une antiquité vénérable. Contentons-nous de noter ici quelques-unes des traces que cette ancienne domination des Etrusques a laissées à Rome.
II
LES MONUMENTS ÉTRUSQUES DE ROME : LE TEMPLE CAPITOLIN ET LA. LOUVE DU CAPITOLE.
La civilisation des grandes villes d'Étrurie nous est révélée surtout par les tombes disséminées autour de leur emplacement. A Rome, les sépultures pouvant se rapporter à la période royale font entièrement défaut. Divers cimetières ont été explorés sur les pentes extérieures de plusieurs collines romaines, à l'est de l'Esquilin, au nord-est du Quirinal, sur le versant sud-ouest du Caelius et jusque dans la vallée Murcia, entre le Palatin et l'Aventin (1). Aucun ne comble la lacune séparant les modestes puits archaïques antérieurs à l'histoire, des inhumations du IVème ou du IIIème siècle avant notre ère. Les agrandissements successifs de Rome ont sans doute fait disparaître, dès l'antiquité, les plus encombrantes parmi les sépultures qui entouraient la ville, c'est-à-dire, précisément, les tumuli et les chambres funéraires de type étrusque.
(1) G.Pinza, XIV 15, col. 265.
Parmi les monuments d'architecture civile ou religieuse pouvant remonter à cette période, la plupart ont naturellement disparu. Ceux qui ont été conservés et que la tradition attribuait aux rois ont été tellement remaniés qu'ils sont devenus méconnaissables et que la critique y trouve d'excellentes raisons de les rapporter à des époques beaucoup moins anciennes. On discute, par exemple, sur ce que pouvait être primitivement le Tullianum, au pied du Capitole, cette prison utilisée dès l'ancienne république, dont le moyen âge fit la prison Mamertine et qui aurait été construite, comme l'indiquait son nom, par le roi Servius Tullius (1). La Cloaca Maxima qui captait le ruisseau stagnant de la vallée du Forum doit remonter évidemment à la première occupation de cet emplacement. Elle représente un de ces travaux de drainage que les anciens Latins avaient multipliés dans tout le pays. Mais ce que l'on en voit aujourd'hui ne saurait remonter plus haut que le début de l'empire (2). Sa voûte à berceau tournant est l'œuvre des ingénieurs, non de Tarquin, mais fort probablement d'Agrippa qui refit la plupart des égouts de l'ancienne Rome.
Il est cependant un monument qui conserva, jusqu'à la fin de l'époque classique, le souvenir de l'architecture étrusque. C'était le temple principal de la cité, celui de la Triade Capitoline (3). Plusieurs fois reconstruit à l'époque historique, il l'avait toujours été sur le plan ancien, car les dieux ne permettaient pas que l'on transformât les lieux dont ils avaient l'habitude (4).
(1) H. thédenat, CLVI, p. 107 sq. G. pinza III, 1902, p. 37-45.
(2) C. huelsen, XIII, 1902, p. 42-44. XVII, 13, 1904, p. 28-29.
(3) saglio, art. Capilolium, LVI. mahtha, CIV, 269 sq. E. rodocanachi, CXXXIX, p. xxvi sq.
(4) homo, LXXXV, p. 173 sq. ; cf. la bibliographie dans kiepert, huelsen, Format Vrbis Romae, s. v, Capitolium. Le temple s'élevait sur un haut soubassement mesurant huit plèthres (236 mètres) de pourtour et environ deux cents pieds (60 mètres) de côté ; la différence entre la longueur et la largeur était insignifiante et n'atteignait pas quinze pieds (4°,50). La façade tournée vers le midi présente une triple rangea de colonnes; les côtés sont entourés d’une rangée de colonnes. L'intérieur est divisé en trois sanctuaires parallèles accolés ; au milieu se trouve celui de Jupiter, et de chaque côté celui de Junon et de Minerve; tous trois se trouvent sous le même faite et sont couverts par le même toit.
Après l'incendie du temps de Sylla, le marbre avait remplacé le bois. Plus tard, sous Vespasien, les augures n’autorisent l'empereur qu'à en augmenter la hauteur. Les descriptions que nous en possédons permettent d'ailleurs d'y reconnaître aisément un monument étrusque.
 ---à Plan du temple étrusque du Capitole.
---à Plan du temple étrusque du Capitole.
La tradition romaine s'accordait à en attribuer la construction à Tarquin le Superbe. « II fît venir, dit T. Live, des artisans de toute l'Étrurie (1). (1)» C'est à l'affluence de ces ouvriers étrusques que l'on attribua l'origine du nom de vicus tuscus, la rue d'Étrurie, que conserve le quartier au pied du Capitole. Les indications les plus précises sur l'œuvre de Tarquin nous sont fournies par Denys d'Halicarnasse (2), contemporain d'Auguste.
(1) Ti. LiV. I, 56.
(2) dion, halic, IV, 61.
On retrouve clairement, dans cette description, les traits essentiels du temple étrusque tels qu'ils sont fixés dans la théorie qu'en donne Vitruve (1) et que nous les présentent les fondations de plusieurs temples fouillés en Étrurie (2).
L'emplacement réservé au temple, dit Vitruve, aura ses côtés dans les proportions de six pour la longueur sur cinq pour la largeur. La longueur sera divisée en deux ; la moitié postérieure sera réservée aux cellae, la moitié antérieure étant occupée par une colonnade. La largeur sera divisée en dix : trois dixièmes, à droite et à gauche, seront occupés par les cellae secondaires, et quatre dixièmes par la cella centrale (3).
Ce sont en effet des dispositions de ce genre que l'on reconnaît à Florence, à Marzabotto, à Fiesole, à Orvieto, à Cività Castellana (Faleri veleres), et à Cività Lavinia (4).

Ce plan semble avoir prévalu, à une époque ancienne, en Toscane et dans le Latium soumis à l'influence étrusque.
Le terre-plein sur lequel s'élevait le temple étrusque était bordé d'un mur de pierres sèches. En pierre également étaient les fondations et probablement les parois des cellae. Mais la majeure partie de la construction était de bois. Les colonnes et toute la charpente n'étaient que du bois revêtu, il est vrai, et protégé de plaques de terre cuite ornées de motifs décoratifs et peintes de couleurs voyantes (5). Les temples grecs jusque vers le milieu du VIe siècle n'avaient pas été construits autrement. Le vieux sanctuaire de Hera à Olympie était un temple de bois. Jusqu'à l'époque classique des provinces demeurées rustiques, comme l'Étolie (6), avaient conservé ce mode d'architecture primitif.
(1) vitruv., IV, 7. Cf. martha, CIV, p. 269 sq.
(2) A. grenier, LXXXI, p. 104 sq. — (3) De Arch., IV, 7.
(4) P. ducati, Contributo allo studio dell'arce entrusca ica rti Marzabotlo, dans Alti e Mem, R. Deput. Storia Patria per le Romagne, 13, 1923, p. 18 sq. (du tirage à part). — Le temple de Segni (Signia) présente bien les trois cellae, mais il est beaucoup plus long que large. Cf. delbrxjkck, LIX, pi. IV.
(5) 3. durm, LXVHI, p. 75 sq.
(6 )Temple de Thermos, sanctuaire de la Ligue étolienne.
--- Elévation d’un temple étrusque.
Comme elles, l'Etrurie est demeurée longtemps fidèle aux matériaux employés par les premiers architectes ioniens (1).
Le temple capitolin était ainsi décoré de terres cuites. Pour leur exécution, Tarquin s'était adressé à Véies, qui était à ce moment, dit Pline, probablement d'après Varron, le centre le plus florissant de cet art. Il avait fait venir un artiste nommé Vulca à qui il avait commandé la statue de culte (2). Le Jupiter du Capitole était en effet primitivement en terre cuite ; comme toutes les statues de terre cuite, il était polychrome et, conformément à la convention de l'art grec archaïque, les chairs et la face notamment étaient peintes en rouge (3). Il tenait d'une main le sceptre et, de l'autre, un foudre :
(1) Sur les décorations en terre cuite de l'architecture primitive en Asie Mineure, en Grèce et dans les Iles, cf. herbert-koch, Studien zu den Campanischen Dachlerrakotten, dans XIII, 30, 1915, p. 1-115.
(2) plin., N. H., XXXV, 157. Cf. plut., Publicola, 13,
(3) plin., N. H,, XXXIII, 111.
inque Jovis dextra, fiçtile fulmen erat (1).
Sur le faîte du temple était un quadrige en terre cuite, fait à Véies et qui ne fut livré par les Véiens, à la suite de la chute de Tarquin, qu'avec bien des difficultés (2). D'autres statues se dressaient encore sur les rampants du fronton, sans parler des acrotères, du fronton lui-même dont nous ne savons rien, des antéfixes, de tous les revêtements des charpentes et des œuvres d'art qui pouvaient encore se trouver sous la colonnade antérieure. A en croire les témoignages nombreux que nous possédons, une plastique abondante aurait orné le temple primitif du Capitule.
Toute cette tradition, comme l'ensemble des traditions relatives aux premiers siècles de Rome, est naturellement sujette à caution. Elle a été attaquée par M. Ettore Pais (3). Selon ce critique, l'aménagement du Capitole et la construction du temple ne dateraient que du ivb siècle. C'est l'invasion gauloise qui aurait révélé aux Romains les avantages défensifs de la colline. La mention de l'artiste véien Vulca ne résulterait que d'une confusion avec le dieu du feu Vulcanus, identifié au dieu Summanus qui aurait précédé Jupiter sur le Capitole. On ne peut manquer, en effet, d'être frappé des dimensions considérables, environ 60 mètres de côté, indiquées par Denys pour le temple capitolin. Celles des anciens temples d'Etrurie se trouvent comprises, généralement, entre 20 et 30 mètres. La colonnade entourant les côtés du temple semble également une disposition architecturale postérieure au VIème siècle- Elle se retrouve à Cîvità Castellana, dans le temple du Junon, construit en pierre et qui apparaît comme une réfection du IVème siècle (4).
(1) Ovid., Fast., I, 202.
(2)Plin., H. N., XXVIII, 16 ; SERV., ad Aen., VII, 188 ; plut.. Publico/a, 13.
(3) E. pais, CXXIV, 1 p, 523 ; 3, p. 337.
(4) Remarque de M. P, decati, art. cité, p. 22, 23.
Bien plus, ce temple primitif de bois, inauguré en 509 et détruit seulement par l'incendie du temps de Sylla, aurait eu une durée bien longue, plus de quatre siècles, alors que les temples de pierre ou de marbre qui lui succédèrent durent être reconstruits à des intervalles beaucoup plus brefs. On accordera, sans difficulté, à M. Pais que le temple dont les restaurations postérieures conservèrent l'image ne devait dater que du ive siècle.
Mais un ensemble de faits archéologiques mis au jour par des fouilles récentes viennent confirmer les indications relatives à l'existence et à la décoration du temple du vie siècle. C'est d'abord la trouvaille, dans les couches les plus profondes du Capitole, à l'emplacement du temple, de fragments de terre cuite qui ne peuvent dater que de cette époque (1). On possède ainsi une grande tuile plate ornée sur l'un de ses bords d'une bande de méandres peints et plusieurs morceaux d'une bordure et d'antéfixes également peints, d'un type courant dans l'architecture gréco-étrusque de la fin du vie et au début du ve siècle (2). Mais surtout, la découverte à Véies de toute une série d'admirables statues de terre cuite ou de fragments de statues est venue apporter une confirmation frappante au souvenir conservé par Pline de la renommée des coroplastes véiens du temps de Tarquin et prouver que le nom de Vulca, loin de résulter d'une confusion avec le dieu du feu, put fort bien être celui d'un artiste et d'un grand artiste de Véies, à la fin du vie siècle (3).
Les fouilles entreprises à Véies ont amené la découverte, en mai 1916, d'une splendide statue d'Apollon archaïque, de grandeur naturelle et à laquelle ne manquent guère que les bras. A côté se trouvait la partie inférieure d'une autre statue de mêmes dimensions et le corps d'un animal, d'une biche semble-t-il, posant sur l'échiné et les pattes liées.
(1) gatti, III, 24, 1896, p. 187-9, pl. XII, XIII.
(2) G. pinza, XVI, 15, col. 500, fig. 152.
(3) gigloli, XVIII, 1919, p. 18-37. pl. 1-VII. Cf. della seta, CXLIX, p. 205-6, fig. 215-7.
La figure d'Apollon et ce fragment devaient faire partie d'un même groupe représentant la dispute d'Apollon et d'Héraclès à propos de la biche aux pieds d'airain. Deux autres dieux assistaient à la scène : Hermès, dont on aretrouvé la tête coiffée du pilos ailé, et probablement Artémis dont il ne reste que des fragments insignifiants. Le style et la technique de ces oeuvres les date, aucune hésitation n'est possible, de la fin du VIème ou du début du Vème siècle.
Le mythe et les dieux représentés sont grecs, mais la technique est étrusque. Elle se révèle un peu plus récente que celle des grands sarcophages de Cervetri qui emploient une argile moins pure. Ces statues ont dû être exécutées à Véies même. « L'artiste qui les modela », dit très justement l'heureux auteur de cette belle découverte, M. Giglioli (1), « qu'il fût un Grec établi en Occident, ou un Etrusque, ou un Italiote, formé à l'école des Grecs, a su, en imitant les modèles qui d'Ionie affluaient en Etrurie, faire œuvre d'art vraiment individuel. La complexité des figures, la science du modelé, ''élégance de la forme, le goût parfait de la polychromie, toute la vie qui anime l'exécution de ces corps aux jambes nerveuses, à la poitrine puissante, l'expression des visages marqués de profonds sillons autour des yeux et de la bouche font de ces terres cuites les chefs-d'œuvre de l'art archaïque en Étrurie. »
Ces belles statues de Véies rappellent d'autres fragments archaïques non moins admirables découverts en 1896 par M. H. Graillot dans les ruines du temple étrusco-latin de Conca, l'ancien Satricum, à la limite du Latium et des Marais Pontins (2). Une antéfixe féminine aux yeux mi-clos, au sourire prononcé, a toute la finesse enveloppée du grand art.
(1) XVIII, 1919, p. 29.
(2) H. graillot. X. 16. 1896.p.131-164,pl. A.V.cf. DELLE SETA CXLIX p. 206-207, fig. 218, 219.
Une tête virile barbue aux grosses boucles schématisées encadrant le front, aux yeux en amande largement ouverts, présente la majesté empreinte de douceur et de bonté qui convient à un Jupiter. Une tête de barbare mourant, trouvée postérieurement, manifeste une tentative intéressante d'exprimer la souffrance et la grimace de la douleur. Des acrotères de Conca représentent des groupes très vivants de Satyres et de Ménades (1). Un des anciens temples de Faleries a fourni de même une belle acrotère représentant des guerriers armés de toute pièce, en train de combattre, des antéfixes, têtes de satyres grotesques aux oreilles caprines et aux rides accusées, ou figures aimables de Ménades, et de très abondants morceaux des revêtements décoratifs qui protégeaient les charpentes de bois (2).
Nous avons là, entre Cervetri, Véies, Faleries et le sud du Latium, c'est-à-dire tout autour de Rome, à la fin du viéme et au début du ve siècle, l'exubérante floraison d'un art plastique de tout premier ordre qui justifie pleinement l'indication de Pline à propos des commandes de Tarquin à Vulca et aux artistes de Véies. La tradition romaine avait donc conservé, à propos de la construction du temple capitolin, un souvenir exact de la floraison de l'art étrusque de la période archaïque. La statue de culte de Jupiter, le quadrige du faîte, les acrotères, la décoration du fronton peut-être, les revêtements décoratifs dont on a retrouvé quelques fragments, les statues accessoires d'Hercule et de Summanus qui se trouvent encore mentionnées, étaient du même genre que celles de Véies et de Conca. Tout cet art de terre cuite avait, au moins depuis Sylla, disparu du Capitole. Mais telle avait été l'abondance de la production que d'autres spécimens en perpétuaient encore la connaissance au temps de Pline.
(1) della seta, CXLIX, p. 175, fig. 176.
(2) Ibid., p. 208, fi . 230, 231 ; p. 172-3, fig. 175 ; p. 177, fig. 177. Sur cette décoration, cf. E. Rizzo, III, 1910, p. 281-322; 1911, p. 54-67. Tous ces fragments se trouvent au Musée de la villa du Pape Jules, à Rome ; cf. della seta, CXLVI1I. p. 120 sq.
On trouve encore en bien des lieux, dit-il, des statues de ce genre, couronnant le faîte des temples, à Rome et dans les municipes ; leur admirable modelé, leur art, la solidité qu'elles ne doivent qu'à leur technique les tend plus précieuses que l'or — ou du moins plus pures \\\
Un chef-d'œuvre de sculpture bien connu, l'un des joyaux du Musée du Capitole, évoque aujourd'hui encore cet art si vivant de l'Italie primitive vivifiée par l'Ionie. C'est la Louve de bronze du Capitole. Elle représente incontestablement une œuvre de la fin du vie ou du début du ve siècle, contemporaine par conséquent, ou de peu s'en faut, de la première construction du Capitole.
Aussi haut que remonte le souvenir, la Louve fait partie des collections romaines ; elle se trouvait durant le moyen âge au Latran. On ignore quand et où elle fut trouvée. On l'identifiait autrefois avec une image de la Louve allaitant Romulus et Remus, dédiée en 296 av. J.-C. par les frères Ogulnii au Forum. Les putti que l'on voit aujourd'hui suçant ses mamelles sont modernes : ils datent de la Renaissance. La louve seule est antique, et son style n'a rien de commun avec la date à laquelle se place la dédicace des frères Ogulnii. Petersen a cru pouvoir établir que la Louve dite aujourd'hui « du Capitole » a bien été de tout temps au Capitole (2). Elle serait donc un des monuments originaux de la première consécration du sanctuaire de la cité romaine. Cicéron, en effet, parle à plusieurs reprises d'une Louve allaitant un Romulus doré qui, de son temps, en 65 av. J.-C., aurait été frappée de la foudre et qu'il aurait vue, arrachée de sa base, gisant à terre. Or un examen attentif du bronze du Capitole a fait remarquer, le long des pattes de derrière, deux déchirures longitudinales, bordées de petits globules de métal fondu qui semblent bien ne pouvoir provenir que d'un coup de foudre. Le feu du ciel n'aurait donc détruit que le pullo, lequel seul était doré, car le bronze de la louve ne présente aucune trace de dorure ; la louve elle-même n'en aurait que peu souffert.
(1) Pline, N. H., 35, 158.
(2) E. petersen, Luna capitolina, IX, 1908, p. 440-456 ; 1909, p. 29-47.—Carcopino, XXV, 1924, 4, p. 1-19 ; 5, p. 16-49.
Sans doute les images de la Louve étaient-elles nombreuses à Rome. Il paraît cependant difficile d'admettre, quelle que soit la fréquence des orages romains, que plusieurs d'entre elles aient été ainsi frappées par la foudre (1). Il est également peu vraisemblable que la Louve que nous possédons soit un butin rapporté par les Romains de Grèce ou d'Etrurie. La légende de la Louve nourricière n'est sans doute pas particulière à Rome. En Ionie, Miletos aurait été ainsi allaité. Une stèle de Bologne, dans l'Etrurie du Nord, nous présente l'image d'un fauve, louve ou lionne, allaitant un enfant (2). Ce mythe en réalité fait partie du folklore de tous les pays, puisque M. Rudyard Kipling l'a retrouvé dans l'Inde et l'a illustré de la manière que l'on sait. Nulle part cependant, il ne semble avoir atteint la même popularité qu'à Rome. Aucune raison décisive n'a été apportée pour prouver qu'il n'appartint pas originairement aux tribus latines ou aux Étrusques et qu'il fut emprunté par l'Italie à la Grèce. Il ne suffit pas d'observer que rien n’exclut ni pour la légende ni pour la statue romaine elle-même l'hypothèse d'une provenance étrangère, il faudrait établir cette provenance étrangère. Jusqu'à preuve du contraire, il paraît légitime de croire que la Louve romaine est bien autochtone et de considérer l'image que nous en possédons comme identifiée par les traces d'un coup de foudre avec celle qui se trouvait dans l'antiquité au Capitule.
S'étonnera-t-on, maintenant que l'on connaît les sculptures de Véies, et en particulier le fragment représentant le corps de la biche, objet du litige entre Apollon et Hercule, qu'une œuvre d'art telle que la Louve ait pu être modelée en Italie, pour
(1) G. de sanctis, XXII, 38 (1910), p. 71-85.
(2) P. ducati, Le pietre funerarie felsinee, dans XIV, 1911, n° 195, col. 530, fig. 24 ; A. grenier, LXXXI. p. 536, fig. 140.
Rome, vers la fin du VIème siècle ? Nous retrouvons dans les terres cuites de Véies, de Faléries, de Conca, le même réalisme exact et vivant associé à une stylisation puissante, le même soin du détail, la même harmonie des masses et, par-dessus tout l'énergie de l'expression et la simplicité de la ligne. Bronziers réputés, les Etrusques étaient capables de réaliser en métal les mêmes conceptions qu'ils excellaient à exprimer en terre cuite. Ne trouvons-nous pas en Etrurie d'ailleurs, àune époque un peu postérieure à celle de la Louve, un autre chef-d'œuvre en bronze, la Chimère d'Arezzo, monstre composite comme les imaginait volontiers l'Ionie, à la tête et au corps de lion dressant au milieu de son dos un cou et une tête de chèvre et dont la queue retroussée se termine par une tête de serpent (l) ?
Reconnaissons donc dans la Louve du Capitule une œuvre étrusque du temps de Tarquin, exécutée pour Rome, au même titre que les statues de culte et les acrotères du temple capitolin, souvenir expressif du grand art qui, au VIème siècle avant notre ère, fut celui de Rome en même temps que de l'Etrurie.
III
l'introduction de l'écriture a rome.
Les Etrusques apparaissent ainsi comme les éducateurs des Romains. Ce sont eux aussi qui leur ont enseigné récriture, et cela, dès le VIIème siècle avant notre ère.
La doctrine courante, celle que l'on trouve encore exposée dans la plupart des manuels classiques, est que Rome a reçu son alphabet, non des Etrusques, mais directement des Grecs de Cumes.
(1) Au Musée de Florence, martua, CXV, p. 310. fîg. 20
Les Étrusques n'auraient transmis leur écriture qu'aux Ombriens de l'Italie centrale et aux Osques de l'Italie méridionale, mais non pas aux Latins (1). Telle est la théorie consacrée, depuis 1850, par l'autorité de Mommsen, bien que Mommsen lui-même ait plus lard, à demi-mot, il est vrai, indiqué une solution moins paradoxale (2). Le chasse-croisé qui rattache à l'écriture étrusque celle des Osques voisins de Cumes, et à Cumes celle des Latins voisins des Étrusques, semble en effet assez étrange. Il apparaît au contraire, aujourd'hui, que les Latins ont reçu leur alphabet des Etrusques, comme les Osques et les Ombriens, mais non pas le même alphabet. L'alphabet latin est l'alphabet étrusque ancien, celui des Osques et des Ombriens est un alphabet étrusque plus récent.
L'écriture était d'un usage courant en Etrurie, dès le début du VIIème siècle au plus tard. Une découverte récente en apporte la preuve : c'est celle, dans une tombe pourvue d'un riche mobilier d'ivoires sculptés de style oriental et que l'on peut dater, en chiffre rond, de l'an 700, d'une tablette à écrire en ivoire portant, gravé à la pointe sur l'un des côtés de son cadre, un alphabet complet (3). Cet alphabet, le plus ancien de tous ceux que l'on connaît, en Grèce aussi bien qu'en Italie, est essentiellement le même que plusieurs autres qui avaient été trouvés autrefois en Etrurie, incisés sur des vases provenant de Cervetri et de Véies ou peints sur la paroi d'une tombe voisine de Sienne (4). Les uns peuvent être datés de la seconde moitié du VIIème ou peut-être du début du VIème siècle ; celui de Sienne n'est peut-être pas antérieur au début du Vème siècle. Leur ensemble embrasse toute la période archaïque de la civilisation étrusque.
(1) F.sommer,CL, p.25; C D.Buck, XLI,p.25; kirchhoff,LXXXIX, p. 129 sq.
(2) V.1882, p. 95.
(3) A. minto, CXII, p. 236 sq.
(4) Alphabet de Cervetri : lepsius, VI, 1836, p. 106-206 ; anziani Mélangea Cagnat, 1912, p. 17-30. Alphabet de Formello, près de Veies : V, 1S82, p. 91 sq, ; breal, X, 1883, p. 147-160. Alphabet de Colle, prêt de Sienne: LI bis, n° 176 b.
Un même alphabet s'est donc trouvé en usage en Etrurie durant au moins deux siècles. Quelle qu'en soit l'origine, qu'il provienne de Cumes, comme on l'admet communément, ou qu'il représente un type plus ancien que celui des Chalcidiens de Cumes, il dérive incontestablement d un modèle grec. L'alphabet étrusque archaïque n'est autre qu'un alphabet grec complet de vingt-six lettres.
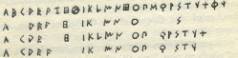 --- Alphabet étrusque et les alphabets latins archaïques.
--- Alphabet étrusque et les alphabets latins archaïques.
C'est dans cet alphabet que sont écrits les plus anciens documents épigraphiques, non seulement d'Étrurie mais du Latium et de Rome. Ces derniers sont rares; ils suffisent cependant pour permettre de juger de leur paléographie. C'est tout d'abord la fibule célèbre de Préneste, portant l'inscription Manios med fhe fhaked Numasio : Manius me fecit Numerico, datée, par la forme même de la fibule, du VIIème ou, au plus tard, du VIème siècle. C'est ensuite l'inscription du cippe mutilé trouvé en 1899 sous le pavage noir du Forum romain, devant le Comitium. On ne saurait affirmer, remarque très justement M. Pais, que l'inscription du Forum soit du VIème du Vème ou même du IVème siècle. Mais son écriture est nettement celle des alphabets étrusques archaïques. C'est aux mêmes alphabets que se rattache l'inscription incisée à la pointe sur le vase connu sous le nom de vase de Duenos, quoiqu'elle apparaisse clairement beaucoup plus récente et ne puisse être datée que du IVème siècle (1). Un coup d'œil sur le tableau ci-joint permettra de s'en rendre compte.
Vers la fin du vie ou plutôt le début du ve siècle, on aperçoit en Etrurie une modification de l'alphabet gréco-étrusque primitif. Les occlusives sonores b et d qui, dans la phonétique étrusque, ne se distinguaient pas des sourdes, disparaissent, ainsi que la voyelle o. Les alphabets commencent donc par les lettres a, c, e, v,(2). Certains suppriment même la lettre c qui fait double emploi avec k. Deux cippes de Chiusi, par exemple, donnent la série : a, e, v, z..... (3). L'o fait défaut partout ; la voyelle u suffisait aux Etrusques. Par contre, un nouveau signe apparaît dans les alphabets et les inscriptions, le signe 8 = f, dont l'origine demeure d'ailleurs objet de discussion (4). Une telle réforme mettant l'écriture en harmonie avec la phonétique paraît l'œuvre d'une volonté réfléchie et intelligente; c'est une véritable réforme orthographique. C'est cet alphabet diminué de ses sonores ainsi que de la voyelle o et augmenté du 8 = f, qui se trouve en usage chez les Osques et les Ombriens, soit que ces peuples n'aient appris àécrire que postérieurement àla réforme orthographique étrusque, soient qu'ils aient suivi aveuglément, et sans se rendre compte du génie différent de leurs parlers, l'exemple des Étrusques. Rome, au contraire, est restée fidèle àl'ancien alphabet. Les lettres qui ne correspondaient "à aucun son latin, comme les aspirées cp = p + h ; x = k + h, ont seules disparu. Pour exprimer le son f', noté dans l'inscription de la fibule de Préneste parle groupe digamma + h : FH, les Latins se sont plus tard contentés du simple digamma : F ; ils n'ont jamais
(1) dressel, VI, 1880, p. 158-195; bréal, X, 2, 1882, p. 147-168; pinza, XIV, 15, col. 643-553.
(2) P. e. le vase de Bomarzo, présente comme le type de l'alphabet étrusque, par bréal, XI, 7, 1892, p. 129-154 ; cf. barnabei, XVlIi, 1897, p. 509.
(3) II bis, n08 1372 et 1373, et gamurrini, VI, 1871, p. 155-166, pi. L.
(4) Voir, en dernier lieu, xogara, IV, 1920, p. 13; note 1.
employé le 8 étrusque. Ils n'ont achevé leur réforme orthographique qu'à la fin du IVème siècle, en 312 avant Jésus-Christ, lorsque l'autorité du censeur Appius Claudius Caecus confirma la troisième lettre C dans sa valeur de gutturale sourde et introduisit à la septième place, au lieu du Z qui ne servait pas un signe nouveau G, destiné à noter la gutturale sonore. A partir du début du Ve siècle, l'évolution de l'écriture latine apparaît donc indépendante de celle de l'écriture étrusque.
Tant que l'on considérait comme étrusque le seul alphabet réformé du v' siècle, il était donc naturel de chercher ailleurs qu'en Etrurie l'origine de l'écriture romaine. Etant donnée la, parenté de l'alphabet étrusque archaïque avec celui de Cumes il était légitime de faire dériver directement celui de Rome de celui des Grecs de Cumes. Mais aujourd'hui, nous connaissons en Etrurie un alphabet complet fournissant toutes les lettres qui furent en usage à Rome. La vraisemblance n'est-elle pas que les Romains aient eu pour maîtres d'écriture les Etrusques, leurs plus proches voisins, plutôt que les Grecs de Cumes?
Un détail enlève toute hésitation à cet égard. C'est la transformation du gamma grec en C latin. Si l'alphabet latin donne la troisième place au C et non au G, la faute n'en peut incomber qu'aux Etrusques. C'est la phonétique étrusque qui confondait la sonore g et la sourde c ; c'est donc en Etrurie que le • grec servit à noter le son intermédiaire entremet c qui était celui de la langue étrusque. Les Romains, au contraire, n'ont jamais confondu les sonores et les sourdes. La preuve en est qu'ils ont introduit dans l'alphabet le signe nouveau G pour marquer la gutturale sonore. Si la confusion, étrangère à la phonétique, a régné durant un temps dans l'écriture, elle provenait de ce que l'écriture était d'origine étrusque. Pour noter l'un et l'autre son, l'alphabet étrusque employait le C. Nous lisons ainsi, sur l'inscription du Forum, le mot RECEI---regei - régi. Le G a dans cemot la valeur de y. Dans le même texte il apparaît dans H0NCE = hunc avec la valeur de c. Dans l'inscription du vase de Duenos nous rencontrons ainsi, l'un à coté de l'autre, les mots cosmis = comis, ou cornes et virco = virgo- C'est en raison de cette indécision ancienne que les Romain ont continué à écrire Caius et à abréger en C. le prénom qu'ils prononçaient Gaius et que les écrivains grecs ont toujours noté tilo,-. Si Rome avait emprunté directement son alphabet aux Grecs, la troisième lettre C aurait toujours conservé la valeur £-et K aurait servi seul pour marquer la gutturale sourde.
Ce sont donc bien les Etrusques qui ont appris à écrire aux Romains et cela, dès le VIèmesiècle avant notre ère, au plus tard, puisque l'alphabet conservé par les Romains a disparu dès le début du ve siècle de l'usage étrusque. C'est sous la férule des Tarquins que Rome a fait ses classes.
IV
la. TRADITION LÉGENDAIRE ÉTRUSCO-HOMA1NE.
A travers les obscurités d'un long oubli, la période royale de Rome qui connut l'écriture, qui eut ses monuments d'architecture, de sculpture et sans doute aussi de peinture, apparaît comme une grande période de civilisation. Elle eut aussi, toujours en commun avec les Etrusques, semble-t-il, ses traditions légendaires, de caractère sinon même de forme épique.
En Grèce, le VIème siècle est marqué par la diffusion de la littérature d'imagination. De l'état oral, l'épopée homérique est transposée en rédaction écrite. Il ne paraîtra pas invraisemblable que les Etrusques, imitateurs de tous les arts helléniques, aient eu, eux aussi, leurs légendes épiques. Furent-elles écrites et sous quelle forme, nous l'ignorons. Mais le souvenir s'en était conservé, fort précis, nous le verrons, jusqu'à l'époque impériale. Nous le retrouvons vers le IVème siècle avant notre ère dans l'art figuré étrusque. Il n'a sans doute pas été étranger à la formation de la tradition historique romaine. Ce sont des légendes étrusques très probablement qui ont transmis à l'histoire les indications à la fois précises et fabuleuses que nous possédons sur l'époque des rois. Il y eut certainement un cycle de Tarquin et de ses compagnons. Une étude détaillée de l'art figuré étrusque sur les miroirs, sur les urnes et les cippes funéraires, sur les parois des tombes, permettrait peut-être de recueillir un certain nombre d'éléments de la légende historique étrusque. Contentons-nous de signaler ici et d'analyser à ce point de vue un monument, du reste bien connu, les peintures d'une tombe de Vulci.
En 1857, le consul et archéologue français Alexandre François découvrait sur les parois d'une chambre funéraire, aux environs de Vulci, une ample composition à l'extrémité de laquelle figurait un personnage désigné, par une inscription, comme Cneve Tarchu Rumach, c'est-à-dire Cneius Tarquin de Rome (1). La peinture elle-même, par son style, ne saurait
(1) martha, CIV, p. 398, fîg. 270; G. koerte, XII, 12 (1897), p. 57-80, fig. p. 70:

Peinture de Vulchi
être antérieure à la première moitié du ive siècle. En représentant un épisode des guerres entre Tarquin de Rome et certains héros étrusques, l'artiste se rattachait à une tradition ancienne demeurée populaire chez ses contemporains. Les noms qu'il écrit soigneusement sous chacun de ses personnages devaient évoquer, dans l'esprit des spectateurs, des souvenirs précis et tout un cycle de légendes. Un récit, alors connu de tous, soutient, pour ainsi dire, cette peinture, de même que les vers de l'Iliade et de l'Odyssée soutiennent les innombrables représentations figurées qu'ils ont inspirées.
La composition se trouve distribuée en triptyque. A gauche Caile Vipinas délivre de ses liens Macstrna qui devait être le prisonnier de Tarquin. Au centre, les compagnons de Vipinas nommés Larth Ulthes, Rasce et Aule Vipinas massacrent les compagnons de Tarquin : Laris Papathnas Velznach, Pesna Arcmsnas Svetimach, Venli Caules Plsachs. Enfin, à droite, un Marce Camitlnas se prépare à tuer Cneve Tarchu Rumach. Les gardes infortunés de Tarquin portent chacun, comme Tarquin lui-même, un triple nom dont le dernier élément est un ethnique. Mais on ne saurait mettre cet ethnique en rapport avec des villes déterminées. Ces personnages demeurent pour nous des inconnus.
Il n'en est pas de même, au moins des chefs du parti adverse. Les deux frères Caile et Aule Vipinas reparaissent sur des urnes étrusques, dans un autre exploit; ils surprennent un personnage, d'ailleurs énigmatique, nommée Cacu (1). Le souvenir de l'un d'eux, Caile, a survécu dans la tradition historique romaine. Tacite nous le présente comme le héros éponyme du mont Caelius, à Rome (2).
Ce mont, nous dit-il, s'appelait primitivement Querquetulanus en raison du grand nombre de chênes dont il était couvert. Il fut ensuite nommé Caellus, de Celés Vibenna, chef étrusque qui, appelé au secours de Rome avec un corps de sa nation, fut établi en cet endroit par Tarquin l'Ancien ou quelque autre de nos rois.
(1) Ce serait un enchanteur, envoyé par Marsyas au roi des Tyrrhènes Tarchon. Il a pu être le prototype du sorcier du feu Cacus que tua Hercule, sur le Palatin, d'après la légende romaine,
(2) tac,, Ann., 4, 65.
Le grammairien Festus, dans un passage d'ailleurs fort corrompu, semble mettre en relation les deux frères Vibenna avec le vicus Tuscus de Rome et même mentionner à leur propos un autre personnage également représenté dans les peintures de Vulci, Macstrna (1).
Celui-ci aussi nous est connu par la mention détaillée que fait de lui le plus célèbre des étruscologues, l'empereur Claude, de qui d'ailleurs peuvent fort bien provenir les indications données par Tacite et par Festus. Dans le discours fameux «qu'il prononça en faveur de l'admission des nobles gaulois au Sénat, discours résumé par Tacite et reproduit in extenso dans une inscription de Lyon, l'empereur érudit s'exprimait aussi :
Servie Tullius, le plus fidèle camarade de Caelius Vibenna et le compagnon de toutes ses aventures, après avoir été chassé d:Étrurie avec tous les restes de l'armée de Caelius, vint occuper le mont Caelius auquel il donna ce nom en souvenir de son chef: puis ayant lui-même changé de nom (car, en étrusque, il s'appelait Mastarna) il régna sous le nom de Servius pour le plus grand bien de Rome.
L'épisode auquel il est fait ici allusion devait être une suite de celui que représente la peinture de Vulci : Mastarna avait été pris par Tarquin. Les frères Vibenna délivrent leur compagnon et tuent Tarquin. Puis devait venir une série d'aventures au cours desquelles périssaient à leur tour les frères Vibenna. Mastarna recueillait les restes de leur armée et venait s'établir à Rome, où il finissait par régner à la place de Tarquin. Nous apercevons là toute la matière d'un fragment d'épopée qui mêlait les chefs étrusques de Rome et la topographie romaine aux aventures de héros célèbres d'Etrurie.
(1) fest., s. v. Tuscus vicus.
On connaissait encore, au temps de l'empereur Claude, les exploits et les malheurs des frères Vibenna ainsi que la fortune extraordinaire de leur fidèle Mastarna. Les livres consacrés par Claude au passé de l'Etrurie, s'ils nous avaient été conservés, nous auraient appris sans doute sous quelle forme le souvenir s'en était transmis. L'hypothèse d'un cycle épique étrusco-romain n'a certes rien d'invraisemblable.
V
survivances diverses de la période étrusque dans la civilisation romaine.
Le fait d'avoir ainsi participé, durant une longue et brillante période; à la vie de l'Etrurie a laissé de nombreuses traces dans toute la civilisation romaine des siècles postérieurs. Cette communauté primitive avec l'Etrurie a eu pour premier effet de rendre Rome particulièrement accessible aux influences étrusques. De tout temps, même après qu'ils se trouvèrent les maîtres de l'Étrurie vaincue, les Romains ont considéré leurs voisins du nord comme détenteurs de bien des secrets qu'ils ne cessèrent de leur emprunter. Il est donc à peu près impossible de distinguer ce qu'ils ont conservé de l'époque pendant laquelle ils furent eux-mêmes étrusques des acquisitions successives réalisées au cours de leur histoire. La religion, l'art et la culture littéraire même, la vie familiale et sociale, accusent à Rome l'autorité persistante de ses premiers éducateurs.
De tout temps, Jupiter Capitolin demeura, dans son temple étrusque, le dieu principal de la cité. Les collèges sacerdotaux, ceux des devins en particulier, augures ou haruspices s'inspirèrent toujours de la discipline étrusque. Lorsque quelque prodige dépassait leur compétence, le Sénat se hâtait de demander à l'Etrurie ses spécialistes les plus qualifiés. Nous retrouverons à chaque pas, dans l'étude des rites et des doctrines de la religion romaine, cette influence profonde de la religion étrusque.
Au point de vue intellectuel, T. Live rappelle que l'habitude ancienne des jeunes Romains de famille noble était d'aller parfaire leur éducation en Etrurie, comme plus tard ils allèrent l'achever à Athènes (1). Les jeux romains sont grecs, sans doute, en majeure partie, mais c'est que les jeux étrusques l'étaient déjà (2). La pompe qui les ouvre, et qui apparaît essentiellement la même que celle du triomphe, mélange les éléments helléniques à d'autres qui semblent particulièrement étrusques (3). Jupiter sur son char, comme le triomphateur, sont costumés à l'étrusque (4). Étrusque est la lourde couronne d'or qu'un esclave supporte au-dessus de la tête du triomphateur et qui ornait le chef de Jupiter. Les licteurs et leurs faisceaux de douze baguettes entourant une hache sont étrusques (3). La hache semble le symbole du grand dieu des peuples de la mer préhelléniques dont bien des croyances survivent parmi les Etrusques; les douze baguettes paraissent correspondre aux douze cités de la confédération tyrrhénienne. La musique, à Rome, est étrusque (6). Les premiers acteurs, les histrions viennent d'Étrurie. Les funérailles romaines, d'un caractère si particulier et imposant, paraissent imitées des funérailles étrusques. En Etrurie, les pleureuses à gages récitent, comme à Rome, la nénie autour du lit funèbre. C'est à l'Etrurie que les Romains ont empruntée l'usage du masque modelé sur la figure du défunt, qui est ensuite conservé dans la famille (7). Leur collection constitue la galerie des ancêtres. Pour le cortège funèbre, les masques ancestraux quittent les âmes de
(1) T. Liv., 9, 3fi, 3. Cf. mueller-deecke, CX1V, p. 323.
(2) F, weege, XII, 3l (1916), p, 137-138.
(3) A. piganiol, CXXXI, p. 15 sq.
(4) mueller-deecke, CXIV, II, p. 198 sq.
(5) La tomba del Littore, à Vetulonia (Musée de Florence)
(6) mueller-deeckce, CXIV, 2, p. 209 sq.
(7) A. minto. CXI1, r. 211 et 276.
bois qui les portent, ils sont appliqués sur le visage de quelque figurant. Celui-ci s'ingénie à reproduire les particularités physiques du personnage qu'il représente, il a soin de claudiquer si l'ancêtre était boiteux. Les générations d'autrefois accompagnent ainsi leur descendant à sa dernière demeure : c'est devant cet aréopage que le plus proche parent prononce l'éloge funèbre.
C'est du masque funéraire, du soin pris par les Étrusques de conserver la ressemblance du défunt, que dérive l'art du portrait. En Italie, en Etrurie, depuis le VIème ou même le VIIème siècle et, plus tard, à Rome, le portrait accuse la tendance réaliste; il cherche à représenter l'individu avec ses traits particuliers ; il s'oppose ainsi à l'art grec du portrait qui idéalise l'individu et, d'une image particulière, cherche surtout à dégager un type général. Ce réalisme règne en maître dans toute sculpture funéraire étrusque depuis ses premiers essais jusqu'à l'innombrable série des urnes qui nous présentent l'Etrusque, tel qu'il était, obèse ou ridé, étendu sur le couvercle de son sarcophage ou de la cassette qui contient ses cendres.
En architecture, de même que le temple romain primitif est étrusque, l'ancienne maison romaine, avant l'adjonction de l'oecus grec, reproduit un plan étrusque. Tous les auteurs anciens sont d'accord pour avouer l'origine étrusque de l'atrium autour duquel se distribuent les pièces d'habitation. Tout en hésitant à les suivre dans leurs étymologies et sans arriver à distinguer très nettement le caractère propre de l'atrium, les critiques modernes ne peuvent en chercher le modèle que dans l'architecture étrusque.
Peut-être même la constitution de la famille romaine est-elle redevable à l'Etrurie de l'un de ses éléments caractéristiques. La femme occupe, à Rome, dans la famille, une place infiniment plus importante qu'en Grèce et que chez la plupart des peuples de même souche que les Latins. Sa situation morale y apparaît en contradiction formelle avec l'état juridique que lui assigne la tradition proprement latine. Légalement, la femme ne compte pas ; elle n'a aucun droit. La phrase célèbre du vieux Caton définit sa situation de perpétuelle mineure : « nos ancêtres ont voulu que la femme soit en la possession et sous le pouvoir de l'homme : in manu et potestate virorum ». Elle n'hérite pas; la parenté par les femmes n'est pas prise en considération dans les relations juridiques de famille à famille. Le droit romain correspond assez exactement, en tous ces traits, au droit grec.
Et cependant, malgré la loi, la femme apparaît, à Rome, comme la maîtresse au moins dans la maison. Tandis que la femme grecque est reléguée dans le gynécée, la materfamilias trône au centre même de la maison, dans la pièce principale, largement ouverte sur l'atrium, d'où elle dirige toute la vie familiale. Les inscriptions latines nous montrent fréquemment en elles les conseillères et les fidèles compagnes de leurs époux dont elles partagent les dangers. A l'époque royale, la légende leur prête un rôle prépondérant dans la vie politique. Jusqu'à la fin de la République, elles n'ont jamais cessé d'exercer une influence considérable sur leurs fils et leurs maris et, par eux, dans la cité. Les mœurs corrigent largement, en leur faveur, la rigueur du droit.
Cette situation doit-elle s'expliquer par une délicatesse particulièrement tendre des anciens Romains ? N'est-il pas plus satisfaisant d'y reconnaître un souvenir de l'organisation de la famille étrusque qui oppose le matriarcat au régime patriarcal latin ? C'est la mère qui, en Étrurie, est le centre de la famille, c'est par les femmes que s'établit la parenté. Les inscriptions funéraires étrusques mentionnent couramment le nom de la mère, tandis qu'elles omettent souvent celui du père. La noblesse de leur race maternelle n'importe pas moins aux Étrusques que celle de leur ascendance paternelle. La femme, en Etrurie, paraît vraiment au moins l'égale de l'homme. De là vient sans doute que, malgré la deminutio capilis dont elle se trouvait frappée par la loi, la matrone romaine jouit dans la maison de l'importance et de l'autorité que lui attribuaient les mœurs étrusques.
Le mariage romain d'ailleurs, continue à reproduire jusqu'en pleine époque impériale les cérémonies et les rites du mariage étrusque. Sur les sarcophages romains, comme sur les urnes funéraires étrusques, les représentations nuptiales nous présentent l'épouse voilée, entourée non seulement de ses compagnes, mais de ses parents. La formule : ubi tu Gaius, ego Gaia, semble bien faire allusion à l'égalité et à la communauté étrusque plutôt qu'à la subordination sévère du droit latin. Dans la vie morale, comme dans celle de l'esprit, dans la famille, comme dans le plan de la maison, une partie de l'originalité romaine semble provenir de traditions étrusques, mêlées de façon plus ou moins cohérente à celle des Latins.
VI
LA POPULATION ET LES NOMS PROPRES ROMAINS.
La population primitive de Rome nous est présentée, par la tradition, comme formée d'un mélange de Latins et de Sabins, appartenant les uns et les autres à la famille italique et parlant des dialectes assez étroitement apparentés. Celle de l'époque historique nous apparaît, d'après les noms propres en usage durant toute la période classique, composée d'indigènes et d'un grand nombre de familles d'origine étrusque.
Etablir une distinction nette entre les uns et les autres serait une tâche à peu près impossible, car, en Etrurie même, les noms proprement étrusques se trouvent mêlés à beaucoup d'autres qui paraissent italiques. Bien plus, dans un même nom, aussi bien en Etrurie qu'à Rome, des éléments purement indigènes sont associés à des éléments étrangers aux langues italiques et que l'on peut considérer comme spécifiquement étrusques. C'est que, en effet, en Etrurie même, les Étrusques semblent n'avoir jamais représenté qu'une minorité ethnique, une caste dominante, ouverte d'ailleurs aux indigènes, qui a imposé autour d'elle ses habitudes de dénomination, en même temps qu'elle se laissait influencer et pénétrer par les noms en usage dans les régions où elle étendait sa puissance.
Les noms propres, aussi bien italiques qu'étrusques, sont formés suivant le même principe, c'est-à-dire par dérivation à l'aide d'un ou de plusieurs suffixes. On y distingue donc le radical, d'une part et, d'autre part, les suffixes. Or, parmi les radicaux, un bon nombre se retrouvent dans les noms propres d'Asie Mineure; ils appartiennent donc en propre aux Etrusques, originaires, selon toute vraisemblance, de cette région. Il en est de même parmi les suffixes. Mais à des radicaux étrusques peuvent se trouver joints des suffixes italiques et vice-versa. Il n'en reste pas moins que la plupart des noms propres romains apparaissent, sinon complètement étrusques, du moins fortement contaminés d'étrusque.
Signalons tout d'abord, à titre d'exemple, quelques-uns des radicaux de noms romains qui, se retrouvant à la fois en Etrurie et en Asie Mineure, ou même simplement en Asie Mineure, peuvent être qualifiés d'étrusques. Parmi les suffixes, l'un de ceux que l'on peut, sans aucune hésitation, attribuer aux Etrusques est le suffixe -f)voç, latin enna que l'on trouve dans le nom propre des Etrusques : Tup<j-7|v&(, Ras-enna . Il se rencontre, dans les noms de personnes, en Etrurie et à Rome, sous les formes -na, -ina, -ena,-enna : Caecina, Murena, Sisenna . Les Romains le développent fréquemment à l'aide du suffixe italique -ius : Herennius (formé sur Herenna), Largennius (formé sur Largennd). Quelques familles, comme les Caecina, gardaient, à l'époque classique, le souvenir de leur arrivée récente de quelque ville étrusque. Tel est également le cas de Mécène, Mecenas. Le nombre et la variété des dérivés proprement romains en -nius,
•mus, -enius, -ennius, -inus, -inius, -innius, formés sur ce premier suffixe étrusque suffisent à indiquer que ce type de noms était extrêmement ancien à Rome.
On s'accorde également à reconnaître l'origine étrusque des suffixes -a et -u.
Voici, par exemple, le nom étrusque Papas-a , qui apparaît dans une autre inscription étrusque sous la forme plus récente Paper-is à laquelle correspond aussi exactement que possible le nom latin Papir-ius. Les noms propres en -a sont nombreux à Rome : Colla, Helva, Sulla, Volca (étr. : Velya). Plus nombreux encore sont ceux dans lesquels ce suffixe -a se trouve développé à l'aide d'autres suffixes. Le nom étrusque Ap-as, par exemple, se trouve à la base de noms romains tels que App-e-ius, App-a-ienus, App-a-edius. Les noms latins en -anius, -arus, -atius, -alinius, apparaissent ainsi comme des dérivations secondaires d'une formation primaire étrusque en -a.
Il en est de même pour le suffixe -u. Un radical étrusque Tary, par exemple, produit une double série de noms. A l'aide du suffixe -ni est formé le nom Tary-ni, Tarqu-inius. A l'aide du suffixe -«. Tarx-u, Tarch-on et son dérivé Tarch-on-ius. Un nom étrusque Velu se trouve ainsi à la base du gentilice romain Velo-nius; Capru, à l'origine de Capr-onius. Les noms romains en onius reposent donc, en général, sur une formation primitive étrusque.
Ces deux suffixes étrusques -a et -u ont servi à former non seulement des noms de famille, mais de nombreux sobriquets qui, de surnoms, sont devenus des noms propres : Agrippa, Galba, Pansa, Nasica, Seneca ; Capito, Fronto, Naso, Strabo, Labeo, Cato . Les radicaux auxquels ils sont joints paraissent pour la plupart d'origine italique : Agrippa : né les pieds devant; Galba : obèse, grosse-tête, grand-front, grand-nez, etc. Mais il est incertain, au moins pour quelques-uns d'entre eux, si l'on a affaire à une racine latine ou étrusque. Le surnom Labeo, par exemple, peut venir de labea, lèvre, à moins qu'il ne représente le même radical que l'on retrouve dans les noms Labius, Lab-inus, Lab-enius, Lab-erius, Lab-onius, dont une partie paraît de formation étrusque. Calo, de même, peut être dérivé de l'adjectif calus, sage, aussi bien que de la racine qui a fourni les noms Cal-ni (élr.), Câlina, Cali-nius, Cafonius, Calunius, Calullus, Caledius, CaleHius, Calillius, etc. Ainsi le cognomen de Virgile, Maro, provient certainement du nom étrusque Masa qui a donné, à Rome, les noms Masonius, Maronius.
D'une façon générale, l'onomastique romaine apparaît constituée de radicaux indifféremment latins ou étrusques, suivis d'une série plus ou moins développée de suffixations. Parmi ces suffixes, les premiers, ceux qui suivent immédiatement le radical, -a, -u,-l: Coc-l-es, Orb-il-ius; -n : Semp-ro-nius, Lab~ er-ius; -s: fa-s-ius, Farius, Vol-u-s-ius; -/ : Pisi-d-ius, Tarc-on-t-ius apparaissent très souvent d'origine étrusque, car ils se retrouvent non seulement en Etrurie, mais aussi en Asie Mineure. Mais la terminaison -ias est latine. La plupart des noms romains sont donc ou entièrement étrusques et latinisés seulement par leur désinence, ou bien portent la marque étrusque dans une partie seulement de leurs suffixes. Nombreuses étaient donc les familles romaines qui tenaient leur nom d'un ancêtre étrusque ou étrusquisé. Les deux langues latine et étrusque paraissent, en outre, avoir à l'origine et durant une période assez longue, confondu dans la formation des noms propres leurs moyens de dérivation. L'impression qui se dégage de l'étude de l'onomastique confirme bien celle qui nous semble résulter d'un examen d'ensemble de la plus ancienne civilisation romaine; nous y voyons l'effet d'un mélange intime et prolongé des deux populations et de la prépondérance exercée par les Etrusques.
Ainsi, lorsque au Palatin ou au Forum, après avoir écarté les débris de l'époque impériale, l'archéologue pénètre plus profondément dans le sol, il y trouve les fondations de l'époque républicaine, reposant elles-mêmes sur de puissantes assises de gros blocs de tuf obscur dont il ne sait plus préciser ni l'époque ni la destination, mais qui, ensevelies sous la terre, et ignorées des Romains de l'époque historique, ont donné au sol sa consistance, son relief et la solidité de son assise. Pour peu que l'on s'attache à l'étude de la civilisation romaine, on aperçoit ainsi, à la base de son développement, les assises obscures mais puissantes que, dès le début de l'histoire, le peuple étrusque a posées partout en Italie. Les détails de l'histoire royale demeurent sans doute incertains. Mais on ne saurait révoquer en doute ni la réalité de cette période étrusque ni son extrême importance.
CHAPITRE III ROME ET L'ITALIE
I
la RÉACTION INDIGÈNE : LATINS ET SABINS.
De tout temps et avec une intensité particulière aux époques anciennes, l'Italie a dû présenter le contraste qui frappe encore aujourd'hui entre la brillante civilisation des villes et la rudesse des campagnes. Les cités, où se rencontrent et vivent les uns à côté des autres des représentants non seulement de toutes les contrées italiennes mais du monde, atteignent le niveau de culture le plus élevé. Les campagnes au contraire, celles surtout qui se trouvent à l'écart des grandes voies de communication et qu'isole à la fois la nature des lieux et la pauvreté de leurs habitants, poursuivent jusqu'à nos jours une vie extrêmement primitive. Que l'on s'écarte même à une faible distance de Rome et de Naples, on se trouvera au milieu d'une population demeurée extrêmement fruste. Une quasi-barbarie voisine avec le développement artistique et intellectuel le plus admirable.
Ces masses rurales et montagnardes que la civilisation moderne, aujourd'hui encore, a effleurées à peine, représentent à la fois une faiblesse et une précieuse réserve de forces. Ces familles arriérées ne prennent qu'une part minime à la vie sociale et économique du pays, mais elles préparent pour l'avenir une race d'hommes vigoureuse, capable de déployer, une fois éduquée, toute l'intelligence et le savoir-faire du citadin, en y ajoutant une énergie, une abnégation, un mépris de la peine et une force de résistance, que ne connaissent plus les fils de la ville habitués à une existence plus douce et plus facile. Du paysan italien l'artiste goûte le pittoresque et les allures primitives, l'homme politique et l'économiste déplorent l'anachronisme qu'il constitue. L'historien peut apprendre de son exemple, nous paraît-il, à concevoir de façon au moins intelligible et vraisemblable le caractère propre et les vicissitudes de la civilisation romaine primitive.
L'histoire de Rome et de l'Italie ancienne n'est pas seulement celle des villes étrusques ou grecques, mais aussi des nombreuses tribus indigènes des plaines, des collines et des montagnes.
Les Étrusques dans l'Italie centrale comme les colons grecs dans le Midi avaient, en créant des villes, introduit dans la péninsule les germes d'une vie politique et sociale nouvelle. Dans leurs cités, les industries, les arts, les idées issues du long développement des sociétés asiatiques et méditerranéennes, portaient des fruits à peine parfumés de la saveur proprement italienne. Mais tout autour d'eux, dans les vastes espaces de l'arrière-pays, les tribus indigènes prolongeaient les traditions de la vie primitive agricole et pastorale telles qu'elles s'étaient constituées durant les longs siècles de la préhistoire. Les campagnes échappaient à l'empire des villes.
A la différence des Grecs, les Etrusques avaient au moins essayé, semble-t-il, de pénétrer les masses indigènes qui les environnaient. Ils en avaient assimilé une partie qu'ils avaient admise avec eux dans leurs cités. Le progrès de leur puissance, dés le VIIème et surtout au cours du VIème siècle, nous fait assister de leur part à un véritable essaimage, depuis les villes côtières, vers l'intérieur des terres italiennes. La confédération des cités tyrrhéniennes avait conçu, semble-t-il, et entrepris de réaliser le vaste projet d'un empire italien, dominant par le moyen de nouvelles confédérations de villes, la vallée du Pô au nord de l'Apennin et les plaines de Campanie au sud du Latium (1). Pour la prospérité de ses industries qui avaient besoin de main-d'œuvre, pour le développement de son commerce qui exigeait une clientèle et pour la nourriture de ses villes, l’Etrurie s'était faite l’éducatrice des Italiens. Mais sa puissance, solidement assise sur la côte, se heurtait, au delà du Tibre, à la barrière des montagnes de l'Ombrie. Au sud de l'Ombrie, les Sabins, puis les divers petits peuples qui les séparaient des Samnites, demeuraient indépendants sur toutes les hauteurs qui, de la plaine côtière, s'élèvent peu à peu vers l'Apennin. Les tentatives de pénétration et les attaques étrusques avaient dû avoir pour effet de mettre en mouvement les peuples indigènes (2). La demi-éducation recueillie au cours des guerres défensives rendait, à la longue, redoutables pour les riches cités tyrrhéniennes le nombre et le courage des tribus montagnardes.
Dans le Latium, Rome étrusque avait réussi à détruire Albe latine. L'Étrurie avait assuré par la fondation de Tusculum la sécurité de la campagne romaine et des routes qui la parcouraient contre les retours offensifs des montagnards. Au début du ve siècle, en 499 ou 496, nous trouvons au lac Régille les Latins alliés de Tarquin en face des Romains (3), mais quelques années plus tard, en 493, les annales romaines mentionnent le traité de Spurius Cassius où il n'est plus question ni de Tarquin ni des Étrusques et qui sanctionne l'alliance entre les Latins et Rome. Les Latins, ce sont sans doute quelques villes étrusquisées comme Rome elle-même et dans les ruines desquelles se retrouvent des fondations et des débris d'architecture étrusque, ce sont les clara oppida dont parle Pline (4),
(1) Cf. homo, LXXXVI, ch. 3.
(2) Cf. homo, LXXXVI, ch. 3, § 4.
(3) T. Liv., 2, 19; Dion. hal., VI, 3.
(4) plin., N. H., 3, 69.
mais ce sont surtout les trente populi ou tribus qu'associe annuellement le sacrifice offert en commun au Jupiter latin du Mont Albain (1). Outre les Monts Albains, le Latium comprend les Monts Lépins demeurés aujourd'hui si sauvages et une partie des plaines qui s'étendent à leurs pieds. Durant tout le vc et la première moitié du ive siècle, jusqu'en 342, où Rome l'emporte définitivement sur Tusculum, Latins et Romains apparaissent étroitement unis. Il semble même bien que les intérêts latins, la politique de Tusculum, plus encore que celle de Rome, dominent la conduite de la Ligue latine (2). Les Latins ont pris sur la rive gauche du Tibre la prépondérance qu'y exerçait autrefois l'Etrurie.
La défaite de l'Etrurie à Rome et dans le Latium semble due à un autre peuple indigène, les Sabins, chez qui l'on aperçoit, sans doute, bien des traces de l'influence étrusque mais qui avaient réussi à sauvegarder pleinement leur autonomie. Ce sont les Sabins qui, vers la fin du vie siècle ou plutôt au début du ve siècle, ont enlevé Rome aux Etrusques (3).
La tradition romaine place en 509 la révolution républicaine contre Tarquin. C'est en 504 que les annalistes rapportaient l'arrivée à Rome du Sabin Atta Clausus, ancêtre de la famille des Claudii, avec tous ses clients dont 5 000 auraient été en état de porter les armes (4). Il s'agirait donc, si l'on peut prêter quelque foi à ce chiffre, d'une immigration Sabine de 20 000 à 25 000 personnes. Ce fut le noyau de la tribu Claudia dont les terres se trouvaient du côté de la Sabine, au nord de l'Anio.
D'autres familles romaines, comme celle des Valerii, revendiquaient également une origine sabine. Or les Fastes consulaires nomment plusieurs Valerii durant la première moitié du ve siècle. Des Claudes exercent le consulat en 495 et 471. En 487 apparaît un Sicinius Sabinus.
(1) A. grenier, LXXXI, p. 50-54.
(2) A. piganiol, Romains et Latins, dans X, 38 (1920), p. 285-316, partie. 297 sq.
(3) Cf. homo. LXXXVI, 1. II, ch. 1.
(4) E. albertini, La Clientèle des Claudii, dans X, 24(1904), p. 247 sq.
Enfin, en 460, la tradition mentionne un chef sabin, Appius Herdonius qui, par surprise, se serait emparé du Capitole. Jusqu'à l'époque de Caton, Rome fut souvent considérée comme une ville sabine et l'on admettait couramment que les Romains descendaient des Sabins. Nous croyons pouvoir nous rallier entièrement à l'hypothèse émise par M. Ettore Pais, d'une conquête de Rome par les Sabins, vers le milieu du vc siècle, au plus tard (1).
L'alliance avec les Latins et la conquête sabine marquent, au début de l'ère républicaine, une réaction des anciennes traditions indigènes contre la civilisation méditerranéenne et urbaine des Etrusques. Les Latins sont des paysans, plus que des citadins. Les Sabins sont surtout des montagnards. Au moment où les Romains conquirent la Sabine, ils y trouvèrent encore la population dispersée en petits groupes, dans des villages ou même des exploitations rurales isolées. Ce sont donc des campagnards qui prennent possession de la ville deRome. Les nouvelles familles qui, dès lors, y exercent la prépondérance politique, demeurent établies dans leurs domaines. Les gentes patriciennes sont essentiellement rurales. La terre constitue leur fortune. Les travaux agricoles occupent l'activité de tous leurs membres. Chefs et clients se rendent à la ville chaque neuvième jour, aux nondines, pour le marché et l'expédition des affaires publiques. Sur le Forum consacré jadis par les Etrusques on crie les oignons. L'inscription gravée sur le cippe mutilé du Forum rappelait, semble-t-il, qu'il était interdit de faire stationner les bêtes de somme (jouxmenta = fumenta) près du prétendu tombeau de Romulus. Non loin de là, les patres se réunissent au Comitium pour préparer les motions qui, tout à l'heure, les ventes achevées, seront soumises aux citoyens rassemblés pour quelques heures dans la cité. La campagne désormais l'emporte sur la ville, l'agriculture sur le commerce, la terre sur l'esprit.
(1) ettore pais, XXIlI, 2. 1909, p. 358-379, et CXXIII, 1. p. 347-364.
Le peuple romain devient un peuple de paysans, gouverné par une aristocratie de propriétaires fonciers.
Deux siècles de vie rustique, obscurs et presque aussi incertains que la période royale elle-même, succèdent ainsi au premier et brillant essor de l'époque étrusque. Ils ont consommé l'union du peuple romain avec la terre latine. Ils ont confirmé la nation, formée d'éléments divers, dans ses qualités de ténacité et d'âpreté. Durant tout ce temps, le peuple romain cultiva la terre et lutta pour la vie, contractant les traits dont la postérité lui a fait gloire, une énergie inlassable et un âpre patriotisme. Paysan et soldat, il a mis son idéal à conserver la terre de ses pères et à l'agrandir par la conquête. Dur pour lui-même, il l'est également pour les autres. Une fidélité obstinée l'attache à ses usages anciens et le détourne de toute nouveauté. L'étranger et ses mœurs, le voisin, est l'ennemi; un seul mot, hostis, désigne à la fois ce qui n'est pas romain et ce qui est odieux. La vertu et la simplicité romaines trouvent leur sauvegarde dans la plus complète étroitesse d'esprit.
La tradition classique a popularisé à l'envi le portrait idéal du Romain de l'ancien temps, adonné de toutes ses forces aux travaux des champs et ne quittant la charrue que pour prendre l'épée. C'est Cincinnatus (1), c'est Manius Curius que les ambassadeurs samnites tentent en vain de corrompre et qui repousse leur or, préférant rester pauvre mais commander aux peuples riches (2). Ce sont les lois somptuaires de la vieille république veillant jalousement sur les dépenses des particuliers (3).
(1) T. Liv., 3, 25-29. Les envoyés du Sénat le trouvent en train de labourer son champ au Transtévère ; ils l'invitent à mettre sa toge pour entendre l'ordre du Sénat qui lui confie la dictature. Seize jours plus tard, l'ennemi vaincu, Cincinnatus vient reprendre ses labours.
(2) Flor, 1, 13, 22. Les Samnites le trouvent dans sa modeste cabane, en train de cuire lui-même les navets de son dîner.
(3) Un trousseau de mariage ne peut compter plus de trois robes à bordure de pourpre. Interdiction des couronnes d'or, à la mode étrusque. Défense de louer des pleureuses pour les funérailles. Le nombre des joueur» de flûte, pour le plus grand enterrement, ne doit pas dépasser dix. En 275, le consulaire P. cornelius rufinus est rayé du Sénat pour avoir été trouvé possesseur d'une vaisselle d'argent pesant dix livres. Les ambassadeurs de Carthage, à la fin de la première guerre punique, reconnaissent chez tous les sénateurs romains qui les reçoivent le même service de table. Le vieux Romain se contente d'une vaisselle de terre noire et ne possède, en argent, que la salière, etc.
L'enthousiasme rétrospectif des historiens se complaît àopposer l'austérité romaine au luxe « étranger ». Il exalte cet esprit absorbé tout entier par les soucis pratiques. La spéculation abstraite, les jeux de l'imagination et de l'intelligence seraient demeurés totalement inconnus à cette dure vertu. Et cette rudesse aurait fait la force de Rome. C'est parce que le Romain était volontairement demeuré le plus fruste des peuples italiens qu'il aurait vaincu tous les autres.
Que ce tableau consacré par la tradition corresponde à quelque réalité, nous n'en voulons pas douter. Il représente sans doute exactement certains traits du caractère romain, disons même les traits dominants d'une partie de la population romaine, de la partie la plus importante de cette population, de celle au moins qui détenait le pouvoir politique. N'oublions pas cependant que, même aux mains des Latins et des Sabins, Rome demeure une ville et une grande ville. Les indigènes se sont emparés de la cité fondée par les Étrusques, mais ils ne l'ont pas détruite. L'ancienne population y est demeurée. Elle n'a pu y subsister, elle qui ne possédait pas la terre, que par son industrie. La prospérité et l'importance de Rome étrusque était due, semble-t-il, au grand commerce dont elle était l'entrepôt. Rome sabine conservait tous les avantages de sa situation au passage du Tibre, entre l'Italie du centre et celle du midi. Bon nombre de ses habitants durent continuer, quoique peut-être avec plus de difficultés qu'auparavant, à servir d'intermédiaires entre les villes étrusques et les populations du centre et du sud de la péninsule. Cette activité était, pour eux et pour la ville elle-même une inéluctable nécessité. Le sol assez maigre qui entourait Rome était incapable de nourrir une agglomération tant soit peu nombreuse. Obligée d'importer des céréales (1), la cité devait par l'industrie et le commerce se procurer les ressources nécessaires pour les payer. Il lui fallait travailler et produire pour subvenir à ses besoins alimentaires.
A côte de l'aristocratie campagnarde, ne voyons-nous pas apparaître du reste, dans l'histoire traditionnelle, et cela dès le lendemain de la révolution républicaine, une plèbe essentiellement urbaine dont le travail est jugé indispensable à la vie de la cité ? On connaît l'apologue des membres et de l'estomac conté à la plèbe retirée sur le Mont Sacré. Cette plèbe regrette les temps étrusques. Tandis que Porsenna assiège Rome, les chefs républicains craignent de la voir ouvrir les portes à l'ennemi et prennent contre elle toutes les précautions (2). Nous n'irons pas chercher ailleurs que dans cette population d'artisans et de commerçants constituée au cours de l'époque étrusque l'origine, si discutée, de la plèbe romaine. Elle est la population urbaine par excellence, conservant l'esprit, les traditions et les industries de Rome étrusque. Ses conquêtes politiques, du Vème au IIIème siècle avant notre ère, témoignent de son importance sans cesse croissante dans l'existence nationale. A côté du Latin et du Sabin rustiques elle représente l'intelligence et les arts méditerranéens.
Rome, du reste, n'a pu vivre deux siècles complètement isolée du reste de l'Italie. Par son commerce, par les mille besoins journaliers de la vie, elle se trouvait en relations avec l'Étrurie aussi bien qu'avec la Grande Grèce et la Sicile. Elle n'a pu manquer de subir leur influence. Grande ville elle-même, elle devait être nécessairement amenée à rivaliser avec les autres grandes villes qui l'entouraient ou qu'elle était amenée à connaître.
(l) T. Liv., 2, 34; 4,25; 4, 52,etc.
(2) T. Liv., 2,9.
La vie italienne générale à laquelle elle a nécessairement participé, ravivant les souvenirs l'époque étrusque, y dut entretenir de tout temps une vie intellectuelle et artistique, un degré de civilisation générale très supérieur à celui que conduit généralement à supposer l'austérité rigoureuse de l'antique vertu.
C'est sur ces éléments souvent méconnus de l'ancienne civilisation romaine que nous voudrions insister dans ce chapitre.
II
rome et les grecs d'italie.
Révoltée contre Tarquin et les Etrusques, Rome trouvait,au vc siècle, des alliés naturels en Italie. C'étaient les Grecs et, en particulier, les Syracusains qui tenaient le premier rôle dans la lutte de l'hellénisme contre l'Etrurie.
Les relations de Rome avec les Grecs d'Italie devaient se faire par terre et par mer. L'importance de la voie de terre qui, à l'est des Monts Albains et Lépins, par la vallée du Sacco, rejoint celle du Liris, ressort des interminables guerres des Romains et des Latins contre les Eques et les Volsques qui leur barrent le chemin. Mais les convois importants de matières lourdes, de blé par exemple, arrivaient à Rome certainement par mer. Etaient-ils transbordés à l'embouchure du Tibre, parvenant ainsi jusqu'à Rome par voie d'eau, ou plutôt le commerce maritime à destination de Rome n'emprunta-t-il pas longtemps le port étrusque de Caere ? Le premier établissement romain à Ostie, à l'embouchure du Tibre, ne semble pas remonter plus haut que le ive siècle. Caeré, d'autre part, quoique étrusque et refuge des Tarquins, paraît avoir entretenu de tout temps avec Rome des relations excellentes et, sans aucun doute, de part et d'autre également intéressées. Son port put fort bien, jusqu'à ce qu'au IIIème siècle Rome fût devenue une puissance maritime, avoir servi couramment aux Romains.
Ce que Rome demandait à la Sicile, c'était tout d'abord du blé. Nous trouvons chez T. Live mention d'achats de blé sicilien pour les années 486, 435, 411, avant notre ère. C'était de Sicile également que Latium aurait tout d'abord reçu son vin et son huile; ce sont des Siciliens qui auraient appris aux Latins à cultiver la vigne et l'olivier. On trouve, semble-t-il, un souvenir de ces influences civilisatrices dans l'édification à Rome, dès le début du Vème siècle, d'un temple à la déesse sicilienne Cérés associée, à la mode étrusque, à Liber (Bacchus) et à Libéra (probablement Demeter). L'architecture du temple était étrusque. Mais on avait fait appel pour la décoration à deux artistes grecs, Damophilos et Gorgasos, qui s'établirent à Rome. Le culte de Cérés paraît avoir été desservi jusqu'à l'époque classique par une prêtresse d'origine sicilienne. C'est aussi durant cette période que sont introduits à Rome Mercure, le Dieu grec du commerce, et Apollon, la grande divinité panhellénique du ve siècle.
Les Romains se trouvent également dès le ve siècle en relations avec Marseille. De Marseille serait venue Diane à qui l'on construisit un temple sur l'Aventin et dont la statue de culte reproduisait l'image d'Artémis, la grande protectrice des Phocéens. Un peu plus tard, en 396, lorsqu'après de longs efforts les Romains se sont emparés de Véies, c'est dans le Trésor de Marseille qu'ils déposent le cratère d'or offert à Apollon Delphique en reconnaissance des avis de son oracle, Après l'incendie gaulois, Marseille contribue à la reconstruction de Rome. Rome entretient à ce moment des relations si excellentes avec les Grecs d'Occident que les échos qui parviennent jusque dans la Grèce propre de sa prise par les Gaulois la représentent comme une ville grecque mise à mal par les Barbares hyperboréens (1).
Les convois de ravitaillement n'introduisent pas seulement dans le Latium des divinités helléniques, mais aussi des idées de toute sorte, morales, sociales et politiques.
L'aristocratie paysanne latine et sabine mise en possession d'une grande ville comme Rome devait être amenée à chercher des règles d'organisation. Où trouver les modèles d'un système politique pouvant donner satisfaction à la plèbe urbaine, sinon dans les cités florissantes et populeuses de Sicile et de Grande-Grèce ? Le Vème siècle est précisément pour elles une période non seulement d'extrême prospérité matérielle, mais de puissant rayonnement intellectuel. Pour la rhétorique, la Sicile devance l'Attique. Platon se réfugie à Syracuse, Hérodote vient s'établir à Thurium en Grande-Grèce, colonie athénienne fondée en 446 vers l'emplacement de Sybaris détruite par Crotone à la fin du VIème siècle. Cette région de l'Italie grecque, le Bruttium, apparaît même comme un terrain d'expériences sociales extrêmement curieuses.
C'est là que se localise, à la fin du vie et au début du Vème siècle, l'histoire de Pythagore, dont le souvenir a laissé une trace si profonde dans l'imagination de toute l'Italie et de Rome en particulier. Au retour de ses voyages en Orient et jusque dans l'Inde, après avoir essayé sans succès d'établir son école en Grèce, Pythagore vint enseigner à Tarente.
(1) plut., Camil., 22.
Puis, appelé par les Crotoniates, il exerça sur leur ville une véritable dictature morale. En 510, après la prise de Sybaris, il bâtit près des ruines de la ville l'institut fameux où il rassembla ses disciples en une sorte de congrégation mystico-philosophique. Nous ne pouvons juger de la qualité de sa doctrine. Les catéchismes conservés sous son nom ne nous en donnent qu'une image grossièrement superstitieuse. Mais ses découvertes mathématiques et ses théories cosmiques classent Pythagore au nombre des grands penseurs de l'antiquité. Son intelligence s'était appliquée à la morale et à la politique aussi bien qu'à la métaphysique. Nous saisissons dans toute l'Italie méridionale des traces nombreuses et persistantes de son influence. Son nom, au moins, était parvenu jusqu'à Rome dès une époque ancienne.
On sait que, malgré l'anachronisme évident, la légende romaine faisait de Numa un disciple de Pythagore. S'il est vrai que la tradition résume sous le nom de Numa le long travail d'organisation sociale et religieuse réalisé à Rome sous l'hégémonie sabine, l'anachronisme disparaît. La légende représenterait un souvenir de l'influence exercée sur Rome par les idées morales et par l'activité législative issues, dans l'Italie méridionale, des enseignements du grand philosophe.
En 454, la tradition romaine place la rédaction des lois des XII Tables. Ces lois auraient été inspirées de modèles grecs, lois de Solon ou autres. Les décemvirs chargés de les rédiger auraient été envoyés à Athènes et dans les villes grecques d'Italie avec mission de recueillir partout les dispositions les meilleures. Ont-ils été vraiment à Athènes ? Dans quelle mesure leur œuvre s'est-elle inspirée d'antécédents helléniques? Nous n'entendons pas le discuter ici, après beaucoup d'autres. Contentons-nous de remarquer que l'idée seule de rédiger un code indépendant de la religion et de publier des lois était toute grecque. Les vieilles lois indigènes, les lois royales, faisant partie du droit pontifical, sont demeurées jusqu'à la fin du IVème siècle le secret des collèges sacerdotaux. Les XII Tables représentent dans l'histoire du droit romain une véritable révolution dont l'origine, nous semble-t-il, né peut provenir que de cités grecques.
Parmi les institutions politiques romaines, celles dont la plèbe impose la création paraissent aussi calquées sur des modèles grecs (1). Le tribunat de la plèbe, institué selon la tradition en 471 ou 466, rappelle la magistrature des démarches de Syracuse. Les édiles plébéiens correspondent aux agoranomes de diverses cités grecques. La sacrosancta potestas paraît l'équivalent de l 'îspà xai acoÀcç àp/_7J des Grecs. Le droit d'asile, en tout cas, attribué à des sanctuaires grecs de Rome, comme le temple de Cérès, est bien une chose grecque. Grecque également est la statue de Marsyas, symbole de liberté, sur le Forum romain. L'institution même des colonies, qui commencera au IVème siècle, s'inspire évidemment de la colonisation grecque. C'est la Grèce qui, par l'intermédiaire de ses rejetons italiens, achève l'organisation de la cité romaine.
L'originalité romaine n'a donc jamais comporté vis-à-vis des régions d'Italie les plus avancées en civilisation, un isolement radical qui eût d'ailleurs été impossible. Elle a consisté au contraire dans la variété des emprunts faits à tous les peuples de la péninsule. Dès le Vème siècle, Rome semble s'être misé résolument à l'école des Grecs. Lorsque, au siècle suivant, elle conquiert l'Italie, elle prend possession non seulement des terres, mais aussi des civilisations qui, depuis quatre cents ans, s'y étaient développées.
(1) E. pais, CXX1I, p. 260 sq.
III
LA CONQUÊTE DES CIVILISATIONS ITALIENNES.
Au début du IVème siècle, les Gaulois prennent Rome et la brûlent. Cette catastrophe semble avoir eu pour conséquence l'essor politique de l'État romain. Ce n'est pas tant Rome, en effet, que son ennemie l'Etrurie, qui se trouvait frappée. A l'Étrurie, les invasions barbares avaient enlevé la plus riche peut-être de ses provinces, la plaine du Pô. Surtout, le voisinage des Gaulois, en faisant peser sur elle l'incessante menace d'incursions nouvelles, détournait vers le nord l'attention de la Confédération étrusque. Libérant les forces romaines, il leur livrait le midi de la péninsule.
Au milieu du IVème siècle, en 342, commence la guerre inexpiable contre les Samnites qui a, pour dernière conséquence, la prise de Tarente en 272 et la domination de Rome sur toute l'Italie méridionale.
Sur les vastes plateaux de l'Apennin central et dans les hautes vallées des petits fleuves qui en descendent aussi bien vers l'Adriatique que la mer Tyrrhénienne vivaient, depuis les siècles préhistoriques, les Samnites proches parents des Sabins. La vie est rude dans ce pays de montagne. Des crêtes couvertes de neige pendant la majeure partie de l'année, un climat rigoureux, une terre maigre, y rendent difficile l'établissement d'une population sédentaire nombreuse. La grande ressource, aujourd'hui encore, demeure l'élevage du bétail. De mai à septembre, les troupeaux de grands bœufs au pelage clair, des myriades de moutons et de chèvres, accompagnés de leurs pâtres, animent les hauts pâturages.
Du sommet de leurs montagnes, les bergers samnites apercevaient à leurs pieds, vers l'est, la vaste plaine d'Apulie avec ses ports et ses villes, et, vers l'ouest, la verte Campanie. Ces plaines désirables leur étaient nécessaires. Sitôt que l'hiver les chassait de la montagne, c'est là qu'il leur fallait aller paître leurs bêtes. Traversant à nouveau le village de la vallée, où était établie leur famille, ils s'acheminaient vers le bas pays qui, du reste, les attendait eux et leurs bêtes pour acheter laine, peaux et viandes. Ce va-et-vient de la montagne à la plaine est demeuré le rythme de la vie dans l'Italie méridionale (1).
Ces échanges entre les deux régions ne s'étaient pas établis et ne se poursuivaient pas sans heurts. La richesse des campagnes du bas pays et de ses villes était une tentation constante pour la pauvreté et la vigueur des montagnards. C'est par le Samnium, semble-t-il, que les populations auxquelles les Grecs ont donné le nom d'Osques sont descendues en Campanie et l'ont peuplée. A la fin du VIème siècle, à l'aube de l'histoire, des montagnards apparaissent de nouveau comme alliés des Etrusques dans la vallée du Vulturne. A la fin du siècle suivant, les Samnites submergent toute la plaine et s'emparent des villes étrusques, comme Nole et Capoue, aussi bien que des cités grecques comme Cumes et Naples, tandis que les montagnards de Lucanie occupent Paestum (2). Du côté de l'est, vers l'Apulie, nous ignorons les rapports qui purent s'établir entre les tribus de l'Apennin et les indigènes de la plaine, Dauniens, Iapyges, Peucétiens, Messapiens et autres (3). Nous trouvons en Calabre des cités grecques florissantes, Brindes et Tarente; en Apulie, sur la côte et à l'intérieur des terres, de grandes villes indigènes riches et prospères. Pour les unes comme pour les autres, les pâtres du Samnium apparaissent un danger constamment menaçant.
(1) A. grenier, La transhumance des troupeaux en Italie et son râle dans l'histoire romaine, X, 25, 1905, p. 293-328.
(2) nissen, CXV, II, 2, p. 681 sq., partie, p. 700, 893.
(3) Ibid., p. 835 sq.
En Apulie comme en Campanie, la civilisation des colonies grecques a conquis les indigènes, Osques ou Iapyges. Dès le milieu du Vème siècle, ces deux régions apparaissent comme les foyers d'une brillante éclosion, sinon intellectuelle, du moins artistique. En Apulie et en Lucanie, des ateliers fabriquent des vases peints qui, peu à peu, évincent les produits attiques. Quelques tombes régulièrement fouillées, parmi un grand nombre qui ont été négligées ou détruites, nous permettent de constater la diffusion dans ces provinces de moeurs, d'idées, d'industries comparables à celles de Tarente ou d'Héraclée. Il en est de même en Campanie, où vient se superposer à l'influence grecque celle des Etrusques qui ont dominé la province durant un siècle au moins, au moment de leur plus grande puissance. Là aussi une céramique peinte indigène rivalise avec les importations grecques. Là aussi quelques tombes, à Cumes, à Noie, à Capoue, à Paestum, nous font connaître une architecture et une peinture funéraires qui suivent sans un retard trop marqué le mouvement de l'art grec et étrusque.
Les Samnites de la montagne eux-mêmes apparaissent au IVème siècle en possession d'une civilisation qui imite celle de la plaine. Leur capitale, Aufidène, dans la haute vallée du Sangro, sur le versant adriatique de l'Apennin, était une citadelle d'architecture rustique, sans doute, mais établie selon les principes savants de la fortification grecque. Les édifices paraissent avoir été surtout de bois, établis sur des stylobates de pierre; ils n'en comportent pas moins des colonnes et semblent indiquer l'existence d'une vie sociale imitée de celle des cités de la plaine. Les tombes, en tout cas, donnent une haute idée de la richesse de ces montagnards et de l'abondance de leurs échanges avec les villes grecques ou hellénisées du bas pays (3). Ces tribus vigoureuses d'une région ingrate forment un peuple que ses relations avec l'Apulie et la Campanie ont élevé très au-dessus de la barbarie primitive.
C'est l'appel de Capoue en même temps, semble-t-il, que les intrigues de Tarente, qui déchaînent la guerre entre Latins et Samnites. Rome est l'alliée, tout d'abord, des villes de Campanie et d'Apulie. Ses armées occupent ces provinces; c'est là que se déroule la lutte. Les trois quarts de siècle durant lesquels elle combattit dans le midi tout hellénisé de la péninsule ont achevé son éducation.
C'est alors, semble-t-il, que les Romains commencèrent à connaître la richesse, le luxe qui en dérive et, par conséquent, la joie de l'art. T. Live insiste sur l'éclat des armes samnites dorées et argentées (1), la blancheur des tuniques, les bandes de pourpre, les hautes aigrettes; il énumère les profits en métal, cuivre, or et argent que rapporte chaque triomphe. Ce que nous connaissons de la civilisation osque confirme pleinement le tableau qu'il en trace(2). Une peinture d'une tombe de Capoue, par exemple, nous présente un cavalier samnite. Il est coiffé d'un casque de bronze à grand cimier, garni d'une abondante crinière ; de chaque côté se dresse un haut couteau de plume. Un justaucorps blanc est serré à la taille par une large ceinture à appliques métalliques. Une plaque de métal doré protège la tête du cheval au dessus de laquelle se balancent deux aigrettes. Le harnachement de cuir est garni de rondelles dorées.
(1) T. Liv., 9, 40.
(2) F. weege, Bewaffnung u. Tracht der Oxker, XII, 24, 1909, p. 141-162.
Les vases peints de Campanie nous montrent parfois le même armement, dans lequel une fantaisie barbare surcharge les formes grecques. Ces gens aiment la parade. Ils se font représenter sur les parois des chambres funéraires dans leur plus brillant appareil, partant pour la guerre ou revenant du combat chargés de trophées. Ces trophées ne sont autre chose que la tunique bariolée de l'ennemi vaincu fixée à la hampe d'une lance. On peut reconnaître là l'origine de nos étendards.
C'étaient de rudes et habiles combattants auxquels les Romains empruntèrent bien des détails d'armement. La cavalerie romaine adopta en particulier le javelot, le bouclier et les manœuvres de celle des Samnites de Campanie. Ceux-ci, en effet, avaient pu profiter des leçons de tactique des Grecs et il fallait que les Romains eux-mêmes fussent déjà en possession d'une éducation militaire savante pour avoir pu se mesurer avec eux. Le bien-être et la civilisation n'avaient pas porté atteinte à l'ardeur combative de ce peuple resté en communications constantes, amicales ou hostiles, avec ses congénères des montagnes. Les peintures funéraires en font foi. Si elles représentent parfois des dames à leur toilette ou des matrones chargées de lourds bijoux, elles figurent plus fréquemment encore des combats où l'on voit les adversaires déjà percés de coups se précipiter encore l'un sur l'autre, bouclier en avant, lance baissée ou brandissant le javelot.
Ces combats semblent n'être souvent, il est vrai, que des jeux. La présence de spectateurs et d'arbitres ne laisse, en certains cas, aucun doute à cet égard. On sait d'ailleurs qu'à Rome le nom de Samnites servit à désigner une catégorie de gladiateurs armés de toute pièce et que, jusque sous l'Empire, Capoue resta un centre important d'écoles de gladiateurs. Est-ce donc en Campanie que les Romains s'éprirent de ce genre de spectacle ? Le premier exemple en aurait été donné à Rome par M. et D. Brutus à l'occasion de la mort de leur père, en 264, c'est-à-dire peu après le moment où Rome avait établi son pouvoir en Campanie. Mais les combats de gladiateurs semblent une institution étrusque aussi bien que samnite. Le nom générique qui désigne à Rome les gladiateurs, lanista, est d'origine étrusque. Il est difficile de décider auquel de leurs voisins les Romains sont redevables de leur goût pour ces jeux sanglants. C'est en Grande-Grèce, en tout cas, à Thurium où ils mirent garnison en 285, qu'ils auraient emprunté les courses de chevaux. Mais les courses de chars devaient être, chez eux, beaucoup plus anciennes et leur avoir été enseignées par les Etrusques. La politique et les guerres qui conduisent leurs armées en Campanie, en Apulie et en Lucanie, mettent les Romains en contact direct avec de brillantes civilisations indigènes, filles de la civilisation grecque d'Italie. Loin de manifester vis-à-vis d'elles la moindre répugnance, ils s'empressent, au contraire, de les imiter.
Rome, à ce moment, devient la capitale de l'Italie gréco-étrusque. Maîtresse .de la majeure partie de la péninsule, elle bénéficie de tout l'effort de civilisation développé depuis des siècles par les peuples divers qu'elle avait successivement vaincus. En même temps que leurs dépouilles et une partie de leur richesse elle recueillait au moins quelques-uns des éléments de prospérité dont ils avaient disposé : industries, commerce, ports, voies de communication ; elle s'ouvrait à leurs hommes et, plus que jamais, à leurs idées et à leurs arts.
L'an 300 marque véritablement la fin du particularisme romain. Au régime de la cité succède un état politique et social nouveau, le groupement de nombreuses villes et de vastes régions en un ensemble encore mal défini, sans doute, mais soumis à une autorité centrale. Cette évolution si caractéristique suit de près, en Italie, la transformation correspondante de la Grèce et des pays hellénisés d'Asie, où l'empire d'Alexandre puis les royaumes des diadoques mettent fin à l'indépendance des cités et constituent de grands États fortement centralisés.
Si nous nous en tenions à la tradition historique romaine, telle qu'elle nous est présentée par Tite-Live, par exemple, nous nous représenterions cette conquête de l'Italie par les Romains comme la victoire d'un peuple demeuré rude sur des ennemis infiniment plus puissants d'apparence mais affaiblis par leur richesse et le raffinement de leur civilisation. Ce serait, en somme, une sorte de première invasion barbare. Rome aurait détruit l'hellénisme italien. En enlevant leur indépendance à ses voisins, elle aurait porté un coup fatal aux arts et aux industries qu'ils avaient créés. Fière de sa rudesse et méprisant ce luxe qui aurait perdu ses ennemis, elle serait demeurée imperturbablement fidèle à ses vieilles traditions jusqu'au moment où la Grèce vaincue aurait enfin séduit sa sévérité. La conquête du monde méditerranéen après celle de l'Italie serait de même le triomphe d'un peuple ayant conservé toute la vigueur de sa jeunesse et son énergie rustique sur les civilisations plus avancées de l'Orient. L'histoire de Rome montrerait uniformément la supériorité de la grossièreté sur le développement de l'esprit.
Ce thème si souvent développé ne nous paraît pas correspondre à la réalité. Nous ne prétendrons pas sans doute que la Rome du ive siècle avant notre ère ait été semblable à Capoue ou à Tarente. Mais aucun fait non plus n'impose l'image d'une Rome demeurée barbare et détruisant brutalement autour d'elle, sans en tirer profit, tout le développement ancien de la Grande-Grèce et de l'Etrurie. Si les Romains ont vaincu tous les autres peuples d'Italie c'est que, à certains points de vue au moins, ils étaient leurs égaux en intelligence. La force brutale peut parfois, sans doute, l'emporter sur la civilisation, mais c'est qu’alors la civilisation elle-même souffre de quelque vice interne qui fait sa faiblesse. Il ne nous paraît pas, autant que nous connaissions les civilisations anciennes de l'Italie, qu'elles se soient trouvées ainsi frappées à mort. Il ne semble même pas qu'elles soient mortes de la conquête romaine.
Sans doute Rome a-t-elle beaucoup pillé et détruit en Italie. Elle s'est enrichie des dépouilles des vaincus. Mais aussi bien en Grande-Grèce qu'en Etrurie elle a pénétré dans beaucoup de villes, à Capoue, à Thurium, à Canosa, comme alliée et protectrice plutôt que comme ennemie. Tarente elle-même, prise de vive force, n'a pas été détruite et reparaît florissante au temps des guerres puniques. Nous ne croyons donc pas que l'on puisse dater de l'apparition des armées romaines l'arrêt des industries d'art, notamment delà céramique peinte, dans l'Italie méridionale. Le fléchissement que marquent ces industries durant la première partie du IIIème des causes plus générales, notamment à l'essor nouveau de l'hellénisme après Alexandre et aux changements dans les goûts esthétiques qui en furent la conséquence. La Grande-Grèce se trouvait dès lors en retard sur le monde hellénique. Nous la voyons, sous la domination romaine, rattraper ce retard dès la seconde moitié du me siècle avec ses céramiques du type de Calés, près de Capoue. Admettons que Rome se trouvât de même en retard sur la Grande-Grèce. Elle n'en participait pas moins à la même civilisation d'origine grecque, implantée en Italie depuis l'établissement des colonies grecques et qui s'était répandue assez uniformément, dans les diverses provinces de la péninsule, depuis le Bruttium jusqu'à l'Étrurie et à la vallée du Pô. Même après la réaction sabine et latine Rome n'a pas cessé de participer à la vie générale de l'Italie. Ses relations avec la Sicile et la Grande-Grèce d'abord, puis ses conquêtes dans le sud et le centre, n'ont fait qu'égaliser peu à peu, pour ainsi dire, entre elle et les régions plus précoces ou plus favorisées par les circonstances, le niveau général de la civilisation.
IV
LE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE A ROME, DU Ve AU IIIe SIÈCLE.
Les historiens romains semblent s'être fait comme un point d'honneur de mettre leur cité à part du reste de l'Italie et de l'opposer aux peuples qu'elle a vaincus. Nous croyons au contraire qu'il faut l'en rapprocher. Nous imaginons à Rome un développement parallèle à celui des autres grandes villes de la péninsule. Essayons d'en retrouver au moins quelques indices.
Dès l'ancienne république, les Romains apparaissent grands constructeurs; ils ne tardent pas à se révéler bons architecte Leur piété multiplie les temples. Dès 484 ils auraient dédié sur le Forum, un temple à Castor (1). En 433, ils en élevèrent un autre à Apollon sur le Champ de Mars (2). On a retrouvé récemment quelques vestiges de ces édifices vénérables et l'étude en a donné lieu à quelques constatations fort intéressantes (3).
Dans les soubassements du temple de Castor datant di l'époque d'Auguste on a reconnu une partie des fondations de l'édifice plus ancien. Ce sont de gros blocs de tuf noirâtre assez grossièrement taillés, dont la disposition est identique àcelle des assises qui forment le soubassement du temple de Jupiter Capitolin ou des très vieux murs que l'on aperçoit encore au Palatin. Du temple d'Apollon on a retrouvé, près du théâtre de Marcellus et du portique d'Octavie, un fort mur d'appui qui devait en soutenir le podium. Les blocs de tuf qui le composent apparaissent très finement et soigneusement taillés et leurs rangées accusent en leur milieu une légère convexité de 0,045 (4), artifice d'architecture imaginé en Grèce au ve siècle, pour corriger l'erreur naturelle de la vision. Un progrès considérable a donc été accompli au cours du demi-siècle qui sépare la construction du temple de Castor de celle du temple d'Apollon, et ce progrès nous montre les architectes qui travaillèrent à Rome au courant des procédés les plus adroits de la technique grecque.
D'autres restes d'anciens temples reconnus dans le sous-sol de Rome et identifiés permettent de constater que jusque vers le milieu du IIIème siècle, c'est-à-dire à la veille de la première guerre punique, l'ordonnance toscane domina à Rome, aussi bien que dans tout le Latium.
(1) T. Liv., 2, 42.
(2) Ibid, 4, 25; 29.
(3) delbrueck, LIX.
(1) R. delbrueck, LIX, p.8 v t 14.
C'est seulement au début du II ème siècle que le plan grec, de forme allongée, et les ordres grecs prirent définitivement la place de l'ancienne tradition architecturale étrusque.
Ces vieux temples romains ne sont, comme les temples étrusques, que des édifices en bois revêtus de terres cuites polychromes. Mais cette décoration plastique suit le mouvement général de l'art grec. Les figures s'y distinguent du simple ornement et se multiplient. Outre les acrotères et lesfrises, on voit apparaître de véritables frontons dans lesquels figurent les dieux de la mythologie hellénique. Les débris trouvés dans de petites localités du Latium comme Antemnae, Ardée ou Lanuvium ne se distinguent pas des restes beaucoup plus abondants trouvés à Faléries et pour lesquels la destruction de la ville en241 fixe une date extrême. Ces reliefs et ces statues en terre cuite apparaissent identiques en Etrurie, en Ombrie, en Latium et en Campanie. Ils sont le produit d'un art véritablement italique, si bien que l'on est naturellement amené à supposer l'existence d'artistes nomades, appelés par les diverses cités qui avaient un temple à construire et à décorer. Rome ne s'est pas tenue à l'écart de ce mouvement artistique. Une belle statue de terre cuite représentant une divinité féminine assise, trouvée près du Palatin et qui se voit au musée des Conservateurs, provient du fronton de quelque temple romain disparu.Les édifices religieux qui s'élevèrent à Rome du V ème au III ème siècle avant notre ère devaient comporter la même décoration figurée que ceux des autres villes d'Italie. Ces temples étaient ornés de peintures. Les témoignages des écrivains antiques ne laissent aucun doute à cet égard. Des artistes grecs, nous l'avons vu, avaient été mandés à Rome pour orner le temple de Cérès et ils s'étaient établis définitivement dans la ville. Pline, à qui nous devons ce renseignement, nous montre en 304 Fabius Pictor, un Romain de l'aristocratique famille des Fabii, décorant le temple de Salus. II affirme, à ce propos, que la peinture, très ancienne en Italie, a toujours été fort appréciée des Romains. Il dit avoir admiré à Ardée et à Lanuvium l'étonnante fraîcheur de peintures qu'il estime plus anciennes que Rome même et où il aurait reconnu Atalante et Hélène représentées nues et d'un excellent dessin (1). C'est à Rome même que Quintilien rapporte avoir vu d'anciennes peintures sur lesquelles il aurait déchiffré les noms de Alexanter, Cassantra, Hecoba, Pulixena (2). Cette orthographe est celle que nous retrouvons sur les miroirs et les cistes du Préneste du IV ème siècle Elle est due à l'influence étrusque et nous indique que c'est par l'intermédiaire de l'Etrurie que les fables du cycle troyen étaient parvenues à Rome. La peinture les y avait donc popularisées en même temps que dans le reste de l'Italie.
C'est aussi dans quelque temple, fort probablement, que l'esclave mis en scène par Plaute, dans les Captifs (3), avait vu la représentation des tourments de l'Achéron. Ces scènes infernales étaient des motifs courants, à partir du IV ème siècle, dans la peinture funéraire étrusque (4). Leur reproduction à Rome y témoigne de la diffusion à la fois des idées et de l'art étrusques. Dès une époque bien antérieure au début de la littérature le peuple romain disposa donc, pour s'instruire et des légendes grecques et des idées étrusques, de ces représentations figurées qui sont les livres des ignorants.
(1) plin., Nat. Hist., 35, 17.
(2) quintil., Inst. Orat., 1, 4, 16.
(3) plaut., Cap!., 998 sq.
(4) weege. CLXIX, p. 25 sq.
Nous trouvons même, dès ce moment, chez lui, l'expression d'une tendance artistique originale destinée à recevoir plus tard, dans la sculpture de la fin de la République et de l'époque impériale, un développement majestueux : la représentation de faits historiques (1). Nous faisons allusion, ici, à un fragment de fresque trouvé à l'Esquilin sur la paroi d'une ancienne chambre funéraire (2). Les peintures sont distribuées en trois bandes superposées : en bas, quelques restes d'une scène de combat ; immédiatement au-dessus, deux personnages de grande taille sont en conversation. L'un, le Romain Q. Fabius, est vêtu de la toge et escorté de quatre personnages plus petits, en tunique ; l'autre, M. Fannius, porte un lourd manteau blanc sur l'épaule gauche et tend la main droite vers son interlocuteur. Nous retrouvons ce même personnage, M. Fannius, au registre supérieur, coiffé cette fois d'un casque à aigrette de type nettement samnite. Il s'avance au-devant d'un personnage très mutilé tenant la lance au pied et qui doit être Fabius : il est question sans doute de la reddition d'une place forte dont on aperçoit le mur et les créneaux. Ces tableaux sont une imagerie naïve et non une œuvre d'art. C'est là précisément leur intérêt. Les œuvres d'art s'inspiraient des motifs traditionnels, de la mythologie surtout, ou des sujets courants soit en Grande-Grèce, soit en Etrurie, pompes triomphales ou scènes funéraires. Ici, au contraire, nous apercevons l'effort maladroit pour rendre sans modèle des faits particuliers à la gloire d'un personnage qui les a accomplis. On ne saurait préciser qui est ce Q. Fabius. Son adversaire Fannius est également inconnu ; c'est, sans aucun doute, un chef samnite. La peinture est donc un document représentant quelque épisode des guerres samnites de la fin du ive ou du début du m6 siècle.
(1) E. courbaud, LII, p. 195 sq.
(2)III, 17 (l889), p. 340-350. pl. XI, XII; XIII, 6 (1891), p. 111; LI. VI, 29, 827.
C'est une œuvre romaine originale, la première de ces compositions figurées inspirées par l'histoire qui devaient raconter au peuple les exploits accomplis par ses chefs.
Une autre catégorie d'oeuvres d'art paraît avoir été, dès l'époque ancienne, particulièrement abondante à Rome: celle des statues représentant non pas des dieux ou des héros mythiques, maisdes personnages réels. Laissons de côté, comme invérifiables et vraisemblablement entachées au moins de fantaisie, les mentions qui sont faites de statues des rois dédiées par eux-mêmes sur Je Capitole aussi bien que de portraits des fondateurs et des premiers défenseurs de la République, de Brutus, d'Horatius Coclès, ou d'héroïnes comme Lucrèce et Clélie. II est cependant difficile de douter qu'une statue dans laquelle on croyait reconnaître l'augure Attus Navius se soit dressée longtemps près de la Curie et l'on ne saurait rejeter en bloc toute la tradition relative aux anciens monuments de Rome depuis que, à l'endroit précis où les textes signalaient la tombe monumentale de Romulus ou de Faustulus, sous le pavage noir du Forum, on a retrouvé en effet les soubassements d'un monument ressemblant à un tombeau, quelle qu'en ait été la destination véritable (1).
La série des monuments honorifiques se serait poursuivie, si l'on en croit la tradition, durant tout le V ème et le IV ème siècle, Les ambassadeurs romains massacrés par les gens de Fidènes en 438, Camille le vainqueur de Veies en 396, C. Menius vainqueur des Latins. Tremulus vainqueur des Samnites, auraient eu leurs statues. Les témoignages concernant des œuvres antérieures à l'incendie gaulois (390) sont évidemment sujets à caution. Mais les monuments de l'époque des guerres samites ont subsisté jusqu'au Ier siècle.
(1) H. thédenat, CLVI, p. 76 sq.
Ce sont les remaniements de Sylla qui firent disparaître du Comitium les statues de Pythagore et d'Alcibiade élevées au cours de ces guerres sur l'ordre d'Apollon Pythien (1). Malgré l'incertitude qui entoure les exemples cités pour l'époque ancienne, nous pouvons admettre que la prétendue sévérité romaine n'a jamais interrompu la tradition étrusque de dresser en public les portraits des citoyens qui avaient utilement servi l'Etat. Ce qu'étaient ces statues honorifiques de l'ancien temps, un exemple célèbre nous permet de nous le figurer : c'est la belle statue de l'Arringatore, trouvée au XVI ème siècle près du lac Trasimène et conservée au Musée archéologique de Florence. L'œuvre est un peu plus récente que l'époque qui nous occupe. Elle ne doit dater que du cours du III ème siècle, d'un temps, en tout cas, où, postérieurement à la conquête de l'Etrurie, l'art étrusque et l'art romain ne se distinguent plus. C'est une statue de bronze d'une technique parfaite, représentant un personnage, Aulus Metilius, par ailleurs inconnu. Drapé dans sa toge, levant le bras pour réclamer le silence, l'orateur se dresse de tout son corps pour dominer la foule. Les rides du front, une légère contraction de la bouche font attendre, pour ainsi dire, la pensée qui va s'exprimer. La figure est austère et grave, l'ensemble profondément vivant. Une telle œuvre apparaît comme le produit d'une longue tradition de l'art du portrait. Elle annonce par un chef-d'œuvre l'innombrable série des statues honorifiques romaines.
A côté de l'architecture et de la décoration religieuses, l'ancienne république a donc connu un art profane. Les jeux du souvenir et de l'imagination ne lui étaient pas étrangers. Loin de vouloir opposer une austère nudité à l'abondance des monuments qui ornaient les cités grecques et étrusques, elle paraît plutôt avoir, de tout temps, essayé de rivaliser avec elles.
Mais a-t-elle possédé aussi des industries d'art ?
(1) plin., N. H., 34, 26; cf. E. pais, CXXI, I, 594.
Le IV ème siècle est marqué dans toute l'Italie, depuis Tarente jusqu'à Chiusi et à Volterra, par une floraison nouvelle du travail artistique. La guerre du Péloponnèse et, surtout, la désastreuse entreprise d'Athènes contre Syracuse, avaient mis fin à la prépondérance de l'industrie attique dans toute la Méditerranée. Vers le milieu du V ème siècle les ateliers de la Grande-Grèce avaient commencé à fabriquer, pour la clientèle italienne, des vases peints semblables à ceux de l'Attique. Au début du IV ème siècle ils sont maîtres du marché. Non loin de Rome, Faleries, ville indigène, mais étroitement soumise aux influences étrusques, apparaît comme un centre de fabrication de premier ordre. Ses produits sont supérieurs comme technique et même comme art à ceux de l'Etrurie. Les modèles de Tarente et de la Grande-Grèce ne semblent pas étrangers à ce développement particulièrement brillant de la céramique falisque.
Une autre ville indigène, voisine et autrefois rivale de Rome, Préneste, s'était fait, au même moment, une spécialité de la ciselure sur bronze. De Préneste proviennent bon nombre de miroirs gravés et de cistes. La fabrication des miroirs était une industrie primitivement grecque, transplantée en Etrurie dès le début du V ème siècle et qui, de là, était passée à Préneste. Les cistes au contraire, au moins sous la forme qu'elles prennent à Préneste au IV ème siècle, représentent une industrie proprement locale. Ce sont des boîtes entièrement métalliques, destinées à contenir les objets de toilette et les bijoux des dames. Le corps, généralement cylindrique, en est couvert de fines gravures exécutées au burin dont les motifs sont ceux des vases peints contemporains de l'Italie méridionale, II repose sur trois pieds moulés figurant le plus souvent une patte de lion, surmontée parfois d'un motif figuré. Le couvercle a pour poignée un petit groupe de deux ou de trois personnages.
Le style de la plupart des cistes est mou et assez négligé. Miroirs et cistes correspondent, par leur caractère plus industriel qu'artistique ainsi que par les sujets représentés, à la céramique peinte de Faléries.
Or la plus belle parmi les cistes de Préneste — et les plus belles sont les plus anciennes, — la ciste Ficoroni, au Musée de la villa du pape Jules depuis 1913, porte une signature qui en localise la fabrication à Rome même : Dindia Macolnia fileai dedit. Novios Plautios med Romai fecid. (Dindia Macolnia m'a donnée à sa fille. Novios Plautios m'a faite à Rome) (1).
La ciste provient de Préneste même ; le nom de Dindia Macolnia est prénestin. Le prénom de l'artiste au contraire est campanien. Le nom de Plautios est celui d'une grande famille romaine. Novios Plautios semble avoir été quelque affranchi d'origine campanienne fixé à Rome. Quelle a été sa part dans la confection de la ciste ? La fabrication comportait en effet plusieurs opérations qui n'étaient pas nécessairement exécutées dans le même atelier ni surtout par le même artisan. Les pieds et le groupe servant de poignée au couvercle étaient fondus à part ; plusieurs se ressemblent ; ils étaient adaptés un peu au hasard dans l'atelier de montage. Le monteur recevait sa tôle de bronze toute ciselée, il la coupait en entamant parfois le sujet figuré ; la preuve en est que les anneaux de suspension fixés dans le corps de la ciste couvrent souvent des parties importantes du dessin. Quoique incisée sur le couvercle, l'inscription doit se rapporter à la partie principale et la seule artistique du travail, à la ciselure du bronze qui forme le corps de la ciste. C'est donc la gravure même qui a été exécutée à Rome.
Elle représente un épisode de la légende des Argonautes.
(1) F. behn, XXIX; martha, CIV, p. 535.
Jason et ses compagnons viennent d'arriver chez les Bébryces et ils débarquent pour aller faire de l'eau. Le roi du pays,
Amykos, Veut le leur interdire. Pollux le bat au pugilat et le lie à un arbre. La Victoire couronne le héros, Castor et quelques-uns des Argonautes l'entourent, tandis que d'autres descendent du navire avec des tonnelets ou se reposent soit sur le pont, soit sur la rive. La scène, compliquée, est d'une composition savante et d'un dessin excellent. Comme l'indique la répétition du même sujet ou de motifs isolés sur différentes cistes, sur des miroirs et même sur des vases peints de l'Italie méridionale, elle s'inspire d'une œuvre célèbre de la grande peinture, fort vraisemblablement d'une œuvre de Polygnote. L'influence de l'art attique du milieu du V ème siècle s'exerce donc à Rome, à environ un siècle de distance, par l'intermédiaire, très certainement, de l'Italie méridionale.
On a proposé, depuis longtemps, sur la foi de l'inscription de la ciste Ficoroni, de localiser à Rome la fabrication des cistes et des miroirs dits de Préneste (1). Les résistances opposées à une telle hypothèse apparaissent pleinement justifiées. L'art de la ciste Ficoroni est beaucoup plus fin que celui de la plupart des cistes et des miroirs de Préneste. Il représente, semble-t-il, l'art d'une capitale, en face de celui d'ateliers provinciaux. Si la majeure partie des cistes trouvées à Préneste est bien de fabrication locale, la signature de Novios Plautios indique cependant que le centre principal de cet art, ou du moins l'intermédiaire entre l'Italie méridionale et la cité èque subordonnée politiquement à Rome depuis le milieu du IV ème siècle environ, dut être Rome (2).
Telles sont les analogies de style et de sujets entre les cistes de Préneste et les vases peints de Paieries que si Rome a fourni des modèles aux unes, elle a dû également exercer une influence sur les autres. La ciste Ficoroni nous la montre en possession d'une tradition artistique émanée directement de la Grande-Grèce. Les circonstances historiques qui, durant la seconde moitié du ive siècle, mêlent si étroitement l'histoire de Rome à celle de l'Italie méridionale, expliquent aisément que des artistes de Tarente, de Capoue ou autres lieux soient venus s'installer à Rome comme, un siècle plus tôt, des artistes attiques étaient venus s'établir en Grande-Grèce. Rome elle-même serait ainsi devenue le foyer secondaire d'où cet art italo-grec aurait rayonné dans les diverses régions de l'Italie centrale sur lesquelles s'affirmait de plus en plus sa suprématie politique.
(1) gamurrini, XIII, 2 (1887), p. 228 sq.
(2) ducati, LXVI, p. 469.
La fable grecque qui devait un siècle plus tard inspirer les débuts de la littérature romaine se trouvait donc depuis longtemps popularisée dans le Latium par l'art industriel aussi bien que par les arts majeurs, peinture et sculpture. La veine réaliste elle-même n'y était pas inconnue. Une autre ciste de type prénestin, mais de provenance inconnue, nous présente les préparatifs d'un repas, véritable illustration des scènes si fréquentes dans la comédie de Plante et de Térence. Les légendes qui accompagnent le dessin pourraient figurer dans un dialogue comique (1). Confice piscim : vide le poisson, lit-on devant un personnage fort mutilé qui semble occupé à cette besogne ; un autre paraît en train de dépecer un quartier de bœuf pendu à des crocs ; deux autres serviteurs se font face, l'un présentant un plat sur lequel sont disposés des morceaux de viande, l'autre lui rapportant un plat vide : cofeci, j'ai préparé la viande, dit le premier; feri porod, coupe encore, répond le second ;
(1) L. duvau, Ciste de Préneste, X, 10 (1890), p. 303-316, pi. 6.
— autour d'un fourneau, un cuisinier tourne la viande qui cuit dans une bassine : made mi recie fais-moi cuire cela royalement ; l'autre saisit les morceaux avec une fourchette et les met sur un plat : misce sane, tourne bien, dit-il à son compagnon ; enfin un autre cuisiner court vers la droite portant deux broches auxquelles sont enfilés des morceaux de viande : asom fero, j'apporte le rôti : ou je porte à rôtir. Le tout est intitulé cœnalia, d'une écriture d'ailleurs différente et qui semble plus ancienne que celle des autres inscriptions. La ciste ne doit dater que de la fin du ive siècle ; la graphie recie = régie la place avant la réforme orthographique d'Appius Claudius. Elle est d'un art rapide et peu soigné mais aisé et qui s'inspire du détail familier de la vie commune. Des scènes analogues se rencontrent sur les parois des tombes étrusques dès la fin du Ve ou le début du ive siècle. Les influences des diverses régions de l'Italie ancienne se donnent donc rendez-vous, pour ainsi, et se croisent dans le Latium. Mythologie et réalisme s'y rencontrent. L'art figuré a précédé, de longue date, l'éclosion de la littérature et préparé peu à peu les esprits à en comprendre les sujets et à en goûter les tendances.
V
la MONNAIE ROMAINE.
Tous ces indices d'une vie intellectuelle et artistique fleurissant à Rome, dès le ve siècle probablement et certainement au ive siècle, apportent un démenti à la tradition classique de la longue rudesse romaine. A l'incertitude qui résulte de cette contradiction, une série importante de documents fournissent une précieuse mise au point. L'histoire des premières monnaies romaines témoigne à la fois d'une longue fidélité aux usages primitifs et d'une remarquable souplesse d'esprit. Tout en maintenant obstinément pour eux-mêmes leurs habitudes, les Romains apparaissent très au courant des innovations réalisées par les autres peuples d'Italie et s'entendent à en tirer profit.
L'étalon de la valeur marchande chez les paysans du Latium était le bétail. Pecunia, la richesse, est un dérivé du mot pecus qui désigne le troupeau. Jusqu'à l'époque de Varron, les tribunaux romains continuèrent à formuler en bœufs et en moutons le montant des amendes qu'ils infligeaient (1). Cependant, dès le début de la République, des tables de conversion officielles permettaient de réduire les têtes de bétail en monnaie courante.
D'autre part, dès le premier âge du fer et peut-être même auparavant, le cuivre apparaît employé comme monnaie dans l'Europe centrale aussi bien qu'en Italie. Jusqu'en pleine époque historique il demeura l'étalon normal de la valeur chez les différents peuples italiques, comme l'or l'était en Asie et l'argent en Grèce.
(1) varr., de R. R., 2, l, 9.
A l'époque préhistorique, le cuivre était employé brut, en fragments que l'on pesait : c'est l'aes rude. L'aes rude continue à figurer dans les trouvailles latines à côté de monnaies frappées de la fin du III ème ou du début du II ème siècle avant notre ère, Durant toute la période du droit civil, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la République, la cérémonie juridique de la vente continua à se faire per aes et libram, c'est-à-dire avec un morceau de métal brut et la balance.
De bonne heure dans toute l'Italie centrale, le bronze destiné à servir de monnaie se rencontre souvent fondu en pains de formes diverses et de poids essentiellement variables ou en broches qui se prêtaient à une division facile. La broche, obelos, représente une monnaie primitive en usage sur les côtes méditerranéennes et notamment en Etrurie jusque vers le VI ème siècle avant notre ère. A ce moment on commence, dans l'Italie du nord et du centre, à marquer les pains de métal rectangulaires servant de monnaie d'un signe rudimentaire, d'une nervure médiane à laquelle d'autres traits obliques donnent l'apparence d'un rameau sec ou d'une arête de poisson, ou bien encore d'une étoile, d'une demi-lune. C'est l'aes signatum. La tradition romaine est peut-être exacte en attribuant à l'un des rois, à Servius Tullius, l'innovation d'avoir marqué d'un signe les pains de bronze destinés à remplacer le bétail des paiements rustiques. Mais elle anticipait en mentionnant dès cette période des figures en relief de bœufs ou de brebis. C'est de beaucoup plus tard, du début du III ème siècle seulement, que datent ces lourdes pièces rectangulaires marquées d'un bœuf. A la même série appartiennent en effet des pains sur lesquels se trouve figuré un éléphant, allusion évidente aux victoires sur Pyrrhus. On a donc continue à Rome à fondre de ces monnaies primitives alors même que des types beaucoup plus parfaits se trouvaient depuis longtemps en usage.
C'est pendant la seconde moitié du iv8 siècle que les Romains commencent à frapper une véritable monnaie, l’aes grave, de forme lenticulaire, d'une valeur et d'un poids calculés suivant une échelle de division fixe et garantis par l'empreinte de l'État. Ce sont les pièces bien connues à tête de Janus, portant une proue au revers. L'unité est l'as, correspondant à la livre de cuivre de 272 grammes et se divisant en 12 onces. On trouve, comme multiples, le double as : dupondius et la pièce de cinq as : quincussis; comme sous-multiples, le semis (1/2), le Triens (1/3), le sextans (1/6) et l'uncia (1/12). Les émissions se poursuivent concurremment avec celles de pièces rectangulaires, permettant de constater à partir du début du III ème siècle une réduction progressive du poids de l'unité jusqu'aux environs de 36 grammes, limite qui semble avoir été atteinte au moment des guerres puniques. La monnaie de cuivre n'est plus, dès lors, qu'une monnaie fiduciaire.
L'histoire fixe à l'année 269, après la prise de Tarente et à la veille de la première guerre punique, le début de la monnaie d'argent romaine. Est-ce à dire que Rome se soit contentée jusque-là de sa monnaie de cuivre? On trouve couramment dans l'Italie du centre et surtout du sud des pièces d'argent portant l'épigraphe romano, puis roma, contemporaines du début de l'aes grave. C'est une monnaie que les Romains faisaient frapper à Capoue pour les besoins de leur politique dans l'Italie méridionale. Elle repose sur le système décimal et non plus duodécimal. L'unité en est le didrachme de 6gr,82 représentant 1/5000 du talent grec. Des monnaies analogues frappées au même moment en Etrurie montrent que les mesures gréco-romaines servent désormais de règle aux émissions étrusques. Du reste, Rome s'était elle-même préoccupée de trouver une commune mesure entre sa nouvelle monnaie et l'étalon d'argent traditionnel en Etrurie, le scrupule de lgr,137. Le didrachme campano-romain représente exactement six scrupules. La monnaie d'argent romaine de la fin du ive siècle était donc faite pour circuler dans toute l'Italie.
Lorsque, en 269, Rome se trouva plus riche que l'Italie méridionale et l'Etrurie vaincues, elle jugea bon de concentrer chez elle l'activité monétaire que depuis plus d'un demi-siècle les ateliers campaniens exerçaient pour son compte. Une nouvelle réforme métrologique rapprocha non seulement sa monnaie mais l'ensemble de ses mesures du type attique qui prévalait à ce moment sur toutes les côtes méditerranéennes. De la drachme attique de 4gr,37 elle fit son denier; le quinaire ou double sesterce de 2gr,18 équivalait au triobole grec. Elle conserva cependant l'étalon étrusque du scrupule qui représentait 2 dixièmes et demi du denier et devint !e sesterce : semis tertius = 21/2. Une vieille tradition qu'elle se refusait à rejeter la liait en effet à la monnaie d'argent étrusque. Avant qu'elle ne fût attirée dans l'Italie méridionale et qu'elle ne disposât des ateliers monétaires de Campanie, c'est d'Etrurie qu'elle avait dû recevoir la monnaie d'or et d'argent dont elle avait besoin.
Depuis le ve siècle, en effet, nous trouvons en Etrurie une monnaie d'argent à tête de Gorgone archaïque dont l'unité semble être une pièce pesant 8gr,53, qui correspond en valeur au quincussis (5 as) de cuivre romain. Au ive siècle, avant d'imiter Rome, l'Etrurie frappe un statère d'argent de 11gr,37, correspondant au decussis (10 as) de cuivre. Auparavant encore, [dès le vie siècle, des pièces d'or et d'argent d'Asie Mineure se trouvent en Etrurie, à Chiusi, à Volterra (1).
(l) mueller-deecke, CXIV, I, p. 385 sq.
Durant la période étrusque, des pièces de même origine ne purent manquer de circuler à Rome. Au ve et au ive siècle les émissions d'argent étrusque durent valoir pour Rome comme, plus tard, les émissions romaines valurent pour l'Etrurie. Le peuple le plus riche, seul, battait monnaie, et cette monnaie circulait chez les voisins qui commerçaient avec lui.
La tardive apparition d'une monnaie romaine confirme, de façon incontestable, la longue fidélité de Rome aux plus anciennes traditions italiques. Pour les agriculteurs patriciens qui composaient le Sénat, le bétail était la mesure de la richesse. Le métal, soit brut, soit sous forme de barres ou de pains, marqués ou non d'un signe, suffisait à faire l'appoint des échanges en nature. On comptait le bétail, on pesait le métal. Mais dans une ville comme Rome, que sa situation et les nécessités de l'existence contraignaient au commerce, l'économie nationale ne pouvait se borner au troc des produits agricoles et à quelques menus achats soldés en cuivre. Les monnaies des villes de Grande-Grèce et de Sicile ont de bonne heure circulé chez elle ; c'est le mot grec vopoç, mesure, qui, en latin, signifie la pièce de monnaie, nummus (1); l’uncia latine correspond au sicilien oùyxi'a ; libra, probablement à Xt'rpa (2). Cette identité d'expressions d'une part, et d'autre part les concordances entre les systèmes monétaires grecs, romains et étrusques, indiquent la circulation, dans l'ensemble de la péninsule, des monnaies de diverse origine. Mais l'État romain s'abstint longtemps de consacrer officiellement, en le dotant d'une monnaie portant sa marque, le mouvement économique laissé à l'activité de cette partie de la population qui n'exerçait pas le pouvoir politique.
(1) mueller-deecke, CXIV, I, p. 298. Peut-être faut-il expliquer par l'intermédiaire de l'étrusque le changement de o en u.
(2) Cf. W. sohulze, Kuhn Zeitschr., 33, 1893, p. 225. L'origine véritable de ces mots est inconnue. Voir l'hypothèse de ernst assmann, Die Baby-lonische Herkunft von as, aes, raudus, uncia, libra, dans Nomisma, 5, 1910, p. 1-9.
II ne s'y décida que durant la seconde moitié du IV ème siècle, lorsque ses armées pénétrèrent dans l'Italie méridionale. Pour Rome, il frappa ses as de cuivre ; pour les Latins, des pains rectangulaires exactement calibrés, et pour la Grande-Grèce, des pièces d'argent. Enfin, après la prise de Tarente seulement, il consentit à renoncer au vieil étalon de cuivre et à introniser à Rome celui d'argent. Mais la monnaie d'argent y était connue depuis longtemps. Une longue tradition, latente mais vivace, en avait consacré les unités, la drachme qui devint le denier et le scrupule étrusque qui fut le sesterce. Les sénatus-consultes n'eurent qu'à ratifier l'usage.
Ne confondons pas la vie romaine avec la politique romaine. La politique est bien celle d'une aristocratie de paysans et de soldats. Cette aristocratie put s'obstiner à ignorer pendant des siècles le progrès qui, en dehors d'elle, mais tout autour d'elle, s'accomplissait en Italie et à Rome même ; il lui était impossible de l'empêcher. A l'intérieur de la ville, elle se trouvait obligée, chaque jour, à composer avec la plèbe urbaine étrangère à ses traditions. Au dehors, chacun des agrandissements de l'Etat romain portait atteinte à l'intégrité de l'esprit conservateur, jusqu'au moment où, capitale de la majeure partie de l'Italie, Rome s'ouvrit définitivement à l'ensemble des civilisations italiennes.
VI
appius claudius caecus (1).
Un personnage représente à lui seul, par son activité multiple, l'état de civilisation atteint par Rome vers la fin du ive siècle ; c'est Appius Claudius Caecus, censeur en 312, consul en 307 et en 296, général, juriste, poète, grammairien et surtout grand constructeur de travaux publics (2).
(1) Cf. P. lejay, Appius Claudius Caecus, XX, 44, 1920, p. 92-141.
(2) T. Liv., 2,56; tac., Ann., 1, 4; suet., Tiber. 1-3.
Appius est un aristocrate, descendant de la grande famille sabine des Claudes dont l'orgueil, l'entêtement et la dureté sont demeurés légendaires. C'est lui qui livre les derniers combats en faveur des privilèges des patriciens (1); il s'indigne surtout à l'idée de voir les sacerdoces exercés par des plébéiens. Il a, du vieux Romain, le patriotisme intransigeant. Lorsque, en 279, le Sénat se laisse tenter par les propositions pacifiques de Pyrrhus présentées par Cineas, Appius Claudius, tout vieux qu'il est et déjà représentant d'un autre âge, sort de la retraite où il s'est enfermé et, par un discours resté célèbre, fait repousser la paix offerte par un ennemi vainqueur (2).
Mommsen a pu, cependant, le présenter comme un novateur, un démagogue révolutionnaire, presque un précurseur des Gracques (3). Novateur, il l'est, en effet. Tout en contestant aux plébéiens l'accès au consulat et l'égalité des droits religieux, il les favorise en faisant entrer au Sénat jusqu'aux fils d'affranchis qui possèdent le cens nécessaire. Il inscrit dans les tribus les citoyens qui ne possèdent pas de propriété foncière et confère à la fortune mobilière des droits égaux à ceux qui demeuraient jusque-là attachés à la possession de la terre (4). Surtout, il fait divulguer par son questeur Cn. Flavius les formules d'action juridique dont la connaissance était réservée aux patriciens. La différence entre son rôle politique et celui des Gracques est que les Gracques s'intéressent aux déshérités de la plèbe, tandis que lui favorise les plébéiens fortunés. Il comprend la puissance nouvelle que constitue entre leurs mains la richesse mobilière et, tout en voulant conserver l'exercice du pouvoir aux seuls patriciens, il s'efforce d'agréger au vieil Etat aristocratique les meilleurs des plébéiens.
Il imite, dit Mommsen, Clisthènes et Périclès.
(1) T. L iv., 10, 7 ; cf. 9, :A.
(2) Cic., de Senect.,6; Brutus, 16 ;PLUT., Pyrrhus, 19.
(3) mommsen, CXII, 1, 287 sq.
(4) E. âlbertini, La Clientèle des Claudii X, 24, 1904, p. 248 sq.
Il prend modèle, pense M. Pais, sur Denys et Architas de Syracuse (1). Que la connaissance de la politique grecque et surtout sicilienne ne soit pas étrangère à l'origine de ses idées, est fort vraisemblable. Mais les réformes qu'il accomplit semblent plus simplement l'effet d'une intelligence romaine s'efforçant de consacrer officiellement un progrès déjà accompli et de le faire servir au bien de l'Etat. Appius Claudius cherche à adapter l'organisation patricienne de la République à un état social nouveau et à l'extension nouvelle de la puissance romaine. Il voudrait légitimer, au moins dans une certaine mesure, la situation acquise par la plèbe dont les traditions constituent un lien entre les diverses régions de l'Italie et Rome leur nouvelle capitale. Appius Claudius est un patricien romain éclairé, non un démagogue.
Il connaît le droit et sait user habilement de la parole. Cette science et cet art n'étaient pas des nouveautés à Rome. Tite-Live oppose Claudius aux militaires maladroits en politique comme Fabius et Decius et indique qu'il vaut mieux au Forum et dans l'administration que comme général (2). Il est en outre moraliste et poète. La souplesse de son esprit doit-elle le mettre en dehors de la lignée romaine ? Il avait composé, en vers saturniens, un recueil de sentences, qu'au dire de Cicéron admirait Panaetius (3). Était-ce simplement une imitation des vers dorés pythagoriciens populaires dans l'Italie méridionale ? On a cru pouvoir y reconnaître aussi l'influence de la comédie nouvelle et, en particulier, de Philémon (4). Certes, les Romains de ce temps qui, depuis trente ans, combattaient et vivaient de la Campanie à l'Apulie, avaient connaissance de cette littérature. Mais des maximes comme celles qui nous sont transmises sous le nom d'Appius Claudius,
(1) E. pais, CXXII, p'. 294.
(2) T. Liv., 10 23.
(3) Cic., Tusc., 4, 2, 4.
(4) F. marx, Zeitsch. f. oenler. Gymn., 1897, p. 217,394.
« chacun est l'artisan de sa propre fortune » — « le travail vaut mieux, pour le peuple romain, que l'oisiveté » — « à la vue d'un ami, oublie tes propres misères » — paraissent aussi bien le résumé de l'expérience pratique du paysan latin, telle qu'elle s'exprime encore aujourd'hui en des proverbes innombrables et souvent d'une savoureuse finesse.
L'influence grecque sert au Latin, semble-t-il, à dégager sa propre originalité. C'est peut-être la connaissance du grec qui a décidé Appius Claudius à réintroduire dans l'alphabet latin la lettre G. Mais le caractère lui-même est nouveau; il prend la place d'une lettre grecque, le Z, qui est éliminé comme inutile. C'est un fait de phonétique proprement latin que consacre le remplacement officiel de s intervocalique par r : Furii, au lieu de Fusii. De telles réformes indiquent un censeur subtilement curieux des questions grammaticales.
L'œuvre la plus mémorable d'Appius Claudius et qui témoigne le mieux du développement de la civilisation romaine de son temps, c'est la construction du premier aqueduc et de la grande route qui a conservé son nom.
Par tradition ancestrale, les Romains étaient experts en travaux de drainage. Mais l'idée d'amener en ville les eaux d'une source lointaine est assez différente de celle que réalisaient les innombrables cuniculi de la campagne latine. Elle fut inspirée, sans aucun doute, par quelque exemple remarqué en Apulie, riche en villes mais pauvre en eaux. Syracuse, la véritable capitale de toute l'Hellade d'Italie, avait son aqueduc dont les canaux souterrains aboutissaient à la citadelle. Comme l'aqueduc de Syracuse, l’Aqua Appia était en majeure partie souterraine. Elle captait les eaux d'une source située non loin de l'Anio, à 16 kilomètres et demi de Rome. La conduite ne sortait du sol qu'à son entrée en ville où elle traversait sur des arches, près de la porte Capène, la dépression entre le Cœlius et l'Aventin, sur une distance d'environ soixante pas (90 mètres). Quarante ans plus tard, en 272, le censeur M. Curius Dentatus fit construire un second aqueduc, souterrain encore dans tout son cours, sauf aux abords de l'Esquilin. Les arcades n'atteignaient encore qu'une longueur de 300 mètres. C'est seulement au milieu du II ème siècle avant Jésus-Christ, en 144, que l'Aqua Marcia, sur un total de 92 kilomètres en eut 11 sur arcades. Les premiers aqueducs représentent donc encore une œuvre de drainage plutôt que d'architecture. Ils eurent sans doute des modèles grecs, mais leur construction repose sur les plus anciennes traditions techniques des paysans latins.
On ne saurait méconnaître l'ampleur de conception dont témoigne l'établissement de la Via Appia, entre Rome et Capoue, à travers les Marais Pontins.
D'autres routes existaient avant celle-là dans l'Italie ancienne. Les relations entre l'Italie du centre et du sud avaient été assurées de tout temps par celle qui devint la Via Latina, de Rome à Bénévent. La Via Salaria, qui de la côte conduisait en Sabine, paraît également fort ancienne. Les Étrusques, bien avant le IV ème siècle, avaient construit de belles et bonnes routes. Les Grecs les avaient multipliées dans l'Italie méridionale. Là encore, de vieilles traditions indigènes rencontraient des exemples étrangers.
Suivant la tradition, ce seraient les Carthaginois qui, en Sicile, auraient enseigné aux Romains l'art de construire des routes. Le rôle des Carthaginois s'est borné, semble-t-il, à introduire en Sicile l'usage du mortier à la chaux, qui par la Grande-Grèce parvint aux Romains. C'est précisément l'emploi du mortier qui distingue la Via Appia des anciennes voies latines et de celles de l'Etrurie. Les fouilles ont permis de reconnaître dans ses substructions les quatre couches dont la superposition est demeurée classique jusqu'à la fin de l'époque romaine : à la base, le statumen, en pierres plates, destiné à l'assèchement, puis une première couche de béton grossier (rudus) ; au-dessus, une seconde couche plus épaisse de béton fin (nucleus), enfin le summum dorsum, soit de gravier, soit de dalles.
Le dallage de la Via Appia ne fut exécuté que peu à peu, dès le début du III ème siècle pour les sections voisines de Rome, sous l'Empire seulement, aux abords de Terracine.
Le premier établissement de la route n'en comportait pas moins des travaux d'art considérables dont on admire aujourd'hui encore la hardiesse et la perfection : un aménagement en corniche au bord des Monts Albains, dans le voisinage d'Ariccia et une chaussée en remblai de trois à quatre mètres de haut sur une longueur de 28 kilomètres à travers les Marais Pontins. Sous l'empire, Stace qualifiait encore la vieille construction d'Appius Claudius de Regina viarum, la reine des routes.
Si, dès le premier contact intime avec les Grecs d'Italie, Rome atteint ainsi la perfection dans la construction de ses routes et aqueducs, si la monnaie qu'elle émet alors, sans tâtonnements, circule immédiatement dans toute l'Italie, si la ciste romaine de Novios Plautios apparaît comme un modèle au milieu de toute la série prénestine, si l'architecture latine réussit à introduire en Campanie, à Paestum même, à côté des plus majestueux exemples du temple grec, le temple étrusco-latin à podium, c'est qu'une longue tradition indigène soutient cette soudaine éclosion. Les exemples de la Grande-Grèce fructifient à Rome parce qu'ils y trouvent un terrain préparé et qu'ils n'y sont pas entièrement nouveaux. L'Étrurie d'abord, puis les relations avec l'Italie grecque, établies dès le début de la République et obscurément poursuivies durant la période latine, ont peu à peu éduqué les Romains. Un caractère comme celui d'Appius Claudius, disait Niebhur, n'étonnerait pas en Grèce, il paraît étranger dans l'histoire romaine. Il nous semble, au contraire, représenter de façon parfaite cette union de l'expérience ancienne et des tendances nouvelles.
C'est faire tort aux Romains que de chercher toute leur originalité dans leur grossièreté. Des paysans têtus et des soldats bornés n'auraient jamais fait souche d'un grand peuple. Il ne convient pas d'opposer Rome des premiers siècles au reste de l'Italie, mais bien plutôt de chercher à distinguer chez elle l'héritage des anciennes civilisations italiennes qu'elle a absorbées et dont elle s'est assimilé la substance.
Qu'elle ait, en outre, possédé son caractère propre, nous n'en disconviendrons pas. Elle a, au début du V ème siècle, rejeté l'hégémonie étrusque pour s'agréger étroitement aux peuples campagnards des monts Latins et Sabins. Puis, elle eut à lutter âprement pour la vie, par le travail et par la guerre. Les circonstances imposèrent à son enfance le sens des réalités, une discipline exacte et une longue pauvreté. Delà, peut-être, dans la suite de son existence, la timidité de l'imagination, l'habitude de l'observation morale, le souci de la pratique et de la logique.... Cui non risere parentes. Quels que soient ses mérites, le Romain n'a jamais le charme du Grec. L'ampleur de la conception ne rachète pas chez lui l'absence de fantaisie ; son idéal ne se détache pas du sol. Il a trop appris à calculer; son raisonnement ne perd jamais de vue l'action qui en sera la conséquence. L'art sera toujours intéressé ou bien il sentira l'effort appliqué de l'écolier.
L'esprit romain ne manque cependant ni d'activité, ni de souplesse, ni de finesse. Il tient aux traditions éprouvées par l'usage, il n'en est pas moins curieux des expériences et des idées étrangères. Il emprunte avec discernement les institutions, les idées et les arts de ses voisins. Il n'imite pas servilement et imprime à ce qu'il adopte un caractère propre. Dès les siècles anciens que nous venons de considérer, la faculté d'assimilation des Romains paraît aussi développée que leur originalité, Rome a triomphé de toute l'Italie, non parce que son peuple était de tous demeuré le plus fruste, mais parce que, devenu sensiblement l'égal des autres en civilisation, il se trouvait plus discipliné et plus énergique.
CHAPITRE IV
L'ANCIENNE RELIGION ROMAINE
Comme l'ensemble de la civilisation romaine, la religion présente un mélange d'anciennes traditions obstinément maintenues et d'emprunts. « Les plus anciennes institutions religieuses, disait Cicéron, sont les meilleures, parce qu'elles sont les plus proches des dieux (1). » Du temps de Cicéron, en effet, et même jusqu'à la fin de l'Empire, le calendrier dont l'établissement était attribué à Numa continua à régler l'année religieuse du Romain. On célébrait suivant les vieux rites des fêtes dont le sens s'était perdu. On en célébrait d'autres aussi, et les dieux nouveaux venus de Grèce ou d'Orient avaient pris dans le Panthéon romain la place occupée par des divinités primitives dont les érudits ne connaissaient plus guère que le nom. Le respect des plus anciennes institutions n'avait pu empêcher la religion de suivre l'évolution politique, sociale et intellectuelle de Rome.
On pourrait essayer de distinguer, dès l'époque ancienne, le fonds religieux primitif de ses transformations successives et de noter les apports des différents peuples d'Italie, Sabins, Etrusques, Campaniens, avec lesquels les Romains se sont trouvés en contact. Mais si nous connaissons assez bien, grâce à un ensemble de documents soit littéraires (2),
(1) Cic., de Legib., 2.
(2) La plupart des renseignements épars chez les érudits, les glossateurs et les Pères de l'Église, en particulier saint Augustin, proviennent de Varron et des savants de l'époque d'Auguste comme Verrius Flaccus.
soit épigraphiques (1), l'aspect de la vieille religion romaine (2), les renseignements précis nous font défaut au contraire sur la plupart des cultes italiques. Les premières transformations et les premiers mélanges paraissent antérieurs à l'état le plus ancien dont les Romains aient noté le souvenir. Et puis ces perpétuelles analyses, forcément mêlées de beaucoup d'hypothèses, finissent par faire perdre de vue la réalité des faits. Essayons plutôt de noter ce que furent les conceptions religieuses du début de l'époque historique et d'en dégager les caractères généraux. Cette religion n'a que peu de traits communs avec celle de la période classique. Les croyances oubliées n'en ont pas moins marqué leur empreinte dans l'imagination et le caractère romain. La gravité romaine, par exemple, semble faite, pour une bonne part, du respect de ces dieux dont la mentalité primitive avait partout multiplié la présence. Et surtout, au point de vue qui nous occupe, une vue d'ensemble du système religieux ancien complétera et précisera l'idée que nous pouvons nous faire de la civilisation romaine des premiers siècles de la République.
I
la CONCEPTION ROMAINE DE LA DIVINITÉ ET LES DIEUX PRINCIPAUX.
On connaît l'admirable tableau que trace Fustel de Coulanges de la vie religieuse du Romain (3) :
« Sa maison est pour lui ce qu'est pour nous un temple ; il y trouve son culte et ses dieux. C'est un dieu que son foyer, les murs, les portes, le seuil sont des dieux, les bornes qui entourent son champ sont encore des dieux.
(1) En particulier le calendrier officiel, datant du début de l'Empire, dont les fragments ont été retrouvés au Forum en 1893.
(2) On trouvera les faits en particulier dans G. wissowa, CLXX, et une vue d'ensemble extrêmement pénétrante et bien documentée chez W. warde fowler, CLXVII.
(3) LXXVIII, p 254 sq.
Le tombeau est un autel et ses ancêtres sont des êtres divins. Chacune de ses actions de chaque jour est un rite... La naissance, l'initiation, la prise de la toge, le mariage et les anniversaires de tous ces événements, sont les actes solennels de son culte... Chaque jour il sacrifie dans sa maison, chaque mois dans sa curie, plusieurs fois par an dans sa gens ou dans sa tribu. Par-dessus tous ces dieux, il doit encore un culte à ceux de la cité. Il y a, dans Rome, plus de dieux que de citoyens... » Prenant un exemple, précisément à l'époque que nous étudions ici, Fustel de Coulanges montre Camille, cinq fois dictateur et qui vainquit dans plus de dix batailles, prêtre autant que guerrier.
« Enfant, on lui a fait porter la robe prétexte qui indique sa caste et la bulle qui détourne les mauvais sorts. Il a grandi en assistant chaque jour aux cérémonies du culte ; il a passé sa jeunesse à s'instruire des rites de la religion. Il est vrai qu'une guerre a éclaté et que le prêtre s'est fait soldat... Un jour vint où l'on songe à lui pour la dictature. Ce jour-là, le magistrat en charge, après s'être recueilli pendant une nuit claire, a consulté les dieux : sa pensée était attachée à Camille dont il prononçait tout bas le nom et ses yeux étaient fixés au ciel où ils cherchaient des présages. Les dieux n'en ont envoyé que,de bons ; c'est que Camille leur est agréable, il est nommé dictateur. Le voilà chef d'armée, il sort de la ville, non sans avoir consulté les auspices et immolé force victimes. Il a sous ses ordres beaucoup d'officiers, presque autant de prêtres, un pontife, des augures, des aruspices, des pullaires, des victimaires, un porte-foyer... »
On peut nier l'existence de Camille; on n'en reconnaît pas moins son image, plus ou moins atténuée, plus ou moins sincère, suivant les temps, dans tout magistrat et même dans chaque citoyen de Rome, jusqu'à la fin des temps antiques.
Un tel état d'esprit représente dès l'époque de Camille un héritage extrêmement ancien. C'est très certainement celui de l'époque préhistorique : il est très antérieure Rome elle-même. Il correspond en effet, aussi exactement que possible, à celui que les études d'ethnographie moderne nous ont fait connaître chez les peuples demeurés à un état de civilisation primitif.
Pour le primitif, comme pour le Latin d'avant l'histoire, la distinction si tranchée dans les sociétés modernes du sacré et du profane, du spirituel et du monde matériel, n'existe pas. De toute part, le primitif se sent entouré de forces mystérieuses, intangibles et invisibles, qu'il ne définit pas, dont il ne saurait calculer le nombre, mais dont il sait bien que dépendent, à tout instant, son sort, celui de tout ce qui lui tient à cœur, ses entreprises, ses biens, sa famille, sa cité. Toute chose est dieu, le rocher, la terre, l'arbre, la source, l'animal, le ciel. Lui-même participe au divin, chacun de ses gestes, chacune de ses paroles comporte des répercussions à l'infini dont il ne peut se rendre compte. Certains moments de son existence possèdent une puissance particulière ou sont au contraire spécialement sensibles et vulnérables à ces forces partout éparses. Quelques hommes, soit pardon naturel, soit en vertu d'une initiation ou seulement d'un acte même involontaire sont censés être en rapports plus étroits avec le divin ; ils savent le moyen d'agir sur ces forces cachées. Ces moyens sont des formules ou des rites, qui agissent par eux-mêmes, qui chassent le mal, attirent, fortifient et multiplient le bien. Le Romain, comme le primitif, a en ces formules, en ces rites et dans les personnes qui en connaissent le secret, une confiance aveugle, inébranlable, une foi que ne saurait entamer l'expérience. Le magicien est roi. Le roi, ou le magistrat qui le remplace, est nécessairement magicien.
On ne saurait, pour une telle époque, parler ni de dieux, ni de génies, ni de liaisons nécessaires de volontés et d'actions. Esprit, matière, forme extérieure, substance, causalité, sont des catégories qui n'existent pas pour le primitif. Il n'y a pas des choses d'une part et des esprits d'autre part, il n'y a pas d'actions mécaniques, il n'y a pas de lois de la nature. Il y a des forces en toute chose et ces forces ne connaissent d'autre loi que leur caprice ou les contraintes qui leur sont imposées par des forces supérieures à elles. Ce n'est même pas l'homme qui agit ; ce n'est pas le maçon qui construit la maison, le général qui remporte la victoire, la lance qui tue, c'est la force qui est dans le maçon qui détermine celle qui est dans la maison, c'est celle du chef ou de la cité qui l'emporte sur celle de l'ennemi, la lance n'est que le signe accidentel du combat de forces dont résulte la mort. Antérieure à la logique, une telle mentalité est longtemps demeurée plus forte qu'elle. Elle n'a cédé que peu à peu, à Rome comme ailleurs. Ni à Rome, ni ailleurs, pas même chez nous à l'époque moderne, elle n'a jamais complètement disparu.
Les traces en sont innombrables dans la religion romaine ancienne, infiniment plus développées, nous semble-t-il, que dans la religion grecque où elles ne se découvrent plus qu'étouffées sous le mythe ou à l'origine du rite. Héritière du long développement intellectuel des civilisations préhistoriques de la Méditerranée, la Grèce est parvenue, dès l'époque ionienne et les poèmes homériques, à la conception de dieux personnels qui pensent, veulent et agissent. Le fond même de la religion romaine est demeuré beaucoup plus primitif. Les dieux autochtones sont à peine des dieux; ils n'ont ni forme, ni personnalité, ni volonté. Ils ne se sont déterminés et paraissent n'avoir reçu de noms que peu à peu, d'après la fonction qu'ils exercent ou le lieu où ils sont censés résider, ou même bien souvent d'après la formule ou le rite destiné à agir sur eux (1). Défaut d'imagination, dira-t-on. Non pas, mais imagination qui demeura
(1) Anna Perenna, par exemple, la déesse de la nouvelle année, semble née de la formule du souhait annare perennareque commode liceat.
liée beaucoup plus longtemps qu'ailleurs par les formes primitives de la pensée humaine et qui ne s'en dégagea que pour trouver autour d'elle une mythologie déjà toute formée qu'elle adopta.
Les circonstances politiques semblent avoir appris au Romain, de très bonne heure, peut-être dès l'époque préhistorique, à concevoir un dieu supérieur, plus fort que tous les autres, celui qui préside aux destinées du groupe, qui représente primitivement la force ou le génie du peuple. Mais ce dieu social n'a jamais supprimé les autres et ne s'est pas substitué à eux dans leurs fonctions propres. Le Jupiter romain ne s'est pas trouvé relégué dans le firmament ou au sommet de quelque Olympe où son rôle se serait réduit chaque jour, pour aboutir finalement à une sorte de présidence virtuelle au jeu des lois de la nature. Il ne fut jamais qu'un dieu semblable aux autres, agissant comme eux dans un cercle nettement défini, et non pas un dieu suprême auquel les autres se seraient trouvés subordonnés. L'hellénisme seul lui donna la toute-puissance.
Tout en conservant une conception du divin encore engainée dans la mentalité primitive, le Romain du temps de Camille n'est cependant plus un primitif. Par l'Étrurie, par la Grande-Grèce et la Sicile, les idées méditerranéennes ont pénétré sa ville et se sont, en partie déjà, imposées à son esprit. Il a organisé sa vie politique et sociale. Sa religion, déjà, forme un tout qui apparaît régulièrement organisé.
La famille, tout d'abord, groupe autour d'elle un bon nombre des cultes qui demeurèrent vivaces assez longtemps pour être recueillis par la religion officielle de l'époque classique. Le foyer domestique est l'autel familial devant lequel le père consacre par des rites traditionnels tous les actes qui touchent à la vie des siens. C'est au feu du foyer qu'il présente, en l'élevant dans ses bras et en l'annonçant comme sien, l'enfant qui vient de naître. C'est devant cet autel, dont elle sera la servante, qu'est amenée la nouvelle épouse, pour partager avec son mari le gâteau sacré de la confarreatio. A côté du foyer, l'armoire aux provisions, penus, a ses dieux bienveillants et généreux, les Pénates. Les autels de Pompéi nous les montrent sous forme de génies légers, couronnés de fleurs, court vêtus et dansant joyeusement au milieu de l'envol de leurs bandelettes. Les diverses parties de la maison ont ainsi leur rôle divin. Limentinus, le seuil accueille les gens de la maison et écarte les importuns. Forculus est la puissance protectrice de la porte ; Cardea, celle des gonds. Janus à double visage, que l'on explique souvent comme représentant la porte—janua—à double face, semble plutôt le dieu qui veille, à droite et à gauche, sur ses abords, le défenseur par excellence du groupe qui habite la maison, le village ou la ville. La porte monumentale aurait été dénommée d’après lui et non lui d'après la porte.
Chacun des actes de la vie familiale évoque ainsi un génie. Nous en connaissons quelques-uns par saint Augustin citant Varron. Lorsque l'enfant naît, Cunina veille sur son berceau, Rumina lui enseigne à prendre le sein, Educa et Polina le font manger et boire, Statulinus le tient debout, Fabulinus le fait parler. Les Actes des Frères Arvales nous apportent un autre exemple de cette multiplication des divinités. Il s'agit un jour d'enlever un figuier qui avait poussé sur le toit de Dea Dia. Pour ce faire on invoque l'intervention de Deferunda qui l'enlèvera, de Coinquenda qui l'ébranchera, de Commolenda qui le coupera en morceaux, de Adolenda qui le brûlera. En sacrifiant à Tellus et à Cérès pour les travaux des champs, le flamine, indique un texte ancien (1), invoque Vervactor pour le premier labourage, Redarator pour le second, Imporcitor pour le hersage, Insitor pour les semailles, Oberator pour le fumage, Occator, Sarsitor, Subrincator, Messor, Convector, Conditor, Promitor.
(1) fabius pictor, ap. serv., ad Georg., 1, 21.
Dieux, Génies, disons-nous improprement; survivances bien plutôt des temps antérieurs aux dieux et aux génies tels que nous les concevons d'après les Grecs et l'époque classique, des temps où toute chose, tout être, tout acte était divin, où le divin ne se distinguait pas de la nature où ce n'était pas l'homme mais une force indéfinie qui coupait l'arbre, qui remuait la terre et faisait pousser la moisson.
Ce sont des dieux de ce genre, imparfaitement personnifiés, artificiellement et tardivement nommés, que nous trouvons en majorité dans le calendrier traditionnellement attribué à Numa et qui ne doit représenter qu'un premier essai de systématisation de l'ancienne religion datant du début de la République. La plupart se trouvent en rapports étroits avec la vie agricole : Pales, dieu ou déesse, dont la fête se célèbre le 21 avril, règne sur les troupeaux ; Faunus, Lupercus, nommé, semble-t-il, d'après le rite des Lupercalia destiné à écarter le loup (15 février), ont un rôle analogue. La richesse des moissons est confiée à Ops unie au dieu de la grange Consus qui cache et conserve. Les Opiconsivia se célèbrent le 25 août, vers le moment où l'on rentre les moissons, les Opalia le 19 décembre, à la fin de l'année agricole, vers le même moment que les Saturnales (19 décembre). Les fêtes agricoles reprennent le 15 avril avec les fêtes des semailles au cours desquelles on sacrifie à Tellus des vaches pleines pour favoriser sa fécondité. Le 19 avril viennent les Cerialia en l'honneur de Cérès, le 25 avril les Robigalia pour conjurer Robigo ou Robigus, la rouille qui gâte les blés.
De cet essaim de numina, c'est-à-dire de volontés, d'énergies ou de forces, quelques-unes se détachent qui devinrent de véritables dieux : Saturne, Janus, Jupiter, Mars, Quirinus, Neptune, Vulcain.
Saturne sembleprimitivement le génie des semailles (Sala). Il serait le plus ancien des dieux de l'Italie. Lorsque les Aborigènes pénétrèrent dans le Latium, ils l'y auraient trouvé régnant paisiblement sur les Sicules leurs prédécesseurs. C'est lui qui les avait réunis en un peuple ordonné ; il leur avait appris à se nourrir de lui et, presque sans travail, racontait la postérité, fournissait en abondance à tous leurs besoins. La jeunesse de Saturne avait été l'âge d'or. Aussi, au printemps et surtout en hiver, figurait-on, pendant quelques jours, le retour de l'âge d'or pour rajeunir Saturne ; c'étaient les Saturnales. Plus de maîtres, plus de serviteurs, plus d'esclaves, plus de travail, plus de propriété privée; la joie seule devait régner. Chacun revêtait comme il lui plaisait les vêtements des autres, buvait et mangeait son saoul. Les Saturnales de décembre ont disparu ; notre Mardi gras perpétue celles du printemps. Un homme jeune et fort, semble-t-il, représentait le dieu ; à l'issue de la fête, lui ou son simulacre était sacrifié au dieu pour lui apporter sa force et sa jeunesse, comme aujourd'hui encore, on brûle solennellement le bonhomme Carnaval. Il y a un ancien dieu et des souvenirs méditerranéens, semble-t-il, dans Saturne et dans la légende de son âge d'or.
Janus, que nous trouvons réduit au rôle modeste de portier vigilant, doit avoir été de bonne heure un dieu puissant, génie du ciel et prédécesseur de Jupiter, comme Saturne était le génie de la terre. Le premier mois du cycle solaire annuel porte soir nom ; sa fête se célèbre le 9 janvier. Son nom Janus-Dianus indique en lui le même numen dont Diana est la personnification féminine. Diane, semble-t-il, est dans le Latium la divinité de la végétation renaissant chaque année et dont la force ne doit jamais s'affaiblir. Elle est, au bord du lac de Némi, la déesse de la forêt, Diana Nemorensis. Le meurtre rituel de son prêtre, lorsqu'il n'a plus la force suffisante pour être victorieux, doit assurer, en le remplaçant par un plus fort, la perpétuelle fécondité de la divinité.
II y a à Rome de nombreux Jupiters. Celui qui règne au Capitole, entre Junon et Minerve, est étrusque. II ne figure pas dans le calendrier de Numa. Celui que l'on fête chaque mois au jour des ides et auquel s'adressent les rites des Vinalia (23 avril et 19 août), des Meditrinalia le 11 octobre où l'on boit le vin nouveau en prononçant la formule :
velus novum vinum bibo,
veleri novo morbo medeor
je bois le vin vieux et nouveau, je suis guéri des maladies anciennes et nouvelles.
ce Jupiter, qui préside encore aux cérémonies du Regifugium et du Poplifugium, fuite du roi, fuite du peuple, semble présenter quelques analogies avec Janus. Son flamine porte le titre de Flamen Dialis. Il n'est probablement pas très différent non plus du Jupiter Latiar ou Latial, divinité ethnique commune aux tribus latines, dont le sanctuaire occupait le sommet du Monte Cavo, au centre des Monts Albains. Mais Jupiter latin n'a rien de commun, primitivement, avec Zeus hellénique. Il n'a pas de traits, il n'est pas le roi divin dont un froncement de sourcils ébranle le ciel et la terre. Il est multiple et se trouve divisé en autant de personnages que d'emplois : Jupiter Lucetius, génie du ciel lumineux, Jupiter Elicius, Fulgur, Summanus, dieu du ciel orageux, de la foudre, de l'éclair ; il est l'aérolithe qui tombe du firmament, probablement aussi la vieille hache de pierre mystérieuse dans laquelle on voit un instrument venu du ciel, Jupiter Lapis. Il est celui par qui l'on jure, Dius Fidius. Dans le gâteau nuptial, il préside à l'union des époux, Jupiter Farreus. On le vénère, comme l'indique l'épithète de pater régulièrement accolée à son nom, mais on ne cherche pas à le connaître et à le définir.
Si Mars est incontestablement devenu à l'époque classique le dieu de la guerre protecteur des armées romaines, son caractère original demeure incertain. Il représente plutôt, lui aussi, un dieu agraire, le génie de la végétation printanière. On s'expliquerait difficilement, s'il avait été toujours un dieu guerrier, le nom d'Arvales porté par ses prêtres et le caractère de la fête des Ambarvalia, la procession qui faisait, au printemps, le tour des champs pour les purifier et en favoriser la fécondité. D'autre part, les Saliens, qui dansent armés et dont le costume est celui des soldats romains du VI ème ou V ème siècle, sont aussi des prêtres de Mars. La double fête de Mars, au printemps et en octobre, semble bien correspondre à une lustration de l'armée avant son départ en campagne et à une purification à son retour. Le 14 mars, les Equirria sont une lustration des chevaux ; le 19, vient la lustration des boucliers, le 23, celle des trompettes, Tubilustrium et la procession dansante des Saliens. A l'automne, les cérémonies se répètent, comme des rites de
sortie ; aux ides, le 15 octobre, le sacrifice d'un cheval ; le 19, après l'Armilustrium, les Saliens rentrent leurs boucliers. Le double caractère des fêtes du dieu, Ambarvalia, Armilustrium, et du dieu lui-même, peut s'expliquer par le fait que le printemps, qui marque la reprise des travaux champêtres, est aussi la saison où les armées entrent en campagne. Le même dieu printanier préside aux entreprises simultanées du paysan et du soldat.
Qu'était autrefois Neptune, devenu un grand dieu par suite de son identification avec Poséidon ? Qu'était Volcanus avant de devenir l’Hephaistos romain? Nous l'ignorons (1). D'autres dieux ou déesses, importants sans doute, puisqu'ils avaient leur flamine, nous sont encore plus inconnus : Carmenta, fêtée les 11 et 15 janvier, Falacer, Furrina, Volturnus. Une déesse Caca semble avoir anciennement joué, sur le Palatin, le rôle de déesse du feu que Vesta remplira plus tard au Forum.
(1) Neptune était particulièrement honoré à Véies et Volcanus à Ostie. Sur ce dieu, cf. carcofino, XLII, p. 87 sq.
Ce ne sont là que quelques-uns parmi les dieux connus, dii certi. A côté d'eux existe encore un nombre infini de dieux indéterminés, dii incerti, qui se révèlent au fur et à mesure des occasions, et cela, jusqu'en pleine époque historique. Lorsqu'on commença à battre monnaie, un dieu Aescolanus vint présider à cette opération. La frappe de l'argent eut encore son dieu, Argentinus, mais non plus celle de l'or. Un dieu jusque-là inconnu, Aius-Locutius, prévint les Romains, en 390, de l'approche des Gaulois. En 211, lorsque Annibal rebroussa chemin après avoir caracolé avec ses cavaliers numides sous les murs de Rome, sa retraite fut attribuée à l'ordre formel de Rediculus Tutanus. Ce fut la dernière des révélations divines à Rome.
Des dieux vaquent ainsi en nombre infini, non seulement dans le Latium, mais par tout le monde. Ceux des voisins sont puissants aussi : il importe pour le Romain de se les concilier. Aucune répugnance ne s'oppose à leur adoption. A côté des dieux indigènes, dii indigetes, la piété romaine invoque, tous ensemble, les dieux étrangers dont plusieurs se trouvent d'ailleurs intronisés à Rome, dii novensiles ou novensides, les dieux nouvellement installés. La formule de dévotion prononcée par Decius nous donne une idée de la complexité du Panthéon primitif : Janus, Juppiter, Mars Pater, Quirinus, Bellona, Lares, divi novensiles, divi indigetes, divi quorum est potestlas nostrorum hostiumque (1). Ces dieux nouveaux seraient pour la plupart, d'après Varron, d'origine sabine (2), comme Ferronia dont le lieu de culte, près du lac Capène, au pied du Soracte, était fréquenté par les bergers sabins, ou Vacuna qui, à Reate, semble avoir été une Vesta. D'autres sont grecs, Mercure, Apollon, Castor et Pollux, Hercule.
(1) T. Liv., 8, 9.
(2) varr., de Ling. Lat., 5 10, 74.
Plusieurs sont les dieux de cités vaincues que Rome a recueillis : Junon Reine, de Veies, Juturna de Lavinium, la Fortune de Préneste. Ce sont encore tous ceux qui correspondent à des idées ou à des faits nouveaux : les Tempestates dont les honneurs ne doivent dater que de la naissance d'une marine romaine, Salus, Spes, Honos, Virtus, Concordia, abstractions qui ne se trouvent en aucune façon étrangères à côté des plus anciennes divinités. C'est aussi parmi les dieux nouveaux qu'il faut ranger les dii Consentes, ceux qui sont ensemble et forment le conseil de Jupiter, six dieux et six déesses d'origine gréco-étrusque, dont les statues dorées se voyaient au Forum, au pied du Capitole et qui furent identifiés plus tard avec les douze grandes divinités du Panthéon hellénique. Toute l'Italie ancienne est ainsi représentée à Rome par ses dieux.
Parmi ces divinités il en est de grandes, celles qui ont une fonction importante, et de petites, celles dont l'action se restreint à un dieu particulier ou à des intérêts réduits. Mais on n'aperçoit à l'origine des dieux ou de leur classement aucune grande hypothèse cosmologique, aucune conception d'ensemble de l'ordre du monde, aucun horizon un peu large. Il est des dieux dans le ciel, sans doute : Janus, Jupiter sont des dieux célestes. Mais la contemplation du ciel absorbe peu le Romain. Il vit sur la terre, il s'inquiète surtout des dieux de la terre; il tire sa subsistance de la fécondité des champs, la plupart de ses dieux veillent sur ses champs. Peu lui importe le monde, le mystère de la vie et de la nature. Ce qui l'occupe, c'est sa famille, sa maison, son domaine, son troupeau, sa moisson, sa ville aussi et son peuple. Pour tous ces intérêts, il ne trouve jamais assez de dieux familiers et serviables. Il remplace la qualité par la quantité.
Le divin étant conçu comme une force mystérieuse répandue dans toute la nature, rien ne s'oppose à ce qu'il réside dans des objets matériels ou des animaux. Il fut un temps où le génie du silex faisait la puissance de l'homme. Il était naturel que le silex fût dieu. Jupiter Lapis en représente un souvenir. La force nuisible ou utile des animaux avait également quelque chose de divin, tout aussi bien que celle de l'arbre, de la source ou du fleuve. Quelques traces de ces imaginations subsistent dans le culte et la légende. Les Lupercales semblent avoir été à l'origine un rite destiné à agir sur la force divine du loup, pour l'écarter des troupeaux. Des rapports certains unissent Mars et le dieu loup; le loup lui est consacré; une louve nourrit Romulus et Remus dont Mars est le père. L'aigle est l'attribut du dieu céleste Jupiter; les oiseaux par lesquels la divinité manifeste ses volontés ont aussi quelque chose de divin. Le pic semble avoir été dieu national dans le Picenum. Mais nous ne trouvons pas, dans l'Italie ancienne, de traces précises d'un culte proprement totémique, où le génie de l'animal s'identifie avec celui de la tribu, où l'animal est conçu comme le père des hommes et où des rites particuliers renouvellent périodiquement la communion entre le groupe social et son ancêtre divin. L'esprit romain est trop soucieux de précision et d'utilité pratique pour s'attacher à de tels mystères. Les dieux, animaux ou autres, ont une fonction, ils sont faits pour servir ou, du moins, il s'agit de les empêcher de nuire. On ne conçoit pas d'union mystique entre l'animal et l'homme. Une force divine n'est pas moins présente dans l'homme, c'est le Genius. Le Genius du père de famille est en même temps celui de toute la famille; c'est lui qui en assure le bien-être, la prospérité et aussi la continuité. Il est le même que celui des anciens chefs de famille qui ont disparu ; il s'identifie avec celui des ancêtres, et ce titre lui vaut un nouveau culte. Il faut le rendre favorable aux générations nouvelles, lui faire sa place dans la vie de la famille et sa part aux offrandes du foyer. Il faut surtout se garder de l'irriter en s'écartant des règles que sa volonté a autrefois fixées. Cette permanence du génie familial est une des bases de l'esprit conservateur romain; elle consacre à jamais le mos majorum, La mère de famille, elle aussi a son génie, sa Juno qui l'assiste dans tous ses actes. Elle l'a rencontrée au jour de son mariage sous le voile, d'où elle est sortie à une vie nouvelle, Juno Pronuba. Sa Junon fait son heureuse fécondité et facilite sa délivrance, Jana Lucina. Chaque femme et chaque homme a sa Junon et son Génie qui partage toutes les vicissitudes de son existence.
Après la mort, l'esprit qui est dans l'homme continue a vivre, mais d'une vie diminuée et obscure. Il est censé reposer dans la tombe où les parents viennent lui présenter leurs offrandes. Au sujet des morts, une seule idée paraît bien nette et immuable dans l'ensemble de la tradition romaine, c'est qu'ils ont impérieusement besoin des aliments dont les vivants entretiennent leur existence. Le Génie a toujours quelque chose de matériel. Satisfaits, les morts sont les Mânes favorables — le mot manus, dans l'ancien latin, signifiait bon. Ils s'identifient avec les génies du groupe familial protecteurs de la famille, souvent représentés, à Pompéi sous forme de serpents qui viennent prendre leur part des offrandes déposées au foyer. Négligés par les vivants, ils souffrent et se vengent. Ils deviennent les Larves ou Lémures redoutables.
C'est du culte des morts que Fustel de Coulanges croyait pouvoir faire dériver toute l'organisation de la famille et de l'état social antique. Ce culte occupe incontestablement une place considérable dans la vie familiale. Le Génie des ancêtres, incarné dans le père de famille, fait son autorité sur toute la gens; il se confond en quelque mesure avec le Génie de la gens elle-même et avec celui du foyer de la maison, centre de la gens. Mais ces conceptions, d'ailleurs assez confuses, apparaissent plutôt comme la conséquence que l'origine de l'organisation familiale romaine. Le culte des morts lui-même semble une continuation de celui du Génie personnel des individus, qui lui-même ne fait que refléter l'idée générale de la vie et du monde dominant toute l'ancienne religion romaine.
La représentation proprement romaine de la vie d'outre-tombe et du séjour des morts apparaît extrêmement vague. C'était là une préoccupation dépourvue d'intérêt pratique, un souci proprement individuel, auquel l'esprit romain n'attachait qu'une faible importance. Le Romain ne s'aventure pas plus dans les enfers que dans le ciel, il reste de préférence sur la terre solide. Mais il ne s'est pas soustrait à l'influence des idées courantes sur ce sujet chez les peuples ses voisins, Les déesses de la mort primitives, Mania mères des Mânes, Acca Larentia mères des Lares, sont peut-être elles-mêmes d'origine étrusque (1). L'Orcus souterrain, où les morts se trouvent rassemblés sous la domination d'un dieu puissant Vedius ou Dis Pater qui se prêtera à l'assimilation avec Pluton, semble inspiré soit par l’Etrurie, soit par la Grande-Grèce. L’Orcus deviendra plus tard l'Enfer de Virgile ; les fables grecques et étrusques s'y mêlent aux idées morales et métaphysiques du pythagorisme et de la philosophie grecque. La vieille religion romaine ne semble pas s'être inquiétée de systématiser ces croyances de diverse origine.
Dès l'époque primitive nous voyons alterner, dans les sépultures romaines, les rites de l'incinération et de l'inhumation, sans pouvoir suivre une évolution correspondante des idées relatives à la vie d'outre-tombe. La survie souterraine du Génie dans le tombeau semble s'accorder avec le rite de l'inhumation. La Terre-Mère, compagne primitive de Saturne, génératrice de toute vie, celle à laquelle on sacrifie le 15 avril une vache pleine pour la fécondité des troupeaux, apparaît conçue aussi comme celle qui reçoit dans son vaste sein tout ce qui a vécu. Déesse des morts, la Terre est étroitement associée aux Mânes. Aux Mânes et à la Terre-Mère, s'écrie Decius, je dévoue les légions et les troupes de l'ennemi, en même temps que moi-même (2).
(1) mueller-deecke, CXIV, 2, p. 101 sq.
(2) T. Liv., 8, 9.
Lorsque à l'époque classique domine le rite de l'incinération qui dégage l'âme du corps, l'emportant pour ainsi dire sur l'aile de la flamme vers les régions lointaines d'un empyrée aérien, on continue à croire à la vie souterraine des âmes, à leur offrir des nourritures, à se les imaginer reçues et gardées par la Terre-Mère, Une inscription funéraire exprime nettement cette idée :
Ereptam viro et matri, Mater me Terra recipit.
La mort m'enlève à mon mari et à ma mère pour me confier à la Terre-Mère.
Nous trouvons, dans l'ensemble des conceptions relatives à l'outre-tombe, plus de littérature et de philosophie que de croyances religieuses.
Lorsque, au contact des dieux personnels de la Grande-Grèce et de l'Etrurie hellénisée, par émulation avec elles et sous l'influence de la fable apportée au moins par l'art figuré, ces numina indigènes eurent pris corps et furent devenues vraiment des divinité, le Panthéon romain se trouva surpeuplé. Sa surabondance justifiait pleinement le mot de Polybe : Les Romains sont plus religieux que les dieux eux-mêmes. Mais ces dieux demeuraient vagues : sans personnalité, sans figure, sans légende, presque sans noms, souvent sans sexe, ne se distinguant que par leurs fonctions et désignés, pour la plupart, par un simple adjectif indiquant leur rôle. De tels dieux ne suscitaient chez leurs fidèles ni sentiments ni émotion. Leur souvenir, du moins celui des dieux locaux, put se perpétuer longtemps chez le peuple campagnard, dont nous connaissons fort peu, d'ailleurs, la religion. Mais à la ville et, surtout, chez les esprits cultivés, ces pâles divinités devaient inévitablement s'évanouir devant les dieux si vivants de la Grèce. La grande surprise que procure l'étude de l'ancienne religion romaine, c'est qu'elle ait laissé jusqu'à l'âge classique tant de traces encore saisissables. Elle le doit à un travail de systématisation qui, tout en conservant les dieux primitifs, transforma entièrement, sinon la forme, du moins l'esprit de leur culte.
II
LES CARACTÈRES DU CULTE ROMAIN.
La grande originalité de cette religion aux conceptions si primitives consiste dans le caractère essentiellement rationnel de son organisation.
Si le voisinage de tant de dieux semble n'avoir jamais troublé le Romain c'est que, vis-à-vis d'eux, il avait de bonne heure et une fois pour toutes adopté la même attitude que vis-à-vis des hommes : celle du droit. Le jus divinum auquel correspond le fas et le nefas, ce qui est permis ou défendu par la religion, était aussi strictement réglé que le jus civile et suivant le même principe : à chacun son dû. L'homme devait au dieu l'accomplissement de certains rites; le dieu devait à l'homme l'exercice régulier de la fonction à laquelle il était préposé. Dans son Manuel du parfait agriculteur, Caton l'Ancien note les cérémonies que doit accomplir le pater-familias et les formules dont il doit les accompagner. Tout dans la prière est précisé par la parole et par le geste comme dans les actions de droit civil. Chaque offrande est soulignée de la mention ut tibi jus est : « comme tu y as droit ». Moyennant quoi, le dieu, ayant son dû, attribuera à l'homme pieux, c'est-à-dire qui a rempli strictement son devoir envers lui, la protection à laquelle cet homme a droit.
Le devoir du Romain envers ses dieux n'est pas une pensée, il n'est pas nécessaire de les connaître; c'est encore moins un sentiment, il n'est pas question de les aimer; ce devoir n'est qu'action, il consiste dans le culte. Mais ce culte est rationnel, il s'adresse à la volonté du dieu.
Si haut que permettent de remonter les documents concernant la religion romaine, nous n'y retrouvons plus, qu'à titre d'exception et déjà en majeure partie périmée, la conception magique primitive suivant laquelle le rite agit directement sur le dieu pour le renforcer ou l'affaiblir et possède la vertu de le contraindre automatiquement, pour ainsi dire, à exercer sa fonction. Le rite essentiel est le sacrifice; comme les autres peuples, les Romains offrent à leurs dieux des nourritures. Mais il s'agit pour eux de conquérir ainsi leur bonne volonté. Leurs sacrifices en effet ne répandent le sang qu'avec une extrême parcimonie. Pline affirme que le culte, tel que l'avait organisé Numa, ne comportait d'autres offrandes que des fruits de la terre et des gâteaux (1). C'est donc qu'il est inutile de recourir à la puissance magique du sang pour vivifier les dieux. On peut citer, à l'époque historique, des exemples de sacrifices humains; c'était là, spécifie Tite-Live en les mentionnant, un rite étranger aux Romains (2). L'érudition moderne peut reconnaître des traces, d'ailleurs incertaines, de sacrifices humains dans quelques rites particuliers de certaines cérémonies romaines (3), il n'en est pas moins vrai que de la mémoire des Romains de l'âge républicain avait disparu tout souvenir des imaginations suivant lesquelles la divinité bénéficiait de la vie qui lui était sacrifiée. Les dieux romains ne tenaient même pas au sang des animaux; ils admettaient aisément des substitutions :
(1) plin,, N. H., 18, 7 : Numa instituit deos fruge colere et mole salsa supplicare.
(2) T. Liv., 23, 57, 6. Dans l'émotion de la seconde guerre punique, le Sénat, après consultation des Oracles sibyllins, fait enterrer vifs, au Forum boarium, deux Grecs et deux Gaulois, minime romano sacro, dit T. Live.
(3) Sur la cérémonie des Argées où l'on jette à l'eau des mannequins représentant des vieillards, cf. H. hubert, Année sociologique, 4, p. 237 sq. Sur le Regifugium, frazer, LXXV, p. 157 et 301.
il est permis, spécifie un scoliaste de Virgile, de substituer des simulacres aux vraies victimes ; si les animaux nécessaires sont difficiles à trouver, les dieux en agréent l'image en pain ou en cire. C'est donc que la force vitale de l'animal n'est censée exercer sur le dieu aucune action nécessaire. L'aspect de l'offrande l'emporte sur sa vraie nature. Le dieu tient surtout à la forme. Le sacrifice lui apporte une satisfaction morale.
La prière, du reste, accompagne toujours le sacrifice. Elle est une formule, sans doute, rythmée et le plus souvent accompagnée de musique, un véritable carmen ; le moindre changement dans les termes détruit son efficacité; c'est que le dieu se plaît au langage rythmé et aux paroles traditionnelles. Ces paroles ne sont cependant pas une incantation, du moins dans la religion officielle ; elles présentent un sens raisonnable; elles nous apprennent clairement ce que l'homme attend de sa prière. La prière ne cherche pas à violenter les dieux; elle s'adresse à leur bonne volonté ; elle implore leur paix : pacem deorum, c'est-à-dire leur satisfaction et leur amitié. Pour obtenir leur bienveillance, e!le leur fait des promesses. Surtout, le fidèle accompagne sa prière de la stricte exécution des rites et des sacrifices qui représentent ses obligations et il demande au dieu d'accomplir, à son tour, les siennes. Les formules de prière citées par Caton concordent entièrement avec celles que nous font connaître les historiens ; elles peuvent servir de type de la prière romaine. Il convient tout d'abord de nommer le dieu auquel on s'adresse, non pas en raison du pouvoir magique du nom, mais par un souci scrupuleux de précision : Mars, te precor quaesoque. Il serait inutile de prier et de supplier, si le nom agissait par lui-même. Te precor quaesoque uti sies volens propitius, mihi, domo, familiaeque nosirae. Après avoir indiqué à qui s'adresse la prière, on spécifie en faveur de qui elle est faite : les deux parties sont, pour ainsi dire, mises en présence. Caton mentionne ensuite le rite accompli ; quojus rei ergo, agrum,terram, fundumque meum suovetaurilia circumagi jussi. Puis il énumère longuement les services qu'il demande au coeur bien disposé de Mars. Il conclut enfin : sic uti dixi, macte hisce suovetaurilibus lactentibus immolandis esto. L'immolation faite, il répète au dieu sa prière d'agréer le sacrifice et de ne pas en oublier l'objet : Mars pater, ejusquem rei ergo, macte his suovetaurilibus lactentibus esto. Ce sont les diverses phases et, souvent, les termes mêmes d'une action juridique.
Le cérémonial des fêtes religieuses comporte des sacrifices, des prières et des rites extrêmement divers et d'origine et de date. Un certain nombre d'entre eux ne trouve son explication que dans des pratiques de caractère primitivement magique. Telle est, nous semble-t-il, la lustration, qui met l'homme en état d'agir ou la chose en état d'être influencée par la divinité. La procession des animaux du sacrifice autour du domaine, celle des frères Arvales à travers les champs, semble bien avoir pour but de recueillir et de neutraliser les influences qui empêcheraient l'action favorable du dieu. Mais de bonne heure s'ajoute à la lustration une idée de purification qui se traduit soit par l'usage d'eau lustrale, soit par le passage à travers la flamme, soit par l'usage de la fumée. Il s'agit encore plutôt de pureté matérielle que de pureté morale. L'homme doit se mettre en état de plaire aux dieux. Lorsque la justice sera devenue la qualité essentielle des dieux, la première condition pour obtenir ta bienveillance divine sera pour l'homme d'être juste, et la lustration aura pour objet de le purifier des fautes autrefois commises. L'état de pureté mystique de la mentalité prélogique se transforme en une idée de justice et de pitié rationnelles. Les termes de justus et de plusprennent un sens moral.
Il est parfaitement légitime, il est même nécessaire de chercher, dans leur origine magique, l'explication du détail de la plupart des rites. Mais l'intelligence qu'ainsi nous en pouvons prendre aujourd'hui échappait entièrement aux Romains dès l'époque à laquelle fut fixé leur culte. Ils répétaient chaque année leurs cérémonies traditionnelles afin de ne pas offenser leurs dieux en leur enlevant leur dû. Ils y ajoutaient aussi. Plusieurs parmi les noms qui désignent des fêtes du calendrier de Numa semblent de formation nouvelle : armilustrium, lubi-lustrium. Les courses de chars, en mars et en octobre, ne paraissent pas chose très ancienne ; ce genre de spectacle ne fut introduit en Italie qu'au vie siècle par les colonies grecques de Crotone et de Sybaris et parvint à Rome, par l'intermédiaire des Etrusques, vers le début du Ve siècle. Il dut y arriver, nous semble-t-il, dépouillé de toute signification magique. A l'issue de la course d'octobre, le meurtre à coups de javelots du cheval de droite du char victorieux conserve la trace d'une sauvagerie de date plus ancienne, à moins qu'elle ne soit d'origine étrangère. On coupe la tête et la queue de la bête ; les gens de Subure et de la Via Sacra se disputent la tête ; la queue est portée en courant sur l'autel de la Regia et les Vestales recueillent le sang qui en découle. Ce rite cruel contraste avec l'esprit même qui, dans la course, met en jeu l'élégance rapide du bon cheval. La signification nous en échappe ; c'est tout ce qu'on en peut dire.
Mais les scènes de ce genre sont exceptionnelles dans la religion romaine. Le culte officiel apparaît de bonne heure dépouillé de la barbarie primitive. Il ne s'entoure pas d'une buée sanglante; il est pur de terreur. Les fêtes des dieux sont toutes, pour le peuple, des jours de joie-; elles ne l'ont jamais avili. Cette religion apparaît surtout utilitaire. Elle célèbre le départ et le retour des troupeaux et des armées, appelant sur les uns comme sur les autres la même protection du même dieu; les processions, en se déroulant à travers la campagne, doivent attirer sur elle le regard favorable de la divinité. En l'honneur de Vesta, du 7 au 15 juin, au moment où la moisson mûrit, on ouvre et on nettoie complètement le penus Vestae, réceptacle symbolique du grain de la cité, et on le prépare à recevoir le blé nouveau. A la fin d'août, les fêtes d'Ops et de Consus sont celles de la moisson rentrée. Culte froid et sans élan, religion grave et d'une sévérité tout administrative, mais essentiellement publique, ignorant les détours obscurs du mysticisme, claire, probe et foncièrement saine. Ce n'est pas sans raison que les poètes de l'époque classique ont vu de la beauté dans ces vieux rites campagnards.
III
l'organisation religieuse et les collèges sacerdotaux.
Par son caractère rationnel, juridique et utilitaire, le culte contraste donc avec la conception demeurée très primitive du divin. C'est que les dieux avaient été imaginés par le peuple, tandis que le culte était réglé par les magistrats de la cité. Entre les dieux et le peuple est intervenu, pour régler leurs rapports, le Collège des Pontifes. C'est lui qui a établi ces rapports sur la base du droit.
Au nombre de trois, tout d'abord, puis de cinq, puis de neuf, les Pontifes, sous la présidence du Pontifex maximus, héritier du pouvoir royal en ce qui concerne la religion, ont autorité pour régler tout ce qui touche aux rapports des hommes avec les dieux. Ils ne constituent cependant pas une caste sacerdotale isolée du reste du peuple. Ils ne sont pas prêtres, à proprement parler, ou du moins ils ne le sont que momentanément, comme chaque citoyen, lorsque sa charge l'appelle à remplir ses devoirs sacerdotaux ; ce sont bien plutôt des espèces de magistrats, des magistrats religieux. Ils se recrutent par cooptation parmi l'élite de l'intelligence romaine. Ils sont en même temps sénateurs, jurisconsultes, généraux. Exclusivement patricien, jusque vers l'an 300, le Collège des Pontifes s'ouvre a!ors aux plébéiens et même à des étrangers comme le Latin Tiberius Coruncanius qui laissa la réputation d'un homme de tout point remarquable (1). Il représente une commission d'administrateurs qui commande à la fois aux prêtres et au peuple.
Les Pontifes ont directement sous leurs ordres les flamines, prêtres annuels des trois grands dieux, Jupiter, Mars et Quirinus (Janus), flamines majeurs, et les douze flamines mineurs. C'est d'eux que dépendent les Vestales. Ils dirigent tous les autres collèges religieux, ceux de spécialistes comme les augures et les decemviri sacris faciundis et les diverses congrégations, Saliens, Arvales, sodales Titii, etc. Ils contrôlent, en un mot, toute la vie religieuse de la cité.
Leur mission particulière consiste à l'organiser et à la régler. Dépositaires de la tradition, ils doivent l'adapter aux circonstances. C'est ainsi que le Collège fixe, chaque année, le calendrier, et intercale les jours nécessaires pour mettre le comput civil d'accord avec le cours du soleil, de façon que les fêtes printanières tombent aux mois du printemps et ainsi de suite. A lui d'indiquer, par conséquent, quels dieux on fêtera et quel jour on les fêtera. Le calendrier dit de Numa est son œuvre. Ce sont les Pontifes qui ont à décider de l'admission des dieux étrangers, de l'emplacement, du plan, de la dédicace des temples et des rites à célébrer. Ils interviennent dans tous les cas nouveaux ou litigieux. De tous les prodiges il leur est rendu compte et on leur demande les moyens d'expiation. Ils représentent un pouvoir permanent chargé de fixer et d'administrer tout le jus divinum. C'est à eux que la religion doit son caractère formaliste et rationnel.
(1) Cic., Brut., 14, 55.
Un autre collège sacerdotal joue, à Rome, un rôle important, celui des augures. Les augures sont des spécialistes qui, sous l'autorité des Pontifes, ont pour mission d'observer les signes de la volonté divine et de les interpréter. Quoiqu'ils habitent parmi les hommes, les dieux romains sont moins familiers, en effet, que les dieux grecs; ils ne se laissent entrevoir que très exceptionnellement ; ils ne parlent pas ; on ne leur connaît pas d'oracle ; ils se contentent, pour donner leurs avertissements, de prodiges généralement enfantins dont les augures ont à discuter la signification. Tout un système de consultation des dieux se trouve en outre organisé ; les augures y président, non pour leur propre compte, mais pour celui du magistrat dont ils sont les auxiliaires.
Là encore, nous trouvons une règle s'efforçant de rationaliser un ensemble de pratiques primitives.
Les signes qu'interprètent les augures sont répartis en cinq catégories: ceux qui viennent du ciel, les éclairs; ceux que donnent les oiseaux, par leur vol et par leur chant ; ceux qui proviennent des quadrupèdes, en particulier l'inspection des entrailles des victimes ; enfin les prodiges divers : les dirae. La signification des éclairs était censée dépendre de la région du ciel où ils se produisaient. Les éclairs du jour paraissaient un avertissement de Jupiter ; ceux de la nuit, de Summanus ou de Vedius, le dieu des morts ; la forme de l'éclair en précisait sans doute la signification. Les coups de tonnerre dans un ciel serein étaient considérés comme particulièrement graves.
En ce qui concerne les oiseaux, la divination la plus couramment pratiquée consistait dans l'observation de leur vol. Ici encore intervenait la doctrine des régions du ciel, favorables ou défavorables, non moins que le nombre des oiseaux et leur espèce. Selon la tradition, Romulus se levait dès la fin de la nuit pour aller prendre les auspices au réveil de la nature. Antérieurement aux guerres puniques, les Romains avaient trouvé un substitut commode à cette vieille pratique : les poulets sacrés. Le magistrat se les faisait apporter à son réveil, et dans le silence favorable engageait avec l'augure préposé à leur soin, le dialogue suivant : « Dis-moi, le silence règne-t-il ? — II semble. — Dis-moi si les poulets mangent. — Ils mangent (1). »On connaît l'anecdote rapportée à la première guerre punique. Les poulets embarqués sur le navire du général se refusaient à manger. « Eh bien, qu'ils boivent, » et le général les fit jeter par-dessus bord. Il engagea la bataille et fut vaincu.
Nous avons déjà mentionné la théorie générale sur laquelle reposait l'examen des entrailles des victimes et, en particulier, du foie. Le mot haruspicium, désignant cette partie de la divination, est, au moins par sa première partie, étrusque ; le terme proprement latin est extispicium. La doctrine elle-même paraît d'origine étrusque. Elle repose sur une connaissance précise de la topographie anatomique du foie, complétée, sans doute, parcelle des entrailles et sur la distinction des parties censées relever de chacun des dieux. La chiromancie, à l'heure actuelle, se livre sur les formes et les lignes de la main à des spéculations analogues. L'autorité des Pontifes a conféré la consécration officielle de l'Etat à ce mode de divination.
Dès le V ème siècle, nous rencontrons également à Rome quelques traces de la divination de type grec. Tandis que le Romain cherche à connaître la volonté présente des dieux, le Grec les interroge, de préférence, sur l'avenir. Les dieux grecs et Apollon en particulier connaissent le destin ; leur prescience dépasse infiniment l'intelligence des dieux aveugles de l'Italie. A Préneste, une déesse peut-être d'origine grecque, ou, du moins, fortement influencée par la Grèce, la Fortune, fille aînée de Jupiter, Fortuna Primigenia (2), rend des oracles sur le modèle de la Pythie de Delphes, ce sont des phrases obscures qu'il s'agit d'interpréter.
(1) Cic., de Div., 2, 31, 71-72.
(2) wissowa, CLXXII, p. 259 sq.
Mais les sorts prénestins, trop voisins, paraissent avoir joui de peu de crédit à Rome, puisque, en 242, le Sénat interdisait encore, à l'un de ses membres, de les consulter (1). Il n'en fut pas de même des oracles sibyllins de Cumes.
Dans quelqu'un des antres volcaniques qui entouraient Cumes, les Grecs avaient dû trouver ou installer un oracle desservi par une prêtresse appelée la Sibylle. Comment elle rendait ses oracles, Virgile nous l'explique au début du sixième chant de l'Enéide (2). Comment un recueil de ces oracles pouvait-il intéresser Rome, les anciens ne semblent pas s'en être rendu compte. Leur tradition racontait seulement que la Sibylle elle-même en avait imposé l'achat à Tarquin (3). Leur introduction à Rome doit, en tout cas, être antérieure à la prise de Cumes par les Samnites en 423. Peut-être date-t-elle précisément de ce moment. Elle représenterait un épisode obscur de la diffusion des influences helléniques dans le Latium. Les oracles sibyllins avaient été déposés dans le temple de Jupiter Capitolin, où ils furent détruits, avec le temple lui-même, en 83 avant Jésus-Christ. Des fonctionnaires spéciaux, au nombre de deux, d'abord, puis de dix, duo puis decemviri sacris faciundis, placés, eux aussi, sous l'autorité des Pontifes, avaient été créés pour garder ces oracles et les consulter. On n'y recourait d'ailleurs que dans des circonstances exceptionnelles ou en face de prodiges dont l'explication dépassait la compétence des augures. Plus que tout autre chose, les oracles sibyllins ont contribué à introduire dans le culte romain les rites grecs, supplications, lectisternes, repas offerts aux statues des dieux, transformant ainsi, peu à peu, en idolâtrie la religion moins imagée mais plus idéale de l'ancienne Rome.
(1) val. max., 1, 3, 2.
(2) Aen., 6, 41 sq.
(3) dion. halic., IV, 62. plin., N. H., 13, 88. Cf. wissowa, CLXXII, p. 536 sq.
IV
la RELIGION ET LES DÉBUTS DE LA LITTÉRATURE.
Si accueillante qu'elle soit aux dieux et aux rites étrangers, la religion n'en porte pas moins profondément marquée l'empreinte originale du vieil esprit romain. L'instinct d'ordre et le soin du souvenir l'ont de bonne heure familiarisée avec l'écriture. Les Pontifes, semble-t-il, en ont fait un usage développé. Chargés d'indiquer les moyens divers et les formules qui devaient donner satisfaction aux dieux, ils prenaient note des prodiges et des solutions intervenues. Cette sorte de casuistique faisait l'objet du recueil des Indigilamenta qui dut être compilé dès le IV ème et, au plus tard, au III ème siècle. Les règles générales édictées sur tout sujet, morale, droit, religion, avaient été recueillies vers la même époque que les Indigilamenta dans les Libri ou Commentarii Pontificum, véritables archives religieuses de l'Etat romain. Ce n'est pas tout. Chargés du soin du calendrier, les Pontifes se trouvaient obligés à garder un souvenir précis des années écoulées, de leur nombre et des intercalations auxquelles elles avaient donné lieu. Primitivement, raconte-t-on, ils les marquaient d'un clou enfoncé dans une planche. Puis, ils prirent note des noms des consuls ; ils y ajoutèrent même une mention sommaire des événements les plus importants qui s'étaient produits dans l'année. Ces indications étaient écrites sur des planches d'abord gardées secrètes et, plus tard, exposées à la demeure du Pontifex maximus sur le Forum. C'est la collection de ces tableaux qui fut publiée en l'an 123 avant notre ère par le grand pontife Mucius Scaevola sous le nom d'Annales Maximi. Précieux document qui constitue la source principale et la seule authentique de notre connaissance de l'histoire romaine. Des albums des Pontifes proviennent également les Fastes, Fastes consulaires donnant la liste des consuls et Fastes triomphaux, que la piété traditionaliste d'Auguste voulut voir exposés, comme autrefois, sur les murs de la Regia et qui y furent gravés de son temps, à côté du calendrier. Ce sont les Annales pontificales qui ont imposé à l'histoire romaine, à Tite-Live comme à Tacite, cette forme qui nous semble étrange d'annales distribuant les événements année par année. On discutera longtemps encore, sans doute, de l'authenticité de ces documents, au moins pour les années qui ont précédé l'incendie gaulois en 390. Leur rédaction par les Pontifes explique le caractère des renseignements que nous possédons sur les temps anciens de Rome. Nous connaissons les noms des magistrats, le vote des lois, les guerres et les traités, les dédicaces de temples et, tout particulièrement, les prodiges qui tiennent encore chez Tite-Live une place si importante. Mais n'y cherchons pas de vues d'ensemble ou des considérations semblables à celles que l'on rencontrera chez Thucydide ou chez Polybe.
Les Pontifes qui dans leurs Commentaires ont fixé les premières règles du droit romain, ont donc été aussi les premiers historiens de Rome. Leur collège représente à la fois l'intelligence directrice et la conscience du peuple. L'emplacement de la Regia, sur le Forum, le lieu où il se réunissait et où il exerça son activité, apparaît comme vénérable entre tous.
C'est aussi dans la religion qu'il faut chercher l'origine de la plus ancienne poésie latine. Les fêtes des dieux lui ont donné l'essor en unissant autour de l'autel du sacrifice la parole rythmée de la prière, la musique et parfois l'exaltation de la danse.
On sait l'importance dont jouissait à Rome, en raison de sa participation nécessaire à toute cérémonie du culte public, la corporation des tubicines. Leur absence arrêtait tout le culte. Les actes du sacrifice et les formules de la prière étaient accompagnés de flûte. Toute invocation aux dieux était donc un texte rythmé. Sans pouvoir le définir, en raison de notre ignorance de la musique ancienne, on retrouve ce rythme dans tous les rituels qui nous sont parvenus, dans les tables Eugubines d'Ombrie, aussi bien que dans le texte étrusque incompréhensible inscrit sur les bandelettes qui entouraient la momie d'Agram. Les musiciens romains étaient élèves de ceux d'Etrurie, héritiers eux-mêmes, semble-t-il, de la tradition ionienne ou gréco-orientale. C'est des modes lydiens que parlent couramment les écrivains classiques lorsqu'ils font allusion à la musique ancienne étrusco-romaine. Par la musique, au moins, l'art étrusque a donc dirigé le premier mode d'expression des sentiments romains.
La même musique animait la danse. C'est peut-être à l'Étrurie, à Véies sa voisine, que Rome a emprunté la danse armée des Saliens. Casqués, portant la lance et les anciles, boucliers sacrés réputés tombés du ciel, les deux groupes de douze Saliens exécutent leurs évolutions sous la direction du vates qui règle les paroles et du praesul qui dirige danse et musique. Nous possédons, par l'intermédiaire de Varron, quelques bribes de leur chant. Les paroles en étaient inintelligibles pour les Romains eux-mêmes ; les commentateurs modernes n'en ont pas éclairci toutes les obscurités. Mais ils s'accordent généralement à y reconnaître au moins une ébauche du vers latin ancien, du saturnien, double succession de trois pieds marqués chacun par un temps fort.
Les frères Arvales dansent, de même, en l'honneur de Mars pacifique et de Dea Dia, sur un rythme à trois temps. L'heureuse trouvaille, dans l'enceinte où ils se réunissaient, aux environs de Rome, des Actes de leur confrérie, gravés à l'époque impériale, nous a livré leur chant (1). C'est une sorte de litanie dont chaque vers était répété trois fois :
Enos Lases iuvale
Neve lue rue Marmar \ sins incurrere in pleoris
Satur fu fere Mars \ limen sali s/a berber
Semunis alternei \ advocapit cunctos.
Enos Marmor iuvalo. Triumpe. Triumpe. Triumpe. \ Triumpe. Triumpe.
Les prêtres, dit le rituel, se retroussent, reçoivent les livrets et, chantant la litanie, dansent à trois temps.
La prière représente donc une poésie lyrique primitive. Lorsque, pour la célébration des Jeux séculaires, Auguste fit composer par Horace l'hymne que devaient chanter les chœurs alternés de jeunes filles et de jeunes gens, il ne faisait que renouveler une tradition dont l'origine remontait peut-être plus haut que Rome elle-même.
Notons la présence à Rome, dès l'époque primitive, du vates, habile à composer les paroles rythmées des hymnes sacrés, du praesul, réglant les danses, et du tubicen accompagnant danses et paroles. En fait, les trois professions devaient se confondre. Elles rentrent dans la corporation des tubicines, artistes, auxiliaires du culte.
Mais ces artistes ont-ils consacré leur talent exclusivement au culte? N’ont-ils pas, comme les bardes, auxiliaires des druides, été tentés parfois par d'autres sujets que les prières?
Nous ne voulons pas nous engager ici dans la question, si débattue depuis qu'elle fut posée par Niebuhr, de l'existence de chants épiques romains.
(1) LI, 28 ; VI, 2104.
La théorie de Niebuhr, reconnaissant à la base de l'histoire légendaire des premiers siècles de Rome les traces d'une épopée, repose sur une impression littéraire à laquelle on ne saurait se soustraire. La plupart des épisodes de cette histoire, la dramatique légende des Tarquins, Horatius Cocles, Clélie, Coriolan, les trois cent six Fabius, Torquatus, présentent une indéniable couleur poétique (1). Aucune raison sérieuse, d'autre part, n'autorise à s'inscrire en faux contre les témoignages antiques rappelant l'habitude des vieux Romains de célébrer, à l'issue des banquets, le souvenir des aïeux en des chants accompagnés de la flûte (2). Mais on ne saurait prouver la relation entre ces chants et la tradition légendaire romaine dont l'origine demeure obscure (3). En Etrurie, les peintures de la tombe de Vulci, où figurent Tarquin et Mastarna, semblent bien prouver l'existence d'un cycle romanesque auquel n'étaient pas étrangers les héros de l'ancienne histoire romaine. Des chants épiques latins pouvaient y trouver des modèles. On reconnaît, aujourd'hui, qu'il ne saurait y avoir de poème sans poète. En Etrurie, les poètes auraient été les musiciens et jongleurs professionnels, ludions et histrions ; à Rome, ils auraient été les tubicines, musiciens dont la formation technique dépendait de l'Etrurie et chez qui la modestie de leur condition n'excluait nécessairement ni la vivacité d'esprit ni l'imagination. S'il en était ainsi, ces auxiliaires du culte auraient bien mérité le droit de festoyer au Capitole aux dépens de Jupiter et de remplir la ville de leurs folies aux jours de leur fête annuelle.
(1) Voir en dernier lieu de sanctis, CXLII, 2, p. 502 sq.
(2) Cic., Tusc., 1, 2, 3 ; 4, 2, 3 (citant caton). val. mav., 2, I, 10; festus, d'aprèsVarron, p. 77 (M.) ; Hor., Carm., 4, 15, 29. Cf. E. pais,
CXXI, 1, p. 9, note 1.
(3) On en explique généralement la formation par une floraison mythique, en majeure partie d'origine religieuse. C'est la tendance que M. Pais pousse à l'extrême. L hypothèse du mythe a remplacé celle de l'épopée populaire. Malgré l'ingéniosité et 1’érudition qu'elles mettent en jeu, ces interprétations apparaissent bien souvent arbitraires.
Le théâtre, en tout cas, plongea quelques racines, à travers la couche superficielle des jeux de type grec, jusqu'à la couche profonde des vieilles fêtes indigènes. Les Jeux romains, suivant la tradition, auraient été institués par Tarquin. Dès le VI ème siècle probablement, et certainement au début du V ème siècle, les Etrusques célébraient en effet des jeux dont leurs peintures funéraires nous ont conservé la représentation. C'étaient des jeux athlétiques, courses de chars, luttes de diverses sortes, qui semblent bien un premier emprunt à la Grèce. Qu'ils remontent ou non à l'époque royale, les Jeux romains se célèbrent en l'honneur de Jupiter Capitolin; ils ont toujours conservé la marque évidente de leur origine étrusque. Ils s'ouvraient par un défilé de tous leurs acteurs, qui reproduisait à peu près exactement la pompe du triomphateur montant au Capitole. Derrière les concurrents et avant les statues des dieux ou le char portant le triomphateur costumé lui-même en Jupiter, marchaient les chœurs de danseurs lydiens, Ludions ou Histrions, et les joueurs de flûte ou de cithare. Le rôle de ces chœurs dans les jeux anciens se réduisait, semble-t-il, à des danses mimées accompagnées de musique, mais sans paroles. De même en Grèce les chœurs de Satyres représentaient par leurs évolutions et leur mimique las fables du drame satyrique. La première apparition de ces acteurs à Rome remonterait à l'an 366; on les aurait fait venir d'Étrurie pour se procurer l'assistance des dieux contre une épidémie. Les Jeux romains, suivant Mommsen, ne remonteraient pas plus haut. Dans le long récit qu'il accorde aux origines du théâtre romain, Tite-Live (1) parle ensuite des plaisanteries, en vers informes, qu'échangeaient les jeunes gens, cherchant à accorder leurs gestes avec leurs paroles. C'étaient les chants fescenins, vieille tradition indigène peut-être, comme l'indique Horace, ou nouvel emprunt à l'Etrurie (2). La licence fescennine, en tout cas, paraît avoir été nettement satirique. Elle fait penser à la veine de parodie qui fleurit au IV ème siècle en Sicile et dans toute la Grande-Grèce.
On vit apparaître ensuite, continue Tite-Live, des acteurs professionnels qui reçurent le nom étrusque d'histrions. Ne se contentant plus de ce vers rude et sans art semblable au fescennin qu'ils improvisaient tour à tour, ils en vinrent à représenter des Satires accompagnées de musique dont les paroles chantées étaient réglées sur la partie de flûte. C'étaient là de véritables pièces de théâtre imitant, sans aucun doute, les farces phlyaques et les Rhintonica de l'Italie méridionale (3). Elles précédèrent d'ailleurs immédiatement les pièces de type classique de Livius Andronicus.
Mais la jeunesse romaine, abandonnant aux histrions cet art trop savant, continua ses anciennes bouffonneries entremêlées de vers. C'est ce qu'on appela plus tard des exodes dont le genre se confond, semble-t-il, avec celui des Atellanes, d'origine campanienne comme l'indique le nom (4). « Les jeunes gens, dit Tite-Live, se réservèrent la représentation des ces pièces et ne la laissèrent pas profaner par les histrions. De là vient que les acteurs d'AtelIanes ne sont point exclus des tribus et font leur service militaire, comme n'étant pas des comédiens (5). »
(1) T. Liv., 7, 2. Cf. piganiol, CXXXI, p. 109 sq.
(2) la ville de Fescennium qui aurait fourni le modèle de ces chants, se trouvait en Etrurie, dans la région de Viterbe.
(3) croiset, LIV, 5, p 172 sq.
(4) ATELLA, petite ville de Campanie, entre Capoue et Naples.
(5) T. Liv., 7, 2.
A côté des spectacles savants, évolutions rythmées des Ludions et Satires des Histrions, nous trouvons donc une veine populaire qui reflète les mêmes tendances et qui introduit peu à peu le dialogue dans les jeux scéniques. Et cette tradition, née aux jours de fêtes religieuses, se poursuit jusqu'à l'époque impériale à côté du théâtre classique. L’Atellane resta populaire; nous la reconnaissons aujourd'hui encore, rajeunie par la verve italienne, dans la Commedia dell’ Arte. Polichinelle, Arlequin, Pierrot, Colombine descendent en droite ligne de Maccus, le lourdaud bossu au long nez en bec de perroquet et aux larges oreilles, de Bucco, le vantard, de Pappus, le vieux radoteur, de Dorsenus et autres types caricaturaux de l'Italie ancienne. Le calembour, l'allusion plaisante à l'événement du jour, la parodie ont égayé les vieux Romains aux fêtes de leurs dieux primitifs. Les jeux de l'esprit, si naïfs fussent-ils, n'ont pas été étrangers à leur religion.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE ROME, L'ITALIE ET LA GRÈCE
Nous reconnaissons dans la religion les mêmes traits que dans l'ensemble de l'ancienne civilisation romaine. Le fond en apparaît extrêmement primitif. La conception même de la divinité, l'organisation du culte autour du foyer et des champs de la famille, apparaissent antérieures à la fondation des cités et proviennent, sans aucun doute, des pâtres et laboureurs descendants des vieilles tribus préhistoriques. Parmi ces éléments primordiaux les uns semblent avoir appartenu plutôt aux envahisseurs indo-européens de la péninsule italique, les autres, comme Saturne et la Terre-Mère, par exemple, aux autochtones méditerranéens, Sicules ou autres (1). Mais sur ce substrat primitif sont venus se déposer successivement les sédiments apportés par toutes les vicissitudes de la plus ancienne histoire romaine. Comme dans une coupe de terrain, nous apercevons dans la masse solidifiée de la religion romaine une couche épaisse et d'ailleurs mal distincte des couches primitives, d'influences étrusques à laquelle succèdent de bonne heure les traces de plus en plus nombreuses des rapports de Rome avec les Grecs de l'Italie méridionale et de Sicile. La nuance hellénique s'accentue à mesure que la puissance romaine progresse vers les régions hellénisées de l'Italie; les dieux grecs se multiplient en même temps que leurs représentations figurées, les légendes étrusques et grecques se mêlent à celles du Latium, des rites gréco-étrusques, les danses, peut-être des rudiments de poésie, les jeux, prennent dans le culte une place de plus en plus large.
(1) Cette distinction est faite avec beaucoup de pénétration par A, PiGANlOL, CXXX, p. 93-139.
La religion romaine n'est pas seulement romaine, elle est italienne et par là même, dès une époque ancienne, toute pénétrée d'influences méditerranéennes et spécialement grecques.
Son trait caractéristique, emprunté peut-être à l’Etrurie, est sa forte organisation administrative sous l'autorité des collèges de spécialistes et en particulier des Pontifes. A travers le mélange hétérogène des traditions religieuses, les Pontifes semblent s'être appliqués à développer, en un réseau cohérent, l'élément rationnel auquel ils ont donné la forme prudente et stricte de rapports juridiques entre l'homme et la divinité. Par eux, la religion romaine devient essentiellement un culte formaliste et officiel. Si haut que nous puissions remonter, elle apparaît comme une religion d'Etat.
Sous cette froide enveloppe palpite cependant une vie populaire que nous connaissons peu, sans doute, mais que nous devinons dans les cultes familiaux et agraires, dans les innombrables cultes locaux et dans certaines manifestations telles que les jeux fescennins ou les Atellanes, non moins que dans bien des rites de caractère et de sens magiques incorporés dans la religion officielle.
Qu'est-ce donc que le peuple romain durant cette longue période que nous venons de parcourir? Quel est son génie et que doit-il à la Grèce ?
Le peuple romain et sa civilisation sont un mélange d'éléments européens et méditerranéens préhistoriques fondus par une discipline, discipline qui fut étrusque, c'est-à-dire toute pénétrée d'éléments helléniques, avant d'être proprement romaine. Au moment où commence l'histoire, nous trouvons à Rome une plèbe urbaine et une population campagnarde, deux peuples pour ainsi dire, dont le second se divise encore en une aristocratie patriarcale et une foule de modestes paysans. Les nécessités de la lutte pour la vie imposent la cohésion à cet agrégat. Mais l'esprit des uns et des autres semble profondément différent. Les fils de la terre, patriciens ou simples paysans, apportent la solidité de leurs traditions rustiques et leur obstination conservatrice. Plus souples, plus entreprenants et moins frustes, les enfants de la ville établissent la liaison entre la cité romaine, les grandes villes étrusques ou étrusquisées qui entourent Rome et les cités plus lointaines de l'Italie hellénisée. Par eux, les idées et les arts que les flots de la mer apportent aux côtes de l'Italie se diffusent par les grands chemins terrestres jusqu'à l'intérieur du Latium et pénètrent dans la ville.
Dans le peuple romain, la conquête de l'Italie introduit ensuite toute sorte d'éléments nouveaux. L'homme du Samnium, de Campanie. d'Apulie, du Bruttium, s'y rencontre avec le Falisque, l'Étrusque et l’Ombrien, les dieux grecs avec ceux des villes italiennes conquises et les divinités topiques des sanctuaires campagnards. Seule, l'aristocratie sénatoriale représente dans cette foule l'élément de permanence ; elle maintient son autorité et impose ainsi autour d'elle la règle et l'unité. Mais l'unité n'est que superficielle et la règle qui s'applique aux moindres détails, à l'alphabet comme au culte, doit, pour conserver sa force, s'assouplir à consacrer successivement les innovations intervenues en dehors d'elle.
Le peuple romain n'est pas, il se forme peu à peu et, avec lui, son génie, d'abord peu caractérisé comme celui de l'enfance, est en perpétuelle transformation. Lorsque, vers la fin du III ème et le début du II ème siècle, une histoire plus certaine va nous le montrer parvenu à l'adolescence et que les débuts de sa littérature nous permettront de saisir ses pensées, il nous apparaîtra plus italien que proprement romain et déjà tout pénétré, antérieurement à tout contact direct avec la Grèce, de légendes, d'idées et de sentiments grecs.
DEUXIÈME PARTIE
ROME CAPITALE MÉDITERRANÉENNE
Cherchant à présenter un tableau d'ensemble de l'histoire romaine, Florus en compare les périodes successives à celles de la vie d'un homme. Il en prolonge l'enfance et l'adolescence jusqu'au consulat d’Appius Claudius, au début du III ème siècle avant notre ère. Puis vient, jusqu'à la mort de César, sa forte et robuste jeunesse. Il avait fallu à Rome, remarquait-il, près de cinq cents ans pour conquérir l'Italie ; moins de deux
siècles allaient la rendre maîtresse de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, en un mot de tout le cercle du monde civilisé.
Adoptons le cadre ainsi tracé. Cette période de jeunesse exubérante et ambitieuse produit en effet un changement décisif dans la civilisation romaine. L'horizon intellectuel des Romains dépasse désormais l'Italie pour embrasser, peu à peu, l'ensemble du monde méditerranéen. La lutte grandiose que Rome soutient contre Carthage la met tout d'abord en possession de la Sicile (première guerre punique, 264-241) puis de toute la Méditerranée occidentale (deuxième guerre punique, 218-201). Elle continue presque sans interruption par l'abaissement puis la conquête de la Macédoine (200-168), de la Grèce (146), de l'Asie Mineure (132), de la Syrie (65) et enfin de l'Egypte (31). Les ambitions que pousse au paroxysme la convoitise du butin suscitent les bouleversements des guerres civiles où sombre l'état social et tout l'idéal ancien. La population même se renouvelle. Les troupes interminables de prisonniers de guerre de toute provenance tombés en esclavage puis affranchis prennent la place des citoyens décimés par les guerres et des petits propriétaires campagnards ruinés par les transformations économiques. Rome voit affluer chez elle les marchandises et les commerçants d'outre-mer, des pédagogues, philosophes, otages, ambassadeurs, artistes et artisans, grecs ou hellénisés, qui exercent autour d'eux une large influence. Ce n'est pas à tort qu'on a vu dans toute l'Antiquité le développement d'une seule et même civilisation dont le centre s'est déplacé successivement d'Athènes à Rome et de Rome à Constantinople. Rome en apparaît dès lors comme la dépositaire.
Le fait essentiel de cette période est le développement d'une littérature romaine. D'une façon générale, cette littérature s'inspire de celle de la Grèce : elle apparaît comme une création savante et artificielle. Elle ne s'en présente pas moins, à ses débuts, comme une littérature d'imagination et de forme poétique et commence, ainsi que les littératures originales, par l'épopée et par des spectacles populaires. Ses premières œuvres, du reste, sont antérieures à tout contact direct avec la Grèce. C'est en 200 que les armées romaines attaquent Philippe de Macédoine. L'œuvre littéraire de Livius remonte à 240. Naevius, un peu plus jeune que lui, disparaît vers l'an 200. Ennius est né en 239, Plaute en 254, Caton en 234 ; ils appartiennent, par conséquent, à une génération entièrement formée par Rome encore exclusivement italienne, Livius Andronicus est un Grec de Tarente, Naevius un Campanien, Ennius un Bruttien, Plaute un Ombrien. L'éclosion de la littérature latine ne saurait donc être considérée comme une révolution soudaine, conséquence de la conquête des pays grecs, mais bien comme le dernier effet de l'assimilation, par Rome, des provinces hellénisées de l'Italie. C'est en Sicile, surtout, au cours de la première guerre punique, que les Romains ont appris à connaître les formes littéraires grecques. La Grèce leur fut révélée tout d'abord par l'école et par les livres. Ainsi s'explique le défaut d'actualité de la première littérature latine. Elle s'inspire non des œuvres contemporaines du monde hellénistique mais des modèles de l'époque classique. Ses maîtres sont Homère et les tragiques. La comédie seule fait exception. C'est que, en Sicile et dans toute l'Italie méridionale, la comédie était un genre exceptionnellement vivant et populaire. La source de la poésie romaine est grecque sans doute, mais elle sort du terroir italien.
Loin de se trouver intimidés par la perfection de tels modèles et de se rétracter sur eux-mêmes devant l'austère noblesse de l'idéal classique, les Romains surent l'admirer et l'adoptèrent d'enthousiasme. Ils se trouvaient en effet préparés à le comprendre par les siècles obscurs de lente initiation parcourus au contact de leurs voisins d'Italie. Ils, se présentèrent à la Grèce en élèves dociles mais déjà formés, capables de profiter de l'enseignement offert, capables aussi d'y faire leur choix. Il empruntèrent beaucoup, mais sans oublier complètement leur développement antérieur et en cherchant, la plupart du temps, à adapter leurs imitations à leurs traditions propres, à leurs besoins et à leurs aspirations. Sous les formes grecques transparaissent bon nombre de traits italiens. Sans méconnaître les premières, ce sont surtout les seconds que nous voudrions tenter de mettre en lumière.
CHAPITRE PREMIER
LES PREMIERS POÈTES
livius andronicus et Naevius.
Andronicus faisait partie du butin enlevé à Tarente en 272 et était échu à la famille des Livii qui l'affranchit plus tard, d'où son nom de Livius Andronicus. Autant que nous en puissions juger par le peu que nous savons de lui, il n'apparaît que comme un bien modeste personnage ; sa figure est terne, son genre manque de rayonnement. Elevé avec les enfants de son maître, il fut employé, plus tard, à enseigner le grec et le latin aux fils des amis et clients de la maison. Il fut le pédagogue, non seulement de ses élèves directs, mais des Romains eux-mêmes.
C'est pour ses écoliers sans aucun doute qu'il s'avisa de traduire l'Odyssée, le livre par excellence de l'éducation enfantine des Grecs. De ce travail il nous reste une quarantaine de vers, cités en menus fragments par des grammairiens. Nous y voyons Livius s'appliquer, magister scrupuleux, à rendre textuellement chaque hexamètre homérique par un saturnien au rythme lourdement frappé. C'est une traduction juxtalinéaire du genre des « corrigés » qui peuvent se dicter aujourd'hui encore dans les classes élémentaires.
Livius traduit tout littéralement, sauf les images et les envolées d'expression devant lesquelles le latin se trouvait dépourvu de moyens. Créer n'est pas son fait, soit qu'il en soit incapable, soit qu'il n'ose se le permettre devant ses élèves.
Par la faveur de ses protecteurs et de ses disciples aristocratiques il n'en fait pas moins figure à Rome à la fois d'interprète officiel de la poésie grecque et de poète national. La première guerre punique terminée, le Sénat voulut donner aux Jeux romains le même caractère qu'à ceux qui se célébraient en pays grec. Andronicus fut chargé, pour cette occasion, de traduire une tragédie et une comédie grecques. Son succès fut sans doute honorable, puisqu'il ne s'en tint pas à ce premier essai. De son œuvre tragique nous possédons quelques titres et une quarantaine de vers. Le style en présente les mêmes caractères de précision sèche et de raideur que celui de l'Odyssée latine.
Mais à travers ces traductions prosaïques c'étaient les héros grecs qui apparaissaient aux Romains, plus grands que la réalité, et cependant profondément humains, passionnés, raisonneurs, héroïques, aventureux ou résignés. Leurs tragiques aventures les mettaient aux prises avec la force invincible du Destin. On reconnaissait en eux des exemples insignes des vicissitudes de la vie. L'action ravissait les imaginations ; on n'apercevait pas la pauvreté de la forme. Par considération pour le traducteur de ces belles légendes, le Sénat accorda aux musiciens, auteurs et acteurs, confrères de Livius, un lieu de réunion et de culte dans le temple de Minerve sur l'Aventin. En 207, pendant la seconde guerre punique, le poète fut encore chargé de composer l'hymne que devait chanter un chœur de vingt-sept jeunes femmes pour remercier les dieux de la victoire du Métaure (1). Avec Livius Andronicus et par lui, la poésie grecque obtenait droit de cité à Rome.
A la sage application de Livius Andronicus s'oppose la fougue enthousiaste de Naevius. Celui-ci est un Italien de Campanie, soldat pendant la première guerre punique, plébéien ardent aux luttes politiques contre l'aristocratie qui l'emprisonna et finalement l'exila.
Poète épique, Naevius est un créateur, précisément par le mélange qu'il accomplit des leçons grecques et des traditions italiques. Livius Andronicus avait traduit l'Odyssée ; il voulut, lui, faire une Iliade, mais une Iliade latine. L'idée et la forme épique, il les emprunta à Homère, mais la guerre qu'il venait de combattre lui parut un sujet aussi grand que la lutte des Grecs contre Troie. C'est donc la guerre punique qu'il chanta. D'autre part, comme la légende grecque semblait la source de toute épopée, il s'ingénia à rattacher son poème au cycle troyen. A l'histoire il donna pour atmosphère le mythe. Le premier, à notre connaissance, il évoqua les origines troyennes de Rome et, à propos de la guerre punique, les amours malheureuses d'Enée et de Didon (2). Qui peut nier que le récit poétique des combats auxquels il assista ne se rattache peut-être à quelque tradition de chants épiques latins ou campaniens, célébrant par le verbe les exploits qu'au jour du triomphe la peinture racontait au peuple et dont elle conservait le souvenir dans des tombes comme celle de l'Esquilin ?
(1) T. Liv., 27, 37, 7.
(2) La Guerre Punique devait commencer par un tableau de la prise de Troie fr. 5. Noctu Trioad exibanl capitibus opertis... — C'est à Didon, sans doute, qu'Énée raconte ses aventures.
Ce n'est pas chez Homère, en tout cas, que Naevius trouvait la source des exploits et des amours d'Enée. Il se serait inspiré, suivant M. Pais, soit de la poésie qui pouvait fleurir de son temps à Tarente ou à Syracuse, soit même des histoires d'Italie composées en Sicile depuis le IV ème siècle et dans lesquelles d'ingénieux écrivains se seraient efforcés de rattacher à la tradition préhistorique grecque les origines de la ville dont la puissance s'étendait progressivement en Italie. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse ici c'est l'originalité de cette combinaison voulue de l'histoire et de l'imaginaire.
La forme de la poésie de Naevius apparaît également nouvelle. Son mètre reste le saturnien. Mais il n'hésite pas à y faire entrer des expressions calquées sur celles de la langue poétique grecque. Avec lui commence le travail d'enrichissement artistique de la langue romaine. Deinde pollens sagittis, inclutus Arquitenens Sanctus Jove prognatus, Putius Apollo.
Il a le sens du style poétique, différent de la prose, surtout par l'emploi de termes spéciaux. En Grèce, le poète use de termes archaïques empruntés le plus souvent à Homère ou de mots dialectaux ; ou bien encore, il invente des composés résumant une image en un mot et qui se transmettent d'œuvre en œuvre. Pour Naevius et après lui pour les poètes romains en général, les mots qui donneront à la poésie sa résonance particulière et sa couleur seront soit des termes étrangers au parler courant, soit des alliances de mots la plupart du temps imitées du grec, soit des mots composés. Les deux vers cités ci-dessus fournissent l'exemple de ces divers procédés. Naevius crée ainsi en latin la langue artistique, celle des dieux et des héros s'exprimant d'autre façon que les hommes pour les besoins pratiques de la vie journalière.
Pour les Jeux, la grande manifestation artistique de ce temps, Naevius composa des tragédies et de nombreuses comédies. Parmi ses tragédies, la plupart sont imitées de pièces grecques ou du moins inspirées par la légende grecque. Mais au théâtre aussi il voulut être novateur. Il mit en scène l'enfance de Romulus et de Remus. Lors du triomphe de Marcellus en 222, il fit représenter l'un des faits d'armes de la campagne, la prise de Clastidium, portant ainsi au théâtre, animé du souffle tragique et du dialogue poétique, le spectacle des victoires du triomphateur. Les acteurs de ces drames historiques revêtaient le costume réel des chefs romains, la toge brodée, praetexta, d'où le nom de fabulœ praetextatae. Si la hardiesse de Naevius avait trouvé auprès du peuple et de l'aristocratie le même appui que les simples traductions de Livius, une tragédie originale romaine aurait pu naître et se développer.
Ses comédies portaient les unes des titres grecs, les autres des titres proprement latins. Dans les premières il usait déjà, semble-t-il, du procédé de la contamination que l'on reprocha plus tard à Térence, c'est-à-dire qu'il fondait en une seule pièce l'action et les épisodes de plusieurs modèles grecs. Quelques fragments qui paraissent provenir de ses comédies à sujet latin portent à croire qu'il y donnait large cours à la verve railleuse des vieux chants fescennins et aux plaisanteries du genre de celles qui, dans la plèbe ou les rangs des soldats, accompagnaient parfois la marche triomphale du général victorieux. Qu'aux fêtes de Liber, au moins, demandait-il, la parole soit libre (1). Un fragment, conservé par Aulu-Gelle, fait une allusion satirique à quelque aventure de jeunesse de Scipion l'Africain (2) :
Celui qui tant de fois accomplit tant d'exploits glorieux, dont les hauts faits brillent aujourd'hui de tant d'éclat, qui aux yeux des nations apparaît seul, en avant de tous, un jour son père l'a ramené de chez sa maîtresse couvert seulement d'un pallium.
Sans doute tous ces efforts originaux de Naevius puisent-ils leur sève dans les traditions anciennes du vates latin ou campanien. On peut reconnaître chez lui la veine indigène épique et comique, amplifiée et élevée à la dignité littéraire par la forme savante des genres poétiques grecs.
II
ennius.
Le grand poète de cette période primitive fut Ennius, à la fois inspiré et savant. Il était lui aussi un Italien du midi, né à Rudies en Calabre, mais devenu profondément romain. Il appartient à la génération qui suivit celle de Naevius et son talent montre bien le progrès rapide réalisé par Rome entre la première et la seconde guerre punique. Son œuvre littéraire, contemporaine de celle de Plaute, embrasse tous les genres : épopée, tragédie, comédie, et en outre la satire, mélange de raillerie, d'idées morales et philosophiques, de polémique et d'exposé didactique de connaissances extrêmement diverses.
(1) Fr. 113: libcra lingua loquemur ludis Liberalibus.
(2) A. gell., V, 7, 8, 5 :
Elle forme vraiment la transition entre la période des débuts et le développement classique. Ennius tient de près encore à Livius et à Naevius tandis que, par Lucilius, le genre qu'il inaugure trouve son prolongement chez Horace et que les contacts sont nombreux et étroits entre les Annales et l'épopée de Virgile.
Comme Nœvius, Ennius voulut attacher son nom à une Iliade romaine. Mais ce n'est plus seulement un épisode de l'histoire de Rome, c'en est l'ensemble, depuis les origines jusqu'à son temps, qu'il entreprend de présenter sous la forme épique. C'est à l'œuvre historique des Pontifes romains qu'il emprunte son titre d’Annales. Entre les Pontifes et !e poète, les premiers historiens romains ses contemporains, Fabius Pictor et Cincius Alimentas, servent sans aucun doute d'intermédiaires. Mais ceux-ci écrivent en grec et ne s'adressent par conséquent qu'à une élite. Par la poésie, c'est le peuple lui-même que veut atteindre Ennius ; son nom et ses paroles doivent voler sur les lèvres de la foule.
La seconde guerre punique, durant laquelle il a combattu, lui apparaît comme l'apogée et l'aboutissement des destins de Rome. Elle devait former le centre du poème, puisque nous la voyons commencer avec le VIII ème chant et que le XVIII ème chant terminait les Annales en l'an 174. Après les légendes de la fondation, déjà narrées par Naevius, et les souvenirs des siècles anciens, on devait donc y voir défiler longuement, avec des attitudes calquées sur celles des héros d'Homère, les chefs qui au cours de ces quarante années décisives présidèrent aux destins de Rome.
Artificielle et savante, comme du reste toute œuvre d'art, cette épopée, par son âme toute vivante d'actualité, était faite pour être comprise et goûtée comme l'ont été longtemps et le sont encore en Italie celles de l'Arioste et du Tasse. Ennius comme Naevius ne sont pas seulement des hommes de cabinet vivant des livres grecs, ce sont des hommes d'action qui cherchent à rendre sous une forme artistique des impressions et des sentiments qu'ils ont éprouvés et qu'ont partagés leurs contemporains. La Guerre punique et les Annales sont bien des épopées romaines et non de simples transpositions de Illiade.
Auprès des Romains qui lisaient ses œuvres, Ennius passait cependant pour plus pénétré des influences grecques que Naevius. Ce jugement devait s'appliquer surtout à sa langue et à son style qui, tout en montrant l'emploi des mêmes procédés, apparaissent en effet plus savants que chez son prédécesseur.
Le mètre, tout d'abord, n'est plus le saturnien mais bien l'hexamètre calqué sur le vers épique grec. Les images et les alliances de mots, les procédés de style, apostrophes, comparaisons, se modèlent sur l'exemple d'Homère. Il ne s'agit pas cependant de simple traduction, mais bien plutôt d'adaptation et de transposition. L'imitation du maître n’altère pas la physionomie propre du poète, tantôt rude et énergique avec une tendance accentuée à l'emphase, tantôt gracieuse et d'une douceur charmante. Les envolées poétiques alternent chez lui avec des traits de réalisme un peu lourds, avec du prosaïsme et des gaucheries, mais l'expression présente, la plupart du temps, une plénitude de sens et une sonorité de verbe qui est vraiment d'un grand poète. Il est un écrivain chez nous à qui fait penser Ennius, c'est Ronsard qu'animé le même génie agité et chercheur fougueusement passionné, amoureux du grand et de la beauté, unissant le zèle inexpérimenté de l'archaïsme aux grâces parfois un peu mièvres empruntées à quelque modèle admiré pour son adresse savante.
Les tragédies formaient une part assez considérable de l'oeuvre d'Ennius ; les anciens nous ont transmis les titres d'une vingtaine (1). Deux d'entre elles mettaient en scène des sujets romains : le Rapt des Sabines et la Prise d'Ambracie ; la plupart des autres appartiennent au cycle troyen, devenu romain par adoption. Presque toutes, a-t-on remarqué, semblent inspirées d'Euripide. De son modèle Ennius ne reproduit pas seulement le pathétique, mais aussi les habitudes raisonneuses et les discussions philosophiques, morales et religieuses. Il discute contre le destin, il s'essaye à analyser le caractère des hommes et même des dieux ; son théâtre est un théâtre de passion et d'idées. Voici une profession de foi tout épicurienne et digne de Lucrèce, provenant delà tragédie de Telamo :
Ego deum genus esse semper dixi et dicam caelitum, Sed eos non curare opinor quid agat humanum genus ; Nam si curent, bene bonis sit, male malis, quod non est.
Qu'il y ait une race des dieux je l'ai toujours dit et je le dirai, mais que ces dieux s'occupent des actes de la race humaine je ne le pense pas, car s'ils s'en occupaient, aux bons ils donneraient le bien et le mal aux méchants, ce qui n'est pas.
C'est le grand argument de l'existence du mal opposé à la perfection divine.
La morale surtout le préoccupe, comme elle intéressait déjà son modèle Euripide. Un fragment d'origine incertaine nous présente une belle image familière et frappante de la solidarité :
Homo qui erranti comiler monstrat viam Quasi lumen de suo lumine accendat facit : Nihilominus ipsi lucet, cum illi accenderit.
L'homme qui aimablement montre la voie à celui qui erre agit comme celui qui laisse son voisin allumer son flambeau au sien ; la lumière ne brille pas moins pour lui lorsqu'il l'a communiquée.
Mais sa morale repose sur une idée bien romaine; le droit passe avant toute autre chose : il est supérieur même à la vertu :
Melius est virtute jus, nom saepe virtutem mali Nanciscuntur, jus aeque ac cum se a malis spernit procul,
Mieux vaut le droit que la vertu, car la vertu, souvent, les méchants peuvent la rencontrer; le droit par lui-même repousse au loin les méchants.
Une ample pensée, beaucoup plus philosophique que religieuse, et plus dramatique encore que philosophique, celle de l'inexorable fatalité, domine tout ce théâtre comme elle dominait le drame athénien. Le sort des hommes ne dépend pas du caprice des anciens dieux innombrables supposés partout présents. Les dieux comme les hommes sont soumis au Destin. Quoi qu'ils fassent, ni les uns ni les autres ne sauraient échapper à la loi suprême et aveugle fixée de toute éternité. Sa force s'empare des individus et bon gré malgré leur fait jouer le rôle auquel ils étaient destinés. La malheureuse Cassandre est l'image vivante de cette loi fatale. Possédée par son don de prophétie, elle gémit en vain du trouble qu'elle jette dans sa famille et dans sa cité :
Mère chérie, de toutes les femmes de beaucoup la meilleure, je suis envoyée pour de mystérieuses prophéties ; Apollon, malgré moi, me force, hors de moi, à proclamer les destins. J'en rougis devant les vierges mes compagnes, j'ai honte de moi devant mon père excellent. Ma mère, j'ai pitié de toi et dégoût de moi-même.
Et la prophétie que nous a conservée un autre fragment s'exprime en des termes qui devaient éveiller un retentisse ment profond dans les âmes d'une génération grandie au milieu des anxiétés de la guerre d'Hannibal. La catastrophe voulue par le Destin se prépare pour la Cité; la voici, rien ne pourra l'écarter.
Du théâtre et par le théâtre, Ennius se trouvait amené à la philosophie. Mais la philosophie qu'il connaît, ce n'est pas encore, semble-t-il, celle des grandes écoles de la Grèce hellénistique, on a du moins n'en perçoit-il l'écho qu'à travers la Sicile. Une de ses satires s'intitulait Epicharme, du nom du poète sicilien dont la verve ne se faisait pas faute de railler les dieux aussi bien que les hommes et dont l^œuvre abondait d'ailleurs de sentences et de discussions philosophiques. Il semble bien qu'elle racontait un songe d'Epicharme; le poète se croyait mort, il descendait aux Enfers et s'entretenait entre autres avec Pythagore lui-même. Un fragment donne la note du poème et des doctrines qui s'y trouvaient développées; c'est un naturalisme, interprétant les vieux mythes religieux par des idées naturalistes. Jupiter n'est autre que l'univers en perpétuelle métamorphose ; c'est l'air qui se fait vent et nuage, et pluie, c'est l'élément nourricier de toute vie :
Istic est is Juppiter, quem dico, quem Graeci vocant
Aerem, qui ventus est et nubes, imber poslea
Algue ex imbre frigus, ventus post fit, aer denuo.
Haec propter Jupiter sunt ista quae dico tibi
Quando mortales atque urbes beluasque omnes juvant.
Plus tard, sans doute, Eunius a même poussé plus loin encore sa critique. Voici que, dans la Grèce hellénistique, venait d'apparaître une théorie nouvelle, à la fois romanesque et rationaliste, suivant laquelle les dieux ne seraient que d'anciens héros divinisés par l'imagination des hommes. Ennius s'en empare ; il traduit ou imite l'Histoire sacrée d'Evhémère. Depuis longtemps le mystère des dieux l'inquiétait. Voici, semble-t-il, la solution qui l'avait séduit. Dans une île lointaine, narrait Evhémère, s'élevait un temple de Jupiter ; sur l'une des colonnes une longue inscription conservait toute l’histoire primitive du monde. Kronos et Jupiter et tous les autres dieux n'étaient que d'anciens rois... Echo fantaisiste des grandes discussions qui mettaient aux prises à ce moment les Epicuriens, Stoïciens et Sceptiques grecs, b en fait pour séduire l'imagination tumultueuse du poète des Annales. De cette vivante série d'efforts accomplis, dès le début du III ème siècle, par ses premiers poètes résultaient pour Rome plusieurs acquisitions définitives : une langue poétique tout d'abord convenant également à la tragédie et à l'épopée, puis des modèles de ces deux genres, enfin la comédie et la satire, sans parler des commencements d'une réflexion philosophique fondée exclusivement sur la raison. Dans toutes ces directions Ennius apparaît vraiment comme le chef qui conduit les Romains à la conquête des choses de l'esprit avec une ardeur égale à celle qui poussait leurs armées de Sicile à Carthage, en Macédoine, en Asie et en Grèce.
III
plaute.
Des trois premiers poètes ainsi que de leurs successeurs, les poètes tragiques Pacuvius et Accius, nous ne possédons que des fragments. Les soins de Varron nous ont conservé, de Plaute, vingt comédies complètes sur les vingt et une reconnues par lui comme authentiques (1). Elles sont toutes imitées de modèles grecs. Plaute lui-même s'en vante : fabula tota graeca est, annonce-t-il ; c'est là une sorte de recommandation auprès du public. La Grèce apparaît comme un idéal d'intelligence, de beauté et de joie, d'autant plus qu'elle n'est connue encore qu'indirectement et de loin, par ses œuvres littéraires. La première par ordre alphabétique des pièces de Plaute, Amphitryon, porte d'ailleurs nettement la marque sicilienne. C'est une de ces hilarotragédies si populaires à Syracuse et à Tarente.
« Pourquoi froncez-vous le sourcil », demande Mercure dans le prologue ; est-ce parce que je viens de vous annoncer une tragédie? Eh bien, je suis dieu; je m'en vais changer cela. Si tel est voire bon plaisir, d'une tragédie, je vais faire une comédie, sans toucher aux vers. Voulez-vous, ne voulez-vous pas ? »
Rhinton lui-même, le créateur du genre, avait composé un Amphitryon. Pour les autres pièces, on peut indiquer comme modèles, souvent d'après Plaute lui-même, Ménandre, Diphile, Philémon, les auteurs les plus célèbres de la Comédie nouvelle. Dans quelle mesure Plaute suit-il la trace de Naevius, nous ne saurions l'indiquer. En tout cas, c'est bien un genre grec qui, par lui, reçoit droit de cité à Rome.
Mais Plaute n'est ni un savant ni un théoricien ; la protection de quelque puissant patron ne lui permet pas, comme à Ennius, de se faire l'apôtre d'un idéal littéraire.
(1) D'après aulu-gelle, 3, 3, 10, cent trente comédies environ étaient attribuées à Plaute. Aelius Stilon en reconnaissait vingt-cinq comme authentiques, d'autres en comptaient quarante. Le Corpus de Varron en avait reçu vingt et une; nous n'avons plus que des fragments de la vingt et unième, la Vidularia. Les autres sont : Amphitruo, Asinaria, Aulularia, Captivi, Curculio, Casina, Cistellaria, Epidicus, Bacchides, Mostellaria,Menœchmi, Miles gloriosus, Mercator, Pseudolus, Poenulus, Persa, Rudens, Stichus, Trinummus, Truculentus. L'édition la plus commode, en attendant celle que prépare M. L. Havet pour la collection Budé, est celle de lindsay, CI. l'Asinaria n'est qu'un pastiche de Plaute : Havet, Comptes rendus Acad, Inscript., 2 mai 1924, p. 158, 159.
Son patron, c'est la foule ; son seul principe est de plaire, son seul but, le succès. Sans que nous puissions préciser les modifications qu'il fit subir à ses modèles, nous pouvons être convaincus qu'il les transforma au goût du public romain. Son oeuvre constitue vraiment un document historique de l'esprit romain vers la fin du III ème et le début du II ème siècle avant notre ère. C'est à ce titre qu'elle nous intéresse particulièrement ici.
Lui-même, il était un plébéien. Né à Sarsina, en Ombrie, avant 250, il exerça pour vivre, jusqu'après la quarantaine, des métiers divers et également modestes, d'abord entrepreneur de spectacles puis commerçant malheureux, au point qu'ildut s'engager comme manoeuvre chez un boulanger. C'est pour échapper à la meule, dit-on, qu'il devint auteur comique. Il connaissait la vie et ses difficultés ; il avait dû traverser bien des milieux différents, voyager peut-être, lorsqu'il faisait du commerce, côtoyer en tout cas les types les plus divers depuis le temps où il fournissait matériel et personnel au théâtre jusqu'à celui où il fit jouer ses pièces. Fils de famille, entremetteurs, esclaves et marchands d'esclaves, cabaretiers et usuriers représentaient, pour lui, des connaissances personnelles. Le plus étonnant, dans son cas, c'est sa formation littéraire, la souplesse et là pureté de sa langue, reconnues par les anciens (l); c’est l'art, souvent très habile, de sa composition et de sa poésie. Il unissait, dira-t-on, le génie naturel à'expérience du théâtre. Mais pour que le théâtre lui-même pût former un tel auteur, il fallait qu'il fût déjà fort .littéraire ; pour que, de la foule, pût sortir un tel écrivain, il fallait que cette foule elle-même ne fût pas sans culture.
Qu'y a-t-il de vraiment original et de caractéristique dans la comédie de Plante ?
Ce ne sont pas les sujets. Nous pouvons admettre qu'ils sont grecs. On nous excusera de les trouver d'une désolante banalité et complètement dénués d'intérêt. Lisez les comédies de Plante et, le livre fermé, essayez de préciser l'intrigue de l'une d'entre elles. Tout se confond dans la mémoire; telle scène, tel épisode peut trouver sa place dans le Stichus aussi bien que dans le Mercator ou le Truculentus. Vous trouverez à peu près uniformément un amoureux servi par un esclave retors et plaisant ; cet amoureux est aux prises avec son père, avec l'entremetteur, avec un soldat fanfaron ou un fantoche Quelconque; l'esclave leur escroque un argent qui sert à racheter la jeune fille. Celle-ci s'est conservée pure à travers tous les dangers. La pièce finit bien, par un mariage, la plupart du temps accompagné d'une reconnaissance.
(1) quintilien, 10, 1, 99, rapporte le mot d'Aelius Stilon : si les Muses voulaient parler latin, elles parleraient la langue de Plaute.
Histoires de voyages en mer, de naufrages et de pirates, retours inopinés, mystifications, quiproquos, fourberies d'esclaves, 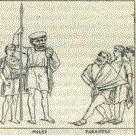 disputes, fournissent les épisodes les plus courants. Le sujet n'est évidemment que l'accessoire. Sauf exception, comme dans l'Aululaire, il compte peu par lui-même ; ce n'est qu'un scénario conventionnel, une trame banale destinée à porter les différentes scènes. Plaute n'y attache, visiblement, aucune importance. Sans se mettre en frais d'invention, il accepte, sans plus, les thèmes et les procédés fournis par la comédie grecque. Il est presque superflu, pour goûter la pièce, de s'astreindre à en suivre le développement, souvent assez confus.
disputes, fournissent les épisodes les plus courants. Le sujet n'est évidemment que l'accessoire. Sauf exception, comme dans l'Aululaire, il compte peu par lui-même ; ce n'est qu'un scénario conventionnel, une trame banale destinée à porter les différentes scènes. Plaute n'y attache, visiblement, aucune importance. Sans se mettre en frais d'invention, il accepte, sans plus, les thèmes et les procédés fournis par la comédie grecque. Il est presque superflu, pour goûter la pièce, de s'astreindre à en suivre le développement, souvent assez confus.
Les personnages eux-mêmes sont conventionnels. Ils ne portaient pas encore le masque, du temps de Plaute, mais rien ne dut être plus facile, lorsqu'on reprit son répertoire, que de le leur appliquer. Ils reproduisent en effet des modèles qui le portaient; ils n'ont rien d'individuel; ce
---à Miles gloriosus.---Peinture de Pompeï.
sont des rôles. Nous trouvons le vieillard, tantôt indulgent et bon, plus souvent sévère et avare. L'un, parfois, s'oppose à l'autre, comme dans l’Aulalaire où l'excellent Mégadore a pour repoussoir l'inquiet et injurieux Euclion. Chaque pièce a son senex. Viennent ensuite le ou les adolescents, tous amoureux, mais les uns vertueux et tendres, les autres, débauchés, violents, jaloux. Ils ont parfois auprès d'eux leur pédagogue ; c'est pour eux qu'intrigue l'esclave, dévoué, goguenard et rusé qui fait rire aux dépens du père avare, du rustaud ou du soldat fanfaron. Ajoutez le parasite et le leno. Dans chaque pièce, ce sont les mêmes personnages que l'on rencontre sous des noms différents. Les rôles de femmes sont moins nombreux mais beaucoup plus insignifiants encore : on sait d'ailleurs qu'ils étaient joués par des hommes ; ils auraient pu l'être par des marionnettes. Hommes et femmes viennent également du théâtre grec. La comédie nouvelle, charmante d'ailleurs par si vivacité, sa bonhomie, l'imprévu des réparties et la sagesse des réflexions, n'est, en aucune façon, une comédie de caractères. On y trouve de la morale, non de la psychologie. N'en cherchons point davantage dans la comédie latine.
Que reste-t-il donc, dans la comédie de Plaute, qui en ait assuré le succès ? Le comique uniquement, comique des situations et surtout des mots.
Le comique des situations n'est pas, la plupart du temps, d'un ordre très relevé; il est produit par des moyens faciles et un peu gros dont les gambades, les coups, l'ivresse, la vantardise, les tromperies de toute sorte, sont les plus courants. Certaines peintures de vases de l'Italie méridionale nous donnent idée de ce théâtre où des personnages grimaçants se livrent à des contorsions excessives mais expressives et drôles. C'est là, plus encore que dans la Comédie nouvelle proprement dite, que Plaute a dû trouver ses jeux de scène. Il en use avec tant de désinvolture et de prodigalité, la surprise se répète et varie si fréquemment, la scène comique se trouve conduite, non sans longueur parfois, mais avec tant d'aisance, de bonne humeur et de fantaisie, que les plus difficiles ne peuvent résister au rire. Il y a, dans ces comédies, une verve un peu enfantine mais simple et saine, qui entraîne. L'auteur s'amuse, on le sent; les acteurs eux-mêmes devaient s'amuser et nous-mêmes aujourd'hui, à la simple lecture, pourvu que nous ne voulions pas nous montrer trop soucieux d'analyse, nous sentons gagnés par toute cette gaîté.
Ce qui appartient en propre à Plaute et reste inimitable, c'est l'emploi qu'il fait de la langue. La phrase est simple, brève, faite pour être immédiatement saisie, calquée sur le type de la conversation courante, mais d'une éblouissante richesse verbale. Le poète fait appel à toutes les ressources d'expression du latin : termes de métier, mots populaires et savants. Avec une parfaite aisance, sa verve emprunte indifféremment au vocabulaire du prêtre, du magistrat, du paysan, du soldat, de l'esclave, des courtisanes et des commères, au parler des carrefours comme à la langue de la haute poésie.
11 ne se contente pas d'user des mots, il en joue; c'est là une de ses ressources préférées. L'abondance des mots et des jeux de mots passait, dès l'antiquité, pour la marque propre de son style.
Jeux sur le son des mots et sur leur sens, calembours, coq-à-l'âne, formations plaisantes font du dialogue un feu ininterrompu d'esprit, non du plus fin sans doute, mais de ce sel un peu gros des salines latines dont Cicéron se plaisait à parsemer ses discours lorsqu'il voulait séduire son public.
Cette richesse verbale ne tient pas seulement à la fantaisie avec laquelle Plaute sait faire usage des ressources du latin, elle procède aussi de son imagination créatrice. Le poète invente non seulement des jeux et des alliances de mots, mais encore, sans aucun doute, bon nombre de termes qu'il dérive de radicaux ou de mots déjà courants, de façon que ces expressions nouvelles puissent être immédiatement comprises et que, cependant, leur nouveauté saisisse et fasse rire. Pour nous, aujourd'hui, il est bien difficile de distinguer ces néologismes lorsqu'il s'agit, au moins, soit de mots simples, soit de dérivés. Les procédés de dérivation, en effet, sont communs à la langue; aucun indice n'y révèle de façon bien nette la personnalité de l'écrivain qui le premier en fît usage pour tel ou tel mot. Les comédies de Plaute sont, en latin, le premier texte littéraire que nous puissions lire de façon suivie ; il nous est impossible d'apprécier l'enrichissement qu'elles ont apporté au parler de Rome.
Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit des mots composés. La haute poésie, celle de Naevius et d'Ennius, tirait des ressources précieuses du procédé de la composition des mots. Les termes de ce genre, les sesquipedalia verba d'Horace, constituent un des éléments caractéristiques du style épique et tragique. Plaute les transpose dans la comédie, il en use pour les effets les plus comiques. On fait accroire au vieillard des Captivi que l'un de ses esclaves a pour père un personnage très riche et très connu du nom de Thensaurochrysonico-chrysides. « C'est sans doute en raison de sa fortune qu'on lui a donné ce beau nom », riposte naïvement le vieillard. Le soldat du Pseudolus s'appelle Polymachaeroplagides, celui du Miles, Pyrgopolinice. Ce n'est là probablement qu'une imitation, sinon des comiques grecs, du moins de ceux de Sicile. Mais Plaute transpose aussi le procédé en latin. Voici tout un couplet injurieux ainsi formé d'un mélange de grec et de latin — il s'adresse à un leno :
Vaniloquidorus, virginesvendonides Nugiepiloquides, argentumextenebronides Tedigniloquides, nugides, palponides, Quodsemelarripides nunquameripides. Em tibi.
Plaute joue sur les noms propres : Credo hercle nomen mutabit mihi
Facietque extemplo Crucisalum ex Chrysalo.
II joue sur les noms communs ; les poings, chez lui, deviennent des casse-dents et les dents des casse-noix :
Ne tibi, hercle, hau longe est os ab inforlunio ita dentifrangibula haec meis manibus gestiunt.
Le parasite :
Quom ejus verba interpretor, mihi cautio est
Ne nucifrangibula excussit ex malis meis.
Toute sorte d'injures comiques sont ainsi formées par composition. Parfois aussi, ce sont les expressions de l'épopée et de la tragédie qui se trouvent parodiées par ce moyen.
Salsipotenti et Multipotenti Jovi' fratri et Nerei, Neptuno.
Ces formations plaisantes par composition portent nettement la marque de Plaute. Associer deux termes précédemment indépendants pour en créer un mot nouveau, c'est en effet faire œuvre personnelle. L'imagination et la volonté de l'écrivain ont part à cette création. L'intimité d'une alliance imprévue entre deux mots provoque la surprise ; l'image plaisante se trouve ramassée et comme resserrée dans l'unité du composé. De telles formations sont une part intégrante de l'œuvre littéraire.
Le propre d'un grand poète est de créer sa langue. Naevius et Ennius ont créé la langue de la haute poésie ; Plaute, celle de la comédie. Là est sa véritable originalité, son titre principal à la place importante qu'il a toujours occupée dans les lettres latines.
La forme même de la comédie est grecque; l'intrigue, les personnages, les idées morales, les sentiments sont grecs. Il ne convient pas d'attacher grande importance aux allusions qui peuvent être faites çà et là à des institutions ou à des coutumes romaines; la désinvolture du poète mêle aisément dans le monde de féerie qu'est le théâtre, ce qui est grec et ce qui est romain. Tous ces éléments, chez Plaute, ne sont que l'accessoire. L'essentiel pour lui est de faire rire. Lui-même et son public sont indifférents à la logique de l'action ; pourvu que les incidents divertissent, peu importe comment ils sont amenés. L'analyse psychologique, les subtilités sentimentales n'intéressent pas le public romain; ce n'est pas lui-même, encore moins l'homme en général que ce public va chercher au théâtre. Plaute simplifie donc, il supprime ou il exagère jusqu'à la caricature les indications de cet ordre qu'il rencontre dans ses modèles grecs. Par contre, il accumule avec une abondance que n'a jamais connue la comédie nouvelle tous les moyens comiques et, en particulier, la facétie verbale qu'il porte à sa suprême perfection. Telle est sa maîtrise en la matière qu'elle lui permet de traiter n'importe quel sujet, tragi-comédie, comme Amphitryon, comédie très libre et licencieuse comme la Casina, ou sérieuse et attendrissante comme les Captifs. Peu importe le sujet, la forme dont il le revêt est l'essentiel ; c'est par elle que Plaute est assuré de plaire.
Il se vante de donner des pièces entièrement grecques parce que la Grèce est à la mode ; Rome vient de lui rendre la liberté; on se sait gré de la connaître, on fait à l'occasion semblant de la comprendre. Mais ne croyons Plaute qu'à demi. Sa comédie est certainement plus sicilienne que grecque, ou plutôt elle est italienne, car depuis longtemps l'influence de la Sicile avait dû, par l'Italie méridionale, se répandre dans l'ensemble de la péninsule et pénétrer à Rome. La fantaisie de Plaute nous conserve certainement beaucoup du laisser-aller des vieilles farces nationales, chants fescennins, atellanes ou satires. Comme dans l'atellane, les personnages ne représentent que des silhouettes conventionnelles. Comme dans les chants fescennins, le jeu de mot et la plaisanterie l'emportent sur la logique de l'action. Si nous connaissions les Atellanes de l'époque impériale, nous y retrouverions sans doute les traits caractéristiques de la comédie de Plaute. Mais ce que probablement nous n'y retrouverions plus, c'est la langue si savoureuse et si pleine du vieux poète et cette truculence qui, dans son archaïsme, évoque invinciblement, chez nous, le souvenir de notre Rabelais.
Le comique latin ne possède pas la profondeur de pensée, ni l'audace satirique, ni le sens d'observation de Rabelais. La substantifique moelle fait défaut chez lui. Mais l'aspect extérieur se ressemble. L'un et l'autre écrivain sont de grands artistes du verbe. Ils excellent à transformer en matière littéraire la langue populaire, brassant les mots de façon à. en exprimer tout le sens et, de leur choc, faisant jaillir l'étincelle du rire. Malgré l'influence grecque, Plaute procède du vieux génie comique italien, comme, malgré la Renaissance, Rabelais personnifie la verve populaire gauloise. Ils sont nourris tous deux des sucs du terroir.
La comédie de Plaute apparaît vraiment comme un spectacle de jour de fête pour un peuple naturellement gai, dont l'exubérance encore jeune est étrangère aux raffinements de l'analyse psychologique, qui aime les gambades et la scurrilité. Gardons-nous cependant d'exagérer en ce sens. Le public de Plaute paraît aussi capable d'entendre quelques idées simples de morale pratique et même certains sentiments délicats, exposés sous une forme humoristique. La comédie des Captifs nous en apporte la preuve.
Cette pièce, prévient Plaute, n'est pas laite comme les autres; vous n'y trouverez aucun de ces vers grossiers dont on n'ose se souvenir ; vous n'y rencontrerez même pas de leno, ni de méchante courtisane, ni de soldat fanfaron.
Le sujet, en effet, est l'amitié délicate et le dévouement mutuel de deux jeunes gens pleins des meilleurs sentiments. Le mouvement et le rire bruyant que déchaînent les esclaves y voisinent avec des tirades empreintes de sensibilité et des sentences morales. Nous nous trouvons ici beaucoup plus près de la nouvelle comédie grecque que de l'atellane. N'oublions pas que la représentation d'une comédie comporte une part développée de musique ; encadrés dans le dialogue, les cantica, morceaux lyriques ou plus particulièrement pathétiques, sont accompagnés de flûte ; ils représentent de véritables envolées de poésie ; ils sont, dans la comédie, l'élément vraiment littéraire qui s'adresse à l'intelligence et au sens esthétique. Le développement de la farce chez Plante n'exclut pas l'art; l'abondance truculente de la parole s'allie souvent, chez lui, à l'expression claire et élégante des idées, à la finesse d'un dialogue spirituel adroitement conduit ; les jeux du corps et du verbe alternent avec ceux de la pensée.
Il convient de laisser de côté, lorsque nous essayons de nous représenter la foule qui, après une tragédie d'Ennius, applaudissait aux comédies de Plaute, les images consacrées par la tradition. Le peuple romain de la fin du III ème et du début du II ème siècle n'est ni le peuple-roi, lourdement conscient de sa majesté et pénétré d'une gravité quelque peu stupide, ni une plèbe démoralisée et vile ne se plaisant qu'aux jeux violents et sanglants de l'amphithéâtre. Il est le peuple italien; le paysan latin et sabin s'y mêle à l'Ombrien, à l'Etrusque, au Campanien, à l'Apulien et au Messapien, voire au Grec de Sicile. Les esclaves de toutes les parties du monde méditerranéen n'ont pas encore afflué dans la ville pour y être affranchis et y faire souche. La foule se compose de petits artisans libres dont beaucoup peuvent être des ouvriers d'art, de commerçants de fortune trop modeste pour être classés parmi les chevaliers mais dont l'horizon intellectuel dépasse de beaucoup la ville et les campagnes latines, de petits propriétaires campagnards qui ont combattu dans toute l'Italie, en Sicile, en Espagne et même en Afrique. C'est une population d'origine libre, de provenance italienne et vivant de son travail qui peuple la ville. Plaute sort de ses rangs et a vécu toute sa vie parmi elle ; il écrit pour elle ; pour elle il unit les traditions du spectacle comique italien aux leçons littéraires de la comédie grecque.
Comme la comédie, l'épopée et la tragédie sont faites pour ce peuple. Leur forme est grecque ; les fables des Grecs de l'ancien temps et celles qu'ont inventées les Siciliens s'y mêlent aux légendes locales et au récit des exploits contemporains des armées et des chefs romains. Un patriotisme ardemment romain inspire chaque effort de Naevius et d'Ennius. L'âme italienne vit dans leurs œuvres non moins que dans celle de Plaute. C'est sur le tronc indigène qu'a été greffé le rameau grec cueilli en Sicile. Les fruits en ont conservé la saveur un peu âpre peut-être, mais originale de la terre italienne.
CHAPITRE II
L'ESPRIT NOUVEAU ET L'IDÉAL ANCIEN. SCIPION L'AFRICAIN ET CATON LE CENSEUR
L'importance des premiers essais littéraires romains tient à ce qu'ils ne sont pas seulement un jeu de l'esprit, mais expriment vraiment une conception nouvelle du monde et de la vie sociale. Telle fut la raison du succès qu'ils rencontrèrent. Les poètes ne faisaient qu'exprimer en latin et répandre dans la foule les idées dont les plus intelligents et les plus hardis parmi les générations nouvelles se trouvaient complètement imbus. Ils en multipliaient et en prolongeaient l'effet. La littérature apparaît à la fois comme l'expression et l'une des causes principales de la transformation des idées.
L'épopée et la tragédie grecques et, d'après elles, la première poésie romaine, sont la glorification du héros. Aimé des dieux ou persécuté par eux, le héros tient le milieu entre les hommes et eux. Prométhée défie Jupiter ; l'ingéniosité d'Ulysse finit par l'emporter sur la rancune de Héra. Au-dessus de la foule, dans un monde de féerie, libéré des règles étroites de la réalité, le héros donne libre cours à toutes les facultés humaines, intelligence, activité, passion. La poésie héroïque est l'exaltation de la personnalité humaine, elle ouvre à l'imagination la rayonnante carrière de la gloire.
L'exemple des héros inspire aux âmes bien nées une noble émulation. Par lui, l'homme conçoit le sentiment de sa propre importance et de son pouvoir. Il prend confiance en lui-même. La vie lui apparaîtra désormais comme une sorte de théâtre, où l'homme supérieur doit s'imposer à la foule, par son audace, par l'ampleur de son geste, par l'imprévu ou la majesté de son attitude. L'ampleur des intérêts ne fera qu'exciter sa hardiesse. Il rêve d'exploits inouïs; qu'il réussisse ou qu'il succombe, une renommée héroïque sera son partage. L'ambition devient vertu. L'individu s'élève au-dessus des intérêts collectifs ; il n'agit plus seulement pour la patrie, mais aussi pour lui-même.
Combien une telle conception ne s'écarte-t-elle pas de la vieille tradition romaine? L'idéal ancien ne fait nul cas de la personnalité. Placé dans l'étroite dépendance de la famille et de la gens, l'individu ne compte que dans le groupe dont il fait partie, il n'agit ni ne pense par lui-même mais seulement en fonction des principes ou des intérêts de son groupe. La vertu suprême est le sacrifice anonyme aux lois de la cité. La littérature arrache le Romain à la foule. En éveillant la pensée personnelle, elle lui apprend à reconnaître, en lui-même, l'homme dans le citoyen. Elle oppose l'imagination aux intérêts matériels, le jeu au strict devoir, le héros au pater-familias. C'est elle qui crée et développe la personnalité. Les Romains ne s'y sont pas trompés; à juste titre, ils ont donné à la culture intellectuelle le nom d'humanités.
I
scipion l'africain.
Le type accompli du Romain des temps nouveaux nous apparaît réalisé dans le personnage de Scipion l'Africain. L'art de Tite-Live a contribué, peut-être, à accentuer chez lui les traits héroïques. Les faits néanmoins reposent pour cette époque sur des témoignages suffisamment certains pour que nous puissions les admettre, dans l'ensemble, comme authentiques.
On connaît la scène qui marque le début de sa carrière. Scipion surgit, pour ainsi dire, du peuple assemblé, rayonnant de confiance en lui-même et paré de tous les dons qu'attribuent les dieux aux mortels qu'ils chérissent (1). C'est aux jours les plus sombres de l'année 212, quatre ans après Cannes. Les messagers de malheur se succèdent au Sénat : Syracuse vient de passer à Hannibal ; Tarente était prise, l'Italie jusque-là fidèle faisait défection, Capoue avait ouvert ses portes à l'ennemi. Le père et l'oncle de Scipion qui avaient réussi en Espagne, pendant des années, à fermer la route aux renforts que Carthage tentait d'acheminer vers l'Italie, venaient d'être tous deux battus et tués. Personne n'osait briguer le lourd honneur de les remplacer. Les comices ont été convoqués, le peuple attend que les candidats se fassent connaître, tous les yeux sont tournés vers les magistrats, ceux-ci se regardent les uns les autres. Tout à coup, P. Cornélius, jeune homme d'environ vingt-quatre ans, se dresse et déclare qu'il demande à remplacer son père et son oncle. Un seul cri, la faveur générale, lui augurent immédiatement un heureux commandement ; l'unanimité des citoyens le charge d'aller en Espagne. Son éloquence et sa sagesse ont beau jeu des hésitations des prudents et des revirements inquiets de la foule.
Tous les actes de sa vie apparaissent ainsi comme des coups de théâtre. Scipion trouve, à l'instant voulu, le geste qui rassure, le mot qui entraîne. Il ne connaît pas d'obstacle. Les lois fixant l'âge des candidatures, les craintes superstitieuses, les traditions strictes de l'administration ne l'embarrassent pas plus que les circonstances hostiles. Il est le héros dont la personnalité domine les choses aussi bien que les hommes.
Le caractère merveilleux de chacun des actes de Scipion n'en impose pas moins à l'ennemi qu'à ses concitoyens. En Espagne, son premier acte est d'enlever par surprise, « grâce à l'aide de Neptune »,
(1)T. Liv , 26, 18.
la citadelle de Carthagène, le trésor et l'arsenal d'Hasdrubal (1). La générosité dont il use après sa victoire le rend aussitôt populaire parmi les chefs indigènes. Le bruit se répand qu'il est arrivé aux Romains un jeune chef semblable à un dieu (2). Il ressemble en effet à quelque Dioscure guidant les marins à travers les dangers de la mer et dont l'éclatante apparition sur le champ de bataille décide de la victoire. Lui-même, d'ailleurs, n'ignorait pas cette réputation et se complaisait à laisser les imaginations tracer autour de lui une auréole de divinité. Tite-Live note en lui non moins de talents véritables qu'un grand art de les faire valoir qu'il cultiva dès sa jeunesse (3).
Ce qu'il proposait à la multitude, ou bien lui était apparu en songe ou bien lui était suggéré par une inspiration d'en haut... Du jour où il prit la toge virile, il ne fit aucune action publique ou privée sans aller au Capitole, sans pénétrer dans le sanctuaire et y rester quelque temps seul, caché à tous les regards. Cette règle, qu'il observa durant toute sa vie, fit croire à quelques-uns qu'il était issu du sang des dieux et remit en crédit avec des circonstances non moins ridicules la fable autrefois répandue au sujet d'Alexandre le Grand ; on attribuait sa naissance à un serpent monstrueux qu'on voyait souvent, disait-on, dans la chambre de sa mère mais qui disparaissait dès que quelqu'un y pénétrait. Scipion lui-même ne porta jamais atteinte à l'autorité de ce prodige, il avait l'habileté de l'augmenter encore en ne le niant comme en ne l'affirmant jamais.
Cette recherche des attitudes, ces tête-à-tête avec Jupiter Capitolin, ces légendes surtout qui indiquent l'imitation d'Alexandre, le héros par excellence, le modèle qui hanta les imaginations de tous les ambitieux depuis les princes de Macédoine, de Syrie et d'Egypte jusqu'à César, voilà qui nous éloigne singulièrement de la simplicité des chefs romains d'antan.
Pour Scipion comme plus tard pour César, ses admirateurs, au moins en pays non romain, songent au titre de roi.
(1) T. Liv., 26, 45. C'est l'utilisation du phénomène de la marée, un prodige pour les Romains, qui livre Carthagène : Neptunum, jubebat ducem itineris sequi, dit Tite-Live.
(2) Ibid., 26, 50.
(3) 26, 10
Il était encore trop romain pour ne pas repousser le mot, mais l'idée correspond trop bien à l'image qu'il conçoit de lui-même et de son rôle dans la cité pour qu'il en décline entièrement l'hommage (1). « Le titre d’imperator queme donnent mes soldats, répond-il aux Espagnols, est pour moi plus honorable, mais si celui de roi vous semble plus haut, contentez-vous de m'attribuer une âme royale. » Une âme royale, c'est évidemment, pour Scipion, celle d'un Alexandre ou d'un Achille. Son idéal n'est plus dans l'ancienne Rome, mais dans cette humanité transfigurée qu'a créée la Grèce.
Son attitude d'ailleurs déplaisait aux vieux Romains et les inquiétait. Par la noblesse de son aspect non moins que par sa bonne grâce et la vivacité de son esprit, il avait pu séduire les chefs numides Syphax et Massinissa, et même son ennemi Hasdrubal (2). Mais Caton, son questeur, lui reproche âprement son faste et son arrogance, il l'accuse de corrompre l'ancienne discipline. Au Sénat, le vieux Fabius Cunctator s'oppose de toutes ses forces au projet que forme le jeune général de passer en Afrique et de terminer cette longue guerre d'usure par un coup d'audace qui peut aboutir au même désastre que l'expédition de Regulus (3). Au lieu de l'Afrique, on lui assigne comme province la Sicile. Peu lui importe. En Sicile, il prépare son expédition d'Afrique, il débarque devant Carthage et oblige ainsi Hannibal à quitter l'Italie. Entre les deux héros, la victoire décide en faveur du Romain.
On raconte que, plus tard, à la cour d'Antiochus, Scipion aurait retrouvé son ancien adversaire et se serait entretenu familièrement avec lui du mérite et du rang des grands capitaines (4). Le premier de tous, de l'avis d'Hannibal, était Alexandre dont la phalange avait dispersé des armées innombrables. Après lui, venait Pyrrhus, maître dans l'art de choisir et de fortifier une position. — Et au troisième rang? Interroge
(1) T. Liv., 27, 19.
(2) T. Liv., 28, 18; 28, 35.
(3) Ibid., 28, 40 sq.
(4) Ibid., 35, Sommaire,
Scipion. — Moi-même, répond Hannibal. — Quel rang te serais-tu donc donné si tu avais été vainqueur à Zama? — Je me serais placé avant Alexandre, avant Pyrrhus, avant tous les autres. — L'anecdote est bien évidemment apocryphe. L'intérêt en est de nous montrer l'obstination des faiseurs de nouvelles à présenter Scipion comme se mettant lui-même en parallèle avec les héros grecs. Les autres tableaux de la vie de Scipion, tels que nous les présente Tite-Live, doivent peut-être également beaucoup plus aux Annales d'Ennius qu'à la vérité historique. Ils sont, en ce cas, une œuvre littéraire nous permettant de juger du tour des imaginations de ce temps. Rien ne prouve d'ailleurs qu'une imagination éprise de romanesque et de littérature n'ait pas inspiré bien souvent la conduite de Scipion. Ne diminuons pas, même pour ces temps anciens, la part des influences littéraires sur la vie et les actions des hommes. N'est-ce pas, en dernière analyse, l'imagination qui détermine leur carrière et, la plupart du temps, anime leurs exploits et leurs forfaits?
C'est par la faute des lettres grecques trop ardemment adoptées comme règle de vie que Scipion se trouva finalement en opposition avec la majorité de ses concitoyens. L'accusation de concussion qui les frappa, son frère et lui, au retour de l'expédition d'Asie, en 190, n'était bien évidemment qu'un prétexte (1). Scipion dédaigna de se justifier et par une dernière bravade entraîna à sa suite le peuple entier au Capitole pour remercier Jupiter de la victoire sur Carthage dont ce jour ramenait l'anniversaire. Il n'en fut pas moins condamné ; on n'osa l'arrêter, mais il termina sa vie dans le demi-exil de Literne, refusant ses cendres à son « ingrate patrie ».
Cent ans plus tôt, avant Livius, Naevius et Ennius, Scipion n'aurait été qu'un Romain comme les autres, soldat courageux magistrat énergique, soucieux uniquement d'exécuter les décisions du Sénat et du peuple pour le plus grand bien de la république.
(1) T, Liv., 38, 50 sq.; partic.. 55, 56.
La poésie n'aurait pas exalté sa personnalité au-dessus du peuple et des lois. Il aurait également battu Hannibal, mais sans cette allure d'épopée que son imagination imprima aux dernières années de la guerre, en Espagne et en Afrique. Il aurait fini écouté au Sénat, respecté par le peuple et, sur son sarcophage, rangé à côté de celui de ses ancêtres dans le tombeau familial, on aurait pu graver la formule traditionnelle : Edile, censeur, consul, il fut parmi vous.
Reconnaissons-le avec les Romains de la stricte observance, l'esprit nouveau qui s'incarne dans Scipion bouleversait les traditions morales et sociales de la république. C'est bien celui qui donna naissance, plus tard, aux Sylla et aux César. Mais d'autre part la tradition patriarcale de la petite cité romaine n'était plus viable dans un grand État. Les victoires même de Rome condamnaient le mos majorum. Les chemins de toute l'Italie, ceux même de la mer, s'ouvraient devant les Romains. Comment maintenir la famille groupée dans son domaine sous l'autorité du père? La subordination à une règle austère de travail et d'économie, l'abnégation de chacun aux intérêts du groupe, tels étaient les fondements de l'ancienne morale. Les qualités qu'exigeait du citoyen la situation nouvelle de Rome étaient à l'opposé. Il fallait au chef l'initiative et la hardiesse que donnent la confiance en soi et l'habitude de l'indépendance. L'ampleur de la tâche à accomplir exigeait une vue plus large des choses et des hommes. La réponse de Scipion aux accusations de Caton était juste : « Je ne dois compte au Sénat que des résultats; je n'ai pas besoin d'un questeur si exact. » Le sentiment de l'honneur, même, était appelé à se transformer ; il ne devait plus consister uniquement à se sacrifier et à obéir, mais surtout à agir et à créer. La cité, en s'agrandissant, rendait la liberté aux individus; ceux-ci devaient trouver en eux-mêmes leur règle. Les vieilles traditions ne la leur donnaient plus. La pensée grecque pouvait la leur fournir ; elle la fournit, en effet, à ceux qui étaient capables de la comprendre. Son seul défaut était d'être trop élevée pour beaucoup. Ce n'est pas d'excès, c'est plutôt du défaut de littérature, que le peuple romain allait souffrir. Plus de sagesse philosophique et moins de convoitises matérielles lui aurait épargné les guerres civiles.
II
caton le censeur.
L'engouement d'une partie de l'aristocratie et de la foule urbaine pour la Grèce et sa littérature n'allait pas sans rencontrer une forte opposition. L'attachement aux habitudes d'autrefois était l'une des formes de l'orgueil romain; le culte excessif de la tradition ou plutôt d'une partie de là tradition ne représente-t-il pas l'une des doctrines de tout nationalisme ? La résistance à l'esprit nouveau s'incarna dans un homme, un homme qui d'ailleurs représentait toute une classe de la population latine dont il possédait, à un degré éminent, aussi bien les vertus que les défauts. Cet homme fut Caton. La classe qu'il représente est celle des petits propriétaires ruraux, durs au travail et âpres au gain, soldats admirables de résistance, de sang-froid et d'énergie, toujours combatifs, sur la place publique aussi bien que sur le champ de bataille, d'un esprit mordant et incisif, sérieux du reste et adroits, passionnément attachés à leur terre, à leur foyer et à tous les souvenirs que représentait pour eux le foyer.
Plus que tous les autres, ces paysans avaient contribué au triomphe de Rome, triomphe dont ils devenaient les victimes. Les récoltes de leurs domaines avaient toujours tenu jusque-là une place prépondérante dans la vie économique de la république. La fécondité de l'Italie méridionale et surtout le commerce maritime menaçaient désormais leurs intérêts. Leur grand ennemi, c'est la Sicile qui, déjà, fournit Rome de blé et les oblige à serejeter sur la culture de l'olivier et de la vigne, c'est l'Afrique qui peut fournir l'huile, la Grèce qui fournira le vin, c'est surtout l'esprit d'aventure et de nouveauté qui développe la fortune immobilière, diminue la valeur de leur patrimoine et en prépare l'absorption par la grande propriété. Ils sont les sacrifiés et les mécontents. C'est en leur nom, animé de leur esprit et de toutes leurs rancunes, que Caton va entreprendre la lutte contre l'esprit nouveau.
La personne même de Caton et son caractère ont vivement frappé l'antiquité ; le portrait que nous en a conservé Plutarque est légendaire, mais les grandes lignes en présentent cependant toute chance d'exactitude. Caton était à la fois Latin et Sabin, né à Tusculum, en 234, et élevé dans le petit domaine de la Sabine que cultivait son père. Un travail assidu, dit Plutarque, une vie frugale et le service militaire dans lequel il était entré de bonne heure, lui avaient donné une complexion aussi saine que robuste. Une épigramme antique évoque ainsi son portrait : « roux, tout en dents, aux yeux glauques : même après sa mort, Perséphone a peur de le recevoir dans l'Adès ». (1).
Il était et affecta toujours de demeurer un simple et un brutal.
Il eut, dès sa jeunesse, le corps tout cicatrisé de blessures honorables reçues dans la guerre contre Hannibal... Dans les combats, il demeurait inébranlable à son poste, portait des coups terribles, montrait à l'ennemi un visage redoutable, le menaçant d'un ton de voix effrayant, persuadé et enseignant aux autres que cette mimique fait souvent plus d'effet sur l'ennemi que l'épée qu'on lui présente... Plus tard, devenu chef, il demeurait soldat. Dans les marches, il allait toujours à pied, portant lui-même ses armes, suivi d'un seul esclave changé des vivres. Simple et facile en tout ce qui concernait son service personnel, il se montrait dans tout le reste sévère et inexorable. Il était, conclut Plutarque, comme Socrate, dont Platon disait qu'il paraissait en son extérieur, grossier, satirique outrageux, mais qu'au dedans, il était rempli de raison et de gravité (2).
(1) plut., Cat., 1.
(2) Ibid., 10.
D'autres mérites, cependant, que son courage et son intégrité lui ouvrirent l'accès aux honneurs. Ce qui le fit remarquer, ce fut son ardeur à plaider et son talent de parole. De sa terre, il se rendait dès le matin aux villes voisines et défendait les clients qui l'en priaient ; puis, revenant à son champ, achevait la journée à labourer avec ses esclaves. C'était là une activité entièrement conforme à la vieille tradition latine. Un patricien romain, son voisin de campagne, Valerius Flaccus, lui aurait conseillé d'aller s'établir à Rome et de s'y occuper des affaires publiques. Ses plaidoyers lui firent bientôt des admirateurs et des amis et, le crédit de Valerius aidant, il put aborder la carrière des honneurs (1).
Que Caton ait été un orateur remarquable, on ne saurait en douter. Les fragments qui nous restent de ses discours ne permettent sans doute guère de juger de son éloquence, mais l'éloge qu'en fait Cicéron mérite d'être cru (2). « Qui jamais sut louer avec plus de noblesse, blâmer avec une plus mordante énergie ? Quelle finesse dans les pensées, quelle ingénieuse simplicité dans l'exposition des faits et des arguments! » Le trait particulier de son esprit semble avoir été une sorte d'humour satirique s'exprimant en mots plaisants frappés comme des proverbes, Plutarque en cite plusieurs exemples, vraisemblablement authentiques, qui sont bien les mots d'un paysan railleur, prompt à noter le ridicule (3). Plusieurs ne semblent autre chose que des proverbes rustiques adaptés avec à-propos à la circonstance. Un jour, le peuple romain demandait avec insistance et hors de propos une distribution de blé. Caton, qui voulait l'en détourner, commença ainsi son discours : Citoyens, il est difficile de parler à un ventre qui n'a pas d'oreilles. Une autre fois, blâmant la dépense excessive des Romains pour la table, il n'est pas facile, disait-il, de sauver une ville où un poisson vaut plus cher qu'un bœuf.
(1) Ibid., 4.
(2) Brutus, 17, 65.
(3) plut., Cat., 11 sq.
Injurié par un sot, il lui riposte : le combat est inégal entre nous; tu écoutes volontiers les sottises et tu en dis avec plaisir : moi, je les entends avec peine et n'ai pas l'habitude d'en dire.
Cet esprit n'est pas, sans doute, extrêmement fin. Bien des traits s'en rapprochent de ce que nous trouvons chez Plaute (1). Ces discours, en effet, sont animés de la même verve caustique indigène et, de plus, ils s'adressent au même public que la comédie. Il s'agit de provoquer non le sourire, mais le rire bruyant qui réjouit un auditoire ou confond l'adversaire. Savoir faire rire, disait Caton, c'est le fait du bon orateur (2).
Dès sa jeunesse, Caton avait fait choix de son idéal moral et politique. Il l'avait trouvé dans le souvenir de son voisin de campagne Manius Curius, trois fois triomphateur et demeuré célèbre pour sa simplicité rustique. Un peu plus tard, à l'armée ou à Rome, il avait pu se proposer comme modèle Fabius Maximus Cunctator. C'est non seulement en raison de son tempérament propre mais aussi au nom de la tradition représentée par ces grands Romains qu'il déclara la guerre aux fauteurs de toute nouveauté.
Nous avons déjà mentionné son hostilité et ses attaques contre Scipion l'Africain (3). Rien ne désarma la ténacité de sa haine. Vingt ans après ses premières accusations, c'est encore lui que nous retrouvons comme l'instigateur de la campagne qui condamna le vainqueur de Carthage à l'exil. Plutarque cite de lui à cette occasion un mot féroce qui montre bien l'âpreté de cette nature froidement violente (4).
Un jeune homme qui avait réussi à faire condamner un ennemi de son père mort depuis peu, traversait le Forum quelques jours après le jugement de Scipion. « Voilà les sacrifices funéraires qu'il convient d'offrir aux mânes d'un père, lui dit Caton, en l'embrassant ; ce n'est pas le sang des agneaux et des chevreaux qu'il faut faire couler pour eux, ce sont les larmes de leurs ennemis condamnés- »
(1) Les procédés, allitérations, oppositions de sons, de mots et d'images, vivacité de repartie, sont souvent les mêmes. Comparer les invectives de Caton contre les femmes, dans le discours très estonien que lui prête Tite-Live (32,2), et celles de Plaute dans les Menœchmes, v. 110-117.
(2) quint., Inst. Or., 6, 3, 103 ; jordan, LXXXVIII, p. 83.
(3) Cf. plut., Cat., 5.
(4) Ibid., 22.
De propos délibéré, Caton ne voulait pas comprendre les modifications qu'imposait à la civilisation romaine la nouvelle situation politique de Rome. De là ses efforts, voués à un échec certain, contre le luxe et la culture grecque. Il s'était composé à lui-même son personnage, tout comme l'avait fait Scipion, et il lui fallait en soutenir l'austère réputation. C'est ainsi qu’il fut amené en mainte circonstance à forcer la note et à céder lui-même à cette vanité qui l'exaspérait chez les autres. Plutarque discute gravement ces exagérations (1) :
Ayant trouvé une tapisserie de Babylone dans la succession d'un de ses amis, il la fît vendre sur-le-champ. De plusieurs maisons de campagne qu'il possédait, aucune n'était blanchie. Le cheval et l'esclave devenus vieux, il fallait les vendre... Caton semblait se faire gloire de son insensibilité ; il se vantait d'avoir laissé en Espagne le cheval qu'il montait à la guerre pendant son consulat afin de n'avoir pas à porter en compte à la république ce que le transport du cheval par mer aurait coûté.
Magnanimité ou mesquinerie ? se demande Plutarque. Vanité, répondra-t-on.
Cette vanité du censeur qui, seul, se croit impeccable, n'a pas échappé d'ailleurs à son biographe (2) :
II ne voulait pas qu'un bon citoyen souffrît une louange qui ne tournât pas à l'utilité publique. C'était cependant l'homme qui se louait le plus lui-même, au point que, lorsque des citoyens avaient fait des fautes dans leur conduite, il faut les excuser, disait-il, ce ne sont pas des Caton... Sur la base de la statue qui lui fut élevée dans le temple de Satus il ne fit graver ni ses exploits militaires, ni son triomphe, mais l'inscription suivante : A l'honneur de Caton pour avoir, par de salutaires ordonnances et des institutions sages, relevé, dans sa censure, la république romaine que l'altération des mœurs avait mise sur le penchant de la ruine.
Quelle que fût d'ailleurs l'obstination de Caton dans sa fidélité au passé et son aversion pour toute nouveauté, il n'ignorait
(1) Ibid.. 6. — (2) Ibid., 28
pas lui-même ces lettres grecques auxquelles il voulait interdire l'entrée de la république. Il était d'esprit trop curieux et trop avide, du reste, de toutes les utilités, pour ne s'y être pas initié dès sa jeunesse. Tout en le montrant, suivant la tradition, occupé à apprendre le grec dans sa vieillesse, Plutarque ne se fait pas faute de mentionner plusieurs épisodes qui contredisent nettement cette légende.
Lorsque Fabius Maximus reprit Tarente (en 209 avant notre ère), Caton, fort jeune, servait alors sous lui. Il était logé chez Néarque, philosophe pythagoricien qu'il désira entendre discourir sur la philosophie. Néarque professait les mêmes doctrines que Platon ; il enseignait que la volupté était la plus grande amorce pour le mal, que le corps est le premier fléau de l'âme... Ces discours firent aimer encore davantage à Caton la tempérance et la frugalité...
Il y aurait donc une part d'influence grecque, même à l'origine de l'ascétisme catonien.
Les leçons de la rhétorique grecque n'auraient pas non plus été étrangères à l'adresse de son éloquence.
Il profita un peu, dit Plutarque, de la lecture de Thucydide, mais beaucoup plus de celle de Démosthène... ; du moins ses écrits sont enrichis de nombreuses maximes et de traits d'histoire lires des ouvrages des Grecs et plusieurs de ses sentences morales en sont traduites mot à mot.
En 191, Caton prit part à l'expédition de Grèce et d'Asie contre Antiochus et fit un assez long séjour à Athènes.
On prétend, raconte Plutarque, que le discours qu'il fil en grec au peuple athénien a été conservé... il n'en est rien, car il parla aux Athéniens par interprète, non qu'il ne sût très bien le grec, mais il était attaché aux coutumes de ses pères et se moquait de ceux qui n'avaient d'admiration que pour les Grecs.
Lorsque, d'ailleurs, on étudie la langue du seul des ouvrages qui nous reste de Caton, le De Agricultura, on est frappé du nombre des mots grecs qui ont pénétré dans ce traité. En champion de la vieille tradition latine, Caton prétendait résumer sa propre expérience de bonus agricola bonusque colonus. En réalité, l'idée même de rédiger la téyvyj de l'agriculture lui a été suggérée par un modèle grec, la traduction en grec d'un traité d'agriculture dû au Carthaginois Hannon. La note vraie nous est donnée par Caton lui-même (1). Il connaît les Grecs et leur littérature, mais il fait profession de les mépriser. Il n'ose proscrire absolument la lecture de leurs œuvres, mais il n'en autorise qu'une notion superficielle; après avoir, à son corps défendant, entr'ouvert la porte, il croit la fermer en maudissant solennellement toute cette culture.
Je parlerai, en son temps, de ces maudits Grecs, je dirai ce que j'ai trouvé à Athènes et comme quoi il peut être bon de jeter un coup d'oeil sur leur littérature, non de s'y plonger. Je démontrerai combien détestable et bonne à rien est leur race. Croîs-le bien, Marcus, mon fils, ceci est parole d'oracle : si quelque jour cette race arrive à nous passer sa littérature, tout est perdu.
Ce n'est pas la culture de l'intelligence que proscrit Caton, mais seulement ce qu'en ont fait les Grecs de son temps. Son attitude lors de l'ambassade de Carnéade à Rome permet de saisir cette nuance. Voici le récit de Plutarque (2) :
Les deux philosophes Carnéade, académicien, et Diogène, de lasecte stoïque, furent à peine arrivés que tous les jeunes Romains qui avaient du goût pour les lettres, étant allés les voir, en furent ravis d'admiration et ne pouvaient se lasser de les entendre. La grâce de Carnéade, la force de son éloquence, sa réputation qui n'était pas au-dessus de son talent, l'avantage qu'il eut d'avoir pour auditeurs les plus distingués et les plus polis des Romains firent le plus grand bruit dans Rome: c'était comme un souffle impétueux qui retentit dans toute la ville; on disait partout qu'il était venu un Grec d'un savoir merveilleux, qui charmait et attirait tous les esprits, qui inspirait aux jeunes gens un tel amour de la science que, renonçant au plaisir et à toute autre occupation, ils étaient saisis d'enthousiasme pour la philosophie. Tous les Romains en étaient dans l'enchantement et voyaient avec plaisir leurs enfants s'appliquer à l'étude des lettres grecques et rechercher avec avidité ces hommes admirables.
(1) Cité par pline, Nat. Hist., 29, 7, 14. Jordan, LXXXVIII, p. 77.
(2 plut., Cat., 34, 35.
Mais Caton vit avec peine cet amour des lettres s'introduire à Rome ; // craignait que la jeunesse romaine, tournant verscette étude toute son émulation et toute son ardeur, en vint à préférer la gloire de bien parler à celle de bien faire et de se distinguer par les armes... Il pensa qu'il fallait, sous quelque prétexte spécieux, renvoyer de Rome tous ces philosophes. Il se rendit au Sénat et lui reprocha de laisser depuis longtemps ces ambassadeurs sans leur donner de réponse. Il faut donc connaître au plus tôt de leur affaire et en décider, afin que ces philosophes retournent à leurs écoles pour y instruire les enfants des Grecs et que les jeunes Romains n'obéissent, comme autrefois, qu'aux magistrats et aux lois.
En cela, note Plutarque, il agissait, non, comme on l'a cru, par inimitié personnelle contre Carnéade, mais par une opposition décidée contre la philosophie, par un mépris affecté, dont il se faisait gloire, pour les Muses et les disciplines grecques.
Une pensée ou, plutôt, un sens politique, qui ne manquait pas d'ailleurs de justesse, animait le vieux Caton. Cette philosophie, aussi bien celle de Zénon que celle de l'Académie ou d'Épicure, ce souci prédominant et presque exclusif des choses de l'esprit et de l'art, représentaient en effet une mentalité de vaincus, résignés à l'impuissance politique et à l'inaction. Elles étaient, au vrai sens du mot, un divertissement, divertissement fort estimable sans doute mais qui néanmoins disposait au laisser-aller, sinon les esprits, du moins les énergies; en concentrant les forces morales vers la vie intérieure, elles les détournaient de l'effort nécessaire pour dominer les choses et les hommes. Pour ce Latin réaliste, dont toutes les pensées étaient tendues vers l'action et qui, au sortir de l'âpre lutte soutenue tout le long de sa jeunesse pour l'existence de sa patrie, comprenait l'urgente nécessité de combattre et de vaincre encore, Socrate n'était qu'un babillard et Isocrate un inutile (1). Il se moquait, non sans raison, de ces disciples qui vieillissaient auprès du maître, comme s'ils ne devaient exercer leur art que dans les Enfers. La philosophie comme l'éloquence ne représentaient pour lui qu'un moyen, un moyen d'action et non une fin.
(1) plut., Cat., 36.
De même qu'après avoir formellement interdit à son fils les médecins grecs, il avait composé lui-même un ouvrage de médecine dans lequel il recueillait les vieilles formules latines, il voulut aussi donner à ses concitoyens une littérature sans danger, une littérature pratique comme le traité de l'Agriculture et une histoire. Il était si peu ennemi des lettres en elles-mêmes qu'il fut l'un des protecteurs d'Ennius et l'emmena avec lui en Sardaigne en 195. Il devait être sensible au génie du poète et surtout à son ardent patriotisme. Il aurait aimé certes, et favorisé une littérature purement romaine et inspirée des seules traditions nationales.
L'histoire, pour lui, représentait un enseignement essentiellement pratique. Il avait voulu, nous dit-on, être utile à son fils en lui transmettant le fruit de l'expérience et les traditions ancestrales. Le profit que le cultivateur devait tirer du De re rustica, le citoyen et l'homme politique devaient les trouver dans l'histoire. Ainsi naquirent les sept livres De Originibus. Historien, Caton trouvait comme prédécesseur immédiat Fabius Pictor qui, vers l'an 200, avait écrit en latin et en prose. Mais Fabius appartenait à la gens Fabia et son œuvre devait être, avant tout, une manifestation de cet orgueil nobiliaire que Caton poursuivait partout d'une haine opiniâtre. Ennius lui-même avait dû se montrer indulgent, dans ses Annales, aux fantaisies généalogiques de ses protecteurs. Par réaction, Caton se serait astreint, nous dit-on, à ne citer aucun nom propre, ou plutôt, il n'en citait qu'un, celui d'un des éléphants de Pyrrhus. Il ne connaissait pas d'individus, il ne voyait que le « consul » ou le « magistrat ». Comme l'indique le titre de l'ouvrage, il s'attachait surtout aux origines des villes d'Italie dont il traitait, semble-t-il, au fur et à mesure que les diverses cités entraient dans l'orbite de Rome. Il empruntait ses renseignements soit aux historiographes grecs, en particulier aux auteurs siciliens des « Origines italiennes », soit aux poètes comme Ennius. Quelques-uns des fragments qui nous en sont parvenus se réfèrent, en effet, à 1a légende d'Enée et des origines troyennes. « Beaucoup de recherches et d'application », jugeait Cornélius Nepos, « mais de doctrine point (l). »
L'atmosphère dans laquelle vivait le peuple romain au temps d'Ennius et de Plaute était trop pénétrée d'intellectualité pour que Caton pût songer à proscrire les choses de l'esprit. Il aurait voulu une littérature purement nationale, ne laissant rien perdre des acquisitions ancestrales. N'était-ce pas lui qui, dans ses Origines, mentionnait les poèmes qui, bien des siècles avant son temps, étaient chantés dans les festins par chacun des convives, en l'honneur des grands hommes (2) ? Mais l'état dans lequel il voyait la Grèce ne lui paraissait aucunement un idéal pour son pays. C'est pourquoi, brutalement, à sa façon, il la répudiait, elle et sa littérature, et vitupérait contre l'engouement de ses contemporains.
Caton vécut trop longtemps pour ne pas assister à la défaite de toutes les idées qu'il avait si âprement défendues. L'esprit nouveau l'emportait définitivement sur l'idéal antique. Lui-même le constatait lors d'un de ses derniers procès : il est pénible, avouait-il, d'avoir à rendre compte de sa vie à des hommes d'un autre siècle que celui où l'on a vécu (3). Du reste, comme il mettait une sorte de point d'honneur à ne pas être parmi les vaincus, on le voit céder lui-même de plus en plus aux nouvelles mœurs. Il avait défendu l'agriculture italienne comme la seule base solide sur laquelle pût reposer
(1) corn. nep., Cat., 3, 2, 4. Voici, autant qu'on peut la reconstituer, quelle était l'économie de l'ouvrage (jordan, p. 4) : I. L'histoire des Rois. — II et III. L'origine des cités d'Italie. — IV. La première guerre punique. — V. La seconde guerre punique. — VI et VII. Les événements postérieurs jusqu'à la préture de Servius Galba, en 161 avant notre ère. Dans ces derniers livres, Caton avait pris soin d'insérer quelques-uns des discours qu'il avait prononcés, mais en les composant, sans doute, à nouveau. Cicéron parle de cent cinquante discours au moins qu'il a pu retrouver et qu'il a lus, mais sans indiquer que ce fût dans les Origines (Brûlas, 17, 65).
(2) Cic., Brut., 19, 75.
(3) plut.. Cat., 22,
la fortune des particuliers et celle de l'État ; il condamnait le grand commerce comme trop hasardeux et celui de l'argent comme honteux. Il vit au moins commencer la ruine de la petite propriété italienne et lui-même, sur ses vieux jours, en vint à négliger ses champs pour acheter des étangs où il faisait de la pisciculture, des sources thermales, et à organiser des ateliers de foulons. Il exerça même, par intermédiaires il est vrai, la plus décriée de toutes les usures, l'usure maritime. Il alla jusqu'à pratiquer le commerce des esclaves, achetant de jeunes garçons qu'il revendait après les avoir instruits et formés. Et il exhortait son fils à tous ces genres de négoces.
Il dut en être de même en ce qui concernait ses goûts littéraires. Bien qu'il professât que la plus belle manière de vieillir fût de s'occuper toujours des affaires publiques, l'accès des jeunes générations aux honneurs finit par lui créer des loisirs. L'étude, qui lui avait paru autrefois un objet indigne d'occuper toute l'activité d'un homme, dut lui sembler, alors, un digne ornement du repos. Or il ne pouvait y avoir, à ce moment, d'autre objet d'étude que les lettres grecques. Il dut s'y adonner avec une ardeur que l'âge n'éteignait pas. De là, sans doute, la légende de Caton s'appliquant sur la fin de sa vie à apprendre le grec. En réalité, depuis longtemps, l'austère champion du vieil esprit latin avait su faire son profit des acquisitions de la science grecque.
Ses concessions à la Grèce, ou plutôt à la vie méditerranéenne sous la forme que lui avait donnée le monde issu des conquêtes d'Alexandre, n'empêchent pas Caton de représenter, au début du II ème siècle, le type accompli du Romain de l'ancien temps, à l'esprit vif mais obstiné, âprement combatif et foncièrement utilitaire. Il en a toutes les qualités, le don du comique et le sens du droit, une énergie indomptable mais avisée ; il en a aussi les défauts de brutalité, de mesquinerie et d'orgueil. Tout compte fait, on préférera Scipion mourant en exil à Caton trafiquant de jeunes esclaves et finissant par épouser la fille de son greffier (1).
Toutes ses idées cependant ne sont pas mortes avec lui ; il en est une au moins que l'on retrouve encore parfois aujourd'hui, à savoir qu'une culture raffinée de l'intelligence contribue à corrompre la pureté des mœurs. Des exemples illustres nous feront constater, au contraire, que l'introduction à Rome de la pensée grecque n'y eut pas pour effet l'abaissement mais bien plutôt l'élévation des caractères (2). La plupart des vices qui se répandirent à Rome à partir de ce moment n'avaient rien de grec : gloutonnerie, avidité sans mesure d'honneurs, d'autorité et d'argent. Marius illettré n'est pas moralement supérieur au dilettante Sylla. Si les défauts romains n'ont pas dans la grossièreté rustique leur racine première, il est plus juste d'en chercher l'origine en Asie (3), avec Tite-Live, plutôt qu'en Grèce. En réalité, ce sont vices de parvenus qui n'ont rien à voir avec la littérature et la philosophie. Ils résultent uniquement d'un enrichissement trop rapide. Rome s'est trouvée grisée d'avoir tout à coup entre les mains le monde et tout son or. Elle a pillé dans la confusion, et le bien mal acquis s'est retourné contre elle. Cette richesse ne s'est même pas trouvée répartie entre tout le peuple vainqueur.
(1) plut., Cat., 37.
(2) Infra, chap. IV : Paul-Emile, Scipion Emilien.
(3) T. Liv., 39,6: « Ce fut l'armée d'Asie qui introduisit à Rome les commencements du luxe étranger (en 190), lits ornés de bronze, tapis précieux, voiles et tissus de soie, etc. Ce fut alors qu'on ajouta aux festins des chanteuses, des joueurs de harpe, des baladins, que les repas eux-mêmes commencèrent à être préparés avec plus de soin et de frais, que le cuisinier, le dernier des esclaves, chez les anciens, pour le prix et l'emploi, fut tenu en estime et que ce qui n'était qu'un office de valet fut regardé comme un art. »
Elle est demeurée le privilège d'une classe restreinte, de l'aristocratie sénatoriale et des chevaliers qui, après avoir ruiné les petits propriétaires italiens, s'est détruite elle-même par les guerres civiles. Il y a là toute une série de phénomènes économiques et sociaux d'ordre matériel complètement étrangers à l'évolution intellectuelle et morale du génie romain. Ce n'est pas la pensée grecque, c'est l'or du monde mis au pillage, qui a ruiné les antiques vertus et finalement la puissance de Rome.
CHAPITRE III
LES TRANSFORMATIONS DE L'ESPRIT RELIGIEUX
Nous accorderons plus volontiers que la critique philosophique était de nature à porter atteinte aux vieilles croyances religieuses. Encore ne faudrait-il pas exagérer, car bien des Romains n'avaient pas attendu la pensée grecque pour dépasser les conceptions primitives, pour faire boire, par exemple, les poulets sacrés lorsqu'ils ne voulaient pas manger (1). Et d'autre part, nous trouvons des hommes cultivés comme Paul-Emile qui demeurent des augures extrêmement scrupuleux et convaincus. Plus encore que les philosophies d'aujourd'hui, celles de l'antiquité abandonnaient bien des énigmes aux réponses toutes prêtes de la religion. Le raisonnement pouvait même servir à justifier d'anciens usages religieux. Ne voyons-nous pas Cicéron défendre la divination ?
Que la Grèce ait miné le crédit des trente mille dieux italiens que trouvait Varron, qui songerait à le lui reprocher? Zeus, surtout le Zeus assagi des philosophes, était infiniment supérieur à Janus et à son cortège. Qu'il fût même devenu un Zeus paresseux et indifférent, nous n'y verrons nul dommage, ni pour la pensée spéculative, ni pour la morale dont il ne se souciait primitivement que fort peu. En réalité, ce ne sont pas ces spéculations nouvelles qui ont tué les anciennes croyances ; celles-ci sont mortes d'elles-mêmes parce qu'elles ne correspondaient plus à l'état intellectuel et social du peuple.
(1) Val. max., 1, 5, 3 et 4 ; Cic., de Div.,1, 16, 29; T. liv.,Epit., 19.
Faute d'avoir rien à y substituer, 1es Romains ont adopté, un peu au hasard, soit des notions philosophiques, soit des mythes et des cultes é!rangers. Laissons de côté, pour le moment, la pensée philosophique grecque qui n'atteint guère que l'élite intellectuelle. Le flot, très mêlé, qui coule aux carrefours populaires provient de sources moins hautes et moins pures.
Nous y distinguons tout d'abord, comme à l'origine de la littérature, des influences italiennes beaucoup plus nombreuses et plus fortes, plus anciennes d'ailleurs, que celles qui peuvent venir de Grèce.
I
L'INQUIÉTUDE RELIGIEUSE A ROME PENDANT LA SECONDE GUERRE PUNIQUE.
La conquête de l'Italie a eu pour effet d'attirer à Rome une foule originaire des diverses provinces de la péninsule. Samnites, Etrusques, Ombriens, Campaniens y sont arrivés soit comme prisonniers, soit comme artisans libres, soit comme réfugiés dépouillés de leurs biens et déracinés, venant chercher asile et fortune dans la nouvelle capitale. La seconde guerre punique a eu pour effet de multiplier outre mesure cette dernière catégorie. Sitôt Hannibal éloigné, le Sénat ordonne à ces misérables de retourner dans leurs provinces, mais ses décrets ne reçurent jamais, sans doute, qu'une application partielle. Ces provinciaux se mêlent à la plèbe romaine; des uns à l'autre s'accomplit un échange d'idées constant et prolongé. L'effet s'en marque tout d'abord par une recrudescence de superstitions.
La guerre traînait en longueur, expose Tite-Live ; les succès et les revers modifiaient moins la situation que les dispositions des esprits. Un zèle religieux, venu en grande partie du dehors, envahit la cité sibien qu'on eût dit que les dieux ou les hommes en avaient été tout à coup changés. Ce n'était plus seulement en secret et dans l'intimité des maisons que l'on abandonnait les rites romains; en public et jusque sur le Forum et le Capitole on voyait des troupes de femmes ne plus sacrifier et ne plus prier les dieux suivant la coutume des ancêtres. Des espèces d'officiants et de devins s'étaient emparés des âmes ; le nombre de leurs fidèles s'augmentait de toute la foule campagnarde chassée par cette guerre interminable de ses champs incultes. Il était facile à ces prêtres d'exploiter la superstition de ces malheureux; ils le faisaient comme si c'eût été un métier autorisé... Le Sénat dut charger le préteur de libérer le peuple de ces cultes. Ce magistrat lut le sénatus-consulte devant l'assemblée et prescrivit par édit que quiconque aurait des livres de prophéties ou des formules de prières ou des rituels de sacrifice devrait livrer ces recueils et tous ces écrits au préteur avant les calendes d'avril. Défense était faite à quiconque de sacrifier, dans aucun lieu public ou consacré, suivant un rite nouveau ou étranger.
L'autorité du Sénat pouvait réprimer les plus bruyantes de ces manifestations; il lui fallait cependant tenir compte de l'inquiétude religieuse répandue dans la foule. Le crédit des anciens dieux était épuisé; ils n'avaient pas eu la puissance de protéger l'Italie, leur terre, contre l'étranger; la vertu des rites traditionnels paraissait usée. Sans doute aussi la vieille religion trop abstraite et exclusivement formaliste ne donnait-elle plus satisfaction au sentiment et à l'imagination populaires. L'inaction imposée par la guerre, l'angoisse du danger, le mélange des peuples, les échos de la poésie et les bribes de philosophie qui pouvaient tomber jusque dans la masse, développaient chez elle, comme une fermentation, des préoccupations nouvelles. D'où vient l'homme, de quelle essence est-il pétri, quelle est sa destinée? Ces questions, naturelles à l'intelligence qui s'éveille, le peuple romain devait se les poser et la religion de ses Pontifes n'y répondait pas.
Les réfugiés de Campanie et de l'Italie méridionale, au contraire, et les Grecs de Sicile., parlaient de dieux étranges qui souffrent comme les hommes, qui meurent comme eux et comme toute la nature, mais pour ressusciter. Ils auraient révélé à certains sages les mystères permettant aux hommes d'assurer leur bonheur après la mort et de comprendre le secret des renaissances. Les noms de Iacchos et de Zagreus qui règnent dans les montagnes de Thrace, de Déméter et de Koré honorées à Eleusis, se mêlent à ceux d'Orphée et de Pythagore. Les initiés à ces mystères gardent précieusement entre eux le secret qui ne fait qu'irriter la curiosité. On les voit se réunir pour célébrer des rites dont les profanes ne peuvent rien savoir de précis; on parle de purifications ineffables et d'une ivresse divine qui exalte l'esprit et les sens ; il est question de descente aux enfers, de mort, da résurrection. Ces gens ne s'habillent que de blanc, ils s'abstiennent de manger tout ce qui a vécu, certaines plantes même leur sont interdites; ils sont les purs et même après la mort n'admettent dans leurs cimetières que les purs. Pénétrés d'une sagesse plus qu'humaine, ils semblent au delà des atteintes du mal. Et les femmes en particulier s'empressent autour d'eux pour avoir part au secret.
A cette exaspération du sentiment religieux dans le peuple correspond un redoublement d'activité dans le fonctionnement de l'administration des Pontifes. Les chefs officiels du culte s'efforcent de donner satisfaction par les moyens réguliers à l'inquiétude nouvelle. A chacun des prodiges qui leur est annoncé ils consultent les Livres Sibyllins (1). Ces oracles grecs leur suggèrent des expiations extrêmement diverses. Evidemment, les Pontifes font appel à toutes les ressources de leur expérience et de leur imagination.
Nous les voyons recourir tout d'abord à de vieux rites italiques. En 217, après les premiers revers de la seconde guerre punique, ils font décréter par le Sénat un printemps sacré (2). Les animaux nouvellement nés, seuls, furent immolés; pour les enfants, on décida d'attendre qu'ils aient atteint l'âge d'homme, ils devraient alors disparaître de la cité et chercher ailleurs un établissement.
(1) T. Liv., 21, 62.
(2) T. Liv., 22, 10.
L'année suivante, après Cannes, le désastre est attribué à l'infidélité de deux Vestales (1). Les malheureuses sont mises à mort. On consulte de nouveau les livres sibyllins et Q. Fabius Pictor, le futur historien, est envoyé à Delphes pour consulter l'oracle. Entre temps, les livres sibyllins ont suggéré un rite abominable : on enterre vivants sur le Forum boarium un Gaulois et une Gauloise, un Grec et une Grecque. La plupart du temps, au cours de chacune des années suivantes, les oracles se contentent de prescrire l'accomplissement de cérémonies de rite grec, ou l'adoption de dieux grecs auxquels on voue des temples à l'intérieur même du pomerium. C'est de ce moment que date l'adoption officielle dans la religion romaine de la plupart des divinités helléniques, connues sans doute depuis longtemps, mais encore traitées en étrangères. En 215, par exemple, un lectisterne fut tenu pendant trois jours (2). Les statues des douze grands dieux grecs furent, à la mode hellénique, installées sur six lits; on était censé leur offrir un festin, pendant lequel le peuple défilait devant eux, leur apportant ses supplications. Les grands jeux en l'honneur d'Apollon sont organisés ainsi, à la mode grecque, en 212, comme dérivation, pour ainsi dire, à l'angoisse populaire en mal d'innovation religieuse.
Parmi les livres prophétiques qu'on avait saisis, raconte Tite-Live (3), les vers d'un certain Marcius étaient tombés aux mains du préteur. Des deux prédictions de Marcius, l'une, confirmée par l'événement postérieurement auquel elle avait été d'ailleurs publiée, faisait assez nettement allusion à la bataille de Cannes. La seconde était plus vague : Romains, si vous voulez chasser l'ennemi et la peste que vous en voient des contrées lointaines, vouez des Jeux à Apollon; que les particuliers y contribuent en même temps que l'État. Que /es décemvirs suivent le rite grec. Si vous accomplissez exactement ces ordres, vous serez toujours heureux et vos affaires deviendront meilleures, car ce dieu exterminera vos ennemis qui se nourrissent tranquillement de vos champs-
On mit tout un jour, continue Tite-Live, à essayer de comprendre cette prédiction. Le lendemain, les décemvirs furent chargés par un sénatus-consulte de consulter les livres sibyllins.
(1) T. Liv., 22, 57.
(2) T. Liv., 22, 10.
(3) 26, 12,
Sur leur rapport, le Sénat décréta l'exact accomplissement des ordres de la prophétie. Les décemvirs devraient donc sacrifier suivant les rites grecs; ils offriraient à Apollon un bœuf et deux chèvres blanches, à Latone une génisse; toutes ces victimes auraient les cornes dorées. Le préteur, au moment da commencer les Jeux, dans le grand Cirque, fit publier que, pendant leur durée, chacun devrait apporter à Apollon ses offrandes. Le peuple assista aux Jeux couronné de fleurs; les matrones, les cheveux déliés, firent des supplications; partout on ouvrit les portes des maisons et l'on prit ses repas au dehors; ce jour fut marqué enfin par des cérémonies de toute sorte. Rites grecs et vieilles pratiques magiques comme l'ouverture des portes, se mélangent pour attribuer au culte romain un aspect entièrement nouveau.
II
LES CULTES ORIENTAUX. la GRANDE MÈRE DES DIEUX DE PESSINONTE.
Toutes ces nouvelles dévotions, qu'elles fussent d'origine italique ou grecque, ne réussissaient pas à écarter le danger. Sept ans après, en 205, l'ennemi continuait à se nourrir des champs italiens. Les prodiges se multipliaient encore (1). Rome était plus que jamais tourmentée de craintes superstitieuses. En consultant à nouveau les livres sibyllins, on y avait trouvé cet oracle : Lorsqu'un ennemi étranger aura transporté la guerre sur le sol de l'Italie, on ne pourra le chasser et le vaincre qu'en transportant de Pessinonte à Rome la statue de la Mère Idéenne. Ce n'était plus aux dieux grecs, c'est à ceux de l'Asie qu'on faisait appel.
La Grande Mère de Pessinonte était la vieille divinité chthonienne adorée depuis les temps préhistoriques en Crète et en Asie Mineure.
(1) T. Liv,, 26, 19; 27, 28 ; 28, 11.
Rhea, Cubébè, Cybèle, étaient ses noms. Mère de tous les dieux, principe de la vie, divine, humaine, animale et même végétale, elle règne sur les hauts plateaux couverts de forêts, sur les animaux, sur les sources, les étangs, dans les antres souterrains et dans les tombeaux. Ses plus anciennes images sont taillées dans le roc; sa figure humaine y est encore mal dégagée de la pierre. Elle est associée à un jeune dieu de la lumière, Attis, son amant. Déesse jalouse, elle exige de ses fidèles un attachement exclusif. Qui lui résiste devient dément. Dans une crise de fureur mystique, Attis s'émascule au pied d'un pin et meurt de sa blessure. La déesse Mère de l'Ida est la déesse nationale de Phrygie ; la ville de Pessinonte est le principal de ses sanctuaires et son domaine propre.
« Sur le plateau d'Anatolie, écrit M. F. Cumont, le climat est extrême. L'hiver y est rude, long, glacé ; les pluies du printemps développent soudain une floraison vigoureuse que brûlent bientôt les ardeurs de l'été. Les brusques contrastes de cette nature, tour à tour généreuse et stérile, éclatante et morose, provoquaient des excès de tristesse et de joie inconnus dans les régions plus tempérées. Les Phrygiens pleuraient désespérément la longue agonie et la mort de la végétation, puis, lorsqu'en mars, la verdure reparaissait, ils s'adonnaient à toute l'exaltation d'une joie tumultueuse. Des rires sauvages exprimaient la véhémence de ces sentiments opposés. Après les jours de deuil où l'on pleurait le trépas d'Attis, une explosion de réjouissances commémorait sa résurrection, c'est-à-dire la renaissance de la nature. Au milieu des clameurs, dans le vacarme des tambourins et des cymbales que domine le bruit strident des flûtes, ce sont des courses folles sur la montagne, des danses échevelées autour des autels, des flagellations et des mutilations. Le sang des hommes se mêle à celui des victimes. Les prêtres, les galles qui ont sacrifié leur virilité à la déesse, forment un ordre saint qui a le don de prophétie. L'orgie de leurs rites produit l'extase qui purifie la vie présente et assure après la mort une existence bienheureuse. » Tel est le culte que, pour chasser Hannibal, le Sénat introduit à Rome.
La grande déesse de l'Ida aborda l'Italie au début d'avril 204, sous forme d'une pierre noire. Elle y fut reçue par celui que le Sénat avait jugé le plus saint des Romains, P. Scipion Nasica, le cousin du futur Africain, et par une matrone de la vieille famille aristocratique des Claudes à la tête de toutes les dames romaines. En attendant qu'elle ait son sanctuaire à elle, on l'installa dans le temple de la Victoire, sur le Palatin, avec tout son clergé de galles émasculés aux longues robes éclatantes, prophètes et mendiants, porteurs d'images de piété de toute sorte, joueurs de tambourins et de musiques stridentes. En même temps des Jeux de type grec, les ludi Megalenses, devaient commémorer chaque année le souvenir de cette introduction du culte exotique dans la ville.
Ce culte de mysticisme et d'exaltation était trop contraire aux principes de la religion romaine pour que les Pontifes n'aient pas bientôt imposé des barrières strictes à ses manifestations. Défense fut faite aux citoyens d'y prendre part et, à plus forte raison, d'entrer dans ce clergé. Il semble d'ailleurs que le bon sens populaire n'ait pas tardé à concevoir le plus profond mépris, sinon pour la déesse, du moins pour ses ministres, ces frotteurs de tambourins, dit Plaute, qui ne valent pas une coquille de noix. Le danger passé, la déesse de l'Ida se trouva reléguée dans son sanctuaire. Il n'en reste pas moins que, pour donner satisfaction à l'émotion religieuse qui travaillait la foule, le Sénat avait introduit à Rome l’undes plus grossiers de tous ces cultes orgiastiques qui sévissaient en Orient.
III
l'affaire des bacchanales. la réaction pontificale.
Moyennant toutes ces concessions diverses à l'esprit nouveau, les Pontifes avaient réussi à sauvegarder leur autorité sur la religion. Les innovations qu'ils admettaient prenaient place dans le culte officiel. Le reste demeurait superstition. Les grands dieux de l'Olympe intronisés à Rome avaient relégué dans l'ombre les innombrables numina des temps primitifs. Souvent, ils s'étaient trouvés assimilés à quelque divinité ancienne et lui avaient prêté leur personnalité. Saturne italique, par exemple, se trouvait décidément confondu avec Kronos; Vénus, une ancienne déesse des jardins, semble-t-il, était devenue Aphrodite. Les sacrifices et les rites à la mode grecque s'étaient superposés et, en bien des cas, avaient dû remplacer les rites indigènes. Sous l'influença de la poésie, en particulier, la religion romaine apparaissait désormais comme une sœur cadette de celle des Grecs. Mais elle demeurait tout aussi strictement réglée qu'auparavant et aussi hostile aux exaltations sentimentales.
Dans le peuple cependant la fermentation religieuse dont la seconde guerre punique avait jeté les germes continuait à développer ses effets. Nous en trouvons trace en particulier dans cette histoire que nous conte longuement Tite-Live du scandale provoqué par les mystères de Bacchus. La sévérité de la répression montre avec quelle énergie s'exerçait l'autorité des Pontifes lorsqu'il s'agissait de sauvegarder les principes de la religion nationale.
L'incident se place en 186 avant notre ère, quinze ans après Zama. Tite-Live semble considérer le culte de Bacchus comme d'introduction toute récente à Rome (1). « Un Grec de basse extraction, dit-il, vint en Etrurie tout d'abord... Le fléau corrupteur passa d'Etrurie à Rome comme une contagion. » En réalité, les mystères bachiques semblent répandus dès le V ème siècle au moins dans toute l'Italie méridionale, où ils se trouvent plus ou moins confondus avec l'orphisme. Ils avaient dû, dès la même époque, pénétrer en Etrurie, s'il est vrai qu'il faille reconnaître des Bacchants et des Bacchantes dans bon nombre de peintures de tombes étrusques. Sous quelque nom qu'on le désignât, Dionysos, Iacchos, Zagreus, Bacchus, et quelle que soit son origine, le dieu est, comme Attis, un dieu de la nature qui meurt et qui renaît. Son culte avait inspiré autrefois à Euripide l'une des plus poétiques et des plus troublantes de ses tragédies, les Bacchantes ; il unissait dans l'enthousiasme de la vie le sentiment de la nature à celui de l'infini, il était un hymne à la beauté, à la joie et un défi à la mort. Il est tout à l'honneur des Romains de n'être pas demeurés insensibles à la grâce troublante et fantaisiste du jeune Dionysos menant son thiase au milieu des danses des Ménades et de l'exubérance des Satyres. Le succès et la diffusion des mystères montre simplement que la vieille tradition religieuse ne suffisait plus à l'esprit romain. L'ardeur de la pensée qui s'éveillait l'entraînait malgré sa prudence aux exaltations mystiques.
La sévérité de Tite-Live pour les sectateurs de Bacchus n'est que l'écho de la tradition pontificale dont s'inspire toute l'historiographie romaine. Les accusations qu'il répète ne sont que les banales et atroces calomnies que toutes les religions nouvelles ont suscitées chez ceux qui ne les connaissent pas. L'ivrognerie et la volupté auraient été les moyens de séduction de ce culte ; le stupre, le faux serment, l'assassinat, ses effets les plus ordinaires.
(1) T. Liv., 39. 8.
Cependant tel avait été son succès que plus de sept mille personnes, hommes et femmes, se trouvèrent impliqués dans les poursuites et que la persécution n'avait pas encore pris fin au bout de cinq ans (1). La seule conclusion à tirer de ces indications, c'est que le peuple de Rome s'était montré accueillant aux doctrines si largement répandues depuis des siècles dans le reste de l'Italie et du monde méditerranéen. L'ivresse religieuse de l'orgie n'était pas nécessairement corruption. Le symbole ne doit pas se confondre avec la réalité, le rite avec l'acte qu'il simule.
La répression fut d'une férocité qui déconcerte. Le consul Posthumius chargé de l'enquête fit au Sénat un rapport effrayant (2) et obtint un décret d'interdiction résumé par Tite-Live et dont le texte complet a été retrouvé au XVIIe siècle dans le Bruttium, gravé sur une table de bronze (3). Il s'agit bien de l'interdiction d'un culte et non pas seulement des réunions secrètes qui pouvaient être occasionnées .par la célébration de ce culte. Cette interdiction est étendue à toute l'Italie, à tout citoyen, à toute personne de droit latin, à tout allié, c'est-à-dire à tous ceux sur qui le Sénat a autorité.
Une grande terreur se répandit à Rome et en Italie... plusieurs initiés, hommes et femmes, se donnèrent la mort. Les arrestations furent innombrables. Tous les initiés coupables furent décapités, les autres retenus en prison et le nombre des condamnés à mort dépassa celui des prisonniers. Les femmes furent remises aux mains de leurs parents ou de ceux en puissance de qui elles se trouvaient pour qu'ils les fissent exécuter (4)...
Rien n'est d'apparence plus fallacieuse qu'une religion mauvaise, déclarait le consul Posthumius. Mais combien de fois nos pères n'ont-ils pas chargé les magistrats de s'opposer à toute cérémonie d'un culte étranger, de proscrire tout rite, tout sacrifice autre que ceux des Romains? Ils pensaient, en effet, que rien ne tend d'avantage à détruire le culte national qu:e les pratiques étrangères (5).
Le sénatus-consulte des Bacchanales est une mesure très nette de réaction non seulement politique, mais aussi religieuse.
(1) T. Liv., 40 19.
(2) T. Liv., 39, 14.
(3) LI, I, n° 196.
(4) T. Liv., 39, 18.
(5) Ibid, 39, 16.
Que l'on compare encore un autre épisode datant de la même période à l'attention prêtée par les Pontifes pendant la guerre punique, en 212, aux prophéties de Marcius. En 181, on aurait découvert au pied du Janicule deux sarcophages de pierre avec des inscriptions grecques et latines indiquant qu'ils contenaient, l'un le corps de Numa Pompilius, fils de Pompo, roi des Romains, l'autre les livres de Numa (1). Le sarcophage de Numa était vide; l'autre contenait sept volumes en latin traitant du droit pontifical et sept autres, en grec, de philosophie morale. Supercherie grossière, indique Tite-Live, reposant sur la tradition qui faisait de Numa l'élève de Pythagore. Il s'agissait évidemment d'introduire, sous le couvert de Numa, des idées ou des rites provenant des sectes pythagoriciennes. Le préteur n'hésita pas ; il déclara que ces livres ne devaient être ni lus ni conservés, et le Sénat les fît brûler par le bourreau sur le Forum. On n'avait plus besoin de nouveaux livres sibyllins.
Le Sénat, par l'intermédiaire des Pontifes, veut conserver la haute main sur les choses religieuses. Il ne conçoit d'autre religion que les cultes officiels. Ces cultes seront élargis, mais par lui. Ils peuvent admettre tous les dieux suivant les circonstances, mais à certaines conditions. La première est qu'ils ne soient l'objet que d'honneurs publics. Comme les autres cérémonies, celles de la religion doivent avoir leur règle fixée par un collège et des chefs responsables pour les présider. La religion n'admet ni culte caché, ni sentiment personnel. Foncièrement individuel, le mysticisme échappe par son essence même et par le secret qui l'entoure à l'action des autorités. Telle est la raison de l'invincible défiance qu'il inspire.
En dépit du Sénat, des idées nouvelles n'en pénètrent pas moins la religion, et cela surtout par l'intermédiaire de la littérature. La tragédie a certainement contribué à l'adoption des dieux grecs.
(1) T. Liv., 40, 29.
Plus populaire, la comédie dut avoir encore plus d'action, mais dans un autre domaine; elle établit un rapport qui jusque-là n'existait pas entre les dieux et la morale. Le prologue du Rudens de Plaute nous paraît caractéristique à cet égard. Jupiter devient le juge et le protecteur de la vertu :
II s'inquiète des actions des hommes, de leurs habitudes, de la fidélité avec laquelle ils observent leurs devoirs, de la façon dont chacun use de la richesse. Jour par jour des messagers lui rapportent fidèlement les noms de ceux qui cherchent le mal, des méchants qui cherchent à gagner leur procès par un faux serment, qui obtiennent du juge ce à quoi ils n'ont pas droit. Et Jupiter juge à nouveau la chose jugée; il frappe les coupables d'une amende qui dépasse leur gain. Des honnêtes gens, au contraire, il tient la liste sur des tablettes à part.
Voici, dans le même prologue, qui est encore plus nouveau et qui bouleverse les vieilles conceptions religieuses :
Sans doute, les méchants s'imaginent qu'ils peuvent se concilier Jupiter par des dons, par des sacrifices. Eh bien, ils perdent leur temps et leur argent. Il en est ainsi parce qu'aucune prière émanant des parjures n'est agréée par Jupiter. L'homme qui remplit ses devoirs, lorsqu'il supplie les dieux, réussit bien mieux que le coupable à obtenir leur faveur.
C'est, nous semble-t-il, transposée dans la religion commune, la distinction établie par les religions de mystères entre les purs et les profanes. Mais il s'agit ici de pureté morale et de vertu (1).
De telles idées viennent sans nul doute de la comédie grecque qui servit de modèle à Plaute. Parmi les éléments très divers qui se mêlent dans la religion romaine du II ème siècle avant notre ère, ceux qu'y introduit la littérature ne sont pas les moins riches d'avenir.
(1) Dans l'inscription métrique du Sérapeion A de Délos, M. P. Roussel relève deux vers qui indiquent que Sérapis et Isis protègent surtout les gens de bien : v. 33, 34, Divinités de salut, vous veillez sans cesse sur les gens de bien qui n'ont en leur esprit que des pensées pures. Chez Euripide, les Dioscures déclarent de même qu'ils ne prêtent assistance en mer qu'aux gens de bien, Electre (v. 1350 sq.) ; P. roussel, CXLI, p. 77 et 293.
CHAPITRE IV
LE CERCLE DE SCIPION ÉMILIEN TÉRENCE ET LUCILIUS
Lorsque au début du IIe siècle avant notre ère les Romains abordèrent en Grèce ils se trouvaient, en quelque sorte, dans l'état d'esprit de ces jeunes gens qui plus tard, à la fin de la République et au début de l'Empire, s'embarquaient, leurs études terminées, pour visiter enfin les lieux dont on les avait si longtemps entretenus. Aussi leurs sentiments à l'égard de la Grèce accusent-ils, au début tout au moins, l'ardeur des enthousiasmes juvéniles. Ce temps, qui était celui d'Ennius et de Plaute, fut pour les Romains une période de philhellénisme ardent que nous avons tout lieu de croire sincère. La proclamation de l'indépendance de la Grèce, en 196, nous en apporte le témoignage.
Mais la Grèce que les Romains apprirent à connaître n'était plus celle des poètes ni même des orateurs. Commencés en idylle, les rapports politiques dégénérèrent bientôt en sauvages exécutions comme le ravage de l'Epire par Paul-Emile en 168 (1) et le sac de Corinthe par Mummius en 146. Dans Athènes déchue la haute poésie s'était tue ; l'éloquence n'était plus que rhétorique ; la philosophie couvrait toutes les autres voix du bruit de ses discussions.
(1) plut., Paul-Emile, 32.
Ce n'étaient là, pour les uns, comme Caton, que de ridicules subtilités. D'autres, d'un esprit moins étroit, furent vivement frappés du profit intellectuel qu'ils en pouvaient tirer. Laissant de côté la métaphysique, ils s'appliquèrent aux théories traitant de la conduite pratique de la vie. La morale avait de tout temps exercé un puissant attrait sur l'esprit romain. Les leçons des philosophes portèrent leurs fruits. A l'idéalisme de la période précédente nous voyons succéder à Rome le goût de l'observation psychologique et de la discussion morale.
Les plus sévères parmi les Romains ne sont d'ailleurs pas insensibles aux séductions de la culture intellectuelle et des arts de la Grèce. Paul-Emile (227-158), après sa victoire de Pydna (168), profita de son commandement, nous dit Plutarque, pour visiter les pays grecs, leurs villes et leurs sanctuaires. De tous les trésors que lui livrait la défaite de Persée, il ne voulut retenir pour lui-même que la bibliothèque du roi, Aux Athéniens, il demanda deux choses, le meilleur de leurs artistes pour exécuter les peintures qui, au jour de son triomphe, devraient représenter les épisodes de sa campagne et le meilleur de leurs philosophes pour parfaire l'éducation de ses enfants.
Pour ses fils, ajoute Plutarque, il nourrissait une affection extrêmement tendre. Il les avait tout d'abord instruits lui-même, suivant la vieille tradition nationale, comme Caton l'avait fait pour son fils. « Mais il prit encore plus de soin à les former aux disciplines grecques. Il tenait toujours auprès d'eux, non seulement des grammairiens, des sophistes et des rhéteurs, mais encore des peintres et même des écuyers, des veneurs et des piqueurs habiles. »
Ainsi fut élevé Scipion Émilien (185-128), fils de Paul-Emile, passé par adoption dans la famille de Scipion l'Africain dont il était du reste le neveu. Cette éducation, qui avait fait de lui l'un des hommes les plus cultivés de son temps, ne l'avait pas empêché de concevoir dans sa jeunesse un vif attachement pour Caton (1). Son ami Laelius, fils du compagnon le plus fidèle du premier Africain, n'était pas moins versé que lui dans les lettres grecques et l'aurait même emporté par un esprit plus brillant. Tandis que Scipion admirait surtout Xénophon, Laelius préférait la philosophie plus subtile des Grecs de son temps. Il fut en 155 l'un des auditeurs assidus du stoïcien Diogène. Un peu plus tard, il s'attacha à Panaetius, stoïcien également, mais de la libre observance et qui prenait son bien chez les plus grands esprits de toutes les écoles, en particulier chez Platon et chez Aristote. C'est dans l'intimité de Scipion et de Laelius que Panaetius créa la tradition de la philosophie romaine, telle que nous la trouvons exposée par Cicéron, toute faite d'éclectisme, à égale distance du scepticisme foncier de la nouvelle Académie et de l'absolutisme du Portique.
L'histoire également, en la personne de Polybe, trouve accueil dans le cercle de Scipion Emilien. Plus âgé de vingt ou vingt-cinq ans que les deux jeunes Romains, Polybe joua longtemps auprès d'eux le rôle d'une sorte de précepteur paternel. Depuis 190, il avait pris part, aux côtés de Philopœmen, aux derniers efforts des Grecs pour sauvegarder cette liberté que venaient de leur octroyer les Romains. En 169, il était hipparque de la Ligue achéenne. C'est à ce titre qu’après la victoire de Paul-Emile sur Persée il fut réclamé comme otage par les Romains. Des livres prêtés furent l'occasion de longues conversations avec le fils du général romain. Tandis que les autres otages étaient internés dans des municipes d'Italie, Polybe obtint de demeurer à Rome. En 150 on lui permit de rentrer en Grèce. Mais Rome était désormais pour lui une seconde patrie. Il en écrivait l'histoire. Il y revint fréquemment.
(1) Cic., de Rep., 2, 1, 1.
Nous le trouvons à côté de Scipion lors de la prise de Carthage en 146; il l'accompagna de même, semble-t-il, à Numance en 133 (1). « II y avait pour ainsi dire, remarque M. Croiset, harmonie préétablie entre l'esprit vigoureux de Polybe et ce monde nouveau. Au milieu de tant de cénacles frivoles et bavards, il est sérieux, pratique, capable d'action et de réflexion, il y a du Romain en lui... » Peut-être Polybe n'a-t-il pas moins reçu de Scipion et de Rome qu'il ne leur a donné.
Dans cette maison de Scipion, où fréquente toute l'aristocratie romaine, les deux meilleurs poètes de l'époque, Térence et Lucilius sont reçus familièrement. C'est pour cette société qu'ils écrivent ; c'est d'elle tout au moins que leur pensée reçoit sa direction.
I
térence (192 environ à 159).
Térence n'était qu'un affranchi, ancien esclave du sénateur Terentius Lucanus. Le surnom d’A fer qu'il portait conserve évidemment le souvenir de son origine, qu'il ait été acheté en Afrique ou qu'il fût le fils de quelqu'un de ces prisonniers que la prise de Carthage, en 204, dut amener à Rome. Son activité littéraire commence avec l’Andrienne et l'Eunuque en 166, un an ou deux après le retour à Rome de Scipion et de Polybe. Sa carrière fut brève. De complexion délicate, il mourut vers 159 au cours d'un voyage en Grèce. Il avait écrit six comédies que nous possédons.
On lui reprochait de n'être pas l'auteur ou du moins le seul auteur de ses œuvres. Un commentateur nous a conservé cette épigramme
(1) Polybe survécut à Scipion Émilien, mort en 129 à cinquante-six ans. Il ne succomba lui-même qu'en 125, âgé de plus de quatre-vingts ans, des suites d'une chute de cheval.
Les pièces que l'on met sous ton nom. Térence, de qui sont-elles ? Ne serait-ce pas quelqu'un qui règle le sort des peuples, un personnage comblé d'honneurs qui les écrivit ?
Si les uns parlaient de Scipion, les autres soupçonnaient, plutôt Laelius. On connaît l'anecdote rapportée par Suétone, Laelius priant sa femme de ne pas l'interrompre parce qu'il se sentait en veine d'écrire et récitant ensuite un passage qu'il venait, disait-il, de composer et qui figure dans VHeaulontimo-roumenos. Térence lui-même mentionne à deux reprises, dans ses prologues, ces accusations. Il n'y oppose pas de dénégation formelle. Il lui était d'ailleurs difficile de donner publiquement un démenti trop net à des allégations qui fondées ou non, constituaient une flatterie pour ses protecteurs. Vous voyez là un reproche, répondait-il, moi j'y vois une louange; je suis fier de plaire à ces personnages que vous aimez tous. La querelle est d'ailleurs sans intérêt. Retenons simplement que ces comédies durent être, alors que Térence les écrivait, un des sujets de conversation et de discussion du cercle de Scipion; une idée, un couplet, une repartie, peuvent provenir de Scipion ou de Laelius ou de quelqu'un de leurs amis. Le ton général, en tout cas, répondait à leur goût. C'est l'esprit de ce cercle de jeunes gens distingués qu'exprimé le théâtre de Térence.
On ne saurait y méconnaître en effet l'influence prépondérante de cette tendance morale qui, de la philosophie grecque, se répand dans toute la littérature de cette époque. Les comédies de Térence sont, avant tout, des études de sentiments et de caractères. Elles sont du théâtre psychologique. C'est pourquoi elles ont été tellement appréciées chez nous durant toute l'époque classique et généralement préférées à celles de Plaute, bien plus vivantes cependant et infiniment plus comiques. Térence, néanmoins, imite exactement les mêmes modèles que Plaute. Il les contamine, — c'est entendu, — c'est-à-dire qu'il transpose d'une pièce dans une autre des épisodes ou des personnages. Plaute, au contraire, se vantait de traduire exactement : Plautus vortit barbare. En réalité, l'un et l'autre usent de leurs modèles avec la même liberté, selon leur tempérament; Plaute y prend surtout la farce et les situations plaisantes, Térence la sensibilité et les nuances psychologiques. Ces éléments divers se trouvaient réunis dans la Comédie nouvelle grecque; chacun des pactes latins développe et renforce ce qu'il pense devoir plaire à son public. Plaute introduit dans la comédie jusqu'aux conventions traditionnelles de l'Atellane et de la plus vieille farce indigène ; Térence yajoute les subtilités d'un esprit délicat qui se replie volontiers sur lui-même pour analyser ses propres mouvements en face des circonstances. Son œuvre marque vraiment le début, à Rome, cette littérature morale, issue du « connais-toi toi-même » de Socrate et qui a pour objet l'homme et la vie.
La découverte récente, en Egypte, par M. G. Lefebvre, d'un papyrus portant des fragments assez développés de Ménandre, nous permet d'ailleurs de nous faire une idée plus précise que précédemment de cette Comédie nouvelle dont s'est inspirée la comédie latine et de là liberté dont usèrent les imitateurs. La moins incomplète des quatre comédies retrouvées était l'une des plus renommées du théâtre de Ménandre, l'Arbitrage. Le sujet en est précisément celui de l’Hécyre de Térence. On ne saurait cependant instituer une comparaison trop serrée entre les deux pièces, parce que l’Hécyre prend pour modèle, non pas directement la comédie de Ménandre, mais une imitation de Ménandre par un auteur de second ordre, Apollodore de Carystos. Les personnages ne sont pas les mêmes, aucune scène ne se recouvre exactement ; l'analogie se réduit à la donnée générale.
Dans l’Arbitrage, l'union de deux jeunes époux, Charisios et Pamphilè, tendrement attachés l'un à l'autre, se trouve brisée par la naissance prématurée d'un enfant, né de la violence que la jeune femme a subie de la part d'un inconnu, avant son mariage. On a exposé l'enfant. Mais Charisios, irrité, a pris une danseuse avec laquelle il essaye d'oublier son chagrin. Des paysans ont recueilli l'enfant. L'arbitrage fortuit de Smikrinès, le beau-père, rencontré par hasard, les fait entrer en possession du signe de reconnaissance que la mère a donné au malheureux bébé, un anneau enlevé par elle à celui qui l'avait violée. Cet anneau passe entre les mains de la danseuse de Charisios. Après diverses complications, Charisios reconnaît son anneau et son enfant. Le ménage se réconcilie, la danseuse et l'esclave son compère sont affranchis selon leurs vœux.
Dans les fragments que nous possédons, l'intérêt se trouve concentré sur l'entrée en scène du ménage de paysans et le plaidoyer du charbonnier contre le pâtre pour obtenir les objets qui faisaient partie du trousseau de l'enfant. Comme l'indique le titre, c'était bien là le nœud de l'action ; la scène principale constituait une sorte de parodie de ces procès où les beaux parleurs d'Athènes déployaient l’ingéniosité de leur dialectique. Une sensibilité légère mêlée d'effronterie anime le personnage de la petite danseuse, Habrotonon, étonnée de la conduite de Charisios qui la achetée mais dont elle ne parvient pas à se faire aimer. Elle rêve de se faire affranchir par amour et, pour atteindre son but, combine avec l'esclave Onesimos des ruses naïves. Le comique est fourni par les colères intempestives du beau-père Smikrinès qui, sans rien comprendre à ce qui se passe, s'agite autour du jeune ménage pour sauver la dot. Malgré les lacunes, nous arrivons à saisir ce qui dut faire le charme et le succès de Ménandre, la variété et la fantaisie de l'action qui entraîne l'imagination du spectateur et lui présente, en une série de tableaux plaisants, la transposition comique de la vie familière.
Plus confus et bien moins adroit apparaît l'argument de l'Hécyre, soit que l'auteur que suit Térence fût moins habile que Ménandre, soit que le procédé de la contamination ait surchargé et embarrassé le développement de l'action. Nous y retrouvons le jeune ménage brouillé malgré lui, mais dans des circonstances plus invraisemblables encore que dans la pièce grecque. Pamphile, lié depuis longtemps à la courtisane Bacchis, s'est laissé marier à Philuménè. Mais depuis son mariage il s'est détaché peu à peu de sa maîtresse, puis il est parti en voyage. Il revient tout à fait amoureux de sa jeune femme. Comme Pamphile dans la pièce grecque, Philuménè a subi, quelque temps avant son mariage, la violence d'un inconnu. Enceinte, elle s'est, en l'absence de son mari, réfugiée chez sa mère. Le beau-père attribue cette fuite à l'influence de sa femme, à laquelle il adresse de violents reproches. Pamphile revient juste pour saisir le secret de l'accouchement. Désespéré, il renonce au bonheur conjugal qu'il attendait et veut divorcer. Les deux pères tombent d'accord pour attribuer cette décision à l'attachement persistant du jeune homme pour la courtisane Bacchis. Comme chez A. Dumas, le père supplie la maîtresse de son fils de s'effacer. Il obtient aisément son renoncement et l'envoie rassurer Philuménè. Au doigt de Bacchis, la jeune femme reconnaît son anneau, celui qui lui avait été enlevé par l'inconnu qui la violenta. Bacchis l'avait reçu de Pamphile ; tout s'explique, le jeune ménage se réconcilie. Applaudissez.
L'épisode qui donne son titre à la pièce, ce sont les invectives du beau-père contre la malheureuse et innocente belle-mère à laquelle il attribue la brouille des jeunes gens : « Oui, vous êtes toutes les mêmes vous n’avez de cesse de voir vos fils mariés et mariés selon votre choix. Les voilà mariés; vous n'avez pas de cesse de les voir chasser leur femme ! »
La scène est assez bien venue, quoique banale. Elle représente le moyen de divertir le public. La belle-mère intervient dans la pièce à titre, pour ainsi dire, d'intermède comique. Le véritable sujet, celui que Térence s'est attaché à traiter, c'est le caractère de Pamphile.
Le héros n'apparaît, sans doute, qu'au troisième acte. Mais dès le premier vers, suivant un procédé classique, il n'est question que de lui et de ses sentiments. Sa maîtresse, son esclave, son père, sa mère, ses beaux-parents ne s'entretiennent que de lui. Lorsque, aussi abondamment présenté, il entre enfin en scène, c'est pour faire confidence de ses sentiments à son esclave.
« Laisse tes consolations. Est-il quelqu'un quelque part au monde aussi malheureux que moi ? Avant de me marier, mon cœur était pris ailleurs. Point n'est besoin de te le rappeler, chacun sait combien j'ai pu souffrir. Et cependant, je n'ai pas osé refuser celle que mon père m'a jetée dans les bras. A peine sorti de là, alors que mon cœur, débarrassé des liens où il était pris, commençait à se porter du côté de ma femme, bon, voilà que surgit une nouvelle histoire pour me détourner d'elle. C'est ma mère cette fois, ou c'est ma femme que je vais trouver en faute, il n'y a pas de doute. Dans l'un ou l'autre cas, que me reste-t-il à faire, si ce n'est de continuer à souffrir? Car, pour ma mère, je dois passer sur ses torts, le devoir me l'ordonne. Et ma femme, d'autre part, que ne lui dois-je pas! Elle a montré autrefois tant de patience à mon égard; de tous mes affronts elle n'a jamais rien dit nulle part... Etc. »
C'est dans ces dispositions qu'il surprend sa femme en train d'accoucher. De nouveau, un long monologue analyse son émotion. Puis ce sont les feintes du jeune homme pour cacher le fait à son esclave à qui il n'en a déjà que trop dit, ce sont ses efforts contre l'abnégation de ses parents qui, pour la paix du jeune ménage, veulent se retirer à la campagne, et contre son beau-père qui veut lui faire accepter l'enfant. Toute la pièce n'est que le développement des embarras d'un jeune homme faible et plein des meilleurs sentiments entre une maîtresse, une femme, un bâtard, un beau-père maladroit, un esclave indiscret, et des parents trop bien intentionnés. Les divers épisodes n'ont pour objet véritable que la psychologie de Pamphile.
La littérature dramatique comporte, en substance, deux éléments distincts. L'un s'adresse aux yeux et à l'imagination, c'est le spectacle d'un monde ou d'un temps qui ravit le spectateur à ses pensées quotidiennes, c'est l'animation de personnages qui agissent, s'agitent, rient, souffrent, s'inquiètent, intriguent, à travers des épisodes plus violents ou plus comiques on plus grands que les circonstances de la vie courante. L'autre, qui intéresse surtout la réflexion, ramène le spectateur à lui-même et à la réalité ; il l'invite à reconnaître ses actes, ses pensées, ses sentiments dans les personnages qui lui sont présentés. C'est le premier élément surtout que développe Plaute. Chez Térence, il n'est au contraire que l'accessoire et ne représente que l'occasion et le moyen de faire jouer des sentiments dont l'analyse constitue l'intérêt principal de la comédie.
Térence, Scipion, Laelius et leurs amis sont des jeunes gens, ils n'ont pas vingt-cinq ans. Polybe, qui en a quarante et qui, depuis vingt ans, a pris part à la vie publique de son pays, fait parmi eux figure d'ancêtre. Ce qui intéresse particulièrement ce cercle, c'est le caractère du jeune homme en général, ses sentiments, ses passions, son éducation, son attitude envers l'autorité paternelle, l'influence sur sa conduite de la sévérité ou de l'indulgence du père. Tels sont les problèmes qu'on discute. Dans la comédie grecque on va chercher des exemples et des leçons. La philosophie grecque, d'autre part, traite abondamment des caractères et des passions ; elle analyse, elle raisonne et, de ses observations, tire des conclusions morales. Térence et ses amis en font l'objet de leurs réflexions. Si dans le théâtre de Térence les caractères de jeunes gens surtout apparaissent vivants, c'est qu'ils sont animés de l'expérience personnelle de l'auteur et de ses amis. N'y cherchons pas leurs portraits, mais seulement un écho de leurs préoccupations et de leurs idées.
Un problème semble tout spécialement à l'ordre du jour, chez eux et sans doute aussi à Rome à ce moment. C'est celui de l'attitude qui convient aux pères à l'égard de leurs fils. Dans l'Heautontimoroumenos, Ménédème a été sévère, comme l'aurait été un vieux Romain de l'école de Caton ; il s'en repent amèrement et se montre disposé désormais à l'extrême indulgence. Son voisin Chremès intervient pour le rappeler à la juste mesure et lui donner de sages conseils de modération. Le thème est repris et traité avec plus de développement et de netteté dans les Adelphes. Demea est un bourru ; il fait de son fils un hypocrite. Micion passe tout à son fils adoptif ; l'enfant gâté abuse de cette indulgence. Micion, en dernière analyse, apparaît comme un égoïste et, au dénouement, c'est lui qui se trouve bafoué. Évidemment, on est partisan, chez Scipion, du juste milieu (1). Mais Térence ne soutient pas une thèse, il analyse, il décrit. Entre la vieille sévérité et un relâchement trop moderne, il adopte le ton, tempéré d'éclectisme, qui devait être celui d'un Panaetius.
Il serait vain d'ailleurs de chercher dans son théâtre des traits de mœurs précisément romains. Ni ses jeunes gens, ni les autres personnages ne sont des Romains. Sont-ils davantage des Grecs de ce temps? Je me garderais bien de l'affirmer. On n'y remarque aucun trait de réalisme. Ils sont le jeune homme ou le père de tous les temps et de tous les pays. Guidée par une philosophie qui ne se soucie que du « général », l'observation aboutit à une analyse qui dégage de tous ses caractères particuliers une sorte d'abstraction empreinte d'une vérité universelle.
(1) C'est l'attitude d'ailleurs qu'en politique, avait adoptée Scipion vers la fin de sa vie, entre les Gracques démagogues et l'obstination réactionnaire de l'aristocratie.
Ce que l'on aperçoit, chez Térence, c'est, comme dans .notre littérature classique, l'homme idéal ou plutôt mêmes des caractères, étudiés en dehors de toute circonstance de temps et de lieu.
Ajoutons que ces personnages sont presque tous foncièrement vertueux ou du moins pénétrés des intentions les plus vertueuses. Les fourberies mêmes des esclaves ne s'inspirent que d'un dévouaient absolu pour leurs jeunes maîtres, et les courtisanes réputées les plus dangereuses cèdent avec élan à l'entraînement général vers la générosité. Le ton est souvent d'une sensibilité un peu larmoyante. Les ombres sont légères dans cette peinture de la vie. Le théâtre de Térence respire un aimable idéalisme. Était-ce là le tempérament propre de Térence ou bien la jeune sagesse de Scipion et de ses amis, heureuse et favorisée par la fortune, ne voulait-elle voir de la vie que les côtés attendrissants? Il n'y a pas lieu de s'étonner que ces comédies, quel que fût leur mérite — et précisément en raison de leur mérite— n'aient joui auprès du public populaire romain que d'une faveur médiocre. L'auteur, dans ses prologues, attribue ses insuccès, à, des circonstances malheureuses, la concurrence d'un funambule, l'annonce d'un pugiliste en renom ou de combats de gladiateurs. On comprend fort bien que le même public qui applaudissait Plaute ou ses imitateurs s'ennuyât à écouter Térence. Tout en nuances et en finesse, le dialogue manque de force et d'éclat. Les subtilités d'une psychologie délicate étaient faites pour séduire, à la lecture, un observateur averti du cœur humain. Les artifices grossiers et dénués de toute vraisemblance que Térence reproche à ses rivaux convenaient mieux à l'amusement des spectateurs (1).
(1) Prologue du Phormion. « Le vieux poète malveillant s'en va répétant que tout ce que tout ce que Térence a donné jusqu'ici au théâtre est aussi pauvre d'invention que de style. C'est qu'en effet on ne trouve rien chez lui du goût de certaine scène où un petit jeune homme halluciné croit voir une biche lancée, une meute à sa poursuite,... elle pleure, la pauvre bête, il l'entend implorer du secours... »
L'œuvre de l'ami de Laelius et de Scipion est par trop dépouillée d'artifice, elle est d'une matière trop pure et trop froide pour amuser le peuple. La pensée abstraite, les jeux savants de l'intelligence demeurent forcément l'apanage d'une élite. Chez les poètes de la génération précédente, le patriotisme de l'épopée, le caractère dramatique des légendes tragiques, tout ce qui relève de l'imagination ou du sentiment se trouvait naturellement à la portée de tous. La Grèce homérique et classique de Naevius et d' Ennius était appelée à plus de popularité que celle du Portique ou de Polybe. Dès ce moment apparaît dans la formation intellectuelle romaine ce caractère aristocratique et fermé qui exclut la masse. Les humanités deviennent le privilège d'un petit cercle d'initiés. L'œuvre littéraire s'écarte du peuple.
Térence ne veut pas comprendre ni admettre ce divorce. Ce qui a plu à Scipion doit plaire au peuple. Il veut être un pur artiste et cependant il demande à la foule ses applaudissements : Encouragez par votre attention et votre silence bienveillant, ne cesse-t-il de répéter, ceux qui cultivent vraiment t'art des Muses. Les Muses qu'il honore ne sont pas divinités de carrefour et de tréteaux. Ce sont les déesses savantes d'une société réfléchie et cultivée que le commerce assidu des lettres grecques sépare profondément de la foule des gradins. Les Muses de Térence ne peuvent plaire qu'à une élite.
II
lucilius (185-103).
Plus jeune que Térence d'une dizaine d'années, Lucilius dut lui succéder dans l'intimité de Scipion et de Laelius. Une anecdote à laquelle Horace fait allusion le montrait jouant avec Scipion et le poursuivant autour de la table à coups de serviette en attendant que le légume fût cuit. Il aurait servi sous les ordres de Scipion au siège de Numance en Î34-133. Il était un Italien de Suessa Aurunca en Campanie à la frontière du Latium. Chevalier et indépendant, il écrivit ; pour sa satisfaction personnelle, quelque démon sans doute le poussant. Il ne commença d'ailleurs à publier que fort tarif vers 131, quelques années seulement avant la mort de Scipion. Ses satires sont l'œuvre de vieillesse de ce cercle dont les comédies de Térence avaient marqué la noble adolescence. La Satire, selon le mot bien connu et si souvent discuté de Quintilien, serait tout particulièrement romaine. Le genre sans doute est latin ; on ne lui trouve pas de modèle dans la littérature grecque. A Rome au contraire Lucilius rencontrait l'exemple d'Ennius et de Pacuvius qui, eux-mêmes, se rattachaient peut-être à quelque tradition de fantaisie parodique et critique d'origine indigène. Après lui, Varron, dans ses Satires Ménippées, mélange prose et vers et en même temps, sans doute, toute sorte de sujets. Horace, qui se réclame en mainte occasion de Lucilius tout en ne se faisant pas faute de le critiquer, donne sa forme définitive à la satire littéraire. Juvénal en exaspère l'âpreté et y introduit, suivant le goût de son temps, la déclamation tandis que Pétrone dans son Satyricon en fait une revue comique des ridicules de l'époque. Issue peut-être originairement de la forme dramatique, la satire aboutit avec lui au genre nouveau du roman.
Mais si la forme est latine, on ne saurait être aussi nettement affirmatif en ce qui concerne le fond. La satire comporte au moins chez Lucilius et chez Horace, deux éléments distincts : la médisance et !e développement moral. La médisance est de tous les temps et de tous les pays. Il ne semble pas que le vieux Latium en ait été le moins du monde exempt. Mais elle fleurit en Grèce comme genre littéraire dans l' ïambe et dans la comédie ancienne qui ne craignait pas d'appeler par leur nom les personnages connus qu'elle tournait en ridicule. Horace lui-même le rappelle (1). Quant au développement moral, la philosophie grecque dans toutes ses écoles en donnait d'abondants exemples. Le maître conversait chaque jour de sujets variés avec ses disciples comme fait Lucilius avec ses lecteurs. Il devait parfois être amené à tourner en dérision le système adverse ou même la personne de tel ou tel philosophe de la secte voisine. L'un de ces philosophes, Timon de Phlionte, vers la fin du IV ème siècle, avait laissé un poème de railleries dans lequel il passait en revue pour les ridiculiser tous les systèmes, sauf celui de son maître le sceptique Pyrrhon. On ne voit pas cependant qu'aucun ait jamais songé à illustrer pour ainsi dire ses leçons de morale par le portrait plaisant des ridicules ou des vices de son temps. La nouvelle Académie, pour laquelle aucune vérité n'était certaine, devait se trouver particulièrement disposée à la moquerie envers le dogmatisme des Stoïciens ou la foi des Epicuriens. Or Lucilius fut en relations particulièrement étroites à Rome avec l'un des chefs de cette école, Clitomaque, qui lui dédia l'un de ses traités. Mais qu'était ce traité ? Quel était le genre d'esprit de Clitomaque? Lucilius prit-il chez les philosophes grecs son goût de la dissertation morale présentée sous forme plaisante et agrémentée d'attaques personnelles visant à faire rire le lecteur ? Ne se contenta-t-il pas tout simplement d'imiter Ennius et Pacuvius ? Quintilien sans doute pouvait en juger, lui qui se trouvait en mesure de lire Ennius et Lucilius et de connaître, autrement que par des « on dit » assez vagues, les philosophes contemporains de ces poètes. Userait, de notre part, présomptueux de le contredire.
(1) Hor., Sat., 1,4, 1 sq.
N'avons-nous pas vu que chez Scipion, comme chez son père Paul-Emile, la tradition latine et la culture grecque étaient tenues en égal honneur? Epargnons-nous la peine, d'ailleurs vaine, de chercher à séparer ce que Lucilius trouvait indissolublement uni. Autant que nous en pouvons juger par ce qui nous en est dit et par les fragments qui en ont subsisté, les trente livres Satires de Lucilius n'étaient pas sans quelque parenté avec la comédie de Térence. La satire est plus abstraite que la comédie en ce qu'elle disserte, mais elle disserte surtout de morale ; elle décrit les travers que la comédie met en action. Elle émaille ses développements de portraits plaisants, d'anecdotes, parfois même de petits dialogues destinés à faire rire. Elle est, en cela, plus précise et plus réaliste que la comédie. Ce n'est pas, par exemple, l'avarice ou l'avare qu'elle met en jeu, c'est tel ou tel personnage, nommément désigné, qui était avare. Elle représente l'application à la vie, l'épreuve expérimentale, peut-on dire, de la philosophie morale et de la psychologie qui, chez Térence, animaient la comédie.
C'est cette précision réaliste, ce sont ces portraits, ces peintures d'actualité qui, dans la Satire, pouvaient paraître originales et particulièrement romaines. Elles durent assurer le succès de l'œuvre de Lucilius ; elles en feraient, pour nous, le vif intérêt. Quelle mine abondante de renseignements ne nous fourniraient ces chroniques dans lesquelles, sur ses vieux jours, le poète rapportait l'expérience de sa vie, ses réflexions et ses observations sur ses contemporains I Le style en était lâche et l'art médiocre, dit Horace. Mais l'ensemble devait en être vivant et constituerait un précieux document sur ce moment que Cicéron considérait comme l’âge d’or de la République et sur cette société encore fidèle aux vieilles maximes et déjà pénétrée cependant de pensée grecque. De tous les poètes latins, Lucilius est peut-être celui dont nous devons le plus amèrement regretter la perte.
CHAPITRE V
DES GRACQUES A LUCRÈCE L'ACTION ET LA PENSÉE
I
le STOÏCISME ET LA RÉVOLUTION SOCIALE.
Tandis que, cantonné dans le domaine de la morale, Lucilius satirisait en paix, la vie de Scipion Emilien, commencée sous des auspices si favorables et longtemps si heureuse, s'achevait dans le drame. Un matin de l'année 129, on le trouva mort dans son lit ; il avait été, fort probablement, assassiné. Rome était en effet en pleine révolution sociale ; les Gracques avaient engagé contre l'aristocratie une lutte sans merci. Des hommes foncièrement honnêtes comme Scipion, mais timorés et soucieux avant tout de la juste mesure, encouraient également les colères des deux partis. Les temps étaient passés du noble idéal de Xénophon et de l'aimable éclectisme de Panaetius.
Un siècle de gouvernement essentiellement aristocratique avait assuré la puissance politique de Rome sur le monde méditerranéen. Il avait enrichi la capitale de toutes les dépouilles des vaincus mais ruiné à tout jamais l'édifice social de l'ancienne Rome. La véritable plèbe urbaine n'existait plus, remplacée aux carrefours et jusque sur le Forum, par lesfils de Daos devenus citoyens. La petite propriété rurale avait disparu, ruinée par la concurrence étrangère; elle se trouvait peu à peu absorbée par les latifundia de l'aristocratie sénatoriale. Mais le Sénat lui-même avait affaire à une classe nouvelle, enrichie par le grand commerce et chaque jour plus puissante, celle des chevaliers, qui aspirait à lui enlever ou du moins à partager avec lui le pouvoir politique. Aussi bien que les sénateurs, ces financiers comprenaient quelle belle chose c'était, selon le mot de Cicéron, que de commander au monde. Dans ce chaos d'hommes et d'intérêts nouveaux, que restait-il de l'ancienne Rome ? Quelques idées et des sentiments qui trouvaient leur force et comme leur nourriture dans la spéculation philosophique grecque.
Entre le vieil esprit latin et la culture intellectuelle de la Grèce n'existait pas en effet l'incompatibilité qu'avait imaginée Caton. La poésie d'Homère et la littérature athénienne du V ème siècle exprimaient le génie d'un peuple courageux et entreprenant. Quant à la nouvelle littérature, celle de la Grèce privée de sa liberté, elle recueillait quelques-unes au moins des plus nobles traditions d'un grand passé. La curiosité scientifique et le souci des choses morales pouvaient se concilier avec l'activité pratique chère aux vieux Romains. Certaines formes de la pensée grecque la plus récente présentaient même, une affinité singulière avec le caractère absolu, la rigidité et d'énergie un peu rude de l'antique Latium. Telles étaient en particulier les doctrines stoïciennes.
Le développement du Stoïcisme à Athènes et en Grèce, au III ème siècle avant notre ère, représente, comme il le fera plus tard dans Rome impériale, une protestation des âmes généreuses contre l'avilissement présent. La vigueur sans nuances et sans ménagements d'une pensée outrancière semblait une sorte de compensation à l'inertie imposée par les circonstances politiques. Zenon plaçait le souverain bien dans l'effort vers la beauté morale. Il préconisait dans la vie l'usage de la raison pour atteindre la tempérance, le courage, la justice. Une telle morale ne faisait que codifier, pour ainsi dire, les principes du vieil idéal romain. A la simple pratique de la vertu, le Stoïcisme ajoutait quelque chose de plus noble encore, à savoir un fondement rationnel et un but idéal. Le développement de sa pensée apportait en outre des principes nouveaux et généreux. La raison étant le partage commun des hommes, tous, quelle que soit leur naissance, se trouvent égaux, et puisque la vertu est l'unique mérite, elle confère à tous les sages, quelle que soit leur condition, la même dignité éminente. Aux séparations de caste, aux distinctions de rang social, le stoïcien oppose la justice universelle. Il pouvait apprendre aux Romains le respect des vaincus et la charité à l'égard des malheureux.
Les stoïciens ne restreignaient pas d'ailleurs leurs spéculations à la métaphysique et à la morale. Ils traitaient également de la politique et nous savons qu'ils n'hésitaient pas, le cas échéant, à s'y mêler, essayant de faire prévaloir leur idéal égalitaire et absolu. L'ardeur démocratique des Gracques tient également des vieilles traditions latines et des leçons stoïciennes.
Les Gracques n'étaient pas, en effet, des hommes nouveaux. Ils appartenaient à l'élite de l'aristocratie romaine. Leur père, Sempronius, était un ami et un partisan résolu du vieux Caton ; leur mère Cornelia était la fille de Scipion l'Africain ; ils trouvaient dans leur famille les mêmes traditions que Scipion Emilien ; ils étaient à même de recevoir avec le même profit que leur aîné les leçons de la Grèce. Ce ne fut pas un Panaetius qu'ils rencontrèrent, mais un stoïcien, le philosophe Blossius, qui demeura fidèlement attaché à Tibérius, le seconda dans son œuvre et, après la mort du premier des Gracques, fut impliqué dans les poursuites dirigées contre ses partisans.
Lorsque Tibérius Gracchus s'adresse au peuple, ne craignant pas, pour soulever ses passions, d'étaler à ses yeux ses griefs et ses souffrances, on entend l'écho, dans sa harangue, à la fois des anciens tribuns de la plèbe et des leçons du Portique. Le fragment que nous a transmis Plutarque révèle, en tout cas, un puissant orateur !
Les bêtes sauvages ont leurs tanières et ceux qui meurent pour la défense de l'Italie n'ont d'autre bien que l'air qu'ils respirent. Sans toit pour s'abriter, ils errent avec leurs femme» et leurs enfants. Les généraux vous trompent quand ils vous exhortent à combattre pour vos temples, pour vos dieux, pour les tombeaux de vos pères. De tant de Romains, en est-il un qui ait son autel domestique et son tombeau familial ? Vous ne combattez et ne mourez que pour nourrir l'opulence et le luxe d'autrui. On vous appelle les maîtres du monde et vous n'avez pas en propriété une motte de terre.
Les exemples de l'histoire grecque n'ont pas moins de part à la tentative des Gracques que les leçons de la philosophie. Tibérius, inspiré par Blossius, semble avoir espéré tout d'abord provoquer à Rome le même mouvement d'idéalisme généreux qu'avait réalisé à Sparte, environ un siècle auparavant, le roi Agis assisté du philosophe stoïcien Sphairos. Agis avait tenté de régénérer sa ville en mettant un terme à la monstrueuse inégalité des fortunes. La révolution avait glissé dans le sang el l'anarchie, mais elle avait eu d'admirables débuts. On avait vu toute une jeunesse enthousiaste et, au premier rang, les femmes, faire abandon de leurs biens sur l'autel de la patrie. Tibérius attendait peut-être de ses compatriotes le même désintéressement.
Caius, de son côté, s'inspire nettement de Periclès. «Son pouvoir, dit G. Bloch, c'est une monarchie personnelle fondée sur l'opinion, issue du suffrage et en relevant, une monarchie à la Périclès. » Le souvenir du grand Athénien parait diriger constamment sa pensée. « La loi frumentaire, par exemple, qui substitue l'État aux nobles dans les libéralités à la multitude et, par 1à, affranchît les votes, paraît inspirée du système des salaires par lequel Périclès essaya de combattre l'influence de l'opulent Cimon. Les grandes constructions ordonnées par l'État étaient, pour le prolétariat, comme un complément de cette loi. Et de même qu'à Athènes, la constitution se trouvait, à Rome, sinon violée, du moins faussée par le prestige de l'éloquence et du génie et par la concentration entre les mêmes mains de tous les ressorts du gouvernement. » Le principe de la révolution tentée par les Gracques était généreux, le succès en aurait peut-être sauvé la République. L'échec en incombe, non pas aux Gracques ni à leurs maîtres ou à leurs modèles grecs, mais à l'aristocratie romaine dont l'égoïsme n'était pas à même de comprendre leur conception, et au peuple lui-même, déjà trop avili, trop habitué à l'oisiveté et aux distractions de la ville, pour donner et surtout pour soutenir l'effort nécessaire à sa régénération. Après la mort de Caius Gracchus, le seul souci de l'intérêt matériel et immédiat domine toute la politique romaine. En 111 commence la guerre contre Jugurtha. En 91, la guerre sociale éclate en Italie et, aussitôt après, celle de Mithridate, en Asie. Marius et Sylla se trouvent aux prises, aussi dépourvus de tout idéal l'un que l'autre ; les guerres civiles et les proscriptions vont se prolonger durant un demi-siècle, jusqu'au principat d'Auguste.
II
lucrèce.
C'est durant cette période de troubles et de passions exaspérées que naissent les grands écrivains de l'époque républicaine: Cicéron en 106, César en 100, Lucrèce vers 98, Salluste en 86, Catulle en 84.
Du personnage de Lucrèce et de sa vie, nous ne savons rien, ou presque. Une glose de Donat, commentateur de Virgile, reposant sur l'autorité de Suétone, nous fournit les dates approximatives de sa naissance (98) et de sa mort (54 av. J.-C.). Ajoutons-y, pour mémoire, l'indication des plus suspectes, provenant de saint Jérôme, d'un Lucrèce affolé par un philtre d'amour, écrivant son poème dans l'intervalle de ses crises et se suicidant à quarante-quatre ans. Achevée mais non terminée, c'est-à-dire amenée à sa perfection, l'œuvre fut publiée, de façon d'ailleurs assez négligente, par Cicéron, aussitôt après la mort du poète.
Sans qu'il parle jamais de lui-même, Lucrèce apparaît cependant à travers son œuvre. La sagesse qu'il chante, l'apaisante doctrine d'Epicure, n'est pas le fruit de l'indifférence et d'une heureuse propension à jouir sans trouble des joies de la vie. Elle est, pour lui, objet de passion. Savoir et comprendre apparaît chez lui comme la consolation d'une nature ardente qui n'a pu agir ou qui n'a pas daigné le faire.
La soif de l’or, DISAIT Salluste, puis celle du pouvoir furent la source de tous les maux. L’avidité ruina la bonne foi, la probité et toutes les autres vertus. A leur place, elle enseigna l'orgueil, la cruauté, le mépris des dieux, la vénalité sans bornes. L'ambition fit prendre un masque à la plupart des hommes ; on eut une pensée cachée au fond du cœur, une autre sur les lèvres ; la haine et l'amitié ne furent plus un sentiment, mais un calcul; l'honnêteté se porta sur le visage et non dans le cœur... — Une cupidité sans mesure envahit tout, profana tout, ravagea tout: elle ne respecta rien, n'eut rien de sacré et finit par se précipiter elle-même dans l'abîme.
Lucrèce, lui aussi, a vu ses contemporains « verser le sang des citoyens pour grossir leurs richesses, l'avidité doubler les fortunes en accumulant meurtre sur meurtre, la cruauté se réjouir des tristes funérailles d'un frère, les parents redouter et fuir la table de leurs proche. »Il a eu sous les yeux le spectacle de l'envie et de la trahison. L'ambition lui a paru le travail de Sisyphe,
qui s'acharne à briguer auprès du peuple les faisceaux et les haches redoutables et qui toujours se retira, vain et plein d'affliction... Car solliciter le pouvoir, qui n'est qu'illusion et n'est jamais donné et, dans cette recherche, supporter sans cesse de dures fatigues, c'est bien pousser avec effort sur la pente d'une montagne un rocher qui, à peine au sommet, retombe et va aussitôt rouler en bas dans la plaine.
Peut-être lui-même, un jour, a-t-il essayé ce travail. Il en a, en tout cas, répudié la vanité. Ce n'est pas cependant une égoïste indifférence qui lui inspire le début de son second chant ; la fin du passage l'indique suffisamment.
Il est doux, quand sur la vaste mer les vents soulèvent les flots, d'assister de la terre aux rudes épreuves d'autrui, non que la souffrance de personne soit un plaisir aimable, mais voir à quels maux on échappe soi-même est chose douce... Mais rien n'est plus doux que d'occuper solidement les hauts lieux fortifiés par la science des sages, régions sereines, d'où l'on peut abaisser les yeux sur les hommes... O misérables esprits des hommes, ô cœurs aveugles ! Dans quelles ténèbres et dans quels dangers s'écoule ce peu d'instants qu'est la vie !
Lucrèce est un Romain qui souffre profondément des maux de sa patrie et qui voudrait les guérir. Il a trouvé lui-même la paix dans la sagesse d'Epicure. C'est pourquoi il passe les nuits au travail pour enseigner à ses concitoyens le remède qui les sauverait.
Veuille donc, ô divine, dit-il dans sa prière du début à la mère des Enéades, veuille, ô Vénus, donner à mes vers une éternelle beauté. Obtiens que les farouches travaux de la guerre, à travers mers et terres, s'apaisent assoupis. Car toi seule as le pouvoir de réjouir les mortels par une paix tranquille, puisqu'aux farouches travaux, c'est Mars qui préside. Et lui-même, souvent, vient chercher asile sur tes genoux, vaincu à son tour par la blessure éternelle de l'amour.
L'art et la beauté doivent prêter leur charme à la sagesse pour ramener les hommes de leurs erreurs et apaiser leurs maux.
L'histoire nous a conservé le souvenir des ambitieux et de leurs comparses, de leurs luttes et de leurs crimes. Elle a laissé dans l'oubli tous ceux qui, comme le poète, restèrent dans l'ombre, soit par impuissance, soit par raison et par vertu tous ceux qui ne firent que subir les maux de l'époque et en souffrirent matériellement et moralement. Ceux-ci cependant furent de beaucoup les plus nombreux tant à Rome qu'en Italie et dans les provinces. Que pensèrent-ils ? Comment cherchèrent-ils à comprendre leur temps et à se comprendre eux-mêmes; comment réagirent-ils, au moins dans leur conscience et dans leur esprit, aux luttes frénétiques dont le monde entier était le théâtre? Ce sont eux vraiment qui représentent la civilisation de l'époque. Et leur influence dut être considérable, puisque sans elle on ne saurait s'expliquer la retraite que tout à coup, en plein succès, s'imposent un Sylla et un Lucullus ou que garda toute sa vie un sage comme Atticus. C'est évidemment le sentiment de beaucoup de Romains, c'est celui qui dut inspirer Lucrèce lui-même et qu'exprimé Salluste lorsque, réduit par force à l'inaction, il déclarait :
« Les magistratures et les commandements militaires, en un mot toutes les charges publiques et toute action politique me semblent, en ce moment, infiniment peu désirables. »
Lucrèce apparaît comme le porte-parole de ces désabusés. Mais dans la retraite fortifiée par la doctrine des sages il apporte toute la passion de ceux qui luttent dans la plaine. A la sagesse que lui enseigna Epicure, il prête toute la tenace insistance du vieux tempérament romain. Il partage l'ardeur frénétique de son temps ; il la dirige non vers l'ambition, mais vers la vérité. Sa philosophie est toute grecque, mais le ton dont il la prêche ne l'est certainement pas. Peu importe que la vérité acceptée d'un cœur aussi fervent soit celle d'Épicure ou du Portique. L'essentiel, dans le poème de Lucrèce, nous paraît cette adhésion passionnée à un idéal tout intellectuel. C'est le même absolutisme farouche des convictions qu'il nous semble reconnaître dans la sombre austérité de Caton d'Utique, peut-être même jusque dans le crime d'un Brutus et d'un Cassius. Pour ces Romains, comme le dit Cicéron en se moquant de Caton, les idées philosophiques ne sont pas seulement une matière à discussion, elles deviennent vraiment des règles de vie, des principes d'action.
Une conséquence de cette adhésion complète de l'âme à une doctrine philosophique est la logique sans restriction et sans réticence qui dirige le développement des principes. Le raisonnement suit son cours imperturbable, aucune considération étrangère à la doctrine elle-même ne le fait dévier. Lucrèce s'est préparé, pour ainsi dire, une âme complètement neuve, un cœur de néophyte ; il a fait table rase de toutes les opinions traditionnelles. C'est une doctrine purement scientifique et exclusivement rationnelle qu'il appelle à régler toutes les croyances et toute la vie de l'homme.
La cause première de tous les vices humains, de ceux en particulier qui font le malheur du siècle, c'est l'ignorance. L'homme ne connaît pas la nature, il ne se comprend donc pas lui-même ni les conditions et les limites de son existence. Le poème doit apporter l'explication de toute la nature. L'intelligence délivrera l'homme de ses erreurs, de ses vains soucis, elle lui épargnera les efforts inutiles et les crimes. La morale est le but de toute connaissance.
Ce point de vue est commun à tous les systèmes philosophiques de ce temps. Mais ici intervient, chez Lucrèce, le principe purement matérialiste de l'épicurisme. L'univers n'est que matière; la matière se compose uniformément d'atomes, d'atomes divers, plus ou moins subtils mais qui obéissent tous aux mêmes lois. Ils tombent uniformément à travers le vide infini; leur déclinaison amène les rencontres qui constituent les différents corps. Rien n'est jamais créé de rien ; tous les corps doivent leur naissance à des germes spécifiques. Les loisqui les régissent sont absolues et sans exception. Rien ne retourne au néant. Si pendant toute la durée des temps écoulés il s'est trouvé des éléments propres à reformer sans cesse notre univers c’est que ces éléments sont doués d’une nature immortelle. Tels sont les dogmes posés dès le premier chant. Tout le reste de la doctrine en découle par voie de conséquence.
Les propriétés des atomes et le mécanisme de leurs combinaisons diverses suffisent pour rendre compte de tout l'univers, de notre monde « avec les races des fauves errant sur les montagnes et la descendance des hommes et les troupes muettes des poissons écailleux et les diverses sortes des races ailées », des autres mondes aussi qui en nombre infini gravitent dans l'espace. Point n'est besoin pour expliquer leur existence de l’intervention des dieux ni d'une Providences.
« Ces vérités connues, aussitôt la nature t'apparaît libre, exempte de maîtres orgueilleux, accomplissant son œuvre d'elle-même, spontanément et sans contrainte» Les dieux existent sans doute, mais ils ne peuvent être que matière comme tout le reste de la nature. « Dans une paix inaltérable, ils mènent une vie sans trouble et une paix sans nuage. » Leur action sur le monde est nulle. Qui pourrait, en effet régir l'ensemble de cette immensité, qui pourrait tenir d'une main assez ferme les fortes rênes capables de, gouverner l’infini ? Qui pourrait faire tourner de concert tous les cieux échauffer des feux de l'éther toutes les terres fertilisées, se trouver en tout temps, en tous lieux, toujours prêt à faire les ténèbres avec les nuages, à ébranler du tonnerre les espaces sereins du ciel, lancer la foudre, démolir parfois son propre temple et, se retirant dans les déserts s’y exercer furieusement à jeter ce trait qui, souvent, passe à côté des coupables et va, par un châtiment immérité, priver de la vie des innocents ?
La nature de l'âme n'est point autre que celle du reste de l'univers. L'âme est matière, comme le reste, produit d'une combinaison d'atomes, plus subtils seulement que ceux qui forment le corps; elle n'est qu'une partie du corps, naît comme le corps, meurt comme lui et avec lui. Pourquoi donc craindre la mort ? Elle n'est rien pour nous, elle ne nous touche en rien. Nous; existons, elle n'est pas; elle survient, nous ne sommes plus. De même que, dans le passé, avant que nous ne fussions, nous n'avons point senti de douleur, de même nous n'avons rien à redouter ni à espérer d'un avenir où nous ne serons plus. Et tout le chant s'achève à tirer les conséquences de ce néant. Insensées les lamentations, vains les soins des funérailles ! Que t'importe que ton corps soit broyé par la mâchoire des fauves ou rôti sur le bûcher, ou mis dans le miel qui vous étouffe, ou raidi par le froid sur la pierre glacée du tombeau, ou enfin écrasé et broyé sous le poids de la terre qui vous recouvre ? Quant aux châtiments infernaux, ce ne sont que légendes ou symboles. La mort est la loi commune; la craindre n'est qu'un effet de l'ignorance; la vie, du reste, n'est rien en comparaison de l'éternité ; tous deux seront aussi longtemps à ne plus être, celui dont la fin date d'hier et tel autre qui est mort depuis bien des mois et des années.
La vie psychologique de l'homme, ses illusions, ses sensations, s'expliquent en fonction de la nature matérielle et de lui-même et du monde. C'est là l'objet du chant quatrième tout entier, qui se termine par l'analyse de l'amour. La sagesse est d'éviter la passion qui n'est qu'égarement et servitude. Et là, toute la prudence austère du vieux Romain vient confirmer l'aversion du philosophe pour ce sentiment qui trouble la paix de l'âme.
Ceux qui cèdent à l'amour se consument et succombent à la peine ; leur vie se passe sous le caprice d'autrui; leur fortune se fond et se dissipe en tapis de Babylone, leurs devoirs sont négligés, leur réputation chancelle et faiblit... Les biens honorablement acquis de leurs pères sont convertis en bandeaux, en mitres, en robes de femmes, en étoffes d'Alinde ou de Cios. Ce ne sont que banquets... jeux, coupes sans cesse remplies, parfums, couronnes, guirlandes. — Vains efforts! De la source même des plaisirs, surgit je ne sais quelle amertume qui prend l'amant à la gorge...
Un tel discours n'aurait pu que plaire à Caton le Censeur, le confirmant, comme dit Plutarque, dans l'amour de la tempérance.
Après l'homme, Lucrèce entreprend d'expliquer les phénomènes de la nature. C'est la physique, c'est l'histoire aussi, ou du moins la préhistoire, considérée comme un phénomène naturel, et exposée d'une façon purement rationnelle dont la précision concorde en somme, dans ses grandes lignes, avec les constatations de la science expérimentale moderne. C'est aussi l'histoire de l'origine du langage. La parole, enseigne Lucrèce, fut inventée peu à peu, par l'instinct et par le besoin, et non pas par quelque individu de génie qui aurait donné son nom à chaque chose. La création des diverses techniques et de la civilisation, les origines de la musique, de la science, de l'écriture, de la poésie, tout s'explique par un progrès naturel et lent, sans merveille ni miracle.
Navigation, culture des champs, fortifications, lois, armes, routes, vêtements et tous les autres gains de ce genre, comme aussi tous les raffinements du luxe, poèmes, tableaux, statues d'un art achevé, c'est l'usage et aussi les efforts opiniâtres et les expériences de l'esprit qui peu à peu les enseignèrent aux hommes par la lente marche du progrès. C'est ainsi que pas à pas, le temps amène au jour chaque découverte que la science dresse en pleine lumière...
Le dernier chant ressemble à quelque appendice où se trouveraient rassemblés différents passages destinés à prendre place dans le cours du poème. Il y est question surtout des phénomènes de la météorologie, des volcans, des eaux et de leur régime, et enfin des maladies. L'œuvre se termine par ce tragique tableau de la peste d'Athènes, triste sortie d'un poème sans joie, mais plein de beauté et de grandeur.
L'intérêt de l'œuvre ne consiste plus, pour nous, dans l'exactitude plus ou moins grande des résultats proclamés acquis par Lucrèce. Cette science n'est, en substance, que celle de Démocrite, reprise telle quelle par Epicure. Nous ne saurions distinguer si Lucrèce en a précisé quelque trait. La partie physique en paraît enfantine, mais les problèmes métaphysiques demeurent aujourd'hui encore l'objet de nos recherches incertaines, et ceux qui touchent à l'homme, à la naissance, à la mort, n'ont guère reçu de réponse plus décisive. L'originalité de l'œuvre et sa nouveauté à Rome, c'est la hardiesse et la vigueur de ce rationalisme pur qui, par le seul jeu du raisonnement, prétend apporter l'explication de toute chose.
C'est là une étape de !a connaissance humaine qui nous apparaît, chez Lucrèce, marquée de façon tout particulièrement nette. Le poète latin y est parvenu en suivant la voie toute tracée par son maître grec. Il s'est trouvé ébloui par la clarté de ce sommet. De là, il découvre l'univers ; il annonce comme nouvelle pour Rome la conception qu'il en rapporte et l'oppose aux mirages anciens, incohérents et, en partie déjà, dissipés par les souffles venus de Grèce.
La curiosité de l'homme devant la nature s'est tout d'abord satisfaite par le mythe. Fils de l'imagination, — du sentiment, si l'on préfère ce nom, — le mythe est la réponse, toute prête, à ces grands problèmes métaphysiques que nous ne pouvons ignorer et dont la solution nous échappe. Le mythe romain c'étaient ces dieux innombrables et modestes partout en fonction. Il n'en est plus question chez Lucrèce : il était périmé C'est le mythe grec, mi-poétique mi-philosophique, qui, clés lors, symbolise l'erreur ancienne. Contre lui, Lucrèce ne fait que répéter les diatribes d'Epicure, mais cette critique d’origine grecque frappe sans aucun doute les conceptions courantes à Rome de son temps. Ce n'est pas tel ou tel dieu que combat Lucrèce, c'est la conception mythique et religieuse du monde. Il lui oppose la conception rationnelle.
Semblables aux enfants qui tremblent et s'effrayent de tout dans 1es ténèbres aveugles, — répète t-il à plusieurs reprises — nous-mêmes, en pleine lumière, souvent nous craignons des dangers aussi peu terribles que ceux que ceux que leur imagination redoute et croit voir s'approcher dans la nuit. Cette terreur, ces ténèbres de l'âme, il faut que les dissipent non les rayons et les traits lumineux du jour, mais la vue de la nature et son explication.
La religion officielle romaine était, en réalité, indépendante de cette mythologie. Son caractère formaliste, le génie méthodiques des Pontifes qui avait présidé à sa constitution, en avaient exclu les effusions sentimentales et les terreurs de l'âme. Elle prêtait cependant aux dieux des « actions merveilleuses et des colères cruelles»; elle tenait grand compte des prodiges et s'ingéniait àles expier. Elle se prêtait en outre à la contamination des rites étrangers, grecs ou même orientaux. Après la grande Mère des Dieux de Pessinonte, c'était la cappadocienne Ma, sanglante et lubrique, que Sylla et ses soldats avaient introduite à Rome. Tous ces cultes, ceux de la Rome ancienne, ceux de la Grèce ou de l'Orient, n’exerçaient plus, sans doute, grande action sur les esprits. La tendance à l'incrédulité était générale durant lé dernier siècle République. Mais cette incrédulité, loin d'exclure la superstition, ne faisait que lui abandonner la place. Les religions de mystère multipliaient le nombre de leurs adeptes. De Délos et de Pouzzoles, les grands ports où l'Orient se mêlait à l'Italie, Sérapis et Isis, leurs prêtres et leurs dévots, envahissaient la nouvelle capitale du monde méditerranéen. Marius conduisait avec lui, dans toutes ses campagnes, sa prophétesse syrienne, Marina. Sylla, que le respect des dieux n'arrêtait guère lorsqu'il s'agissait de piller leurs sanctuaires (1), n'en portait pas moins sur lui une petite statuette d'Apollon qu'il invoquait et baisait aux moments critiques. « Tes légions en manœuvre dans la plaine, tout l'appareil de la guerre, met-il en fuite les superstitions effrayées, délivre-t-il ton âme des terreurs de la mort, te fait-il un cœur libre et dégagé detout souci (2)? »
Religions de toute origine et de tout caractère, superstitions diverses, tout procède de la même erreur, tout est également condamnable et funeste. « O race infortunée des hommes, que de gémissements vous êtes-vous préparés à vous-mêmes » en inventant les dieux, « que de plaies pour nous, que de larmes pour nos descendants (3) ! ».
Les dieux existent sans doute ; il ne s'agit pas de déserter leurs temples, mais simplement de s'y présenter le cœur tranquille.
Les dieux ne sont pas des maîtres cruels acharnes à le nuire... Cesse de leur faire outrage en leur attribuant des soins indignes d'eux. C'est ton erreur qui t'empêche d'accueillir dans le calme etl'apaisement de ton âme ces images idéales de beauté qui émanent de leur auguste corps (4).
La véritable piété, c'est de connaître et de comprendre cette nature dont les dieux ne sont qu'une part.
La piété, ce n'est point se montrer à tout instant couvert d'un voile et tourné vers une pierre et s'approcher de tous les autels. Ce n’estpoint se pencher jusqu'à terre et se prosterner, tendre les paumes ouvertes en face des sanctuaires divins ; ce n'est point inonder les autels du sang des animaux ou lier sans cesse des vœux à d'autres vœux. La piété, c'est bien plutôt de pouvoir tout regarder d'un esprit que rien ne trouble (5).
(1) plut-, Sulla, 29.
(2) 2, 40 45
(3) 5, 1191 sq.
(4)6, 63sq. –
(5)5, 1198sq.
Ne nous étonnons plus, dès lors, de cette belle et pieuse invocation à Vénus, volupté des dieux et des hommes, par laquelle s'ouvre le poème ou d'un tableau tel que celui du triomphe de Cybèle, mère des dieux, mère des espèces sauvages et créatrice de l'humanité (1). L'intelligence des dieux procure à l'homme la joie de leur beauté parfaite. L'erreur seule des conceptions primitives et irrationnelles cause le trouble et le crime.
La noblesse de cette philosophie, c'est de proposer un idéal à un monde qui n'en avait plus. Le mos majorum, la tradition ancestrale enseignée et maintenue par la famille était oublié. La cité agrandie et élargie n'imposait plus aux citoyens une raison de vivre. A des intelligences qui désormais embrassaient le monde, les vieux mythes et les vieux rites, les froides cérémonies du culte officiel, n'apportaient plus satisfaction. Les croyances vacillaient entre le néant et les aberrations du mysticisme. Chez beaucoup, la morale demeurait sans doute une habitude et comme un souvenir pieux; ce n'était qu'une règle tout individuelle, dénuée de fondement et de sanction. Dans ce chaos dont il souffre et auquel il attribue justement les maux de sa patrie, Lucrèce aperçoit la vérité nouvelle qui restaurera l'ordre. L'intelligence lui est apparue comme la souveraine maîtresse de mesure et de sagesse. Le triomphe de la raison, voilà la grande espérance qui anime et inspire son enthousiasme.
La paix du sage, l'aimable laisser-aller de celui qui sait, lai joie de vivre de qui comprend la nature et sa beauté, tel est l'idéal qu'il veut révéler. Mais la tâche est rude, car la vérité est obscure et l'erreur tenace. Le poète se propose sans doute de garnir les bords de la coupe d'un miel blond et sucré (2). Mais son ardeur impérieuse l'emporte sur ses promesses. Contre l'ignorance, ses formules ont la même décision que les vieilles formules du droit. Il s'y ajoute une fleur de passion qui, à cette philosophie fille de la vieille spéculation grecque et de la froide raison, prête la chaleur de l'enthousiasme et la vigueur un peu rude des poésies primitives.
(l) 2, 598 sq.
(2) 1, 936 sq.
Les temples sereins de la science sont pour Lucrèce comme des forteresses qu'il emporte d'assaut. La sagesse est celle d'Epicure, mais le ton en est plutôt celui du stoïcisme ou plus simplement, d'un Romain à l'âme antique qui a trouvé dans la raison l'arme qu'il croit invincible contre les hontes et les vices de son siècle.
CHAPITRE VI
LA SCIENCE ET L'ÉRUDITION
I
la PHILOSOPHIE ET LES SCIENCES.
Dès la fin du ne siècle avant notre ère et, à plus forte raison, durant tout le premier siècle, la pensée grecque telle qu'elle fleurit dans le monde hellénistique contemporain a donc cause gagnée à Rome. L'Italie dans son ensemble est devenue une province de la civilisation méditerranéenne et sa capitale tente de rivaliser, même en ce qui concerne la vie intellectuelle, avec les autres métropoles méditerranéennes.
La philosophie représente le courant principal de cette activité de l'esprit qui vise au savoir. Elle comprend en effet l'ensemble des sciences physiques et naturelles. Le second chant du poème de Lucrèce, par exemple, nous offre un véritable traité de physique. La science ne s'est pas encore dégagée de la métaphysique; elle ne s'est pas constitué une méthode propre, elle ne comporte toujours qu'une série de développements logiques ne reposant que sur des observations superficielles ; son objet se borne en conséquence à des explications plus ou moins fantaisistes des phénomènes et chaque école a les siennes.
Deux ordres de connaissances se sont cependant, dès l'époque hellénistique, constitués en disciplines spéciales indépendantes de la spéculation philosophique, d'une part la science abstraite des mathématiques avec ses applications à l'astronomie et, d'autre part, la science essentiellement pratique qu'est la médecine. Leur progrès à Rome à la fin de l'époque républicaine nous indique pour ainsi dire l'étiage dudéveloppement scientifique.
II
l'astronomie et le calendrier romain.
C'est par l'astronomie et la mesure du temps que les mathématiques conquirent droit de cité. Les Romains voulurent apprendre tout d'abord l'almanach.
On raconte qu'en 263 ils installèrent au Forum le premier cadran solaire ; ils l'avaient enlevé à Catane (1). Catane étant située à quatre degrés au sud de Rome, le cadran, au Forum, était inexact. Les Romains auraient été près d'un siècle avant de savoir faire la correction. Mais en 168, lors de la campagne de Paul-Emile en Macédoine, son tribun C. Sulpicius Gallus aurait été capable d'annoncer une éclipse de lune pour la nuit précédant le jour où l'on devait livrer bataille et de prévenir ainsi la terreur qui n'aurait pas manqué de frapper l'armée (2). Ce même personnage aurait également calculé la distance de la lune à la terre et laissé des ouvrages astronomiques — fort vraisemblablement traduits du grec — admirés de ses compatriotes comme œuvres d'un profond génie (3).
Le calendrier n'en restait pas moins, sous la direction du Collège pontifical, réglé par le pur empirisme et souvent compliqué par l'arbitraire politique. La difficulté provenait surtout du défaut de concordance entre les mois, réglés par le cours de la lune, et l'année, réglée par celui du soleil.
(1) plin., N. H., 7, 213.
(2) Telle est la version de T. live, 44, 37. Il semble plutôt que son rôle se borna à expliquer aux soldats la cause de l’éclipser et à dissiper ainsi leur frayeur. Cf. plut., Paul. Emil., 18; poi.yb., fragm. 29, 6, 8-10; Cic., De Rep., 1, 15; De Senect., 14.
(3) Cic., De off., l, 6; De Rep., 1, 14-16; plin,, N. H., 2, 12,9; 2, 2l, 19,
Douze mois lunaires de 29 jours et demi donnent 354 jours. L'année solaire mesure 365 jours. La différence était de 10 à 11 jours. Les Romains avaient pris le parti de fixer l’année à 355 jours et d'intercaler tous les deux ans entre février et mars un mois tantôt de 22 et tantôt de 23 jours. Le cycle complet, au bout de quatre ans, comprenait donc deux années déficitaires et deux autres augmentées. L'année moyenne ressortait à 366 jours, d'où un mois d'avance tous les trente ans. C'est pourquoi, sans doute, Manius Acilius Glabrio, vainqueur d'Antiochus en 191, au retour de son expédition en Grèce et en Asie, autorisa les Pontifes à faire ou à ne pas faire, à leur gré, les intercalations. Mais ceux-ci n'usèrent de ce droit que pour abréger ou allonger les magistratures, pour léser ou favoriser les fermiers des deniers publics. La confusion dura jusqu'à César.
En l'année 46, César, grand pontife et dictateur, confia au mathématicien grec Sosigenès le soin de rétablir la concordance entre l'année civile et l'année solaire et de fixer les règles que devraient à l'avenir observer les pontifes pour maintenir cette concordance. On se trouvait, à ce moment, en retard de deux grands mois. On inséra donc, entre novembre et décembre, deux mois intercalaires de 67 jours, quoique l'année eût déjà reçu, avant mars, un mois supplémentaire de 23 jours. Cette année 46 compta donc 445 jours. Afin de prévenir le retour de l'erreur, Sosigenès suggéra d'ajouter, tous les ans, 10 jours à l'année lunaire de 355 jours, et César décida de distribuer ces jours supplémentaires entre les mois lunaires de 29 jours, de façon à ce que trois d'entre eux fussent augmentés de deux et quatre autres d'un jour. Il restait encore entre l'année lunaire ainsi rectifiée et l'année solaire une différence d'un quart de jour. Tous les quatre ans on devrait donc en outre ajouter un jour à la fin de février, à la place précédemment occupée par les mois intercalaires.
L'autorité de César imposa la réforme de Sosigenès. Mais les Pontifes eux-mêmes ne la comprirent pas. La preuve en est qu'ils se trompèrent dans l'intercalation du jour supplémentaire. Le texte du décret portait quarto quoque anno ; ils interprétèrent : au début de chaque quatrième année, c'est-à-dire tous les trois ans. De là une erreur qui ne fut corrigée que par Auguste en l'an 8 après Jésus-Christ. La réforme de César intronisait en même temps à Rome un calendrier stellaire fixant le lever et le coucher des astres à chaque jour du calendrier, suivant des observations faites à Alexandrie, qui se trouvaient n'être plus complètement exactes à Rome.
Cette réforme était basée non plus sur l'empirisme, mais sur une science astronomique qui avait calculé exactement l'année sidérale solaire. Elle était œuvre alexandrine. La science en était d'ailleurs imparfaite. Les anciens ne pouvaient se rendre compte, en effet, de la différence entre l'année sidérale et l'année tropique, plus courte en raison de la précession des équinoxes, c'est-à-dire de la rétrogradation annuelle des points équinoxiaux sur l'écliptique. Ils avaient calculé l'année solaire à 365 jours 6 heures, or elle n'est que de 365 jours 5 heures, 48 minutes, 49 secondes, soit une différence annuelle de 11 minutes qui en 129 ans produit un jour d'avance. C’est ainsi qu'en 1582 l'équinoxe de printemps se trouvait tomber le 11 mars. La réforme grégorienne, en supprimant dix jours, le rétablît pour l'année suivante au 2l mars et obvia au retour de cette discordance en modifiant légèrement les intercalations bissextiles (1).
(1) Parmi les années séculaires, on ne compte, comme bissextiles, que celles qui sont divisibles par 400 : 1800 et 1930 n'ont pas été bissextiles, mais 2000 le sera.
Les orthodoxes, qui ont conservé le calendrier romain de Jules César, se trouvent, du fait de l'accumulation des 11 minutes d'écart annuel, en avance sur nous de treize jours.
Il y eut des mathématiciens à Rome, mais c'étaient des Grecs ou de leurs élèves directs. Nous n'y apercevons pas d'école romaine faisant faire quelque progrès à cette science ou seulement lui prêtant un développement digne de remarque. Il y eut cependant bon nombre de Romains initiés aux mathématiques et sachant les utiliser pour la pratique. Qu'on ouvre par exemple le De Architectura de Vitruve, œuvre sans prétention d'un technicien modeste. On y trouvera de nombreux emplois de la géométrie ; on y trouvera aussi, au début, en guise de prologue, un programme des connaissances diverses nécessaires à un architecte, connaissances parmi lesquelles les mathématiques tiennent une place importante. L'architecte doit non seulement être lettré et savoir dessiner, mais il lui faut être instruit en géométrie, n'être pas ignorant de l’optique et bien connaître l'arithmétique... avoir au moins quelques notions de l'astronomie. Les raisons par lesquelles Vitruve justifie ses exigences apparaissent d'ailleurs assez naïves.
L'architecte doit être versé dans les lettres pour dresser de bons mémoires de ce qu'il propose de faire... L» géométrie lui est d'un grand secours particulièrement pour lui apprendre à bien se servir de la règle et du compas, pour prendre les alignements des édifices et dresser toutes les choses à l'équerre et au niveau... L'arithmétique lui sert pour la dépense des ouvrages qu'il entreprend et pour régler les mesures et les proportions qui se trouvent parfois mieux par le calcul que par la géométrie... La connaissance de cette partie de la philosophie qui traite des choses naturelles et qui, en grec, est appelée physiologie, le rendra capable de résoudre quantité de questions diverses, ce qui lui est indispensable en plusieurs cas, notamment lorsqu'il a à établir une conduite d'eau... De plus, l'architecte ne pourrait jamais comprendre, sans une formation scientifique, les traités de Ctesibius, d'Archimède et autres auteurs du même genre... Enfin l'astronomie lui servira pour l'établissement des cadrans solaires, pour la connaissance des points cardinaux, des équinoxes, des solstices et du cours des astres...
L'architecte, précise Vitruve, doit avoir connaissance de toutes ces sciences, mais il n'est ni possible ni même nécessaire qu'il les possède à fond. Tel est bien le point de vue romain, celui qu'admettait déjà Caton à propos de la pensée grecque en général : il est bon, parce qu'il est avantageux, d'en avoir notion, mais il est inutile de s'y plonger. Laissons les Grecs se spécialiser et inventer, bornons-nous à recueillir le bénéfice de leurs découvertes. En tout art, conclut Vitruve, il y a la théorie générale que chacun peut connaître et la pratique réservée au spécialiste.
Les Grecs ont travaillé pour l'amour de la science. Les Romains aussi ont aimé la science, mais pour eux-mêmes, non pour elle; ils ont estimé surtout le profit qu'ils en pouvaient tirer. Aussi n'ont-ils jamais été de vrais savants.
III
la MÉDECINE.
Il y eut ainsi des médecins à Rome, Grecs pour la plupart, mais aussi Romains ; il n'y eut pas de science médicale romaine.
La médecine et la chirurgie grecques étaient fort avancées. Elles atteignaient, à l'époque alexandrine, à peu près le niveau auquel elles se trouvaient chez nous vers le milieu du siècle dernier, alors qu'elles demeuraient des arts expérimentaux. Les trouvailles d'instruments chirurgicaux, à Pompéi et les écrits latins nous montrent que l'Italie et Rome les avaient entièrement adoptées.
Pline raconte l'histoire du médecin péloponnésien Archagatos qui, au moment de la seconde guerre punique, en 219, vint s'établir à Rome. L'émerveillement que causèrent ses opérations chirurgicales fut tel qu’on lui donna le droit de cité et qu'une résidence lui fut attribuée par l'État. On le logea à son hôpital... Mais plus tard, « sa furie de couper et de brûler le fit traiter de bourreau » et aurait contribué à l'impopularité de la médecine et des médecins, impopularité dont nous recueillons l'écho dans les invectives du vieux Caton : « Les Grecs se sont juré entre eux d'exterminer tous les Barbares par la médecine ; le comble est qu'ils se font payer pour cette besogne... Je t'interdis absolument les médecins. » On trouvera dans le De Agricultura quelques-unes des recettes, mêlées de formules magiques, de la médecine indigène. Le chou y joue le rôle de panacée :
: ... En cataplasme, il guérit toutes les blessures infectées et gangreneuses... Si le mal est intérieur, mange le chou au vinaigre, cela chassera le mal, guérira le ventre, guérira la tête, guérira les yeux. Mais il faut le prendre le matin à jeun. On soigne ainsi la bile, la rate, le cœur, le foie, les poumons... Pour les rhumatismes, rien ne vaut le chou cru que tu prendras haché et saupoudré de coriandre, etc...
Malgré le progrès des idées, les Romains semblent avoir conservé longtemps un peu des préventions de Caton contre la médecine et les médecins. L'art de guérir se trouvait pratiqué, en effet, surtout par des affranchis ou des gens d'assez basse condition. Ce n'était pas tant, explique Pline, la médecine elle-même et l'art de guérir que l'on condamnait, mais l'exercice de la profession de médecin, non rem antiqui damnabant sed artem. On ne voulait pas admettre que les soins tendant à conserver la santé devinssent un métier rétribué. L'exercice de la profession, comme d'ailleurs de la plupart des professions, paraissait incompatible avec la dignité romaine. Les Romains qui s'y adonnaient passaient donc comme des transfuges au camp grec. Un médecin n'obtenait confiance que s'il parlait grec; le client romain, indique Pline, voulait ne pas très bien comprendre lorsqu'il s'agissait de sa santé.
Pour relever le niveau de l'état médical à Rome et y attirer des élèves et des maîtres des écoles grecques, César accorda le droit de cité à tous les médecins qui, à Rome, pratiqueraient ou enseigneraient leur art (1). Sous Auguste, nous trouvons mention d'un médecin célèbre, Antonius Musa. En l'an 23 avant notre ère, Auguste avait failli mourir d'une maladie de foie (2). Antonius Musa le sauva par des bains froids, et cette cure lui valut auprès de l'aristocratie romaine la plus grande renommée. Quelques années plus tard, il est vrai, le même traitement tua ou, du moins, laissa mourir Marcellus, le neveu chéri de l'empereur, qui venait d'épouser sa fille Julie. On sait le rôle important et souvent criminel que, plus tard, sous Claude, des médecins jouèrent à la cour impériale. Messaline avait son médecin Vectius; Agrippine se servit du médecin de Claude, C.Stertinius Xenophon, pour le faire empoisonner. Vespasien attribua aux médecins les mêmes privilèges qu'aux grammairiens, rhéteurs et philosophes (3). Au début du III ème siècle, Alexandre Sévère organisa un enseignement officiel de la médecine que nous rencontrons, à l'époque de Constantin, non seulement à Rome, mais dans les provinces (4).
Une œuvre médicale latine nous a conservé de précieuses indications sur l'état de cette science à la fin de la République ou au début de l'Empire, c'est le De Medicina de Celse.
La personnalité de l'auteur et les dates de son existence nous échappent. Il était certainement romain, il n'est pas incontestable qu'il fût médecin. Son traité de médecine n'est qu'une partie d'une encyclopédie à la fois littéraire et scientifique, théorique et pratique, dont le titre était Artes. Le
(1) suet., Caes., 42.
(2) suet., Oct. Aug., 81.
(3) suet., Vesp., 18.
(4) S. reinach, LVI, s. v. Medicus, p. 1674 sq.
Arts comprenaient l'Agriculture, la Médecine, l’Art militaire, le Rhétorique, la Philosophie et enfin la Jurisprudence. L'originalité de cette collection consistait précisément dans la présence d'un traite de médecine; c'est la seule partie qui nous en ait été conservé.
La science médicale que résume Celse, à l'usage non pas des médecins, mais du public cultivé de Rome, est celle de l'école alexandrine du temps des derniers Ptolémées. Deux doctrines s'y partageaient les esprits, celle des empiriques prétendant que la médecine consiste tout entière dans la pratique et l'expérience, et celle des dogmatiques qui posaient en principe que sans l'intelligence des causes, causes lointaines et prochaines de la maladie, sans la connaissance de l'action naturelle des remèdes, l'art du praticien demeure aveugle et impuissant. Les uns cherchaient surtout à agir et les autres à comprendre. Les partisans de la médecine rationnelle pratiquaient couramment à Alexandrie la dissection des cadavres. Bien plus, pour saisir le fonctionnement des organes, des médecins alexandrins avaient été jusqu'à la vivisection.
Hérophile et Erasistrate raconte Celse, avaient ouvert tout vivants des criminels que le roi leur abandonnait au sortir des cachots afin de saisir sur le vif ce que la nature leur tenait caché, prétendant qu'il n'y avait nulle cruauté à chercher dans 1e supplice d'un petit nombre de criminels le moyen deconserver d'âge en âge des générations innocentes.
Les empiriques, de leur côté, en protestant contre l'abus du raisonnement philosophique, des abstractions et des hypothèses de la part des rationalistes, accumulaient les observations précises. L'art de guérir, remarquaient-ils, varie suivant les individus et même suivant les climats; il sera différent en Egypte, à Rome ou en Gaule. La découverte de la cause des maladies n'est pas celle du remède; seule une expérience assidue enseigne la marche à suivre dans le traitement ; toutes les conjectures sur l'origine de la maladie ne vont pas au fait, il est moins important de connaître ce qui engendre le mal que ce qui le guérit.
Raisonnement d'une part, expérience de l'autre. Les Alexandrins ne s'étaient pas avisés de réunir les deux méthodes et de tirer de l'expérience une science rationnelle. Leur interprète romain se contente de chercher, entre les uns et les autres, une juste mesure qui les dispense de prendre parti.
Je pense, dit-il, que la médecine doit être rationnelle, en ne puisant cependant ses indications que dans les causes évidentes, la recherche des causes occultes pouvant exercer l'esprit du médecin mais devant être bannie de la pratique de l'art... Il est inutile et cruel d'ouvrir des corps vivants, mais il est nécessaire à ceux qui cultivent la science de se livrer à la dissection des cadavres, car ils doivent connaître le siège et la disposition des organes... Les empiriques ont raison de s'attacher surtout à la recherche du remède, mais la mémoire et la pratique sont insuffisantes et le raisonnement doit intervenir constamment... etc.
Telle est exactement l'attitude que prend Vitruve au début de son traité d'Architecture entre les partisans de la pratique et ceux de la théorie.
la pratique résulte d'une application prolongée des procédés usuels... La théorie démontre et explique l'exécution d'une oeuvre par le moyen de l’intelligence et du raisonnement... L'architecte qui, sans théorie ne cherche que la seule pratique n'a jamais réussi à obtenir une autorité proportionnée à ses efforts... Celui qui n'a voulu s'appuyer que sur la théorie ne poursuit qu'une ombre sans réalité.... Celui au contraire qui les unit, est armé de toutes pièces et réussit au delà de ses espérances.... (1).
La querelle, on le voit, renaissait en Grèce à propos de tous les « arts ». Ce n'est pas aux Romains qu'il en faut demander la solution.
Génie médiocre, disait Quintilien, de Celse (2). Le maître de rhétorique songeait peut-être surtout aux parties plus littéraires des Artes. Il est certain que le De Medicina n'a rien ajouté aux connaissances médicales du temps.
(1) vitruv., De Arch., 1, 1 sq.
(2) quint., Inst. Or., 12, 11, 24.
C'est en tout cas une œuvre de bon sens. N'en citons que ce seul exemple :
L'homme doué d'une bonne constitution et qui possède à la fois la santé et la liberté de ses actions ne doit s'astreindre à aucun régime et peut se passer de médecin... Mais pour les personnes délicates, parmi lesquelles je range une grande partie des habitants des villes et presque tous les gens de lettres, il y a nécessité de s'observer davantage (1).
S'il était médecin, Celse fut vraisemblablement un bon praticien, mais il n'a rien du véritable savant. Son traité représente une très honorable érudition médicale, mais non pas de la science.
IV
LES SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES.
Les connaissances concernant non pas l'homme mais les hommes, leurs actions, leur passé et leurs œuvres s'étaient organisées, en pays grec, en dehors de la philosophie. Hérodote était indépendant de Socrate. Mais au II ème siècle avant notre ère l'esprit des grandes écoles philosophiques exerçait son influence sur l’histoire. Les philologues qui à Pergame et à Alexandrie étudiaient et commentaient les écrits anciens n'échappaient pas non plus aux idées généralement répandues par la philosophie. Dans l'ensemble des études historiques et philologiques, la philosophie avait introduit deux préoccupations essentielles: le souci de la vérité tout d'abord et, par conséquent, la critique et, en second lieu, la notion de loi. Elle en avait ainsi transformé le caractère.
Le souci de la vérité, nous semble-t-il, n'est pas primitif en histoire. L'enfance des peuples comme celle des individus s'intéresse moins au réel qu'à la légende.
(l) CELS., de Med., I, 1 et 2. Voyez encore ce portrait du chirurgien : « Le chirurgien doit être jeune ou assez voisin de la jeunesse : il faut qu'il ait la main ferme, prompte, jamais tremblante, la gauche non moins habile que la droite, la vue nette et perçante, l'esprit hardi... »
L'imagination et le sentiment se mêlent au récit des faits de façon tellement intime qu'ils le défigurent entièrement. Les Romains s'étaient tout d'abord épris des fables grecques qu'ils avaient, sans aucun scrupule, mariées à leurs mythes indigènes. Les poètes Naevius et Ennius, les premiers historiens Caton et Fabius Pictor, avaient ainsi composé à leur patrie une tradition héroïque et imaginaire. Pour leur génération, la distinction du vrai et du faux n'avait pas réellement de sens. On imaginait ou l'on répétait les inventions étrangères; on ne s'était pas encore avisé d'observer et de critiquer.
C'est Polybe qui enseigna aux Romains la recherche du vrai. Les pages nourries de pensée philosophique qui servent de préface à son histoire représentent une véritable leçon à leur adresse. L'historien doit oublier son patriotisme et l'orgueil national.
La vérité est à l'histoire ce que les yeux sont aux animaux ; si l’on arrache les yeux aux animaux ils deviennent inutiles, si de l'histoire vous ôtez la vérité elle n'est plus bonne à rien. Qu'il s'agisse d'amis ou d'ennemis, on ne doit, à l'égard des uns et des autres, consulter que la justice... En un mot, il faut qu'un historien, sans aucun égard pour les auteurs des actions, ne forme son jugement que sur les actions mêmes (1)
Mais il ne suffît pas, en ce qui concerne les actions humaines, de savoir y distinguer la réalité, il faut encore la comprendre, c'est-à-dire savoir y reconnaître la liaison des effets avec les causes. Et pour introduire dans l'histoire les liaisons logiques qui constituent comme la trame sur laquelle seront tissés les faits, il est nécessaire de considérer les événements dans leur complexité et leur ensemble (2). C'est ainsi seulement que l'historien arrivera à saisir le plan de la fortune, c'est à dire l'enchaînement même de la réalité. Je rassemblerai pour les lecteurs, dit Polybe, en un seul tableau tous les moyens dont la Fortune s'est servie pour l'exécution de son dessein. C'est là le principal motif qui m'a porté à écrire... (3).
(1) polyb., 1, 24, 4-8.
(2) Ibid., 1, 4, 4-15.
(3) Ibid., 2.
Le plan de la Fortune, ce n'est sans doute qu'une hypothèse arbitraire. La recherche de ce plan n'en représente pas moins, dans l'histoire, l'introduction d'une liaison logique, quelque chose comme la poursuite des causes lointaines pour les médecins de l'école rationaliste ou la théorie de l'architecture opposée par Vitruve à la simple pratique. Il s'agit désormais pour l'historien non plus de narrer, non plus même de savoir, mais d'essayer de comprendre (1).
Cette leçon n'a peut-être pas été comprise par tous les historiens romains, mais elle n'a pas été perdue. La conception de Polybe domine toutes les histoires romaines jusqu'au Discours sur l'Histoire universelle de Bossuet inclusivement. La Fortune prédestinait Rome à l'empire du monde. « Comme la Fortune a fait pencher presque toutes les affaires du monde d'un seul côté et semble ne s'être proposé qu'un seul but... il m'a semblé qu'il ne fallait pas laisser dans l'oubli le plus beau et le plus utile de ses ouvrages... (2). » Tite-Live ne fait pas autre chose, il prépare et il explique le triomphe de Rome. Sa philosophie de l'histoire est celle de Polybe.
Les Histoires de Polybe furent continuées par un philosophe de profession, Posidonius d'Apâmée (133-49) qui, lui aussi, vint à Rome et y exerça une influence profonde sur tous ceux qui s'intéressaient aux choses de l'esprit. Nourri de toute l'érudition des écoles d'Asie Mineure, Posidonius apporte en histoire un scrupule de documentation qui ne s'arrête pas aux faits mais vise surtout à en dégager les causes. Grand voyageur comme Polybe, il visite comme lui les régions où se déroulent les faits qu'il doit exposer, mais il s'ingénie en outre à recueillir les traditions indigènes ; il observe, il cherche à faire parler et il note.
(1) De quel point de vue interpréter et juger les faits ? Le problème se pose toujours aux historiens. Tout effort, même vain, pour le résoudre est un premier mérite. La sévérité de M. G. Radet à l'égard de Polybe n'est pas sans fondement : « Ce type du capitaine en retraite est plus riche en prétentions qu'en talent » (XXI, 1907, p. 6). Elle paraît cependant excessive. La conception seule de l'« histoire pragmatique» et la conscience de l'exécution méritent l'estime.
(2) polyb., 1, 4, 1.
Les quelques fragments qui nous restent de lui nous conservent les plus précieux peut-être de tous les renseignements que nous possédions sur la Gaule préromaine. Physicien en même temps que moraliste, il cherche à discerner les rapports entre les mœurs des hommes et la nature. C'est de lui que provient, selon toute vraisemblance, la théorie, destinée à une longue et brillante fortune, de l'influence des climats, telle qu'elle se trouve exposée au début du vie livre de Vitruve. Nous le voyons se rendre à Gadès à la fois pour étudier le phénomène du flux et du reflux de l'Océan et essayer d'y recueillir quelques nouvelles de l'expédition d'un Grec, Eudoxos de Cyzique, parti de là, quelque vingt ans auparavant, à la recherche de la route des Indes. Posidonius fut vraiment un maître et considéré comme tel par les Romains qui le connurent ou qui se pénétrèrent de ses travaux. César, dans ses Commentaires, ne se fait pas faute de lui emprunter bon nombre de renseignements et, probablement, la plupart des digressions descriptives qui interrompent ça et là le récit des faits militaires. C'est à lui également que semble remonter une partie au moins des développements moraux qui donnent un caractère si particulier aux œuvres historiques de Salluste. La curieuse dissertation, par exemple, qui, au début de la Conjuration de Catilina, présente le tableau du profond changement intervenu à ce moment dans les mœurs romaines, rappelle de près un passage que Diodore déclare provenir de Posidonius. A César et à Salluste, Posidonius a appris à observer les terres et les hommes, à noter les phénomènes physiques et les mœurs. Il devait, pour son compte, appliquer à cette observation un esprit purement scientifique et, dans les faits, chercher les causes lointaines et prochaines. Trop engagés dans l'action ou trop passionnés d'ambitions, ses élèves romains ne se trouvaient pas à même de le suivre dans cette voie. Ils s'arrêtèrent à mi-chemin, à l'histoire militaire et politique.
Le véritable émule des savants alexandrins fut M. Terentius Varron (116-26). C'est une curieuse figure que celle de ce chevalier romain né à Réate en Sabine, agriculteur ingénieux à mettre en valeur son patrimoine, homme de guerre et marin, lieutenant de Pompée en Cilicie lors de la guerre contre les pirates et en Espagne pendant la guerre civile, poète satirique comme Lucilius, plein de verve et d'humour, critique, grammairien, archéologue, historien, organisateur et directeur des Bibliothèques publiques de Rome sous César et Octave. Il put connaître Marius et Sylla et ne mourut qu'après Actium, au moment où Octave organisait son principal. Il représente comme un trait d'union entre la vieille république et l'empire.
Des anciennes traditions dont il se trouve encore tout voisin, il recueille quantité de faits, de sentiments et de croyances. Elève des philosophes, d'Antiochus d'Ascalon, dont il suivit les leçons à Athènes, et des érudits comme Aelius Stilon, le plus ancien des philologues romains, il traite ces traditions comme une matière de connaissance. Avec lui, la réflexion savante s'exerce sur le passé romain pour le codifier. La forme de ses études est grecque, la matière en est romaine.
Son amour des choses littéraires et l'enseignement d'Aelius Stilon l'amènent tout d'abord à la philologie. Les critiques du Musée, à Alexandrie, avaient fait le Canon des anciens poètes et des orateurs grecs; Varron s'attache à l'ancienne poésie latine ; il étudie les comédies attribuées à Plaute et, sur plus d'une centaine, en reconnaît vingt et une pour authentiques. Ils s'applique aux débuts du drame latin et dresse la liste des représentations dramatiques à Rome. Il recueille tout ce que l'on peut savoir des poètes du siècle qui ont précédé le sien : il est, en somme, le critique érudit de l'ancienne littérature.
Des œuvres, il passe à l'histoire de la langue et à celle de l'écriture latine. Il en vient ainsi à l'histoire et même à la préhistoire. Son traité De gente populi romani s'ingéniait à faire rentrer les origines du peuple romain dans les cadres tracés par la spéculation préhistorique grecque et à donner une apparence scientifique à la légende. La légende le conduit à l'archéologie. Ses Antiquitates rerum humanarum et divinarum recueillaient en 41 livres tout ce que l'on pouvait savoir de son temps touchant l'ancienne civilisation romaine, les hommes, les temps, les lieux, les choses et les dieux. Les nombreux emprunts faits par saint Augustin aux Antiquités divines nous montrent la précieuse abondance des renseignements ainsi conservés.
Cet érudit était en même temps un vulgarisateur, car c'était une œuvre de vulgarisation populaire que ses Imagines, collection de sept cents portraits d'hommes illustres accompagnés chacun d'un éloge en vers. Cette entreprise de librairie, peut-on dire, lui avait été suggérée par l'ami de Cicéron, Atticus, qui fut son collaborateur et son éditeur.
Mieux que quiconque, Varron se trouvait qualifié pour composer cette Encyclopédie au sujet de laquelle nous ne trouvons que de rares allusions mais qui formait, semble-t-il, le manuel classique des sept Arts libéraux : Grammaire, Dialectique, Rhétorique, Géométrie, Arithmétique, Astronomie, Musique. Il s'y ajoutait même, probablement, un traité de médecine et un traité d'architecture, sans parler d'un traité de droit dont nous ne connaissons que le titre : De jure civili. L'encyclopédie de Varron dut rester un modèle, fréquemment imité et rajeuni. Les Artes et le De Medicina de Celse, le De Architectura de Vitruve ne représentaient sans doute que des perfectionnements apportés par des spécialistes à l'œuvre ancienne du puissant polygraphe.
Ritschl porte au compte de Varron 74 ouvrages différents comptant un total de 620 livres. Quelle que fût la fécondité et la facilité du savant, une telle production dépasse les forces humaines, d'autant plus que la guerre et les affaires durent enlever à la science un bon nombre des heures de Varron. Nous ne possédons pas de renseignement sur sa méthode de travail. Il n'est peut-être pas invraisemblable d'imaginer que toute cette besogne put être accomplie par une sorte d'atelier de Grecs plus ou moins latinisés ou d'érudits latins de second ordre travaillant sous la direction du maître. Varron aurait donc fait de la science, un peu comme son ami Atticus faisait de l'édition, à moins que la tradition n'ait mis sous son nom beaucoup de la production érudite de son temps.
De toute cette œuvre nous ne possédons plus qu'une partie du De lingua latina et les trois livres Rerum ruslicarum.
Le De lingua latina comprenait vingt-cinq livres. Les livres 5 à 10 seuls sont parvenus jusqu'à nous, et encore avec de nombreuses lacunes. Les récapitulations placées au début de chaque livre permettent cependant d'en reconstituer le plan. Le traité comprenait trois grandes divisions : étymologie, déclinaison et syntaxe. Ce qui subsiste contient la fin de la première et le début de la seconde partie. Quelques indications précieuses s'y trouvent mêlées à beaucoup de fatras.
Au début de la flexion se trouve exposée la grande querelle de la grammaire de ce temps entre analogie et anomalie. Les anomalistes étaient les empiriques de la grammaire : ils prétendaient s'en tenir aux faits. Arrêtés par le grand nombre des exceptions qu'ils se trouvaient incapables d'expliquer, ils prétendaient qu'on ne pouvait, en fait de langage, parvenir à formuler des règles générales, que tout n'y était qu'accident. Les analogistes, au contraire, reconnaissaient dans l'analogie la grande loi des formations grammaticales, la loi logique supérieure à toutes les exceptions de fait. Ils représentaient les rationalistes. C'était, transposée dans l'étude du langage, la grande dispute philosophique entre les partisans de l'observation pure et simple du réel et les logiciens qui, partant d'une idée abstraite, cherchaient avant tout, dans l'expérience, les effets des causes générales qu'ils imaginaient.
Entre les uns et les autres Varron se contente d'adopter la solution romaine, superficielle sans doute mais qui, à ce moment, était celle du bon sens, la solution du juste milieu. Analogie et anomalie se trouvent, selon lui, associées dans la langue : les uns ont tort de tout vouloir soumettre à la règle, les autres de ne voir que les exceptions. On ne pouvait lui demander, évidemment, d'inventer les lois de la phonétique et l'histoire du langage.
Si l'on veut juger de la science de Varron par ce qui nous reste de ce traité — et il semble bien qu'on soit en droit de le faire — cette science n'est que compilation hâtive, présentée sous une forme littéraire plus que médiocre.
Tout différent est le genre du traité de l'Agriculture. Le style en est vivant, non sans esprit ni agrément ; on y aperçoit la personnalité de l'auteur. C'est bien là l'œuvre du vieux Romain prudent et avisé, aimable et de bonne compagnie mais un tantinet pédant. « Ma quatre-vingtième année, dit-il, m'avertit d'avoir à plier bagage et de me préparer à quitter cette vie » ; il va donc recueillir son expérience de bon propriétaire romain. Il en tire un tableau précis et extrêmement instructif de l'économie rurale et même de l'économie générale de l'Italie de son temps. L'œuvre se présente sous forme de dialogue, comme la plupart des traités de Cicéron, mais les divisions et subdivisions, les souvenirs abondants de lectures, trahissent l'érudit sous l'agriculteur et l'habitude des disciplines savantes des écoles grecques chez un émule du vieux Caton.
Varron n'est pas isolé à Rome. Depuis son maître Aelius Stilon, une école nombreuse d'érudits y poursuivait les mêmes études philologiques et archéologiques que lui. Leur réputation et leur influence étaient telles que César lui-même, dans sa jeunesse, avait jugé bon pour sa gloire de composer un traité sur l'Analogie. L'esprit romain n'est réfractaire à aucun des genres de connaissances de la Grèce.
L'érudition latine est grecque par son origine, par ses méthodes et par ses idées. Mais son objet est le passé latin.
Lorsque les savants d'Alexandrie ou de Pergame étudient le passé grec, ils le font de façon absolument désintéressée, sans autre but que d'en constituer méthodiquement la connaissance. Ce passé, en effet, leur est pour ainsi dire étranger, il représente à leurs yeux celui de l'humanité elle-même dans ce qu'il eut de plus élevé et de plus généralement humain. Ils ne se font pas faute, dû reste, d'y ajouter l'ensemble du monde qui peut leur être connu. Les Barbares eux-mêmes intéressent un Polybe et surtout un Posidonius. La curiosité d'Eratosthène s'étend à toute la terre.
Tout autre est l'esprit des savants romains. Une piété tout particulièrement romaine anime leur zèle érudit. L'orgueil national préside à l'inventaire qu'ils font des antiquités de leur pays. Ce sont pour eux comme des richesses qu'ils ne veulent pas laisser perdre. On retrouve chez Varron, semble-t-il, un sentiment assez analogue à celui qui soutenait les efforts poétiques de Naevius et d'Ennius. Le patriotisme des vieux poètes se proposait de doter Rome d'une littérature égale à celle de la Grèce. Varron, de même, vise à constituer rapidement pour sa patrie un trésor de connaissances équivalant à celui que des générations successives de savants ont patiemment recueilli pour la Grèce. Il veut montrer que les antiquités nationales romaines ne sont pas moins riches d'éléments intellectuels ni moins intéressantes que le passé homérique ou l'époque classique grecque.
Varron et ses émules n'attendent sans douta de leurs recherches aucun effet pratique. Il serait faux de leur prêter quelque intention de remettra en honneur et de ressusciter ce passé qu'ils étudient. En le tirant de l'oubli, ils visent uniquement à faire œuvre de savants. Mais ils ne l'étudient pas uniquement en savants. Le sentiment patriotique se mêle chez eux à l'esprit scientifique. La tendresse dont ils entourent les faits, les croyances, les traditions d'autrefois, anime leur étude d'une sorti de vie idéale. L'érudition qui apprend aux Romains à voir clair dans leur propre passé éveille aussi chez eux une véritable conscience nationale dont la politique fera bientôt un puissant élément d'action.
C'est dans les études de Varron qu'il faut chercher l'origine de la veine poétique d'archéologie nationale qui apparaît chez Tibulle, prend une place de plus en plus large chez Properce et triomphe avec Virgile. Du domaine de l'imagination la tradition ressuscitée par la science de Varron passe dans la pratique avec les tentatives de restauration morale d'Auguste. Sans l'avoir voulu mais par l'effet des tendances propres qu'elle introduit dans la science, l'érudition romaine aboutit donc, elle aussi, à l'action. L'esprit romain excelle à saisir toutes les utilités et à tirer profit des connaissances même les plus désintéressées en leur principe.
CHAPITRE VII
LA TECHNIQUE ORATOIRE. CICERON ET LA PROSE LITTÉRAIRE
I
L'ÉLOQUENCE ET LA RHÉTORIQUE.
Avant de connaître la Grèce, les Romains n'avaient notion ni de philosophie ni de science. Il était donc naturel qu'en fait de philosophie et de science ils se missent entièrement à l'école des Grecs. Mais ils pratiquaient depuis longtemps l'art oratoire. L'habileté à la parole était indispensable dans une république à quiconque aspirait à dominer la foule. L'éloquence politique dut naître chez eux en même temps que la politique. Bien plus, le développement du droit, l'usage chez les clients de recourir en justice à l'appui de leur patron, imposait comme un devoir à l'aristocratie de savoir défendre une cause. Le désir de briller, l'ambition de s'imposer à l'attention de ses concitoyens, trouvaient dans la parole publique le moyen le plus courant et le plus sûr. « Dans une si grande et si ancienne république, dît Cicéron, où les plus brillantes récompenses sont proposées à l'éloquence, tous ont désiré exercer le talent de la parole » Aussi, lorsque, dans le Brutus, il entreprend de retracer l'histoire de l'éloquence romaine, n'hésite-t-il pas à en faire remonter l'origine à L. Brutus qui chassa les Tarquins et trouve-t-il à citer, antérieurement à Caton, bon nombre d'orateurs. On aurait donc pu s'attendre à ce que l'art oratoire romain continuât cette vieille tradition ou, du moins, à ce qu'il conservât en face de l'éloquence grecque quelques traits originaux et une allure indépendante.
Il n'en est rien, c'est la rhétorique grecque que nous trouvons triomphante à Rome avec Cicéron.
Toute l'éloquence antérieure à la période de la rhétorique paraît de peu de poids à Cicéron. Les éloges même qu'il donne à Caton la condamnent ; il loue le talent naturel de Caton : personne n'aurait dépassé l'éloquence du vieux censeur, si à ce talent naturel il avait pu ajouter la science que connurent ses successeurs :
Ajoutez du nombre à ses périodes, mettez entre leurs parties plus de liaison et de symétrie, assemblez les mots avec plus d'art, emboîtez-les, pour ainsi dire, les uns dans les autres, alors vous ne mettrez personne au-dessus de Caton (1)... Servius Galba, contemporain de Lelius et de Scipion Émilien, fut sans contredit le plus grand orateur de cette époque; le premier parmi les Romains il usa de tous les procédés qui sont le privilège de l'orateur, digressions, amplifications, mouvements pathétiques, lieux communs (2).
A Rome, comme en Grèce, la véritable éloquence n'apparaît, au goût de Cicéron, qu'avec l'art oratoire.
Cet art, analysé longuement dans le de Oratore et dans l'Orator, est celui des rhéteurs grecs. C'est une discipline extrêmement délicate et complexe qui prend l'orateur pour ainsi dire au berceau et continue à s'imposer à lui lors même qu'il est sorti de la période de formation. Essentiellement pratique, elle distingue les genres d'éloquences et les espèces de causes, elle catalogue les types d'arguments les mieux appropriés à chacune, les tours de phrases, les dispositions de mots, les effets les plus propres à séduire l'auditeur. Ces habiletés doivent être en mesure de rendre forte la cause la plus faible et de faire paraître faible la cause la plus forte. Le rhéteur est le maître des arguments et des mots ; il a pour but unique le succès.
(1) Brut., 17,65. —
(2) Brut., 21, 82.
Née en Sicile et en Grèce avec les sophistes, cette technique tout empirique de l'éloquence a reçu dans les écoles du monde hellénistique un développement nouveau. Dans les royaumes issus du partage de l'empire d'Alexandre, l'éloquence n'a conservé qu'une place infiniment moindre que celle qu'elle occupe à Rome. Elle se trouve réduite au genre très artificiel du discours d'apparat ou à l'étroitesse du plaidoyer judiciaire. Chassée de la place publique, elle s'est réfugiée sous les portiques de l'école et les maîtres ont porté, en paix, tout l'effort de leur subtilité à raffiner les théories et les méthodes. Chaque forme de pensée, chaque tour de phrase a été étudié pour lui-même et classé sous un nom propre ; les balancements, les oppositions, les figures, les traits, tout a été analysé et régie. La forme des mots elle-même, leur valeur rythmique, leur agencement dans la période, ont fait l'objet de calculs et de dosages savants. Les maîtresderhétorique avaient fixé une métrique de la prose, moins stricte sans doute que celle de la poésie, mais qui ne s'en rapprochait pas moins de celle du lyrisme et des cantica dramatiques (1). Elle s'appliquait surtout au début et à la fin des phrases, mais à l'intérieur même de la période, suivant le mouvement du discours, la nuance de l'idée et du sentiment, on observait attentivement la quantité des syllabes, la succession, l'alternance ou l'accumulation des longues et des brèves. Le discours devenait une sorte de déclamation musicale, une monodie minutieusement réglée.
Cet art savant et délicat avait l'orgueil de ne reposer sur d'autres bases que l'expérience, d'être le fruit de longues séries d'observations. Il ne voulait reconnaître d'autre réalité que la parole, plus forte que les faits, plus forte que la vérité, maîtresse de la vraisemblance. Pour ses fidèles, le verbe était vraiment le principe de toute choses. Les rhéteurs étaient les empiriques de l'éloquence.
(1) Orat., I68 sq.
Ils lui avaient donné sa forme et l'avaient élevée, reconnaissons-le, de l'état d'improvisation instinctive à la dignité d'une composition littéraire savante.
Leurs enseignements avaient tout d'abord surpris les Romains, et pendant longtemps avaient rencontré chez eux une vive résistance. On se souvient de la boutade de Caton tournant en dérision les trop longs efforts qu'ils exigeaient et demandant si c'était pour plaider dans les Enfers que les élèves des rhéteurs passaient ainsi leur vie à étudier. En 161, les rhéteurs avaient été confondus avec les philosophes dans un sénatus-consulte d'expulsion. En 91, l'orateur Crassus, lors de sa censure, les avait de nouveau chassés. Crassus est un des interlocuteurs du de Oratore. Cicéron lui fait expliquer les raisons de son édit (1).
Les rhéteurs grecs, de nos jours, dit Crassus, manquent de fond, aussi voit-on notre jeunesse se gâter et désapprendre à leur école. Leurs connaissances sont cependant encore bien plus étendues que celles de leurs émules latins... Que pouvait-on gagner aux leçons de ces nouveaux docteurs, qu'une excessive confiance en soi-même? C'est là tout ce qu'ils enseignaient, ils tenaient seulement école d'impudence, ludus impudentiae.
L'habileté rhétorique semblait dangereuse pour la moralité et le sérieux de l'éloquence. Crassus n'avait pas tort. C'est le développement immodéré de la rhétorique qui a produit la déclamation.
Tout en recueillant avidement le fruit de l'enseignement des rhéteurs et en en faisant profit dans ses discours, Cicéron se garde bien cependant de se ranger entièrement de leur parti. A côté de ses empiriques, l'éloquence a aussi, en effet, ses dogmatiques et, conformément à l'habitude romaine, Cicéron s'efforce de tenir la balance égale entre les deux écoles.
(1) De Orat. 3, 24.
« Borner les obligations de l'orateur à connaître les principes qu'enseignent les rhéteurs, dit-il, c'est l'enfermer dans un cercle bien étroit ; c'est réduire une carrière immense à un bien petit espace (1). » Mais ce n'est pas la pratique romaine, l'ampleur et la passion des grands débats politiques dépassant les petites habiletés de l'école, qu'il oppose aux rhéteurs, c'est une autre théorie également d'origine grecque.
Les adversaires des sophistes d'abord, puis des rhéteurs, ont été en Grèce les philosophes. En face de Gorgias et de Protagoras, artiste du verbe, Socrate et Platon avaient revendiqué les droits de l'idée. Aristote surtout avait montré combien était superficiel un art qui prétendait enseigner à bien parler sans se soucier d'apprendre à penser. Au vraisemblable, il avait opposé le vrai et avait donné comme base à l'éloquence la théorie de la preuve. De la recherche du procédé, de la collection des recettes pratiques, il élevait la rhétorique à la dignité d'une véritable science logique. La forme parfaite ne devait plus être que l'expression d'une pensée cohérente et foncièrement vraie.
Après Aristote, l'époque hellénistique avait accentué la réparation entre l'éloquence et la philosophie. Les rhéteurs avaient recouvré leur liberté tandis que les philosophes, spécialisant leurs recherches, avaient généralement subordonné l'art de l'expression à l'exacte définition des faits et des idées. Épicure dédaignait l'éloquence et ses ornements, les stoïciens en faisaient l'humble servante de la dialectique. La Nouvelle Académie seule cherchait à maintenir le contact entre les deux disciplines et donnait la philosophie et la science pour soutien à la rhétorique. C'est sa doctrine que nous trouvons exposée avec abondance, en particulier dans le de Oratore.
Le caractère superficiel et l'étroitesse de l'art des rhéteurs doivent au gré de Cicéron, se trouver compensés par l'ampleur de la culture de l'orateur. La rhétorique donnera la forme, la philosophie et tout le cycle des connaissances humaines fourniront le fond.
(1) De Orat., 3, 19.
La dialectique de l'orateur n'est que le développement de la logique. La morale, c'est-à-dire la science des caractères, des sentiments et des passions prêtera à l'éloquence les moyens de jouer des divers mobiles qui conduisent l'humanité. L'histoire et le droit seront pour l'avocat et l'homme politique comme un arsenal d'exemples et d'arguments. La physique, science de la nature, et même la métaphysique à laquelle aboutissent tous les problèmes de la vie, doivent compléter la formation de l'orateur. En un mot, l'orateur, outre la rhétorique, doit posséder toutes les sciences.
Mais, comme le font observer les interlocuteurs du de Oratore, c'est là un cercle trop vaste pour être embrassé. Perdu au milieu de ces spéculations diverses dont chacune suffit à absorber l'activité intellectuelle de toute une vie d'homme, l'orateur n'aura plus le temps de s'appliquer à l'objet particulier de son art. Un luxe inutile, ou seulement peu utile, de culture générale fera tort à la préparation technique particulière. L'éloquence n'est-elle que la fleur et comme le couronnement de tout savoir ou ne constitue-t-elle pas un art particulier ayant ses règles et ses méthodes ? Ne se développe-t-elle pas surtout par la pratique et n'est-ce pas aux exercices propres à cet art que doit avant tout s'appliquer l'orateur ?
L'opinion propre de Cicéron, telle qu'on peut l'apercevoir à travers les discussions du dialogue, reflète le même éclectisme que nous trouvons dans tous les exposés romains des querelles intellectuelles grecques. La sagesse consiste dans une juste mesure. N'exigeons pas de l'orateur une connaissance approfondie de toutes les matières qui peuvent prêter appui à l'éloquence ; ne lui demandons que des notions suffisantes. Sans être philosophe, il aura des clartés de philosophie. Il devra seulement être capable d'emprunter, à l'occasion, aux diverses sciences spéciales les moyens de nourrir et d'amplifier le sujet qu'il traite. Un bon orateur, comme plus tard chez nous l'honnête homme, peut se contenter de n'être complètement étranger à aucune des branches du savoir humain. Mais, dans sa formation, la rhétorique qui lui apporte la technique propre de son art tient de beaucoup la première place.
L'art oratoire romain est donc entièrement grec. Parmi les interlocuteurs du de Oratore, ceux-là même qui s'élèvent le plus vigoureusement contre les prétentions et la pratique des rhéteurs, Crassus et Antoine, apparaissent fort au courant des théories les plus subtiles de la rhétorique. Ils y ajoutent sans doute leur propre expérience, mais les leçons qu'ils ont reçues et qui les ont préparés à se présenter au tribunal et au Forum n'ont pas été autres que celles des rhéteurs. Ce sont les doctrines d'école, constituées dans les centres intellectuels du monde hellénistique, qui sont venues à Rome affronter l'épreuve de la vie.
II
LES ÉCOLES DE RHÉTORIQUE.
Les seules divergences entre les orateurs romains tiennent à la diversité des doctrines des théoriciens grecs.
Les différentes écoles de rhétorique, en effet, n'avaient pas toutes le même idéal. Celles d'Athènes s'en tenaient à un art particulièrement sobre et un peu sec. La perfection toujours admirée des modèles anciens conservait à l'art de la parole une tendance vers l'archaïsme. Lysias et Thucydide y étaient les maîtres les plus admirés. On s'ingéniait à reproduire la simplicité de l'un, à imiter la vigueur contenue et la concision de l'autre. Les Attiques étaient les maîtres du goût sévère,
Les écoles d'Asie, au contraire, celle de Pergame en particulier, avaient introduit dans l'éloquence grecque les couleurs, la souplesse de rythme et les ornements qui, de tout temps, furent chers à l'Orient. Plus d'imagination que de logique dans l'invention, un emploi immodéré des figures, des mots effet, des oppositions, dans la déclamation des jeux de la voix qui faisaient de la parole une sorte de chant, une action exubérante, telles étaient les caractéristiques du genre asiatique.
Entre l'Attique et l'Asie, Rhodes essayait de trouver la juste mesure. Ses rhéteurs condamnaient à la fois la rigueur un peu sèche des uns et la richesse trop chargée des autres. Le maître le plus célèbre de l'école rhodienne était Molon, habile avocat, excellent écrivain, maître remarquable non moins par ses critiques que par ses leçons, dit Cicéron (1). C'est chez lui que l'orateur latin était venu parfaire son éducation rhétorique.
Ce sont ces trois nuances diverses de l'art hellénistique que nous retrouvons à Rome au Ier siècle avant notre ère. Elles y apparaissent en action, personnifiées pour ainsi dire en des orateurs célèbres ou plutôt même exprimées par trois générations successives d'orateurs. La faveur du public passe de l'une à l'autre de ces écoles d'éloquence dont le succès représente vraiment l'évolution du goût romain entre les années 100 et 50 avant notre ère. Nous n'avons ici qu'à suivre Cicéron, critique très sûr de l'art de ses contemporains.
Le genre asiatique obtint la vogue le premier et triompha surtout en la personne d'Hortensius, né en 115 et qui débuta au Forum dès l'année 96 (2). Il y apporta, dit Cicéron, un talent impétueux et une fécondité inépuisable, d'admirables qualités naturelles fortifiées par un exercice assidu. Il abondait d'expressions brillantes, de figures vives et de pensées légères; sa voix était chantante et sonore, son geste très étudié. La goût des gens de sens rassis n'était pas satisfait : « Souvent je voyais Philippe rire de pitié ou même s'indigner, mais les jeunes gens admiraient et la foule était entraînée (3). » — Dans la médiocrité générale d'alors, Hortensius n'eut pas de peine à s'imposer. Parvenu bientôt aux honneurs et à la gloire, il crut pouvoir dédaigner ses rivaux et, sans s'inquiéter de ceux qui venaient après lui, jouir de son succès.
(1) Brut., 91, 316.
(2) Brut., 64, 228 sq.
(3) Brut., 95, 326.
Il cessa de travailler et l'oisiveté « produisit sur ses qualité; le même effet que le temps sur des peintures anciennes. Tout dégénéra en lui, en particulier cette élocution facile et rapide qui semblait couler de source (1). » Quand les honneurs et la dignité de l'âge mûr exigèrent un ton plus grave, Hortensius resta toujours le même orateur. Son zèle était seulement refroidi ; tout en conservant cette abondance de pensées ingénieuses qui se pressaient dans ses discours, il ne savait plus, comme autrefois, les revêtir de la parure d'un style éblouissant. L'éclat asiatique convenait à la jeunesse ; il manquait du sérieux qui donne l'autorité.
Plus jeune qu'Hortensius d'une quinzaine d'années, Cicéron l'avait trouvé dans sa gloire. « Je l'ai suivi en m'attachant à ses pas »dît-il (2). Les deux orateurs demeurèrent, en effet, tout le long de leur carrière intimement liés. C'est le genre d'Hortensius qu'imita Cicéron à ses débuts.
Je prononçais un discours entier, sans baisser le ton, de toute la force de ma voix, avec une véhémence d'action à laquelle tout mon corps prenait par... J'étais alors très maître et d'une complexion délicate, j'avais le cou long et mince, enfin une conformation qui n'était pas, dit-on, rassurante quand on y joint le travail et de grands efforts de poitrine (3).
On le pressait d'abandonner le Forum ; il résolut seulement de se faire une manière plus modérée et plus sage et partit pour l'Asie. Après six mois passés à Athènes, il vint à Rhodes.
Molon réprima, ou du moins fit tous ses efforts pour réprimer les écarts d'une fougue juvénile et resserrer le torrent débordé d'une élocution redondante... Lorsqu'au bout de deux ans, je revins, je n'étais plus le même, ma déclamation était moins véhémente, mon style plus reposé (4).
C'est alors qu'il crut constater la déchéance et les défauts d'Hortensius. Au genre de son aîné il opposa un idéal plus sobre et plus sérieux, prétendant à plus de mesure dans le goût et plus de fond dans les idées. Le style de Cicéron était le style rhodien.
(I) Brut., 93, 320.
(2) Brut., 90, 307.
(3) Bral., 91, 313.
(4) Brut.,315-3l6.
Il régna sans conteste pendant près de vingt-cinq ans. Vers 56 apparut au Forum une jeune génération pleine de talent et de sévérité pour ses prédécesseurs. Son représentant le plus brillant au Forum était Calvus, que nous retrouverons parmi les poètes du cercle de Catulle. Ces jeunes gens, au nom de l'idéal attique, adressaient à Cicéron exactement les mêmes critiques que celui-ci avait formulées autrefois contre Hortensius, une abondance excessive et artificielle et un excès d'ornements d'un goût douteux.
Ces attaques contre sa primauté paraissent avoir ému assez virement le grand orateur. Calvus mourut jeune en 46. Le Brutus et l'Orator, écrits l'un et l'autre cette année même, nous apportent un écho extrêmement précis de la querelle.
On s'étonne, dans le Brutus, de voir tout d'un coup, à propos de Caton l'Ancien, évoqués et les Attiques et Lysias et Hypéride.
Pourquoi nos jeunes gens n'admirent-ils pas Caton et ne le suivent-ils pas ? C'est pure ignorance de leur part. Ils vantent chez les Grecs ce goût antique et cette simplicité qu'ils appellent de l'atticisme et ils ne savent pas les reconnaître chez Caton. Ils veulent être des Hypérides et des Lysias — très bien ; — mais pourquoi ne veulent-ils pas être des Catons ! Ils disent aimer le style attique — parfait; — ils devraient en imiter aussi les qualités et non pas seulement les défauts... Vraiment ils auraient intérêt à ne pas ignorer profondément Caton (1).
L'ironie est un peu lourde et le ton manque d'aménité. La discussion semble vouloir se faire plus sérieuse dans l’Orator (2). Elle embarrasse visiblement Cicéron, qui s'en tire en jouant sur le sens de l'épithète « attique ».
Une éloquence sans étude et sans soin pourvu que l'expression en soit précise et dépouillée serait seule « attique »...
(1)Brut. 17, 67 ; cf. 82-85, 283 sq.
(2) Or., 9, 28-33.
Mais, en ce sens, Périclès lui-même ne serait pas un orateur attique, car s'il avait pratiqué une éloquence aussi simple, jamais Aristophane n'aurait dît de lui qu'il lançait des éclaira, qu’il tonnait, qu'il bouleversait toute la Grèce... Ainsi l'éclat, la force, l'abondance appartiennent aux Attiques, sans quoi aï Eschine ni Démosthène ne seraient des Attiques.
Ne nous laissons pas abuser par Cicéron plaidant pro arte tua. L'opposition est plus sérieuse, le principe surtout en est plus intéressant que Cicéron ne veut avoir l'air de l'admettre. Les néo-attiques sont des artistes aussi experts en rhétorique que Cicéron lui-même. Ils ne se réclament aucunement ni de l'éloquence naturelle ni de la vieille tradition romaine. Leurs modèles, à eux aussi, sont en Grèce et viennent de l'école. Mais pour leur école le comble de l'art consiste précisément dans l'apparence d'y être étranger. La connaissance du sujet, tel est le véritable principe de l'éloquence. Leur parole s'appuie, sans doute, sur la pratique et l'expérience, mais sans aucun des procédés factices destinés à amplifier et à orner le discours. Pour les attiques, l'art ne vient pas s'ajouter à l'idée; il fait corps avec elle, il en émane directement, il en est l'âme. L'architecture qu'ils veulent élever doit sa beauté à la seule qualité des matériaux et à l'agencement des masses et des lignes; elle repousse les ornements rapportés.
Cicéron au contraire ne conçoit pas la beauté sans ornement, l'art sans artifice.
On n'a pas tort de prétendre, dit-il, que la connaissance parfaite del'objet est le principe de l'éloquence, mais il est encore plus vrai d'affirmer que s'il est impossible de bien parler de ce qu'on ignore, il l'est également, même lorsqu'on connaît bien le sujet, sil'on ignore l'art de composer et d'orner un discours (1).
La technique oratoire consiste donc, pour lui, d'abord à savoir ordonner son discours, faciunda oratio, puis à savoir l'orner, potiunda oratio. Les néo-attiques la plaçaient tout entière dans la première de ces deux opérations. Trop de beautés de qualité médiocre, tel était le reproche que Cicéron avait adressé à Hortensius et que, à son tour, lui adressait Calvus. A lire les discours de Cicéron, on ne peut s'empêcher de donner raison à la jeune école du goût sévère. Les artifices de la rhétorique y sont trop abondants et trop apparents. Les arguments, leur disposition, l'agencement des phrases et des mots, le ton du discours, enjouement ou mouvements d'indignation, représentent dans l'éloquence cicéronienne une application presque mécanique des principes de l'école, tels qu'ils se trouvent exposés dans les traités théoriques du de Oratore et de l’Orator. Non seulement tout est calculé et voulu, ce qui est le propre de l'art, mais trop souvent le procédé prend la place de l'inspiration, il s'ajoute à l'idée, il la déforme ou la surcharge. Le rhéteur fait tort à l'orateur.
Cette technique savante et trop poussée est devenue chez Cicéron une seconde nature et comme la loi de son esprit. Elle lui a certainement, en mainte occasion, facilité sa tâche en le mettant à même de prononcer presque impromptu un discours sur n'importe quel sujet, en lui suggérant des développements, en lui fournissant une réplique ou le moyen de retourner l'argument de l'adversaire. C'est là chez lui « le métier ». Il en use avec une virtuosité qui a pu lui valoir fréquemment les applaudissements du public ou même la faveur des juges, mais qui fait tort à la sincérité d'un tempérament magnifiquement oratoire et diminue la valeur littéraire de son éloquence.
C'est à la rhétorique qu'il faut attribuer, dans les discours de Cicéron, tout ce bagage de préparations et de digressions qui souvent dispersent l'attention ou alourdissent le discours. Rhétorique encore cette surabondance d'arguments dont tous ne sont pas bons, et dans chaque argument cette surabondance de mots qui lassent, du moins à la lecture. Chaque démonstration est trop complète, chaque période trop parfaite. De la rhétorique surtout provient cet abus des petits moyens et des lieux communs.
(I) De Orat., 1, 14.
On attendait l'expression sincère d'un sentiment profondément senti ou quelque grande idée, on ne voit venir qu'une dialectique vaine ou un pathétique de mauvais aloi. G. Boissier en note, dans la quatrième Catilinaire, un exemple particulièrement frappant.
« Cicéron avait à discuter cette question, une des plus graves qui puissent être posées devant une assemblée délibérante : jusqu'à quel point peut-il être permis de sortir de la légalité pour sauver son pays ? Il ne l'a pas même abordée. On souffre de voir comme il recule devant elle, comme il la fuit et l'évite pour développer de petites raisons et se perdre dans un pathétique vulgaire. »
II y a dans toute cette éloquence, conclut Boissier, trop d'artifice et de procédé. Un débat serré et simple conviendrait mieux à la discussion des affaires. Les grandes tirades philosophiques seraient avantageusement remplacées par une exposition nette et sensée des principes politiques de l'orateur et des idées générales qui règlent sa conduite. Calvus et les Néo-Attiques ne devaient pas prononcer un autre jugement.
III
la PROSE LITTÉRAIRE.
L'enseignement des rhéteurs ne se limitait pas étroitement à l'éloquence; il embrassait l'expression de toutes les idées et tous les genres littéraires, histoire, philosophie, traités didactiques et même le genre épistolaire. Si l'ensemble des connaissances humaines devait, selon Cicéron, fournir le fond de l'éloquence, l'éloquence ou du moins la rhétorique prêtait à son tour sa forme à l'ensemble de l'activité intellectuelle. Les écoles grecques et, à leur suite, les Romains ne conçoivent pas d'œuvre littéraire en dehors d'elle.
L'histoire, en particulier, se trouve, dans la conception antique, étroitement subordonnée à la rhétorique. Lorsqu'il polémique contre ses adversaires néo attiques, Cicéron distingue avec beaucoup de justesse le style qui convient à l'exposé des faits de celui qu'exige le tribunal ou le Forum. Les rhéteurs n'avaient pas manqué de faire cette observation, L'histoire n'en est pas moins pour lui un genre oratoire, opus est maxime oratorium. Il la sépare si peu du discours où il s'agit de plaire et de prouver et même il pousse si loin la déformation professionnelle qu'il va jusqu'à concéder au rhéteur le droit de mentir un peu en histoire pour embellir son récit et accuser sa démonstration (1). La rhétorique se trouve ici en opposition avec les leçons beaucoup plus sérieuses des philosophes. Les historiens romains de la fin de la république, César et Salluste, ont subi sans doute l'influence de l'histoire philosophique de Polybe et surtout de Posidonius. Ils ont emprunté, surtout à Posidonius, les renseignements qui pouvaient leur servir. Mais dans l'ensemble ils apparaissent comme des élèves des rhéteurs encore bien plus que des philosophes. L'histoire n'est véritablement pour eux qu'une sorte de plaidoyer dans lequel la narration représente l'élément principal et qui comporte essentiellement les mêmes procédés et les mêmes ornements que toute œuvre oratoire. La passion politique qui les
anime, la part prépondérante que tient l'éloquence dans la vie publique romaine, ne sont évidemment pas étrangères à cette conception. L'origine ne s'en trouve pas moins dans les enseignements de la rhétorique grecque.
La formation intellectuelle de César avait été la même que celle de Cicéron et de tous les hommes politiques romains. Il s'était préparé à être orateur. C'est à d'autres moyens que l'éloquence qu'il demanda le pouvoir politique;
(1) Brut., 11,42. C'est, il est vrai, Atticus qui parle, et en riant. Il souligne ainsi une fantaisie historique de Cicéron, s'écartant d'une version qu'il soutenait lui-même à propos de la mort de Coriolan.
il n'en avait pas moins, dans sa jeunesse, étudié à Rhodes et fréquenté lui aussi les cours de Molon (1). C'est bien comme un plaidoyer personnel, ayant pour base un rapport militaire, qu'il faut considérer ses Commentaires. Le style est celui de la narration ; la phrase est courte, le fait y est l'essentiel. C'est là un effet de l'art. La limpidité de la phrase de César est d'ailleurs souvent plus apparente que réelle. Lorsqu'il s'agit de préciser le détail et de fixer la réalité qu'elle enveloppe, on reconnaît combien cette simplicité se rapproche parfois du schématisme qui supprime, comme accessoire, ce qui serait essentiel pour n'accuser que le trait utile à la cause. Les actes et les décisions de César y apparaissent en belle lumière, on comprend moins bien les manœuvres de l'ennemi qui se trouve traité à peu près comme la partie adverse dans l'exposé d'une cause. Déjà les contemporains ne se faisaient pas faute d'observer tout ce qu'il y avait d'artificiel dans ces prétendues notes de campagne (2). C'est à la rhétorique qu'il faut l'attribuer.
La rhétorique apparaît encore plus nettement chez Salluste. Salluste a choisi en Grèce son modèle, c'est Thucydide. Or, pour les rhéteurs attiques, Thucydide est le maître dont on analyse les procédés et dont on propose le style comme un exemple à imiter. Salluste essaye d'en reproduire la concision pleine et nerveuse. Par opposition à la période régulière de Cicéron, il recherche les effets provenant delà dissymétrie. Ses fins de phrase ne se soumettent pas aux règles métriques. L'art auquel il vise prétend à un aspect un peu fruste et archaïque. C'est là aussi une affectation savante. Salluste appartient à la jeune école des néo-attiques qui, loin de renier la rhétorique, ne prétend, au contraire, que la pousser jusqu'à une perfection plus raffinée.
(1) suet., Caes,4- Sur son éloquence, ibid., 56. Les éloges que, dans le Brutus, Cicéron lui fait adresser par Atticus paraissent empreints de quelque flatterie : Brut., 72, 252-3.
(2) Asinius Pollion, ap. suet., Caes., 57.
Si la forme de Salluste peut rappeler le style de Thucydide, combien l'esprit du Catilina, du Jugurtha et des quelques fragments qui nous restent des Histoires ne s'écarte-t-il pas de la hautaine impartialité de l'historien grec ! C'est pour servir son parti, c'est surtout pour desservir ses adversaires, que Salluste écrit l'histoire. Le Forum lui est fermé, il cherche ailleurs une tribune dont les échos seront encore plus durables. Il moralise dans ses préfaces, il plaide et invective tout le long de son récit, recherchant comme un effet nouveau le contraste entre l'austérité, la froideur extérieure du style jet la passion ardente de l'idée.
Ni César ni Salluste ne sont « cicéroniens », en ce sens qu’ils n'appartiennent pas exactement à la même école littéraire que Cicéron. Ils n'ont pas le même idéal, mais ils ont le même art qui est, d'une façon générale, celui de la rhétorique grecque. Orateur et historiens sont, presque au même titre, les élèves des rhéteurs, ils possèdent la même formation qui se confond avec la formation littéraire elle-même.
De toutes les disciplines grecques, c'est la technique oratoire qui a obtenu à Rome le succès le plus complet. Tandis qu'en philosophie ou en science les Romains sont demeurés des disciples ou se sont bornés à être des compilateurs, ils ont, en rhétorique, atteint la complète maîtrise. Ils y étaient préparés sans doute par l'importance toute particulière de l'éloquence dans la vie romaine. Mais en cessant d'être une simple pratique, en devenant un art, l'éloquence et avec elle la prose littéraire romaine a renoncé à tout caractère proprement national. La différence entre Démosthène et Cicéron ne tient pas, à ce que l'un est grec et l'autre romain. Elle provient sans doute de la différence des tempéraments individuels, mais elle doit s'expliquer surtout par le développement apporté à la rhétorique entre le IV ème et le Ier siècle avant, notre ère, par les écoles du monde hellénistiqne.
CHAPITRE VIII
LA POÉSIE, — CATULLE
Qu'il s'agisse d'action politique et sociale — avec les Gracques — ou de spéculation pure — avec Lucrèce — ou des sciences appliquées, ou de l'éloquence — avec Cicéron, — l'esprit romain apparaît entièrement soumis aux formes grecques. Il en est de même de la poésie.
La forme de la poésie, ce sont non seulement les genres, mais aussi les mètres. Les uns et les autres d'ailleurs vont de pair, et l'on sait leur importance dans la poétique ancienne. Les genres les plus cultivés à l'époque hellénistique sont, avec l'épigramme et les poésies légères de circonstance dont l’Anthologie nous a conservé la fleur, les petits poèmes pittoresques et érudits tels qu'en composa Callimaque, ou l'élégie sentimentale et volontiers érotique. Ce sont ceux que nous trouvons à Rome avec Catulle. Les mètres aussi sont entièrement grecs. L'un des principaux mérites de cette poésie, aux yeux des contemporains, devait être précisément l'habileté avec laquelle les types de vers créés par Anacréon, par Archiloque, par Sappho se trouvaient adaptés au latin. D'autres Romains avaient sans doute, avant Catulle, imité les mêmes modèles. L'originalité consiste chez lui dans la science délicate d'une forme aussi parfaite que celle des poètes alexandrins.
Inspirées du grec apparaissent également bon nombre d'expressions, d'alliances de mots et d'images. Catulle rentre, en cela, dans la tradition de la poésie latine depuis ses débuts. Les rapprochements de ce genre que trouvent à faire ses commentateurs seraient sans aucun doute bien plus nombreux encore si la majeure partie de la poésie alexandrine n'avait pas disparu. Imitation volontaire souvent et souvent aussi, très certainement, inconsciente. Formée par la lecture des œuvres grecques, par les légendes, éduquée aussi par la vue des œuvres d'art, sculptures, bas-reliefs et surtout peintures, l'imagination romaine ne se distingue guère de celle des Grecs contemporains; la mémoire des poètes est pleine de réminiscences qu'ils n'ont qu'à exprimer en latin. Ils le savent et ne s'en cachent point :
... Veterum dulci scriptorum carmine Musae
Obleclant (1).
Les vieux poètes dont la douceur charme Catulle, ce sont, bien entendu, les Grecs. On ne conçoit pas plus, de son temps, la poésie sans la poétique grecque que la prose littéraire en dehors de la rhétorique.
Catulle d'ailleurs n'est pas un isolé. Il appartient à ce groupe de jeunes gens qui, au nom de l'atticisme, opposaient à l'abondance cicéronienne un idéal plus sobre et plus sévère. Cette école nouvelle s'affirme entre les années 60 et 53. Elle a pour chef Valerius Caton, la Sirène latine, celui qui, entre tous, excellait à lire les poètes et qui savait les former. L'esprit le plus vigoureux et le plus énergique, celui qui aurait pu exercer sur son temps l'influence la plus considérable s'il n'était mort à trente-cinq ans emporté par son ardeur excessive au travail, était Licinius Calvus, fils de l'annaliste Licinius Macer, « le petit bout d'homme éloquent », disertum salaputionem, comme l'appelle Catulle. C'était lui dont le genre nouveau et les succès au Forum alarmaient Cicéron.
(1)CAT., 68,7.
Non moins qu'à son éloquence, Calvus devait grande réputation à son oeuvre poétique, épigrammes, épithalames, élégies et poème sur les courses vagabondes d'Io, dans lequel il s’inspirait fort probablement de Callimaque. L'un des plus célèbres, après Calvus, de ces jeunes poètes amis de Catulle, était Helvius Cinna, auteur d'une Smyrna, très vantée par les contemporains. Le sujet de ce petit poème était l'amour incestueux de Smyrna pour son père, amour dont serait né Àdonis et qui devait être chanté plus tard par Ovide. De toute cette floraison délicate, le hasard ne nous a conservé que l'œuvre de Catulle.
Ces jeunes gens, nés entre les années 90 et 89, qui arrivent à l'âge d'homme, vers le moment où va se préciser la rivalité entre Pompée et César, dont quelques-uns verront encore Actium et l'établissement de l'empire, ne sont pas exclusivement des savants adonnés tout entiers à leur art. Calvus, homme d'action et orateur, sans ambition politique cependant — il ne brigua jamais aucune charge — est parmi eux une exception. La plupart des autres et Catulle en particulier prétendent jouir de la vie : ils dédaignent l'action mais goûtent fort la société. Catulle est un poète mondain. Les épigrammes et les pièces légères qui forment la majeure partie de son œuvre sont des poésies de circonstance. Beaucoup d'entre elles s'inspirent peut-être de modèles grecs, leur technique, leur art est grec ; elles n'en doivent pas moins leur composition aux menus événements de la vie de société romaine et surtout aux incidents de la vie sentimentale du poète. Laissons de côté leur forme pour chercher ce qui en fait l'âme. Sous le jeu, nous trouverons l'émotion sincère. Une passion qui n'a plus rien d'alexandrin, parfois brutale, souvent généreuse, palpite dans le vers savamment ciselé. L'ardeur d'une jeunesse encore un peu fruste vivifie et transforme en beauté le maniérisme d'une poésie artificielle. Elle y met la marque romaine. Provincial, né à Vérone d'une famille aisée, Catulle était venu à Rome avant sa vingtième année, sans doute pour y achever son instruction et y préparer une carrière politique. Les relations mondaines, en ce temps-là, offraient un utile appui à l'ambition et, dans le monde, les femmes commençaient à jouer un rôle prépondérant. L'époque hellénistique fut le triomphe de là femme; l'exemple d'Alexandrie où les reines commandaient aux rois avait influé sur tout le monde méditerranéen. Il en était à Rome comme ailleurs. César avait su habilement utiliser ses succès féminins et il n'en avait point usé autrement que beaucoup d'autres. Plutarque raconte comment s'y prit Lucullus pour obtenir le gouvernement de la Cilicie. Le tribun Cethegus dominait alors dans la ville, or Lucullus avait peu auparavant fait campagne contre lui et en était fort mal vu.
Il y avait alors à Rome une femme nommée Precia, du nombre de celles que leur beauté et les grâces de leur esprit avaient rendues célèbres, mais qui au fond ne se conduisait guère mieux qu'une courtisane de profession... Quand Cethegus eut été pris pour elle d'une passion extrêmement vive, toute l'autorité fut dans les mains de cette femme; aucune affaire publique ne se faisait que par Cethegus et l'on n'obtenait rien de Cethegus que par Precia. Lucullus, pour la gagner, n'épargna donc ni flatteries ni présents; il lui faisait assidûment une cour qui flattait l'orgueil et l'ambition de cette femme. Dès ce moment, Cethegus devint le panégyriste ce Lucullus et brigua pour lui la Cilicie... (1).
Catulle n'était pas Lucullus. Nous ne savons si l'ambition tout d'abord l'aiguilla vers la maison de Lesbie. En tout cas il ne tarda pas à y oublier tout autre sentiment que l'amour. Lesbie, semble-t-il bien, n'était autre que Clodia Metella, la sœur de Clodius Pulcher, l'ennemi de Cicéron, celui que tua Milon, et femme de Q. Caecilius Metellus, consul en. 60. Elle appartenait exactement à la même catégorie que Precia. Mariée en 63, elle devint veuve dès 59; on l'accusait d'avoir empoisonné son mari; on l'accusait encore d'inceste avec son frère.
(1) plut., Lucullus, 9.
En 56, Cicéron eut à défendre contre elle un de ses anciens amants qui avait voulu, prétendait-elle, l'empoisonner. C'était Caelius, l'ancien élève, l'ami et, plus tard, le correspondant de Cicéron. Le Pro Caelio trace de Clodia un portrait cruel qui justifierait bien les dernières invectives de Catulle contre Lesbie.
Dès son arrivée à Rome, vers 62 et pendant près de quatre ans, l'amour de Lesbie paraît avoir été pour Catulle la principale raison de vivre. La mort du mari semble avoir marqué la fin de son bonheur. En 57 il a définitivement rompu et part en Bithynie à la suite de Memmius, celui-là même à qui Lucrèce dédia son poème, un assez piètre personnage à en juger parce que nom en confie Catulle. C'est vers ce moment, de 58 à 54, que se placent les quelques poèmes plus étendus que les autres qui forment comme le centre de l'œuvre de Catulle, les deux Épithalames (pièces 61 et 62), le poème d'Attis (63), l’Épithalame de Thétis et de Pelée (64), le poème sur la Chevelure de Bérénice (66), imitation de Callimaque, enfin l'admirable élégie (68) où il exhale à la fois le chagrin que lui cause la mort de son frère et la profonde mélancolie de son amour malheureux. Il meurt âgé d'un peu plus de trente ans, avant l'année 50.
Dans le cercle brillant et léger qui entoure Lesbie, Catulle se laisse aller d'abord tout entier au bonheur d'aimer. Son esprit et sa grâce enjouée doivent lui valoir des succès dont il est fier de faire hommage à sa maîtresse. Il y a bien quelque afféterie dans les deux pièces fameuses sur le moineau de Lesbie, mais la fraîcheur juvénile des Baisers n'est gâtée ni par l'écho épicurien qui fait comme le fond de la première pièce ni par l'érudition mythologique qui se mêle au motif de la seconde. En même temps Catulle plaisante ses amis ou lance quelque épigramme, grossière parfois et qui indique dans cette société un raffinement un peu hâtif et bien superficiel, contre tel ou tel qui avait dû déplaire ou peut-être trop plaire. Il est insouciant et gai. Il sait à l'occasion esquisser d'un dessin net et d'une couleur simple mais charmante une scène de genre ou même un tableau de nature plus large, dans lequel le sentiment s'unit au pittoresque. Son art léger et gracieux est celui des peintures aux teintes claires qu'encadrent des guirlandes liées de rubans.
Noté d'un trait, avec une précision sous laquelle se devine le trouble de la passion, son amour apparaît d'une sincérité presque naïve. Ce n'est pas fantaisie d'imagination ni même amour de tête. Catulle aime d'un cœur ardent ; il aime avec noblesse. Aux premiers déboires il oppose un courage un peu fanfaron. Mais la trahison a blessé son amour « comme la fleur, à la limite d'un champ, est touchée par le passage de la charrue ». Il s'inspire, sans doute, pour peindre le sentiment qu'il ressent, du modèle de Sappho, mais c'est que l'œuvre grecque lui semble exprimer de façon parfaite sa propre expérience. L'imitation n'est pas simple exercice littéraire.
Il est l'égal d'un dieu, il est, si possible, plus qu'un dieu, celui qui assis près de toi te voit et t'entend doucement souriante. Malheureux, ta vue me ravit l'usage de mes sens, car sitôt, ma Lesbie, que je t'ai aperçue, tout disparaît pour moi... ma langue est muette, subtilement dans tous mes membres une flamme se répand, un bourdonnement tinte dans mes oreilles, un voile couvre mes yeux de nuit... — Je t'aimais, Lesbie, non seulement comme quiconque aime sa maîtresse, mais comme un père aime son enfant. Aujourd'hui je te connais, ma passion est plus vive mais tu m'es infiniment moins précieuse et moins chère. — Comment dis-tu? — Oui, une telle injure force un amant à désirer davantage, mais à aimer moins. — Je ne pourrai désormais ni t'aimer si tu devenais parfaite, ni cesser de te désirer quoi que tu fasses.
Et c'est, tracé en quelques vers, le roman banal, sans doute, mais profondément senti, des nouveaux serments et des nouvelles querelles, des efforts de l'homme pour se ressaisir, de ses fureurs contre les nouveaux amants et, enfin, des injures passionnées. Le voile de préciosité qui cachait l'amour heureux est déchiré, souvenirs littéraires ou philosophiques, la mythologie même, tout est oublié : « Je hais et je désire. Comment puis-je faire? demanderas-tu. Je ne sais, mais je le sens et je souffre.»
Ce roman de Catulle et de Lesbie est l'un des très rares documents de la sentimentalité antique. On a prétendu que l'antiquité et, en particulier, l'antiquité romaine n'avait jamais connu toute cette gamme de sentiments qui font à l'amour comme une sorte d'auréole. Les nuances subtiles et infiniment variables de la passion qui fournissent chez nous l'un de ses éléments essentiels à la poésie lyrique, au théâtre et au roman, ne tiennent en effet que fort peu de place dans la littérature latine. On imagine généralement, dans la société romaine, une distinction absolue entre l'amour conjugal dont la calme tendresse est tout empreinte de gravité et la sensualité des liaisons irrégulières. Pour la materfamilias, le Romain éprouve une affection confiante dont mainte épitaphe de la fin de l'époque républicaine ou du début de l'empire dit encore tout le sérieux et la profondeur. Aimer, au contraire, est le fait de la passion. Entre l'un et l'autre sentiment existe la différence marquée chez Catulle par l'opposition entre les deux termes amare et bene velle. C'est le dernier que développe et explique la pièce 72 : « Je t'ai aimée comme un père chérit ses fils et ses gendres... » Pour sa maîtresse, Catulle éprouve non seulement la passion sensuelle des amours illégitimes, mais en outre toute la tendresse des justes noces. « Ma Lesbie, oui, Lesbie, cette Lesbie que Catulle a aimée par-dessus tout, plus que lui-même, plus que tous les siens... » Les désillusions ont tué la tendresse mais sans amortir la passion. C'est encore la passion que manifestent les malédictions et les injures contre l'infidèle.
Cet amour à la fois passionné et tendre apparaît chez Catulle profondément sincère. Il est pur de tout mélange de convention, de toute mode passagère, de toute influence littéraire. Est-il grec ? Est-il romain ? Est-il antique ou moderne ? Vaine question ; il est l'amour simplement, ressenti par une âme à la fois violente et délicate, exprimé par un esprit assez maître de son art pour en traduire toute la vivacité sans en supprimer ou en fausser les nuances.
L'amour, la joie, la colère, l'indignation, toute la gamme des sentiments et des impressions fugitives, atteignent avec Catulle une forme littéraire. Avec lui se constitue le lyrisme qui se développe et s'épanouit dans lespoèmes de plus ample envergure, Telle est la grande nouveauté de son œuvre.
La puissante vibration sentimentale imprimée par la passion malheureuse à l'âme artiste de Catulle semble avoir donné l'essor à son talent. Elle l'a dégagé du simple jeu de l'imitation savante. Les autres pièces, celles où il n'est plus question de Lesbie et qui s'inspirent de modèles grecs, en conservent une sensibilité toujours en éveil qui anime les fictions, s'émeut des mythes et des images et les teinte d'une mélancolie voilée. On dirait une blessure demeurée irritable qui répond aux moindres excitations et communique à toute la vie un pathétique douloureux.
C'est cette sorte d'atmosphère morale qui enveloppe les tableaux divers tracés par Catulle. Elle prête une âme, pour ainsi dire, à sa virtuosité savante. Le petit poème d'Attis (1), par exemple, n'a aucun rapport ni avec les sentiments personnels de Catulle ni même avec l'amour. Est-il une simple imitation, ou un développement de quelque modèle grec, ou plutôt a-t-il été inspiré au poète par quelque scène aperçue lors de son voyage en Bithynie ? Peu importe.
(1) Pièce 63.
On y peut noter, au premier plan, la recherche d'un pittoresque exotique. Le mouvement de l'orgie phrygienne s'y trouve
exprimé d'un trait précis et rapide.
Hâtons-nous, montons tous ensemble, ô Galles, aux sommets boisés de Cybèle, venez tous ensemble, troupeau vagabond de la souveraine du Dindyme... Point de retard, marchons tous ensemble, suivez-moi vers la demeure phrygienne de Cybèle, vers les bois phrygiens de la déesse, où résonne la voix des cymbales, où retentissent les tambourins, où le flûtiste phrygien chante sa plainte sur son roseau recourbé, où secouent leurs têtes avec violence les Ménades couronnées de lierre, où elles célèbrent leurs rites sacrés avec des hurlements aigus...
Mais bientôt reparaît la plainte mélancolique où des sentiments vrais se mêlent à la fiction, où l'âme du poète prête à son art une sincérité émouvante :
O ma patrie, toi qui m'as créé; patrie, ô toi qui m'as engendré! Je t'ai abandonnée, malheureux, comme les esclaves fugitifs abandonnent leur maître... Ma patrie, mes biens, mes amis, mes parents, j'ai tout perdu ; j'ai perdu le forum, la palestre, le stade et les gymnases. Malheur! ah malheur! gémis, gémis encore, ô mon cœur!... J'ai été éphèbe, j'ai été enfant, j'ai été la fleur du gymnase, j'ai été la gloire des athlètes ; à moi les portes où accourait la foule, à moi les seuils chauds d'enthousiasme, à moi les couronnes fleuries... Et me voilà maintenant prêtresse des dieux, servante de Cybèle...
Les lions qu'envoie la déesse pour ramener son galle infidèle, ne sont-ils pas un symbole de la force invincible qui ramène l'amant à l'objet de sa passion ?
Grande déesse, déesse Cybèle, déesse dame de Dindyme, écarte, ô souveraine, toutes tes fureurs de ma maison; à d'autres inspire tes transports, à d'autres inspire tes égarements !
Dans l’Épithalame de Thétis et de Pelée, les plaintes d'Ariane abandonnée sont, de même, le centre et comme le motif principal du poème. Ne faut-il pas aussi comprendre comme une explosion de lyrisme sincère cette peinture de l'amour qui pénètre la jeune fille et embrase jusqu'au fond toutes les moelles de son corps ?
O loi qui infliges, hélas ! aux malheureux mortels le tourment d'un si cruel délire, divin enfant, qui mêle à leurs joies tant de peines, et toi, déesse qui régnai sur Golges et l'ombreuse Idalie, de quelles tempêtes vous avez agité le cœur enflammé de cette vierge quand l’étranger à la blonde chevelure lui arrachait tant de soupirs !
On a pu parler, à propos d'Alexandrie, de 1' « érotisme alambiqué de la production littéraire ». L'érotisme, certes, ne fait pas défaut chez les Alexandrins de Rome. Mais chez Catulle au moins, le seul que nous connaissions des poètes de la jeune école, un souffle sincère, généreux et puissant vient animer ces images légères. Le raffinement et l'esprit, l'art trop subtil de ses maîtres, devient chez ce Romain une sévère conscience professionnelle cherchant, en même temps que la couleur, la simplicité du trait et la netteté de la ligne.
Avec Catulle, la forme poétique atteint à Rome sa perfection. Elle est pleine et comme ramassée. Peu de mots, tous soigneusement choisis, chargés de sens et artistement enchâssés dans le vers, dessinent des images d'un style savant. Cet art est celui de la poésie grecque contemporaine qui continue la tradition de Callimaque. Il conserve cependant je ne sais quoi de plus rigide, mais de plus vigoureux aussi et de plus pur. La grâce n'y fait pas défaut cependant. On trouve en abondance, chez Catulle, de très beaux passages d'un sentiment délicat et d'une couleur extrêmement fraîche qui expriment avec éclat, en les idéalisant, les impressions sincères d'un esprit sensible à la beauté des choses, des passages où se reconnaît à la fois le style de l'époque et le talent d'un véritable artiste. Nous n'en voulons citer qu'un seul, les strophes alternées des jeunes gens et des jeunes filles dans le Chant nuptial :
Comme une fleur mystérieuse, dans l'enceinte d'un jardin, croit ignorée des troupeaux, respectée du soc meurtrier, les zéphyrs la caressent, le soleil l'affermit, la rosée la nourrit.., tous les jeunes gens, toutes les jeunes filles la désirent ; une fois cueillie par l'ongle tranchant, ni jeunes gens ni jeunes filles ne la désirent plus. Ainsi la vierge, tant qu'elle reste étrangère à l'hymen, est chère à tous les siens... — Comme une vigne solitaire née dans un champ sans culture jamais ne s'élève, jamais ne produit la douce grappe; son plus haut rameau retombe sur sa racine; ni laboureur ni berger ne s'en soucie. Mais qu'elle s'unisse à l'ormeau marital, tous, bergers et laboureurs l'admirent à l'envi. Ainsi la vierge, tant qu'elle demeure étrangère à l'amour, tant qu'elle vieillit abandonnée Mais un mariage heureux formé au juste temps la rend chère àson époux, chère à ses parents.
Tandis que par sa minutie parfois un peu pénible, Lucrèce, contemporain de Catulle, appartient encore à l'archaïsme, l'art des alexandrins de Rome, plus souple mais qui ne connaît pas encore la mièvrerie, a déjà toutes les qualités classiques. Art d'imitation, sans doute, mais qui par ses qualités propres, par sa sincérité surtout et par sa jeune vigueur, devait dépasser de loin ses modèles. De même que le talent de Cicéron, animé par la vie et porté parfois par la passion, s'élève bien au-dessus de la rhétorique qui l'a formé, qui le nourrit et souvent l'entrave, la poésie romaine de la fin de la République ajoute l'inspiration véritable à l'art délicat et savant des techniciens grecs. Le monde hellénique d'alors n'avait aucun poète à opposer ni à Lucrèce ni à Catulle.
CHAPITRE IX
L'ART GREC A ROME
I
l'invasion des œuvres d'art et des artistes grecs.
Si, durant le dernier siècle de la République, le contact de la vie prête à l'éloquence, comme à l'histoire, comme à la poésie romaine, quelque chose de plus dru et de plus passionné, c'est-à-dire un caractère infiniment plus vigoureux que tout ce que nous pouvons trouver dans le monde grec depuis Alexandre, les arts plastiques sont loin de présenter la même originalité. Ils accusent sans doute, d'une façon générale, les mêmes tendances et les mêmes goûts que l'ensemble de la littérature, mais sans revêtir l'inspiration grecque d'une forme romain? Ils montrent à nu, pour ainsi dire, le caractère foncièrement hellénisant de la civilisation que Rome et l'Italie partagent avec tout le monde méditerranéen.
Lorsque, au début du second siècle avant notre ère, Rome se trouve attirée vers la Grèce et les royaumes hellénisés d'Asie, elle possède déjà une longue et belle carrière artistique dont nous ayons essayé, plus haut, de retrouver quelques traits. L'art ancien de Rome, c'est celui de l'Etrurie, c'est celui de la Campanie et de l'Italie méridionale dont elle s'est, au cours de son histoire et de ses conquêtes, assimilé les qualités diverses. Capitale de l'Italie, elle a synthétisé le génie de toute la péninsule. Au cours du second siècle, les traditions italiennes cèdent peu à peu la place à celles de la Grèce contemporaine. Au Ier siècle, la révolution est accomplie et l'art romain apparaît entièrement grec.
Il s'est produit à Rome, à ce moment, un phénomène analogue à celui que l'on constate en France au XVI ème siècle. Des principes d'art nouveau ont tout à coup envahi le pays, reléguant dans le dédain les formes anciennes, les étouffant ou du moins les réduisant à une vie latente. L'effet des expéditions romaines en Grèce et en Asie peut se comparer à celui des expéditions françaises en Italie qui ont produit la Renaissance.
Tous les souvenirs de l'art ancien ne disparaissent sans doute pas complètement. Ils survivent obscurément dans l'art populaire, en particulier dans les campagnes écartées de Rome. Beaucoup plus tard, sous l'Empire, nous avons la surprise de retrouver jusque dans les provinces étrangères à l'Italie comme la Gaule, des statuettes pieuses qui rappellent les types de l’ancienne Etrurie et, dans l'art de la capitale elle-même, nous voyons reparaître certaines tendances comme le réalisme du portrait et le soin de représenter exactement par l'image des faits historiques, tendances qui semblent bien plonger leurs racines dans l'ancienne tradition italienne. Elles marquent l'affleurement dans le grand art de traditions conservées par les artisans et les ateliers populaires, bien plutôt, nous semble-t-il, qu'un réveil de facultés innées à la race. C'est le vieil art italien qui, avec la dynastie paysanne des Flaviens et la nouvelle noblesse d'origine provinciale, sort de la longue léthargie que lui a imposée, près de trois siècles auparavant, l'engouement pour l'art hellénistique. Cet étouffement de l'art indigène apparaît comme la vengeance du monde grec pillé par Rome conquérante. Appliquant à la Grèce et à l'Asie le traitement qu'elles ont infligé à l'Italie, les armées romaines font régulièrement main basse sur les œuvres d'art accumulées dans les villes et les sanctuaires. Pour orner le triomphe des généraux, statues et tableaux sont, en masse, acheminés vers Rome. La plupart des statues de Rome et les meilleures, écrivait Strabon sous Auguste, viennent de Corinthe. Le butin artistique de deux siècles de victoires encombrait la ville et les magasins de l'Etat.
Les Romains furent émerveillés tout d'abord; plus tard ils admirèrent et aimèrent toute cette beauté ravie à la pointe de l'épée. Pline date de la mort d'Attale, c'est-à-dire du dernier tiers du II ème siècle, cette transformation de leur sentiment. La satisfaction trop aisée de l'amour du beau émoussa chez eux le goût de la recherche inquiète qui, des éléments connus, s'efforce de dégager des aspects nouveaux et constitue l'un des éléments essentiels du sentiment artistique. Un idéal qu'on croit posséder cesse d'être un idéal et en perd la vertu. Les œuvres d'art mal acquises et une surabondance de chefs-d'œuvre étrangers ont tué l'art romain. « Le dialecte artistique d'Italie meurt, dit Furtwaengler, la langue artistique grecque devient la langue universelle du monde romain». Ce ne sont pas seulement les œuvres d'art, ce sont aussi les artistes qui, des pays grecs, affluent à Rome. Des villes et des royaumes appauvris par le passage des légions les artistes s'acheminent vers la nouvelle capitale où s'accumule la fortune du monde et où ils peuvent espérer trouver une clientèle. Ils se mettront sans doute aux ordres de cette clientèle et exécuteront les travaux qu'elle leur commandera, dans le sens qu'elle exigera. Ainsi le peintre Métrodore que Paul-Emile a été cherché à Athènes sera chargé de brosser les images traditionnelles qui, au jour du triomphe, raconteront pour ainsi dire au peuple romain les exploits de ses armées. La commande sans doute dirige l'artiste. Mais les idées, les goûts et les habitudes de l'artiste s'imposent aussi à la clientèle, surtout lorsque ces clients, comme l'élite romaine du temps de Flamininus et de Scipion Emilien, sont entichés d'hellénisme et reconnaissent toute la supériorité de la tradition grecque sur la leur.
Ce ne sont pas du reste des artistes isolés, mais des familles entières et des ateliers grecs qui viennent s'installer à Rome. Telle est la famille de ce Timarchidès, de Polyclès et de Dionysos, que ramène Metellus le Macédonien. Tel est plus tard, sous Auguste, le graveur en pierres fines Dioscouridès et ses trois fils Eutychos, Hérophilos et Hyllos. Au début de l'époque impériale, un certain nombre de signatures nous font connaître les noms des artistes qui travaillent à Rome; ce sont presque tous des Grecs, et en grande majorité des Athéniens, Apollonios, Antiochos, Criton et Nicolaos, Glycon, Cleomenes, Menophantos...
C'est donc l'art grec qui, avec eux, s'implante à Rome, l'art grec avec ses motifs, avec son style et aussi ses théories. En art, comme dans les sciences, comme dans la rhétorique, comme dans la poésie, la technique grecque, la texen, s'imposa aux Romains. Comme l'art n'a pas besoin de la transposition à laquelle la langue oblige la littérature, comme il n'est généralement pas pratiqué par des Romains, l'art de Rome, durant les derniers siècles de la République, ne se distingue pas de celui du monde hellénistique contemporain. Ce n'est pas à Rome que nous en trouverons les tendances directrices.
Dans cette grande civilisation méditerranéenne qui, à ce moment, envahit l'Italie, les écoles esthétiques correspondent aux écoles littéraires. Nous reconnaissons dans l'art les influences opposées de l'Asie et de l'Attique auxquelles viennent s'ajouter celles d'Alexandrie. Les grands centres intellectuels sont aussi, en effet, les centres artistiques. Ils exercent leur action sur Rome. Les tendances diverses y aboutissent et s'y mélangent. S'il est un caractère propre à l'art romain, il consiste précisément dans l'éclectisme qui accueille, avec une facilité témoignant peut-être de peu de discernement, les styles les plus divers. Devant le flot d'idées nouvelles que lui apporte le courant méditerranéen, le Romain se trouve quelque peu désemparé : il ne sait que choisir et, dans son embarras, adopte tout. Ce sont les circonstances plutôt qu'une volonté propre ou un goût marqué qui décident de la succession des modes et des styles.
II
l'art asiatique. pergame.
Le courant le plus ancien et le plus profond, semble-t-il, est celui qui vient d'Asie- Dès le début du II ème siècle, l'Asie, où les armées romaines ont pénétré presque aussi tôt qu'en Grèce, a frappé l'imagination des Romains bien plus encore que la Grèce propre.
En Grèce, les Romains trouvaient une vie municipale assez semblable à celle de la province italienne et plus mesquine que celle des villes grecques d'Italie. Le pays était pauvre. Athènes et surtout Corinthe faisaient seules exceptions à la médiocrité générale. Bien peu parmi les Romains étaient à même d'apprécier la noblesse des souvenirs et la grandeur des modestes cités qui, par le libre développement de l'intelligence et la passion du beau, avaient contribué au progrès de la civilisation hellénique. Bien peu, au contraire, pouvaient manquer d'admirer la richesse éclatante de l'Asie.
L'Asie était le domaine de la couleur et du colossal. Les terres s'en étendent à l'infini, bordées de déserts qui en prolongent l'horizon plutôt qu'ils ne le limitent. Chaque royaume y groupait de nombreuses provinces, plus vastes chacune que la Grèce. Les villes y étaient immenses, regorgeant d'un peuple actif, industrieux et bruyant. Dans les capitales, une cour déployait son luxe autour du souverain. Les moindres cités étalaient l'ambition des gouverneurs royaux maîtres de la fortune et de l'obéissance de sujets humblement soumis. La puissance du maître se manifestait par l'éclat de sa richesse, par l'ampleur du palais, par l'ostentation de monuments d'un goût moins pur mais plus somptueux que ceux de la Grèce. Quel exemple et quelle tentation pour les chefs romains comme pour le moindre des soldats! C'est en Asie que les Romains ont pris le goût du luxe et du gigantesque en même temps que les habitudes du despotisme.
Des rives de la Méditerranée à celles de l'Euphrate et du Nil, les triomphes d'Alexandre avaient mêlé deux mondes, la Grèce et l'Orient. Les lieutenants du héros avaient fondé en pays barbare des monarchies grecques calquées sur le modèle oriental; les généraux macédoniens et leurs descendants s'étaient mués en successeurs et émules du Grand Roi. Ils restaient Grecs cependant et attiraient autour d'eux le meilleur des forces helléniques en même temps que l'aristocratie indigène. Celle-ci s'hellénisait, mais en laissant de ce côté ce qu'elle ne comprenait pas de la culture grecque et en introduisant en échange, parmi les Grecs qui se mêlaient à elle, quelques-unes des traditions de son passé et de ses principes moraux, politiques et sociaux. Il n'était que trop aisé aux Grecs maîtres de l'Asie de se barbariser et d'adopter la richesse matérielle de ceux qu'ils dominaient en même temps que les vices, conséquence naturelle de l'excès. Le plus admirable, c'est la persistance de l'hellénisme dans ces cours plus qu'à demi orientales et le culte presque religieux dont y demeurèrent entourés les arts et les lettres grecques.
Leur richesse nouvelle permettait d'ailleurs aux dynastes grecs d'Asie et de l'Egypte de prêter à la vie intellectuelle et artistique un développement beaucoup plus ample et brillant que ne pouvait le faire la Grèce propre. Dans les cités grecques, l'architecture s'était bornée le plus souvent à élever des temples aux dieux. En Asie, c'étaient des villes entières qu'il s'agissait de construire. Les habitations privées, les perspectives et l'agencement des rues, les places publiques, les édifices civils et surtout les palais des princes avec toutes leurs annexes, posaient une infinité de problèmes nouveaux dont la solution était confiée à l'artiste. L'art religieux des temps anciens avait cherché la beauté dans l'harmonie des proportions, dans la simplicité des lignes et la gravité sévère de la décoration. L'esprit nouveau appelait le gigantesque et multipliait l'ornement. Au sculpteur, au peintre, au mosaïste, au ciseleur même, l'architecte confiait la décoration de vastes surfaces. L'immensité des places publiques, le long développement des portiques, les jardins, exigeaient des statues ou plutôt des groupes et sollicitaient tous les artifices qui attirent l'œil, l'occupent et l'amusent. L'art grec avait à remplir un cadre oriental.
Trois villes avaient pris, dès le III ème siècle, la tête de ce mouvement : Alexandrie, la capitale des Ptolémées, Antioche, capitale des Séleucides en Syrie et, un peu plus tard, Pergame, capitale des Attalides en Asie Mineure. D'Antioche, nous savons trop peu de chose pour pouvoir mesurer le rôle qu'elle a joué dans la civilisation hellénistique. Mais on ne saurait comprendre l'art romain sans se représenter, au moins dans ses grandes lignes, le développement reçu par l'art grec à Pergame et à Alexandrie.
Pergame était une création de sa dynastie qui l'avait presque entièrement construite et, peu à peu, avait constitué autour d'elle un royaume. Elle commence à jouer un rôle important dans le monde hellénistique avec Attale I (241-197) qui avait conquis sur les Syriens une bonne partie de l'Asie Mineure. Ennemi de Philippe de Macédoine, Attale opposait son philhellénisme à la brutalité macédonienne et comblait en particulier Athènes de ses attentions. Il était en même temps, depuis la fin du III ème siècle, l'ami des Romains; c'est lui qui, vers la fin de la seconde guerre punique, en 204, leur avait envoyé le bétyle sacré de Pessinonte; Homère faisait à Pergame figure de poète national ; l'amitié d'Attale n'est sans doute pas étrangère au développement que reçut à Rome la légende du Phrygien Enée. Le successeur d'Attale, Eumène II (197-159), avait pris nettement parti pour les Romains contre la Macédoine et la Syrie et avait partagé avec Rome les dépouilles d'Antiochus. Il se présentait en même temps en Asie comme le protecteur de l'hellénisme contre les Barbares, Galates ou autres et faisait construire à Athènes le portique dont les ruines se voient aujourd'hui encore entre l'Odéon d'Hérode Atticus et le théâtre de Dionysos. Sous Attale (159-138) les Romains se trouvaient déjà effectivement les maîtres de Pergame. Intelligents et exceptionnellement vertueux parmi les princes d'Asie, vaillants soldats et diplomates habiles, les souverains de Pergame employaient leur richesse, demeurée proverbiale, à construire de beaux monuments et à attirer autour d'eux artistes et savants. Max. Collignon les compare aux Médicis. Mais en 138 Pergame tombe entre les mains d'Attale III, un fou inquiet et soupçonneux qui, n'ayant pas d'héritier, pousse le dévouement à Rome jusqu'à lui léguer ses trésors et son royaume. A sa mort, en 133, le vaste domaine constitué en Asie Mineure par les Attalides devenait la province romaine d'Asie.
C'est l'hellénisme qui triomphe à Pergame, un hellénisme plus pur de tout mélange indigène qu'en Syrie et en Egypte, presque celui d'Athènes mais vivifié par la faveur de souverains actifs et la richesse de l'Asie. Athéna est la souveraine de Pergame. Tandis qu'Athènes prend les apparences d'une ville morte peuplée d'oisifs au milieu desquels pérorent rhéteurs et philosophes, Pergame est une ville industrieuse et active où fleurissent les manufactures royales de brocarts d'or, où l'effort des artistes est soutenu par un grand mouvement industriel, par une vie politique intense, par des victoires à célébrer, par d'amples commandes à satisfaire. Ses rois cherchent à rivaliser avec ceux de l'Egypte : ils créent une Bibliothèque dont ils font un centre d'études et d'enseignements aussi variés que le Musée d'Alexandrie. C'est là que professait Cratès de Mallos dont l'ambassade à Rome, vers le milieu du II ème siècle avant notre ère, fut l'un des événements capitaux de la vie intellectuelle romaine. C'est à Pergame, aux leçons de Cratès que s'était formé Panœtius. Le royaume des Attalides devenu province romaine, Rhodes recueille pour ainsi dire l'héritage des écoles et des ateliers de Pergame. Posidonius professait à Rhodes. Les maîtres de Pergame et plus tard ceux de Rhodes furent les véritables intermédiaires entre l'hellénisme et Rome.
Les Romains reçurent de Pergame l'initiation à la vie artistique grecque. Attale et Eumène avaient créé dans leur capitale un véritable Musée royal en constituant des collections destinées à l'ornement des palais royaux et de la Bibliothèque. Ils avaient réuni un choix d'originaux ou de copies de toutes les grandes écoles d'art helléniques. Ils achetaient ou faisaient copier les tableaux les plus célèbres. De leur impulsion est née l'histoire de l'art. Les savants de la Bibliothèque, comme Antigone de Carystos, artiste en même temps qu'écrivain, avaient rédigé à Pergame le canon des maîtres grecs qui jusqu'au temps de Pline n'a pas cessé de faire autorité à Rome.
Mais ce n’est pas seulement la critique d'art qui fleurissait à Pergame. Les arts eux-mêmes y recevaient du philhellénisme des princes une féconde impulsion. Les artistes, pour la plupart, venaient de Grèce, et en particulier d'Athènes. C'est bien l'art grec que nous trouvons à Pergame, mais l'art grec renouvelé par les programmes nouveaux que lui propose une royauté asiatique. A la fin du III ème siècle, Attale avait fait représenter, dans une série de statues destinées à orner un grand monument triomphal, ses victoires sur les Galates. La tradition artistique grecque enseignait à cacher sous le voile d'une allégorie mythologique les allusions aux faits contemporains. Ce sont au contraire des Galates authentiques, copiés de la façon la plus exacte sur le modèle vivant de prisonniers, que nous trouvons à Pergame. L'art romain, remarque M. Collignon, se chargera plus tard de pousser jusqu'au bout les conséquences de cette évolution en représentant avecune exactitude rigoureuse le type, le costume et l'armement des peuples barbares. La sculpture historique qui fleurira à Rome a ses origines non seulement dans la tradition italienne de représenter au naturel les exploits des armées triomphantes, mais aussi dans les leçons de Pergame.
Vers le premier quart du II ème siècle, Eumène II avait voulu à son tour perpétuer par un monument insigne le souvenir des victoires remportées de concert avec les Romains, victoires qui assuraient définitivement à Pergame le rang de grande puissance.
L'allégorie, cette fois, ne fut pas écartée. C'est la défaite des Géants en lutte contre les dieux que nous trouvons représentée sur la frise du grand autel. Mais dans l'allégorie s'aperçoit la même tendance au réalisme et surtout au pathétique que dans les figures des Gaulois vaincus et mourants. L'artiste accumule les épisodes tragiques, les contrastes romanesques. Dans les contorsions douloureuses des corps des Géants il cherche à exprimer l'intensité de la souffrance physique la plus aiguë. Son habileté de main est étonnante, sa science remarquable. Il multiplie les morceaux de bravoure faits suivant ces formules d'atelier qui sont à l'art ce que sont dans la littérature les recettes de la rhétorique. L’Asianisme, c'est-à-dire la tendance à la forme déclamatoire, est ce qui domine. L'œuvre est d'une conception puissante mais théâtrale. L'évolution hellénistique qui a son point de départ dans le pathétique de Scopas et le naturalisme de Lysippe est désormais complète. Elle n'ira pas plus loin. C'est en Italie que se fera sentir plus tard l'action de cet art de Pergame (1). / A Pergame en effet se constitue cette école d'art asiatique éprise de formes grandioses et de mouvements excessifs dont les ateliers rhodiens produiront vers le début du I er siècle les types les plus caractéristiques et les plus célèbres. Le Laocoon et le groupe du Taureau Farnèse, représentent dans le domaine de l'art cet asianisme déclamatoire personnifié dans l'éloquence par les rhéteurs d'Asie Mineure. Lorsque nous retrouverons ces traits à Rome, gardons-nous d'y reconnaître un caractère particulièrement romain. Ils n'y représentent qu'un style qui s'est constituée Pergame au cours du II éme siècle avant notre ère et s'est épanoui jusqu'au milieu du I er siècle avant notre ère sur la terre d'Asie.
III
alexandrie.
L'influence d'Alexandrie sur les imaginations et sur l'art romain semble avoir été moins profonde que celle de Pergame et surtout beaucoup plus tardive. Les relations politiques de Rome avec l'Egypte ne se précisent et ne se multiplient en effet qu'avec Pompée. César, après Pharsale, est le premier général romain qui, avec une armée, pénètre en Egypte. Nous ne voulons pas dire qu'avant lui, la vie, la science, l'art alexandrins soient demeurés inconnus à l'Italie. Dés le II ème siècle, Délos avait servi d'intermédiaire entre le royaume des Ptolémées et les Romains. Vers la fin de ce siècle les navires égyptiens débarquaient à Pouzzoles leurs hommes et leurs dieux qui, de là, parvenaient aisément à Rome. La science et l'érudition alexandrines semblent avoir été connues à Rome aussi bien que celles de Pergame. Le courant égyptien paraît cependant être resté longtemps plus faible et surtout avoir été toujours considéré comme beaucoup plus étranger que celui qui, par l'intermédiaire de Pergame, fit affluer en Italie l'hellénisme teinté des couleurs de l'Asie.
Au lieu d'être une alliée et bientôt une sujette comme Pergame, Alexandrie faisait figure en effet de capitale de l'hellénisme indépendant. Fondée par Alexandre pour être le centre de son empire, la ville du Nil avait conservé une sorte de primauté sur tout l'Orient. Son port était de tous le plus actif. Sa population la plus nombreuse et la plus industrieuse, ses monuments les plus célèbres. Le monde n'avait rien à opposer à son Phare, qui parait avoir été le modèle des minarets et de nos clochers, ni à son Arsenal avec ses immenses magasins. La tombe monumentale d'Alexandre occupait le centre de la ville. Le temple de Neptune et celui de Sérapis, le Sérapeion, n'avaient leurs égaux nulle part. Le Palais des rois l'emportait sur tous les autres par son luxe et son extension : il occupait le tiers de la ville, véritable ville lui-même, au milieu de parcs et de jardins entourés de portiques. Au Palais appartenait le théâtre ; du Palais faisait partie le Musée, bibliothèque royale, la plus grande de l'antiquité, et qui finit par réunir 900000 volumes.
La Bibliothèque était le centre d'une vie intellectuelle intense dont s'enorgueillissaient les Ptolémées. Autour d'elle, dans les jardins, s'allongeaient les Portiques destinés aux entretiens des maîtres avec leurs disciples. Des salles de cours et même des réfectoires attendaient savants et étudiants. C'était le Prytanée réuni aux jardins d'Academus. « A Alexandrie, disait un satirique, on engraisse quantité de scribes qui se livrent à un caquetage effréné dans la volière des Muses. » Par tous les moyens, les rois s'appliquaient à attirer et à retenir au Musée les savants les plus réputés. Le poète érudit Callimaque (310-240) avait été l'un des premiers directeurs de la Bibliothèque. Après lui était venu Eratosthène, mathématicien et géographe, puis Aristophane de Byzance (265-185) et Aristarque de Samos (220-145), les plus grands maîtres de la poésie, de la science et de la philologie. Les catalogues, les éditions savantes et les commentaires alternaient, parmi les productions de Musée, avec les poèmes allégoriques remplis à la fois d'érudition et de grâce spirituelle. Toute cette vie intellectuelle gravitait entre les livres et la Cour.
Avec ses rois fastueux et sa riche aristocratie de commerçants, Alexandrie ne pouvait manquer d'être une ville d'art. Son style se distingue assez nettement de celui de Pergame. A Pergame règne Minerve, sérieuse, héroïque, qui pousse la majesté jusqu'à la pompe et l'effort jusqu'à la déclamation. Alexandrie est la ville de Dionysos, joyeux et efféminé, dieu de l'exaltation voluptueuse, entouré de ses Satyres aux grimaces plaisantes et de la souplesse des Ménades, asservissant les fauves et se réjouissant des enlacements de la vigne et du lierre. Le plaisir et les fleurs, l'esprit poussé jusqu'à la parodie et la caricature, le joli et le grotesque avec toutes les nuances intermédiaires, telle est l'âme de l'art alexandrin.
C'est lui qui a multiplié ces aimables types de Vénus que d'innombrables copies ont répandus dans le monde antique, l'Aphrodite accroupie de Doedalsas, et toute la descendance très humanisée de l'immortelle Cnidiehne. La charmante petite Vénus de l'Esquilin qui fait partie de ce chœur gracieux est assez nettement caractérisée comme Egyptienne par l'uraeus qui s'enroule autour du vase déposé à ses pieds. Dans cette ville voluptueuse, l'étude du nu féminin est devenu le grand problème. Les Musées italiens indiquent assez combien cette veine fut féconde à Rome.
En sculpture, comme en peinture, l'école alexandrine répand partout l'ornement à profusion. Elle affectionne surtout la souplesse des guirlandes et la joie des couronnes, les fleurs et les fruits. Au milieu des rosés d'Alexandrie, la mythologie se fait plaisante et aimable. Les Amours y jouent le premier rôle, passant aisément d'ailleurs des légendes divines aux scènes de genre et multipliant partout les grâces potelées de l'enfance. Alexandrins sont les innombrables amours de Pompéi, exerçant tous les métiers, courant en char, jouant avec tous les animaux, luttant entre eux ou faisant la vendange. L'esprit de l'Egypte grecque vient égayer et animer d'une grâce légère l'exubérance féconde de la nature campanienne.
Mais l'Egypte est aussi une terre de vivant réalisme, d'un réalisme parfois grossier mais qui n'est jamais triste, qui toujours associe le rire à la laideur. La cour des Ptolémées a accueilli Théocrite et l'idylle ; la fraîcheur de la pastorale et la naïveté des scènes populaires reposent de l'érudition et des grâces maniérées de l'esprit courtois. C'est à Alexandrie que furent créés les types célèbres de la vieille femme ivre, souriant de sa bouche édentée à la bouteille qu'elle presse contre son sein flétri, du négrillon contorsionné et grimaçant, du paysan et de la paysanne conduisant leur veau ou portant leur agneau au marché, probablement aussi toutes ces scènes campagnardes qui sur un fond pittoresque de rochers surmontés d'un arbre présentent au premier plan un agneau qui tète sa mère ou une lionne à demi soulevée à l'approche du danger qui menace ses petits.
Tout cet art n'a d'autre but que de plaire et d'amuser l'esprit; il est tout divertissement et dilettantisme. Il fait partie du luxe domestique. Statues, bas-reliefs, peintures, mosaïques, vaisselle ciselée, n'ont d'autre objet que de rendre aimable et gaie la maison où le maître accueille ses amis pour le banquet et la fête. C'est à Alexandrie en particulier que Rome a emprunté son luxe et le modèle du décor plaisant dont son aristocratie s'applique à entourer sa vie.
L'Asie a enseigné à l'art romain sa majesté pompeuse, l'Egypte lui a appris la grâce. Une figure symbolise la beauté alexandrine, celle que la tradition prête à la dernière des reines égyptiennes, à Cléopâtre, savante et amoureuse, unissant tout le charme raffiné de la coquetterie à une ambition subtile et à une énergie passionnée. Combien de grandes dames et d'impératrices romaines ont-elles, consciemment ou non, copié Cléopâtre? Aucune image ne fait mieux comprendre l'essence de l'art alexandrin que le tableau tracé par Plutarque de lareine se rendant à Tarse pour l'entrevue à laquelle l'avait mandée Antoine. La scène a été reproduite, presque textuellement par Shakespeare. C'est la traduction de cette traduction que nous donnons ici :
La barque qui la portait, telle qu'un trône étincelant semblait brûler l'eau. La proue en était d'or battu, les voiles, de pourpre et si parfumées que les vents en étaient fous d'amour. Les rames en argent réglaient leurs mouvements au son des flûtes efforçaient l'eau qu'elles battaient à les suivre plus vite, comme amoureuse de leurs coups. Quant à Cléopâtre, elle était couchée sous un pavillon de drap d'or et de soie, plus belle que cette fameuse statue de Vénus où nous voyons combien l'imagination peut dépasser la nature. De chaque côté d'elle se tenaient dejolis enfants potelés comme autant de Cupidons souriants, armés d'éventails multicolores dont les reflets semblaient enflammer les joues délicates de la reine. Toutes ses dames en Néréides, comme autant de Sirènes, la servaient au moindre clignement de ses yeux et ornaient la barque des courbes gracieuses de leurs corps. A la poupe, c'est une Sirène qui semblait gouverner. Le gréement de soie frémissait sous la pression de ses douces mains de fleur qui vivement remplissent leur office. Da la barque s'échappa un parfum étrange inondant de ses senteurs les quais adjacents. Au devant d'elle la ville lâcha de toutes ses portes tous ses habitants, tandis qu'Antoine sur son tribunal restait seul au milieu de la place du marché.
La passion de César pour Cléopâtre marque le triomphe de l'Alexandrinisme à Rome. Depuis deux ans, Cléopâtre avec une partie de sa cour séjournait à Rome lorsque, en 44, César fut assassiné. On imagine combien cette présence devait contribuer à répandre dans la haute société romaine les modes et les goûts artistiques de l'Egypte.
C'est de ce moment, bien évidemment, que datent ces bustes romains de style égyptisant dont on peut suivre la série, depuis César jusqu'à la fin de l'Empire. Le César de la collection Baracco à Rome en fournit l'un des exemples les plus typiques. La pierre est une basalte noire ou quelque marbre très dur dont les reflets opposent violemment les larges plans de lumière et d'ombre. Le crâne est allongé en arrière selon l'ancien type égyptien. Un réalisme fortement accusé qui ne fait grâce d'aucune ride s'unit au schématisme conventionnel de la barbe et des cheveux marqués soit par un pointillé, soit par les arabesques de boucles menues incisées plutôt que sculptées. Le parti pris de la stylisation prête à l'ensemble un aspect d'exotisme très accusé. Ce n'est pas seulement l'hellénisme alexandrin, c'est un reflet de la vieille Egypte qui apparaît ainsi à Rome. A plus forte raison tous les éléments qui constituent la vie grecque telle qu'elle s'est constituée en Egypte depuis Alexandre doivent-ils, à ce moment, acquérir droit de cité sur les bords du Tibre,
IV
L'ÉCOLE NÉO-ATTIOUE.
Tandis que Pergame et Rhodes cherchent des couleurs nouvelles dans le pathétique et le pittoresque, que l'Alexandrinisme s'ingénie à combiner gracieusement la beauté grecque à l'esprit égyptien, Athènes de son côté, avec une pieuse fierté du passé qui est son bien propre, s'attache de plus en plus à sa tradition et s'efforce de la faire revivre. L'art attique a toujours été marqué de quelques traits archaïsants. Désormais, par un parti pris de réaction contre les nouveautés étrangères, il accuse les qualités propres à cet archaïsme. A la déclamation asiatique, à la mignardise d'Alexandrie, il oppose la sévérité, la sobriété nerveuse et la pureté de lignes de l'époque ancienne, pureté qu'il pousse jusqu'à la sécheresse. Le mérite qu'il apprécie par-dessus tous les autres est la netteté. Le marbre, sous les mains attiques, atteint à la précision et aux contrastes un peu durs du bronze. Au demeurant, les artistes d'Athènes montrent l'éclectisme le plus large ; ils ne choisissent pas entre les époques, toutes les écoles d'autrefois sont à leurs yeux également glorieuses. Ils imitent indifféremment et même confondent souvent dans une même œuvre les modèles anciens des styles les plus divers qui se trouvent mêlés à Athènes.
Ce culte du passé fait tort à leur originalité. Dès le milieu du II ème siècle et surtout durant tout le cours du Ier siècle avant notre ère, les Attiques apparaissent comme des praticiens plus soucieux de la perfection dans l'exécution que de l'invention. Ils accusent dans l'art une sorte de réaction exactement parallèle à celle que provoquent dans la littérature les jeunes orateurs se qualifiant eux-mêmes d'attiques.
C'est leur influence et leur travail qui, à partir de l'époque de Sylla, multiplie à Rome et dans toute l'Italie ces reliefs décoratifs où l'on reconnaît aisément soit des copies, soit plutôt des imitations plus ou moins libres des œuvres célèbres des grands artistes d'autrefois. Nous n'en citerons qu'un exemple, le vase de marbre signé de Sosibios
 ---> Vase de Sosibios
---> Vase de Sosibios
au Musée du Louvre. La panse en est ornée d'une frise délicatement sculptée. De part et d'autre d'un autel s'avancent une Artémis et un Hermès archaïsants. Derrière Artémis, une Ménade joue de la lyre et un Satyre souffle dans une double flûte ; derrière Hermès danse en tournant sur elle-même une Ménade en délire puis un Satyre, tandis que deux autres Ménades assistent à la scène. La Ménade dansante est la copie d'un original célèbre de Scopas. Toutes les autres figures reparaissent, soit isolées, soit groupées, sur bon nombre d'autres reliefs trouvés pour la plupart en Italie. Ce sont des transpositions d'œuvres attiques des V ème et IV ème siècles. Tous les motifs et tous les styles du passé reparaissent dans ces reliefs néo- attiques.
V
les écoles d'art hellénistiques a rome.
Ces influences diverses de l'Asie, d'Alexandrie et d'Athènes se mêlent non seulement dans le monde grec, mais surtout à Rome. L'art attique ancien exerce son action sur Pergame, qui elle-même transmet bon nombre des éléments artistiques développés par elle, notamment l'élément pittoresque, à Alexandrie. Alexandrie et Athènes se trouvent d'autre part en relations directes. Les bas-reliefs de cabinet attribués à Alexandrie n'échappent pas au purisme néo-attique et les Attiques de leur côté ne demeurent pas insensibles à la variété et à la souple fantaisie de l'art alexandrin. Si les bas-reliefs où triomphe le pastiche apparaissent particulièrement attiques, si au contraire dans bon nombre de bas-reliefs pittoresques certains détails, des ibis, des cigognes, des crocodiles ou des hippopotames, accusent nettement une origine égyptienne, qui cependant oserait prétendre que des ateliers attiques ne soient sortis que des pastiches et que les Alexandrins n'aient sculpté que des bas-reliefs pittoresques ? Les cadres que nous avons essayé de tracer apparaissent dès maintenant un peu schématiques même pour l'histoire de l'art en pays hellénistiques ; à plus forte raison le sont-ils pour Rome où travaillent, les uns à côté des autres, des artistes de toute provenance. Chacun de ces artistes peut d'ailleurs, avant d'aboutir à Rome, avoir exercé son activité dans des centres divers. Tel, par exemple, formé à Athènes, peut avoir complété son talent et enrichi son répertoire soit en Asie, soit en Egypte, soit successivement dans l'un et l'autre pays. Plus simplement encore il peut s'inspirer tantôt d'un modèle pergaménien et tantôt d'un type alexandrin. Contentons-nous donc de constater à Rome la présence d'œuvres relevant des divers courants artistiques du monde hellénistique.
L'art du monde grec a-t-il pris à Rome, sous l'influence de la vie romaine, quelque caractère particulier qui puisse apparaître comme spécialement romain ?
La commande romaine nous semble surtout avoir contribué à accentuer une disposition qui d'ailleurs se marquait déjà dans l'art hellénistique, à savoir celle à la production industrielle des œuvres d'art.
A Rome, plus encore que dans les résidences royales ou les grandes villes commerçantes de l'Orient, les amateurs d'art sont, pour la plupart, des nouveaux riches à qui fait défaut à la fois un idéal et une formation raffinée du goût. Ils ne trouvent pas chez eux de tradition artistique propre ; ils y suppléent par un enthousiasme excessif et sans discernement pour tout ce qui vient des centres d'art réputés de l'étranger et surtout pour tout ce qui se recommande d'une tradition artistique éprouvée. De là le goût de l'exotisme d'une part et d'autre part la mode de l'antique.
Chez les chevaliers qu'a enrichis le commerce, la ferme des impôts ou simplement l'usure, chez les militaires ou les gouverneurs de province dont le vol a fait de grands seigneurs, nous voyons se développer l'amour de l'archaïsme et la manie du collectionneur. L'œuvre d'art, surtout l'œuvre d'art ancienne, prend une valeur marchande, elle devient objet de commerce. L'affranchi Chrysogonus en remplit sa maison. Scaurus dépense à enrichir ses collections l'héritage de sa mère et de son beau-père Sylla. Verres ne se contente pas, en Sicile, de voler les œuvres d'art, il se livre à leur sujet à toute sorte de spéculations, il les maquille, il a des ateliers de restaurateurs qui de parties enlevées à des vases anciens fabriquent des faux. Les vétérans que César établit comme colons sur l'emplacement de Corinthe pratiquent dans les anciennes nécropoles de véritables fouilles à la recherche de la vaisselle antique.
Il y a à Rome des marchands d'antiquités, des experts, des courtiers et des restaurateurs. On cite le cas de ce C. Avianius Evander, Grec d'origine, sculpteur et toreuticien, amené d'Athènes à Alexandrie par Antoine, conduit à Rome, vendu comme esclave puis affranchi, qui exerce le métier de sculpteur et de marchand d'œuvres d'art de toute sorte. Amateurs et brocanteurs ont leurs lieux de rendez-vous, les atria auctionaria qui font songer aux salles de nos hôtels des ventes. Ce commerce du beau étouffe la recherche originale et la création.
C'est le moment où dans la campagne romaine et dans toute l'Italie s'élèvent en hâte de grandes villas de luxe. Pour les orner, l'activité des ateliers italiens ne saurait suffire. Cicéron mande à Atticus de lui acheter en Grèce des bas-reliefs pour sa villa de Tusculum. Courtier zélé, Atticus procure en même temps des statues grecques à Pompée pour son théâtre. Appius Claudius fait lui-même le voyage de Grèce à seule fin d'en rapporter sculptures et tableaux. C'est par bateaux complets, comme au temps de la conquête, que les œuvres d'art sont acheminées en Italie.
On connaît la trouvaille faite autrefois près d'Anticythère des épaves d'un chargement de ce genre datant de cette époque. Plus récemment, en 1907, M. Merlin a eu la bonne fortune d'explorer la cargaison d'un bateau antique coulé à Mahdia, sur la côte orientale de Tunisie. Le gros du chargement se composait d'une soixantaine de colonnes de marbre, destinées, semble-t-il, à un portique. Des flancs du navire on a retiré des sculptures de marbre et de bronze, torses et têtes colossales, Faunes, Satyres, figures féminines, des statuettes, des bas-reliefs, des inscriptions grecques, des bases triangulaires de candélabres, des fragments de cratères monumentaux rehaussés sur leur pourtour de scènes bachiques, et de nombreuses appliques de meubles figurant des têtes de divinités, des masques, des griffons, des têtes d'animaux. Quelques pièces sont de véritables chefs-d'œuvre : un Eros de type praxitélien, un Hermès de Dionysos barbu signé de Boethos de Chalkedon, sculpteur rhodien de la première moitié du II ème siècle, deux appliques de corniche représentant Ariane et Dionysos, un Hermaphrodite lampadophore, un Satyre prêt à bondir, un charmant petit Eros citharède et deux figurines de danseuses grotesques, naines difformes à la tête disproportionnée accompagnées d'un danseur bouffon. Le lieu d'origine du chargement paraît bien l'Attique, à laquelle reportent les inscriptions et certains bas-reliefs, mais la cargaison réunit les styles les plus divers. Les colonnes sont neuves et sortaient de la carrière ; par contre, plusieurs parmi les œuvres d'art présentent des réparations antiques. L'ensemble doit émaner de quelque courtier d'œuvres d'art athénien ; il devait être destiné à l'ornementation de quelque villa romaine. M. Merlin croit pouvoir fixer la date du naufrage vers la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère. Combien d'autres chargements du même genre durent, pendant des siècles, aborder aux ports d'Italie!
L'originalité de l'Italie, à ce moment, semble avoir surtout consisté à industrialiser la production des œuvres d'art. Les carrières de marbre de la côte étrusque n'étaient pas encore en exploitation (1) et les autres pierres indigènes se prêtaient peu à la sculpture. Restait la matière si employée par l'ancien art indigène, la terre cuite. On connaît précisément un nombre assez considérable de bas-reliefs en terre cuite dont les dimensions et le style rappellent ces bas-reliefs de cabinet alexandrins et néo-attiques destinés à être encastrés dans la muraille des portiques et des chambres. Comme les bas-reliefs eux-mêmes, ces plaques de terre cuite étaient coloriées; elles jouaient dans la décoration des édifices le même rôle que les tableautins peints au centre des panneaux dans l'encadrement des architectures. Faites au moule, ce qui en permettait la multiplication, mais très finement retouchées, ces terres cuites décoratives sont désignées sous le nom de plaques Campana; elles sont incontestablement de fabrication italienne.
Les sujets en sont ceux du bas-relief hellénistique en général. La mythologie et le cycle bacchique tout particulièrement inspirent la plupart de ces compositions. L'art en est nerveux et souple. On connaît le bel exemplaire du Musée des Thermes, à Rome, représentant la danse des Curètes armés autour de l'enfant Zeus, ou la plaque du British Muséum figurant les Satyres et les Ménades dansant autour du jeune Bacchus.
(1) Les marbres de Luni et de Carrare semblent avoir été employés pour la première fois par Mammura, l'ami de César, et encore seulement pour des revêtements architectoniques.
Un autre exemplaire du Musée des Thermes représente, entre deux arceaux d'une colonnade ou d'une fenêtre, un paysage d'Egypte, des huttes que menace l'inondation du Nil et sur le toit desquelles se tiennent des cicognes tandis qu'au premier plan des chasseurs en barque attaquent le crocodile et le rhinocéros. Les diverses inspirations de l'art figuré, celles qui viennent de l'Attique et celles de l'Egypte, se retrouvent donc sur les plaques Campana.
Les motifs et les styles de l'art hellénistique se répandent ainsi dans l'industrie décorative italienne. Sur les parois et les plafonds des chambres, dans les maisons et dans les tombes, des reliefs en stuc d'une exécution rapide mais admirablement adroite et souple multiplient les images. Ceux qui ont été trouvés à la Farnésine, sur la rive gauche du Tibre, et qui datent des environs de notre ère, peuvent passer pour le modèle du genre. Dans des encadrements de motifs architecturaux, des rinceaux et des fleurs alternent avec des Amours, des Victoires ailées et des griffons. Ou bien encore ce sont de petits tableaux mythologiques ou rustiques dans lesquels des personnages se détachent sur un fond pittoresque, autel à l'ombre d'un vieil arbre, entrée de ferme, pont hardiment jeté au-dessus d'une rivière en miniature... Le genre est intermédiaire entre le relief et la peinture; il évoque toute une imagerie familière, la même qui se retrouve dans telle ou telle pièce de Catulle, de Tibulle ou de Properce.
L'art s'amenuise encore, sans perdre cependant sa finesse, dans les gracieux reliefs qui ornent le flanc des vases de terre rouge d'Arezzo. De même que les plaques Campana imitent les bas-reliefs de marbre hellénistiques, la poterie italienne reproduit à bon marché et en quantités industrielles les œuvres de la toreutique pergaménienne et alexandrine. On sait l'admirable développement de cette poterie durant le dernier siècle de la République et au début de l'Empire. Elle dérive d'une vieille tradition italique qui, par la céramique en relief de Calés (en Campanie) du III ème et du II ème siècle, rejoint les anciens ateliers campaniens et étrusques antérieurs à la conquête du monde grec. Mais la tradition indigène apparaît, au Ier siècle avant notre ère, entièrement renouvelée par l'influence de la poterie dite samienne dont nous parlent les écrivains, mais dont nous ne savons pas exactement, il faut l'avouer, ce qu'elle représente. Sans doute les ateliers grecs, ceux de Samos en particulier, ont-ils entrepris les premiers de reproduire à l'usage du menu peuple les vases précieux en métal ciselé qui ornaient la table des riches. Les potiers italiens se sont empressés de suivre leur exemple et, comme ils y avaient déjà réussi au IV ème siècle pour la céramique peinte, ils n'ont pas tardé à évincer complètement les importations étrangères. L'industrie italienne en général demeure jusqu'au début de l'empire extrêmement active dans tous les genres de production et d'une souplesse qui témoigne d'une puissante vitalité. Elle ne cherche pas à résister aux modes étrangères et à leur opposer un genre propre ; elle adopte au contraire et s'approprie les innovations des divers ateliers méditerranéens.
Les maîtres potiers d'Arezzo sont des Italiens. Le plus ancien, qui se place au cours du Ier siècle avant notre ère, signe Marcus Perennius. Son successeur, ou un concurrent plus récent, Publius Cornélius, devait travailler sous Auguste. Mais l'un et l'autre emploient des ouvriers, soit grecs, soit latin? dont les noms figurent souvent à côté du leur. A Perennius par exemple se trouvent associés Tigranes, Bargates, Cerdo... Les reliefs figurés sont produits par estampage dans un moule et finement retouchés. Les sujets appartiennent au même cycle que ceux des bas-reliefs de marbre ou de terre cuite : personnages et épisodes mythologiques et scènes de genre, traitées dans le style gracieux avec une légère affectation d'archaïsme qui répond au goût de l'époque.
Les vases, plus récents, de Cornélius se distinguent par le développement de l'ornement floral traité dans le genre réaliste qui apparaît en sculpture au temps d'Auguste. Ils rappellent ainsi certaines coupes d'argent du trésor de Boscoreale ceintes d'une branche de laurier aux feuilles touffues. Les motifs figurés demeurent ceux qu'a mis en vogue l'art hellénistique. C'est à ce répertoire que l'art décoratif de l'empire, jusque vers la fin du III ème siècle, empruntera ses sujets.
Qu'il soit industriel ou non, qu'il soit exercé par des Grecs ou par des Italiens, l'art qui se constitue en Italie dans les derniers siècles de la République et qui, dans ses grandes lignes, restera celui de Rome impériale, doit son inspiration aux derniers efforts originaux de l'imagination hellénique.
VI
LA PEINTURE.
Comme l'indiquent les différences de style entre les vases de Perennius et ceux de Cornélius, cet art gréco-romain ne demeure pas immobile. Il évolue comme une chose vivante. La série des décorations murales de Pompéi, qui s'étend depuis le second siècle avant notre ère, jusqu'à la catastrophe de 79 après Jésus-Christ, nous permet de suivre les transformations du goût sinon à Rome même, du moins dans une petite ville de la province campanienne.
Durant la période républicaine, le style dit d'incrustation réduit la peinture des parois à peu de chose. Ce sont des panneaux de stucs colorés imitant les plaques de marbre dont étaient revêtus les murs des palais orientaux. Le luxe durant cette période est constitué par les mosaïques splendides comme la Bataille d Issus de la maison du Faune, ou les natures mortes de la même maison, ou encore, dans la villa dite de Cicéron, la mosaïque représentant une scène de comédie et signée Dioscourides de Samos. Çe sont des œuvres grecques, copies de peintures grecques, exécutées par des artistes grecs. Les compositions d'amples dimensions comme la Bataille d'Alexandre ont certainement été exécutées sur place, mais les petites ont fort bien pu être expédiées toutes faites de quelque atelier hellénique. La peinture elle-même ne dépasse pas le niveau de la «peinture de bâtiments ».
Le second style se prolonge depuis l'époque de Sylla jusque vers la fin du règne d'Auguste (80 av. J.-C -14 ap. J.-C.). Avec le retard provincial, il doit correspondre à peu près à celui qui fleurit à Rome avant le siècle d'Auguste. Les corniches et les montants des panneaux sont figurés en perspective. Des colonnes projetant une ombre puissante donnent l'illusion de la profondeur. L'artifice de la peinture semble souvent ouvrir le mur; dans cette ouverture en trompe-l'œil est placé un petit paysage, une scène de genre ou un sujet mythologique, qui semble apparaître hors de la maison. Le style de ces compositions répond exactement à celui des stucs de la Farnésine. Ces motifs figurés sont le plus souvent rapportés et incrustés au centre des panneaux monochromes comme les emblemata des mosaïques dans le pavement du sol. Ils ont été soigneusement composés à l'atelier par de tout autres artistes que ceux qui ont peint les murs. L'encadrement d'architecture en trompe-l'œil n'est l'œuvre que d'habiles artisans, les sujets figurés relèvent de l'art gréco-romain.
Le troisième style appartient à l'époque de la dynastie julienne, depuis la fin du règne d'Auguste jusqu'à la première destruction de Pompéi en l'an 63 de notre ère. C'est celui des architectures fantaisistes, simple jeu de l'imagination, sans solidité et sans relief, excessivement légères et aériennes. A l'intérieur de cet encadrement en teintes claires, les panneaux sont bordés de bandes de petits sujets traités comme des miniatures et généralement sur fond noir; leur centre est occupé par un tableau de dimensions plus ou moins grandes et d'un style beaucoup plus réaliste que durant la période précédente.
C'est entre les deux catastrophes de 63 et de 79 que se place le quatrième style. Les architectures peintes, tout en demeurant fantastiques, retrouvent cependant un relief réel. Les motifs figurés prennent, dans le cadre de la décoration murale, un plus grand développement. Les sujets en sont de plus en plus variés; des marines, des natures mortes alternent avec les scènes de genre souvent fort réalistes et les sujets mythologiques. Sur les parois sont peintes des portes par lesquelles semblent entrer des personnages ou des animaux. Ce style finit par aboutir à une complication de plus en plus grande, mélange peu cohérent de toutes les formes et de tous les motifs.
Un bon nombre parmi les tableaux du troisième et du quatrième style sont de belles œuvres d'art, d'une sûreté de dessin, d'une pureté de lignes, d'une harmonie de couleurs remarquable. L'Italie, à ce moment, a des artistes, de véritables artistes, jusque dans une ville de médiocre importance telle que Pompéi. Nous ne saurions sans doute apprécier l'originalité de ces peintures; nous en pouvons du moins apprécier l'extrême habileté.
VII
LES PREMIERS ESSAIS d'un ART ROMAIN. —— PASITELÈS ET SON ÉCOLE.
Tout nourri qu'il est de sève hellénistique, l'art tel qu'il se pratique à Rome au temps de Pompéi, de Cicéron et de César n'en représente pas moins un rameau vigoureux de l'art grec. Son effort tend surtout à imiter. II n'est pas encore sorti de l'apprentissage et, des leçons de ses maîtres, n'a pas dégagé sa personnalité. Il est cependant déjà fécond et manifeste au moins quelques tendances intéressantes.
Le mieux connu de ces émules des Grecs qui cherchèrent à réaliser eux aussi la beauté est Pasitelès. C'était un Italien d'origine grecque peut-être, mais citoyen romain au titre d'habitant de l'Italie méridionale. Fixé à Rome, il était en pleine réputation en 62, l'année où mourut le grand comédien Roscius en souvenir de qui il exécuta un vase d'argent ciselé dont parle Cicéron (1). La ciselure, semble-t-il, était son premier talent; on admirait les miroirs d'argent portant sa signature (2) ; la ciselure l'avait conduit à la sculpture; il avait exécuté une statue de Jupiter en or et ivoire (3). Comme plusieurs grands artistes de Pergame, Pasitelès était un érudit, très au courant des anciennes écoles de l'art grec ; il avait consacré cinq volumes à décrire les œuvres les plus célèbres du monde entier (4).
On citait de lui comme trait original le soin tout particulier avec lequel il pratiquait le modelage de la terre. Il n'exécutait aucune œuvre sans avoir fait en terre une maquette extrêmement poussée et professait que la plastique de l'argile était la mère de la sculpture (5), souvenir sans aucun doute de la vieille tradition italique qui fait de la terre cuite l'emploi que l'on sait. Le travail de l'argile lui permettait en outre de scrupuleuses études d'après nature. Une anecdote nous le montre manquant un jour d'être dévoré par une panthère alors que dans un port où l'on venait de débarquer des animaux d'Afrique il s'appliquait à modeler un lion. Précision et naturalisme, ce sont des qualités fort développées sans doute dans l'art hellénistique, mais qui le seront encore davantage par l'art romain auquel elles prêteront son cachet propre. De Pasitelès nous ne possédons aucune œuvre.
(1) De Divin., 1, 36.
(2) plin., N. H., 33, 130.
(3) Ibid., 36, 39.
(4) Sur Pasitelès, cf. M. collignon, XLVII, p. 658 sq.
(5) plin., N. H., 35, 155.
Mais son élève Stephanos, qui vécut durant la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère, a signé une belle statue d'éphèbe actuellement à la villa Albani. « La structure du corps », dit de cette statue M.Collignon, «rappelle les anciennes œuvres péloponnésiennes, mais l'exécution très adoucie lui donne je ne sais quelle expression équivoque et contraste avec la solidité des formes.» Cédant à la vogue de l'archaïsme et au goût de l'antique qui domine à Rome, l'école romaine de Pasitelès cherche donc son idéal dans l'époque antérieure à Phidias, mais elle tempère la raideur de l'antiquité par un reflet de la grâce alexandrine.
Stephanos eut lui-même pour élève Menelaos, qui travailla sous Auguste et Tibère. Nous possédons de ce Menelaos un groupe soigné mais fade représentant une femme faisant accueil à son fils. Est-ce une scène d'adieu ou de réunion ? On ne saurait décider. Le motif, en tout cas, semble bien une adaptation assez peu adroite de quelque bas-relief funéraire attique du ive siècle. Menelaos restait fidèle à la tradition des Néo-Attiques. Cette école archaïsante qui peut passer pour spécialement romaine a multiplié les œuvres en Italie. Citons l'Artémis du musée de Naples, copie d'une statue de culte du début du Ve siècle, mais copie bien modernisée au moins dans le jeu de la physionomie. Citons encore au musée de Naples le groupe dit d'Harmodius et d'Aristogiton et celui que l'on connaît sous les noms d'Oreste et Electre. Le prétendu Oreste semble une copie du même original que l'éphèbe de Stephanos ; il est associé à une figure de femme à la carrure presque virile qu'anime toute la force contenue des images anciennes. Sans doute, l'extrême abondance à Rome des œuvres grecques classiques et préclassiques n’est-elle pas étrangère à cette multiplication des pastiches.
Mais à côté de ces œuvres austères fleurit la coquetterie étudiée de la Venus Genitrix commandée par César au sculpteur Arcesilas. La déesse incline légèrement la tête, attachant un regard souriant sur la pomme de Paris qu'elle tient de la main droite. D'un geste qui ne manque pas d'afféterie, sa belle main gauche relève au-dessus de l'épaule le pan de son chiton transparent qui, découvrant le sein droit, épouse de ses plis légers la courbe gracieuse du ventre et la rondeur des cuisses. On retrouve dans l'ensemble le souvenir classique d'Alcamène, alangui par la volupté alexandrine. Sans être originales, ces premières productions de la sculpture gréco-romaine n'en témoignent pas moins d'une vie artistique active et d'un noble goût. Les Romains se sont sincèrement épris de la beauté grecque; leurs artistes s'étudient à en reproduire et en rajeunir le charme.
VIII
l'autel de domitius ahenobarbus.
Nous possédons de cette époque un monument complet qui présente l'intérêt de pouvoir être daté avec précision et de mettre en évidence l'éclectisme des œuvres romaines de la fin de la République. Ce sont les frises de l'autel qui s'élevait devant le temple de Neptune construit par Cn. Domitius Ahenobarbus, l'un des ancêtres de Néron, entre les années 35 et 32 avant notre ère. Ces deux frises, séparées, se trouvent l'une au Louvre, l'autre à Munich; elles ont été reconnues comme appartenant au même monument par Furtwaengler en 1893.
La frise de Munich représente le cortège nuptial de Poséidon et d'Amphitrite. Au centre, le couple divin est assis sur un char que traînent de jeunes Tritons, l'un jouant de la lyre, l'autre soufflant dans une conque ; il est suivi de Néréides chevauchant des monstres marins et d'un Triton qui se laisse indolemment bercer par les flots. Toute la poésie de la mer, la musique du vent jouant dans la lyre, le grondement des flots exprimé par la conque, les vagues bondissantes couronnées de leur écume comme les chevaux marins portant les blanches Néréides et celles qui viennent indolemment mourir sur la grève, fait cortège à la divinité. Au-devant du couple nuptial s'avance la mère d'Amphitrite montée sur un cheval marin et portant les torches nuptiales ; elle est escortée d'une Nymphe et de deux Néréides dont l'une n'est vue que de dos et s'appuie sur la croupe d'un jeune Triton. L'ensemble se développe avec une brillante fantaisie dans laquelle on s'accordait à reconnaître autrefois, avant de savoir que la frise appartenait à un monument romain, lestyle des écoles classiques finissantes, encore tout imprégné des influences du IV ème siècle mais annonçant déjà la souple fantaisie hellénistique. La frise semble bien l'œuvre d'un Grec, mais d'un Grec travaillant à Rome et pour un grand seigneur romain quelques années avant Actium.
Le bas-relief du Louvre est d'un tout autre caractère, d'une exécution beaucoup moins adroite, flasque et lourde, manquant de finesse et de netteté mais non pas de vie. Le sculpteur n'est certainement pas le même que celui de la frise de Poséidon, il doit être un Romain. Laissant là les modèles grecs, il s'est essayé à une composition originale proprement romaine. Au centre de la scène s'élève l'autel sur lequel va s'accomplir le sacrifice d'action de grâces. Casqué et appuyé sur sa lance, l'imperator est debout d'un côté tandis que, de l'autre, le prêtre tourne le visage vers le cortège qu'il attend. En tête s'avancent les victimes, le taureau, la brebis et le porc, poussés par des serviteurs, puis viennent deux légionnaires armés, tandis qu'un cavalier au casque empanaché s'apprête à sauter à cheval. Ace groupe correspond, à l'extrémité opposée de la frise, une scène dans laquelle on croit reconnaître le licenciement des légionnaires à la fin de la campagne. Deux soldats portent encore l'équipement militaire, deux autres ont déjà revêtu la toge; ils entourent deux personnages assis dont l'un semble quelque secrétaire en train de rédiger un diplôme. Cette composition si régulièrement ordonnée est un bas-relief historique ; c'est le sacrifice de la victoire et de la démobilisation.
L'autel de Domitius associait donc dans sa décoration la tradition allégorique grecque qui, par une scène empruntée à la mythologie, commémore les victoires navales d'Ahenobarbus, et le réalisme historique qui n'était pas inconnu sans doute aux artistes grecs, à ceux de Pergame en particulier, mais qui ici, représentant des scènes proprement romaines, semble bien provenir des tableaux et images triomphales de la vieille Italie. Nous retrouverons sous l'Empire, à de nombreux exemplaires, la procession des suovetaurilia qui forme ici le motif central. C'est dans l'ancienne Etrurie et en Campanie que l'on rencontrerait les prototypes de la pompe à la fois militaire et religieuse qui fournira le sujet à la décoration de tant de monuments impériaux.
L'art romain, à la fin de l'époque républicaine, ne distingue pas plus entre son bien propre et les leçons étrangères qu'entre les différentes écoles hellénistiques elles-mêmes. Il pousse l'éclectisme jusqu'à la confusion. Cette période de passion et de dilettantisme manque d'une idée directrice. C'est, en art comme en politique, un temps d'anarchie.
IX
l'architecture.
L'art dominant dans le monde hellénistique est l'architecture. La sculpture, la peinture, la mosaïque, la ciselure même, car les métaux sont couramment employés à la décoration architecturale, lui sont subordonnées beaucoup plus étroitement que ne l'étaient, à l'époque classique, la sculpture et la peinture. Dans les grands sanctuaires d'autrefois, à Delphes, à Olympie, les statues s'élevaient un peu au hasard des donations, indépendamment des temples, et les compositions picturales, lors même qu'elles ornaient un monument comme la Lesché de Delphes, y prenaient une importance souvent supérieure à celle du monument lui-même. Désormais, c'est l'idée de l'ensemble qui l'emporte dans l'art. Dans la ville, les maisons particulières, les monuments publics, les temples des dieux, les rues, les places, obéissent à une ordonnance générale et dans chaque construction les motifs décoratifs sont conçus en fonction de l'endroit précis qu'ils doivent occuper. Dans les palais, qui atteignent souvent l'ampleur d'une ville, sculptures et peintures sont essentiellement destinées à l'ornementation des salles, des portiques et des jardins. La splendeur des monuments apparaît comme le signe de la puissance. L'Etat romain ne pouvait manquer de suivre dans cette voie les dynastes de l'Asie et d'Egypte. Il devait au peuple roi des monuments et une ville dignes de sa puissance. Les grandes entreprises d'architecture étaient, pour les chefs victorieux, comme la rançon du commandement auquel ils devaient gloire et profit.
Ces chefs, familiarisés par leur éducation, leurs voyages et leurs campagnes avec les choses de Grèce et d'Orient, s'adressent, pour construire, à quelque architecte qu'ils ont ramené dans leur suite ou qu'ils ont trouvé à Rome et qui, comme les autres artistes, sculpteurs, peintres ou ciseleurs, est venu chercher fortune en Italie. L'architecte, à son tour, s'abouche avec un entrepreneur, redemptor, qui se trouve être le plus souvent le représentant de quelqu'une de ces grandes sociétés financières qui exploitent tout le bassin de la Méditerranée. L'architecte a fait son apprentissage et a travaillé autrefois dans une ou plusieurs grandes villes du monde hellénistique ; l'entrepreneur a bâti partout où les Romains ont pu avoir à construire, de l’Espagne à l'Afrique et jusqu'à Délos. Les chefs de chantier sont des esclaves ou des affranchis ; la plupart sont originaires de Syrie, d'Asie Mineure ou d'Egypte(1). L'ensemble de ce personnel se trouve au courant à la fois des modes artistiques et des innovations techniques du monde méditerranéen. Quant à la main-d'œuvre, elle est fournie par les prisonniers de guerre et les marchés d'esclaves : elle est extrêmement abondante, mais de qualité très médiocre; peu de maçons, beaucoup de manœuvres. On emploiera donc les procédés les plus simples, ceux qui réalisent une économie de temps et d'argent et n'exigent, de la part de l'ouvrier, que la moindre habileté.
Répondant à ces conditions nouvelles, la technique des monuments du II ème et du Ier siècle n'a plus rien de commun avec celle du IV ème et du III ème siècle. La pierre n'est plus taillée minutieusement pour la place qu'elle occupera, mais débitée industriellement en blocs ou en moellons uniformes ; la belle qualité et la construction soignée se trouvent limitées aux parties essentielles de l'édifice ; pour le reste, un blocage rapide suffit. Les murs s'évident ; ils varient d'épaisseur, ils ne sont plus d'un seul tenant mais se composent d'arcades entre lesquelles s'ouvrent les vides de portes et de fenêtres nombreuses et les renfoncements des niches. Le mur s'articule, on en calcule étroitement les résistances, on économise la matière. A côté des colonnes monolithes, des pilastres ou des montants en pierre de taille, l'appareil joint au mortier occupe la plus grande place. La voûte, qui utilise des matériaux médiocres, remplace les grandes et lourdes architraves. L'usage du mortier est originaire, semble-t-il bien, de Syrie. C'est de là également que paraissent provenir les divers types de la voûte ; l'art de bâtir de la fin de la République est nettement hellénistique.
(1) M. Licinius Crassus Dives avait à son service, en 10S av. J.-C., 500 architectes. plut., Crassus, 2.
Comme dans la littérature, les influences grecques et hellénistiques apparaissent dans l'architecture romaine antérieurement à tout contact direct avec l'Orient. Durant la majeure partie du II ème siècle encore, elles semblent être parvenues à Rome par l'intermédiaire de la Sicile.
A l'extrémité orientale de l'île, Syracuse est en effet, dès le début du III ème siècle, une grande ville hellénistique. En relations suivies non seulement avec la Grèce et les îles grecques mais aussi avec l'Egypte et les ports de Syrie, elle reçoit, dès ce moment, un apport abondant d'éléments orientaux. La conquête romaine, en 212, ouvre à Syracuse toute l'Italie du sud et du centre. C'est là, nous a-t-il semblé, qu'Appius Claudius a trouvé le modèle du premier aqueduc romain. De Syracuse aussi proviennent Vraisemblablement les premières leçons du nouvel art de bâtir.
L'action de l'Asie ne dut s'exercer directement sur l'architecture romaine que vers la fin du II ème ou même le début du Ier siècle avant notre ère. Elle atteint son plein développement au temps de Sylla qui reconstruit Rome après l'avoir en partie brûlée. Et parmi les régions de l'Asie, celle dont paraissent provenir les innovations les plus fécondes est la Syrie. C'est la Syrie en effet qui a adapté à l'art hellénique les vieux procédés techniques et une partie des formes d'art du continent asiatique. La voûte, le mortier, les briques de terre cuite, semblent originaires de Syrie. Syracuse au II ème siècle, Antioche au Ier, auraient donc été les grandes initiatrices de l'architecture romaine. On sait que cette influence de l'architecture syrienne continua sous l'Empire et que c'est de nouveau celte région qui, à la fin du III ème et au début du IV ème siècle après Jésus-Christ surtout, détermina la dernière transformation de l'art de bâtir de l'Occident.
C'est dès le commencement du II ème siècle, sous l'influence de Syracuse, par conséquent, que commence la transformation architecturale de Rome. Il ne s'agit plus seulement, dès lors, de l'édification de temples en des emplacements quelconques fixés par le Sénat et les Pontifes, le plus souvent hors de l'enceinte ou dans les quartiers excentriques. Même lorsqu'il s'agit de temples, on se préoccupe de la perspective et de l'ensemble dans lequel ils viennent prendre place. Mais on élève surtout des édifices civils destinés à embellir le centre même de la ville. En 185/4, Caton le censeur construit la basilique Porcia ; en 179, la basilique Aemilia occupe au Forum l'emplacement où l'on en voit aujourd'hui encore les fondations (1). En face d'elle, sur le côté sud du Forum, la basilique Sempronia, édifiée en 169, précéda la basilique Julia, tandis que sur le petit côté ouest, non loin du temple de la Concorde, contre le Capitole, s'élevait la basilique Opimia. La date de ces deux dernières ne saurait être exactement fixée mais se trouve, sans aucun doute, antérieure à 159. Ce fut, on le voit, dans l'espace d'une trentaine d'années, une véritable floraison de basiliques.
Nous ne connaissons le plan d'aucune de ces vieilles basiliques républicaines. Le nom en est grec, BaciXixA ctôa = portique royal, quoique la dénomination grecque n'apparaisse elle-même que tardivement, au moins dans les textes que nous possédons.
Les exemples de basiliques sont demeurés exceptionnels en Grèce et dans tout l'Orient. Si l'on en juge par les basiliques romaines plus tardives que nous possédons, le type dériverait de bâtiments du genre de cette salle hypostyle de Délos qu'a étudiée G. Leroux et qui fut édifiée vers le dernier tiers du III ème siècle avant notre ère pour servir de bourse aux marchands déliens. Cette salle rappellerait elle même des constructions égyptiennes. Elle apparaît en tout cas comme une création de l'architecture hellénistique.
(1) Elle a été, il est vrai, plusieurs fois rebâtie.
Ce qui appartiendrait en propre aux Romains, estime G. Leroux, c'est d'avoir adopté la grande salle hypostyle comme édifice principal de la cité, de lui avoir donné sa destination de lieu de réunion et de tribunal et d'avoir consacré pour elle la désignation jusque-là peu usitée, et sans doute d'origine populaire, de basilica. Mais entre l'Egypte alexandrine, Délos et Rome, se place vraisemblablement l'intermédiaire de Syracuse et nous ne saurions préciser ce qui, dans la basilique, telle qu'elle apparaît à Rome dès la première moitié du II ème siècle avant notre ère, est romain et ce qui est sicilien.
De la même période que les basiliques datent les Navalia construits sur les bords du Tibre, pour servir d'entrepôt, par l'architecte Hermodore de Salamine (149) et le grand temple de Jupiter voué par Metellus Macédoniens, œuvre du même architecte. En marbre pentélique, ce temple occupait le fond d'une place entourée d'une colonnade; il est le premier exemple d'un édifice religieux faisant vraiment partie d'un ensemble architectural. Le portique, genre de construction éminemment hellénistique, devient dès lors l'un des éléments essentiels de l'architecture urbaine. Dès 193, Aemilius Lepidus avait fait construire, pour abriter les marchandises apportées à Rome par la batellerie du Tibre, le portique de l'Emporium. En 174 fut élevé celui qui bordait des deux côtés la rampe conduisant au Capitole et, en 168, le portique de Cn. Octavius. Plus tard, à partir de César surtout, les portiques se multiplient à Rome, ils deviennent l'encadrement normal des Forums et de toute place publique, le lieu de rendez-vous favori, l'abri des affaires et le refuge de la flânerie.
Au premier siècle avant notre ère, les grandes périodes de construction sont celles de Sylla, de Pompée et de César.
C'est à Sylla que revient la construction des Archives romaines, du Tabularium, ouvrant d'une part sur le Capitole et dominant d'autre part, de toute la hauteur de sa façade, le côté ouest du Forum. Sylla construit encore, hors de Rome, le grand sanctuaire de la Fortune à Préneste, letemple de Gabies et les deux temples de Tivoli, dont l'un, le temple rond, subsiste encore presque intact aujourd'hui. Par leur technique comme par leurs formes, tous ces monuments de Rome et du Latium relèvent de l'architecture hellénistique. Ils n'ont rien de proprement latin ni même d'italien. On cite sans doute, à ce moment, le nom de l'architecte Cossutius qui, après avoir travaillé à Rome, fut appelé par Antiochus IV de Syrie et chargé par lui d'achever l'Olympieion d'Athènes. La réputation d'un architecte romain se serait donc imposée même à un prince syrien. Mais il est fort probable que le nom latin de Cossutius ne fait que déguiser en Romain un artiste syrien déjà célèbre dans sa patrie.
Pompée, à son tour, offre au peuple romain des édifices imités de ceux des grandes villes d'Asie. En 55, il dédie sonthéâtre que couronnait un sanctuaire de Venus Victrix, le premier théâtre de pierre construit à Rome. A côté du théâtre, un portique célèbre, orné de nombreuses œuvres d'art, entourait des jardins que fréquenta bientôt tout le public élégant. De là, un autre portique, l'Hécatostyle (les Cent colonnes), conduisait vers le Capitole. C'est à proximité de ce portique que se trouvait la Curie, également construite par Pompée, dans laquelle César fut assassiné. Tout ce quartier du Champ de Mars, entre le Palais Farnèse actuel et le Capitole, avait été transformé par Pompée.
César s'assigna la tâche de faire oublier la munificence architecturale de son rival. Le butin des Gaules fut employé à créer, au nord du vieux Forum, un nouveau Forum mieux ordonné et plus majestueux que l'ancien. Eprise du grand et du nouveau, l'imagination du dictateur était tout entichée de l'Orient. Son Forum fut conçu, nous dit-on, sur le modèle de ceux des Perses. Une muraille bordée de portiques l'entourait entièrement. Au centre s'élevait le temple de Venus Genitrix, périptère corinthien, tout en marbre, orné de sculptures et « resplendissant de l'éclat de l'or » (1). La statue de la déesse était l'œuvre d'Arcesilas; à côté d'elle, César avait placé une image de Cléopâtre en or — ou du moins dorée; en avant du temple, il avait dédié sa propre statue montant le cheval fabuleux au sabot fendu qui était réputé assurer à son maître l'empire de l'univers (2). Au centre du Forum se trouvaient les Appiades, des fontaines, probablement avec des nymphes sculptées par Stephanos, l'élève de Pasitelès. L'inauguration de ce Forum fut une sorte de féerie orientale avec un cortège monté sur des éléphants. L'Egypte, à ce moment, triomphait à Rome ; c'était vers la conquête du royaume des Parthes que son ambition allait entraîner César. L'idéal artistique des Romains n'était qu'un reflet de celui des monarchies gréco-orientales.
Qu'il s'agisse d'architecture, de sculpture, de peinture ou des arts mineurs, nous n'apercevons qu'exceptionnellement, dans les œuvres de la fin de la République, quelque trait spécifiquement romain. La tradition indigène n'est pas morte sans doute, mais elle fait piètre figure à côté de la floraison hellénistique et se trouve comme déchue de la dignité artistique. Réfugiée autour des sanctuaires rustiques et dans les boutiques populaires, elle n'apparaît guère dans l'art de la capitale que par la persistance du modelage de la terre prôné par Pasitelès et de la technique des reliefs en terre cuite. On s'étonne presque de rencontrer sur l'autel de Domitius Ahenobarbus le motif romain de la procession des suovetaurilia et la représentation précise de faits historiques contemporains.
(1) plin., Nat. Hist., 35, 45, 2.
(2) suet., Caes., 61.
D'une façon générale, les techniques sont grecques, les idées directrices sont celles qui règnent dans tout le monde méditerranéen, les sujets, les styles sont ceux qui ont cours dans les grands centres intellectuels et artistiques de Grèce, d'Asie et d'Egypte. L'art romain de la République finissante n'est qu'un rameau de l'art hellénistique, un rameau vigoureux et déjà fécond, mais qui n'a pas encore subi les influences du terroir dans lequel il s'est trouvé transplanté.
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
Depuis le milieu du III ème siècle jusque vers le dernier tiers du Ier siècle avant notre ère, nous avons cherché dans les idées et les œuvres romaines le trait général qui pût établir le lien entre elles et qui puisse être interprété comme l'expression du génie propre du peuple. Nous ne l'avons pas trouvé, ou plutôt, la faculté dominante qui donne son caractère propre à cette période d'une richesse un peu confuse nous paraît être surtout, comme d'ailleurs durant la période précédente, une merveilleuse facilité d'assimilation. Nous la trouvons chez Scipion comme chez Caton, chez Naevius et Ennius comme chez Catulle, dans le peuple qui accueille les inquiétudes religieuses de toute l'Italie comme au Sénat et chez les Pontifes qui admettent à Rome les dieux grecs, et jusqu'à la Grande Mère Phrygienne de Pessinonte. Nous la trouvons dans l'art qui se fait sicilien, puis pergaménien, puis néo-attique et alexandrin, comme dans la vie courante qui, dès le temps de Sylla, confond entièrement les mœurs grecques avec celles de l'Italie, de même qu'elle accole couramment la maison hellénistique à péristyle au vieil atrium romain. Rome, au cours de ces deux siècles, a absorbé la civilisation du monde méditerranéen sa conquête comme, durant les siècles précédents, elle s'était assimilé celle de l'Italie. La richesse de cette civilisation a étouffé, au moins pour un temps, la tradition indigène.
Chez qui d'ailleurs irions nous chercher un génie proprement romain ? Seuls sont originaires de Rome même, parmi les écrivains latins, Lucrèce et César, dont l'esprit vraiment ne semble pas présenter la moindre parenté. Cicéron est latin comme Caton, Lucilius est campanien comme Naevius, comme Pasitelès, Ennius est calabrais, Plaute ombrien' Catulle vient de Vérone et Térence d'Afrique. C'est toute l'Italie, l'Italie infiniment variée et riche de facultés diverses qui, depuis des siècles, a fait Rome. Dès la fin des guerres puniques ce sont toutes les régions méditerranéennes qui lui fournissent ses idées, ses techniques, sa science, son art, voire ses artistes et même la masse de ses citadins. Lorsqu'une ville conquiert un monde, elle ne peut guère avoir la prétention de rester elle-même.
TROISIÈME PARTIE
LE SIÈCLE D'AUGUSTE
Malgré les guerres civiles, malgré la corruption des mœurs des classes dirigeantes et la médiocrité du gouvernement sénatorial, le dernier siècle de la République avait été pour Rome une période de vie puissante et de progrès. C'était la fin d'une adolescence turbulente et passionnée mais d'une généreuse exubérance. L'avidité et les brutalités de la conquête du monde se trouvent rachetées en une certaine mesure par l'énergie même qu'exigea cette conquête et par l'ardeur des Romains à s'assimiler le meilleur de la civilisation hellénistique mise au pillage. A défaut d'originalité, on ne saurait contester à l'âge de César, de Cicéron, de Lucrèce, de Catulle, la vigueur de l'intelligence et un vif sentiment du beau.
Faisant suite à cette époque mouvementée, apportant la paix et l'ordre, le siècle d'Auguste apparaît comme une période de repos. L'œuvre des générations appelées à bénéficier des victoires républicaines sera de classer et d'élaborer les acquisitions trop rapides de leurs aînées. Les esprits seront moins distraits par le spectacle sans cesse renouvelé du monde étranger ; l'attention se concentrera sur l'Italie, sur Rome elle-même et sur son passé. L'orgueil du triomphe tirera de l'oubli la tradition nationale. Eduqué par la Grèce et le monde hellénistique, le génie romain va dégager peu à peu, au cours du long règne d'Auguste, sa personnalité et jeter les soubassements de l'édifice nouveau qui a transmis à la postérité le souvenir de Rome.
CHAPITRE PREMIER
LA POÉSIE ET LES MŒURS
la fin de l’alexandrinisme.
Le partage du monde romain, entre Octave et Antoine en l'an 42, la batailla d'Actium elle-même, en l'an 31, et le principat d'Auguste n'ont tout d'abord modifié qu'insensiblement les grands courants intellectuels qui dominaient à Rome. Les transformations politiques n'agissent en effet qu'à la longue sur la civilisation d'un peuple et, lors même qu'elles lui ont imprimé des directions nouvelles, elles ne coupent pas court aux développements antérieurs. C'est ainsi que nous voyons se poursuivre jusqu'à la fin du règne d'Auguste le mouvement littéraire représenté par Catulle et se perpétuer aussi, en dépit des efforts moralisateurs du prince, les mœurs de la haute société de la fin de l'époque républicaine. Le conflit entre l'esprit ancien et la règle nouvelle produira, dans la famille même d'Auguste, des épisodes tragiques et le dernier représentant du dilettantisme poétique, Ovide, ira finir dans l'exil lamentable de Tomes le cours impitoyablement abrégé de sa brillante carrière.
Les épigones de l'école alexandrine n'en ont pas moins contribué au lustre poétique du siècle d'Auguste. C'est de leurs rangs d'ailleurs qu'est sorti le plus grand poète de l'ère nouvelle, Virgile. Les élégies de Tibulle et de Properce, l'œuvre d'Ovide, diffèrent sans doute assez profondément des poésies de Catulle. Leur art à tous, non moins que celui de Virgile à ses débuts, n'en relève pas moins de l'inspiration hellénistique. Properce se réclame de Galvus et de l'école qui était celle de Catulle; il demande aux mânes de Callimaque et de Philetas de Cos de lui ouvrir l'accès de leurs enclos ; Gallus avait imité Euphorion, Virgile lui-même avait essayé son chalumeau dans les campagnes de Théocrite. D'un commun accord, ces poètes visent, avant toute autre chose, à la perfection de la forme, à la nouveauté piquante de l'expression, à la grâce d'un pittoresque très stylisé, à la couleur conventionnelle d'une mythologie savante. Leur délicatesse est pleine de recherche; sans exclure la sincérité, chez Tibulle, ni la vigueur, chez Properce, elle aboutit couramment à la préciosité. Elle n'ose s'écarter des petits sujets. Les œuvres de longue baleine; même, les Métamorphoses ou les Fastes d'Ovide, ne sont qu'un assemblage de scènes de genre dans le style de ces bas-reliefs de cabinet chers à l'art alexandrin et néo-attique.
Evoquant les souvenirs de sa jeunesse, Ovide dénombre dans ses Tristes cette aimable phalange :
Souvent Properce était le compagnon de mes plaisirs, me récitait ses vers, me peignait les ardeurs de sa flamme amoureuse. Battus et Pomponius, tous deux renommés, l'un pour le poème héroïque, l'autre pour les vers ïambiques, ont été ceux que j'ai chéris avec le plus de douceur et de familiarité. Horace, par la cadence de ses vers charmait mon oreille. Quant à Virgile, j'eus seulement le bonheur de l'entrevoir, mais non de le fréquenter. Pour Tibulle, les destins ne m'ont point envié ce contentement ; nous avons été longtemps amis, nous avons joui des fruits d'une charmante intimité. Le poète Gallus fut le premier qui commença la chaîne de ces amitiés. Properce vint ensuite, moi après eux. Et peu de temps mes vers eurent de la réputation comme ceux de mes amis.
Quintilien caractérise chacun de ces poètes d'un jugement magistral :
Parmi nos élégiaques, Tibulle me paraît d'un style poli et d'une extrême élégance ; certains préfèrent Properce, plus savant mais plus obscur. Le genre d'Ovide a moins de retenue que celui de ces deux poètes, celui de Gallus moins de souplesse.
Pour Tibulle (né en 54, mort en 19 ou 18 av. J.-C.), pour Properce, un peu plus jeune (50 environ à 15 av. J.-C.) et pour Ovide (43 à 17 après J.-C.), Virgile né en 70 (mort en 19 av. J.-C.) et Horace né en 65 (mort en 8 av. J.-C.), sont des aînés de presque une génération. Presque tous cependant s'éteignent en même temps et prématurément : Horace et Ovide survivent seuls. Le premier, Virgile avait conquis la gloire poétique sous le patronage du précieux alexandrin qu'était Gallus, ou plutôt même de la maîtresse de Gallus, l'actrice Cytheris qu'avait autrefois aimée Antoine et qui se préparait d'ailleurs, à ce moment, à quitter son poète pour un militaire de l'armée du Rhin.
Alpinas, a! dura nives et frigora Rheni
Me sine sola vides ! (1).
C'était vers l'an 40. Chassé de son patrimoine par les vétérans d'Octave, Virgile s'était réfugié à Rome. Ami de Gallus, il lui avait lu la sixième Eglogue qu'il venait de composer, celle où le Silène chante la genèse du monde, et la pièce avait enthousiasme la comédienne. Cytheris voulut la déclamer au théâtre. Le triomphe de l'actrice fît le succès du poète. Le lendemain Virgile était célèbre à Rome; bientôt il fut reçu par Mécène qui la présenta à Octave. Il renoncera d'ailleurs peu après à la Bucolique, non sans avoir payé sa dette de reconnaissance à Gallus et à sa charmante infidèle :
Permets moi encore, ô Muse de Théocrite, ce dernier travail, quelques vers pour mon cher Gallus, mais des vers que lise aussi Lycoris. Il le faut ; comment refuser des vers à Gallus ?
Ces vers sont la Xe et dernière Eglogue.
La veine poétique à laquelle Virgile renonçait de propos délibéré n'était cependant pas épuisée.
(1) VlRG., Egl., X.
C'était toujours elle qui attirait les jeunes gens. Tibulle et Properce étaient des chevaliers, jouissant d'une aisance qui les faisait accessibles aux tentations du monde romain. Comme Catulle, ils paraissent avoir été détournés par l'amour et les plaisirs faciles de l'ambition d'une carrière à préparer. Telle est bien la teneur de la prédiction qu'un devin est censé faire à Properce :
Militiam Veneris blandis patiere sub armis
Et Veneris pueris utilis hostis eris ;
Nam tibi victrices quascumque labore parasti, Eludet palmas una puella tuas (1).
Ton service sera celui de Vénus ; tu porteras ses armes charmantes ; aux Amours fils de Vénus tu offriras une cible facile ; les palmes victorieuses que t'avait préparées ton travail, une femme te les ravira toutes.
Properce d'ailleurs avait accepté volontiers cet augure :
Ut regnem mixtas inter convivia puellas
Me fuvet hesternis languere coronis
Quem letigit jactus certus ad ossa deus (2).
Mon règne, que ce soient les banquets peuplés de femmes aimables... ; mon plaisir est l'alanguissement sur les couronnes de la veille, car, frappant à coup sûr, le dieu m'a touché jusqu'aux os.
Une telle profession de foi pourrait être également celle de Tibulle ou encore d'Ovide, avec cette différence que si l'amour a frappé Properce et Tibulle jusqu'aux moelles, il semble n'avoir blessé Ovide qu'assez superficiellement et à la tête plutôt qu'au cœur.
(1) 4, 1.
(2) 2, 34.
II
TlBULLE.
Comme celle de Properce, l'élégie de Tibulle est, avant tout, un poème amoureux. Délie en est la Muse. Le poète chante les joies et aussi les peines que luicause sa Délie. Ce nom de Delie qui correspond à celui de Lesbie, cher à Catulle, cache une personnalité de condition plus modeste. Délie est mariée, sans doute, mais il est assez difficile depréciser le rôle que jouait le mari dans ce ménage. La mère de Délie, en tout cas, tantôt bénie par Tibulle, lorsqu'elle le guide, dans la nuit, jusqu'à sa maîtresse, et maudite avec truculence lorsqu'elle ourdit des ruses pour l'écarter, apparaît d'une respectabilité extrêmement douteuse. Certes, Délie n'appartient pas à la classe des matrones à la longue robe qu'Ovide exhorte à ne pas lire ses vers. Tibulle a pu se croire aimer; il n'en fut pas moins quitté pour un amant plus riche. Après une courte absence à la suite de Messala, une reprise de sa liaison avec Délie fut pour lui pleine de déboires et d'amertume, si bien que d'autres amours, plus complètement vulgaires, succèdent bientôt à la passion de sa jeunesse.
L'amour semble avoir procuré à Tibulle plus de chagrins que de plaisirs. Du moins le poète insiste-t-il davantage sur les tristesses que sur les joies. Catulle invectivait contre ses rivaux il injuriait sa maîtresse infidèle ; il arriva à Properce de la battre ; Tibulle se réfugie dans la mélancolie. La mélancolie, telle était bien, à en juger d'après les encouragements protecteurs que lui adresse Horace, le fond môme de son tempérament (1). Les allusions à la mort sont fréquentes dans son œuvre ; les funérailles, les cendres, le bûcher y fournissent le thème à maint développement.
(1) Hor, Ep., I,4.
Même amoureuse, l'élégie chez lui s'avance vraiment en longs habits de deuil. Particulièrement accentuées chez Tibulle, ces préoccupations funéraires semblent d'ailleurs l'effet d'une tendance assez répandue parmi sa génération, puisqu'elles se retrouvent chez Properce et chez le poète, d'ailleurs inconnu, Lygdamus,dont les œuvres se sont mêlées à celles de Tibulle, formant le troisième livre de son recueil. La mélancolie très sincère de Tibulle correspond donc à un état d'esprit assez courant dans un siècle fatigué. Sa morale, d'autre part, rejoint celle de Catulle :
Inlerca cum fala sinunt jungamus amores.
Jam veniet tenebris mors adoperta caput. Jam subrepet iners aetas nec amare decebit
Dicere nec cano blanditias capite).
Tant que les destins le permettent, unissons nos amours. Voici bientôt venir la mort à la tête voilée de ténèbres, voici que rampe vers nous l'âge inerte et qu'il ne siéra plus d'aimer, ni de dire des douceurs, la tête chenue.
Catulle insistait davantage sur les baisers ; la pensée de Tibulle s'arrête avec plus d'insistance sur la décrépitude prochaine et sur la mort aux voiles des ténèbres. La passion amoureuse ne satisfait plus qu'imparfaitement une génération trop délicate. Elle ne remplit plus les âmes. Elle y laisse place à ce malaise moral qui assombrit la nature et la vie. Cette tristesse romantique affleure partout chez Tibulle ; elle s'étale dans son œuvre en plaintes douces et sans violence, en lassitude, en une sorte de pessimisme, pourrait-on dire, qui détourne l'esprit du poète des temps présents vers le passé, vers la simplicité idyllique de l'âge d'or ou d'une vie champêtre d'un idéalisme tout conventionnel. Les élégies de Tibulle contiennent d'ailleurs bien autre chose que del'amour et de la mélancolie. Elles s'animent d'un esprit aimable, un peu artificiel parfois mais toujours gracieux et souvent ironique. Elles plaisent par les nombreux tableaux familiers qu'elles esquissent. Scènes de genre, anecdotes, espiègleries, y alternent avec l'expression des sentiments, les souvenirs, les espoirs, les développements philosophiques ou didactiques. Tous les genres en faveur chez les alexandrins s'y retrouvent, pastorale, descriptions de paysages, scènes de magie ou de sacrifice, un peu de mythologie et beaucoup de morale. Les occasions de rapprochements n'y manquent pas, non seulement avec Properce et Ovide, mais aussi avec Virgile et Horace. Tibulle s'attarde dans le genre idyllique. Des essais qu'arrêtent surtout sa timide et une excessive modestie l'élèvent parfois jusqu'au petit poème dont Callimaque avait fourni le modèle mais dont le fonds est latin et le sentiment tout personnel et où l'on peut reconnaître un reflet des idées nouvelles dont, à ce même moment, s'inspirent Horace et Virgile.
III
properce .
Ces souffles nouveaux venant animer l'esthétique ancienne se font sentir plus fréquents et plus forts encore chez Properce que chez Tibulle. Properce est d'un tempérament poétique plus dru et plus vigoureux que Tibulle ; il est plus savant; son esprit est plus riche d'images qu'il excelle à présenter en menus tableaux d'une ligne toujours nette, presque dure, manquant de fond et d'atmosphère, mais avec des raccourcis parfois obscurs.
Sa dame, Cynthie, est une aristocrate comme Lesbie, riche et coquette, fort instruite, disant et même faisant des vers, chantant et dansant avec art. La femme aimable et savante apparaît en ce moment dans la société romaine. Nous possédons, mêlées aux élégies de Tibulle, celles d'une poétesse, Sulpicia. Les inscriptions funéraires de ce temps vantent couramment non seulement la vertu des défuntes, mores, mais leur beauté, forma, et leur esprit, facela, consulta. L'épitaphe en vers d'une précieuse fait allusion à sa lyre et à sa cithare. L'amour introduit Properce dans un milieu élégant tout pénétré de littérature. Le poète fréquente en même temps le cercle de Mécène. Il est zélé partisan d'Auguste qu'il célèbre quoique Octave ait autrefois, en Ombrie, fait périr son père. Il éprouve pour Virgile une profonde admiration. Ses modèles n'en sont pas moins les poètes minutieusement savants et raffinés d'Alexandrie. La mode et aussi, semble-t-il, le goût de Cynthie et le désir de lui plaire, lui ont imposé l'élégie. Mais la fin de son œuvre, après la brouille avec sa maîtresse, manifeste nettement une tendance vers un genre de poésie plus large, dans lequel les idées prendront la place du sentiment. Properce chantera surtout ses amours et, puisque les chagrins d'amour ont plus de poésie que les triomphes, il ne se fera pas faute de faire entendre des plaintes contre sa maîtresse, contre la société, contra le monde et la vie, plus ou moins responsables de ses tristesses. Pourquoi chercher ailleurs à grand'peine un sujet d'œuvre d'art? son inspiration, c'est Cynthie :
Ingenium nobis ipsa puella facit.
Son ami Pontius tente l'épopée. Que lui sert ce grave poème? En amour, le vers de Mimnerne l'emporte sur Homère. Va donc et compose de ces petits poèmes mélancoliques que voudra répéter toute femme amoureuse. La troupe dans laquelle il se range de propos délibéré est celle des poètes de la génération précédente, Catulle, Calvus, Gallus. A leur exemple, Properce a chanté Cynthie. Puisse la renommée lui donner place parmi eux.
Mais les protestations mêmes qui reviennent sans cesse dans ses vers contre les genres plus élevés témoignent que l'idée en obsède son esprit. Dès le second livre, la dixième élégie adressée à Auguste essaye un ton plus grave. Ailleurs, dans le même livrent (1), se remarque une tendance à la description minutieusement précise de choses vues, d'œuvres d'art en particulier, et du Portique d'Apollon que vient de construire Auguste. Mais il ne tarde pas à revenir à Cynthie; la sagesse de Socrate, la science de Lucrèce, lui paraissent trop austères, il en remet l'étude à plus tard, lorsque Vénus aura fui son âge appesanti, et que dans sa noire chevelure apparaîtra la blancheur de la vieillesse (2). Qu'il lui suffise pour le moment d'admirer, sans les suivre, ceux de ses amis qui ont osé plus que lui, dont la sagesse a secondé le talent et que Vénus n'a pas arrêtés dans leur course vers les sommets du Parnasse.
Sans qu'il le cherche cependant et presque sans qu'il le veuille, de grandes images et un souffle d'une puissance qui dépasse celle de l'élégie, viennent élever chez lui le ton du poème.
Ni les Pyramides à grands frais élevées jusqu'aux autres, ni la demeure vaste comme le ciel de Jupiter Olympien, ni le Mausolée, splendide modèle du tombeau, ne sont exempts de la loi suprême de la mort. Des uns, la flamme, des autres, la pluie, minera la gloire ou bien les ans, à coups répétés, l'emporteront sur leurs masses et ils crouleront. Mais le génie gagne une renommée que le temps ne sapera pas ; le génie dresse une gloire qui ne connaît pas la mort (3).
Ce n'est pas d'ailleurs à l'épopée qu'aurait abouti, si Properce avait vécu, son très réel talent.
(\)Eleg.,31
(2)2,34.
(3) 3, 2 ; ou bien encore le Songe de Properce, 3, 3.
Ce qui ressort chez lui dès le second livre et s'affirme dans le livre III, c'est la tendance au développement moral illustré pour ainsi dire d'images plastiques et colorées. A quoi bon les ambitions et les agitations humaines ? L'essentiel c'est l'âme, la vie de l'esprit. Insensé Prométhée qui, en modelant le corps humain, a oublié l'âme :
Corpora disponens mentem non vidit in arte.
Recla animi primum debuit esse via.
Toutes les distinctions matérielles, la mort les effacera :
Nudus ad infernas, stulte, vehere rates
Victor cum victis, pariter miscebimur Indis,
Consule cum Mario capti Jugarthae sedes.
C'est à la même idée ou à une idée toute voisine, la vanité des ambitions humaines et en particulier de la recherche de la fortune, qu'est consacrée la belle élégie du livre III qui pleure la mort du jeune Petus victime d'un naufrage, idée, assez banale mais qui se trouve développée avec une sincérité d'émotion et une richesse d'images véritablement puissantes :
Ergo sollicitae tu causa pecunia vitae es,
Per te immaturum mortis adimus iter.
Nam dum te sequitur primo miser excidit aevo
Et nova longinquis piscibus esca natat.
Ce que Properce loue chez Mécène, ce ne sont pas tant ses talents que sa modération :
... in tenues humilem te colligis ambras,
Velorum plenos subtrahis ipse sinus.
Tandis qu'on s'évertua autour de lui à chanter la gloire de Rome, il aperçoit et il note la tare secrète de son triomphe. L'avidité qui a dirigé les conquêtes sera la ruine de cet empire :
Proloquar, atque utinam patriae sim vanus haruspex,
Frangitur ipsa suis Roma superba boni?...
C'est l'exemple de Sparte qu'il préconise pour sa patrie :
Quod si jura fores pugnasque imitata Laconum,
Carior hoc esses tu mihi Roma bono.
Properce se rencontre ici avec l'Horace des Odes et surtout des Satires. L'amant de Cynthie, dont l'amour, disait-il autrefois lui-même, faisait tout le talent, devient un maître de morale sociale. Il n'a pas modifié son art cependant, il n'en a ni assourdi la sonorité, ni atténué les images, ni simplifié la mythologie : il reste alexandrin par la forme. Mais le fond s'est renouvelé. L'art hellénistique était essentiellement désintéressé : il était l'art pour l'art. Par une tendance naturelle à Rome et que renforce le courant d'idées du siècle d'Auguste, la poésie de Properce se fait moralisante ; elle subordonne le beau à l'utile.
Cette orientation nouvelle qui réduit l'art alexandrin à n'être plus que le revêtement chatoyant et précieux d'idées romaines, triomphe dans le quatrième et dernier livre de Properce.
La poésie hellénistique, celle de Callimaque aussi bien que d'Apollonius de Rhodes, s'inspirait d'érudition plus encore que de sentiment. Elle était souvent, peut-on dire, de la poésie archéologique. Cette Muse savante, élève du Musée et des Bibliothèques, triompha à Rome avec la maturité d'Ovide, dans les Métamorphoses et surtout dans les Fastes. Elle était apparue dès l'œuvre de Catulle dans l’Epiltalame de Thétys et de Pelée par exemple ou dans la Chevelure de Bérénice. Elle renouvelle l'élégie de Properce.
Mais ce n'est pas à la fable grecque, c'est à la tradition latine que Properce emprunte ses sujets. De même, Varron avait appliqué au passé romain la curiosité et les méthodes de l'érudition hellénistique, de même l'épopée de Virgile prend pour objet la fondation de Rome. L'effort d'originalité de Properce l'écarte ainsi de ses maîtres alexandrins et l'entraîne dans le sillage du rénovateur de l'État romain. Mais si son esprit redevient romain, son talent s'est formé à l'étude des poètes grecs, il est alexandrin et il le reste. Le passé légendaire de Rome se trouve illustré d'une série d'images de style hellénistique, d'un pittoresque à la fois familier et précieux. Tout est trop précis et un peu sec dans cette succession de petits tableaux; la composition d'ensemble fait défaut, le souffle reste court, l'horizon ne s'élargit pas.
Hoc quodcumque vides, hospes, qua maxima Roma est
Ante Phrygem AEnean collis et herba fuit....
Le chef-d œuvre du genre, nous semble-t-il, est la pièce consacrée à l'héroïne légendaire Tarpeia. La peinture d'une violente passion amoureuse met une âme et de la vie dans cette poésie trop exclusivement savante.
Le poème le plus caractéristique du talent de Properce, celui dans lequel s'unissent la veine mélancolique, la morale et les souvenirs historiques, est la Consolation adressée à Paulus. Sa jeune femme, Cornélie, qui vient de mourir, apparaît à Paulus comme naguère Cynthie était apparue à Properce.
Cesse, ô Paulus, d'affliger ma tombe de tes pleurs. Jamais la porte noire ne s'ouvre aux prières ; une fois les morts entrés sous les lois infernales, on ne saurait en fléchir l'acier et obtenir le retour. Lors même que tes prières atteindraient le dieu du sombre empire, tes larmes seront bues par le rivage sans écho. Les vœux peuvent toucher les dieux d'en haut. Lorsque le nocher a reçu l'obole, la lugubre enceinte se ferme et l'herbe croît sur les bûchers...
Ce qui reste de moi, cinq doigts le peuvent soulever. Nuits auxquelles sont condamnés les morts et vous, marais dormants dont les replis retienne»! mes pieds, avant l'heure je suis venue ici, mais j'y suis venue innocente... Sur ma pierre on doit lire qu'à toi seul je fus unie. J'en atteste les dieux que tu vénères, ô Rome, et mes aïeux dont les surnoms, Afrique, sont écrits sur tes ruines, Cornélie n'a pas terni l'éclat de tant de triomphes ; d'aucune tache elle n'a fait rougir vos Pénates. La nature, votre sang, m'ont donné mes vertus ; la crainte d'un juge n'y pouvait rien ajouter. Quelle que soit la sentence de l'austère tribunal, nulle femme n'aura honte de me voir prendre place auprès d'elle ni toi, Claudia qui détachas avec ta ceinture la statue de Cybèle immobilisée, ni toi qui, devant Vesta, réclamant le feu qui t'avait été confié, fis de ton voile blanc jaillir la flamme vive...
... Maintenant, Paulus, je te confie les gages de notre union, nos enfants. Leur souci anime encore ma cendre, il survit au bûcher. Sois pour eux une mère, toi leur père...
C’est là vraiment l’œuvre maîtresse de l'élégie latine. Sainte-Beuve reconnaissait en Properce le plus généreux des élégiaques latins ; il louait en lui la grandeur dans les sentiments, la variété de l'inspiration, une gravité et une énergie que l'on n'est pas habitué à rencontrer dans ce genre de poésie. On la compare parfois à André Chénier et, en effet, l'abondance des images empruntées à la mythologie érudite de l'hellénisme justifie ce rapprochement. Mais il convient aussi d'ajouter que, par les idées qu'il a fait entrer dans l'élégie, Properce est le plus romain des alexandrins.
IV
ovide.
Ovide représente la fin de cette école. Avec lui, l'alexandrinisme se survit pour ainsi dire à lui-même, non pas qu'Ovide n'ait de l'art un sens aussi raffiné que ses devanciers, mais en ce sens que les effets qui, chez ses prédécesseurs, étaient le fruit d'une recherche raisonnée naissent chez lui spontanément de l'application du procédé. Son infériorité tient surtout à sa facilité. L'image se présente toute faite à son esprit avec les lignes et les couleurs trouvées avant lui par deux générations de poètes. Elle est agréable, elle plaît, Ovide ne cherche pas davantage. Il a pu ainsi multiplier les œuvres un peu banales, composées d'une suite de morceaux charmants mais dont l'ensemble apparaît bientôt d'une fatigante monotonie. Ovide est un écolier brillant, mais, jusqu'aux Tristes exclusivement, il reste un écolier.
Que sa première œuvre, les Héroïdes, écrites vers sa vingtième année, présente ce caractère, on ne saurait s'en étonner. Le recueil se compose d'une vingtaine de lettres d'amoureuses célèbres dans la mythologie à leurs époux ou à leurs amants. Une épître de Pénélope à Ulysse ouvre cette correspondance.
Hanc tua Pénélope lento tibi mittil Ulixe ;
Nil mihi rescribas, attamen ipse veni,
La présente, c'est ta Pénélope qui te l'écrit, tardif Ulysse. Ne m'envoie pas de réponse, apporte-la toi-même.
Ce n'est pas de la parodie, mais seulement de l'esprit souligné d'un sourire. Ce début donne le ton. La lettre, d'ailleurs, est plaintive et attendrie à souhait. Pénélope maudit comme il convient le ravisseur adultère cause de son long veuvage; elle détaille avec sensibilité ses inquiétudes alors que durait la guerre, les joies du retour qu'elle envie aux autres femmes, son incertitude à elle et sa mélancolie. C'est une pièce parfaite de vers latins, mais qui n'inspire qu'un désir médiocre de lire les suivantes. Et cependant que de jolis tableaux elles contiennent parfois! Ariane abandonnée adresse par écrit ses reproches à Thésée (Épître X).
C'était le moment où la terre se couvre de la transparente rosée du matin, où les oiseaux gazouillent invisibles sous le feuillage. Dans cet instant d'un réveil incertain, toute languissante de sommeil, j'étendais pour toucher Thésée des mains encore appesanties... Personne à côté de moi: je les étends de nouveau, je cherche encore, j'agite mes brai à travers la couche. Personne! La crainte m'arrache au sommeil, je me lève épouvantée, je me précipite hors du lit solitaire...
Ce ne sont pas des métamorphoses, mais ce sont déjà toutes les Métamorphoses, les jeux de l'esprit et de la fable.
Abandonnant les ambitions que, dans le municipe de Sulmone, son père avait conçues pour lui, voici le jeune Ovide qui n'aspire plus qu'à être poète. Ses aînés, Tibulle, Properce, l'accueillent dans un monde où le dieu Amour a pris la place d'Apollon. Il faut chanter l'amour et, pour le chanter, le ressentir ou feindre du moins d'être touché deses flèches. Ovide composera donc lui aussi de ces élégies qui valent au poète le succès auprès des jeunes femmes et lui assureront, dans l'avenir, une renommés immortelle. Les Amours paraissent entre l'année 19, date de la mort de Virgile et de Tibulle, et l'année 15, date de la mort de Properce. Ovide, le dernier venu, se trouve donc le seul représentant de l'école poétique dont il possède tous les secrets. On l'a marié deux fois déjà, mais les liens conjugaux vite relâchés et bientôt dénoués n'ont pas entravé la liberté de sa carrière mondaine. Il célèbre Corinne comme ses aînés avaient chanté Lesbie, Délie et Cynthie. Mais celles-ci avaient été les maîtresses bien réelles des poètes qui les avaient aimées. On a au contraire de bonnes raisons pour se demander si Corinne a jamais existé. Ce n'est pas une femme qu'aimait Ovide, c'étaient toutes les femmes. « Mon cœur, dit-il, ne s'astreint pas à préférer certaines beautés, il trouve cent raisons de les aimer toutes (1). » Cette ampleur du sentiment amoureux fait tort évidemment à la profondeur de l'amour. De telles amours ne sont en tout cas que des amours de tête, et la sincérité de l'élégie s'en trouve gravement atteinte.
Toujours sur le ton plaisant et aimablement spirituel qui lui est cher et qui constitue peut-être le trait le plus original de son talent, Ovide entreprend désormais de donner la théorie de cette vie galante dont les Amours étaient, pour ainsi dire, la chronique. L'Art d'aimer paraît entre l'an 1avant Jésus-Christ et l'an 2 ou 3 de notre ère. En l'an 3 de notre ère sont publiés les Remèdes d'Amour, sorte de palinodie qui insiste sur les leçons de l'Art d'aimer plutôt qu'elle n'y apporte un palliatif. Vers cette époque Ovide s'était marié une troisième fois et fort brillamment. Sa femme était issue de la gens Fabia ; elle était parente de consuls et fort liée avec une tante d'Auguste. Par elle, le poète prenait rang dans la société officielle ; il venait de dépasser la quarantaine. C'en était fini des amours légères et de la fréquentation du monde irrégulier des Amours et de l’Art d'aimer. Plus heureux que ses aînés, Ovide allait pouvoir, après les badinages de sa jeunesse, tenter une grande œuvre.
C'est à partir de ce moment, entre les années 3 et 8 de notre ère, qu'il compose les Métamorphoses et les Fastes. Les Métamorphoses, quinze livres d'environ 800 vers chacun, sont à peu près achevées en l'an 8. Sur les douze livres que devaient compter les Fastes — un pour chaque mois de l'année — six se trouvent rédigés, au moins provisoirement, à la même date ; les six autres ne devaient jamais voir le jour. Ces années sont donc pour Ovide une période d'effort assidu. Il est, depuis longtemps, le poète favori de la haute société romaine. Il voudrait devenir, à son tour, le poète officiel et conquérir aussi la faveur d'Auguste. C'est dans cette ambition qu'il s'essaye au grand poème didactique. Les Métamorphoses, sans doute, ne sont encore que de la mythologie grecque, mise suivant la formule ancienne en contes aimables toujours galants et souvent érotiques. On y retrouve l’esprit des Héroïdes et parfois même des Amours. Ovide y reste le « maître du joli ». Mais les Fastes témoignent d'une volonté de renouvellement. A pleines voiles, Ovide s'engage dans la voie ouverte par Properce dans le quatrième livre de ses Élégies, il aborde un sujet à la fois romain et religieux, il sacrifie à l'esprit du siècle nouveau; il espère ainsi s'élever à la place demeurée vide depuis la mort d'Horace, disparu en l'an 8 avant notre ère. Le savant Verrius Flaccus qu'Auguste avait choisi comme précepteur de ses petits-fils ne venait-il pas, dans le palais même, de se livrera de savantes recherches sur l'ancien calendrier romain, secondant les efforts du prince pour restaurer l'antique piété et la vieille religion nationale ? Ce sont les dieux et les fêtes d'autrefois qu'Ovide se propose de populariser en les rendant aimables, en leur prêtant toutes les grâces et les couleurs plaisantes de son esprit.
L'exil vient subitement, en l'an 8 de notre ère, briser tous ces espoirs, couper court à ces ambitions et interrompre l'œuvre commencée.
Les raisons de ce coup inattendu demeurent mystérieuses. C'était une condamnation personnelle. Ovide avait commis une faute ou une erreur de conduite, il l'avoue lui-même, sans laisser cependant deviner en quoi il avait péché (1). Mais c'était aussi un effet de la réprobation d'Auguste pour sa poésie, puisque l'Art d'aimer était en même temps exclu des Bibliothèques publiques. Son œuvre, son œuvre ancienne au moins, fut la véritable cause de l'exil d'Ovide, le resta n'en fut que l'occasion, estime M. Boissier. Il semble bien qu'il ait complètement raison.
Toute cette poésie, en effet, depuis Catulle jusqu'à Ovide, est celle d'une société mondaine, désœuvrée, dont l'esprit sans idéal s'amuse de l'amour. Chez Catulle, chez Tibulle et chez Properce, l'amour est un sentiment profond qui donne l'éveil à la poésie ; il est le dieu du temple; les colonnes d'une architecture savamment gracieuse, les bosquets et les perspectives d'un fond stylisé, encadrent son image.
(1) Tristes. 2, 1, 200.
Il règne, mais de loin, et l'art qui l'entoure le fait souvent oublier. Simple libertinage, il étale au contraire sa licence dans toute l'œuvre qu'Ovide avait jusqu'alors publiée. La poésie ne semble plus qu'une invitation à l'amour. C'est la théorie que formule expressément l'Art d'aimer; les connaissances littéraires serviront avant tout à conquérir des amants (1).
Rien ne séduit, est-il professé, comme une belle voix ; que les jeunes filles apprennent donc à chanter ; qu'elles retiennent et les airs entendus au théâtre et les couplets d'Egypte... Apprenez aussi à faire vibrer les cordes du psaltérion, leur mélodie convient aux jeux de l'amour... Sachez les vers de Callimaque et ceux du chantre de Cos... sachez encore Sappho ; est il rien de plus voluptueux que ses poésies..,. Lisez les œuvres du tendre Properce, quelques passages de Gallus et de notre aimable Tibulle... Peut-être parmi ces grands noms le mien, un jour, trouvera-t il sa place... oui quelqu'un dira peut-être un jour : choisissez dans ces trois livres qu'Ovide intitula les Amours lepassage que vous lirez d'une voix souple et voluptueuse ou déclamez avec art une de ses Héroïdes....
S'étonnera-t-on que cette poésie ait pu encourir le ressentiment d'Auguste, comme une entremetteuse ?
Il ne s'agissait pas seulement, en effet, du succès de ses lois sociales contre l'adultère, en faveur du mariage et da la fécondité des familles. Dans sa propre maison, des drames répétés, l'inconduite de sa fille et de sa petite-fille, les deux Julies, l'avaient frappé au cœur profondément. Il pouvait, sans injustice, en rendre responsable cette poésie « composée sur les airs du Nil » et le poète lui-même qui, tout le long de son règne, avait maintenu à ce genre un succès plus éclatant que jamais. Malgré le secret conservé par Ovide sur l'occasion de sa disgrâce, on a toute raison de penser que le poète s'était trouvé mêlé plus ou moins directement au scandale provoqué par les amours de la seconde Julie avec Silanus.
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.
L'élégie latine fut englobée avec le dernier de ses représentants dans la condamnation prononcée par Auguste.
(1) 3, 315 sq.
La persistance durant tout le règne d'Auguste d'une poésie inspirée par l'amour correspond à la prolongation, sous l'empire, de la liberté de mœurs qui avait marqué la fin de la République. Malgré les anecdotes qui accusaient d'hypocrisie l'austérité dont il faisait étalage, Auguste avait renoncé aux débauches d'Octave. Il s'efforçait de faire revivre autour de lui l'antique sévérité. Sa femme et sa fille filaient la laine, il ne voulait porter de toges que celles qui étaient entièrement confectionnées dans sa maison. Mais l'aristocratie qu'il s'efforçait de rallier à son pouvoir se refusait à ce retour aux mœurs d'autrefois. Horace s'était fait l'interprète de l'idéal du prince bien plutôt que le chroniqueur exact de la réalité en célébrant d'avance le succès de la régénération morale de ses contemporains.
L'honneur des familles, chantait-il, n'est plus souillé par l'adultère, les mœurs et la loi ont dompté le vice ; on félicite les mères de mettre au monde des enfants qui ressemblent à leur père ; toute faute est suivie de près par le châtiment.
Hélas, vers le moment même où paraissait l'Art d'aimer d'Ovide, le scandale de l'adultère avait éclaté dans la maison même d'Auguste et un exil impitoyable avait châtié les fautes de Julie, la fille chérie, l'enfant unique et l'orgueil du prince.
La chronique romaine nous a transmis sur le compte de Julie une série d'accusations infamantes qui la ravaleraient au niveau de la Lesbie déchue qu'injurié Catulle.
De nuit, raconte Sénèque, on la vit errer par la ville au milieu d'une escorte d'amants, promenant ses hontes au Forum et déshonorant de son dévergondage cette tribune aux harangues du haut de laquelle son père avait promulgué la loi contre l'adultère. De jour, c'était près de la statue décriée de Marsyas qu'elle donnait ses rendez-vous et là, mêlée aux dernières créatures de Rome, elle partageait insolemment leurs vils plaisirs.
Le ton suffit à indiquer que la légende ne s'est pas fait faute d'avilir la femme condamnée. Sénèque ici pense évidemment
et veut faire penser à Messaline qui l'avait exilé. La réalité dut se réduire, dans le cas de Julie, à une légèreté de mœurs
qui avait droit, il faut le reconnaître, à bien des circonstances atténuantes. Julie était une femme aimable et frivole adorant
le luxe, les arts et la littérature. « Une douce humanité, une âme ennemie de toute sévérité lui avaient concilié, dit
Macrobe, une immense popularité qu'elle conserva dans son malheur.» Le peuple et des amis fidèles intercédèrent
pour elle à plusieurs reprises. Sa culpabilité, d'ailleurs, ne saurait faire de doute : des lettres d'elle, paraît-il, l'accusaient
nettement et il fallut des preuves évidentes pour convaincre la tendresse longtemps aveugle d'Auguste. Mais la culpabilité
n'entraîne pas les indignités qui lui furent attribuées.
Un examen de sa propre conscience aurait dû cependant disposer son père à l'indulgence. Un caprice de jeunesse lui avait fait épouser Scribonia, la mère de Julie ; un autre caprice la lui avait fait répudier pour épouser Livie, on sait dans quelles conditions. L'éducation que la jeune fille avait reçue au palais sous la surveillance de sa marâtre avait été d'une sévérité à fatiguer pour toujours de la vertu. Assise à la maison, elle avait filé la laine sans autre société que Livie, Octavie, sœur d'Auguste et leurs enfants. A Baïes, un jour, un jeune homme s'était permis de venir la saluer. Auguste avait écrit incontinent à cet audacieux pour lui reprocher son incorrection (1). Toute jeune, elle avait été mariée à Marcellus, fils d'Octavie, mort moins d'un an après ce mariage. C'est à elle qu’Auguste voulait laisser sa dignité impériale. Par raison d'État, il la donna donc successivement à tous les héritiers désignés de l'empire. Marcellus disparu, le successeur éventuel était Agrippa qui, ayant dépassé la quarantaine, dut divorcer pour épouser la toute jeune veuve.
(1) Suet. Aug. 64
Ce plébéien énergique et dur, travailleur infatigable, aux sourcils toujours contractés, n'était peut-être pas l'époux qui eût le mieux convenu à Julie. Fille obéissante, Julie accomplit d'abord tout son devoir. Cinq enfants naquirent de ce mariage, Caius et Lucius César, puis la seconde Julie, puis Agrippine, enfin Agrippa Posthume. Mais les affaires de l'Etat appellent Agrippa à toutes les extrémités de l'empire. Julie l'accompagne tout d'abord en Orient, où elle est fêtée comme une reine. A Rome, toute une jeunesse brillante afflue autour de cette femme charmante, la première de Rome et l'une des plus belles. Un Appius Claudius, un Lollius, un Sempronius Gracchus, un Scipion, désœuvrés et galants papillonnent autour d'elle, non moins que son compagnon d'enfance, ce Jules, fils d'Antoine, ami des poètes et poète lui-même, à qui Horace dédia une Ode. C'étaient, dès ce moment, paraît-il, autant d'amants. Peut-être le chagrin et la dignité ne sont-ils pas étrangers aux perpétuels voyages d'Agrippa et à sa fin prématurée, à cinquante-deux ans, au début de l'an 12 avant Jésus-Christ.
En attendant que les fils de Julie puissent gouverner, la mort d'Agrippa met au premier rang dans l’empire le fils de Livie, Tibère. Julie avait, nous dit-on, éprouvé autrefois, pour ce beau ténébreux, une inclination, qui aurait été brutalement repoussée. Tibère était marié; il reçut l'ordre de répudier Vipsania qu'il aimait, pour épouser Julie. « Elle passait, remarque G. Boissier, de l'un à l'autre avec tant de rapidité, qu'elle ne pouvait guère distinguer ses maris de ses amants », ou plutôt, elle pouvait choisir ses amants tandis que ses maris lui étaient imposés.
Peu de mariages étaient moins raisonnables que celui-là. Tibère, un Claude, doué de toute l'obstination sombre de sa race, traditionaliste intransigeant, sévère, connaissant encore moins le sourire qu'Agrippa, détestait et méprisait son époque. Julie, coquette et légère, était toute portée à considérer que le temps où elle vit est vraiment l'âge d'or. Sitôt marié, Tibère emmène sa femme loin de Rome, à Aquilée, où elle met au monde un fils qui meurt l'année suivante. Mais la mort de son frère Drusus l'appelle d'urgence en Germanie. L'exil d'Aquilée ne peut d'ailleurs durer toujours. Le dissentiment s'accuse entre cette jeune femme de trente ans, d'une « douce humanité », et son époux soupçonneux. Tibère s'enfonce dans sa mélancolie; il n'ose ni accuser sa femme ni la répudier. Il a pris d'ailleurs, en Germanie, le commandement qu'avait exercé son frère et s'y fait détester par sa sévérité chagrine. Finalement il se dit malade, abandonne toute affaire et demande comme une faveur le droit de se retirer à Rhodes.
A Rome, autour de Julie, la jeune noblesse dont elle est l'idole entreprend une campagne acharnée contre l'atrabilaire dont la quasi-désertion a rempli l'empereur d'amertume. A cet austère champion du passé elle entreprend d'opposer les fils de Julie et d'Agrippa, princes charmants de la jeunesse que chérit Auguste et qu'au sortir de l'enfance on désigne pour le consulat. Julie triomphe, elle est toute-puissante et libre. Tibère absent devient insensiblement un proscrit. Pressée de profiter des quelques années qui lui restent avant la pleine maturité, apercevant déjà quelques fils blancs dans sa belle chevelure, Julie abandonne toute retenue. Aux anciens amis viennent s'en ajouter d'autres : Murena, Cépion, Lépide, tous les grands nom; d'avant Actium. C'est durant ce temps qu'Ovide ciselait les vers de son Art d'aimer.
Il est probable qu'une haine de femme ne fut pas étrangère à l'explosion du scandale. L'impératrice Livie ne devait éprouver ni tendresse ni indulgence pour la fille du premier lit d'Auguste, pour la mère des jeunes Césars, ostensiblement désignés à l'empire au détriment de son fils à elle, Tibère, pour la bru qui a contribué à l'hypocondrie de ce fils et dont l'inconduite le maintient depuis huit ans dans l'exil déguisé de Rhodes. Ce fut elle, sans aucun doute, qui réunit les preuves des bruits qui ne pouvaient manquer de courir et qui les mit sous les yeux d'Auguste. Elle avait été patiente, car elle était prudente. C'était, disait d'elle son petit-fils Caligula, Ulysse en robe de femme. Il fallait que ses preuves fussent irréfutables pour vaincre la tendresse si longtemps aveugle du père. Elle eut gain de cause complet. Amis et amants, indistinctement, tous furent frappés. Sempronius Gracchus fut exilé en Afrique; le fils d'Antoine se tua. L'affranchie Phœbé, la confidente de Julie, se pendit : « J'aurais préféré, dit Auguste, être le père de Phœbé. » Il voulait faire mourir sa fille. Il se contenta de l'exiler dans une île déserte sous une étroite surveillance. Scribonia, l'épouse jadis répudiée, obtint seule la permission d'accompagner son enfant. Auguste avertit le Sénat de sa décision par une lettre que lut le préteur et, pendant longtemps, il évita, comme par honte, de se laisser voir. Peu après les deux fils de Julie, Gains et Lucius César mouraient à dix-huit mois d'intervalle. Auguste, dit Suétone, supporta plus légèrement la perte de ses petits, le seul espoir de sa race, que le déshonneur de sa fille. Tibère était rentré à Rome dès la disgrâce de Julie. La disparition des jeunes Césars ouvrait à nouveau devant lui la voie de l'empire (1).
Cinq ans plus tard, le peuple assemblé demandait la grâce de Julie. « Je vous souhaite, répondit l'empereur, de pareilles filles et de pareilles femmes afin que vous soyez à même d'apprécier mes sentiments et de juger ma conduite. » La malheureuse vécut encore quinze années lamentables, assez pour voir Tibère succéder à Auguste et Livie, au début tout au moins plus puissante encore sur son fils qu'elle ne l'avait été sur son époux.
(1) La rumeur publique n'avait pas manqué d'ailleurs d'accuser Livie de la mort des deux héritiers présomptifs.
Ce drame avait eu lieu en l'an 1 de noire ère, vers le moment même où Ovide publiait l’Art d'aimer.
Huit ans après, la fille de Julie renouvelait le scandale. Et il semble que cette fois Ovide ait été mêlé plus ou moins directement à ses amours avec Silanus. « Ce sont mes vers, confesse-t-il, qui pour mon malheur ont fait souhaiter aux hommes et aux femmes de me connaitre: mes vers ont attiré sur moi et sur mes mœurs la censure de César (1). » II était sans doute, suppose G. Boissier, un de ces confidents d'amour qu'où introduit volontiers dans les liaisons pour rompre, de temps en temps, les tête à tété. Personne ne devait s'entendre aussi bien que ce poète et bel esprit à égayer un entretien et animer une fêté galante. Etqui sait la part que put prendre l’Art d'aimer dansles égarements de la seconde Julie qui n'avait pas vingt-cinq ans ? Les deux amants furent exilés séparément en Italie et Ovide s'en fut mourir àTomes, sur les bords du Pont-Euxin, en 17, trois ans après l'avènement de Tibère.
De l'exil d'Ovide nous viennent deux recueils d'élégies, les Tristes et les Politiques. Ce ne sont plus des exercices d'école ni des jeux de salon, mais une poésie sincère. Les thèmes d'amour ont fait place à une mélancolie profondément sentie et de plus eu plus accentuée. L'esprit, sans doute, ni la mythologie, ni le sens du pittoresque, ni l'art raffiné de ciseler un trait, n'en ont disparu. Le talent d'Ovide reste, en sa forme, tel que l'ont formé trente ans d'alexandrinisme. Mais, pour la première fois, l'âme du poète s'y montre au naturel, sans la contention que lui imposaient les modes littéraires ou seulement les entraînements de la vie mondaine. On peut lui appliquer la formule dont Macrobe définissait la nature de Julie : mitis humanitas minimeque severus animus : « une culture aimable et pas la moindre méchanceté».
(I) Trist., 2, 5,
Les impressions de son malheureux voyage, sa vie à Tomes, ses descriptions du pays des Scythes et de là petite garnison de la frontière où il se trouve lui-même parfois obligé de coiffer le casque et de boucler la cuirasse, sont parmi les morceaux les plus pittoresques, les plus originaux et les plus vivants de la poésie latine.
L'art, un art tout hellénistique, aimable et fleuri, même dans la tristesse, est devenu vraiment chez Ovide une seconde nature. Mais l'ardeur à se justifier et l'espoir tenace, jusqu'à la mort d'Auguste, d'obtenir, après une dure pénitence, la grâce du retour en Italie, élève par instants sa Muse légère jusqu'à la discussion des idées. A la lumière de son infortune il fait son examen de conscience, il réfléchit sur son œuvre et, en même temps, sur tout le genre de poésie dans lequel elle se range, sur l'ensemble de cette civilisation qu'il aime et qui lui semble être la forme suprême de la culture humaine. Dans quelle mesure, se demande-t-il, l'art est-il responsable du relâchement des mœurs?
Sa réponse, sans doute, n'est qu'un plaidoyer pro Musa sua. Elle n'en pose pas moins, de façon beaucoup plus profonde que l'optimisme lyrique d'Horace, tout le problème de la réforme morale tentée par Auguste.
Mon Art d'aimer, convient-il, n'est pas un livre empreint de gravité. Mais pourtant il ne renferme rien de contraire aux lois; il ne s'adresse pas d'ailleurs aux dames romaines; c'est une œuvre légère pour femmes légères. Sans doute, dira-t-on, mais une matrone peut essayer de cet art destiné à d'autres. S'il en est ainsi, une matrone devra s'interdire toute lecture, car toute poésie peut être pour elle une école de corruption. Si elle a du goût pour le vice, quelque livre qu'elle prenne, elle aura bientôt façonné ses mœurs au mal. Il ne faut cependant pas en conclure que toute lecture poétique soit criminelle ; mais il n'est rien de bon qui ne puisse comporter quelque inconvénient. Où s'arrêter d'ailleurs? Si la poésie lyrique est corruptrice, les jeux de la scène présentent le même danger. Proscris donc le théâtre, proscris tous les spectacles et ces divertissements qui sont cause de tant de désordres ; proscris le cirque où la jeune fille peut se trouver assise auprès d'un inconnu. Pourquoi laisser ouverts tous ces portiques où l'on voit certaines femmes se promener et donner des rendez-vous à leurs amants? Mais les temples eux-mêmes et toute la mythologie, la peinture et la sculpture sont immorales... Une femme honnête doit fuir aussi les temples. Le temple de Jupiter lui rappelle combien de femmes ce dieu a rendues mères... Devant le temple de Mars, œuvre de ta magnificence, elle verra la statue de Vénus près de celle du dieu vengeur. Vénus lui rappellera Anchise, Diane elle-même, le héros du Latium... Tout peut consommer la perle des cœurs déjà corrompus(1)
La formule finale est parfaite et le développement apparaît juste dans son ensemble. Mais de tels arguments n'étaient pas de nature à guérir la blessure faite au cœur paternel d'Auguste ni à calmer l'irritation qu'il devait ressentir de son impuissance à réformer les mœurs. Ovide d'ailleurs ne pouvait guère aborder le fond même de la question. Si la corruption n'a son origine ni dans la littérature, ni dans l'art, ni dans la vie de société, quelles en sont les vraies raisons ? Il ne pouvait accuser ni l'oisiveté imposée à une jeunesse ardente, ni la richesse excessive d'une minorité pour qui le plaisir constituait le seul idéal. Il pouvait encore moins montrera l'empereur la contradiction entre ses lois renouvelées de l'antique et l'état moral et social de son temps et lui opposer l'exemple de tous ces divorces et de ces mariages imposés en dépit de toute considération sentimentale, infiniment plus immoraux que la plus licencieuse des poésies.
Cependant s'il est vrai, comme le dit fort bien Ovide, que ni Homère lorsqu'il représente l'aventure de Mars et de Vénus, ni Ménandre chez qui il n'est pas une pièce qui ne traite d'une histoire d'amour, ni Catulle ni Tibulle, ni Properce, ni aucun autre, ne peut être rendu responsable de la corruption des cœurs, on ne saurait nier, par contre, que toute cette poésie amoureuse et souvent érotique, développée dans le monde hellénistique et qui s'épanouit à Rome à partir de Catulle, ne représente l'effet de cette corruption. Elle en est comme la fleur, fleur charmante sans doute, mais dont les racines se nourrissent de l'immoralité. Et Ovide, plus que tous les autres, lui qui sans passion véritable, par dilettantisme et par ambition du succès, s'était attaché à flatter le penchant déjà trop accusé de ses contemporains vers les choses de l'amour, était, sinon un corrupteur, du moins un profiteur de la corruption.
(1) Trist., 2, 1, v. 276 sq.
Si Catulle, si Tibulle et Properce, méritent qu'il leur soit beaucoup pardonné parce qu'ils ont beaucoup aimé, Ovide non plus n'est pas sans droit à quelque indulgence, non pas en raison de la sincérité de ses sentiments, mais bien de son ardent amour de l'art d'écrire et de son talent.
L'amant, dit-il, voit les dangers qu'il court, il ne s'en attache pas moins à l'objet de son amour. Comme lui, malgré mon infortune, je garde la passion d'écrire et j'aime le trait qui m'a blessé. Peut-être cet amour passera-t-il pour folie,... De même qu'une Bacchante perd le sentiment de sa blessure lorsque, en proie au délire, elle pousse ses hurlements sur le sommet de l'Edon, ainsi lorsque ma brûlante imagination s'exalte sous l'influence du thyrse sacré, cet enthousiasme m'élève au-dessus de toutes les disgrâces humaines (1).
Ovide est assez grand artiste pour que la justice à son égard consiste à ne le juger qu'en artiste. Il ne s'est point soucié de morale; il ne voulut être qu'un poète. Tel était au fond le véritable grief d'Auguste à son endroit. Son exil, c'est de la part de l'empereur vieilli et aigri, de la part du prince qui voulut être le restaurateur de la vieille Rome, la condamnation de l'art pour l'art alexandrin.
(1) Trist., 4, 1, 35 sq.
CHAPITRE II
AUGUSTE ET LA RÉACTION NATIONALE HORACE ET VIRGILE
I
césar et auguste.
Neveu de César, Octave se présentait aux Romains comme son héritier et son vengeur. Son adoption par le dictateur était en effet, au point de vue politique, le plus net de ses titres. Mais au point de vue du caractère et des idées le contraste est frappant entre César et celui qui prétendait à sa succession. On ne saurait en effet imaginer une opposition plus absolue que celle qui se marque entre la direction imprimée par César à la civilisation romaine et les tendances que fit triompher Auguste.
L'influence de César se manifeste, au cours des quelques années qui séparent le passage du Rubicon (59) des ides de mars (15 mars 41 — assassinat de César), par le complet épanouissement de ce cosmopolitisme qui, depuis la conquête de l'Orient, s'est emparé de Rome. C'est le moment où, dans l'art et dans les mœurs, l'Egypte impose ses modes. Le quadruple triomphe de César en l'année 45 expose à l'étonnement des Romains le Rhône, le Rhin, et l'Océan vaincus, et Vercingétorix prisonnier depuis six ans, et Pharnace roi du Pont, et Juba de Maurétanie, l'Afrique et l'Espagne subjuguées, et surtout les images du Nil et de l'île de Pharos avec Arsinoé, femme du roi Ptolémée. Cléopâtre ne figure pas au triomphe, mais elle doit y assister, en reine, escortée de toute une cour exotique. L'exemple du dictateur entraîne les imaginations romaines vers les lointains inconnus et les pays étranges, ceux des Gaulois, des Bretons et des Germains encore à demi barbares aussi bien que ceux qui fléchissent sous la maturité d'une civilisation trop raffinée.
César, c'est le nouvel Alexandre. Il a fait sien le rêve héroïque de domination personnelle et universelle conçu par l'âme exaltée du grand Macédonien. La guerre conquérante et le pouvoir politique s'entourent chez lui de l'ivresse mystique du thiase dionysiaque. Comme Dionysos avait entraîné son cortège jusque dans l'Inde, César, au moment où il fut assassiné, se voyait déjà courant, à la tête des légions, la grande aventure orientale, soumettant les Parthes, ravissant leurs trésors, dominant au loin le continent asiatique, traversant ensuite les terres encore inconnues de l'Europe pour regagner le Rhin, d'une marche triomphale semée d'exploits. Comme Alexandre et les despotes orientaux, César s'élève lui-même au-dessus de l'humanité; il s'identifie avec Jupiter (1), il se déclare fils- de Vénus. Assis, comme un dieu, devant le temple de sa mère, il reçoit sans se lever les hommages du Sénat, Pour son regard qui embrasse tout l'univers, Rome n'est qu'un point, le peuple romain, la tradition romaine, qu'une chose que l'on conquiert, que l'on violente et qu'on abandonne une fois qu'on en a exprimé la vertu. Ce n'est pas à tort sans doute qu'on lui prêtait le plan, réalisé trois siècles et demi plus tard par Constantin, de délaisser l'Italie épuisée et trop étroite, de transporter le siège de son empire à Alexandrie, à Ilion ou dans quelque autre site de l'Orient et d'y prendre le titre de roi (2).
(1)Suet., Caes. 76.
(2) Ibid., 79.
Le véritable héritier de la pensée de César et son continuateur, ce fut non pas Octave mais Antoine, nouveau Dionysos, époux de Cléopâtre dont César avait été l'amant et maître de l'Orient. Dans quelle mesure Octave, rival puis ennemi déclaré d'Antoine, contribua-t-il à provoquer la protestation de l'esprit national romain et italien contre la prépondérance de l'Orient, ou dans quelle mesure fut-il seulement le bénéficiaire de ce courant d'idées, c'est ce qu'il est bien difficile de déterminer. Il sut en tout cas très habilement épouser l'opinion italienne et se laisser porter par elle.
La réaction nationale avait commencé par l'érudition. Nous en apercevons l'origine dans l'œuvre de Varron. Elle s'était propagée peu à peu dans les milieux savants, dans la moyenne bourgeoisie, dans le peuple des provinces et des campagnes. Mais la poésie surtout prêta son éclat au patriotisme nouveau et en assura la diffusion. La Muse précisa la politique d'Octave et se mit à son service. Horace et Virgile furent les hérauts de cette réaction nationale.
II
horace.
Horace, fils d'un affranchi petit fonctionnaire de Venouse dans l'Italie méridionale, se trouvait à Athènes, y terminant ses études en compagnie des fils de l'aristocratie romaine, lorsque Brutus et Cassius vinrent s'y réfugier après le meurtre de César. Avec ses compagnons, il s'était enrôlé dans l'armée que levaient les vengeurs de la liberté romaine et du Sénat. On l'avait fait d'emblée tribun de légion. Le désastre de Philippes l'avait précipité de ce songe héroïque et il se trouvait à Rome, déchu de ses ambitions, abandonné de tous, sans fortune, renié de cette jeune noblesse au niveau de laquelle l'avait élevé son éducation et perdu dans la foule des déclassés. Chanter l'amour, comme c'était la mode, il n'y songeait guère. Mécontent de lui-même et des autres, se sentant supérieur à son sort, il pense plutôt à railler y c'est la vieille forme moralisante de la satire qui le tente. Pourquoi, se demande-t-il, personne ne se trouve-t-il satisfait de la part qui lui est échue dans la vie ? A quoi bon désirer toujours plus qu'on ne possède ? Les sots ne savent jamais garder un juste milieu. Quel que soit le milieu où nous vivons, ayons la sagesse de supporter les défauts de nos amis. Tels sont les sujets que développent ses premières satires.
Mais en même temps il cherche une forme de poésie plus riche et plus brillante. Ce n'est pas aux modes hellénistiques, c'est à la Grèce ancienne qu'il va demander un type original de lyrisme. Dans l'incertitude de ses Épodes apparaissent de-ci de-là, mêlées à beaucoup d'autres, quelques inspirations nettement politiques. Victime des guerres civiles, il cherche à détourner les Romains de nouvelles erreurs ; il célèbre la victoire d'Octave sur Sextus Pompée et invective déjà contre Cléopâtre ; il augure la fin du siècle de fer. Mais c'est surtout un peu plus tard, vers le moment d'Actium, que l'actualité prend dans ses Odes une place prépondérante. Avec la paix des dieux, Octave apportera aux Romains le renouveau ; soumis à Jupiter seul, il donnera des lois sages à toute la terre. Non sans quelque ironie, peut-être, il célèbre son propre retour à la piété et, surtout, il chante le triomphe du jeune César et de l'Italie sur l'Égyptienne fatale.
Nunc est bibendum, nunc pede libero
Pulsanda tellus, nunc saliaribus
Ornare pulvinar deorum
Tempus erat dapibus, sodales.
Le temps est venu de boire, le temps est venu de frapper la terre d'un pied sans souci et de charger les tables des dieux de mets dignes des prêtres de Mars, ô mes amis.
Bientôt, dans le second livre des Odes, voici le poète qui s'élève à des considérations sociales sur l'envahissement du luxe et de la grande propriété, invoquant les lois de Romulus et de l'austère Caton (1).
Jam pauca aratro jugera regiae
Moles relinquent...
... Non ita Romuli
Praescriptum et intonsi Calonis
Auspiciis veterumque norma.
Ni Mécène dont il est devenu l'ami, ni son propre génie ne semblent avoir été précisément qualifiés pour inspirer à Horace l'éloge de la vertu guerrière qui occupe la seconde Ode du livre III.
Que le jeune Romain endurci aux fatigues de la guerre apprenne à supporter l'extrême pauvreté. Que la lance à la main, cavalier redoutable, il harcèle le Parthe belliqueux.
Il répond ainsi, de façon martiale, aux malédictions de son doux ami Tibulle et des élégiaques en général, contre le métier militaire; il prêche une vertu qu'Auguste aurait voulu voir renaître chez les fils de l'aristocratie trop pacifiée de Rome.
Les deux derniers livres des Odes, dont la composition se place entre le retour d'Auguste en Italie et l'an 23 avant notre ère, expose tout le programme de rénovation morale et politique du prince. Le bonheur et la puissance de Rome exigent avant tout la réconciliation avec les dieux, la renaissance de l'ancienne piété et la restauration des temples (2).
Delicta majorum immeritus lues,
Romane, donec templa refeceris
Dis te minorem quod geris imperas
Hine omne principium, huc refer exitium.
(1) Carm., 2, 15.
(2) Carm., 3, 6.
Régulus est le héros qu'il propose en modèle à son temps. Il supplie Auguste, pour mettre un terme définitif aux meurtres impies de la guerre civile, de refréner la licence des mœurs. A la corruption romaine il oppose la vertu des Barbares et leurs nombreuses familles. Et déjà il célèbre les heureux effets de la paix.
Grâce à toi, le bœuf parcourt en paix les prairies; Gérés et l'Abondance fécondent nos champs; les navires volent sur les mers pacifiées, l'Honneur s'alarme même d'un soupçon...
Par quels honneurs l'amour du Sénat et des citoyens éternisera-t il dans nos Fastes l'immortel souvenir des vertus d'Auguste...?
Ton règne, ô César, a ramené l'abondance dans nos campagnes ; il a rendu à notre Jupiter ces drapeaux arrachés aux temples orgueilleux des Parthes ; il a fermé le sanctuaire de Janus... II a imposé des bornes à la licence effrénée, banni le vice, rappelé ces antiques vertus qui ont fait grandir le nom latin, croître l'Italie en puissance et ont porté la majesté de l'Empire depuis les rivages de l'Occident jusqu'aux régions où le soleil se lève...
Et nous, dans nos fêtes et chaque jour, au milieu des dons du joyeux Bacchus, entourés de nos enfants et de nos femmes, après avoir d'abord selon les rites invoqué les dieux... nous célébrerons à l'exemple de nos pères les héros illustres, Troie, Anchise et la descendance de Vénus.
Ainsi Pindare, dans laGrèce ancienne, se faisait l'interprète de l'enthousiasme soulevé par les victoires Olympiques et Pythiques. Horace a choisi la forme légère de l'Ode, celle d'Alcée, celle d'Anacréon, il a reculé devant le grand poème lyrique tel que le composait Pindare mais, dans cette forme, il a versé la poésie qui s'exhale des grands sentiments collectifs éprouvés par tout un peuple.
Cette joie triomphante du calme et de l'ordre revenus après les angoisses de la guerre civile, ces hymnes à l'Italie sauvée du danger oriental et désormais assurée de ses conquêtes, ces aspirations à l'antique vertu, à la piété, à une vie d'idylle dans les campagnes devenues à nouveau fertiles, tout ce lyrisme étonne de la part de l'épicurien sceptique qu'était Horace. Poète, il se fait l'interprète de la grande espérance du peuple romain. Victorieuse de l'Egypte fatale, débarrassée de tous les factieux, Rome se retrouve elle-même, sous le règne de la loi représentée par Auguste. Ses épreuves, conséquence de l'ambition, de l'avidité et des vices des anciennes générations, ont pris fin ; la paix est revenue et, avec la paix, le travail fécond et le bonheur. C'est véritablement un siècle nouveau succédant à celui du fer, c'est l'âge d'or, annoncé jadis par Virgile dans ses transports mystiques de la quatrième Eglogue,
Ullima Cumaei venit jam carminis aetas;
Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo,
Jam redit et Virgo, redeunt Salurnia regna
Jam nova progenies caelo demittitur alto,
Mieux que jamais, aujourd'hui, nous pouvons comprendre l'exaltation des peuples devant l'espoir d'un tel changement. Les guerres,, toutes les guerres, sont définitivement terminées ; il n'est plus d'ennemis à vaincre au dehors ; dans l'empire, la sagesse, la modération, la piété, assureront la concorde. Si cruellement déçus qu'aient été de tels espoirs, cette idée de la paix romaine étendant son bienfait sur le monde apparaît vraiment comme une grande et noble conception. Ce n'était qu'un vœu, sans doute, qu'un idéal, mais un idéal qu'il est tout à l'honneur du peuple romain d'avoir une fois conçu. Il a véritablement suscité l'enthousiasme d'une génération et, dans cette génération, surtout des humbles et des simples, de tous ceux qui se trouvent le plus désarmés devant les calamités publiques et qui ont le plus à espérer d'un renouveau social. Virgile, poète des bergers et fils de paysans, prête à cet idéal une couleur religieuse et miraculeuse. La terre, d'elle-même, sans travail, offrira ses dons à l'homme ; tous les maux, tous les dangers s'évanouiront ; les lions ne seront plus la terreur des troupeaux; le serpent mourra, les plantes vénéneuses mourront ; partout des fleurs et des fruits. Horace, en se faisant, dans ses strophes savamment ciselées, l'interprète du sentiment populaire, cherche à le préciser par des images plus réelles. Il en trouve les éléments dans les spectacles de la vie rustique et dans les souvenirs embellis du passé romain. La paix auguste, c'est le bœuf creusant son sillon, c'est le dieu Faune parcourant les étables et comblant de ses bienfaits les troupeaux et leurs petits, c'est le laboureur soupant joyeusement au milieu de sa famille. C'est aussi la renaissance des temps glorieux de Romulus, de Regulus, de Fabius, de Caton, des temps où tout le monde, imaginait-on, était vertueux et sage et où les dieux, satisfaits de la piété du peuple, procuraient à la République une gloire sans mélange.
En face de l'élégie liée par l'imitation hellénistique et qui n'ose s'élever plus haut que de mesquines histoires d'amour, contre tout ce lyrisme moulé dans une convention d'élégance mondaine, guindé dans un maniérisme trop savant et d'un style affecté, il crée une poésie parfaite en sa forme et d'inspiration volontairement naïve, populaire et romaine. Ses Odes sont vraiment la poésie du siècle nouveau.
III
les géorgiques.
En plein succès, Virgile avait renoncé au genre factice des Bucoliques. C'est lui-même qu'il condamne en même temps que l'école alexandrine lorsqu'il renie tous ces sujets rebattus dont la poésie n'est bonne qu'à occuper le vide des esprits. « Qui ne connaît l'histoire du cruel Eurysthée, du misérable Busiris et de son autel? Qui n'a chanté l'enfant Hylas et Délos chère à Latone et Hippodamie et Pélops à l'épaule d'ivoire ? »(1) Lui-même, dans l'Églogue qui lui avait valu son premier triomphe, avait chanté Hylas (2).
(1) Georg.. 3, 4 sq.
(2) Egl., 6, 43, 44.
Il se propose désormais de tenter une voie nouvelle qui l'élève à la gloire.
Cetera quae vacuas tenuissent carmina mentes
Omnia jam vulgata...
... Tentanda via est qua me quoque possirn
Tollere humo victorque virum volitare per ora (1).
L'origine de cette inspiration nouvelle se trouve à la fois dans la vie intellectuelle et savante de son temps et dans les conditions économiques et politiques de l'Italie d'alors. On ne saurait mettre en doute, à la source des Géorgiques, l'influence de Varron et des savants de son école. C'est en 37 qu'avait paru le De Re rustica. La même année, un savant grec que César avait autrefois ramené d'Alexandrie, Hygin, avait lui aussi publié un traité d'agriculture dans lequel une place tout particulièrement importante était faite à l'élevage des abeilles. On sait que tout le quatrième chant des Géorgiques est consacré à ce sujet. Les raisons qui, à ce moment, reportaient ainsi vers l'agriculture l'attention des Romains ont été mises en lumière par M. Ferrero. Sextus Pompée bloquait les côtes de l'Italie, interdisant l'arrivée des blés exotiques. Antoine, maître de l'Orient, arrêtait l'afflux de l'or. Il fallait, pour vivre, en revenir aux principes de l'économie essentiellement agricole du passé. Agé de quatre-vingts ans, Varron retrouvait aisément dans les souvenirs de sa jeunesse la tradition même du vieux Caton. L'expérience de toute sa vie lui permettait de l'adapter à l'état actuel de l'agriculture italienne.
Demeuré rustique et d'allures et de goûts, connaissant la terre et l'aimant, Virgile lui aussi retrouvait aisément, par delà les bergeries conventionnelles de ses Bucoliques, la vie campagnarde italienne. Il la retrouvait vivifiée par la science d'Hygin et de Varron.
(1) Georg-., 3, 3; 7, 8.
Il passe, avec les Géorgiques, de l'école à la vie réelle ; il reçoit son inspiration d'un courant d'idées véritablement vivant.
Là est l'originalité du poème, dans le fond plus encore que dans la forme. La poésie délaisse la fiction mythologique pour des faits positifs et réels ; elle descend des nuages de l'Ida pour prendre pied sur le sol, sur le sol italien.
Aux contemporains, la tentative de Virgile devait paraître moins hardie et moins nouvelle qu'elle ne nous semble. Les Géorgiques sont un poème didactique; or le genre didactique était en grand honneur chez les alexandrins et leurs imitateurs romains. Elles rappelaient en une certaine mesure les Travaux et les Jours d'Hésiode, et des poètes romains avaient déjà traduit ou imité Hésiode. Virgile d'ailleurs avait soin de se réclamer de ce patronage vénérable. « J'aborde, dit-il, un sujet d'antique louange et de vieille poésie ; j'ose ouvrir à nouveau une source sainte et dire dans les cités romaines le chant que jadis entendit Ascra.» Mais c'est en l'honneur de l'Italie qu'il reprend le chant antique; c'est en fils de l'Italie qu'il célèbre la terre de Saturne, puissante mère des moissons, des troupeaux et des hommes. Les Géorgiques n'ont vraiment que peu de traits communs avec les Travaux et les Jours.
Le réel, le réel italien, non pas seulement un sentiment ou une idée mais la chose vue, le détail exact si humble soit-il, devenu objet de poésie, telle est la grande nouveauté des Géorgiques. Laissons de côté les traits qui tiennent au caractère propre de l’esprit de Virgile et à son tempérament poétique, en particulier l'émotion sentimentale et cette sorte de tendresse que lui inspirent non seulement les hommes mais les animaux et même les choses et qui enveloppe comme d'une atmosphère douce la netteté des images ; laissons de côté la qualité même de ces images, la vivacité et l'harmonie de leur couleur. Contentons-nous de considérer ce qui constitue essentiellement l'art de Virgile, la composition et du poème et de chacune de ses parties. L'originalité de cet art consiste, nous semble-t-il, dans l'union profonde et jusque-là sans exemple de la sensation saisissant directement la réalité et des traditions savantes de la poésie grecque, du réalisme romain et de l’idéalisme hellénique.
Il paraît inutile d'insister sur la part considérable des détails réalistes dans les Géorgiques. Le poème est, avant tout, une description minutieuse et précise des travaux rustiques et de la vie campagnarde. Les passages de caractère technique, pour ainsi dire, sont nombreux; ils doivent leur poésie à la force pittoresque de l'expression.
.... Ergo age, terrae
Pingue solum primis extemplo a mensibus anni
Fortes invertant tauri, glebasque jacentes
Pulverulenta coquat maturis solibus aestas.
Lorsque la terre est encore grasse de l'humidité de l'hiver, dès les premiers mois de l’année, les forts taureaux doivent la retourner afin que les mottes soulevées cuisent sous les mûrs soleils de l'été poussiéreux.
De tout son talent, en bon ouvrier consciencieux, Virgile s'applique à s'acquitter de la tâche didactique assumée. Il décrit donc les choses telles qu'elles sont, accumulant les traits d'observation, en véritable technicien. Citons comme exemple sa description de la bonne vache :
... Optima torvae
Forma bovis, cui larpe capui, cui plurima cervix
Et crurum tenus a mento palearia pendent.
Le type le meilleur est celui de la vache à l'air mauvais; elle a la tête épaisse, la nuque très puissante, depuis la naissance du cou les fanons lui pendent jusqu'aux jambes.
S'attachant à la réalité, il en saisit la beauté et sait l'exprimer en artiste. Ce naturalisme n'est cependant pas continu. Virgile craindrait d'en fatiguer son lecteur. Lui-même, semble-t-il, s'en lasse parfois.
Venons-en aux Dryades, à leurs forêts et à leurs clairières que je n'ai pas encore abordées, telle est, Mécène, la rigueur de tes ordres.
L'autorité de Mécène n'empêche pas son imagination de s'évader fréquemment du milieu des champs et des bêtes vers les fictions de la fable. Ou bien encore il s'applique à fondre le détail réaliste, objet de la sensation, dans un thème mythologique d'inspiration savante. L'éloge fameux de l'Italie, au second chant, offre un exemple remarquable de ce dernier procédé.
L'idée qui se présente tout d'abord à l'esprit de Virgile est d'opposer sa patrie aux terres lointaines et fameuses dans la légende hellénistique, à celle des Mèdes aux forêts précieuses, à celles du Gange et de l'Hermus pleines d'or, à la Bactriane, à l'Arabie qui produit l'encens. Ce sera là pour ainsi dire le fond du tableau, fond un peu vaporeux et de couleur exotique où l'accumulation des noms célèbres, la mention de l'or, des essences rares et des parfums met la note brillante. Puis viennent, toujours par opposition, des allusions mythologiques. Ce ne sont pas, comme en Colchide, des taureaux soufflant le feu qui ont labouré notre terre pour qu'on y semât les dents de l'hydre ; on n'y voit pas se lever des moissons de casques et de lances. Enfin apparaît, esquissée d'ailleurs à grands traits, l'image des campagnes italiennes portant les lourdes céréales et la liqueur du Massique chère à Bacchus, nourrissant l'olivier et les gras troupeaux.
Le cheval de guerre y galope la tête haute. Dans ton cours, ô Clitumne, et baignent les grands troupeaux blancs et le taureau qu'aux jours de triomphe on immole devant les temples de Rome. Cher nous règne un perpétuel printemps ou bien l'été. Le bétail chez nous porte deux fois l'an, l'arbre fruitier produit deux récoltes. Pas de tigres, pas de serpent traînant ses spires écailleuses, mais de belles villes, de grands monuments, des citadelles élevées par l'homme au sommet des monts rocailleux et des fleuves baignant le pied des vieux murs...
C'est là d'ailleurs un morceau d'apparat auquel le mythe doit prêter une allure particulièrement noble et dont l'enthousiasme ne va pas sans quelque exagération. On ne saurait cependant y méconnaître les traits exacts et pittoresques.
La composition de chacun des chants du poème accuse le même soin d'unir le réel à l'idéal et de relever le naturalisme par l'artifice traditionnel de l'allégorie et du mythe.
Le premier chant, par exemple, a pour objet les labours et les semailles. Virgile y décrit attentivement les soins divers qu'il convient de donner à la terre, il dit à quel moment doit être fait chaque travail. Mais il ne s'interdit pas de lever les yeux vers le ciel ; la science et la philosophie viennent en maint passage interrompre le calendrier rustique. Les travaux des hommes sont subordonnés au cours des astres. Les signes du zodiaque, la division du monde en zones habitables, les variations de l'atmosphère amènent le poète à traiter de la prévision de l'avenir et à rappeler les présages de la mort de César, brillante clausule qui doit ennoblir aux yeux du public contemporain l'humilité des détails techniques et des recettes pratiques, le véritable objet du chant.
Le second chant est consacré aux produits de la terre, aux plantes et aux arbres. Après les préceptes exacts et minutieux touchant les greffes, les plantations, la taille, l'élève des jeunes plants, vient l'éloge du printemps. Le chant se termine de nouveau par un air de bravoure plus philosophique, il est vrai, et plus politique que mythologique malgré la place importante qu'y tiennent les souvenirs mythologiques.
O fortunatos nimium sua si bona norint
Agricolas ! quibus ipsa procul discordibus armis
Fundil humo facilem victum juslissima tellus.
Qu'on relise le passage ; il est fait tout entier de souvenirs ou du moins de réminiscences littéraires ; il est l'œuvre du poète savant bien plus que du campagnard. Virgile ne s'en cache pas d'ailleurs ; tout comme Tibulle et Properce, comme le fera plus tard Ovide, il proclame son amour pour les Muses savantes :
Me vero primum dulces ante omnia Musae
Quarum sacra fera, ingenti percussus amore
Accipiant, caelique vias et sidéra monstrent.
Les soins rustiques n'apparaissent qu'en seconde place, et encore se trouvent-ils représentés sous la forme imagée de leurs dieux.
Felix qui potuit rerum cognoscere causas
Fortunatus et ille deos qui novit agrestes
Panaque Silvanusque senem Nymphasque sorores.
Les deux derniers chants accusent une composition de même sorte. Dans le troisième chant ce ne sont pas seulement les grands bœufs blancs du Clitumne qui vont inspirer sa Muse. Un souffle plus ambitieux et moins italien l'anime. Les chevaux de course de la plaine d'Argos et les chiens de chasse de Laconie l'appellent tout d'abord.
,,.. socat ingenti clamore Cithaeron
Taygelique canes domitrixque Epidauras equorum.
C'est la chasse d'Actéon qui traverse ici le poème de l'agriculture italienne.
Ce que Virgile voit dans les animaux, ce sont les formes, sans doute, mais ce sont aussi et surtout les passions, l'amour et l'ardeur à la lutte, la vie, les souffrances, tout ce qui les rapproche de l'homme. L'éleveur trouvera dans ses vers quelques bons conseils, peut-être; le moraliste qui n'a cure de l'élevage y rencontrera, à coup sûr, en plus grand nombre des sujets de réflexions et des images pleines de sens. Le chant se termine comme tous les autres par un long morceau d'apparat de tradition éminemment classique, le tableau de la peste des animaux, sorte de réplique, transposée des hommes aux bêtes, de la peste d'Athènes décrite par Thucydide et par Lucrèce.
Ce sont encore les hommes qu'au quatrième chant on entrevoit derrière les abeilles. Toute la seconde moitié du chant se trouve d'ailleurs occupée par un épisode purement mythologique: l'histoire d'Aristée, où nous voyons reparaître non pas l'enfant Hylas, sans doute, et Pelops à l'épaule d'ivoire, mais la nymphe Cyrène et Nérée et Orphée et Eurydice. La campagne antique était peuplée de dieux. Virgile y salue longuement tous ceux qu'il rencontre; il y ajoute bien des divinités et des héros étrangers, hôtes familiers de son imagination qu'il acclimate sans effort dans les champs d'Italie-
L'influence des leçons qui ont formé son esprit et ses yeux de poète se retrouve dans l'œuvre nouvelle. La poésie romaine ne pouvait se détacher tout à coup de la forme hellénistique. Par la mythologie, par l'art de composer les images, les Géorgiques demeurent soumises à l'esthétique de leur temps. Mais l'âmeen est originale, car l'inspiration en vient directement du sol italien, et cette inspiration par elle-même comporte l'observation exacte des choses de la terre et la peinture réaliste des plus humbles détails. Virgile se trouve ainsi amené à exprimer artistement l'une des veines profondes de la vie nationale. Depuis les siècles de la préhistoire, dans les campagnes, loin des villes, en dehors de l'histoire, des millions d'hommes ont inventé peu à peu et répété de génération en génération les gestes et les œuvres décrites par le poète. Autant que la guerre et les délibérations du Sénat leur travail obscur fit la grandeur de Rome. Et l'on ne saurait comprendre la renaissance augustéenne si l'on oublie cette humble mais multiple activité qui, dans l'Italie pacifiée, tous les jours et par toute saison, s'appliquait à tirer de la terre la subsistance des hommes. Ce travail agricole pénible et intelligent avait reconquis les vétérans récompensés par un champ de leurs années de guerre. Par lui, la vieille tradition italique entraînait également les colons anciens et les nouveaux. Faite d'attention scrupuleuse, de prudence, de ténacité et d'énergie, la vie campagnarde formait la future aristocratie destinée à venir prendre à la ville et dans l'empire la place laissée vide par l'ancienne noblesse épuisée. La terre représente vraiment la force secrète de l'empire romain, celle de tous les renouvellements inattendus qui, comme des matinées radieuses, suivent les nuits de tempête et d'horreur. Tandis que dans le champ de son père, au pied des Alpes, dans la plaine où le Minio s'attarde en lents détours, un étranger faisait germer de nouvelles moissons, Virgile, pour l'utilité de tous et aussi pour le plaisir de l'art, chantait l'agriculture nourricière de Rome.
IV
L'ENÉIDE.
C'est en l'an 29 avant notre ère que Virgile put lire les Géorgiques complètement achevées à Octave rentrant en Italie. Après Actium, le prince venait de passer deux années presque entières à organiser l'Orient. La prospérité renaissait partout, la concorde se faisait par l'oubli des rivalités anciennes. A l'unanimité, le Sénat offrait le pouvoir suprême au pacificateur du monde. Celui n'acceptait que pour une période de dix ans une autorité qu'il s'efforçait de faire rentrer dans le cadre de l'ancienne constitution. La vieille République semblait reparaître rajeunie, mieux ordonnée et simplement guidée par une sagesse nouvelle. Un enthousiasme sincère concrétisait autour de la personne d'Auguste tous les espoirs de l'âge d'or. Les souvenirs glorieux du passé romain, les aspirations à un avenir plus calme mais encore plus brillant, formaient comme une auréole à sa récente victoire. C'est dans ces sentiments communs à tout le peuple que Virgile semble avoir voulu tout d'abord chercher l'inspiration d'un nouveau poème. Ce projet, il l'annonce dès le troisième chant des Géorgiques :
Dans les verdures de la campagne je veux élever un temple de marbre, le long de l'eau... sur les rives du Mincio bordées d'une frange de souples roseaux. Au milieu je placerai César. Il sera le maître du temple. Vainqueur et s'offrant aux regards dans la pourpre tyrienne. . il présidera aux jeux que je veux instituer en son honneur...(1).
Entre l'idée première d'un poème en l'honneur d'Octave vainqueur à Actium et 1'Enéide dut intervenir toute une série de réflexions dont l'œuvre, telle qu'elle nous est parvenue, accuse les tendances. Quelles sont les idées qui ont présidé à la composition de l'épopée nationale des Romains?
La première, incontestablement, est celle de Rome et de la grandeur romaine. Elle s'affirme dès les premiers vers du poème. A travers les feux de la dernière nuit de Troie, dans les pérégrinations et toutes les aventures d'Enée, dans les conseils des dieux et les combats des hommes, partout et à chaque instant, reparaît le thème de Rome future maîtresse du monde :
(1) Georg., 3, 12-33.
... gravidam imperiis belloque frementem
... ac totum sub leges milleret orbem.
L’Eneide est l'épopée de la prédestination de Rome. C'est Rome et non plus Auguste qui y tient la première place ; la ville, son peuple, l'Italie se sont substitués à la personne du prince. L'inspiration est devenue infiniment plus ample.
Élevant sa pensée bien haut au-dessus des temps présents, Virgile a pris son sujet dans les âges préhistoriques et fait d'Enée son héros. La figure d'Auguste n'apparaît qu'en deux passages, à la fin du sixième chant, lorsque Anchise présente à Enée la lignée de ses descendants et, avec plus de développement, dans la description du bouclier d'Enée. Mais ne l'aperçoit-on pas à chaque instant à travers celle du premier fondateur ? Le portrait du pieux ancêtre manque, dit-on, de caractère. Combien ne s'anime-t-il pas si nous y reconnaissons, ainsi que ne pouvaient manquer de le faire les contemporains, comme une préfigure du prince qui a parachevé l'œuvre de la grandeur romaine. Enée se sacrifie lui-même à la tâche imposée par le destin. Auguste, lui aussi, pouvait dire : « Les destins ne me permettent pas de conduire ma vie selon mes auspices et d'ordonner à mon gré mes soucis.» Sa maxime n'avait-elle pas été pendant longtemps celle que professe Enée : « Suivons le sort dans les détours qu'il m'impose ; quoi qu'il arrive, quelle que soit la fortune, emportons-le sur elle en la supportant.» Cette patience obstinée dans la difficulté s'allie chez Enée à l'audace :
Tu ne cede malis sed contra audentior ita
Qua te fortuna sinit.
et à l'amour de la gloire qui doit résulter d'une œuvre grande et utile. N'est-ce pas là toute l'histoire d'Octave et le secret de son triomphe dans les guerres civiles ? La froide volonté dont fait preuve Énée n'est-elle pas aussi le trait dominant du caractère d'Auguste, celui dont le prince était le plus fier ?
Mais il ne se laisse émouvoir par aucune larme : aucune parole ne peut l'attendrir, le sort ne le permet pas, un dieu ferme les oreilles du héros inébranlable... Tel un chêne aux racines profondes laisse, sans fléchir, passer la tempête... .
Lorsqu'au onzième chant les Latins une première fois vaincus viennent demander une trêve pour enterrer leurs morts, la réponse d'Énée semble un mot d'Octave : « Vous me demandez la paix pour vos morts, c'est aux vivants que je voudrais l'accorder.» Ce chef qui se réclame des droits à lui attribués par le destin, qui veut la soumission de l'adversaire pour le bien de la patrie, tout prêt à accueillir ceux qui viennent de le combattre, n'est-ce pas le vainqueur d'Actium ? Comme Énée encore, dès le temps où Virgile finissait l'Enéide, Auguste dans son triomphe pouvait dire : « Mon enfant, apprends de moi la vertu et le vrai labeur, d'autres t'enseigneront à être heureux » Les traits peut-être volontairement un peu flous du héros troyen et les couleurs effacées de son image prenaient dans l'esprit de Virgile une précision vivante. César n'a pas été complètement dépossédé du monument élevé par le poète, c'est sa figure froide et compassée qui .trône au milieu du temple sous la forme idéale du héros légendaire.
Tout au long du poème, le patriotisme romain de Virgile aperçoit ainsi la réalité vivante dans le mythe. La patrie, pour Virgile, ce n'est pas seulement le prince père de l'empire, c'est aussi la terre d'Italie et les hommes qui la peuplent, ce sont les légendes et les traditions, les images familières et les grands souvenirs historiques. Le sentiment profond du poète anima les choses et leur prête couleur et relief, il inspire la description et la fait exacte. C'est avec un accent religieux que dès le troisième chant Enée et ses compagnons et le vieil Anchise lui-même qui reposera au seuil de la terre promise, saluent du milieu de l'Adriatique « les collines obscures et basses sur l'horizon » de la cote italienne. A partir du cinquième chant l’Enéide devient en quelque sorte l'épopée géographique de la terre d'Italie. L'érudition s'y mêle au pittoresque. Voici l'Eryx célèbre par les guerres puniques et Drepanum qui doit sa gloire au tombeau d'Anchise ;voici Cumes eubéenne et sa citadelle à laquelle, tout en haut, Apollon préside. Le cap Misène, le cap Palinure, doivent leurs noms aux tombes des compagnons d'Enée ; Caieta, la vieille nourrice du héros aurait, en mourant, assuré la renommée éternelle de la ville de Gaète. Lorsque les Troyens touchant le sol latin, une émotion nouvelle s'empare du poète.
Dis-moi, Erato, supplie-t-il, quels étaient les rois, quel fut l'ordre des faits, quel fut l'état de l'antique Latium... Mon sujet s'élève, j'aborde une œuvre plus haute... ('.). — De quels hommes florissait dès lors l'Italie nourricière? Tu le sais, toi Déesse, tu peux nous l'enseigner ; à nous, hélas, est parvenu de toute cette renommée à peine un faible écho.
Ce faible écho suffit à Virgile pour animer de détails précis le dénombrement des Latins et leurs alliés, et plus loin, au chant dixième, celui des Etrusques et des Ligures qui viennent au secours d'Enée. Ces épisodes s'inspirent d'Homère sans doute, mais, reconnaît un excellent juge, par la valeur des peintures et leur intérêt ethnographique, l'imitation a surpassé le modèle.
En mettant le pied sur la terre encore inconnue du Latium, Enée y reconnaît sa demeure.
Hic domus, haec pairia est.
Comme dans la maison paternelle les moindres détails y prennent leur importance, tout chargés qu'ils sont de souvenirs et d'émotions. Ce sentiment devient pour Virgile le principe d'un art essentiellement concret qui, par un trait exactement noté, par une simple épithète pleine d'un sens précis, évoque comme en raccourci tout un tableau ou un ensemble d'impressions, de même qu'entre les enfants d'une même famille un mot suffît à réveiller le cher passé commun. Ainsi pour les lecteurs romains, les vers où Virgile mentionne les lieux ou les gens du Latium, où il fait allusion à leurs traditions ou à leurs rites, se chargent d'impressions réelles et deviennent comme le signe évocateur de choses vues et senties. Ces images, ces mots d'un retentissement profond ne sont-ils pas le secret même de la poésie ?
Ce n'est pas seulement dans le Latium et en Italie, c'est tout le long des courses d'Enée à travers mers et terres que le patriotisme de Virgile trouve la réalité et l'actualité romaines. Enée parcourt l'Adriatique ; il ne manque pas d'y apercevoir la cime nuageuse du promontoire de Leucade séjour d'Apollon, d'Apollon d'Actium; il débarque, il sacrifie à Jupiter et sur le rivage d'Actium qui, un jour, consacrera définitivement la fortune d'Auguste, il célèbre des jeux et élève d'avance un trophée. La visite du fondateur conquiert pour ainsi dire par anticipation à l'empire les terres méditerranéennes destinées à devenir romaines : la Thrace, la Crète, les côtes d'Épire et d'Afrique : le poème deviendra ainsi le bien commun des Romains et de leurs sujets.
Les quatre premiers chants du poème se trouvent localisés à Carthage : c'est là qu'Enée raconte à Didon la prise de Troie et ses longues pérégrinations, c'est là que se déroule ce roman d'amour si goûté des lecteurs romains, L'issue tragique de l'idylle doit annoncer sans doute la fureur des guerres puniques. Mais une autre idée semble aussi inspirer les tableaux que présente Virgile. Voici Enée qui, vêtu en Tyrien, préside aux embellissements de la ville étrangère. Ce chantier où tout le monde travaille comme dans une ruche, où l'on creuse ici un port, où l'on jette les fondations d'un théâtre, au centre duquel s'élève un temple à Junon, ce n'est pas seulement la Carthage de Didon, c'est aussi celle d'Auguste. C'est une peinture d'actualité. Sur le site maudit et désert depuis plus d'un siècle de la cité punique, Auguste venait en effet d'ordonner la construction d'une nouvelle ville, la future capitale de l'Afrique romaine. « II a trouvé dans Virgile, note M. Carcopino, le poète qui, pendant que la ville renaissait de ses cendres, s'est chargé de l'embellir de ses vers et de dissiper, au souffle purificateur des légendes les plus populaires de la tradition latine, l'atmosphère de méfiance et de crainte qui l'étouffait encore et pouvait en arrêter le développement. » L'imagination de Virgile s'appuie sans cesse sur la réalité romaine, sur la sensation directe de la terre et des choses d'Italie, sur l'histoire nationale et sur l'idée politique augustéenne. Malgré la transposition du sujet dans le mythe, l'Enéide est bien l'épopée de Rome maîtresse du monde, de l'Italie et du Latium, l'épopée de la restauration morale et matérielle voulue par Auguste.
C'est pourquoi les dieux et la religion y tiennent une place dont l'importance ne va pas sans causer quelque étonnement. La perpétuelle intervention de quelque divinité semble un procédé nuisible à l'intérêt de l'action; la piété d'Enée apparaît parfois fastidieuse. Les héros de l'Iliade et l'artificieux Ulysse nous montrent l'activité humaine beaucoup plus dégagée de la tutelle divine. Ils s'aident d'abord en attendant que le Ciel les aide. Enée attend pour agir que le Ciel ait décidé de l'événement.
Les divinités, dans l'Enéide, s'étagent pour ainsi dire sur plusieurs plans. Tout en haut règne le Destin; au-dessous viennent les grands dieux, Jupiter, Junon, Vénus, Neptune, Vulcain, Diane, Mercure etc.; enfin les innombrables dieux topiques, les oracles, Mânes, Pénates, toutes les forces divines de la terre et des eaux, du ciel et des enfers. Le Destin ordonne toute chose : dès l'origine des temps c'est lui qui a décidé de donner l'empire du monde à Rome héritière de Troie. La puissance de l'Asie et la race de Priam sont tombées lorsqu'il a semblé bon aux dieux supérieurs ; ce ne sont pas ses gestes que raconte Enée à Didon, ce sont les décrets des dieux.
Fata renarrabat divum cursusque docebat.
Enée s'abandonne entièrement à cette puissance supérieure qui le conduit comme par la main, qui lui évite sinon les difficultés, du moins tout imprévu, qui a réglé d'avance jusqu'aux moindres détails et qui assurera avec le même soin l'avenir de sa postérité. La surprise ne contribue en rien à l'intérêt de l'action. Une majestueuse finalité, flatteuse pour l'orgueil romain et consolante pour les vaincus, domine toute l'épopée. Mais ce Destin répond à une conception plus philosophique que religieuse. Il exprime une idée fort voisine du « plan de la Fortune » imaginé par Polybe et ne se distingue guère de la Providence chère à Bossuet. Le Destin maître des dieux eux-mêmes n'est qu'une image de piété symbolisant la philosophie de l'histoire la plus courante à Rome.
Les grands dieux de la famille de Jupiter n'apparaissent guère que comme un artifice épique conventionnel. La rancune de Junon, la sollicitude de Vénus tendre mère, le froncement de sourcils de Jupiter qui, bien inutilement, fait trembler l'Olympe et la terre, ne représentent que l'héritage d'Homère. Ces intervenions merveilleuses semblent de règle dans l'épopée. Tout autre est le rôle des modestes divinités de l'étage inférieur. C'est à elles surtout que vont la crainte respectueuse, les scrupules et les soins du héros fondateur. Ils représentent l'élément vraiment religieux de l'Enéide.
On a pu soutenir que le véritable héros du poème n'était pas Enée, mais les Pénates. Durant la nuit tragique de l'incendie de Troie, l'ombre d'Hector les confia à Enée. Mais le héros n'ose y toucher de ses mains ensanglantées. Anchise, qui du reste est le chef de la race, en aura provisoirement la garde :
Tu genitor, carpe sacra manu patriosque Pénales.
Me, bello e tanto digressum et caede recenti
Attreclare nefas donec me flumine vivo
Abluero.
C'est pour ses Pénates qu'Enée cherche une terre favorable et qu'il conquiert le Latium. Le nom troyen disparaîtra, la langue et les mœurs des compagnons d'Enée deviendront celles de l'Italie, le sang des hommes se mélangera mais les Pénates passeront du camp troyen à la ville de Latinus, de celle-ci à Albe et d'Albe à Rome; ils assurent la continuité du peuple. L'élément essentiel de la patrie romaine, ce sont ses dieux.
La piété d'Enée consiste dans la soumission parfaite de son esprit aux ordres de tous les dieux ; elle se marque surtout par une attention constante à tous les signes par lesquels les dieux sont censés manifester leur volonté. Les prodiges accompagnent ses pas, il ne s'en étonne point, il les sollicite au contraire comme chose naturelle. Ses errements à Délos, en Crète, en Epire, en Sicile, à Cumes, ne sont qu'une course aux oracles. A chaque danger qui menace, le chef troyen, Anchise, tant qu'il vit et, après lui, Enée, lève vers le ciel ses paumes renversées et prie :
Di, prohibete minas, Di talem avertite casum
Et placidi servate pios.
La dernière formule, placidi servate pios, exprime de façon parfaite l'esprit du culte romain. Enée et ses compagnons sont pieux en ce sens qu'ils s'acquittent scrupuleusement, chacun pour sa part, de leurs devoirs envers les dieux. Dieux, écartez d'eux l'adversité, vous leur devez votre paix!
Le destin sans doute a décidé la fondation de Rome. Mais que de complicités divines sont nécessaires en tout temps et en tout lieu pour assurer l'accomplissement de ses ordres ! Un dieu dicte chaque décision, inspire chacune des pensées aussi bien des Troyens que de ceux qui les combattent, un dieu guide chaque pas et dirige chaque geste. C'est le dieu qui est vainqueur et qui tue ou du moins qui décide du moment fatal en s'écartant de l'homme que le destin a condamné. Après tous les épisodes où les dieux jouent un rôle plus important que les hommes, c'est au ciel que se prépare la conclusion de l'épopée et que se discutent entre Jupiter et Junon les termes de l'alliance solennelle entre Troyens et Latins. Du mélange des deux races naîtra un peuple qui dépassera en piété les dieux eux-mêmes. Ce pacte conclu, la nymphe Juturne n'a plus qu'à abandonner le char de son frère Turnus qui se sent perdu et dont l'âme, dans un gémissement, s'enfuit indignée chez les ombres.
Une pensée profondément religieuse domine toute l'action de l'épopée; elle s'unit au patriotisme pour recueillir avec un soin pieux et célébrer la tradition des cultes romains. Il n'est guère de rite qui ne se trouve illustré par un épisode. Dès le troisième chant, voici qu'Enée rend les honneurs funèbres à Polydore. Le thème reparaît à plusieurs reprises et trouve son plein développement au onzième chant dans la description détaillée des funérailles du malheureux Pallas. Le cinquième chant presque entier est consacré au culte des Mânes. Au sixième chant voici le temple de Cumes et d'amples renseignements sur les oracles de la Sibylle. « Tes sorts et tes secrets, annonce Enée, je les imposerai à mon peuple et je consacrerai à leur soin des prêtres choisis. » Au début du chant suivant, après tous les prodiges qui accueillent Enée sur la terre latine, Latinus de son côté va consulter à Albunée l'oracle de Faunus, puis vient la description du temple de Picus et, bientôt après, le déchaînement de la fureur orgiastique qui entraîne Amata dans les forêts de Lavinium. Tout le long du huitième chant, tandis que la guerre menace, Enée s'attarde avec Evandre à une promenade archéologique à travers les lieux saints de la future ville de Rome : sur l'Aventin il se fait raconter l'histoire de Cacus et les rites du grand autel dédié à Hercule, et les légendes de la porte Carmentale, de la roche Tarpéienne, du Capitole... A la fin du chant, il arrive avec ses cavaliers à l'antique sanctuaire de Sylvain sur le territoire de Caeré, près du fleuve qu'enferment des collines aux flancs creusés de cavernes, sans doute d'anciennes tombes étrusques, aux sommets couronnés de noirs sapins. C'est là qu'il reçoit les armes divines que lui apporte Vénus. Dans chaque lieu, à propos de chaque peuple, Virgile ne manque pas d'en évoquer tout d'abord les dieux, de rappeler les mythes et les souvenirs saints.
La part de la religion dans l’Enéide se trouve encore augmentée par la descente d'Énée aux Enfers. Au centre même du poème l’épisode occupe presque tout le sixième chant. L'idée en vient sans doute d'Homère qui, dans le onzième chant de l'Odyssée, montre Ulysse évoquant d'une fosse remplie de sang l'âme de sa mère Anticlée et du devin Tirésias. Mais quel développement Virgile ne lui a-t-il pas prêté? Sous la conduite de la Sibylle Enée parcourt tout le monde souterrain et en apprend les secrets. Ce voyage à travers le mystère est pour lui comme une initiation qui consacre sa sainteté et, en lui infusant une vertu nouvelle, le prépare à vaincre les dernières difficultés qui l'attendent sur la terre latine.
Virgile semble s'être assigné comme tâche à la fois d'embrasser toute la tradition religieuse gréco-latine et de répondre aux préoccupations théologiques de son temps. Le sixième chant de l'Enéide comble une lacune de la vieille religion romaine. Au ciel et à la terre déjà pleins de dieux il ajoute les enfers et, par la voix d'Anchise présentant à Enée les âmes de ses descendants, il nous les montre gros, eux aussi, de toute la gloire romaine future.
Rome et les dieux, telles sont nous, semble-t-il, les deux grandes idées inspiratrices de l'Énéide, les deux Muses qui ont fourni la matière du poème, qui lui ont donné sa forme et même ont déterminé jusqu'au détail de l'art virgilien. Elles assurent à l'épopée romaine son originalité.
Virgile cependant avait ses modèles auxquels il a ouvertement emprunté non seulement le type même de son œuvre, mais encore de nombreux développements Homère est son maître; il n'est cependant pas sa source. Dans l'Iliade, Enée n'apparaît que comme personnage tout à fait secondaire. C'est l'imagination des âges postérieurs qui a développé son rôle, sans que nous puissions d'ailleurs saisir au juste l'origine de sa légende. Les historiens de Sicile, semble-t-il, l'ont transmise toute faite aux premiers poètes latins. Virgile a trouvé chez eux l'essentiel de son sujet. Le choix d'Énée comme héros le rattachait à la tradition de l'épopée romaine.
Les vieux poètes remis en vogue par la mode archaïsante qui fleurissait autour du sévère Asinius Pollion interviennent comme intermédiaires entre l'inspiration homérique et l'épopée du siècle d'Auguste. « Au commencement, dit Norden, était Homère, puis vint Naevius, puis Ennius et enfin Virgile.» Les quelques fragments qui nous restent des Annales nous permettent de reconnaître dans l'Enéide non seulement des expressions, des hémistiches ou même des vers entiers d'Ennius, qui d'ailleurs ne sont jamais reproduits mot à mot, mais encore des épisodes de même origine. Tels sont l'ouverture des portes du temple de Janus au chant VIIe et le conseil des dieux qui ouvre le dixième chant. Le tableau de la prise de Troie au second chant serait la transposition, indique Servius, de la destruction d'Albe telle que la racontait Ennius. Les combats de 1'Enéide rappellent sans doute ceux de 1'Iliade, mais ils empruntent aussi bien des traits aux nombreux récits de bataille d'Ennius. Premitur pede pes, disait le vieux poète : haeret pede pes densusque viro vir, lit-on chez Virgile. Virgile ne devait guère moins, semble-t-il, à Naevius. L'orage du premier chant de l’Enéide et les plaintes de Vénus à Jupiter viendraient en droite ligne, affirme Macrobe, du Bellum Panicum. Les anciens qui possédaient Ennius et Naevius pouvaient se rendre compte mieux que nous de tout ce que leur avait emprunté Virgile.
Si Virgile, dit Aulu-Gelle, fait parfois des vers durs, des vers énormes et qui dépassent un peu la mesure c'est afin que le peuple d'Ennius reconnaisse bien dans le nouveau poème les traces d'antiquité
A côté des modèles homériques, Virgile fait donc une large place à la tradition épique romaine. C'est chez elle qu'il a trouvé son héros et son sujet; il lui emprunta beaucoup. Il bénéficie d'ailleurs de toute la virtuosité que l'éducation hellénistique a développée depuis Ennius dans la poésie romaine. L'art alexandrin lui a appris à voir le pittoresque et à l'exprimer en quelques mots, comme en raccourci. Le vers évoque souvent chez lui l'image plastique et colorée. Dans la description des enfers, M. S. Reinach remarque plusieurs scènes qui lui semblent directement inspirées de peintures ou de bas-reliefs. Toute l’Enéide abonde de passages de ce genre, sans parler de ceux où Virgile se complaît à décrire des œuvres d'art, comme les sujets qui décorent les portes du temple d'Apollon à Cumes, ou les scènes figurées sur le bouclier d'Enée. Ainsi l'apparition de Neptune et de son cortège au chant V rappelle la frise de l'autel de Domitius Ahenobarbus. La forge de Vulcain au huitième chant est bien un sujet de tableau. Mais si Virgile introduit dans l'épopée tout l'art de son temps, c'est pour le soumettre aux idées de patriotisme et de piété que le siècle d'Auguste a réveillées à Rome, idées dont il a peut-être retrouvé la tradition chez les vieux poètes épiques romains.
L’Eneide acréé ainsi un art nouveau qui revient aux réalités de la terre et de l'âme italiennes et qui cherche à en dégager la beauté. Cet art n'est plus fantaisie légère visant à l'amusement par l'imprévu, par l'esprit, par le joli. Sa gravité paraît un peu froide parfois, mais quelle passion sincère et quelle vie profonde ne recouvre-t-elle pas ? Passion pour tout ce qui touche à la patrie romaine, à son histoire et à son présent, vie profonde d'une pensée religieuse dont les racines plongent jusqu'aux siècles primitifs. Ces grands sentiments animent le mythe d'actualité, ils attachent la description aux choses elles-mêmes dont l'aspect émeut l'âme du poète. D'une épopée légendaire et coulée dans le moule homérique, ils font un poème original exprimant vraiment le génie de la Rome d'Auguste.
C'est à juste titre que 1'Enéide est devenue non seulement pour Rome elle-même mais pour le mode romain l'œuvre nationale par excellence. Recueillant dans une forme nouvelle et vivante l'ensemble de là tradition artistique gréco-romaine, unissant les souvenirs de l'ancienne république aux aspirations les plus nobles du nouvel empire, alliant le plus pur patriotisme latin à une généreuse philosophie de l'histoire méditerranéenne, célébrant le Latium et l'Italie mais les réconciliant avec l'Afrique et rattachant à l'Asie les origines de leur gloire, associant les pratiques de l'ancien culte et les aspirations mystiques de la religiosité contemporaine, relevant, dans le détail de son exécution, l'idéalisme et les procédés de stylisation de la grande poésie classique par le réalisme et par un souci de précision minutieux, encadrant dans le mythe des tableaux d'actualité et localisant la légende dans un paysage foncièrement exact, l'épopée de Virgile par sa complexité même répondait aux tendances les plus diverses des hommes et des peuples pacifiés et associés par l'Empire. Elle était vraiment le poème de Rome impériale, l'épopée du monde et des temps nouveaux.
Sa renommée et son influence survécurent même à la civilisation qui lui avait donné naissance. Après la ruine du monde antique Virgile et l’Enéide ont continué à vivre dans les imaginations du moyen âge, età ceux-là même pour qui le poème et les idées qui l'inspiraient étaient devenues lettre morte, Virgile apparaît comme un héros, comme le romancier par excellence ; il est le prophète, il est le magicien. Le nom du poète en effet et le souvenir de son œuvre se trouvaient indissolublement liés à la mémoire de Rome elle-même et de tout l'âge antique, à la hantise d'un passé qui, même obscurci et devenu mystérieux, ne cessait d'apparaître à l'humanité comme l'image de sa grandeur, de sa noblesse et de sa beauté.
V
les jeux séculaires.
L'œuvre littéraire de Virgile et d'Horace est l'expression d'une véritable renaissance nationale, d'une renaissance voulue et consciente que solennisèrent les Jeux séculaires organisés par Auguste.
Virgile était mort en l'an 19 avant notre ère, au retour d'un voyage en Grèce et en Asie entrepris pour préciser par la vue des lieux les descriptions des premiers chants de 1''Enéide. A la fin de son sixième chant, il annonce déjà la grande fête symbolique qui devait célébrer l'ère nouvelle (1).
Augustus Caesar, divi genus, aurea condet
Saecula.
C'était là en effet une pensée dès longtemps caressée par le prince et qui, depuis César, hantait l'imagination des Romains. Elle reposait sur une des plus anciennes traditions de la spéculation religieuse étrusque et s'était trouvée remise en vogue par quelques-uns de ces prodiges qui, de tout temps, avaient exercé de si fortes impressions sur l'imagination du peuple. L'inauguration religieuse de son siècle représentait donc pour Auguste un acte éclatant de propagande politique en même temps qu'une application de son programme de restauration religieuse.
(1) Aen., 6, 792.
Les jeux séculaires devaient être comme l'arc de triomphe idéal marquant le passage des temps anciens aux nouveaux.
C'est la volonté des dieux, professaient les Etrusques, qui marque la séparation entre les époques de l'humanité. Un siècle, pour eux, n'était pas une période fixe de cent années; c'était un cycle incertain révolu par la disparition du dernier vivant né à son début. Les hommes n'étant pas à même d'observer un tel fait, les dieux se chargeaient de le leur révéler par des prodiges. Ces croyances avaient été adoptées autrefois par les Romains avec l'ensemble de la discipline augurale étrusque. Des jeux séculaires auraient été célébrés, suivant la tradition pontificale, dès 449, après la chute des Décemvirs, puis en 3-;6 et en 249, à la fin de la première guerre punique, enfin en 149 ou en 146 vers le moment de la réduction de la Grèce en province romaine. En l'an 43, peu après la mort de César, était apparue une comète et un haruspice avait déclaré que ce prodige indiquait la fin du neuvième siècle des Étrusques.
Les circonstances, à ce moment, étaient peu favorables à la célébration de Jeux séculaires. L'apparition de la comète jointe à la lassitude de tous et au désir de temps meilleurs, n'en avait pas moins suscité dans le peuple de grandes espérances, celles dont la quatrième églogue de Virgile semble précisément apporter ['expression poétique. Puis, les années avaient passé; Actium avait réalisé l'unification de l'empire, le Sénat avait renouvelé pour une période de dix ans les pouvoirs exceptionnels d'Auguste, lorsqu'on l'an 17 un nouveau prodige, la réapparition de la comète de César, avait semblé venir annoncer que l'âge d'or tant espéré était enfin venu. C'était le moment de célébrer les Jeux traditionnels. Auguste n'y manqua pas.
Nous connaissons particulièrement bien tous les détails de la fête grâce surtout aux nombreux fragments d'une inscription trouvée en 1890 sur les bords du Tibre et qui portait le compte rendu officiel des cérémonies.
Dès l'apparition de la comète, les Quindécemvirs avaient été, suivant l'usage antique, chargés de consulter les livres Sibyllins. Sur leur rapport, le Sénat décréta la célébration des Jeux séculaires. Des hérauts furent envoyés dans toute la ville,costumés à l'antique, casque à haute aigrette de plume, petit bouclier rond et grand bâton; ils étaient chargés d'inviter le peuple à cette fête unique qu'aucun vivant n'avait encore vue et que personne ne reverrait. Le détail en fut réglé par Auguste lui-même assisté des Quindécemvirs. Elle durerait trois nuits et trois jours consécutifs. Au préalable, le peuple entier devait être soumis à des fumigations rituelles destinées à le purifier de toutes les souillures contractées au cours de l'âge antérieur. C'était une génération neuve pour ainsi dire et vierge de toutes les fautes anciennes qui allait être admise à jouir des temps nouveaux.
Les fêtes commencèrent dans la nuit du 31 mai au 1er juin, au Tarentum, sur la rive gauche du Tibre, lieu depuis longtemps consacré aux divinités infernales. Massé sur les deux rives, le peuple de Rome contemplait en silence le feu des autels et les illuminations qui éclairaient les officiants. La première nuit on invoqua les Moires grecques, les déesses du sort, auxquelles furent sacrifiées neuf brebis noires et neuf chèvres. La seconde nuit, les sacrifices et les prières furent adressés à Ilithye, déesse de la fécondité, et enfin, la troisième nuit, à la Terre Mère. Chaque fois Auguste lui-même prononça la prière suivant la formule traditionnelle.
Comme il est prescrit par les livres Sibyllins, pour cette raison et pour le «lieux du peuple romain des Quirites, recevez ce sacrifice de neuf agnelles et de neuf chevrettes et agréez ma prière.
Augmentez l'empire et la majesté du peuple romain des Quirites en guerre et en paix. Protégez toujours le nom latin, accordez une intégrité éternelle, la victoire, la santé au peuple romain des Quirites.
Favorisez le peuple romain des Quirites.
Conservez sain et sauf l'État du peuple romain des Quirites.
Je vous supplie de vouloir bien être propices au peuple romain des Quirites ; au collège des Quindécemvirs, à moi-même, à ma famille, à ma maison.
Je vous supplie d'agréer ce sacrifice de neuf agnelles et de neuf chevrettes qui vous sont consacrées, qui vont vous être immolées.
En restaurant les antiques solennités, Auguste les avait mises à la mode du jour; il avait substitué le rite grec, achivo ritu, et des divinités grecques, les Moires, Ilithye, aux rites étrusques et aux sombres divinités souterraines Dis Pater et Proserpine. Il leur avait adjoint en outre les grands dieux lumineux du Ciel en l'honneur de qui furent célébrées les fêtes de jour.
Le premier jour, la procession des citoyens monta au Capitule et offrit le sacrifice à Jupiter. Le second jour fut réservé aux matrones : cent dix d'entre elles chantaient en chœur tandis que, toujours sur le Capitole, Auguste et Agrippa immolaient à Junon une génisse blanche. Le troisième jour fut le jour de la jeunesse honorant le couple fraternel Apollon et Diane. La cérémonie eut lieu, cette fois, au Palatin, sur la colline consacrée jadis par Romulus et dont Auguste faisait à nouveau l'un des centres saints de la Rome nouvelle, devant le temple d'Apollon d'Actium, élevé une dizaine d'années auparavant à proximité du palais impérial.
C’est là que, par une dernière innovation du prince ami des lettres, les fêtes se terminèrent par une sorte de bouquet de poésie lyrique. Vingt-sept jeunes gens et autant de jeunes filles chantèrent le poème nouveau qu'Auguste avait commandé à Horace, comme autrefois le Sénat avait commandé à Livius Andronicus l'hymne de remerciement pour la victoire sur le frère d'Hannibal. Si Virgile avait vécu, c'est à lui certes que serait revenu l'honneur de composer ce chant séculaire, épilogue pour ainsi dire de son épopée des destins de Rome. Horace en fit comme un rappel des prières des nuits et des jours précédents, substituant le charme de la poésie au pouvoir magique des vieilles litanies et y ajoutant une allusion à la rénovation morale et sociale accomplie par Auguste.
Soleil bienfaiteur dont le char rayonnant dispense et ravit la lumière, toi qui renais toujours nouveau, toujours le même, puisses-tu ne rien voir de plus grand que la ville de Rome.
Douce llithye, toi qui ouvres le sein maternel à l'enfant mûr pour la vie, protège les mères. Que tu veuilles être appelée Lucine ou Genitalis, déesse puissante, multiplie les enfants de Rome, bénis les décrets du Sénat sur les mariages, protège cette loi conjugale qui doit être féconde en citoyens.
Qu'un cycle nouveau de cent dix années rende à Rome ces chants et ces jeux célébrés pendant trois jours de splendeur, pendant trois nuits d'allégresse.
Et vous, Parques, divinités véridiques, dont les oracles ne sont jamais trompés par l'immuable sort, ajoutez d'heureuses destinées à celles qui viennent de s'accomplir.
Que la terre, fertile en moissons et en troupeaux, donne à Cérès une brillante couronne d'épis! Que des eaux salutaires et un air pur fécondent les germes dans son sein...
Horace ne manquait pas d'ailleurs de rappeler en ce jour de fête le souvenir de l'épopée nationale, chef-d'œuvre de son ami trop tôt disparu :
Si Rome est votre ouvrage, si c'est par votre ordre que les Troyens, changeant de foyers et de remparts, abordèrent d'une course heureuse aux rivages d'Étrurie,
S'il est vrai qu'à travers l'embrasement de Troie innocente le pieux Énée survivant à sa patrie sut conduire ses compagnons, par un chemin libre, vers des destins supérieurs à ceux qu'ils abandonnaient.
Dieux, prêtez des mœurs pures à la jeunesse docile ; dieux, à la vieillesse paisible donnez le repos; à la nation de Romulus accorde et la richesse et de nombreux rejetons et toute espèce de gloire..,
Dieu qui voit l'avenir, Phœbus, toi dont l'arc resplendit et que chérissent les neuf Muses, toi dont l'art salutaire ranime la force épuisée des corps,
Si tu vois d'un œil favorable tes autels du Palatin et la chose romaine et le Latium fécond, proroge nos destinées pour un nouveau siècle, pour des temps toujours meilleurs.
CHAPITRE III
LA CONNAISSANCE ET L'IDÉE IMPÉRIALE LA GÉOGRAPHIE ET L'HISTOIRE A ROME
Tandis qu'elle conquérait les provinces méditerranéennes, Rome s'était contentée d'adopter telles quelles et tant bien que mal les acquisitions de la science grecque. Nous avons trouvé chez elle des vulgarisateurs et des traités didactiques, mais pas de véritable science. Ni le siècle d'Auguste ni l'empire n'ont apporté de progrès dans la connaissance de la nature.
Mais si ni le monde, ni la vie, ni les choses, n'ont suscité de la part des Romains un effort personnel, il n'en est pas de même des notions qui les concernaient eux-mêmes, leur vie nationale et leur passé. Varron et ses émules avaient essayé, en appliquant les méthodes grecques aux traditions romaines, de se représenter l'activité intellectuelle, morale, sociale et politique de l'ancienne Italie. A défaut de savants, la République a possédé au moins de; érudits et des historiens. L'homme l'intéressait plus que la nature.
L'empire du monde devait nécessairement élargir l'horizon intellectuel des Romains. La pratique même leur imposait d'étendre leurs regards au delà de leur ville et des rivages de la péninsule. Il leur était indispensable de connaître ces peuples si divers qui leur obéissaient, les régions lointaines qu'ils administraient et celles-là même qui échappaient à leur autorité et d'où pouvait sortir pour eux quelque danger. Une connaissance exacte et de lui-même et du monde était indispensable au peuple qui gouvernait le monde. On pourrait s'attendre à ce que le siècle d'Auguste ait fait accomplir un progrès sensible à la géographie et à l'histoire.
Voyons tout d'abord comment il a entendu la géographie et ce qu'il en a fait.
I
la GÉOGRAPHIE.
La géographie représentait dans le monde hellénistique une science brillamment cultivée. Les conquêtes d'Alexandre avaient ouvert à la curiosité des savants l'ensemble de la terre habitée. Conduite par le raisonnement, la connaissance avait rapidement dépassé les limites de l'expérience et embrassé à la fois la terre et le ciel dont elle s'efforçait de donner une image à la fois précise et concrète. Des savants comme Eratosthène, Hipparque, Artémidore, avaient fait de la géographie une véritable cosmographie. Non seulement ils avaient déterminé par le calcul l'étendue des terres continentales entre les rivages connus de la Méditerranée et les bords encore mystérieux de l'Océan du nord, entre les côtes de l'Asie et les empires orientaux de l'Inde et même des Sères, c'est-à-dire de la Chine, mais ils avaient essayé le même travail pour l’Afrique. Bien plus, l'astronomie les avait conduits à concevoir la forme vraie de la terre. Ils savaient qu'elle était un globe. Si l'immensité de l'océan Atlantique, professait Ératosthène, n'y mettait obstacle, il serait possible de naviguer, en suivant le même parallèle, d'Ibérie jusque dans l’Inde (1). Les compilateurs romains n'avaient pas manqué d'ailleurs de recueillir cette doctrine. C'est par leur intermédiaire qu'elle est parvenue aux savants de la Renaissance et a déterminé des entreprises comme celle de Christophe Colomb.
(1) Cité par Srabon, 1, 64 (4, chap. 6).
« Quelle est la distance demande Sénèque, entre les rivages extrêmes de l'Espagne et les Indiens? — L'espace d'un très petit nombre de jours si le vent poussait le navire (1). »
Le monde romain n'a guère connu cette science grecque, semble-t-il, que par ses vulgarisateurs et ses abréviateurs. Strabon, au début de l'empire, fut le grand géographe : il avait laissé tomber toute la partie mathématique et logique de la géographie alexandrine. Au II ème siècle de notre ère, Ptolémée est l'abréviateur de la science géographique grecque. C'est en somme de ces deux écrivains grecs que nous vient le meilleur de nos connaissances en fait de géographie antique. A côté d'eux, Pline a compilé, sans grand discernement et sans méthode, des renseignements provenant de sources grecques.
Le raisonnement mathématique s'exerçant sur un petit nombre de renseignements d'origine livresque de valeur extrêmement médiocre ou sur quelques indications émanant soit de trop rares explorateurs, soit de commerçants, telle est la méthode de la géographie hellénistique. Elle Ayant à décrire l'Espagne, Strabon remarque l'incertitude et le vague qui règnent sur toutes les régions où les Grecs n'ont pas travaillé eux-mêmes. « Les écrivains romains, dit-il, suivent les Grecs; tout ce qu'ils disent, ils le prennent des Grecs ; ils n'apportent d'eux-mêmes aucune vraie curiosité. Il en résulte que si les historiens grecs font défaut, les autres ne nous offrent pas grande ressource pour combler la lacune (1). » Strabon était grec, dira-t-on, et se trouve porté à exagérer le mérite de ses compatriotes au détriment des Romains. Mais l'ensemble de ses descriptions géographiques ne justifie que trop cette remarque. Voici par exemple le cours du Rhin. Les Grecs n'ont pas eu l'occasion de l'étudier. Mais depuis César, c'est-à-dire depuis un demi-siècle, les armées romaines parcourent les rives du grand fleuve occidental dont elles assurent la police. Auguste lui-même a séjourné sur ses bords, créant des villes, décidant de l'établissement de camps, traçant des routes. Des milliers d'officiers, d'ingénieurs, d'administrateurs ont défilé le long de sa vallée. Strabon ne peut savoir si la longueur totale du fleuve mesure 6000 stades (plus de 1000 kilomètres), comme l'affirme Asinius Pollion, ou seulement la moitié de ce chiffre, si le Rhin se jette dans la mer par deux bouches ou davantage (2). Au delà du Rhin, les armées romaines s'étaient avancées jusqu'à l'Elbe. Pendant trois ans, de l'an 12 à l’an 9, Drusus avait parcouru en combattant toute la Germanie occidentale. Entre les deux fleuves la route était jalonnée d'étape en étape par des camps romains. Le testament d'Auguste proclame la Germanie soumise jusqu'à l'Elbe. Strabon croit pouvoir estimer la distance entre les deux fleuves à 3000 stades (532 kilomètres); Velleius un peu plus tard, après le désastre de Varus et les campagnes vengeresses de Germanicus, l'évalue à 400 milles (576 kilomètres). Les deux chiffres concordent à peu près, mais ils sont le double de la réalité.
(1) strab., 3, chap. 4, 19 (166).
(2) strab., 4, 3, 3 (193).
II
la carte d'agrippa.
Auguste lui-même, cependant, et surtout son collaborateur Agrippa s'étaient attachés à un inventaire géographique détaillé de l'empire. Ils en avaient fait peindre la carte officielle sur la paroi du portique Vipsania au Champ de Mars, dans le voisinage de la Piazza Colonna actuelle. Agrippa étant mort avant l'achèvement de l'œuvre, c'est sous la direction d'Auguste lui-même que la carte avait été exécutée, d'après les notes (Commentarià) laissées par Agrippa.
Travailleur acharné, voyageur infatigable, Agrippa avait été le grand organisateur de la domination romaine sur le monde. L'établissement du cadastre, semble-t-il, était son œuvre; les travaux publics, les routes surtout, dont il traça le réseau, son domaine. Plébéien d'origine, préteur à vingt-deux ou vingt-trois ans dès l'an 40 avant notre ère, consul pour la première fois en 37 et, dès lors, le bras droit d'Octave dont il commandait la flotte à Actium, Agrippa était un administrateur et non pas un savant. C'est de la pratique exclusivement qu'il se souciait. Au peuple de Rome il avait offert le Panthéon et des Bains. Il aurait voulu, raconte Pline, que les .œuvres d'art, tableaux et statues, au lieu de se cacher dans l'exil des villas, fussent toutes exposées au public. Sa carte dut être conçue, de même, à l'intention du peuple de Rome. Elle devait présenter aux Romains le tableau de ce monde immense qui, en majeure partie, leur obéissait. Il ne s'agissait pas de science, mais de vulgarisation géographique.
Sous quel aspect imaginer cette carte ? Elle était peinte sur le mur d'un portique. Par opposition aux cartes grecques qui, rationnellement, représentaient le monde comme un cercle, — orbis, — elle devait se présenter étirée en longueur. C'est précisément l'image que nous offre le document essentiel de la cartographie romaine, 1a carte dite de Peutinger, du nom du banquier augsbourgeois en possession de qui elle fut découverte à lafin du XVe siècle (1). Sur une longue bande de parchemin destinée à former un rouleau se trouve représente tout le monde connu des anciens. La partie extrême manque. Nous n'avons ainsi ni les îles Britanniques, ni l'Espagne; mais en suivant la carte de gauche à droite nous y distinguons successivement la Gaule dans le haut et l'Afrique dans le bas, séparées par la Méditerranée, puis l'Italie du nord, le Norique, la Pannonie, la Macédoine et, au-dessous de ces régions, la péninsule italienne et la Sicile, enfin l’Asie et au-dessous d’elle l'Egypte, auxquelles font suite l’Arabie, la Mésopotamie et enfin l'Inde. C'est un schéma très conventionnel qui n'a rien de commun avec nos cartes mais où l'on reconnaît cependant à peu près; la forme des rivages. Les noms géographiques, clairement indiqués, évitent d'ailleurs l'incertitude.
La carte de Peutinger n'est qu'une copie du moyen âge ; elle remonte à un original qui, d'après les noms qu'il contient, paraît avoir été mis à jour au ive siècle de notre ère. Le modèle primitif qu'elle reproduit semble bien n'être autre que la carte d'Agrippa. Cette carte, nous le savons, avait été copiée à de nombreux exemplaires, soit sur parchemin (2), soit sur les murs des écoles, à Autun par exemple; Nous pouvons; donc nous croire en possession d'une édition revue, corrigée et probablement simplifiée, de la carte du monde préparée par Agrippa et peinte par les soins d'Auguste sous le portique romain.
Comme nous le montrent les nomenclatures de la Géographie de Ptolémée, les Grecs avaient soin de situer les lieux aussi exactement que possible par leur longitude et leur latitude.
(1) Elle se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de Vienne (Autriche).
(2) Suet., Domit., 10.
Ces indications abstraites ne signifient rien pour les Romains. On n'en trouve pas trace sur la carte de Peutinger. Elles ne pouvaient d'ailleurs figurer sur une image du monde aussi profondément altérée que la carte d'Agrippa. La topographie elle-même, les chaînes de montagnes et les vallées des fleuves, n'est représentée que très sommairement et de la façon la plus conventionnelle. L'essentiel, ce sont les routes et les étapes marquées par les villes avec l'indication des distances qu'elles comportent. La carte n'est qu'un itinéraire peint. Les Grecs, suivant une formule heureuse, se guidaient sur les étoiles pour déterminer la surface de la terre ; les Romains considèrent les pierres milliaires qui jalonnent les routes.
Le grand travail géographique d'Agrippa et d'Auguste se réduisait donc à un schéma de ce réseau routier par lequel la vie romaine allait circuler d'une des extrémités à l'autre de l'empire. Ces voies étaient pour le monde un bienfait inappréciable et pour Rome un indispensable moyen de gouvernement. Le prince et son collaborateur pouvaient être fiers à juste titre de les avoir tracées. Bien plus que de la science géographique grecque, la représentation qu'ils en firent peindre semble avoir pu s'inspirer du souvenir de ces images qu'au jour du triomphe le général vainqueur étalait aux yeux du peuple et sur lesquelles étaient figurés, de façon assez schématique, la forme et la topographie des provinces conquises. La carte d'Agrippa n'était qu'une œuvre de vulgarisation. Le tort des Romains fut de lui prêter, en partie par respect pour ses auteurs, une autorité qu'elle n'avait pas; ce fut de n'avoir pas cherché à se représenter le monde d'une façon plus parfaite. L'une de leurs faiblesses fut d'avoir toujours manqué de curiosité.
III
la germanie de tacite.
Pour trouver, de la part d'un Romain, l'effet d'un regard attentif sur le monde étranger, il nous faut descendre jusqu'à Tacite et à son petit traité des Mœurs des Germains. Nous ne saurions d'ailleurs préciser ce qui, dans cet opuscule, est vraiment original. La description géographique et ethnographique était une tradition de l'histoire grecque depuis Hérodote. Les Romains s'y étaient conformés. César n'avait pas manqué d'illustrer ses Commentaires de quelques passages de ce genre, à la base desquels on reconnaît l'influence du savant grec Posidonius. Depuis César, les luttes contre les Germains tenaient dans la vie de Rome une place assez importante pour que les historiens aient porté leur attention sur ce peuple et le pays qu'il habitait. Tite-Live, comme nous permettent de le constater les sommaires qui nous été conservés de ses livres perdus. avait consacré plusieurs chapitres à la Germanie et aux Germains. Il ne suivait pas exactement César, mais ne disposait cependant sur eux que de renseignements de seconde main. Asinius Pollion, sans doute qui, lui, avait servi sur les bords du Rhin, et surtout un historien grec que nous ne connaissons plus que de nom mais qui semble avoir joui d'une grande autorité, Timagène, étaient ses auteurs. Plus tard, Pline l'Ancien, que des fonctions militaires et administratives avaient conduit en Germanie, avait consacré un ouvrage considérable aux guerres contre les Germains. Tacite, lui aussi, avait dans sa jeunesse exercé un commandement dans la région. Ne possédant aucun des ouvrages écrits entre celui de César et le sien, nous ne pouvons faire exactement la part de ce qu'il doit à ses prédécesseurs et de ce qui revient à ses observations personnelles. La première partie du traité de Tacite, la description des mœurs des Germains, dépend certainement pour une bonne part de toutes ces sources que nous ignorons. La seconde partie est plus particulièrement géographique. Elle nous apporte une énumération des différentes peuplades germaniques avec l'indication des régions qu'elles occupent. La simple considération du texte suffit à indiquer que Tacite suit une carte. « De même que j'ai tout à l'heure suivi le cours du Rhin, je vais maintenant descendre celui du Danube (1). » ... Au delà de ceux-ci...; dans le voisinage de ceux-là... derrière eux... en avant d'eux:... à côté d'eux..., tels sont les débuts les plus habituels de ses chapitres. Cette carte était des plus médiocre ; les détails topographiques font à peu près totalement défaut; il ne nous est presque rien dit des montagnes ni des fleuves ; absolument rien de la nature ou desproductions du sol. Il est fort possible que Tacite se soit guidé tout simplement sur la carte d'Agrippa. Sur cette carte, en effet, nous le savons par Pline, la Vistule était portée (2). En l'année 98 de notre ère, sous Trajan, époque à laquelle Tacite écrivait la Germanie, un tel document aurait pu paraître périmé, on du moins aurait-il dû recevoir d'abondantes corrections et additions. Il n'en était rien. Tacite lui-même constate, depuis Auguste, un recul plutôt qu'un progrès des connaissances géographiques. « L'Elbe, dit-il, nom célèbre et bien connu autrefois, est aujourd'hui presque ignoré. » Comparez au traité de Tacite les quelques pages que Strabon consacre à la Germanie; elles sont moins détaillées, sans doute, mais l'impression qui s'en dégage apparaît plus nette.
Tacite est un psychologue et un artiste, mais non pas un savant que tenaille la passion d'apercevoir le réel. Pline l'Ancien, son aîné, meurt sans doute, dans la catastrophe du Vésuve, en 79, victime de sa curiosité.
(1) Germ., 41.
(2) N.H., 4, 87.
Son ardeur à savoir est inimitable. Il ne perdait pas un instant. Tout le temps qui n'était pas consacré à ses fonctions, il l'employait à lire et à se faire lire ; il prenait des notes et faisait des extraits de tout. Il n'est si mauvais livre, disait-il, dont on ne puisse tirer profit par quelque endroit. Son neveu avait hérité de lui de plus de cent cinquante registres de morceaux de choix, écrits d'une écriture très fine... Beaucoup de diligence, comme disait un critique, du vieux Caton, mais de doctrine point. Le livre, le livre grec surtout, au lieu d'éveiller l'esprit, l'étouffé. Il cache la réalité. Le savant romain a des yeux pour lire et non pas pour voir.
Un esprit humain, d'ailleurs, si distingué soit il, ne peut créer à lui seul la science, il lui faut des moyens matériels, des instruments, des travaux préparatoires. Il lui faut surtout un courant scientifique, l'intérêt du public, la contradiction. Or la science à Rome ne se distingue pas de l'érudition. Son triomphe est la compilation. Et encore, bientôt, aux compilations du genre de celle de Pline vont succéder les abrégés et les résumés. Une trop longue attention dépasse les facultés du lecteur. Le rhéteur s'empare de la géographie, comme il s'empare del'histoire. La Chrographie de Pomponius Mela, sous Claude, l'Epitome de l'histoire romaine de Julius Florus, sous Hadrien, sont les exemples les moins mauvais de cet envahissement de la futilité verbale et de cet amoindrissement progressif de l'effort intellectuel. Il n'y eut jamais de milieu scientifique à Rome.
IV
L'HISTOIRE DE TlTE-LlVE.
C'est comme une œuvre d'art et non de science qu'il faut considérer le grand monument historique du siècle d'Auguste, nous voulons dire l’Histoire de Tite-Live. Elle se rattache au même courant d'idées que l'épopée de Virgile, elle lui fait pendant est avant tout rationnelle; la base empirique en est notoirement insuffisante. Les savants grecs et les princes de Pergame ou d'Alexandrie qui s'intéressaient à leurs efforts manquaient des moyens nécessaires pour organiser l'exploration du monde. C'est le hasard en somme qui fournissait les documents sur lesquels travaillait la science.
On aurait pu s'attendre à ce que l'empire romain, disposant de tous ces moyens matériels, entreprît de fournir à la science géographique le fondement expérimental qui, jusque-là, lui avait fait défaut. Il se contenta au contraire d'une connaissance exclusivement utilitaire et par conséquent imparfaite et sans envergure. Avec mille occasions d'observer infiniment mieux que les Grecs, les Romains n'ont pas même su le faire aussi bien qu’eux, pour ainsi dire.
(1) Quaest. Nat., I, fragm. 13. Cf. plin., N. H.,6, 57.
L'Enéide montrait comme une préfigure de Rome, elle annonçait sa domination sur les mers et sur les terres, elle glorifiait le pouvoir d'Auguste, récompense accordés par les destins à tant de sagesse et d'héroïsme. Tite-Live, en suivant pas à pas, la plupart du temps année par année, la réalisation de ces destins, compose de la piété et de la vertu romaine une série de tableaux majestueux. Le poète chante Rome en dehors du temps ; l'historien célèbre au cours des siècles la grandeur romaine.
Ne méconnaissons pas l'actif mouvement d'érudition marqué par la publication des Annales des Pontifes et surtout par les recherches de Varron. Ce mouvement continue sous Auguste, autour de lui et favorisé par lui. Verrius Flaccus, précepteur des petits-fils de l'empereur, étudie l'ancien calendrier romain. Auguste lui même fait mettre de l'ordre dans les archives du Capitole. Lorsqu'on restaure la Regia sur le Forum, il y fait graver les Fastes consulaires et triomphaux dont il a provoqué une nouvelle rédaction. La connaissance du passé romain se vulgarise, pour ainsi dire. Elle apparaît dans la poésie de Properce. Ovide cherche dans les Fastes l'inspiration d'un grand poème. Elle prend aussi un caractère pratique. Le prince, et avec lui la majeure partie de l'opinion publique, y voit un moyen d'assurer à jamais le nouvel état politique et de consolider la République par les anciennes traditions. C'est ainsi que l'entend Horace, chez qui Romulus, Régulus, Caton, apparaissent comme des maîtres de vertu sociale. L'histoire devient une sorte de morale ou même de politique en action.
Ce souci pratique se traduit par plus de diligence que de discernement. Dans le Forum qu'il construit, Auguste dresse les statues de tous les grands hommes d'autrefois, en commençant par Romulus et, pour chacun d'eux, il fait composer une inscription rappelant leurs mérites. Enée, Lavinia et leur fils Sylvius ont leur statue et leur inscription aussi bien que Fabius Cunctator. Il s'agit de glorification et non de vérité. La légende, pense-t-on, peut avoir, au point de vue politique, des effets aussi profitables que le vrai.
La mode est à la résurrection du passé pour l'éducation du présent. Auguste lui-même pousse jusqu'au pédantisme cette passion de l'histoire utile.
Il ne cessait de lire les historiens grecs et latins; raconte Suétone, y cherchant avant tout des préceptes et des exemples d'ordre public ou privé qui pussent servir ; il les copiait mot à mot et les envoyait soit à ses familiers, soit aux gouverneurs de provinces ou commandants d'armées, soit aux magistrats des villes, suivant qu'ils avaient besoin d'un avis. Il en vint même à donner lecture au Sénat de livres entiers qu'il porta souvent par édit à la connaissance du peuple; par exemple le discours da Q. Metellus sur la nécessité de multiplier le nombre des enfants et celui de Rutilius contre le luxe des constructions, afin de bien montrer qu'il n'était pas le premier à proposer de semblables mesures, mais que les anciens s'en étaient déjà préoccupés.
Ces passages d'historiens qui reçoivent les honneurs de séances du Sénat et de l'affichage paraissent bien être des extraits de Tite-Live. L'historien pouvait soutenir la cause de Pompés contre César et faire l'éloge de l'ancienne république sans offenser le prince qui se présentait comme le restaurateur de l'antique état de choses. Par elle-même, l'histoire était considérée comme d'utilité publique.
Philosophe et rhéteur, Tite- Live ne songe pas un instant à se soustraire aux idées de l'empereur et de ses contemporains touchant le but moral et politique du travail historique (1).
(1) Né en 5S av. J.-C,, Tite-Live semble avoir consacré exclusivement à son Histoire tout le temps qui s'écoula entre la bataille d'Àctium (31 av. J.-C.) et la mort de Drusus (3 av. J.-C.), c'est-à-dire vingt et un ou vingt-deux ans. Il en publiait les différentes parties au fur et à mesure de leur achèvement. L'ensemble, formant 140 ou 142 livres, embrassait l'histoire de Rome, depuis ses débuts jusqu'à la mort de Drusus. Nous n'en possédons que 35 livres, à peine le quart : I-X, des origines à la troisième guerre samnite, soit 461 ans, sorte d'introduction à l'histoire moderne et contemporaine qui était l'essentiel — et XXI-XLV, de la seconde guerre punique au triomphe de Paul-Emile (167 av. J.-C.). Du reste, nous n'avons que de courts sommaires, Periochae. La division en décades (séries de 10 livres) est antique, mais n'émane pas, semble-t-il, de Tite-Live lui-même.
Ce qu'il me faut, déclare-t-il dans sa Préface, c'est que chacun pour sa part s'applique fortement à connaître quelles furent les mœurs, quelle fut la vie à Rome, par quels hommes et par quels moyens, dans la paix et dans la guerre, cet empire a été fondé et accru. Qu'on suive alors le mouvement insensible par lequel, dans le relâchement de la discipline, les mœurs s'affaissèrent d'abord puis tombèrent chaque jour plus bas et enfin se précipitèrent vers leur ruine jusqu'à ce qu'on en vînt à ces temps où nous ne pouvons plus souffrir ni nos vices ni leurs remèdes....
S'il y a dans la connaissance de l'histoire quelque chose de fructueux et de salutaire, c'est qu'on y peut contempler en des monuments éclatants les enseignements de tous les exemples; c'est qu'on y trouve pour soi et pour l'Etat les modèles à suivre et les errements à éviter parce que l'entreprise et l'issue en sont honteuses...
Au reste, si l'amour de mon sujet ne m'abuse, il n'y eut jamais de république si grande ni si sainte, ni si riche en bons exemples, ni de cité où la débauche et l'avidité aient pénétré si tard et où l'on ait tant et si longtemps honoré la pauvreté et l'économie, tant il est vrai que, moins on avait, moins on désirait. C'est tout récemment que la richesse et l'abondance des plaisirs ont apporté la cupidité et la passion de périr et de tout perdre à force de luxe et de débauche.
Il s'agit donc, non pas d'atteindre, de distinguer et d'exposer le vrai, acquisition définitive qui s'imposera à tous les temps, mais de présenter aux contemporains un tableau des mœurs anciennes, et cela à double fin, d'abord pour leur servir de leçon, ensuite pour glorifier l'ancienne Rome. C'est là pur propos de moraliste.
Tite-Live se trouve donc ainsi de plain-pied dans la tradition de l’historiographie romaine. Le vieux Caton, nous dit-on, avait écrit ses Origines en grosses lettres pour servir à l’instruction de son fils. Un autre, Fabius Pictor, avait composé une histoire de Rome pour la gloire de la gens Fabia. Les Commentaires de César étaient une apologie personnelle. Salluste, dans toutes ses œuvres, plaide pour son parti contre l'orgueil de l'aristocratie. L'ambition de Tite-Live est plus haute et plus noble ; il ne s'agit plus de partis, ni des intérêts du Sénat ou de la plèbe. C'est Rome tout entière et l’ensemble d:e son passé qu'il se propose de faire revivre. L'image qu'il veut montrer à ses contemporains pour leur éducation politique et leur amélioration morale est celle d'une cité conduite par les meilleurs et les plus sages, d'une cité dans laquelle le peuple, après des tentatives de résistance, finit toujours par comprendre l'idée de son aristocratie et par se dévouer à la même cause, dans l'intérêt supérieur de la République. C'est l'idéal civique et national qu'au sortir des guerres civiles a conçu le peuple romain et qu'Auguste s'efforce de réaliser. Rien n'est plus sincère que l'enthousiasme inspiré à Tite-Live par .son sujet. «. A vivre ainsi par l'esprit dans les temps antiques, dit-il lui-même, mon âme se fait antique (1). » C'est l'esprit romain dans ce qu'il a de plus élevé qui préside à cette grande œuvre historique, ce n'est pas l'esprit historique.
L'esprit historique, nous le trouvons en Grèce chez Thucydide et chez Polybe. Il exclut toute préoccupation morale, politique, nationale ou autre ; il exige une documentation scrupuleuse et une critique sévère; il conçoit comme tâche essentielle d'atteindre la vérité et subordonne à ce devoir austère l'art de l'exposition et le style. Pour imposer au lecteur l'idéal qu'il a conçu, Tite-Live s'efforcera au contraire de le séduire par la couleur de tableaux habilement composés et de l'entraîner à sa suite par la chaleur de son éloquence. Du fait qu'elle se propose d'être utile découle pour l'histoire la nécessité d'être avant tout œuvre d'art. Ce n'est pas la sèche exactitude de l'érudition qui lui .convient. Son style doit s'accorder à son objet; tantôt majestueux, tantôt familier, il restera toujours digne de la grandeur romaine. Et en ce point encore Tite-Live demeure fidèle à la tradition romaine pour qui l'histoire représente un genre oratoire par excellence (2) ; nous dirions, aujourd'hui, un genre essentiellement littéraire.
Son éducation, en effet, avait été celle d'un rhéteur (3).
(1) 43, 13.
(2) Cic., de Legibus., 1, 2, 5.
(3) Outre son Histoire, il aurait écrit, nous apprend Quintilien, un petit traité des Etudes de la jeunesse dans lequel il recommandait la lecture de Démosthène et de Cicéron et — au dire de Sénèque le Rhéteur, — divers ouvrages philosophiques ou philosophico-historiques. On sait que sa fille épousa un rhéteur.
Cicéronien déclaré, il ne songe point à appliquer dans son œuvre d'autres principes que ceux qui avaient été formulés par Cicéron lui-même.
N'est-ce pas un emploi digne du talent de l'orateur que d'écrire l'histoire? Je ce sais s'il est un genre qui demande une manière plus large, plus abondante plus variée (1). — L'historien ne se contentera pas de rapporter les actions des personnages mais, pour ceux qui ont jeté le plus d'éclat, il s'attachera encore à peindre leurs mœurs, leur caractère, leur vie.,.. Pour ce qui est du style, il faut une manière douce, égale, quelque chose de coulant, d'abondant, de facile, sans cette âpreté qui convient au barreau, sans ces traits énergiques dont l'orateur anime son discours à la tribune (2).
Cicéron, certes, n'aurait pu qu'admirer la façon dont l'œuvre de Tite-Live répond au programme qu'il trace à l'histoire. Ne demandons pas à l'historien autre chose que ce qu'il a voulu nous donner : une belle œuvre d'art moralisatrice, des tableaux et des portraits destinés à faire admirer et aimer l'ancienne Rome.
Le problème de la vérité qui domine notre pensée dès qu'il s'agit d'un récit historique ne se pose pas pour Tite-Live dans les mêmes termes que pour nous;
Dans son premier livre, qui narre la fondation de Rome et la période des rois, Tite-Live se trouve en présence de légendes. Peut-être ces légendes renferment-elles une part de vérité; elles n'y correspondent en tout casque fort inexactement. Son contemporain, Denys d'Halicarnasse, rhéteur de profession lui aussi, mais grec, s'attache à ces légendes ; il cherche à comprendre et à interpréter, à dégager le noyau de réalité qu'elles sont censées envelopper. Il le fait d'ailleurs d'une manière enfantine et qui n'inspire pour son esprit qu'une estime médiocre. Il les traite cependant, en érudit, comme matière de connaissance. Tite-Live en use au contraire vis-à-vis d'elles avec une désinvolture dans laquelle se mêle le scepticisme et l'orgueil. Il s'en explique d'ailleurs dans sa préface :
(1) Cic., de Orat., 2, 15.
(2) Ibid.
Les faits qui se passèrent avant que la ville ne fût fondée ou qu'on voulût la fonder sont plutôt ornés de fables poétiques que transmis par des sources pures. Je n'ai l'intention ni de les nier, ni de les affirmer. Laissons à l'antiquité le droit de mêler le divin à l'humain pour rendre plus augustes les commencements des villes. Au reste, s'il est permis à un peuple de consacrer ses origines et de prendre les dieux pour ses auteurs, le peuple romain plus que tout autre a bien le droit de choisir Mars comme père de son fondateur. Sa gloire guerrière est assez grande pour que les nations de l'univers souffrent sa fantaisie comme elles admettent son empire. De quelque façon que l'on regarde ces récits et qu'on les juge, je n'y attache pas grande importance.
Pour son compte, il rapporte l'essentiel de ces fables, sans insister et sans s'y attarder. Il lui suffit de composer de la légende un récit bien ordonné, une sorte de conte poétique dont il atténue d'ailleurs le merveilleux avec un sourire.
La vestale Rhéa Sylvia, devenue par la violence mère de deux enfants, attribue à Mars cette douteuse paternité, soit conviction, soit dessein d'ennoblir sa faute par la complicité d'un dieu. Mais ni les dieux ni les hommes ne peuvent soustraire la mère et les enfants à la cruauté du roi...
D'une façon générale, comme il convient chez un fervent de la rhétorique, le vraisemblable est pour Tite-Live la mesure du vrai. Il se montre d'ailleurs peu rigoureux en ce qui concerne la vraisemblance.
Plus tard surviennent les premiers documents, fort douteux eux-mêmes et, pour la plupart, Tite-Live ne se le dissimule pas, entachés d'erreur ou de fraude. Il les utilisera cependant, comme il a fait des légendes, mais sans se départir en face d'eux de là supériorité d'un rationalisme de bonne compagnie.
J'ai exposé jusqu'ici une histoire obscure, et par son extrême antiquité, comme un objet qu'on aperçoit à peine à cause de son trop grand éloignement, et par l'insuffisance et la rareté, à ces mêmes époques, de l'écriture, seule gardienne fidèle des souvenirs et des actes du passé, et enfin, par la destruction presque entière, dans l'incendie de la ville par les Gaulois, des registres des Pontifes et autres monuments tant publics que particuliers. C'est avec plus de clarté comme avec plus de confiance que j'exposerai désormais les événements qui vont suivre au dedans et au dehors.
II sait fort bien que les écrivains grecs qui les premiers ont traité de l'histoire romaine, que les poètes latins qui ont chanté les exploits de la République, que l'orgueil des grandes familles, ont multiplié les triomphes et les consulats. Il le signale, mais sans se soucier de rechercher chez ses prédécesseurs les effets de ces multiples causes d'erreur. Les citoyens et les étrangers devront admettre la tradition romaine telle que l'ont constituée les générations qui ont fait l'empire romain.
Pour imposer cette tradition, il lui suffit de la rendre vraisemblable et, à cet effet, il la compose de la façon la plus adroite. Il la fait repasser tout entière par sa raison, supprimant au moins l'apparence des contradictions, choisissant diligemment, parmi les détails rapportés par ses sources, les harmonisant, établissant entre eux des relations logiques. Il en fait une narration d'un seul jet, puissamment conçue, où tout se tient et qu'il faut admettre ou rejeter tout d'un bloc.
La tenue du récit est parfaite. L'historien traite les renseignements qui lui sont fournis par ses sources comme l'orateur en use avec les faits d'une cause. Il les met en bonne place, les laisse dans l'ombre ou les rejette suivant qu'ils s'accordent plus ou moins avec la thèse soutenue, avec l'ensemble du tableau à présenter. Il ne juge pas le renseignement en lui-même, il n'en analyse pas la valeur intrinsèque. Il se contente des apparences et apprécie le fait en raison du récit. Il prend pour guide, non pas une méthode critique dont il ne conçoit même pas l'idée, mais uniquement son instinct artistique et le sentiment littéraire.
Dans tout le cours de l'histoire, comme à ses débuts, le vraisemblable est la mesure du vrai et la convenance oratoire la règle du choix.
Chez Tite-Live, nous cherchons avant tout, aujourd'hui, le document. Nous avons tort. Dans la pensée de l'auteur, le fait n'occupe pas la première place, il est subordonné à l'idée.
Dans les événements importants qui méritent d'être transmis à la postérité, enseignait Cicéron, on veut connaître tout d'abord la pensée qui les a préparés, puis l'exécution et enfin le résultat. L'écrivain doit donc énoncer tout d'abord son opinion sur l'entreprise elle-même, ensuite nous faire connaître tout ce qui s'est dit ou fait et de quelle manière ; quant au résultat, il en indiquera fidèlement les causes en faisant la part du hasard, de la prudence et de la témérité (1).
La pensée de l'historien vient donc en première ligne, avant l'exposé de ce qui s'est dît ou fait : la conclusion consiste en un jugement moral du résultat. Ainsi en use Tite-Live. Sa conception personnelle fournit d'abord la trame ; c'est une idée politique dont l'assurance Impose sa couleur à l'incertitude des faits. L'exposé des faits a pour objet de justifier cette idée et de préparer la leçon morale qui se dégagera de la conclusion. Fondées sur une étude superficielle (les documents, ces idées directrices ne peuvent avoir qu'une valeur historique légère. Elles apparaissent cependant fort raisonnables; elles sont présentées surtout de façon suffisamment cohérente pour s'être imposées à la plupart des écrivains qui ont cherché à saisir l'enchaînement de l'histoire romaine. Tel qu'il est, le tableau ne nous inspire plus qu'une confiance médiocre, mais noua devons reconnaître qu'il est puissamment conçu, qu'il est d'une belle venue et que sa facture mérite toute admiration.
Il va sans dire qu'un artiste aussi accompli que Tite-Live se garde bien de présenter les éléments de son récit toujours dans le même ordre. Il a soin d'éviter la monotonie. L'idée est parfois sous-entendue et ne ressort que de l'agencement des faits. Plus souvent elle se trouve abondamment développée dans ces discours que, conformément à la tradition antique, l'historien prête à ses personnages. En d'autres cas elle est mise en action pour ainsi dire : elle s'exprime par quelque épisode particulièrement dramatique aussi artificiel et aussi soigneusement travaillé que les discours eux-mêmes. En veut-on un exemple? Dis le second livre, c'est-à-dire dès la période
(l) De Orat., 2, 15.
royale, Tite-Live croît devoir signaler l'épuisement des classes rurales sous le faix des guerres continuelles tout en montrant l'union de toutes les classes devant la menace étrangère. A cet effet il invente, ou il transpose à cette époque primitive, un fait divers qui lui paraît significatif.
Un vieillard avec les marques de tous les maux se jette dans le Forum. Ses vêtements sales, son corps exténué, plus hideux encore que sa pâleur et sa maigreur, sa longue barbe, .ses cheveux, lui donnaient un air sauvage. On le reconnaissait pourtant, tout défiguré qu'il était ; on disait qu'il avait été centurion; la foule, en le plaignant, célébrait ses anciennes récompenses militaires. On lui demande pourquoi cet aspect, qui l'a ainsi défiguré, et le peuple s'amassait autour de lui presque aussi nombreux qu'à l'assemblée. Pendant qu'il servait contre les Sabins, dît-il, non seulement il avait perdu sa récolte par les ravages de l'ennemi, mais sa ferme avait été brûlée, tout son bien pillé, son troupeau enlevé; dans sa détresse on avait exigé de lui l'impôt. Il avait emprunté ; sa dette grossie par l'usure l'avait dépouillé d'abord des champs de son père et de son aïeul, puis du reste de son bien, puis comme une lèpre avait atteint son corps. Emmené par son créancier, il avait trouvé non un maître, mais un geôlier et un bourreau. Et il montrait son dos meurtri par les coups récents des verges....
La colore gronde dans la foule, l'émeute se prépare, on réclame l'abolition des dettes, on se porte contre le sénat, les magistrats sont impuissants à retenir le peuple, lorsque tout à coup on annonce une attaque de l'ennemi; tout le monde court aux armes et prend son rang...
Va-t-on chicaner à Tite-Live l'authenticité de son récit et lui demander sa source? Lui aussi répondrait en souriant, comme autrefois Atticus a Cicéron, que l'historien a bien le droit de forcer un peu la vérité pour la beauté du récit.
« Occupé à faire parler ses personnages et à louer de belles actions dit Taine, Tite-Live ne rencontre les causes qu'en passant, il en omet plusieurs, il range mal les faits, il ne sait pas choisir entre eux... Il rencontre toutes les idées générales qu'on peut trouver quand on n'en cherche pas. » Dans l'esprit oratoire et la tendance moraliste, Taine reconnaît déjà quelque chose cependant de l'intelligence philosophique et scientifique qu'il exige de l'historien. N'en demandons pas tant. Contentons-nous de constater qu'une pensée toujours calme et généralement élevée, offrant au moins, dans sa parfaite mesure, toutes les apparences de la plénitude et de la justesse, anime l'ensemble du récit. Cette pensée n'a d'ailleurs rien de recherché ni, à notre sens, de particulièrement profond. Elle exprime simplement le point de vue delà tradition aristocratique qui est celui de presque toute l'historiographie romaine et sur laquelle s'appuie Auguste dans sa tentative de rénovation politique et morale.
C'est donc l'esprit de la Rome augustéenne bien plus qu'une image exacte de la vieille république que nous présente l'histoire de Tite-Live; c'est l'image idéale que se forme du passé national une génération qui n'a pas encore entièrement renoncé au souci de la chose publique, mais que n'agitent plus les passions politiques, une élite cultivée imbue de rhétorique et du souvenir récent des luttes oratoires du Forum, une classe nouvelle d'hommes de bonne volonté qui transpose dans les siècles d'autrefois les aspirations dont elle se trouve animée.
Ne jugeons pas cette majestueuse composition littéraire comme une œuvre de science ni même d'érudition. Elle est avant tout une œuvre d'art. Les faits représentent pour l'historien ce qu'est la réalité pour le poète. Parmi ses impressions, le poète choisit à sa fantaisie celles dont il composera son œuvre; il les élabore et les associe en vue de l'ensemble qu'il conçoit. Tite-Live en use de même des documents quels qu'ils soient. Légendes, Annales des Pontifes, Fastes, épopées ou histoires antérieures, lui fournissent les éléments de son travail. Il les soumet à la formule enseignée par la rhétorique. Une grande idée domine toute l'œuvre et lui prête une âme, l'idée de Rome justifiant par ses vertus la gloire de son destin. Ce n'est pas une « histoire » peut-être, au sens rigoureux que nous prêtons aujourd'hui à ce mot, c'est le tableau de ce que les meilleurs Romains du temps d'Auguste voulaient qu'ait été leur passé et, en même temps, en quelque sorte, l'idéal qu'ils proposaient à leur avenir. Par les qualités littéraires du récit, l'histoire de Tite-Live répond pleinement à l'idée que se faisaient les Romains d'un chef-d'œuvre historique. Et cette perfection lui a assuré l'effet pratique voulu par l'auteur. On sait l'enthousiasme qu'elle suscita non seulement dans la capitale mais plus encore, peut-être, dans les provinces. Pline le Jeune raconte l'histoire de cet habitant de Cadix qui fit le voyage de Rome dans la seule intention de voir le grand homme qui avait si éloquemment narré l'histoire de la Ville. Dès qu'il l'eut aperçu, il s'en revint chez lui content. C'est Tite-Live qui a donné à la tradition romaine sa forme définitive. Des générations de citoyens ont appris chez lui à connaître leur patrie. Vraie ou fausse, l'image tracée par le grand écrivain est devenue leur idéal. Plus que tout autre livre, l'histoire de Tite-Live a contribué à former cette aristocratie nouvelle qui, après la tyrannie des Césars, apparaît sous les Flaviens et les Antonins, héritière de la vertu, de la sagesse et des qualités viriles que la noble imagination de l'écrivain avait prêtées à l'ancienne Rome.
Aux peuples conquis, Tite-Live, en même temps que Virgile, ont présenté de la République conquérante une image digne de respect et d'admiration. Ils ont fait aimer aux vaincus leur nouvelle patrie. On peut appliquer à ces deux grands artistes du verbe le beau vers que le poète Rutilius Namatianus adressait à Rome elle-même :
Palriam facisti diversis egentibus unam.
Des peuples du monde vous avez créé une seule patrie.
Dans les esprits et dans les cœurs, ils ont réalisé la paix romaine.
CHAPITRE IV L'ART AUGUSTÉEN
I
L'IDEAL AUGUSTÉEN ET L’ART OFFICIEL.
L'idéal qui, sous Auguste, a renouvelé la littérature apparaît plus intellectuel qu'esthétique et même plu tôt moral et politique que purement intellectuel. Ce ne sont pas des principes artistiques différents qui séparent Horace de Tibulle, Properce de Virgile, c'est un souci nouveau d'utilité, une sorte d'ambition politique. L'élégie reste de l'art pour l'art : l'inspiration en demeure individuelle. L'Ode, au contraire, vise à exprimer des sentiments collectifs; Virgile, en célébrant la terre italienne et la patrie romaine, se fait l'auxiliaire de l'œuvre restauratrice d'Auguste. Mais le but social que se propose la poésie agit sur l'art indirectement. L'idée d'un renouvellement, tout d'abord, détache les esprits des modes et des formules que l'on considère comme périmées ; elle rend la liberté à l'art. En second lieu, d'autres sujets et d'autres pensées conduisent le poète à d'autres formes. La légèreté du petit poème alexandrin et le distique élégiaque ne conviennent plus au lyrisme plus ambitieux d'Horace. Le poète va chercher les strophes de l'ancienne poésie lyrique grecque et, avec les strophes, c'est un souffle nouveau qui pénètre la poésie latine. De même i'amour de la terre, la sollicitude pour les humbles travaux rustiques et le désir d'apporter aux cultivateurs agrément et profit, introduisent dans les Géorgiques un réalisme de toute autre nature que celui des Bucoliques et de la pastorale hellénistique. Pour chanter la prédestination de Rome, Virgile rattache son art à la fois à celui d'Homère et des vieux poètes épiques latins. L'idéal augustéen, en tirant la Muse hors des petites écoles littéraires et des cénacles mondains pour la conduire dans la cité, a changé son aspect et son instrument.
Sur les arts plastiques, il a exercé une influence du même ordre mais plus lente, moins nette et avec un succès moins complet. La peinture, la sculpture, les arts en général, demeurent moins sensibles que la littérature aux idées abstraites; ils ne s'en laissent pas pénétrer, en tout cas, de façon aussi directe et aussi rapide. La technique et les traditions d'atelier les attachent, d'un poids plus lourd, aux formules courantes. N'oublions pas d'ailleurs que les artistes continuent, sous l'empire, à être en majorité des Grecs et qu'en outre, par leur condition sociale inférieure à celle des écrivains et des poètes, ils demeurent plus étrangers aux courants nouveaux de l'opinion. Le siècle d'Auguste n'a pas trouvé son grand artiste novateur comme il a eu ses poètes et son historien.
La masse de la production artistique du siècle d'Auguste continue donc les directions assez confuses de la période antérieure. La grâce légère, le genre épisodique, les sujets mythologiques, l'alexandrinisme, l'art néo-attique, ajoutez encore les tentatives de l'école de Pasitelès, conservent leur vogue auprès de l'aristocratie romaine qui, en littérature, continue d'ailleurs à Ovide la faveur que la génération précédente avait témoignée à Catulle. Les styles anciens poursuivent tout le long du règne d'Auguste et jusque sous Tibère une existence assez monotone dont l'évolution apparaît à peine sensible.
Au sein de cette banalité existent cependant quelques tendances nouvelles qui, plus tard au cours des siècles impériaux, donneront sa physionomie propre à l'art romain. Elles ne se manifestent que dans un petit nombre d'œuvres qui tiennent de près à l'empereur lui-même et à certains grands événements de son règne. Elles naissent de l'atmosphère impériale, pour ainsi dire, des faits historiques, des idées et des sentiments qui ont déjà transformé la littérature. Leur origine apparaît plus intellectuelle qu'artistique ; elles modifient plutôt la conception de l'œuvre d'art que la technique. C'est l'idée nouvelle qui introduit des motifs nouveaux; elle inspire la composition et oblige l'artiste à se détacher des modèles traditionnels pour imaginer des moyens d'expression qui lui conviennent. L'art officiel est, à ce moment, le plus original. Nous ne parlerons donc ici que de l'art officiel augustéen et spécialement de deux monuments insignes de la sculpture, de la statue d'Auguste trouvée à Prima Porta, aujourd'hui au Braccio nuovo, au Vatican, et de quelques-uns des fragments qui nous restent de l'Autel de la Paix.
II
la statue d'auguste.
A quelques milles de Rome, un peu au-dessus de la vallée du Tibre, sur le territoire de Veies, près de la voie Flaminienne, Livie s'était fait construire, peu de temps après son mariage avec Octave, une villa de dimensions médiocres. C'était la villa aux poules, ad gallinas, dont les ruines ont été fouillées vers le milieu du siècle dernier. La localité moderne porte le nom de Prima Porta. Retraite familiale du couple princier, la villa avait sa légende qui la rattachait symboliquement au destin, sinon de l'empire, du moins de la famille des Jules. On racontait qu'un jour un aigle y avait laissé choir, juste dans le giron de Livie, une poule blanche tenant en son bec un rameau de laurier. La poule aurait donné une telle quantité de poussins que la basse-cour avait valu son nom au domaine. Quant au rameau de laurier, il aurait produit un bosquet si magnifique que tous les Césars prirent l'habitude d'y cueillir les branches nécessaires à leurs triomphes. Sous Néron, les lauriers séchèrent et toutes les poules moururent, présage funeste pou la descendance d'Auguste (1). C'est des ruines de la villa ad gallinas que provient la plus célèbre des statues d'Auguste ; elle y devait occuper la place d'honneur.
L'empereur se trouve représenté en pied, tête nue mais cuirassé, en costume de chef militaire. Le sceptre qu'il tient de la main gauche est une restauration moderne et doit avoir remplacé une lance ou plutôt même une enseigne, une des enseignes perdues par Crassus et que les Parthes venaient de rendre aux Romains. Le bras droit, levé horizontalement, semble également moderne mais doit reproduire assez exactement le geste antique. L'attitude est celle du discours autoritaire et calme ; nous avons devant nous l'imperator haranguant ses soldats après la victoire. Ainsi seront représentés Trajan et Marc-Aurèle sur les reliefs des colonnes consacrées à leurs exploits ; ainsi avaient dû être portraiturés précédemment bien des chefs romains, militaires ou hommes politiques, depuis l’Arringatore étrusco-romain du Musée de Florence qui présente, sous la toge, le même schéma et le même geste qu'Auguste sous le harnais. Le motif est donc bien romain ; il exprime une réalité romaine, il reproduit un type traditionnel à Rome.
Mais que l'on compare l'Auguste de Prima Porta à l'Arringatore de Florence, on ne peut 'manquer d'être frappé de l'aisance supérieure, de l'assurance plus reposée, de la majesté plus souple de l'image impériale. C'est que l'attitude et le mouvement du corps, les proportions même s'y inspirent, en partie au moins, du Doryphore de Polyclète. Ce n'est pas, sans doute, une imitation ni même une transposition de la statue célèbre mais, comme le dit fort bien Wickhoff, la structure du corps d'Auguste est d'un artiste à qui l'œuvre de Polyclète est visiblement très familière. Traditions latine et grecque se trouvent, en somme, fondues en un tout nouveau.
(1) Cf. suet., Galba, 1 plin.. N. H., 15, 30 (41).
Une inspiration purement grecque aurait prêté à l'empereur la nudité héroïque. C'est ainsi, par exemple, que deux sculpteurs grecs avaient autrefois représenté à Délos, à peu près exactement dans la même attitude, mais complètement nu et le manteau simplement rejeté sur l'épaule et le bras gauche, le romain C. Ofellius Férus. Ici au contraire, tous les détails du costume, les attaches delà cuirasse, les plis de la tunique, les franges qui tombent de la ceinture, sont traités avec une exactitude scrupuleuse. C'est le même soin du détail vrai que l'on retrouve sur les stèles funéraires des militaires de l'armée du Rhin : on y peut compter et reconnaître leurs décorations et les moindres particularités du harnachement. La statue d'Auguste n'a conservé de la convention héroïque qu'un seul souvenir, la nudité des pieds. Cette partie seule échappe au réel. Dans l'ensemble, la statue de Prima Porta donne une impression de réalité et non d'image idéalisée.
Livie a voulu un portrait ressemblant de son époux glorieux et l'artiste a obéi. Ainsi s'explique sans doute la lourdeur du bas de la statue et les jambes un peu courtes. Cette lourdeur se trouve encore accentuée par les plis extrêmement serrés de la chlamyde au-dessous de la ceinture et par la masse volumineuse du vêtement qui tombe du bras gauche. La stature est bien d'un homme, non d'un dieu ; les plis sont ceux d'une étoffe réelle et chaude, d'un vrai paludamentum d'imperator et non du vêtement conventionnel d'un habitant de l'Olympe. Cette statue repose solidement sur la terre ; elle glorifie mais sans diviniser. Le visage est bien celui d'Auguste ; on y reconnaît non seulement la physionomie du prince telle qu'elle nous est décrite par Suétone (1) et qu'elle se trouve figurée par plusieurs autres portraits (2), mais même l'âge, la quarantaine. Le nombre et la disposition des boucles de cheveux sur le front sont ce que les montrent les effigies d'Auguste depuis sa prime jeunesse; ce sont ses grands yeux, enfoncés dans l'ombre des orbites mais qu'animé la lumière froide d'un regard très clair, des joues maigres, un nez mince et allongé, peu distant de la bouche, des lèvres assez charnues, et surtout ce menton proéminent, presque épais, qui projette son ombre sur un cou large et puissant. Ces traits si individuels se trouvent comme figés dans une expression immobile de majesté calme. Ils sont d'ailleurs largement traités, par grands plans, sans détails superflus et sans minutie. La facture est celle d'une tête idéale, mais l'idéalisation est ici étroitement subordonnée à la ressemblance.
Certes les Grecs de l'époque hellénistique ont exécuté eux aussi des portraits ressemblants ; ils ont même parfois poussé le réalisme jusqu'à une intensité remarquable. Le réalisme, chez eux, s'oppose nettement à la tendance idéaliste ; il cherche exclusivement l'individu et, autant que possible, dans l'individu, la particularité épisodique, le trait saillant, presque caricatural, qui dominera toute la physionomie. Il devient un jeu, presque une gageure de la virtuosité. Dans le portrait romain, à l'époque d'Auguste tout au moins et dans l'art distingué, réalisme et idéalisme s'allient et se fondent en un tout d'un caractère très particulier. La fidélité scrupuleuse au modèle constitue comme le fond instinctif du travail. L'artiste a dû commencer par reproduire tous les détails ;
(1)Aug, 79.
(2) Comparer en particulier l'admirable portrait d'Octave jeune, provenant d'Ostie, à la Galerie des Bustes au Vatican ; la tête de bronze d'un réalisme plus accusé de la bibliothèque vaticane, récemment publiée par nogara (XIII, 1914, p. 186-199), et la statue d'Auguste en toge trouvée en 1910 dans les environs de Rome (PASQUI, XVIII, 1910).
puis il les a estompés, il les a enveloppés dans une stylisation de l'ensemble qui cherche à élever la physionomie individuelle à la noblesse et à la généralité d'un type conçu par l'imagination (1). Est-ce la vieille tradition du portrait italique qui reparaît ainsi à l'époque impériale sous un art plus savant, ou bien avons-nous affaire à une combinaison éclectique des deux tendances opposées qui se rencontrent dans l'art hellénistique ? Nous préférons y voir une alliance de l'esprit latin épris du réel et de la culture classique grecque qui cherche dans la nature une beauté plus parfaite que celle de l'individu et une vérité plus haute que celle de la pure sensation. Mais les arguments font complètement défaut, reconnaissons-le, pour exclure l'influence du réalisme hellénistique, dont l'effet fut peut-être précisément de réveiller et de remettre à la mode le vieux réalisme étrusco-latin.
Ce qui frappe dans la statue d'Auguste c'est, comme dans l'art de Virgile, cette union intime d'un sens réaliste profond et d'un idéalisme savant. Auguste apparaît comme un homme, mais il a aussi du héros. Les traits de la physionomie sont individuels, mais l'immobile gravité de l'expression respire une noblesse plus qu'humaine.
Les reliefs qui ornent la cuirasse sont conçus dans le même esprit. Le motif central est la représentation exacte par ses moindres détails d'un fait historique réel ; il est encadré d'allégories qui comportent elles aussi des éléments de réalité mêlés à la convention, tandis que d'autres figures sont de purs symboles mythologiques. La signification de l'ensemble se trouve ainsi élargie et élevée au dessus du simple intérêt épisodique.
Ces reliefs ont été souvent décrits et ont fait l'objet d'amples discussions. Les uns les ont rapprochés de l'art purement alexandrin, tandis que d'autres se sont efforcés d'en mettre en lumière l'originalité.
(1) Nous pensons en particulier ici aux charmants portraits de Romaines du i" siècle de l'empire, tels que celui qui fut trouvé près de la Farnésine et qu'a publié rayet, CXXXVI, 2, 6, 2.
La technique en est évidemment tout hellénistique, alexandrine si l'on veut ; l'effet en est celui des ouvrages de toreutique et de ciselure qui reçurent à Alexandrie un développement particulièrement brillant. Les motifs semblent hellénistiques, au moins en partie. Mais l'idée qui les assemble est bien romaine. C'est l'idée qui fait l'originalité de cette décoration.
 --- Reliefs de la cuirasse d’Auguste.
--- Reliefs de la cuirasse d’Auguste.
Sur l'étroit espace de la cuirasse d'Auguste, l'artiste a voulu représenter le monde que domine tout entier la puissance romaine. En haut, au dessus des pectoraux, le Ciel étend son voile ; le Soleil sur son char s'élance précédé de l'Aurore qui répand sa rosée, tandis que la lune disparaît déjà à demi avec son flambeau pâli. C'est le matin d'un jour radieux qui se lève pour l'univers. En bas de la cuirasse repose, mollement étendue dans la paix, la terre maternelle ; elle semble contempler sa corne d'abondance pleine de fleurs et de fruits ; deux enfants se blottissent contre elle ; de part et d'autre apparaissent les dieux protecteurs de l'empire, Apollon, le dieu d'Actium, chevauchant son griffon et Diane montée sur un cerf. Aucun de ces motifs n'est sans doute nouveau; leur association sur la cuirasse d'Auguste n'en prend pas moins une signification originale.
Au centre du monde ainsi symbolisé, la scène historique qui marquait le triomphe de Rome et assurait la paix se joue entre deux seuls personnages. Un barbare, un roi, caractérisé par son diadème et son costume comme étant Phraates, roi des Parthes, présente une aigle de légion à un personnage costumé en officier romain qui tend les deux mains pour la recevoir. Un chien est représenté en arrêt aux pieds du Romain. Très nettement il s'agit d'un chien et non d'un loup ou d'une louve. Aucune raison n'autorise donc à identifier avec Mars le personnage cuirassé et casqué qui fait face à Phraates. Il faut reconnaître en lui, non pas un dieu, non pas même un Romain quelconque, mais précisément Tibère, le jeune beau-fils de l'empereur qui avait été délégué pour recevoir les trophées autrefois enlevés à Crassus et que le roi des Parthes, en signe d'amitié, remettait à Rome pacificatrice. Le fait datait de l'an 20 avant notre ère. Comme le confirma l'âge que la statue attribue à l'empereur, la sculpture dut être exécutée vers cette époque. La scène principale de la décoration de la cuirasse représente donc, d'une façon concentrée sans doute, mais avec une précision aussi parfaite que possible et un scrupuleux réalisme dans tous les détails du costume et de l'armement, l'un des épisodes les plus glorieux du règne, celui qui, sans effusion de sang et par le seul prestige de la nouvelle puissance romaine, semblait assurer pour toujours au monde civilisé le respect des barbares d'Orient.
L'Occident non plus n'est pas oublié dans cette glorification d'un moment si exactement déterminé du règne d'Auguste. A droite et à gauche du groupe que forment Phraates et Tibère se voient deux figures assises dans l'attitude affaissée des vaincus. L'une, celle de droite, serre d'une main un fourreau vide et, de l'autre, une trompette gauloise à tête de monstre ; elle a devant elle un sanglier enseigne. C'est évidemment la Gaule. L'autre tend une épée qu'elle semble rendre à un vainqueur. Ce doit être l'Espagne. En l'an 21 avant notre ère, Agrippa y avait en effet désarmé les Celtibères. Ces figures allégoriques de provinces vaincues expriment donc elles aussi des faits précis ; chaque détail, le fourreau vide, l'épée que l'on rend, la trompette et le sanglier gaulois, a son sens. La personnification de provinces, de fleuves, de continents est chose courante dans l'art hellénistique. L'originalité consiste peut-être ici à exprimer de l'histoire par l'attitude, par le geste et les attributs de ces symboles géographiques.
Elle s'affirme en tout cas dans la composition à la fois harmonieuse et pleine d'idées de l'ensemble. Le motif central se détache de son cadre allégorique par ses proportions plus fortes et son relief plus accusé. Le fait historique apparaît très nettement comme l'essentiel. L'air circule autour des figures. Ces motifs si divers, ramassés en un espace étroit, ne donnent cependant aucune impression ni de surcharge ni d'incohérence. Empruntés ou non au répertoire de l'art hellénistique, ils se sont imprégnés de pensée romaine; l'idée impériale leur a donné leur valeur et leur place.
Pour compléter l'intelligence de cet art, n'oublions pas la polychromie qui venait encore accentuer la vie de ces représentations. Les inventeurs de la statue ont encore pu en relever les traces. La tunique et la chlamyde de l'empereur étaient rouge cramoisi, la couleur réelle du paludamentum de l'imperator. Les franges de la cuirasse imitaient le jaune du cuir naturel ; sur l'épaule, les fermoirs de la cuirasse, censés en bronze, étaient bruns. Sur les chairs et le fond de là cuirasse les traces colorées faisaient défaut. La voûte du ciel était rosée comme un lever de soleil et le char de l'astre, pourpre. Au centre dominaient les tons bleu clair dans les vêtements des figures assises. Le cerf de Diane était de couleur fauve. Le roi parthe portait des braies bleuâtres et une tunique cramoisie. La cuirasse d'acier et le casque bleutés de Tibère faisaient ressortir l'éclat de son manteau rouge. Les couleurs étaient vraies, comme les détails. Mais il nous est difficile de juger, sur leurs restes, de leur harmonie.
De cette statue, destinée non pas à un monument public mais à la retraite paisible de la villa de Livie, se dégage une impression de noblesse un peu froide, rachetée peu à peu, à mesure qu'on l'examine de plus près, par la richesse et la vie des détails. C'est bien l'image de l'idéal augustéen, une volonté tendue, une pompe solennelle, un héroïsme de convention, aboutissant, jusque dans la vie familiale, à l'ennui pontifiant d'une perpétuelle morale en action. On comprend et on excuse presque, à la vue de la statue de Prima Porta, la révolte d'une Julie contre l'étouffante atmosphère de vanité grandiloquente, de vertu prêcheuse et un peu hypocrite qu'Auguste avec Livie et Octavie devait faire régner autour d'eux. Mais que l'on surmonte cette première impression, sous la solennité du geste, sous la froideur des traits, apparaît la vie, une vie puissante de passion disciplinée, imposant le calme et subordonnant le caprice et la fantaisie aux réalités. La grandeur de ces réalités excuse l'orgueil et la grandiloquence; c'est Rome ramenée à l'ordre et, par elle, la paix apportée au monde avec toute sa fécondité, le respect imposé même aux nations demeurées indépendantes ; c'est vraiment un jour nouveau et radieux d'espérances se levant pour l'humanité. « Quand les auteurs, écrit un excellent connaisseur du monde hellénistique, nous montrent le génie de l'Occident apparaissant dans le monde grec sous la figure de Scipion Emilien, on est vraiment reconnaissant à ces collecteurs d'anecdotes de faire circuler une bouffée d'air frais à travers l'épouvantable charnier. » On en peut dire autant de la figure d'Auguste apparaissant au milieu du monde des guerres civiles.
La vertu romaine, quand bien même elle n'aurait été qu'un idéal, quand bien même elle se serait réduite à une convention à demie hypocrite, à des aspirations sans effet vers une antiquité faussée, ne valait-elle pas mieux pour le monde que le dilettantisme intellectuel ou les fantaisies de quelque brillant despote ? S'il l'avait voulu et comme pouvaient le faire craindre ses débuts, Auguste aurait pu devenir un tyran effroyable, résolvant par des exterminations les oppositions et les difficultés qu'il ne cessa de rencontrer. Dès qu'il se trouve le maître, au contraire, il s'impose le devoir de conquérir les esprits et les cœurs à un idéal de modération, de raison et de justice. La contention qu'il impose, à lui et aux autres, est sensible dans sa figure comme dans l'esprit et les œuvres de son temps. Elle a bride l'imagination ; aux caprices de l'individualisme elle a substitué la règle de l'utilité sociale. Cette sévérité cependant n'a pas étouffé la beauté. Elle s'est trouvée féconde, au contraire, d'une poésie plus noble et plus riche que la licence alexandrine, d'une histoire qui lui doit sinon sa perfection littéraire, du moins sa majesté et l'ampleur de son allure, d'un art plus vrai et plus profond que celui des écoles hellénistique?
L'art augustéen rachète sa froideur par la vie de l'ensemble et par la valeur expressive des détails. Sa précision réaliste paraît souvent un peu sèche. La faute en incombe aux artistes qui n'ont pas eu en partage un génie égal à celui des poètes. Mais il baigne dans une atmosphère d’idées et de sentiments noblement humains. Dans les belles œuvres, qu'il s'agisse de scènes religieuses, mythologiques, historiques ou de portraits, nous trouvons à Rome, à partir d'Auguste, un souffle nouveau. L'art conserve toute la sûreté du métier et la science de la composition qui ont été portées à la perfection par la Grèce. Il renonce à la banalité comme aux excès d'une fantaisie sans soutien et sans idée sincère ; il s'applique au réel ; c'est du vrai qu'il cherche à dégager le beau.
III
l'autel de la paix.
On se souvient du vers de Properce blâmant Prométhée d'avoir oublié de donner une âme à l'être façonné de ses mains :
Corpora disponens mentem non vidit in arte.
La critique pouvait s'appliquer à l'art de l'hellénisme finissant. La technique en est parfaite et l'élégance irréprochable, mais l'âme est absente. Considérons par exemple les bas-reliefs célèbres du Palais Grimani (aujourd'hui au Musée de Vienne), la lionne menacée dans son antre et se soulevant à demie pour protéger ses lionceaux, ou la brebis allaitant son petit, spécimens accomplis de ces nombreux reliefs hellénistiques publiés par M. Schreiber. Ce sont de charmants tableautins. Mais on y chercherait vainement une idée et surtout un sentiment. Tout cet art n'est qu'un jeu; il est fait pour l'amusement d'esprits vides. L'art romain veut signifier quelque chose, évoquer une idée, perpétuer un souvenir, en rappeler l'émotion, transmettre à l'avenir une impression de grandeur et de beauté. Il s'inspire de la vie romaine, il cherche à exprimer l'âme de la cité.
Nous avons noté, à la fin de l'époque républicaine, l'originalité de la frise qui, autour du l'autel de Domitius Ahenobarbus, représentait le sacrifice triomphal et le congé des vétérans. L'orgueil romain confiant à l'art la célébration de faits historiques n'était pas chose nouvelle. Que l'on se rappelle ces peintures qui traditionnellement figuraient au cortège des triomphateurs. La tradition n'en était pas .périmée. C'est à elle que se rattachent les grandes épopées plastiques de l'arc de triomphe de Titus, de la colonne Trajane et de là colonne Antonine. Elle avait été consacrée en effet par l'art officiel du début de l'empire. C'est la juste célébrité des bas-reliefs de l'autel de la Paix qui l'a rendue féconde pour l'avenir.
Ce monument a fait l'objet de nombreuses études depuis que, en 1879, un premier et magistral article de M. von Duhn en a révélé les fragments dispersés. Des fouilles récentes en ont exhumé de nouveaux morceaux et ont permis de se faire une idée à peu près complète de l'ensemble. Telle qu'on peut la reconstituer aujourd'hui, l’Ara Pacis apparaît vraiment comme l'exemple le plus caractéristique du grand art augustéen.
La construction de l'autel se place entre les années 13 et 9 avant notre ère. Après une longue absence en Orient, en 17, puis en Gaule et sur le Rhin, depuis l'an 16, Auguste était, en l'année 13, impatiemment attendu par tout le peuple de Rome.
Reviens, prince bienfaisant, chantait Horace (1), rends la lumière à ta patrie. Ainsi qu'au retour du printemps, sitôt que le peuple aura revu ton visage, les jours seront plus beaux et le soleil brillera d'un plus, doux éclat Comme une mère soupire après son fils..., ainsi la patrie tourmentée d'une tendre impatience, ne cesse de réclamer César.
Chargé d'organiser les fêtes par lesquelles on voulait célébrer ce retour tant souhaité, Julius Antonius, le fils de l'ancien triumvir, l'ami de Julie, s'était tout d'abord adressé à Horace. Il lui avait demandé, semble-t-il, un pendant au Chant séculaire qui avait précédé le départ de l'empereur. Mais Horace s'était excusé :
Je compose, non sans peine, des ouvrages proportionnés à ma faiblesse. Un poète tel que toi chantera César sur un ton plus sublime... Tu diras nos jours de fête, tu peindras Rome dans !es jeux, le peuple dans l'allégresse pour le retour glorieux qui rend Auguste à nos désirs...
Ces fêtes, cette allégresse du peuple qu'Horace se refusait à célébrer, Antoine s'avisa de les commémorer par l'image. On ignore d'ailleurs à quel artiste il en confia le soin.
Deux jeux furent organisés par les consuls. Le Sénat décida que tout le peuple irait attendre l'empereur à la porte de la ville — la porta del Popolo actuelle — et lui ferait cortège jusqu'à un autel qui serait préparé au Champs de Mars pour le sacrifice d’actions de grâces. Ce beau programme fut d'ailleurs déjoué par le prince qui rentra dans Rome incognito, la veille du jour où il était attendu. Ce jour, le 4 juillet, le peuple averti alla le saluer au Palatin et organisa un cortège au Capitole et au Forum où siégeait le Sénat. L'autel définitif qui devait perpétuer le souvenir du retour ne fut prêt et inauguré que quatre ans plus tard, en 9 avant notre ère.
Le monument consistait en une enceinte de marbre entourant l'autel lui-même. Les soubassements en ont été retrouvés au Corso, sous le palais Fiano ; c'était un carré de 11m, 65 de côté. L'enceinte devait atteindre 3 ou 4 mètres de haut.
(1) Carm., 4, 5.
A l'intérieur étaient sculptées de lourdes guirlandes de feuillages et de fruits accrochées à des bucranes. Le champ des reliefs extérieurs se divisait en deux étages : le bas n'était décoré que de rinceaux; les frises figurées occupaient le haut et faisaient tout le tour de l'enceinte. Nous en possédons une partie. Elles reprenaient vraiment l'essentiel du programme tracé par Horace et traduisaient en images les sentiments exprimés par lui : l'Italie heureuse et féconde par Auguste, le peuple dans l'allégresse faisant cortège au prince rentrant à Rome. Deux larges portes ouvraient les côtés est et ouest de l'enceinte. Celle de l'ouest seule était précédée de quelques marches ; celle de l'est, réservée sans doute aux animaux du sacrifice, n'était marquée que d'un léger seuil. Nous avons donc de ces deux côtés, quatre pans de murs dont le développement, réduit encore par les pilastres des angles et des portes, n'atteignait pas 3 mètres. Cespetits côtés étaient décorés de reliefs allégoriques dont un seul a été conservé intact. Les indications de monnaies reproduisant l'autel permettent de localiser de part el d'autre de l'entrée orientale, à gauche (côté sud), l'image de l'Italie ; à droite, celle de Rome; de part et d'autre de l'entrée occidentale, à droite (côté sud), le relief d'Énée sacrifiant aux Pénates dont la moitié de droite représentant Enée a été retrouvée en 1903, et à gauche (nord) fort probablement une représentation de la Louve allaitant les jumeaux Romulus et Remus sous le figuier ruminal (1).
Sur les côtés continus se déroulait la procession, sorte de réplique romaine des Panathénées du Parthénon. Au sud, la tête du cortège, se dirigeant vers la gauche, représentait Auguste et sa famille ; au nord venait le peuple, marchant vers la droite et semblant faire suite, par conséquent, à la famille impériale.
Le bas-relief intact de l'Italie, qui flanquait l'entrée orientale, désigné généralement sous le nom de Tellus, 'se trouve aux Offices, à Florence, ainsi que les parties des grandes frises représentant la famille d'Auguste et une moitié environ de la procession du peuple; deux autres morceaux de cette procession se trouvent, l'un au Vatican, l'autre au Louvre. Le Musée des Thermes, à Rome, possède, outre divers fragments les deux moitiés à peu près complètes du sacrifice d'Énée aux Pénates.
(1) Je suis ici les indications de Studniczka, qui me paraissent exclure toute incertitude.
La partie de la frise méridionale qui précédait immédiatement les morceaux de Florence demeure aujourd'hui encore en place dans le sous-sol du Palais Fiano. Les reliefs encastrés dans le mur de la Villa Médicis, du côté du jardin et que l'on croyait autrefois provenir de l'autel de la Paix, semblent bien n'avoir appartenu qu'à un monument du temps de Claude.
Contentons-nous d'examiner quelques-uns des fragments de cette grande œuvre sculpturale.
Le plus connu est le relief allégorique des Offices qui occupait le petit coté à gauche de la porte est. On croyait y reconnaître autrefois une image de la Fécondité ; d'autres préféraient y voir la Terre maternelle; il faut lui attribuer, croyons-nous avec M. van Baren, un sens plus précis; c'est l’ltalie : elle faisait pendant à l'image de Rome placée à droite de cette même porte.
Sur un roc une femme est assise, tenant deux poupons dont l'un cherche son sein tandis que l'autre semble jouer ; des fleurs, des fruits et des raisins remplissent son giron; derrière elle jaillit, à gauche un arbuste, et à droite une touffe de fleurs. Dans l'angle inférieur gauche du relief une urne renversée figure une source ; l'eau s'en écoula à travers une abondante végétation, un oiseau vient y boire; sur les bords herbeux de la rivière née de cette source, au bas du relief, un grand bœuf couché rumine et un mouton paît aux pieds du personnage principal. Deux figures plus petites complètent le tableau: elles ont le buste nu, leur manteau se gonfle comme une voile au-dessus de leur tête, leurs pieds ne touchent pas la terre; l'une, celle de droite, a près d'elle un dauphin, l'autre est assise sur un cygne qui s'envole.
Le principe d'une telle représentation, la personnification d'une idée abstraite, Fécondité, Terre nourricière, ou d'un fleuve,est grec sans aucun doute. Mais que l'on considère le visage du personnage principal, de la belle femme aux deux poupons assise sur son roc. Le type n'en a rien de grec ; les traits sont maigres et presque durs, la physionomie reste sévère jusque dans le sourire qui semble suivre le jeu de l'un des poupons ; le crâne rond et petit, le nez accusé et nettement détaché du front, la bouche forte et placée très haut dans la figure, la longueur du menton, semblent d'un portrait plutôt que d'une tête idéale et d'un portrait italien bien plutôt que grec. Une femme certainement a posé pour ce visage ; l'artiste en a rendu la beauté très individuelle.
Cette nourrice aux puissantes mamelles qui pointent sous les plis souples du péplum, c'est la terre d'Italie, magna parens frugum, magna virum. Dans les détails de la sculpture, M. van Buren retrouve tous les traits essentiels de l'éloge fameux de l'Italie au second chant des Géorgiques, et ce n'est pas là jeu d'esprit. Voici dans son giron les fruits et les raisins :
Gravidae fruges et Bacchi Massicus humor (v. 143);
derrière elle, les fleurs et les feuillages, verassiduum (v. 149); à ses pieds, le fleuve et les troupeaux, armenta laeta (v. 144).
... albi Clitumne greges et maxima taurus
Victima, saepe tuo perfusi flumine sacro (v. 146-147).
La figure maternelle est assise sur le roc comme tant de vieilles villes d'Italie, au-dessous d'elle s'étendent les prairies au milieu desquelles serpente la rivière,
Tot congesta manu praeruptis oppida saxis
Fluminaque antiquos subterlabentia muros (v. 156-157).
Les figures aériennes qui se font pendant et encadrent pour ainsi dire l'Italie, ce sont les Jovis aurae, les souffles heureux de Jupiter qu'invoqué Horace dans le Chant séculaire.
Ferlilis frugam pecorisque tellus Spicea donet Cererem corona.
Nutriant fœtus et aquae salubres
Et Jovis aurae (v. 29-33).
Fertile en moissons et en troupeaux, que la terre d'Italie couronne Cérès de ses épis; que les petits aient pour se nourrir une eau pure et les souffles de Jupiter.
A droite, nettement désigné par la présence du dauphin, est l'air de la mer ; à gauche s'envole sur son cygne la brise de terre ; ce sont les deux souffles qui, aux jours chauds, rafraîchissent alternativement les campagnes italiennes. Aucun Romain qui, vers l'heure où le soleil baisse à l'horizon, a attendu le réconfort de l'air de l'Apennin succédant à la brise marine qui a vivifié le matin, ne saurait mettre en doute la précision et le sens de ces figurations.
L'inspiration de toute cette allégorie est trop nettement italienne pour que l'on puisse accepter l'hypothèse de M. Schreiber qui voudrait y reconnaître simplement un motif alexandrin. M. Schreiber prend argument de la trouvaille à Carthage d'un bas-relief presque identique à celui de l'Ara Pacis au moins en ce qui concerne la figure centrale. Les figures accessoires, au contraire, ont été modifiées de façon à représenter, semble-t il, les Syrtes tempétueuses et les côtes d'Afrique. Il nous paraît tout à fait vraisemblable de considérer le relief de Carthage comme une imitation de celui de Rome. Comme bien d'autres capitales de province, Carthage a pu vouloir posséder elle aussi son autel de la Paix ou même son autel de Rome et d'Auguste et se sera contentée de transposer à son usage les modèles fournis par l'autel célèbre de Rome (1). Une copie d'une image banale aurait au contraire été difficilement admise dans la décoration du monument élevé en l'honneur du retour d'Auguste.
Si les Géorgiques et une strophe du Chant séculaire ont pu inspirer le relief de l'Italie, c'est le souvenir de l'Enéide que l'on retrouve dans les deux fragments du Musée des Thermes qui ornaient le côté sud de la porte ouest de l'Ara pacis. La scène représente le sacrifice d'Enée aux Pénates. Un personnage de type purement idéal, ressemblant à quelque Jupiter ou à un Esculape, est debout, la poitrine nue et la tête voilée d'un pan de son manteau. Derrière lui, à droite, s'aperçoit le bras d'un compagnon, appuyé sur un solide bâton. Il faut reconnaître, non pas une personnification du Sénat, comme on l'a proposé, mais bien Enée suivi de son fidèle Achates. Enée tend la main vers une corbeille de fruits ou de gâteaux que lui présente un camille (enfant de chœur); un serviteur pousse vers lui une truie. Dans le fond, sur une hauteur, s'élève un petit temple dans l'ouverture duquel apparaissent deux personnages assis. C'est le temple des Pénates que venait de restaurer Auguste. La scène figure le premier sacrifice offert par l'ancêtre mythique du peuple romain aux divinités nationales troyennes qu'il vient d'installer en terre italienne. Le personnage d'Enée à la barbe fleurie est bien un Grec, un héros idéalisé dans le style pergaménien. Le petit temple, au second plan, le rocher creux sur lequel il s'élève, rappellent exactement les fonds pittoresques des bas-reliefs dits alexandrins, mais il constitue en même temps une allusion précise à un fait actuel romain, la reconstruction du temple des Pénates.
(1) Parmi les fragments de l'autel de Rome et d'Auguste de Lyon, conservés au Musée de la ville, on notera des guirlandes qui rappellent de très près celles de l'Ara Pacis.
A côté de ces motifs conventionnels, le groupe des deux camilles, le plateau aux offrandes, le vase d'eau lustrale, la truie, le groin en terre, que l'on pousse vers l'autel, apportent la note vivante et réaliste (1). Le tableau est composé, comme un épisode de l’Enéide, de motifs empruntés à l'art hellénistique, d'idéalisme héroïque, d'actualité et de choses vues. L'ensemble présente un sens nouveau et s'inspire de la légende nationale qui remplit à ce moment les imaginations. Le souvenir de Troie et la pensée de Rome planent, pour ainsi dire, dans cette image et animent la composition.
Nous ne pouvons que deviner, par les menus fragments recueillis ou par les indications de quelques monnaies, le sujet des deux autres reliefs qui décoraient les petits côtés près des portes. A l'Italie féconde faisait pendant Rome assise dans sa gloire ; au sacrifice d'Enée, la louve nourrissant Romulus et Rémus. La conception, on le voit, en était la même que celle des tableaux qui nous ont été conservés.
Sur les deux grandes frises continues des côtés nord et sud, c'est le réel qui s'étale, pur de tout mélange conventionnel ou mythique. C'est la procession du peuple romain faisant cortège à son prince dont il fête le retour. Cette longue suite de personnages animés d'un même mouvement mais d'attitudes infiniment variées, est une véritable série de portraits. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil sur le groupe initial de la plaque du Vatican : deux vieux licteurs, l'un de profil, l'autre de face, précédant un magistrat. L'individualisme des physionomies, l'intensité et la diversité des expressions, les trait:s empâtés du premier, la face ridée et parcheminée dû second, le profil accusé du magistrat, tout indique une copie aussi exacte que possible du modèle vivant.
Les contemporains devaient pouvoir mettre un nom sur chacune des figures de ces frises.
(1) On la retrouvera sous tout l'empire dans les innombrables scènes de sacrifice aux dieux Lares et de Suovetaurilia. C'est un ancien motif de l'art religieux populaire qui émerge dans l'art officiel dès l'autel de Domitius Ahenobarbus,
Ce n'est pas un peuple idéal, comme celui des Panathénées, qui défile dans la beauté et dans la gloire, c'est le peuple de Rome qui marche, d'un pas paisible mais bien appuyé, sur son sol. L'art a consisté, pour le sculpteur, à composer cette foule, à éviter la monotonie et la dispersion, à grouper les individus en une foule compacte, mais dans laquelle on sent cependant le mouvement propre la vie et même la pensée de chacun. Variant les costumes, entremêlant hommes, femmes et enfants, les présentant de profil, de trois quarts ou de face, distribués généralement sur deux plans et conversant parfois entre eux, en usant surtout très habilement de la direction diverses des regards qui lient pour ainsi dire les personnages entre eux, l'artiste a déployé dans la peinture de celle procession une incomparable virtuosité. On a justement comparé son œuvre aux tableaux de corporation des maîtres hollandais. C'est en effet la même inspiration réaliste soutenue par une technique parfaite et animée d'un esprit plein de saveur et de finesse.
Contentons-nous ici d'examiner l'une des parties de la frise méridionale et d'essayer d'y reconnaître au moins quelques-uns des personnages de la famille de l'empereur.
En tête du cortège marchait Auguste, entouré de licteurs et accompagné sans doute de Livie. De cette dalle nous ne possédons que quelques fragments (1). Puis venait lebloc qui est demeuré en place sous le palais Fiano, sur lequel, entre autres personnages, deux flamines se reconnaissent à l'apex, sorte de houppe pointue qui surmonte leur bonnet. Cette partie précédait immédiatement celle qui se trouve à Florence, dont les deux premiers personnages sont précisément deux autres flamines. Ces prêtres se trouvent ainsi figurés au nombre de quatre. Or le collège ne se trouva au complet qu'en l'an 11 avant notre ère. On en a conclu que le cortège représenté sur la frise était, non pas celui de la réception manquée de l'an 13, mais celui de l'inauguration de l'autel en janvier de l'an 9.
(1) Au Musée des Thermes.
On a fait remarquer, à l'appui de cette hypothèse, qui les personnages étaient figurés douillettement enveloppés dans leurs manteaux comme on l'est en janvier, même à Rome, mais comme il est pénible de l'être en juillet. Quel que soit le souci de précision dont témoigne la frise, peut-être ne convient-il pas de prêter considération à des remarques aussi minutieuses. Le peuple est en costume de fête, costume qui, pour les hommes, comporte la toge et pour les femmes le manteau, dont elles peuvent s'envelopper aussi bien contre le soleil que contre la tramontane: La frise a été sculptée entre la fin de l'an 13 et le début de l'an 9 ; elle a dû comporter des esquisses nombreuses et peut-être des retouches; il était naturel que l'artiste !a mit à jour, il est peu vraisemblable qu'il ait songé à distinguer entre la procession de l'an 13 qui n'avait pas réellement eu lieu et celle de l'inauguration pour laquelle son œuvre devait être en place et qui n'avait donc pas encore eu lieu. Disons simplement qu'il s'agit sur la frise d'une procession solennelle du peuple romain célébrant à la fois le retour de son prince et la paix donnée au monde.
En conséquence, nous devons nous attendre à y trouver l'image de la famille d'Auguste telle qu'elle était constituée vers l'an 10, au moment où le sculpteur dut mettre la dernière main à son œuvre.
Quel est le personnage qui, au milieu de la dalle de Florence, se présente le corps de face et le visage de profil légèrement incliné vers la droite ? De haute taille, d'attitude très noble, il voile sa tête sous un pan de sa toge comme un prêtée en train d'officier. Il s'avance derrière un licteur; à sa gauche, un jeune garçon s'accroche au pan de son vêtement. Ses traits sont déjà accentués par l'âge. On a proposé d'y reconnaître Agrippa. Mais Agrippa était mort en l'an 12. La physionomie un peu lasse et rêveuse du personnage ne répond pas d'ailleurs aux traits énergiques et bien connus du collaborateur d'Auguste. La place occupée par cette figure conviendrait parfaitement à Agrippa ; ce n'est cependant pas Agrippa ; ce ne peut être Agrippa. Le personnage demeure inconnu. Peut-être une retouche du visage a-t-elle modifié son identité en faisant disparaître le portrait du bon administrateur héritier présomptif de l'empire.
A gauche de cette figure mystérieuse, séparée d'elle ou plutôt reliée à elle par le jeune garçon qui se trouve entre eux, une femme se drape coquettement dans son manteau. Elle aussi se présente de face, sortant presque du cortège ; le visage, de trois quarts, s'incline légèrement a droite, le regard semble s'abaisser vers le jeune garçon qui lève les yeux vers elle, en réalité il erre distraitement tandis que la bouche sourit de façon énigmatique. L'inconnu à la tête voilée, l'enfant et cette élégante jeune femme forment évidemment groupe. Cette belle et charmante matrone, qui a l'air de s'ennuyer un peu, n'est pas Livie. Livie serait plus âgée ; elle devait marcher en tête du cortège en compagnie d'Auguste. C'est Julie, la fille d'Auguste. Le jeune garçon, à côté d'elle, doit être Lucius César, le second de ses fils. L'aîné, Gaius, devait accompagner Auguste. En 13, Julie était bien l'épouse d’Agrippa. Le groupe des trois personnages qui semble se détacher si nettement de l'ensemble de la procession aurait formé, à ce moment, un charmant tableau de famille. L'inconnu aurait été évidemment Agrippa.
Mais dès l'an 11, veuve depuis quelques mois, Julie avait dû, par ordre de son père, épouser Tibère soupçonneux et jaloux. C'est bien le profil austère de Tibère que, sur la frise, on reconnaît derrière elle, la considérant fixement tandis qu'elle détourne la tête. Sans doute l'image de Tibère a-t-elle été rapprochée de celle de Julie avec laquelle elle forme véritablement couple; sans doute surtout, la direction du regard qui les unit a-t-elle été précisée, au moment même où quelques coups de ciseau faisaient rentrer dans l'anonymat Agrippa défunt ou lui substituaient quelque fonctionnaire sacerdotal inconnu de nous.
Quel contraste entre le groupe de Julie et de Tibère et celui qui le suit ! Tournés l'un vers l'autre et semblant se soucier assez peu de la cérémonie, une jeune femme et un jeune homme conversent gaiement, si bien qu'au second plan, une dame austère, étroitement voilée, mettant le doigt devant la bouche, les rappelle au silence religieux. De grande taille, solidement campé, le manteau militaire jeté sur l'épaule, l'homme présente un profil aimable qui n'est cependant pas sans ressemblance avec celui de Tibère. C'est son frère Drusus. Depuis l'an -12, il est entrain de conquérir la Germanie; il est revenu recevoir le triomphe à Rome, à la fin de l'an 10. Il va retourner sur les bords du Rhin pour une nouvelle campagne qu'il compte pousser encore plus loin dans l'inconnu que les précédentes. Et dans l'automne de l'an 9, à travers l’Italie consternée, Tibère rapportera à Rome les cendres du jeune général mort à trente ans des suites d'une chute de cheval sur les bords de l'Elbe. Devant lui, sur la frise, c'est Antonia, sa femme; elle tient par la main leur fils, un bébé de deux ans environ, assez embarrassé de sa petite toge, Germanicus, le futur vengeur de Varus, qui suivra au delà du Rhin, les traces de son père. Né en 15 avant Jésus-Christ, il devait avoir à peu prés cet aspect en juillet 13.
Une scène enfantine gracieuse suit ce tableau du bonheur conjugal. Un petit garçon de cinq ans environ a saisi le pan du paludamentum de Drusus, comme devant lui le jeune Licius César tient le vêtement du prêtre inconnu. Sa mère, dont le profil très pur occupe le second plan, le retient d'une main distraite, tandis que sa sœur aînée, derrière lui, lui adresse en souriant une observation qu'il reçoit très gravement. La mère ne peut être qu'Antonia l'aînée, femme de L. Domitius Ahenobarbus qui marche derrière elle et leurs enfants. Au second plan, le vieillard dont la silhouette apparaît entre les deux époux est probablement le père de Domitius. C'est toute la lignée de Néron que nous trouvons groupée ici.
La frise continue ainsi par une succession de personnages et de groupes profondément vivants. Chaque figure apparaît copiée de la réalité avec un soin attentif et minutieux; le costume, les traits, l'attitude sont vrais; chacun des portraits, chacun des groupes est en même temps une création de psychologie précisa et que l'on sent exacte. Des épisodes sentimentaux, le regard de Tibère sur Julie, la conversation d'Antonia et de Drusus, et de gracieuses anecdotes enfantines émaillent pour ainsi dire cette scène d'histoire. Une grande idée religieuse l'anime, indiquée par le costume rituel des flamines ou l'attitude des prêtres marchant la tête voilée, et rappelée de temps à autre par un détail, par la belle silencieuse interrompant un bavardage ou par la main de Domitius, levée la paume ouverte pour la prière. Cet art est plein de sens et c'est là son originalité. La pensée en est essentiellement concrète et positive; elle ne se perd pas dans un idéal suprasensible ; ces hommes, ces femmes, ces enfants, ne voguent pas comme les cavaliers du Parthénon dans une zone éthérée entre ciel et terre; leurs pieds reposent sur le sol, ils sont des êtres de chair, leurs formes sont celles d'individus humains bien ressemblants, leurs sentiments sont ceux de leur vie de tous les jours, ils transparaissaient à travers leurs traits, l'idée est une idée romaine, l'idée du moment que représente la frise, la piété envers les dieux de la cité que l'on remercie solennellement du retour du prince.
L'artiste romain a des yeux pour voir ; son esprit analyse la sensation, il en dégage les éléments et les ordonne, il ne s'élève pas au-dessus d'elle, il n'a pas d'élans vers un monde supérieur où l'individuel se fond dans l'idée, l'accident dans la loi. La réalité matérielle, voilà son domaine.
Nous n'avons pas à insister ici sur la maîtrise technique de ces frises et la science d'une composition très étudiée et extrêmement habile sous son apparente simplicité. Avec deux plans seulement, l'artiste est parvenu à donner l'impression de la profondeur ; il combine harmonieusement le jeu des lignes et desmasses, il distribue la variété des plis à travers les toges de laine blanche, les robes plus souples et les voiles légers, et sous l'ombre des cheveux couronnés de laurier il excelle à faire jouer à la lumière les traits et l'expression desvisages. Toute cette virtuosité est l'héritage de la Grèce ; l’art romain sait en faire un usage nouveau.
Ne quittons pas l'autel de la Paix sans jeter un coup d'œil sur la décoration florale qui ornait les pilastres, qui occupait tout le champ inférieur de l'enceinte, au-dessous des frises et en garnissait de guirlandes la face intérieure. C'estun ornement splendide, à la fois très riche et d'une élégante souplesse.
A l'extérieur, la décoration est plus stylisée ; la fantaisie de ses arabesques fait contraste avec le réalisme des frises. De lourdes touffes d'acanthe dont les feuilles inférieures retombent vers le sol, jaillissent les courbes aériennes de rinceaux aux volutes largement épanouies. Des tiges, se détachent des vrilles, des folioles, des fleurs et des fleurons, d'un dessin chaque fois différent et qui, dans la trame irréelle dés rinceaux, piquent de temps en temps la note naturaliste. L'ensemble est conçu dans un style très largement décoratif; les détails cependant y sont poussés avec un soin minutieux. Posés sur un bouton, des oiseaux aquatiques au long col sinueux déploient leurs ailes, des passereaux becquètent des fleurs, des lézards courent sur les tiges ; il n'est pas jusqu'à des moustiques qu'on ne voie voler sous les feuilles. Comme dans les scènes allégoriques et mythologiques, le réel anime l'idéal. Une matière solide, des choses vues et senties, viennent remplir le cadre savamment stylisé ; un souffle familier anime ces feuillages de fantaisie, une sève vivante nourrit la souplesse gracieuse des arabesques. On a beaucoup insisté, avec quelque exagération d'enthousiasme mais non sans un fond de justesse, sur la fine observation de la nature dont témoigne l'art romain. On a parte d'impressionnisme, d'illusionisme et d'art japonais. Laissons là ces généralisations ambitieuses et qui témoignent peut-être d'une attention insuffisante accordée aux antécédents très divers de l'art augustéen. Ce naturalisme décoratif que l'on observe en effet dans les monuments romains de l'âge impérial peut avoir ses origines à Alexandrie, la ville des fleurs et des fruits, tout aussi bien que dans la veine réaliste de l'esprit lutin. On l'aperçoit dans les guirlandes peintes qui ornent des séries de vases de terre cuite hellénistiques. Il triomphe dans la ciselure des vases de métaux précieux. Rien ne prouve sans doute que tous les exemplaires fournis par les trésors de Boscoreale et de Hildesheim soient de provenance alexandrine. Plusieurs d'entre eux sont même certainement italiens. Il n'en est pas moins vrai que la décoration florale dont i!s sont ornés semble bien s'inspirer de modèles alexandrins. Les Romains ont compris la beauté des fleurs et des feuillages soit stylisés, soit copiés au naturel, ils ne l'ont pas inventée. Contentons-nous donc de constater le développement à l'époque d'Auguste du décor végétal de style réaliste. En peinture, l'exemple le plus typique de ce genre est le panneau de la villa de Livie à Prima Porta, qui représente le bosquet d'un jardin avec ses espèces d'arbres différentes, ses fruits, ses oiseaux. En sculpture, on mentionnera en première ligne les lourdes guirlandes des faces intérieures de l'autel de la Paix. Chaque feuille, chaque fleur, chaque fruit, poire, figue, baie de laurier, pomme de pin, raisin, épis, y est travaillé pour lui-même avec un soin délicat et se reconnaît du premier coup d'œil, sans que cette exactitude fasse tort à l'effet décoratif. On peut examiner encore les rameaux de platane qui décorent un autel de la même époque, au Musée des Thermes. Ils sont traités comme des branchages réels posés sur le marbre. Chaque feuille a ses plis, les veines elles-mêmes en sont nettement visibles. Que la couleur vienne s'y ajouter, comme c'était le cas dans l'antiquité, l'illusion serait complète.
Il y avait à Rome, au temps d'Auguste, raconte Pline, un artiste nommé Possis qui avait pour spécialité de reproduire ainsi, en marbre, des fruits qui trompaient l'œil. Mais ce Possis était-il un Italien? Son talent, qui ne représente pas d'ailleurs le comble de l'art, pouvait n'être qu'une imitation de ce qui se faisait ailleurs, quelque part dans l'Orient hellénisé, à Antioche ou à Alexandrie. Des essais de ce genre pouvaient se trouver à la base de la décoration végétale de style strictement naturaliste qui apparaît dans la plastique romaine à l'époque d'Auguste et qui avait fourni l'ornement des parois internes de l'Ara Pacis. N'oublions pas d'ailleurs que sur la face extérieure de ces mêmes parois, l'ornement réaliste n'est que clairsemé dans une décoration extrêmement stylisée.
Ni dans la décoration, ni dans les scènes historiques, ni dans le portrait, les Romains n'ont inventé le réalisme. Ils se sont contentés de l'utiliser et lui ont prêté un développement nouveau.
Cette tendance de l'art hellénistique coïncidait en effet avec l'une des traditions de l'art populaire tel qu'il subsistait dans le menu peuple et dans les provinces italiennes. En Italie, comme d'ailleurs dans la plupart des pays à l'esprit simple et peu cultivé, on avait toujours aimé les portraits ressemblants, les scènes représentant des faits observés, les ornements rappelant à s'y tromper l'ornement naturel. Le bon sens populaire tend généralement à bien comprendre ce qu'il voit et à voir ce qu'il comprend. Comme la littérature nationale de Virgile et de Tite-Live, l'art augustéen s'adresse, par delà les petits cénacles et les connaisseurs raffinés, à un public plus large, aux couches nouvelles de population qui viennent prendre la place de l'ancienne aristocratie décimée par les guerres civiles. Il accorde donc la préférence au style le moins savant, le moins abstrait, à celui qui conserve le plus d'éléments sensibles et se trouve, par là même, le plus immédiatement et le plus généralement intelligible. Par le réalisme, l'art romain sort de l'école et des écoles, il devient un art pour tout le peuple. En face du dilettantisme et des raffinements de la période républicaine finissante, il présente un aspect plus robuste, plus plein et qui semble plus sain. Il apparaît comme une réaction du goût national contre l'exotisme autrefois prépondérant. Il devient ainsi la forme qu'adopte le plus habituellement l'art officiel de l'empire. Des exemples comme celui des frises de l'autel de la Paix ont dû, plus que toute autre chose, contribuer à la diffusion de ces nouvelles tendances artistiques. Leur style a bénéficié, en quelque sorte, de la consécration attachée au souvenir du fondateur de l'empire et a été regardé comme le plus adéquat à l'idéal politique et religieux du temps. En réalité l'idéal augustéen ne comportait en lui-même aucune théorie esthétique. Auguste accordait une égale faveur aux diverses formes d'art recueillies par Rome sur tous les rivages de la Méditerranée ; nous voyons tous les genres poursuivre sous son règne, et souvent sous sa protection, leur évolution normale. L'étude des grands camées, de celui du triomphe d'Auguste, à Vienne, et de celui du triomphe de Tibère à la Bibliothèque nationale à Paris, trouverait, dans l'image des princes héroïsés, le souvenir assez net de l'art alexandrin et, dans la composition des scènes elles-mêmes, la trace évidente de souvenirs asiatiques pergaméniens. Sur l'autel de la Paix même, à côté des grandes frises réalistes, les panneaux placés de part et d'autre des portes nous présentent des allégories et des compositions mythologiques d'un style tout différent. Dans la statue d'Auguste également, et parmi les reliefs qui en décorent la cuirasse, l'idéalisme et les motifs conventionnels de l’art hellénistique se mêlent aux traits d'une exactitude réaliste.
Mais dans toutes ces œuvres, des camées à la cuirasse d'Auguste, les allégories et les créations de l'imagination expriment des idées et des sentiments proprement romains. Nous y voyons les motifs et les formules de l'art hellénistique adaptés à la glorification de l'empereur et de sa famille, à celle de Rome et de l'Italie aussi bien qu'à la représentation des légendes nationales romaines ou à l'expression des espoirs que suscite la paix romaine se levant sur le monde.
L'art augustéen, en somme, ce n'est pas un style particulier; ce n'est que dans une mesure restreinte une création nouvelle ou une résurrection des traditions anciennes de l'art italien. Ce n'est ni le pur réalisme ni l'idéalisme. C'est l'adoption définitive par Rome des tendances esthétiques diverses éparses à travers le monde méditerranéen. Les motifs, les formes, la technique, tout l'extérieur de l'art ne représente que l'héritage du monde hellénistique. Mais l'idée impériale infuse à cette tradition une âme proprement romaine qui devient le principe d’une vie nouvelle.
CHAPITRE V
LA RELIGION IMPÉRIALE
Saint Augustin nous a conservé un mot profond du grand pontife Mucius Scœvola que Cicéron avait connu dans sa jeunesse. « II y a, déclarait ce représentant officiel de la religion romaine, trois espèces de religions : celle du poète, celle du philosophe et celle de l'homme d'Etat. Les deux premières sont ou bien futiles ou superflues ou même nuisibles ; il conviant de les rejeter; la dernière seule doit être acceptée (1). » Nous trouvons là la formule parfaite de la tradition politique romaine en matière religieuse. Les dieux sont faits pour servir l'Etat. C'est bien ainsi que l'entendait Auguste. La restauration religieuse qu'il s'efforça d'accomplir fut essentiellement politique.
La religion du poète n'était qu'imagination et fantaisie grecque. Jamais elle ne produisit floraison plus exubérante qu'à la fin de la République dans la littérature et dans l'art inspirés par le monde hellénistique. Elle se perpétua durant tout l'empire et jusqu'après le triomphe du christianisme. Mais elle ne comportait ni croyance ni sentiment et ne fournissait rien qui pût intéresser la pratique.
La religion du philosophe, celle du Lucrèce, celle de Cicéron devait exercer une action plus profonde. Elle s’adresse à l'intelligence ; sa part grandit à mesure que se développe la culture intellectuelle.
(1) De Civ. Dei, 4; 27.
Elle tend à l'interprétation rationaliste des vieilles conceptions mythiques, elle se plie aux opinions individuelles ; elle varie chez le même homme suivant les circonstances de la vie (1). En fait, elle aboutit le plus souvent, à l'égard des dieux de la cité, si non à la négation absolue, du moins au scepticisme et à l'indifférence. « Je voudrais bien », confie Cassius à Brutus, à la veille de la bataille de Philippes, «qu'il y ait des dieux afin que nous ayons confiance non seulement dans nos armes mais dans la justice de notre cause » (2). Ni Cassius ni aucun de ses contemporains ne se trouve bien convaincu de l'existence des dieux, ou du moins cette conviction est-elle trop vacillante pour influer sur l'action.
La religion officielle cependant existe toujours. Ses prêtres continuent, lorsqu'ils n'en sont pas détournés par la vie politique, à s'acquitter régulièrement de leurs fonctions. Les rites ne subissent pas d'interruption. L'esprit même du collège pontifical ne se trouve ni modifié ni élargi. Le vieil exclusivisme dont l'affaire des Bacchanales avait fourni un exemple tragique manifeste même quelques réveils inattendus. Quatre fois, entre les années 58 et 48, le Sénat proscrit à Rome le culte d Isis (3). Vains efforts : l'âme du peuple se détourne des cultes pratiqués en son nom par 1'Etat ; les anciens dieux, les vieux temples ne retiennent plus de fidèles. Varron exprime la crainte de voir périr tous les dieux romains, non du fait de l'ennemi, mais par la négligence des citoyens (4).
Conformément à la tradition aristocratique des Pontifes Scaevola n'oublie qu'une chose, ce sont les besoins religieux du peuple. Poètes, philosophes, hommes d'État même, ne représentent que le petit nombre qui sait exprimer sa pensée et qui cherche à y conformer ses gestes et ses actes.
(1) Chez Cicéton, par exemple.
(2) plut., Brut., 42.
(3) lafave, XCI, p. 41 sq.
(4)Aug., De Civ. Dei., 6, 2 ; Antiq. Div. (Aghad), 141.
Le peuple, en fait de religion, ce n'est pas seulement la masse illettrée des plébéiens, mais aussi tous les demi-lettrés et tous ceux pour qui la spéculation abstraite ne représente dans la vie que l'accessoire, depuis l'esclave jusqu'au chevalier qui commerce dans tout le monde méditerranéen, depuis le soldat jusqu'au général, depuis le paysan jusqu'au sénateur qui administre son bien et fait delà politique. Tous ont désormais d'autres intérêts que ceux de l'Etat, intérêts pour lesquels ils éprouvent le besoin d'une protection divine. Ils s'adressent sans doute aux dieux pleins de promesses de l'étranger. Mais ils ont aussi chez eux, dans leurs maisons et sur leurs champs, des dieux qu'ils connaissent, qu'ils invoquent, qu'ils redoutent ou qu'ils aiment. Entre la religion individuelle des penseurs et le culte officiel, une religion populaire recueille les imaginations simples, les traditions pieuses, la ferveur et les émotions naturelles à l'homme devant l'inconnu. Elle forme la couche profonde qui même chez les plus cultivés affleure toujours en quelque point. C'est sur cette religion populaire qu'Auguste appuiera, au moins en partie, sa restauration nationale.
I
la RELIGION POPULAIRE.
La forme et la vivacité de ce sentiment religieux nous sont révélés surtout par la découverte récente, à Délos d'un certain nombre de monuments du culte familial provenant de la colonie romaine établie dans cette île durant la première moitié du Ier siècle avant notre ère. Ces modestes monuments concordent, d'une façon générale, avec les renseignements que nous fournissent bon nombre des peintures de Pompéi qui ne datent, en majeure partie, que du premier siècle après notre ère et se trouvent postérieures par conséquent à la restauration augustéenne. Ils forment ainsi comme l'un des anneaux de la chaîne qui relie la religion de l'époque impériale à celle des siècles anciens de Rome; ils prennent à ce titre un intérêt tout particulier.
Dans la plupart des maisons habitées par les Romains à Délos, nous trouvons, comme à Pompéi, l'autel familial orné ou entouré de peintures représentant un culte qui n'est pas grec et que nous avons toutes raisons de rattacher aux plus anciennes conceptions religieuses de l'Italie. L'autel se trouve à Délos devant la porte, tandis qu'à Pompéi il ne se rencontre qu'à l'intérieur de la maison. Au-dessus, dans la paroi, se voit souvent un petit abri voûté destiné à protéger le feu du sacrifice. Sur l'enduit qui recouvre l'autel, ou sur le mur de la maison, de part et d'autre de l'autel, des peintures représentent la cérémonie célébrée en l'honneur du Génie du père de famille, des Pénates et des Lares. Elles perpétuent pour ainsi dire le sacrifice et, en le rendant permanent, lui donnent une vertu continuellement efficace. Lorsque la couleur s'atténue et tend à s'effacer, on a soin de la renouveler. De nombreuses couches superposées, que l'on a réussi parfois à détacher les unes des autres, indiquent l'attention apportée à maintenir toujours fraîches ces images rituelles?
Entre des guirlandes peintes qui encadrent la scène, nous voyons, escorté de tous les siens, le père de famille qui, le pan de sa toge ramené sur la tête, fait libation devant l'autel. En face de lui, un joueur de flûte accompagne la prière. Parfois à Délos et plus peuvent à Pompéi, deux serpents sont peints au-dessous de la scène et semblent ramper vers l'autel comme pour y recueillir les offrandes. L'un des deux a généralement une crête sur la tête et une sorte de barbiche au menton, l'autre est démuni de ces attributs. On y reconnaît la figuration naïve du Génie du paterfamilias et de la Juno de la materfamilias, confondus avec les esprits des ancêtres qui veillent sur la maison. Ces peintures du premier siècle ayant et après notre ère représentent la célébration de ce très ancien culte familial issu de la divinisation des diverses parties de la maison, du foyer où brûle le feu, de l'armoire aux provisions, penus sur laquelle veillent les Pénates, du chef qui commande et qui, héritier des parents descendus sous terre, assure la perpétuité de la race. Cette religion familiale est donc demeurée vivante dans lafamille romaine.
Aux divinités du foyer, les peintures de Délos et de Pompéi associent couramment celles de la terre sur laquelle s'élève la maison, les Lares. Les Lares sont les dieux du dehors, tandis que les Pénates sont ceux de l'intérieur. Leur domaine, à la ville, c'est la rue et la place publique ; à la campagne, les champs, les chemins et les carrefours. Là s'élèvent leurs autels ou leurs sanctuaires modestes. Ils protègent les serviteurs, les
esclaves et tous ceux qui, étrangers par le sang et exclus par des cultes du foyer, n'en font pas moins partie de la familia,
A côté du sacrifies aux Pénates, sur les faces latérales des autels de Délos ou sur le mur de la maison à côté de l'entrée, se trouvent figurées les cérémonies du culte des Lires. On leur sacrifie un porc, tandis que le menu peuple en liesse se livre à ses jeux « de vilains », boxe et lutte, dont les prix seront les jambons du porc sacrifié et des amphores de vin.
Les Lares sont des dieux accueillants et sans préjugés. Autour de leurs autels des carrefours ils groupent tous les vagabonds, tous ceux qui n'ont pas de famille, pas de foyer, pas de culte propre. Leurs humbles clients s'associent pour les fêter de leur mieux, ils se constituent à cet effet en collèges de carrefours, collegia compitalicia. Plusieurs inscriptions de Délos mentionnent des competaliastes, sans aucun doute présidents ou dignitaires de ces congrégations joyeuses. Durant les guerres civiles, les fauteurs de désordre eurent beau jeu à transformer en bandes à leur solde ces dévots de la rue et de la place publique. Les collèges de carrefours apparaissent ainsi, un instant, à la lumière de l'histoire. Interdits en 64,ils furent quelques années après restitués légalement par le tribun Clodius, l'ennemi de Cicéron. César les abolit de nouveau. Nous allons les retrouver plus vivaces que jamais sous l'empire.
Diverses divinités apparaissent encore, à Délos et à Pompéi, associées au culte familial. C'est, en première ligue, la Fortune, très souvent unie à Mercure porteur du caducée et de la bourse et accompagné d'animaux tels que le coq, le chien, la tortue. C'est aussi Hercule. Mercure, le dieu du commerce, Hercule, celui de la force physique et de tous les travaux bienfaisants, sont les patrons professionnels des petits commerçants, boutiquiers et artisans qui constituent la population des villes. Tous invoquent aussi la Fortune qui doit veiller sur la prospérité de leurs affaires. Plusieurs inscriptions de Délos nous font connaître des collèges d'hommes libres ou d'affranchis groupés sous l'invocation de dieux tels que Hermès, Apollon, Poséidon : Hermaïstes, Posidoniastes, Apolloniastes, groupements professionnels, bien évidemment, de marchands, de gens de mer et d'artisans. Ces inscriptions se trouvent groupées en certaines places publiques où le collège semble avoir possédé un autel ou un petit sanctuaire. Dans les villes antiques, comme dans celles du moyen âge, les divers corps de métier paraissent s'être trouvés souvent localisés en un quartier dont le dieu protecteur de la profession aurait été le patron. Le père de famille membre d'un de ces collèges introduisait à son foyer domestique en l'associant à ses Pénates le dieu de son gagne-pain. Il s'unissait en outre aux autres membres de sa corporation pour l'honorer en public au sanctuaire de son quartier. Ces dieux, dont les inscriptions et les peintures de Délos nous indiquent le rôle, dès le premier siècle avant notre ère, Mercure, Hercule, Apollon, la Fortune, sont encore ceux que, sous l'empire, nous retrouvons le plus honorés en Italie et dans les provinces. Ils apparaissent notamment sur les autels des rues et des places publiques et semblent souvent avoir donné leur nom aux rues ou aux quartiers des villes.
Les cultes de la maison, ceux de la rue et ceux des champs, les dieux de la famille, de l'agriculture et des métiers, les simples protecteurs de la vie journalière et du travail sont donc demeurés vivants. Ils n'ont pas de théologie, leur horizon est limité, ils ne s'inquiètent ni de ce qui a pu précéder, ni de ce qui peut suivre la vie, ni des phénomènes du monde et encore moins de ceux du ciel. Leur être ne répond qu'à des pensées simples et primitives; ils protègent l'homme dans son activité la plus humble, ils lui procurent la santé, la prospérité, l'abri d'un toit, le bonheur d'une postérité et la joie des jours de fêtes.
Ils sont bienveillants, ils sont familiers et ils sont gais. Ce sont les dieux d'une terre douce, d'un peuple positif et sans envolée, mais laborieux et d'un esprit essentiellement sain. On ne les redoute guère, mais on les aime et on leur reste fidèle. Ils ont offert au christianisme une résistance plus efficace que Jupiter. C'est contre eux spécialement que fulmine un article du Code théodosien interdisant « d'entretenir le feu en l'honneur des Lares, de faire la libation de vin au Génie, d'offrir des parfums aux Pénates, d'allumer des lampes, de brûler de l'encens, de suspendre des guirlandes autour de leurs autels » (1).
Lacité primitive a grandi jusqu'à englober tout le monde méditerranéen, mais en étendant son empire Jupiter du Capitole, le plus grand et le meilleur de tous les Jupiters, a perdu son action sur les âmes et jusqu'à sa personnalité. Il n'est plus qu'un symbole d'orgueil et de domination auquel les magistrats rendent mécaniquement des honneurs officiels. Il se confond, à Rome même, avec les grands dieux de l'étranger, avec Zeus grec, avec Serapis égyptien, Sabazios asiatique; c'est en vain; ces contaminations et ces transfusions ne raniment pas sa vie. Faîte pour une ville et son canton, son image se perd dans l'horizon trop large et trop scintillant d'idées de la Méditerranée et de ses lointains rivages.
Capitale d'un grand Etat, Rome a ses philosophes et ses poètes qui ont répandu parmi la classe dominante à laquelle les conquêtes ont procuré richesse et loisirs, les idées et les imaginations fruits des réflexions ou des fantaisies de toute l'humanité. A côté d'eux des hommes et des prêtres des nations les plus diverses ont appris aux demi-lettrés, aux femmes surtout, à sentir le mystère de la vie et à se préoccuper de leur félicité personnelle par delà la vie. A l'angoisse qu'ils éveillaient ils offraient le baume de contes enfantins et de rites dont le mystère et l'exaltation sensuelle faisaient l'attrait. Mais hors des écoles et des lieux de réunions mondaines, hors des petits temples et des réduits où s'assemblent les adeptes des dieux de mystère, dans les maisons et les rues de la ville comme dans l'immensité des campagnes, la vie du peuple se poursuit suivant le rythme ancien. Elle est demeurée presque insensible aux transformations politiques qui n'ont guère modifié ni l'état social ni les conditions économiques. Le cadre traditionnel de la famille subsiste.
(1) Cod. Theod., 16, !0, 20.
Pour vivre, les hommes labourent la terre comme ils le faisaient jadis, ils travaillent de leurs mains, ils commercent dans d'humbles boutiques. Les dieux anciens de leur activité inchangée ont conservé toute leur raison d'être. Telle est leur vitalité que, loin de céder devant les cultes étrangers, ils suivent leurs fidèles jusque dans les terres nouvelles où ils s'établissent et qu'avec les, artisans et marchands italiens, ils multiplient leurs autels jusque dans l'île sacrée d'Apollon délien.
Sous le revêtement brillant mais superficiel de la vie intellectuelle cosmopolite, sous la couche plus médiocre du mysticisme gréco-oriental compliqué de magie et d'astrologie, n'oublions pas la vie profonde et puissante des masses populaires italiennes. L'histoire, tout aristocratique et politique, neleur a guère prêté attention. Elles ont vécu en effet hors de l'histoire, pour ainsi dire, contentes seulement de vivre sous un ciel heureux, sur une terre qu'elles aimaient. Il leur suffisait de quelques idées très simples héritées des ancêtres et de quelques rites familiers qui leur procuraient confiance et joie. Race fidèle et courageuse que n'agite aucun tremblement devant l'inconnu, qui, au fond, s'en soucie peu, elle a, sous l'afflux des pensées et des imaginations méditerranéennes, perpétué les conceptions originales et les gestes religieux des plus anciens maîtres de la terre italienne. C'est au feu non éteint de ses humbles autels que se rallumera la religion de Rome impériale.
II
LA PENSÉE ET L'OEUVRE RELIGIEUSE D'AUGUSTE.
Par tempérament, Auguste lui-même semble avoir été foncièrement religieux. Nerveux et impressionnable à l'excès, il pousse la crainte des dieux jusqu'à la superstition. Il éprouve de la foudre une peur maladive. Pour s'en protéger, il ne quitte pas une amulette de peau de veau marin et, au moindre orage, se réfugie dans un réduit voûté (1). Les auspices et les présages de toute sorte lui sont sacrés, il en tient scrupuleusement compte; il partage à cet égard toutes les idées du moindre des citoyens de la petite ville de Velletri, sa patrie. Suétone insiste longuement sur ce trait de son caractère et en relate de nombreux exemples. Les prodiges et leur observation jouent un rôle considérable dans sa vie.
Une tendance mystique le porte à adopter toutes les croyances qui dépassent l'entendement. Il est un fervent de l'astrologie et professe le plus grand respect pour Nigidius Figulus, philosophe et mage, qui depuis le temps de Cicéron a contribué plus que tout autre à répandre ces doctrines dans la haute société romaine. Nigidius n'avait-il pas tiré son horoscope et, dès le jour de sa naissance, prédit sa grandeur future? Cet horoscope, Auguste le fit publier officiellement, pour couper court sans doute aux fausses prédictions que l'on faisait courir sur son compte. Il n'en témoignait pas moins par là de l'importance qu'il accordait à toutes ces imaginations. Il fit frapper, ajoute Suétone, une monnaie d'argent au signe du Capricorne sous lequel il était né. C'est le Capricorne que nous voyons figurer au-dessus de sa tête sur le grand camée de Vienne qui le représente trônant à côté de Rome dans une gloire héroïque.
Nigidius Figulus n'était pas seulement astrologue, il était aussi pythagoricien. Or, depuis l'époque de Cicéron et surtout sous le règne d'Auguste, nous assistons à une renaissance de la doctrine pythagoricienne mélangée de platonisme et qui colore de mysticisme le panthéisme stoïcien. C'est le pythagorisme qui répand la croyance à la vie future et qui, surtout, prête une forme à cette croyance (2).
(1) suet., Aug., 90.
(2) Le sixième chant de l’Enéide est tout imprégné des doctrines pythagoriciennes.
L'âme vit dans les enfers en attendant sa réincarnation. Elle y est soumise à diverses purifications. Ses retours sur la terre constituent de nouvelles épreuves ; la qualité de la matière qu'elle est appelée à animer, végétale, animale, humaine et le sort même de l'individu qu'elle contribue à former, dépend de sa pureté. La vie n'est donc que la préparation d'autres existences. Elle ne représente qu'un moment de l'être; tout, dans ce moment, doit être sacrifié à l'avenir infini qui nous attend (1). Et la doctrine abonde de préceptes ascétiques tendant à assurer la constante pureté de l'âme. Deux philosophes surtout représentent sous Auguste l'école pythagoricienne, Sextius père et fils. Ils tiennent école pratique de vertu et prêchent avec un succès éclatant la sincérité, la tempérance, la frugalité, le végétarisme (2). Le mysticisme, par eux, devient le principe d'un puissant mouvement de puritanisme qui achève de lui conquérir toute la faveur du prince.
Que les tendances religieuses d'Auguste aient été profondément sincères, on n'en saurait douter. Qu'elles aient été confirmées par une intention politique paraît aussi évident. Auguste voit dans la religion un des éléments essentiels de la tradition romaine et, volontairement, il conforme son attitude à celle des anciens magistrats romains. Comme eux, par exemple, il établit une distinction foncière entre les cultes officiellement consacrés par l'usage romain et les innovations; il témoigne aux premiers un profond respect ; il dédaigne les autres. Il s'était fait, à Athènes, initier aux mystères d'Eleusis mais, en Egypte, il avait refusé de voir le bœuf Apis et il félicite son petit fils voyageant en Judée de s'être abstenu d'offrir des supplications au temple de Jérusalem (3).
Rien de plus naturel donc chez lui que l'idée de rétablir la paix des dieux et d'assurer par elle à la fois son pouvoir et la prospérité de Rome.
(1) ovide, Metam., 15, v. 75 sq.
(2) sen., Epist., 73, 15 ; 108, 17. Nat. quaest., 7, 32, 2.
(3)SUET., Aug., 93.
Bon courtisan, Horace exprime l'idée du maître, semble-t-il, plutôt que la sienne propre lorsqu'il menace les Romains de porter la peine de l'impiété de leurs pères tant qu'ils n'auront pas restauré les autels des dieux, leurs temples qui tombent en ruine et leurs images défigurées par la fumée noire. Auguste en effet s'impose la tâche de remettre en état les temples délabrés de Rome. Il se fait gloire, dans son Testament, d'en, avoir réparé quatre-vingt-deux. Tite-Live lui décerne le titre de fondateur et restituteur de tous les temples. Pour imposer le respect de la religion il s'applique, en même temps, à relever la dignité des fonctions sacerdotales qui devront désormais être réservées aux sénateurs et aux chevaliers. S'il avait eu lui-même, proclamait-il, une fille remplissant les conditions voulues, il aurait été fier d’en faire une vestale. Après avoir reconstruit le temple de Vesta, il en installe les prêtresses dans la Regia, II tient à honneur de faire partie lui-même de la vieille confrérie des Arvales dans laquelle il fait entrer les princes de sa famille. La procession primitive des Luperques était tombée en désuétude; il en rétablit l'usage. Il renouvelle chaque année, sous leur plus ancienne forme, les cérémonies de l'alliance avec les Latins. Il unit en somme le traditionalisme archaïsant de sa politique àla crainte des dieux. Comme dans la célébration des Jeux séculaires, il chercha à émouvoir le peuple par l'éclat de: pompes religieuses officielles et à l'associer tout entier à ce renouveau de la vieille religion.
Reconnaître les dieux pour maîtres, proclame Horace, c'est assurer l'empire de Rome.
Dis te minorem quod geris imperas.
C'est aussi assurer le pouvoir de leur restaurateur. Aussi Auguste prend-il soin de consacrer par un présent aux dieux chacune des étapes de sa carrière politique. Vengeur de César, il élève un temple à Mars Ultor. Vainqueur à Actium il met le nouvel ordre de choses sous la protection d'Apollon qui reçoit un temple au Palatin à côté du palais que se construit le prince. En face du Capitole, la colline de Romulus devient ainsi comme la nouvelle acropole de Rome impériale. Elle restera la colline des empereurs.
Le respect de la forme, particulièrement en matière religieuse, fait attendre à Auguste la mort de Lépide, en 12 avant Jésus-Christ, pour s'emparer du souverain pontificat. Mais, une fois grand pontife, il reprend dans toute sa rigueur la tradition du collège. En restaurant la religion officielle, il veut la débarrasser de la superstition qui l'étouffé. A cet effet, comme jadis après les guerres puniques, il poursuit les recueils de prophéties et les rituels non autorisés par l'État. Il en ramassa, nous dit-on, plus de deux mille qu'il fit brûler solennellement. Mais il retint soigneusement les livres sibyllins, en faisant, il est vrai, un choix parmi leurs oracles. Ceux qu'il conserva, il les fit déposer dans la base de la statue d'Apollon Palatin (1). Il les avait ainsi sous sa garde, presque sous la main. Avec le collège des quindécemvirs qu'il présidait, il était assuré d'y trouver la solution, satisfaisante pour lui-même, de toutes les difficultés qui pouvaient se présenter.
L'influence du chef de l'Etat et son exemple détermine certainement, au moins dans les classes moyennes qui ne prétendent guère, généralement, à l'autonomie de leur pensée religieuse et se montrent assez disposées à suivre en cette matière les courants directeurs de la mode, un retour vers les pratiques anciennes du culte national. C'était là comme une manifestation de loyalisme au régime politique qui assurait la paix et le bien-être. Cette piété nouvelle était aussi une réaction contre le rationalisme et les conceptions philosophiques touchant la divinité.
(1) suet-, Oct., 32 ; tac., Ann., 6, \2.
Horace l'indique très nettement : « Je ne prodiguais pas mes offrandes aux dieux, je ne fréquentais guère leurs autels, égaré que j'étais par l'assurance d'une sagesse insensée ; aujourd'hui, il me faut virer de bord et faire voile en arrière. » Jupiter et Mars et Apollon et tous les dieux grands et petits retrouvent donc des fidèles qu'à sa suite leur ramène le prince. Combien de temps les garderont-ils ?
C'était de la part d'Auguste une entreprise paradoxale que de ressusciter la piété pour une religion essentiellement politique chez le peuple qu'il excluait de la vie politique. Il était d'esprit trop avisé pour ne pas s'en apercevoir. Aussi n'est-ce pas seulement dans le passé qu'il va chercher ses moyens d'action. Il se garde de négliger les formes encore vivantes du sentiment religieux. A côté des cultes officiels, il s'efforce de constituer officiellement les cultes populaires et de les associer à la religion d'Etat. Sa restauration se double d'innovations destinées à mettre la tradition en harmonie avec le présent.
C'est ainsi en particulier qu'il rappelle à l'existence les associations cultuelles des carrefours, dissoutes autrefois comme éléments de trouble. Epris d'ordre et d'organisation, il veut grouper leurs forces éparses et les utiliser. Il soumet leur indépendance aux faveurs et aux obligations d'une institution régulière.
Cette importante réforme apparaît comme la conséquence de la réorganisation municipale de Rome. En l'an 7 avant notre ère, Auguste divise la ville en quatorze régions et chacune de ces régions elles-mêmes en quartiers, vici. A chaque quartier il donne pour centre un autel des Lares autour duquel il réorganise un de ces collèges qui s'étaient autrefois constitués spontanément. Mais aux Lares du vicus il fait ajouter le Génie du prince, chef et père commun de tout le peuple de la ville. Cette admission officielle du génie d'un homme et d'un homme vivant parmi les Lares n'a rien de nouveau ni d'étrange pour la conception religieuse romaine. A Délos, comme à Pompéi, nous trouvons couramment le genius du père de famille et la Juno de la maîtresse de maison, associés autour de l'autel familial aux Pénates et aux Lares. C'est, de la part des membres de la famille, des serviteurs et des clients, le témoignage habituel de leur dévouement et de leur reconnaissance au patron qui les fait vivre. Il était naturel que hors de la maison, dans les rues de la ville, les artisans, affranchis et esclaves, honorassent comme le père de l'immense famille populaire le prince auquel ils devaient leur prospérité et qui comblait d'ailleurs leurs associations de cadeaux. L'idée leur en fut suggérée sans doute officiellement; rien ne s'opposait à ce qu'ils l'adoptassent d'enthousiasme. Bien avant l'an 7, Horace ne montrait-il pas déjà le paysan d'Italie ajoutant l'image d'Auguste à celles de ses dieux domestiques?
Il t'invoque comme un dieu tutélaire, il te prodigue les prières ; en ton honneur il fait couler le vin pur de ses patères ; aux Lares il mole ton nom comme la Grèce célèbre la mémoire de Castor et du grand Hercule.
Le culte du Génie d'Auguste à l'autel des Lares n'est que la forme religieuse de l'affection du peuple à la personne du prince.
Le culte populaire des Lares devient ainsi une institution administrative ; les présidents des collèges apparaissent désormais avec les prérogatives et le costume de fonctionnaires sacerdotaux et municipaux : ils sont les chefs réguliers du quartier et s'en trouvent très fiers. Leur fonction consiste non seulement à organiser les fêtes religieuses à l'autel de leur vicus, mais aussi à prêter leur concours aux recensements, à faire la police et à combattre les incendies. Les nombreux monuments, autels sculptés et inscriptions qui nous restent du Culte des Lares augustaux ou des Lares et du Génie d'Auguste, nous indiquent combien il fut florissant.
III
le culte de rome et d'auguste.
Ce n'est pas seulement à Rome et en Italie, c'est dans tout l'empire que la religion impériale trouve l'inspiration de nouveaux cultes. La Grèce créatrice de mythes, l'Asie surtout, oùla forme religieuse domine les idées, prennent une part active à la vie morale et intellectuelle de Rome. Malgré l'orgueil romain et la réserve dédaigneuse d'Auguste à l'égard des cultes exotiques, il était inévitable que la pensée orientale, si puissante sur la religion privée, exerçât également une influence sur celle de l'Etat. C'est l'Orient en effet qui apporte un couronnement original à la restauration entreprise par Auguste. Le temple conçu sur un plan traditionnel, rebâti attentivement des matériaux anciens, reçoit à son fronton l'image divinisée de Rome et d'Auguste. La capitale et le maître du monde sont conçus comme des dieux et ce mythe, si contraire au vieil esprit latin, devient comme le symbole nouveau de la religion impériale.
Personnifier une idée abstraite comme l’Honneur, la Vertu, la Victoire est un des procédés courants de l'esprit grec. Prêter forme humaine à une entité telle qu'une province ou une ville n'est qu'une des manifestations de l'anthropomorphisme qui a façonné la religion grecque. Les Romains ont adopté ce type de représentations sitôt qu'en Campanie ils se sont trouvés directement en contact avec les provinces hellénisées de l'Italie. Dès la première moitié du III ème siècle avant notre ère, Rome apparaît sur les deniers romano-campaniens sous forme d'une figure féminine héroïsée. L'enthousiasme des Grecs libérés associe, en 195, Rome à Zeus lui-même et, dès l'année suivante, Smyrne élève à la nouvelle déesse un premier temple. L'idée de voir une divinité dans la ville conquérante et de l'honorer comme telle se propage rapidement en Asie. Plusieurs villes instituent des jeux en son honneur comme on le fait en l'honneur des dieux. Les Romains laissent faire : leur orgueil s'étonne à peine de celte flatterie. A Délos, une statue de Rome paraît remonter au I er siècle avant notre ère. Dans l'île où se rencontrent à ce moment l'Orient et l'Occident on peut se demander si Rome fait figure de déesse ou si son image n'est qu'une simple personnification. Mais l'Asie tout entière et Athènes elle-même s'habituent à considérer comme une divinité la ville dont la puissance abat les royaumes et régit au loin les peuples.
L'Orient divinise tous ses maîtres. Alexandre s'y est laissé faire dieu. Ses successeurs l'ont imité. César à Alexandrie ne voit aucun inconvénient à se laisser proclamer dieu fils de dieu ; Antoine après lui est pour ses sujets orientaux un nouveau Dionysos. Octave lui-même, lorsque après Actium il séjourne en Egypte et parcourt l'Asie, y revêt un tout autre personnage qu'à Rome. Maître par sa victoire, il apparaît aux peuples comme un dieu plus puissant que tous ceux qu'il a vaincus. Ses portraits exécutés à ce moment en Orient nous le montrent comme le successeur des diadoques, portant comme eux soit le bandeau orné de pierreries, soit le diadème radié qui sont les insignes de la royauté divine. Ces attributs, bandeau et diadème n'apparaissent sur aucun de ses portraits romains. En Orient, il est roi et dieu ; à Rome, il ne veut être que le premier magistrat de la République et l'imperator, général victorieux. En Asie, ses sujets lui élèvent des temples; un refus ne serait pas compris. Il se contente de poser comme condition que son culte soit associé a celui de la déesse Rome et qu'aucun Romain ne soit admis à y prendre part. Les provinces d'Occident ont à cœur de rivaliser avec celles d'Orient. Leur zèle, hommage spontané des vaincus au vainqueur, deviendra pour Rome un instrument de règne.
Un autel de Rome et d'Auguste s'élève ainsi tout d'abord à Terragone. En 12 avant Jésus-Christ a lieu l'inauguration de celui de Lyon, qui groupe les représentants de tous les peuples de Gaule. Un Gaulois est le grand prêtre de cette religion, étrangère à Rome mais qui symbolise la puissance romaine et la forme nouvelle de l'empire du monde. Lorsque Auguste put croire la Germanie conquise jusqu'à l'Elbe et qu'il voulut en faire une province romaine, le signe de cette union fut l'édification chez les Ubiens d'un autel de Rome et d'Auguste, desservi par le plus noble des Germains acquis à la cause romaine. L'autel des Ubiens, auprès duquel s'éleva Cologne, devait être la capitale de la Germanie romaine. C'était là le véritable culte politique du nouvel empire, le lien religieux entre la métropole et les provinces, le signe de communion spirituelle entre les peuples divers fondus dans la paix romaine.
Mais à Rome, ni Rome ni Auguste ne sont des divinités. La tradition romaine s'oppose à de telles confusions. Le surnom d’Auguste, qui devient comme le nom du prince, le rapproche sans doute des dieux, sans l'assimiler cependant à eux. « C'est avec Jupiter, dit Ovide, que César partage son nom. Nos pères appelaient augustes les choses saintes ; augustes étaient les temples consacrés suivant les rites par la main des prêtres.» La personne du prince et son pouvoir sont choses saintes, c'est-à-dire consacrées à la divinité et agréées par elle, elles ne sont pas choses divines. La flatterie et l'influence des modes de penser orientaux tendent, dès le règne d'Auguste, à effacer cette distinction. Le pouvoir impérial, en effet, tel qu'il est en réalité, c'est-à-dire la concentration entre les mains d'un seul homme de l'autorité suprême, représente la transposition à Rome de la royauté orientale dont la divinité est l'attribut. L'esprit qui se développe autour de cette monarchie est celui de l'Orient. Auguste s'y prête, se félicitant de l'autorité et du prestige que lui confèrent ces hommages indus.
C'est après sa mort seulement qu'il fut officiellement divinisé comme l'avait été César. L'apothéose est un témoignage de reconnaissance plus ou moins spontané, réservé par les Romains à l'empereur une fois qu'il les a quittés. On suppose qu'il n'a pu manquer de prendre rang parmi les dieux. Lors des funérailles d'Auguste, il se trouva un ancien prêteur pour affirmer par serment qu'il avait vu l'image du prince s'envoler du bûcher vers le ciel (1). On raconta couramment plus tard qu'un aigle s'était échappé du bûcher pour porter son âme dans l'Olympe (2). Livie consacra à son époux un temple au Palatin (3).
(1) suet., Aug., 100.
(2) Dio, 56, 34 ; 71, 5.
(3) plin., N. H., 12,19, 42.
Sans hâte, Tibère en éleva près du Forum un autre qui ne fut inauguré que par Caligula (1). Sauf lorsqu'il avait d'avance démérité de son successeur, l'empereur défunt recevait régulièrement le titre de divus. « Je me sens devenir dieu », goguenardait Vespasien, éprouvant les premiers symptômes de la maladie qui devait l'emporter (2).
Quelle qu'ait été l'incertitude et l'extrême variété des croyances romaines touchant l'outre-tombe, l'idée de faire un dieu d'un homme, même après sa mort, n'est pas romaine. Pour les Romains, les mânes des ancêtres sont divins, sans doute, non moins que le génie qui anime chaque homme durant sa vie. Il est légitime d'offrir aux Mânes et aux Génies des sacrifices et des prières. Mais ni Génies ni Mânes ne sont des dieux d'en haut : ils sont liés soit aux corps, soit à la terre ; ils peuvent avoir des autels, non des temples : ils séjournent ici-bas, non dans le ciel. C'est l'Orient qui a imaginé l'envolée des âmes vers le ciel et qui a confondu les génies de la terre et les véritables dieux (3). Dès le lendemain de la mort d'Auguste, l'opinion romaine reproche à sa mémoire d'avoir usurpé les honneurs réservés aux dieux supérieurs et d'avoir accepté comme eux des temples, des statues de culte, des prêtres et des flamines (4). Ainsi Cicéron, au lendemain de la mort de César, avait protesté contre cette confusion entre les honneurs rendus à un homme et le culte des dieux véritables.
(1)Dio, 56, 46; 59, 9.
(2) suet. , Vespas., 23.
(3) L'aigle qui les emporte est syrien; cf. F. cumont, L'aigle funéraire des Syriens et l'apothéose des empereurs (Rev. Hist. Relig.. 62, 1910, p. 119, sq.) Le grand camée de France, à la Bibliothèque Nationale représente l'apothéose d'Auguste. Ce camée, gravé en l'an 17 de notre ère, doit être l'oeuvre de l'un des fils de ce Dioscouridès qu'Auguste avait autrefois ramené d'Asie Mineure. Au registre supérieur, au-dessus de Tibère trônant avec Livie, se voit Enée divinisé portant Je costume phrygien et, immédiatement derrière lui, Auguste couronné du diadème oriental. A sa droite se tient Drusus, Le quatrième habitant du ciel qui chevauche un cheval ailé conduit par un amour serait Marcellus, sivant Furtwaengler. Je préférerais reconnaître César fils de Vénus à qui Enée vient apporter l'empire du monde,
(4) tac , Ann,, 1, 10.
Comment peut-on adresser des supplications à un mort qui a son tombeau pour y recevoir le» honneurs funéraires ?... Que les dieux immortels pardonnent ce sacrilège au peuple et au Sénat qui en sont innocents (1).
L'apothéose décernée à César et à ses successeurs c'est, proclame Lucain, la punition des dieux qui ont laissé périr la République (2). Sénèque d'ailleurs s'en moque tout au long dans l’Apocolokynthose, et sa raillerie n'est que l'écho du bon sens occidental contre les imaginations introduites par l'Orient.
De qui je tiens tous les détails qui vont suivre sur la façon dont Claude a été reçu parmi les dieux ? S'il me faut citer mon auteur, allez interroger celui qui a vu Drusille monter au ciel ; il vous racontera aussi comment il a vu Claude s'y acheminer. Qu'il le veuille ou non, ce personnage ne peut manquer de voir tout ce qui se passe dans le ciel; c'est le curateur de la voie Appienne par laquelle, vous le savez bien, Auguste et Tibère sont montés vers les dieux...
Le souvenir de l'apothéose de César avait imposé l'apothéose d'Auguste et l'exemple du premier empereur était devenu une loi pour ses successeurs (3). C'était pure et simple flatterie qui n'était prise au sérieux par personne. Quant à la divinisation de Rome et d'Auguste, elle ne fut acceptée dans la capitale de l'empire que beaucoup plus tard, au second siècle, lorsque les modes, les idées et la religiosité de l'Orient triomphent définitivement à Rome. Hadrien, le premier, reconnaît et consacre officiellement le culte de l'État divinisé en faisant construire sur la voie Sacrée, près de l'arc de Titus, le temple de Rome et de Vénus. C'est Vénus, la mère des Enéades, non l'empereur lui-même, qui se trouve associée à Rome. Il fallut attendre la fin du me siècle et la transformation de l'empire en une monarchie complètement orientale pour que la personne du prince vivant fût considérée comme un dieu (4).
(1) Cic., Philipp., 1, 6, 13.
(2) lucan., Phars.,1, 756.
(3) Sur ce sujet et les nombreuses représentations figurées qu'il a inspirées, voir Mrs stronq, CLII, Voir aussi le petit article de G. boissier, Apotheosis, LVI. p. 3 5-326.
(4) Consulter sur ce sujet toutain, CLXII, 1, 1907, partie, p, 19, 37, 62,
La religion romaine, à ce moment, n'est plus qu'une tradition effacée, bien près de disparaître entièrement.
IV
LES EFFETS DE LA RESTAURATION AUGUSTÉENNE.
Rétablie par Auguste dans ses honneurs et dans ses formes officielles, la religion romaine va poursuivre durant des siècles encore son cours pompeux. L'autorité personnelle du prince et l'exemple de sa piété, l'enthousiasme sincère suscité dans la majeure partie du peuple par l'ensemble de son œuvre, l'imposent non seulement à la génération qui avait souffert des guerres civiles et redouté un instant la déchéance de Rome en face de l'Orient, mais à toutes celles qui, plus tard, considéreront les temps augustéens comme l'idéal et la règle du nouvel état politique du monde. Plus étroitement que jamais la religion se trouve liée à l'État; elle est non pas tant un moyen de gouvernement que l'expression même et le symbole de l'autorité de Rome sur le monde. Les dieux romains apparaissent vraiment comme l’âme de l'empire.
Au point de vue politique, la conception était parfaite et pleine d'à-propos. Mais une religion ne peut se contenter d'être exclusivement politique ; il lui faut une légende mythologique ou philosophique; il lui faut surtout une atmosphère émotive et sentimentale. La légende de la religion augustéenne était pâle et sa philosophie faible ; l'émotion et le sentiment lui faisaient complètement défaut. L'artifice restait partout trop apparent.
Comme Virgile son poète, la religion augustéenne a renoncé une fois pour toutes à pénétrer le principe des choses. Tel n'était pas son rôle sans doute. Mais elle renonçait par là même à l'assentiment de quiconque à Rome avait appris à penser. Une fois passé l'engouement pour l'œuvre du restaurateur de l'empire et de ses dieux, la folle sagesse dont parle Horace devait reprendre ses droits. Elle ne tarda pas en effet à le faire. Le successeur d'Auguste, Tibère, tout épris qu'il fût de la vieille tradition romaine, professait une indifférence profonde pour les dieux et leur culte parce que, dit Suétone, « il était mathématicien et convaincu que des lois nécessaires règlent toute chose»(1).
Quant à ceux qui, sans être ni mathématiciens ni philosophes, ne trouvaient cependant pas la complète satisfaction de leurs besoins religieux au foyer de l'autel domestique ou dans les réjouissances des carrefours, il ne ressentaient qu'un faible réconfort des sacrifices solennels au Capitule. Occupés à veiller au salut de l'empire, les grands dieux de la religion nationale sont pour eux trop étrangers à leurs pensées habituelles, pour éveiller leurs sentiments. Les dieux agrestes, dans les campagnes, suffisent et suffiront longtemps encore au paysan. Mais dans les villes, les religions de mystère, celle de Bacchus et celles de l'Orient exercent plus que jamais leur attraction. Elles sont bien faites, en effet, pour combler le vide que n'a pas su remplir la restauration trop exclusivement politique du fondateur de l'empire.
Ces religions représentent le principe exactement contraire à celui de la religion nationale romaine. Les dieux romains étaient ceux de la cité; l'homme s'adressait à eux surtout en tant que citoyen. Avec les croyances de l'Orient, au contraire, dit M. F. Cumont, « la religion cesse d'être liée à l'État pour devenir universelle; elle n'est plus conçue comme un devoir public mais comme une obligation personnelle; elle ne subordonne plus l'individu à la cité mais prétend avant tout assurer son salut particulier dans ce monde et surtout dans l'autre. Les mystères orientaux ont tous découvert à leurs adeptes les perspectives radieuses d'une béatitude éternelle. L'axe de la moralité fut ainsi déplacé; on ne chercha plus, comme faisait autrefois la philosophie grecque, le souverain bien sur cette terre mais après la mort; on n'agit plus en vue de réalités tangibles mais pour atteindre des espérances idéales. L'existence ici-bas fut conçue comme une préparation à une vie bienheureuse, comme une épreuve dont le résultat devait être une félicité ou une souffrance infinies. Tout le tableau des valeurs éthiques fut ainsi bouleversé. » Le triomphe de ces idées représentait la ruine de l'État aussi bien que de la religion romaine, dont le royaume était de ce monde et non pas de l'autre.
Le soin apporté par Auguste à la restauration religieuse n'a pas été cependant complètement vain.
Les dieux romains ont péri mais le cadre de l'administration officielle des choses religieuses a survécu. Croyants ou incrédules les empereurs, après Auguste, ont tenu également au souverain pontificat et en ont exercé les fonctions comme une de leurs charges principales. L'histoire de la religion romaine sous l'empire se confond en quelque sorte avec l'histoire des conceptions religieuses de chaque empereur. Elle se fait stoïcienne avec Marc-Aurèle et complètement orientale avec la dynastie des Sévères. A côté des empereurs et sous leur autorité le collège des pontifes, les flamines, les quindécemvirs, les augures, ont continué à régler les détails du culte officiel, maintenant dans la tradition les congrégations sacerdotales comme celle des Vestales, ou les collèges religieux, Saliens, Luperques, Arvales. Alors même que dans leur cœur les Romains avaient cessé de révérer leurs dieux, le culte a poursuivi son cours imperturbable. Plus que jamais, alors que tout sentiment religieux s'était éteint, les rites des dieux nationaux et les honneurs divins rendus à Rome et à l'empereur sont apparus comme le symbole et le signe du patriotisme romain. La religion était devenue une nationalité.
L'administration officielle du culte a même survécu au culte lui-même. Lorsque le christianisme eut triomphé, les empereurs persistèrent à considérer la direction des choses religieuses comme l'une des fonctions essentielles de leur pouvoir, On vit Constantin intervenir dans un concile de théologiens. Dépossédée de l'empire, Rome a conservé son souverain pontife qui, entouré de ses collèges sacerdotaux, exerce sur les rites et les cultes la même autorité que l'empereur autrefois et qu'avant lui, les magistrats religieux de la République.
Auguste n'a pu rénover l'ancienne religion nationale romaine, car il ne pouvait lui rendre une âme. Mais il en a restauré, de façon indestructible, toute l'armature extérieure.
Le temple qu'il a édifié est resté vide. Les dieux grands et petits se sont évanouis de son Panthéon, mais la maçonnerie en a vaincu les siècles.
CONCLUSION
LE GÉNIE ROMAIN
La religion, la littérature et l'art du siècle d'Auguste apparaissent comme l'expression la plus parfaite de ce génie romain dont nous avons suivi la formation et les progrès depuis les origines de la Ville. Il était parvenu, à la fin de la République, à sa pleine maturité. Après avoir assimilé les éléments de civilisation de toute l'Italie ancienne, il s'était mis avec une ardeur passionnée à l'école de la Grèce et était entré en pleine possession du savoir et des techniques du monde hellénistique. Le siècle d'Auguste, ou plutôt le demi-siècle du règne d'Auguste, nous montre la maîtrise complète des Romains dans tous les ordres de l'activité intellectuelle. Rome n'a pas dans tous les domaines égalé la Grèce ; dans quelques-uns elle l'a dépassée et de beaucoup, au moins la Grèce de ce temps ; dans tous elle a cherché une voie nouvelle et atteint une perfection qu'elle n'a plus jamais dépassée ni même retrouvée. Cette période marque donc bien l'apogée de son génie.
Lorsque nous parlons de « génie romain », il ne s'agit aucunement, répétons-le ici, d une force immuable, d'un ensemble cohérent de facultés censées propres au peuple et encore moins à la race. S'il est un peuple auquel fasse défaut l'unité d'origine et dont on ne puisse vraiment saisir la substance ethnique, c'est bien le peuple romain. Quel est-il? Les Romains eux-mêmes n'attachaient à cette question qu'une importance secondaire et ils avaient raison. Nous avons essayé d'indiquer au début de ce travail comment il s'était constitué peu à peu d'un mélange d'autochtones dits Sicules, d'Aborigènes, tribus vagabondes d'origine vraisemblablement européenne, puis d'une fusion de Latins, de Sabins et d'Etrusques, issus eux-mêmes de mélanges peu définis. Nous avons montré comment Rome s'était constamment enrichie d'éléments plus ou moins importants empruntés aux nations vaincues d'Italie et de tout le bassin méditerranéen, leur prenant idées, arts et hommes. La population de la ville elle-même, qui donne le ton à la civilisation romaine, apparaît en état de renouvellement constant. L'aristocratie dirigeante est sans doute plus stable ; cependant, au cours des siècles de l'histoire romaine, elle s'est reconstituée plusieurs fois. Combien, au siècle d'Auguste, reste-t-il des vieilles familles patriciennes de la République ? Mommsen n'en comptait pas plus d'une trentaine. Dans la population comme dans le domaine des idées, la faculté maîtresse chez le peuple romain a été la puissance d'assimilation.
Laissons donc entièrement de côté la tendance à chercher dans l'atavisme l'explication du sort des individus et des peuples. Renonçons même à voir dans leur histoire le développement continu de qualités et de défauts attribués, par hypothèse d'ailleurs, au prétendu noyau primitif. Peuple de paysans et de soldats, dira-t-on du peuple romain. C'est possible, mais il a été bien autre chose aussi, et cela dès ses débuts. Rien ne permet d'ailleurs d'affirmer que les périodes récentes de l'histoire d'un peuple n'aient pas sur son esprit autant et même plus d'influence que ses origines et ses périodes primitives. Le génie romain n'est pas, il s'est fait peu à peu, il s'est formé des vicissitudes mêmes du développement romain, du travail et des efforts de Rome, de ses acquisitions successives, de ses peines comme de ses triomphes.
Si malgré le renouvellement de la population et l'enrichissement des idées, très rapide à certaines périodes, on constate cependant une certaine cohérence dans l'évolution de la civilisation romaine, ou l'attribuera avant tout à l'atmosphère intellectuelle et morale qui enveloppe les Romains anciens et nouveaux, à la tradition sociale qui par la famille, par les groupements de toute sorte, par l'Etat surtout, se transmet de génération en génération. Mais cette tradition est créée par l'histoire, par les conditions de vie économiques et politiques, par les voisinages, par les contacts, par les événements, parfois même par des circonstances fortuites et souvent par des individus. Les grands hommes qui ont donné des exemples fameux, les grands écrivains surtout dont les œuvres ont agi sur la pensée et l'imagination de leurs concitoyens, ont efficacement contribué à déterminer le génie du peuple. Ils sont à la fois agissants et agis : ils subissent l'influence du milieu et des événements et ils la répercutent, comme un « écho sonore », pour leurs contemporains et les générations à venir. C'est ainsi que la religion, la littérature et l'art se trouvent en même temps les expressions les plus hautes du génie romain et parmi les forces primordiales qui l'ont constitué.
Le génie romain nous apparaît donc comme la succession des aspects divers qu'il a présentés. Il a tout d'abord été religieux; à l'origine nous placerons les dieux. Puis, l'Etat romain une fois constitué a exercé sur l'âme du peuple une action plus énergique, plus efficace et plus durable qu'aucun autre. Le second aspect du génie romain sera la Cité. Devenue un grand Etat, la Cité s'est trouvée envahie par la vie méditerranéenne qu'elle dominait. La mythologie, la politique, les arts, les lettres helléniques lui ont enseigné le Jeu. Mais la pensée grecque est aussi philosophie et science. L'esprit romain a appris d'elle à étudier et à connaître l'homme. Cette connaissance a pris dans la littérature et dans l'art de Rome un développement remarquable. L’humanité nous paraît aussi l'un des traits caractéristiques du génie romain.
I
les dieux.
Fustel de Coulanges a marqué autrefois l'importance primordiale des dieux dans la cité antique et les études modernes, en restreignant seulement la portée de quelques-unes de ses affirmations, n'ont fait que confirmer la justesse foncière de sa thèse. Les Romains ont tout d'abord vécu parmi les dieux, se mouvant au milieu d'eux, car le monde entier leur apparaissait divin. Les dieux ont dominé l'ensemble de leur civilisation primitive. Il n'y avait encore ni pensée spéculative, ni politique, ni droit, ni art proprement dit ; la religion exprimait tout l'idéal, tout se confondait en elle. C'est d'elle que sont issues les différentes formes de l'activité intellectuelle qui, longtemps, ont continué à porter l'empreinte des dieux. Cette période primitive nous échappe presque complètement, mais les âges postérieurs en ont conservé la trace. A l'époque classique nous trouvons les dieux anciens encore puissants au foyer domestique, dans les campagnes et aux carrefours populaires de la ville. La religion officielle garde dans son calendrier et dans ses rites le souvenir de l'ancienne omniprésence divine. La tradition historique, issue de l'autel, permet de retrouver les traits essentiels des conceptions périmées.
La divinité, à Rome, ne semble jamais avoir été ni farouche ni méchante; elle apparaît modeste, familière, officieuse et serviable, tout appliquée à ses fonctions protectrices. Elle se contente du sacrifice des fruits de la terre et de libations de lait. Elle est raisonnable et surtout juste; elle exige son dû, mais ignore le caprice. Que chacun parmi les hommes s'acquitte pour sa part de son tribut vis-à-vis de ses dieux particuliers, chacun parmi les dieux s'acquittera de sa tâche et tous donneront leur paix aux hommes. Ces dieux ne demandent pas à être connus, encore moins aimés; ils n'ont pas de mythes, ils n'enseignent rien, ils n'exigent aucun sentiment; ils ne sont sensibles qu'à la parfaite régularité des formules et des rites. Ils manquent évidemment d'envergure, rien ne les destine à l'empire du monde; ils sont les dieux d'un peuple exact et travailleur, qui manque de sensibilité mais ne connaît par les troubles du cœur.
Ils ne règnent d'ailleurs pas seuls à Rome, tant s'en faut. A côté d'eux s'aperçoivent, dès l'origine, des dieux d'une puissance plus étendue, héritage, semble-t-il, du passé préhistorique de la péninsule. Tels sont en particulier Saturne et la Terre-Mère. Les hommes en se mêlant mélangent leurs dieux qui se contaminent et s'imitent les uns les autres. Puis viennent les dieux étrusques, issus eux aussi d'une fusion entre les divinités indigènes et d'autres dieux relevant d'une civilisation plus développée mais plus sombre. A la mode hellénique l'Etrurie imagine ses dieux sous forme humaine, elle leur suppose des liens de parenté, leur prête des aventures, elle les groupe entre eux. C'est une triade étrusque qui, la première, règne au Capitole. La religion étrusque possède une théologie et même, semble-t-il, une cosmogonie : elle connaît l'habitat des dieux dans le ciel, le détail de leur action sur la terre et la loi des Enfers où ils règnent sur la mort. Elle a ses collèges de prêtres spécialisés, ses écoles, ses livres de doctrine, ses formulaires :tout chez elle paraît réglé avec précision et méthode. Les Romains lui prennent tout l'essentiel de cette organisation savante et en particulier, semble-t-il, ses collèges sacerdotaux. C'est cette organisation étrusque qui préside à la naissance d'une vie intellectuelle à Rome. Les lois royales origine du droit, le compte des années, le calcul des siècles, le calendrier, les Fastes, les albums puis les Annales des Pontifes, origine de l'histoire, les images des dieux, la musique et le rythme des paroles qui accompagnent le sacrifice, peut-être même des chants plus libres mêlant les aventures des hommes à celles des dieux, la pompe des fêtes, les jeux avec leurs danses, leurs dialogues plaisants, toutes ces racines profondes de la littérature et de l'art germent autour de l'autel et sont fécondées par ses cendres. Ce n'est pas, comme en Grèce, l'aventure guerrière et marine qui éveille à Rome la vie de l'esprit, c'est la prudence sacerdotale.
Bientôt viennent s'ajouter aux dieux étrusques quelques-unes des divinités plus libres et plus claires de la Grande Grèce et de Sicile. En même temps que Castor et Pollux, dieux cavaliers, qu'Apollon, que les grandes divinités de l'agriculture savante et de la vigne, voici paraître à Rome un reflet de la mystique pythagoricienne et les oracles de Cumes chargés de mythologie et de rites helléniques. La religion romaine se montre accueillante pour les dieux étrangers, mais les Pontifes qui veillent sur elle imposent à ces nouveaux venus la loi minutieuse d'une tradition déjà établie; ils choisissent parmi eux, ils fixent l'emplacement de leurs sanctuaires, ils acclimatent prudemment les cultes et les rites.
Cette œuvre se poursuit durant des siècles, au gré des circonstances qui introduisent à Rome la plupart des dieux de l'Italie, puis de la Grèce et quelques-uns de ceux de l'Orient. A l'époque classique une religion officielle gréco-romaine recouvre une religion populaire demeurée italique. A mesure qu'a progressé l'esprit romain, la pensée religieuse s'est affaiblie et comme vidée de son contenu. Les formes divines subsistent, reléguées dans leurs temples, symboles de conceptions abstraites qui n'ont plus rien de religieux. L'extérieur de la religion, le culte et son administration subsistent intégralement, mais ce n'est plus la piété qui le soutient, c'est une plus récente, celle de la Cité.
II
la cité.
Constituée sous l’égide des dieux, la Cité s'est peu à peu dégagée de leur domination pour vivre de sa vie propre. Cette évolution a dû commencer dès l'époque royale. La louve du Capitole apparaît déjà comme un symbole plus politique que religieux. La révolution républicaine, ou l'événement quel qu'il soit, qui sépare Rome de l'Etrurie, engage la ville dans la voie d'un particularisme national où la raison semble avoir déjà plus de place que le sentiment religieux. La constitution des Décemvirs les lois des douze tables, l'imitation de l'effort législatif de la Grande Grèce pythagoricienne, marque l'avènement de l'État laïque ; au règne des dieux succède celui de la Cité.
Cette phase de l'histoire romaine a imprimé au génie romain l'un de ses aspects les plus caractéristiques. Dans tous les ordres d'activité et à toutes les périodes nous retrouvons à Rome l'idée civique. L'État, sa vie, son intérêt, tiennent dans l'âme du Romain la première place. C'est l'État lui-même semble avoir façonné l'esprit du peuple.
Durant près de trois siècles, en effet, jusqu'à la fin d seconde guerre punique, la vie semble avoir été rude pour la jeune cité romaine, entre ses anciens maîtres étrusques et ses voisins Latins, Sabins, Eques, Volsques et autres. Pour que Rome l'emportât dans cette lutte de tous les jours, il lui fallut l'étroite subordination de tous à l'aristocratie dirigeante. De là l'habitude d'une stricte discipline, une abnégation complète à la chose publique, un patriotisme toujours en éveil. De là aussi le souci prépondérant de l'utile, le dédain de la fantaisie, la dureté du cœur, la crainte de la nouveauté. Ainsi se forme cet esprit à la fois énergique et timoré, d'une combativité passionnée et en même temps prompt à l'obéissance, ardent et routinier, tout générosité pour la patrie et méfiance hostile pour l'étranger, cet esprit qui s'incarne dans le vieux Caton et qui apparaît comme l'idéal de la vertu romaine.
La Cité, représentée par son sénat autoritaire et méticuleux, asservit tout chez elle, ses dieux les premiers. Les dieux s'identifient avec la cité; ils sont les serviteurs de son intérêt. C'est bien ainsi que, ressuscitant la tradition, les conçoit Auguste.
Dans la vie de chacun les devoirs envers l'État prennent le pas sur tous les autres. C'est pour la cité qu'il faut se marier et avoir des enfants, c'est pour elle qu'il faut vivre et qu'il est beau de mourir. On sert la cité en cultivant son champ, on la sert encore en exerçant sa pensée et en usant delà parole soit pour défendre les citoyens, soit pour attaquer ceux dont les actes ou les tendances paraissent nuisibles à la chose publique. Les luttes de partis sont une des formes que prend le patriotisme. Tous se surveillent et se censurent les uns les autres dans l'intérêt général. Le peuple romain est une armée dans laquelle l'attention de chacun est constamment tendue vers le salut de tous et la gloire de la cité.
L'art, né du règne des dieux, se trouve, comme la religion elle-même et comme la vie des citoyens, asservi à l'État. Il sert toujours sans doute à construire et à orner les temples, il prête une figure aux dieux, mais il est employé aussi à commémorer les bons citoyens, ceux qui ont bien mérité de la cité. Dès les siècles anciens de la République, nous trouvons mentionnées de nombreuses statues honorifiques, exemples illustres exposés à l'émulation des citoyens. C'est là encore une tradition qu'Auguste remettra en honneur. Dans les familles, les portraits des ancêtres et les inscriptions qui rappellent leurs noms et leur carrière constituent de même une constante exhortation à la vertu civique. L'art sert encore à glorifier la cité en honorant le triomphe des chefs victorieux. Dans le cortège qui reproduit la pompe religieuse des Jeux, entre les chœurs de chanteurs et d'histrions et les chariots chargés du butin, des peintures représentent les faits mémorables de la campagne et jusqu'à l'aspect des provinces conquises. Le hasard nous a révélé à Rome une seule peinture funéraire, la fresque de l'Esquilin. Elle figure divers épisodes militaires et non pas, comme en Etrurie, les fêtes religieuses en l'honneur du mort ou les images du séjour infernal. Statues honorifiques, portraits, peintures historiques sont l'œuvre d'un art subordonné à l'intérêt de l'État. Cette veine est celle que nous retrouvons dans l'art officiel du siècle d'Auguste et de tout l'empire. Le beau y remplit, pour ainsi dire, une fonction publique. De là son allure solennelle et compassée, sa froideur trop raisonnable, sa tendance à l'exactitude servile du détail, son réalisme sans envolée. L'artiste s'acquitte trop évidemment d'une tâche imposée.
L'utilité assignée comme but et la raison comme moyen, expliquent que l'architecture soit devenue sous l'empire l'art romain par excellence. Dans l'architecture impériale c'est l'idée impériale qui triomphe. Temples, palais, monuments publics, manifestent le pouvoir et la munificence du souverain. L'orgueil fait leurs proportions colossales. La richesse de leur décoration étale la fortune du peuple romain. Leurs formes et leurs lignes paraissent choisies le plus souvent pour embellir Rome de tous les styles qui fleurissent dans les provinces que leur prospérité ou la faveur de l'empereur met à la mode. L'histoire de cette architecture serait la meilleure illustration de l'histoire de l'empire et des empereurs eux mêmes.
Il paraît presque superflu d'insister encore ici sur la part importante de l'idée civique et politique dans l'ensemble de la littérature romaine. Dès le début de la période littéraire, 1e sentiment national et le patriotisme font l'originalité de épopées de Naevius et d'Ennius. Le poète en composant ses chants reste soldat, citoyen et Romain. C'est pour la plus grande gloire de Rome qu'il s'efforce d'introduire chez elle les Muses. C'est l'inspiration patriotique de la vieille épopée romaine qui, sous Auguste, anime l'Enéide ; c'est le souci tout romain de l'utilité sociale qui a conduit Virgile de l'art desBucoliques à celui des Géorgiques. Moraliser, corriger, imposer le bon sens et la mesure dans l'intérêt de la cité, tel est le but, que de Lucilius à .Horace et même à Juvénal et à Perse, se propose la satire. La poésie avec elle se fait censure. En prose, la vie de la cité anime l'éloquence. La preuve en est que sous l'empire, une fois exclu du Forum, l'art oratoire perd tout caractère et devient, comme en Grèce, pure déclamation d'école. Quant à l'histoire, nous avons essayé de montrer comment son intérêt et sa faiblesse tiennent à ce qu'elle a toujours subordonné la recherche et l'exposé des faits soit à la passion politique, soit à un idéal de patriotisme moralisateur. Une partie de la poésie et toute la prose, à Rome, tendent donc à l'action pour le plus grand avantage de la cité. La pensée toujours présente de l'Etat est un des traits essentiels du génie romain, aussi bien dans la religion que dans la vie, dans l'art que dans la littérature.
III
le jeu.
Mais Rome n'est pas seulement une cité qui, solidement assise sur sa terre, lutte de toutes ses forces pour la possession du sol et des biens matériels; elle est aussi une ville de commerce, un point de passage, un pont, a-t-on dit, presque un port. Sitôt que vers l'ouest ou le sud le Romain sort de ses murailles, il rencontre la vie méditerranéenne. Il n'a jamais pu s'en isoler. Lorsque, vainqueur sur terre et sur mer, il aborde la péninsule hellénique et presque aussitôt après l’Asie, il est déjà tout préparé aux leçons de la Grèce. L'imagination grecque domine bientôt Rome et lui apprend le jeu.
Le jeu dans la religion, ce sont les fables divines que l'on répète parce qu'elles sont plaisantes et présentent à l'esprit des images aimables mais dont on ne se soucie pas de savoir à quelle réalité elles correspondent. Chacun les embellit et les interprète à son gré; sans les affirmer mais sans prendre la peine de les nier, il y découvre le sens ou le symbole qui lui plaît. Le jeu dans l'art, c'est la fantaisie des lignes et des couleurs, les scènes familières ou héroïques qui figurent les légendes mythologiques, c'est Bacchus et son cortège, ce sont les mille statues de Vénus et la beauté divinisée, les jeux des amours, les bergeries, l'autel campagnard au pied du vieil arbre chargé de guirlandes, les paysages exotiques, les architectures en trompe-l'œil, les arabesques, les fleurs et les feuillages, tout ce qui divertit l'esprit et l'œil. C'est la musique, la voix humaine savamment modulée et l'accompagnement des divers instruments à corde remplaçant la flûte; ce sont les chansons et c'est la danse. Ce sont les représentations du théâtre qui de la cérémonie religieuse font une tête pour les hommes; c'est toute la tragédie qui dans l'exploit montre l'aventure, c'est la comédie de Plaute qui lance au peuple, tout chargés de rire, les mots de son langage. C'est la fantaisie didactique d'Ennius imaginant le songe d'Epicharme, narrant la fiction d'Evhémère ou composant les recettes culinaires des Heduphagetica. C'est la poésie légère et le lyrisme de Catulle, de Tibulle, de Properce et d'Ovide. Dans la langue, c'est le pittoresque et c'est la musique des mots, leur harmonie et leur ampleur, c'est la composition de la période, c'est la diversité des mètres grecs remplaçant les trois temps lourdement frappés du saturnien.
Le jeu est l'aspect prépondérant de l'art, de la littérature et même de la religion à Rome, dans le dernier siècle de la République. Mais les premières manifestations s'en rencontrent beaucoup plus tôt, dès le ive siècle, dans la décoration des cistes de Préneste ; elles doivent remonter jusqu'à la période étrusque. Le jeu se perpétue, malgré Auguste, tout le long de son règne et jusqu'à la fin de la civilisation antique.
Le jeu est grec, mais il prend à Rome un aspect particulier, en raison précisément des éléments auxquels il se superpose ou s'incorpore. Succédant à langueur utilitaire imposée par la cité, il est comme le bouillonnement d'une adolescence trop longtemps contenue. Il affecte, au temps du premier Scipion, une ardeur que ne connaissait pas la Grèce. L'esprit nouveau répudie violemment l'idéal traditionnel de prudence et de soumission. Avec les Gracques il se fait audace généreusement révolutionnaire. Dans la vie et même dans l'art, chez Catulle par exemple, il s'anime de passion, il se fait violent, il demeure un peu cru et dégénère aisément en brutalité. Chez une aristocratie avide de richesse, de pouvoir, de jouissances de toute sorte, il s'exprime par une ambition sans mesure et souvent assez vulgaire, par le luxe excessif des constructions et des ameublements, par un mélange de goûts hétéroclites, d'exotisme ultra-moderne et d'archaïsme. Il produit la corruption, la dissolution des mœurs et a pour tare la gloutonnerie.
Chez le peuple, l'exemple des grands détruit l'ancienne discipline et développe l'esprit de faction. Le jeu se traduit chez la plèbe par la veulerie qui attend subsistance et joie du bon plaisir des puissants, par la paresse croissante, par la grossièreté des spectacles du cirque et de l'amphithéâtre. Les conditions sociales et économiques de la vie romaine sont peu favorables à l'affinement des esprits. Du reste la période hellénistique est foncièrement aristocratique, l'intelligence et la beauté demeurent l'apanage de l'élite et Rome elle-même a cessé depuis la défaite des Gracques et depuis Sylla d'être une cité démocratique.
Les arts plastiques demeurés aux mains de Grecs restent longtemps exclusivement grecs. Mais pour les arts de l'esprit ce sont des Romains qui adaptant le jeu grec au goût de leurs concitoyens. Leurs efforts valent à la littérature son originalité.
D'une façon générale, la technique grecque s'est, dans tous les ordres de l'activité intellectuelle, imposée à la pratique romaine. La poésie accepte les mètres, les modes et les genres qui ont la vogue dans le monde hellénique. La poétique grecque s'impose au théâtre comme au lyrisme, comme au genre didactique. La matière même, au moins celle du théâtre et de la poésie lyrique, semble grecque ; elle est empruntée à la fable héroïque et mythologique ; les développements, les images sont la plupart du temps des imitations, les expressions mêmes traduisent des modèles grecs. Et cependant, dans l'élégie même, le plus grec des genres romains, nous apercevons la tendance progressivement accentuée de Catulle à Tibulle et à Properce, à insérer, dans la forme hellénique, des sujets, des idées et des sentiments romains. Fils d'un peuple façonné par la lutte, les élégiaques romains ont pris le jeu lui-même au sérieux; ils ne se sont pas contentés de s'en amuser, ils l'ont vécu, ils en ont ressenti ce qui chez leurs maîtres n'était souvent que fiction, et l'ont exprimé en conséquence d'une façon plus forte.
L'éloquence, de même, emprunte à la Grèce toute sa technique. La matière naturellement en reste romaine, mais l'esprit et la passion qui l'anime sont aussi romains. Les Romains pratiquent le jeu grec avec toutes les traditions de leur passé, presque comme un devoir. Ils y apportent une ardeur que n'a pas encore refroidie le dilettantisme sceptique, ils mettent à en appliquer les règles la conscience professionnelle d'hommes habitués aux taches pratiques de la vie.
Surtout, la plupart du temps, ils fondent le jeu dans les préoccupations traditionnelles de l'esprit romain. Ennius avait donné l'exemple de ce mélange en usant de toutes les ressources de l'épopée grecque pour illustrer l'histoire de Rome et composer à sa patrie un poème national. Virgile parfait disciple des Muses grecques, artiste accompli, qui unit la légende grecque à l'inspiration religieuse, au patriotisme et à une conscience foncièrement romaine, représente dans sa complexité vivante le génie romain qui adopte le jeu pour l'employer au bien et à la gloire de la cité.
IV
LA CONNAISSANCE DE L'HOMME.
Mais la pensée grecque n'était pas seulement jeu artistique, elle s'était aussi appliquée à concevoir la réalité du monde et à comprendre la vie universelle. Dès le v8 siècle avant notre ère, l'effort rationnel de la Grèce, sous sa forme pythagoricienne, semble avoir exercé son influence sur la République à ses débuts. Les effets ne purent manquer de s'en accuser lorsque Rome se trouva en contact direct avec la Campanie, la Grande-Grèce et la Sicile. Mais il faut attendre le second siècle avant notre ère pour voir la Grèce propre, Pergame et Alexandrie, enseigner aux Romains la philosophie et les sciences. De l'époque du second Scipion à celle de Cicéron, les Romains ont témoigné le même enthousiasme aux leçons de Panaetius et de Posidonius. La réflexion et la connaissance sont aussi l'un des aspects de leur génie.
En matière de philosophie et de science, ils n'ont cependant jamais dépassé le rang d'élèves. Ils se sont trouvés arrêtés par le développement qu'avait pris chez eux le principe de l'utilité sociale. Nous avons essayé d'indiquer comment le culte de la cité avait abouti chez eux au pragmatisme, non pas au sens où. Polybe entendait ce mot, mais dans son acception la plus moderne. Le pragmatisme sans doute n'étouffe pas nécessairement l'ardeur à connaître. Ne trouvons-nous pas en effet à Rome des savants d'une curiosité passionnée depuis Varron jusqu'à Pline l'Ancien ? Mais il soumet la vie de l'esprit à des règles qui ne sont pas les siennes. Il la prive de son autonomie, il se préoccupe prématurément des résultats et des effets pratiques de la pensée. Il prévoit l'action dans la science et subordonne la recherche de l'inconnu au respect de ce qui existe. Or la connaissance exige pleine liberté. La réalité représente pour elle un point de départ et non d'arrivée. Des faits et des séries particulières, elle s'élève par l'abstraction aux idées générales; l'idée pour elle, au moins chez les Grecs, était devenue la réalité suprême. Dans le monde des idées rien ne doit arrêter la logique du raisonnement. La science n'a cure que de vérité et ne se soucie pas des brèches que la vérité pourra ouvrir dans la cité. Le Romain, au contraire, les redoute ; il s'attache au sensible et au concret, il se sent mal à l'aise dans l'abstraction, il hésite dans le raisonnement et change de voie sitôt que ses conclusions lui semblent devoir heurter la tradition. Il n'admet pas la raison pure; il s'en est pour toujours tenu à la raison pratique.
C'est ainsi qu'il est exceptionnel de voir un Romain accepter l'intégrité logique d'un système de philosophie ou d'une méthode scientifique. Son éclectisme, son souci constant de conciliation dans le juste milieu, n'est que souci de la pratique et appréhension de se trouver entraîné par le raisonnement trop loin du concret. En philosophie, la Nouvelle Académie, qui tempère l'idéalisme aristotélicien recueille le plus grand nombre d'adeptes. A côté d'elle, le stoïcisme séduit par la rigueur de sa morale et la complaisance de sa métaphysique pour les conceptions religieuses traditionnelles mais on laisse de côté sa dialectique. Sous Auguste, on accentue les tendances religieuses du stoïcisme en les mélangeant de pythagorisme et de platonisme. Plus tard, Sénèque unit pour ainsi dire en une seule les morales de Zenon et d'Epicure; l'une procède de l'idéalisme, l'autre du matérialisme ; qu'importe si dans la pratique leurs préceptes se rapprochent. L'opinion publique, qu'épouse pleinement un esprit aussi distingué que Tacite, ne témoigne qu'une sympathie médiocre aux stoïciens de stricte observance malgré l'élévation de leur caractère et bien qu'ils fassent figure d'opposants à un pouvoir odieux. Leur intransigeance convient trop peu à la pratique.
Un seul parmi les écrivains romains a possédé l'énergie intellectuelle suffisante pour suivre jusqu'à ses conclusions extrêmes la logique d'un système, c'est Lucrèce. Aussi la légende transmise par saint Jérôme le présente-t-elle comme un fou. Et cependant, chez Lucrèce même, quel souci bien romain de la pratique et de l'utilité ! C'est pour guérir ses contemporains des inquiétudes et des maux causés par l'ignorance qu'il a entrepris son travail ardu. Il met toute sa passion à présenter sous une forme séductrice l'amère sagesse qu'enseigna le maître. C'est pour sa morale bien plus que pour sa physique qu'il s'est enthousiasmé d'Epicure.
Dans les sciences comme en philosophie, nous avons trouvé le Romain incapable de prendre un parti entre les théories et les méthodes. Le rationalisme en médecine, l'analogie en grammaire, lui paraissent des voies aventureuses ; elles le conduisent trop loin du réel. L'empirisme, d'autre part, et l'anomalie ne satisfont point son besoin d'ordre. Les Grecs, en effet, n'avaient pas réussi à tirer de l'observation des faits une doctrine de science expérimentale. Quelle belle tâche à remplir pour l'esprit romain épris du concret ! Mais quelle patience, quelle abnégation et quelle foi dans le pouvoir de la raison et du raisonnement ne supposait-elle pas ! Pressé d'agir, le Romain ne s'attarde pas aux principes et aux méthodes; entre les deux chemins opposés, il adopte une direction moyenne qui lui permette une vue d'ensemble sans cependant l'élever trop haut au-dessus des faits. La science, au fond, ne lui apparaît pas différente d'une technique ; il y voit un pur instrument de pratique, un simple moyen d'action. En conséquence, il s'appliquera à adapter, à vulgariser, à utiliser l'activité scientifique des Grecs ; il se fera compilateur, mais il ne sera jamais un grand savant parce qu'il n'a jamais voulu être seulement un savant. La science ne doit au génie romain ni une idée ni une méthode.
S'ils laissent à d'autres l'exploration du monde matériel, les Romains ont, au contraire, porté tout l'effort de leur attention vers le monde moral. Tout ce qui concerne l'homme, son caractère et sa conduite, a suscité chez eux un intérêt passionné. Dès la première apparition de la philosophie grecque à Rome, un cercle de psychologues et de moralistes se groupe autour de Scipion Emilien. Le théâtre de Térence et la satire de Lucilius sont le fruit des premières réflexions romaines sur la nature de l'homme. Autant que nous en pouvons juger par les fragments qui nous restent de la tragédie, le jeu tragique se charge d'analyse psychologique et de discussions morales. Sous Auguste, le mime, comédie dégénérée et souvent licencieuse, doit sa valeur littéraire et une partie au moins de son succès aux traits d'observation exacte et aux sentences morales qui le relèvent. La satire d'Horace trouve ses sujets autant dans la théorie morale de la philosophie grecque que dans la critique des travers romains. L'étude de l'homme, en général, apparaît à Rome comme l'objet essentiel de l'activité intellectuelle ; la connaissance des caractères, des sentiments et des passions, est considérée comme le degré suprême de la culture de l'esprit. La littérature, dans son ensemble, est devenue « les humanités ».
Cette connaissance de l'homme est l'un des traits caractéristiques qui, dans le génie romain, se mêle à ceux que nous avons distingués plus haut. Elle a fait prendre au Romain conscience de soi-même et de l'humanité en lui ; toutes les œuvres romaines apparaissent profondément imprégnées de ce sentiment de la réalité humaine.
On le reconnaît chez Lucrèce, dans l'importance attribuée aux analyses psychologiques, dans l'exacte description des impressions et la notation pittoresque du sentiment sous le geste et l'attitude. Il anime les Géorgiques de Virgile où l'homme transparaît à travers la nature, et, bien plus encore, l'Enéide qui lui doit la vie de ses personnages et le ressort de ses épisodes les plus frappants. Parmi les jeux de l'élégie apparaissent de même, chez Catulle, chez Tibulle et surtout chez Properce, de fines analyses de tous les sentiments qui font cortège à l'amour et des développements moraux d'allure didactique. Dans les arts plastiques même, cette attention scrupuleuse prêtée à la vie morale fait l'originalité du portrait romain et constitue l'intérêt de grandes compositions telles que les frises de l'Autel de la Paix. Les caractères apparaissent dans les traits du visage et toute l'attitude des corps. C'est vraiment l'âme qui donne à l'image sa vérité vivante.
Nous nous faisons presque scrupule d'insister sur la place qu'occupé l'étude et la connaissance de l'homme, dans l'ensemble de la prose romaine. Salluste ne vise-t-il pas avant tout à paraître psychologue profond et moraliste austère ; Cicéron dans toutes ses œuvres ne témoigne-t-il pas de sa connaissance subtile des hommes et du caractère humain ? L'attention qu'il porte à la vérité morale n'apparaît pas seulement dans les opuscules, le de Senectute, le de Amicitia qui ont la morale pour objet, mais aussi dans tous ses autres traités. Qu'ils discutent d'éloquence ou de philosophie, ou des lois ou de tout autre sujet, ses personnages ne dissertent jamais dans l'abstrait ; sous la théorie empruntée à la Grèce, l'écrivain latin aperçoit l'homme auquel elle doit s'appliquer, il ne perd pas de vue les effets qu'elle produira dans la réalité, il attache avant tout son attention aux sentiments et aux mœurs. Dans ses discours et dans ses lettres, avec quelle complaisance ne s'attarde-t-il pas à distinguer les nuances des .idées et des passions, avec quelle sûreté et souvent quelle finesse sont tracés les portraits des personnages mis en cause, amis aussi bien qu'adversaires ! Cicéron voit presque trop clair dans les caractères ; c'est là une des raisons de l'indécision de ses actes et de l'incertitude de ses opinions politiques.
C'est surtout dans l'histoire que le souci constant de la réalité humaine donne aux œuvres latines une couleur particulière. L'idée de la cité domine toute la pensée de Tite-Live, mais, dans la cité, apparaissent les hommes ou plutôt le Romain semblable dans tous les temps à celui que Tite-Live trouve en lui-même ou a pu observer autour de lui.. Les éléments matériels de la civilisation et l'aspect des siècles passés n'éveillent pas la curiosité de l'historien romain. Nulle part n'apparaît une image comme celle qu'au début de son œuvre Thucydide, par exemple, évoque de la Grèce primitive. Ni les intérêts économiques ni même les idées politiques, si rudimentaires fussent-elles, qui durent animer les efforts des anciens peuples de l'Italie, ne trouvent considération. C'est dans l'esprit des hommes surtout, parleurs caractères, par leurs passions et par les actes qu'elles leurs inspirent, que se joue le drame historique. Histoire abstraite, dira-t-on. Oui, dans une certaine mesure, car elle ne tient que très peu compte des réalités extérieures à l'homme. Mais histoire éminemment concrète aussi par tout ce qu'elle contient d'humanité, par le relief de ses portraits, par la couleur vivante de ses récits et le mouvement de ses discours. Toute cette psychologie en action aboutit à des leçons de morale. Dans l'histoire du peuple, Tite-Live voit surtout les individus, il les voit avec une précision parfaite, comme s'ils vivaient devant lui, et ce qu'il distingue de prime abord c'est, pour ainsi dire, la contexture de leur âme et les mobiles de leur activité.
Ce caractère essentiellement psychologique de l'histoire romaine se trouve encore plus fortement accusé chez Tacite. Le récit s'attache à suivre dans l'esprit des personnages le jeu des sentiments qui peu à peu décide des faits. Cette vie intérieure se trouve peinte de traits si vigoureusement réels que le tableau s'en impose à l'imagination. Telle est la vérité morale qu'elle semble rendre superflu l'effort de critique et de documentation qui en ferait la vérité historique. L'âme des foules elle-même est analysée avec la même précision délicate que celle des individus. L'homme se trouve toujours au premier plan, en pleine lumière; l'intérêt se concentre, non sur son extérieur, la plupart du temps à peine indiqué, mais sur les caractères, qui sont scrutés avec une sévère perspicacité. Les esprits, que l'étude de l'antiquité romaine a habitués à la rigueur de cette observation du cœur humain, ne peuvent l'oublier ; à tort ou à raison, ils se résignent difficilement à ne pas mettre l'homme au premier plan dans l'histoire et, en tout cas, ne peuvent plus se contenter, en guise de portraits, d'ébauches schématiques ou d'images conventionnelles.
Les épigrammes de Martial et toute l'œuvre philosophique de Sénèque témoignent de la même attention aux mœurs et à la vie morale. La connaissance de l'homme et le règlement des moindres détails de la vie de son âme deviennent l'objet suprême de la philosophie. La religion elle-même, qui jadis ne se souciait que peu de la conduite des hommes, se fait morale. C'est vers l'homme autant que vers Dieu que se dirige la réflexion pieuse de Marc-Aurèle. Le « connais-toi toi-même » de Socrate est devenu comme la maxime de la pensée romaine. Les qualités et même les défauts développés par des siècles d'histoire concordent pour assurer au Romain, dans la connaissance de l'homme, une maîtrise qui, autant qu'il nous semble, n'avait pas encore été égalée et qui, en tout cas, a exercé sur le monde moderne et en particulier sur nos siècles classiques une profonde influence.
V
l'originalité romaine.
Les dieux, la cité, le jeu, la connaissance de l'homme, telles ont donc été les préoccupations essentielles de l'esprit romain. Venant s'ajouter les unes aux autres et réagissant constamment les unes sur les autres, elles ont constitué peu à peu le génie du peuple. Les sédiments profonds laissés par les pensées anciennes soutiennent les couches plus récentes venues se superposer à elles ; ils sont cachés le plus souvent ; ce n'en est pas moins eux qui déterminent le relief superficiel. Qu'une faille se produise, qu'une révolution bouleverse le sol établi par les siècles et l'on voit, comme au siècle d'Auguste, affleurer de nouveau les conceptions primitives qui font des dieux les maîtres de toute pensée humaine et proposent la cité et son intérêt comme le premier objet de l'activité des citoyens. Le jeu se soumet à l'utile ; la religion, le patriotisme, l'art, cherchent un intérêt nouveau dans la connaissance de l'homme.
Le génie romain doit son aspect au cours de chacune des périodes différentes de son histoire à un mélange diversement proportionné des éléments que nous avons cru pouvoir y distinguer. Son originalité tient non pas à ces éléments, mais à leur dosage et aux réactions qu'ils ont provoquées ; elle est non dans les composants, mais dans le composé. Tous les peuples ont commencé par attribuer aux dieux, dans leur vie, une part prépondérante. La religion romaine se constitue tout d'abord d'une fusion des dieux divers que les siècles de la préhistoire et les migrations ont intronisés en Italie ; elle reçoit ensuite des dieux étrusques et grecs, elle en admet même quelques-uns qui sont originaires d'Orient, mais c'est la cité qui lui imprime une forme quasi juridique, administrative et enfin foncièrement politique.
La cité romaine elle-même semble issue du courant méditerranéen qui groupe les bourgades des campagnes en un tout plus fort et sème les colonies sur toutes les côtes; elle naît de l'expansion étrusque ; devenue autonome, elle cherche ses modèles jusqu'en Grande-Grèce ; conquérante, elle devient un État de type hellénistique puis une monarchie d'inspiration orientale. L'âme de la cité n'en demeure pas moins ce que l'ont faîte des siècles de lutte obscure et âpre, prudente, ordonnée, ardente dans la recherche de l'intérêt public et étroitement attachée au rocher Capitolin qui tut son berceau. Ses qualités solides mais étroites domineront par la suite toute sa vie intellectuelle et morale.
De la Grèce, Rome apprend le jeu, par l'intermédiaire de l'Etrurie d'abord, puis de l'Italie hellénisée et surtout de la Sicile. Plus tard Athènes, Pergame, Alexandrie complètent son éducation artistique. Dans le jeu, le Romain apporte une application, un souci du détail et du réel, un sérieux et une passion qui conservent le souvenir d'un passé longtemps austère et les habitudes d'une activité jadis exclusivement dirigée vers l'utile.
La vie intellectuelle tout entière est grecque de provenance, mais l'esprit romain se contente des résultats scientifiques acquis par la Grèce, sa curiosité se porte soit vers Rome elle-même et son passé, soit vers l'homme et la vie morale.
Comme tous les autres peuples, le peuple romain n'a cessé à aucune période de son histoire d'emprunter autour de lui les éléments de sa civilisation. Son attachement aux anciens usages n'a guère ralenti son ardeur à s'emparer de tous les fruits que ses conquêtes mettaient à portée de sa main. La masse de ses emprunts, à certains moments au moins, a même dépassé la mesure moyenne et il n'a pu l'assimiler que peu à peu. L'intérêt du siècle d'Auguste est précisément de nous montrer à la pleine lumière de l'histoire les idées religieuses et politiques du passé romain réagissant sur les acquisitions plus récentes, choisissant parmi elles, développant les unes et tentant d'éliminer les autres, s'emparant du jeu et de la connaissance pour les utiliser et les faisant entrer dans la tradition nationale. Ainsi s'est constitué par un lent progrès, par l'effet des événements et par l'effort des hommes, la puissante personnalité du peuple romain. Le génie romain a recueilli peu à peu la substance de tout le monde antique et lui a donné une forme nouvelle. C'est sous cette forme imposée par Rome que l'héritage de l'antiquité est parvenu au monde moderne, au moins à celui d'Occident et aux nations latines en particulier.
Fin
sommaire