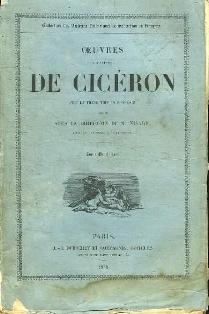
DE
LA RÉPUBLIQUE
de
CICÉRON
Nisard
1841 et 1864
Livre 6 avec LE SONGE DE SCIPION
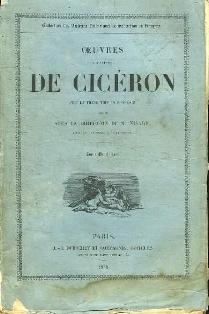
PRÉFACE. (de l'édition de 1864)
Parmi les ouvrages philosophiques de Cicéron, il n'en était pas de plus fréquemment cité par l'auteur, et de mieux apprécié dans l'antiquité, que le traité de la République. C'était de tous le plus sérieux et le plus original; Rome s'en enorgueillissait, et des Grecs eux-mêmes le préféraient aux livres d'Aristote et de Platon. Aussi, lorsqu'à la renaissance des lettres, les amis de l'antiquité rassemblèrent avec ferveur les livres dispersés du grand orateur, ils furent douloureusement surpris de ne plus trouver un seul manuscrit d'un ouvrage qui avait été répandu dans tout le monde savant, et que les premiers siècles du moyen âge avaient certainement connu et multiplié. Des recherches actives furent dirigées de tous côtés; on demanda l'ouvrage du consul romain à l'Italie, à la France, à l'Allemagne, à la Pologne elle-même; il n'y fut épargné ni dépenses ni soins. Mais tous les efforts furent inutiles; et l'on vit pendant quatre siècles les éditeurs de Cicéron réduits à déplorer une perte réputée irréparable; et à rapprocher du songe de Scipion, admirable fragment de la République, conservé par Macrobe, quelques textes de saint Augustin, de Lactance, du grammairien Nonnius, débris informes d'un monument dont ils ne montraient ni l'économie ni le mérite. Un savant italien a eu, dans les premières années de ce siècle, le bonheur si longtemps et si vainement poursuivi à l'époque de la renaissance, et que tant d'érudits modernes rêvaient encore, malgré l'inutilité des recherches du seizième siècle. M. Angelo Maï, récemment élevé au cardinalat, a retrouvé la République à demi effacée sur un de ces manuscrits qu'on nomme palimpsestes, parce que la première écriture est recouverte d'une seconde. Malheureusement la découverte est incomplète. Le précieux manuscrit présentait beaucoup de lacunes, et la composition entière, qui devait être la plus vaste de Cicéron, n'avait jamais été renfermée dans le seul cahier que la poussière du Vatican nous ait rendu. Nous ne pouvons, malgré cette bonne fortune de M. Angelo Mai, récompense si légitime de tant de travaux, nous ne pouvons nous flatter d'avoir plus de la moitié d'un ouvrage tour à tour admiré, et remplissant le monde, perdu, recherché vainement, et sortant tout à coup en lambeaux des feuilles oubliées d'un parchemin que la pieuse barbarie du moyen âge avait consacré à une tout autre destination.
Cicéron avait d'abord divisé la République en neuf, livres pour répondre au nombre de jours des féeries latines, pendant lesquelles l'artifice de la composition voulait que l'entretien qui remplit l'ouvrage eût été tenu. Il réduisit ensuite les neuf livres à six, et le nombre de jours à trois. De ces six livres, le manuscrit du Vatican nous a fait retrouver une grande partie du premier, un long fragment du second, quelques beaux détails du troisième, et enfin deux ou trois pages du quatrième et du cinquième. Le sixième livre est encore réduit, dans l'édition de M. Angelo Maï, au songe de Scipion et à quelques phrases sans lien, recueillies par les écrivains anciens qui citaient souvent Cicéron et ce traité en particulier. De toutes ces pièces éparses, nous pourrons cependant, sans trop d'imperfection et d'arbitraire, recomposer un tout, qui ne sera pas la République de Cicéron telle qu'elle est sortie des mains de son auteur, mais qui nous en donnera une juste idée, nous en montrera les principales divisions, le but et l'esprit. Cicéron, qui aimait à mettre ses pensées dans la bouche des plus célèbres de ses concitoyens, et surtout des hommes anciens, à la fois très illustres et très graves, pour donner à ses propres sentiments l'autorité de ces grands noms, a rassemblé dans le traité de la République tout ce que Rome contenait de plus fameux à l'une des plus glorieuses époques de son histoire. Scipion Émilien, Lélius, Manilius, Tubéron, Philus, Fannius, Scévola, sont les principaux personnages de ces dialogues; Scipion en est le héros; Lélius y défend la cause de la justice; tous ensemble recherchent quelles sont les conditions de la vie politique, comment une nation doit être constituée, d'où vient la grandeur de l'empire romain, et par quelles sages maximes, quelles institutions et quelles lois ou pourra le maintenir, le protéger et le perpétuer. Le premier livre est consacré à la discussion des diverses formes de gouvernement: c'est un entretien purement théorique, dont le but est d'établir les vrais principes de toute politique, en dehors des applications, et un peu dans le monde idéal, comme avait fait Platon, mais avec un sentiment bien plus vif de la réalité, et un bon sens pratique qui perce jusque dans cette métaphysique politique. Cicéron, qui veut au moins imiter l'art de Platon, s'il repousse ses conceptions chimériques, n'entre pas en matière dès le début du dialogue. Il fait d'abord porter la conversation des hôtes de Scipion sur un phénomène astronomique, et met en scène la sphère d'Archimède, la science de Gallus, Thaïes, Anaxagore, et les armes que la science naissante avait déjà données au bon sens contre la superstition. L'entretien est ramené à son véritable sujet par une observation de Lélius, qui demande s'il est bien convenable de se promener en esprit parmi les sphères célestes et d'admirer stérilement l'ordre des régions éthérées, quand de toutes parts le désordre s'introduit dans Rome, menace d'ébranler l'empire et d'en compromettre la destinée. Il n'est d'autre moyen de venir en aide à la patrie ainsi travaillée, que de remonter à la source de la bonne direction des États, aux principes de la science politique. Scipion est prié d'exposer à ses amis selon quelles règles il pense que les sociétés doivent être gouvernées. Ici commence le développement des idées de Cicéron, dont il est plus facile peut-être de montrer l'enchaînement que de comprendre le vrai mérite.
Scipion parle d'abord des trois formes de constitution qui ont été remarquées, expliquées et appréciées par tous les écrivains politiques. Il en signale les avantages et les inconvénients, et tout en préférant la royauté à l'aristocratie et surtout à la démocratie, il déclare que, dans sa pensée, la meilleure constitution pour un peuple est celle qui est composée de ces trois formes simples, tempérées les unes par les autres, et formant dans leur réunion un juste équilibre qui maintient dans l'État assez de majesté, assez de lumières et assez de liberté. Toute autre constitution est perpétuellement sur une pente dangereuse, voisine d'un abus, et, en conséquence, d'une révolution. Il n'y a de stabilité que dans l'harmonie des diverses forces naturelles que présente une nation. Hors de cette condition parfaite, les sociétés sont soumises à des vicissitudes fatalement déterminées, qui les font passer de la licence à la tyrannie, et dont il est presque impossible d'arrêter le cours. Mais toutes ces considérations ont, pour des Romains et même pour l'esprit le plus philosophique de Rome, le grand inconvénient d'être purement abstraites, de porter la pensée dans une région idéale dont on ne voit pas trop les relations avec la vie pratique, et de ne pas frapper au but que Lélius avait déterminé. Cicéron se hâte de prendre terre en quelque sorte, et de chercher parmi les sociétés humaines un modèle auquel il rapporte ses préceptes, qui en contrôle la justesse, et lui fournisse cette expérience indispensable aux bons raisonnements sur la politique. Le modèle est bientôt rencontré; Rome l'offrait et l'imposait. C'était, il faut l'avouer, une meilleure école que toutes celles où avaient pu s'instruire les politiques de la Grèce, et en présence de l'empire romain, on était moins exposé à mépriser la réalité et à construire des cités imaginaires, qu'à la vue de la mobilité et de l'abaissement d'Athènes, ou de l'égoïsme étroit et des dures institutions de Lacédémone. Le second livre contenait l'histoire de la constitution romaine, depuis les premiers essais de Romulus jusqu'à l'entier développement de la République. Le fragment de ce livre, retrouvé dans le manuscrit du Vatican, ne nous conduit que jusqu'à l'époque des Décemvirs; probablement la moitié de cette histoire philosophique nous manque. Cicéron essayait de prouver que la supériorité de la constitution romaine venait de ce qu'elle n'était pas l'œuvre d'un seul homme et le monument d'une seule génération, mais le fruit de l'expérience de plusieurs siècles, et du génie d'une longue suite de grands hommes. En même temps qu'il mettait en lumière l'excellence des institutions romaines, il montrait comment, jusqu'à l'époque de leur accomplissement, la République n'avait jamais été stable, et s'était vue soumise aux vicissitudes dont il est parlé dans le premier livre. Pour Cicéron, la constitution des beaux temps de la République offrait la perfection et l'équilibre que demandait Scipion: les consuls représentaient l'autorité royale, le sénat était le modèle de l'aristocratie éclairée et vertueuse, le peuple avait une juste mesure de liberté: doucement contenu, il ne manquait ni de droits ni de puissance.
Dans le troisième livre, la politique est rattachée à la morale; les sophismes odieux qui voulaient ôter à la justice la conduite des États, et allaient jusqu'à nier la justice elle-même, en attaquant le droit et la sainteté des lois dans leur source, toute cette doctrine que Rome n'avait pas portée, mais qu'elle avait reçue de la Grèce, est réfutée par Lélius avec entraînement et une éloquence pleine d'élévation. Philus s'était chargé d'abord de soutenir la cause de l'injustice; il avait reproduit toutes les plus fortes objections de Carnéade contre la justice et le droit naturel, objections qui remontaient à Gorgias et aux sophistes, et que dans tous les temps quelques esprits faux, corrompus ou chagrins, ont essayé de remettre en honneur. Malheureusement nous n'avons qu'une partie fort restreinte du beau discours de Lélius; et nous ne voyons qu'imparfaitement par quelles raisons profondes Cicéron était conduit à identifier la politique et la morale, et à vouloir que toutes les lois humaines fussent prises à la source éternellement pure du droit naturel et divin. Après avoir démontré que la justice doit régner sur le monde, il soumet à cette première maîtresse toutes les formes de gouvernement, et, les jugeant de plus haut encore qu'il n'avait fait jusqu'ici, il affirme que sans la justice il n'est plus ni rois, ni gouvernement, ni autorité, ni peuples. Ce qui nous reste du quatrième et du cinquième livre est trop peu de chose, et entre ces fragments isolés il y a trop peu de liens pour qu'il soit possible d'indiquer avec quelques détails l'objet de ces nouveaux entretiens. On peut soupçonner que, dans le quatrième livre, Cicéron parlait des mœurs, et dans le cinquième des règles du gouvernement et des devoirs de l'homme politique.
Enfin, dans le sixième, il s'élevait, selon toute vraisemblance, des lois et des institutions humaines, à la religion, au culte, à l'influence salutaire de la crainte des Dieux et de la croyance à une autre vie. Le seul fragment important que nous ayons de ce livre est le songe de Scipion; nous ne le devons point au palimpseste de Rome; Macrobe l'avait commenté, et, ce qui valait mieux, reproduit; et l'ouvrage de Macrobe s'est conservé. Les copies du songe de Scipion n'ont jamais été rares, et il est peu de pages détachées des ouvrages anciens dont on ait plus parlé que de celles-ci. Scipion raconte à ses amis que, pendant son premier séjour en Afrique, recevant l'hospitalité sous le toit du vieux Massinissa, il vit en songe l'Africain son aïeul lui apparaître, et l'enlever en esprit dans les demeures célestes. L'univers entier se dévoila à ses yeux; il entendit l'harmonie des sphères, et vit partout un ordre merveilleux et la main de Dieu sur le monde. Le vainqueur d'Annibal lui apprit à mépriser la terre, ce globe misérable perdu dans l'infinie grandeur des cieux; à élever sa pensée vers les biens impérissables, à ne chercher d'autre gloire que celle de la vertu et de l'immortalité. Au milieu de ces sublimes idées, qu'on croirait inspirées par le christianisme, on regrette de trouver une démonstration subtile de l'éternité de l'âme, et une copie d'un passage de Platon, déjà reproduit dans les Tusculanes, et où le génie de Cicéron ne se reconnaîtra jamais. M. Villemain a dit avec beaucoup de goût: «Le songe de Scipion est un exemple de ce que la raison et l'enthousiasme peuvent faire pour s'élever à l'éternelle vérité, et de ce qui leur manque toujours pour y parvenir, c'est un monument précieux, tout à la fois parce qu'il est sublime, et parce qu'il est insuffisant. Quelle que soit en effet l'élévation et l'éloquence de ce morceau, il semble que la simplicité de la grande vérité qu'il renferme est souvent altérée par les raisonnements d'une philosophie argutieuse et subtile. Que d'efforts, que d'expressions scolastiques pour prouver que l'âme est immortelle, parce qu'elle a son mouvement en elle-même! Les descriptions du monde céleste, le bruit harmonieux des sphères, et toute cette théurgie pythagoricienne dont Cicéron fait un grand usage, forment aussi un bien petit spectacle à côté de l'immensité réelle de l'univers. Mais l'épisode entier n'en conserve pas moins une vraie magnificence de pensées et d'expressions.»
Ce qui nous reste de la République suffit pour que nous puissions, en connaissance de cause, confirmer l'opinion, généralement accréditée dans les temps anciens, que c'était là l'ouvrage le plus parfait de Cicéron. Ce traité de politique l'emporte de beaucoup sur les autres écrits philosophiques de notre auteur. Ici ce n'est point un disciple de la Grèce expliquant en beaux termes des systèmes que l'esprit romain n'aurait jamais conçus: c'est le plus fin et le plus vaste génie de Rome parlant de la constitution et de la force des États au milieu de la plus grande république du inonde, et trouvant sans effort, dans son expérience et sa pensée, des vérités que la Grèce n'avait pas connues, ou qu'elle n'avait pu saisir avec cette haute simplicité et ce bon sens parfait, si nécessaires à qui entreprend de juger les affaires. On voit que, dans la composition de la République, Cicéron est à l'aise; il a naturellement l'élévation d'un philosophe et le tact d'un grand homme d'État; il sait comprendre les hommes; il méprise autant les abstractions sonores que les esprits chimériques dédaignent la réalité; il a reçu de la nature cet heureux mélange de raison et de sagesse pratique, ce tempérament d'esprit si rare et qui n'exclut point la noblesse, enfin toutes ces qualités précieuses qui valent mieux que la sublimité d'un génie en divorce avec le monde, et qui forment seules le moraliste et le politique. Le traité de la République a été publié pour la première fois en France en 1823. M. Villemain en a donné à la fois le texte et la traduction. Il a joint à cette traduction un discours préliminaire qui est à lui seul un ouvrage très intéressant, et l'un des meilleurs écrits sur la politique ancienne. Il a essayé, dans des dissertations ingénieuses et pleines d'érudition et de goût, de suppléer aux lacunes du manuscrit de Rome, et de nous tracer une esquisse des cinquième et sixième livres, qui de tous eussent été les plus curieux pour les lecteurs modernes. Quelques années après, M. Le Clerc a donné de la République une traduction nouvelle dans son édition complète des œuvres de Cicéron. Après de tels maîtres, qu'est-il permis de faire, si ce n'est de les prendre pour guides? C'est à eux, et aux notes excellentes de M. Angelo Mai, que nous devons tout ce qui n'est pas trop imparfait dans notre humble copie d'un si grand modèle.
I. ... Sans cette vertu, C. Duellius, Aulus Atilius, L. Métellus n'auraient point délivré Rome de la terreur de Carthage; les deux Scipions n'auraient point éteint dans leur sang l'incendie de la seconde guerre Punique, qui jetait ses premières flammes. Quand il éclata de nouveau plus menaçant et plus vif, ce fléau n'eût pas été victorieusement combattu par Q. Maximus, étouffé par M. Marcellus; et des portes de Rome qu'il assiégeait, rejeté par P. l'Africain jusque dans le sein de la cité ennemie. M. Caton, que nous regardons tous, nous qui marchons sur ses traces, comme le modèle du citoyen actif et dévoué, pouvait sans doute, alors qu'il était inconnu et sans nom, goûter les douceurs du repos dans les champs de Tusculum, sous ce beau ciel et si près de Rome. Mais il fut assez insensé, si l'on en croit ces partisans de la mollesse, pour s'exposer jusqu'à son extrême vieillesse, sans que rien lui en fit un devoir, sur cette mer orageuse des affaires publiques, et préférer tant d'agitation aux charmes d'une vie retirée et tranquille. Je pourrais citer un nombre infini d'hommes qui tous ont rendu à notre patrie des services signalés; mais je me fais surtout une loi de ne nommer aucun de ceux qui se rapprochent de notre âge, afin que personne ne puisse se plaindre de mon silence sur quelqu'un de sa famille ou sur lui-même. Tout ce que je veux faire entendre, c'est que la nature a fait aux hommes une telle nécessité de la vertu, et leur a inspiré une si vive ardeur pour la défense du salut commun, que cette noble impulsion triomphe facilement de toutes les séductions de la volupté et du repos.
II. Il n'en est pas de la vertu comme d'un art, on ne l'a point si on ne la met en pratique. Vous pouvez ne pas exercer un art et le posséder cependant, car il demeure avec la théorie; la vertu est tout entière dans les oeuvres, et le plus grand emploi de la vertu, c'est le gouvernement des États, et la perfection accomplie, non plus en paroles, mais en réalité, de toutes ces grandes parties dont on fait tant de bruit dans la poussière des écoles. Il n'est aucun précepte de la philosophie, j'entends de ceux qui sont honnêtes et dignes de l'homme, qui n'ait été quelque part deviné et mis en pratique par les législateurs des peuples. D'où viennent la piété et la religion? A qui devons-nous le droit public et les lois civiles? La justice, la bonne foi, l'équité, et avec elles la pudeur, la tempérance, cette noble aversion pour ce qui nous dégrade, l'amour de la gloire et de l'honneur, le courage à supporter les travaux et les périls, qui donc les a enseignés aux hommes? Ceux-là même qui, après avoir confié à l'éducation les semences de toutes ces vertus, ont établi les unes dans les moeurs, et sanctionné les autres par les lois. On demandait à l'un des plus célèbres philosophes, Xénocrate, ce que ses disciples gagnaient à ses leçons : "Ce qu'ils y gagnent? répondit-il ; c'est qu'ils apprennent à faire de leur propre mouvement ce que les lois ordonnent." Il faut donc en conclure que celui qui obtient d'un peuple entier, par l'empire salutaire et le frein des lois, ce que les philosophes peuvent à grand'peine persuader à quelques auditeurs, doit être mis fort au-dessus de ces docteurs habiles, malgré tous leurs beaux discours. Quelles merveilles leur talent peut-il produire, qui soient comparables à un grand corps social parfaitement établi sur le double fondement des lois et des moeurs? Autant les grandes villes, "les cités dominatrices," comme les appelle Ennius, l'emportent sur les bourgades et les châteaux forts, autant il me semble que la sagesse des hommes qui gouvernent ces cités et en règlent les destins, s'élève au-dessus d'une doctrine conçue loin du monde et du jour des affaires. Ainsi donc, puisque notre plus grande ambition est de servir la cause du genre humain; puisque nos pensées et nos efforts n'ont véritablement qu'un seul but, donner à la vie de l'homme plus de sécurité et en accroître les ressources; puisque la nature elle-même nous donne un si généreux élan, poursuivons cette carrière, où nous voyons devant nous tout ce que le monde a compté d'hommes excellents, et n'écoutons point ces efféminés qui sonnent la retraite, et voudraient rappeler ceux que leur ardeur a déjà emportés.
III. A ces raisons si certaines et si évidentes, qu'opposent les philosophes que je combats? D'abord les rudes travaux sans lesquels on ne peut servir son pays; obstacle bien peu fait pour arrêter un homme vigilant et actif, obstacle méprisable non seulement au prix de tels intérêts, mais même dans la poursuite des biens de l'esprit les moins relevés, dans l'accomplissement des devoirs les moins importants, dans les affaires les plus simples. Ils parlent ensuite des périls que l'on court sans cesse, et cherchent à inspirer aux hommes de coeur cette terreur de la mort qui retient les lâches, oubliant que les hommes de cette trempe regardent comme un plus grand malheur d'être lentement consumés et de s'éteindre de vieillesse, que de faire à la patrie, dans une belle occasion, le sacrifice de cette vie, que tôt ou tard il eût fallu rendre à la nature. Mais où croient triompher ces philosophes paresseux? c'est quand ils rassemblent toutes les infortunes des grands hommes, et les traitements indignes que leur a fait souffrir l'ingratitude de leurs concitoyens. La Grèce leur fournit plus d'un douloureux exemple : Miltiade, victorieux des Perses anéantis par ses armes, la poitrine encore saignante des blessures qu'il a reçues au milieu de son éclatante victoire, trouve dans les prisons d'Athènes la mort qui l'avait épargné sur le champ de bataille; Thémistocle, proscrit par le peuple qu'il a sauvé, craignant pour ses jours, vient chercher un asile non dans les ports de la Grèce dont il est le libérateur, mais sur les rivages des Barbares que ses armes ont moissonnés. Les exemples de l'inconstance des Athéniens et de leur cruauté envers leurs plus grands hommes sont innombrables; l'ingratitude a pris en quelque façon naissance chez eux, et partout nous en voyons les marques; mais dans Rome même, dans l'histoire de cette grave cité, ne les retrouvons-nous pas à chaque pas? On cite alors l'exil de Camille, la haine qui poursuivait Ahala, l'impopularité de Nasica, la proscription de Lénas, la condamnation d'Opimius, la fuite de Métellus, Marius et son affreux destin, les chefs de l'État immolés, et les maux terribles qui bientôt après désolèrent notre patrie. Il n'y a pas jusqu'à mon nom qui ne soit invoqué : et parce que ces amis de la paix croient sans doute qu'au prix de mes veilles et de mes périls j'ai protégé leur vie et garanti leur repos, ils me plaignent avec plus d'effusion et de sympathie que pas un autre. Mais moi, je ne puis comprendre comment des hommes qui, pour s'instruire et voir le monde, traversent les mers ... (LACUNE)
IV. Lorsqu'au sortir de mon consulat, je pus déclarer avec serment, devant Rome assemblée, que j'avais sauvé la république, alors que le peuple entier répéta mon serment, j'éprouvai assez de bonheur pour être dédommagé à la fois de toutes les injustices et de toutes les infortunes. Cependant j'ai trouvé dans mes malheurs mêmes plus d'honneur que de peine, moins d'amertume que de gloire; et les regrets des gens de bien ont plus réjoui mon coeur que la joie des méchants ne l'avait attristé. Mais, je le répète, si ma disgrâce avait eu un dénoûment moins heureux, de quoi pourrais-je me plaindre? J'avais tout prévu, et je n'attendais pas moins pour prix de mes services. Quelle avait été ma conduite? La vie privée m'offrait plus de charmes qu'à tout autre, car je cultivais depuis mon enfance les études libérales, si variées, si délicieuses pour l'esprit : qu'une grande calamité vînt à nous frapper tous, du moins ne m'eût-elle pas plus particulièrement atteint, le sort commun eût été mon partage : eh bien! je n'avais pas hésité à affronter les plus terribles tempêtes, et, si je l'ose dire, la foudre elle-même, pour sauver mes concitoyens, et à dévouer ma tête pour le repos et la liberté de mon pays. Car notre patrie ne nous a point donné les trésors de la vie et de l'éducation pour ne point en attendre un jour les fruits, pour servir sans retour nos propres intérêts, protéger notre repos et abriter nos paisibles puissances; mais pour avoir un titre sacré sur toutes les meilleures facultés de notre âme, de notre esprit, de notre raison, les employer à la servir elle-même, et ne nous en abandonner l'usage qu'après en avoir tiré tout le parti que ses besoins réclament.
V. Ceux qui veulent jouir sans discussion d'un repos inaltérable recourent à des excuses qui ne méritent pas d'être écoutées : Le plus souvent, disent-ils, les affaires publiques sont envahies par des hommes indignes, à la société desquels il serait honteux de se trouver mêlé, avec qui il serait triste et dangereux de lutter, surtout quand les passions populaires sont en jeu; c'est donc une folie que de vouloir gouverner les hommes, puisqu'on ne peut dompter les emportements aveugles et terribles de la multitude ; c'est se dégrader que de descendre dans l'arène avec des adversaires sortis de la fange, qui n'ont pour toutes armes que les injures, et tout cet arsenal d'outrages qu'un sage ne doit pas supporter. Comme si les hommes de bien, ceux qui ont un beau caractère et un grand cœur pouvaient jamais ambitionner le pouvoir dans un but plus légitime que celui de secouer le joug des méchants, et ne point souffrir qu'ils mettent en pièces la république, qu'un jour les honnêtes gens voudraient enfin , mais vainement, relever de ses ruines.
VI. Ils nous accordent une exception, il est vrai, mais qui ne peut faire passer leur système; le sage ne doit, selon eux, se mêler d'affaires publiques que s'il y est contraint par la nécessité et dans des circonstances éminemment critiques. Y eut-il jamais, je le demande, de circonstances plus critiques que celles où je me trouvai moi-même? et dans ces circonstances qu'aurais-je pu faire, si je n'avais été consul? et le titre de consul, comment aurais-je pu l'obtenir, si je ne m'étais dès mon enfance avancé dans cette carrière qui m'a conduit par degrés, moi obscur chevalier romain, à cet honneur suprême? Vous ne pouvez donc venir au secours de votre patrie, quand vous le souhaitez, dans une circonstance critique, dans un danger pressant, si vous n'êtes déjà en position de la servir. Ce que j'admire surtout dans les écrits de ces philosophes, c'est que des hommes qui sur une mer calme ne croiraient pas pouvoir servir de pilotes, parce qu'ils n'ont pas appris l'art de tenir le gouvernail, déclarent qu'ils sont tout prêts à conduire un vaisseau au milieu des tempêtes. Ils disent fort ouvertement qu'ils n'ont jamais appris et qu'ils n'enseignent pas l'art de constituer et de gouvernér les Etats; ils le disent et s'en font gloire; ils soutiennent que ce n'est pas là l'affaire des savants ni des sages, et qu'il faut laisser ce soin aux politiques. Mais alors pourquoi promettre de prêter leur secours à l'État, si la nécessité les y contraint? pourquoi, lorsqu'ils avouent qu'ils seraient incapables de prendre part aux affaires publiques dans les temps ordinaires, et sans comparaison plus faciles? Mais entrons dans leurs vues; admettons que le sage ne descendra pas volontairement à s'occuper des intérêts de 1'Etat, mais que si les circonstances l'y obligent jamais, il ne reculera point devant le fardeau qu'elles lui imposeront : je dis qu'alors même le sage ne doit point négliger l'étude de la politique, car il est de son devoir de se préparer à toutes les ressources dont il ignore s'il ne sera pas un jour obligé de faire usage.
VII. Si je me suis étendu sur ce sujet, c'est que me proposant de traiter de la République dans cet ouvrage, et ne voulant pas faire un livre inutile, je devais avant tout lever tous les doutes sur l'excellence de la vie publique. S'il est des esprits qui aient besoin pour se rendre de l'autorité des philosophes, qu'ils jettent les yeux sur les écrits de ceux qui tiennent la première place dans l'estime des meilleurs juges, et dont la gloire est incomparable; ils verront ce que pensent ces grands maîtres, qui tous n'ont pas eu des Etats à gouverner, mais qui, méditant et écrivant avec tant d'ardeur sur les sociétés humaines, me semblent avoir exercé par là quelque importante magistrature. Quant aux sept sages dont la Grèce s'honore, je les vois presque tous engagés dans les affaires publiques. C'est qu'en effet l'homme ne se rapproche jamais plus de la Divinité que lorsqu'il fonde des sociétés nouvelles, ou conduit heureusement celles qui déjà sont établies.
VIII. Pour nous, nous avons peut-être plus d'un titre à entreprendre cet ouvrage; car nous réunissons le double avantage d'avoir signalé notre carrière politique par quelque fait digne de mémoire, et acquis par l'expérience, par l'étude et l'usage constant de communiquer nos connaissances, une certaine facilité à traiter ces matières délicates; tandis que ceux qui nous ont ouvert la carrière ont tous été ou d'élégants écrivains, dont on ne pourrait citer aucune action mémorable, ou des politiques habiles, mais étrangers à l'art d'écrire. D'ailleurs mon intention n'est pas de développer ici un nouveau système politique éclos de mon imagination, mais de rapporter en narrateur fidèle , et tel que nous l'avons entendu de la bouche de P. Rutilius Rufus, lorsque nous passâmes, vous et moi, vous bien jeune alors, plusieurs jours à Smyrne, l'entretien de quelques anciens Romains, les plus illustres de leur temps et les plus sages de notre république. Dans cet entretien se trouve rassemblé, à ce que je crois, tout ce qui a un rapport essentiel aux intérêts et au gouvernement des Etats.
IX. On était alors sous le consulat de Tuditanus et d'Aquillius; Publius l'Africain, le fils de Paul Émile, avait décidé qu'il passerait les féries Latines dans ses jardins, et ses plus intimes amis lui avaient promis de venir le voir souvent pendant ces jours de fêtes. Le premier luisait à peine, que Q. Tubéron, son neveu, devançant tous les autres, se présente. Scipion, charmé de le voir et lui faisant un aimable accueil : Eh quoi ! mon cher Tubéron, lui dit-il, vous si matin chez moi ! ces jours de repos vous offraient cependant une belle occasion de vous livrer à vos études favorites. — J'ai tout le temps d'être avec mes livres, répondit Tubéron, car personne ne me les dispute; mais c'est une bonne fortune que de vous trouver de loisir, surtout à une époque orageuse comme celle-ci. — De loisir, je le veux bien; mais je vous avoue que vous me trouvez plus libre de corps que d'esprit. — Cependant, reprit Tubéron, il faudra bien que vous donniez aussi quelque relâche à votre esprit; car nous sommes plusieurs qui avons formé le dessein, si notre empressement ne vous est pas importun, de venir goûter dans votre société le repos que les féries nous donnent. — Ce me sera une distraction fort agréable, et j'espère qu'elle nous rendra pour un temps aux douces préoccupations de la science.
X. — Voulez- vous donc, Scipion, puisque vous m'encouragez et me donnez l'espoir de vous entendre, que nous examinions ensemble, avant l'arrivée de nos amis, ce que ce peut être que ce second soleil dont on a annoncé l'apparition au sénat? Ceux qui déclarent avoir vu deux soleils sont nombreux et méritent confiance; il ne peut être question de contester ce prodige; le mieux, selon moi, est de chercher à l'expliquer. — Que n'avons-nous ici, dit alors Scipion, notre ami Panétius, qui étudie avec tant d'ardeur tous les secrets de la nature, et surtout ces phénomènes célestes! Mais, à vrai dire, Tubéron, car je veux vous déclarer franchement ce que je pense, pour toutes ces questions mystérieuses je ne m'en rapporte pas aveuglément à notre confiant ami; bien des choses qu'il est déjà très hardi de conjecturer, Panétius les affirme avec tant d'assurance qu'il semble les voir de ses yeux ou les toucher de ses mains. Cette témérité me fait mieux apprécier toute la sagesse de Socrate, qui s'était interdit ces recherches curieuses, et avait pour maxime que la découverte des secrets de la nature excède la portée de notre esprit, et n'est absolument d'aucun intérêt pour la vie humaine. — Je ne sais, reprit Tubéron, pourquoi l'opinion s'est répandue que Socrate proscrivait toutes les recherches physiques et ne s'occupait que de morale. Qui peut nous faire connaître Socrate avec autant d'autorité que Platon? et ne voyons-nous pas dans les dialogues du disciple le maître parler en plus de vingt endroits non pas seulement des moeurs, des vertus, de la république, mais des nombres de la géométrie divine, de l'harmonie des sphères, à l'exemple de Pythagore? — Je suis loin de contester ce que vous dites, Tubéron ; mais vous devez savoir qu'après la mort de Socrate, Platon, emporté par l'amour de la science, alla d'abord en Égypte, et vint plus tard en Italie et en Sicile pour s'instruire dans la doctrine de Pythagore; vous savez qu'il eut de fréquents entretiens avec Archytas de Tarente et Timée de Locres, qu'il recueillit tous les ouvrages de Philolaüs, et que dans ces contrées, que remplissait à cette époque la renommée de Pythagore, il se livra aux hommes de cette école et à leurs études favorites. Mais comme il avait voué un culte exclusif à Socrate et qu'il voulait lui faire honneur de toutes les richesses de son esprit, il unit avec art la grâce Socratique et son habile dialectique aux dogmes obscurs et aux graves enseignements de Pythagore.
XI. A peine Scipion avait-il prononcé ces derniers mots, qu'il vit entrer L. Furius; il le salua, le prit amicalement par la main, et le fit asseoir près de lui. P. Rutilius, celui qui nous a rapporté cet entretien, arrivait en même temps. Scipion, après les premiers compliments, lui fit prendre place près de Tubéron. De quoi parliez-vous? dit alors Furius; est-ce que notre brusque arrivée aurait mis fin à votre conversation? — NulIement,: répondit Scipion; car la question que Tubéron avait soulevée entre nous est de celles qui ont d'ordinaire le privilège de vous intéresser vivement. Et quant à Rutilius, je me souviens que sous les remparts mêmes de Numance il proposait parfois des sujets semblables à nos entretiens. — Mais enfin, de quoi était-il question? demanda Philus. —De ces deux soleils dont tout le monde parle, dit Scipion; et j'aurais grande envie de savoir ce que vous-même pensez de ce prodige.
XII. A cet instant, un esclave vint annoncer que Lélius sortait de chez lui et se dirigeait vers les jardins de Scipion. Celui-ci se lève, met à la hâte sa chaussure et une toge, et sort de son appartement; après avoir fait quelques pas sous le portique, il rencontre et reçoit Lélius, et avec lui Spurius Mummius, pour qui il avait une tendresse particulière; C. Fannius et Q. Scévola, tous deux gendres de Lélius, jeunes gens d'un esprit fort cultivé, et qui déjà avaient atteint l'âge de la questure. Scipion fait accueil à chacun, puis il se retourne pour les conduire, en ayant soin de laisser la place du milieu à Lélius. C'était en effet comme une convention sacrée de leur amitié, que dans les camps Lélius honorât Scipion comme un dieu, à cause de sa grande gloire militaire, et qu'une fois les armes déposées, Scipion à son tour témoignât le respect d'un fils à Lélius, qui avait plus d'âge que lui. Toute la société fit d'abord un ou deux tours sous le portique, en échangeant quelques paroles de bienvenue. Bientôt Scipion, qui était heureux et charmé de l'arrivée de ces hôtes, leur offrit de venir se reposer à l'endroit de la prairie le plus exposé au soleil, car on était alors en hiver. Ils se rendaient à son invitation, lorsque survint un habile jurisconsulte, M. Manilius, qui leur était cher et agréable à tous; Scipion et la société le reçurent avec un empressement affectueux, et il alla prendre place auprès de Lélius.
XIII. Je ne crois pas, dit alors Philus, que l'arrivée de nos amis doive nous faire changer d'entretien ; la seule obligation qu'elle nous impose, c'est de traiter le sujet avec le plus grand soin, et de nous montrer dignes d'un tel auditoire. — Quel est donc ce sujet, demanda Lélius, et quelle conversation avons-nous interrompue ? — Scipion me demandait, dit Philus, ce que je pensais de l'apparition incontestable d'un second soleil. — Lélius. Eh quoi! Philus, sommes-nous assez édifiés sur ce qui se passe chez nous ou dans la république, pour nous mettre ainsi en quête des phénomènes célestes? — Philus. Croyez-vous donc, Lélius, que nos intérêts les plus chers ne demandent pas que nous sachions ce qui se passe dans notre propre demeure? Mais la demeure de l'homme n'est pas renfermée dans l'étroite enceinte d'une maison; elle est aussi vaste que le monde, cette patrie que les Dieux ont voulu partager avec nous. Et d'ailleurs, si nous ignorons ce qui se passe dans les cieux , combien de vérités, que de choses importantes nous seront éternellement cachées! Pour moi du moins, et je puis dire hardiment pour vous aussi, Lélius, et pour tous les vrais amis de la sagesse, étudier la nature, approfondir ses mystères, est une source de plaisirs inexprimables. — Lélius. Je ne m'oppose pas à ces belles spéculations, surtout un jour de fête; mais pouvons-nous encore vous entendre, ou sommes-nous arrivés trop tard? — Philus. Nous n'avions pas même commencé; le champ est entièrement libre, et je suis tout prêt, Lélius, à vous céder la parole. — Lélius. Il vaut bien mieux vous entendre; à moins toutefois que Manilius ne veuille, en jurisconsulte consommé, régler le litige entre les deux soleils, et assigner à chacun la possession définitive d'une partie du ciel. — Manilius. Vous ne cesserez donc pas, Lélius, de tourner en raillerie un art dans lequel vous excellez vous-même, et dont les lumières sont indispensables à l'homme pour qu'il sache quel est son droit, quel est le droit d'autrui? Tout n'est pas dit là-dessus entre nous; mais pour le moment écoutons Philus, que l'on consulte, à ce que je vois, sur des matières plus graves que celles qui nous exercent d'ordinaire, Mucius et moi.
XIV. Ce que je vous dirai, reprit Philus, n'est pas nouveau; je n'en suis pas l'inventeur et ma mémoire seule en fera les frais. Je me souviens que C. Sulpicius Gallus, un des plus savants hommes de notre puys, comme vous ne l'ignorez pas, s'étant rencontré par hasard chez M. Marcellus, qui naguère avait été consul avec lui, la conversation tomba sur un prodige exactement semblable; et que Gallus fit apporter cette fameuse sphère, seule dépouille dont l'aïeul de Marcellus voulut orner sa maison après la prise de Syracuse, ville si pleine de trésors et de merveilles. J'avais souvent entendu parler de cette sphère qui passait pour le chef-d'œuvre d'Archimède, et j'avoue qu'au premier coup d'oeil elle ne me parut pas fort extraordinaire. Marcellus avait déposé dans le temple de la Vertu une autre sphère d'Archimède, plus connue du peuple et qui avait beaucoup plus d'apparence. Mais lorsque Gallus eut commencé à nous expliquer, avec une science infinie, tout le système de ce bel ouvrage, je ne pus m'empêcher de juger qu'il y avait eu dans ce Sicilien un génie d'une portée à laquelle la nature humaine ne me paraissait pas capable d'atteindre. Gallus nous disait que l'invention de cette autre sphère solide et pleine remontait assez haut, et que Thalès de Milet en avait exécuté le premier modèle; que dans la suite Eudoxe de Cnide, disciple de Platon, avait représenté à sa surface les diverses constellations attachées à la voûte du ciel ; et que, longues années après, Aratus, qui n'était pas astronome, mais qui avait un certain talent poétique, décrivit en vers tout le ciel d'Eudoxe. Il ajoutait que, pour figurer les mouvements du soleil, de la lune et des cinq étoiles que nous appelons errantes, il avait fallu renoncer à la sphère solide, incapable de les reproduire, et en imaginer une toute différente; que la merveille de l'invention d'Archimède était l'art avec lequel il avait su combiner dans un seul système et effectuer par la seule rotation tous les mouvements dissemblables et les révolutions inégales des différents astres. Lorsque Gallus mettait la sphère en mouvement, on voyait à chaque tour la lune succéder au soleil dans l'horizon terrestre, comme elle lui succède tous les jours dans le ciel ; on voyait par conséquent, le soleil disparaître comme dans le ciel, et peu à peu la lune venir se plonger dans l'ombre de la terre, au moment même où le soleil du côté opposé ... (LACUNE).
XV Scipion ... J'étais moi-même fort attaché à Gallus, et je savais que Paul-Émile, mon père, l'avait singulièrement apprécié et beaucoup aimé. Je me souviens que dans ma première jeunesse, lorsque mon père commandait les armées romaines en Macédoine, une nuit que nous étions dans les camps, toutes nos légions furent frappées d'une terreur religieuse, parce que la lune, alors dans tout son éclat, s'était soudainement obscurcie. Gallus, qui dans cette campagne était le lieutenant de mon père, une année environ avant son consulat, n'hésita pas à déclarer le lendemain aux légions qu'il n'y avait eu aucun prodige, que ce phénomène était dans l'ordre de la nature et se reproduirait à des époques réglées, toutes les fois que le soleil se trouverait situé de manière à ne pouvoir éclairer la lune de ses rayons. — Mais c'est une vraie merveille, dit Tubéron; comment Gallus a-t-il pu faire comprendre cette explication à des hommes grossiers? comment a-t-il osé braver la superstition de ces soldats ignorants? Il l'a fait, reprit Scipion, et avec une grande.... (LACUNE). .... Point de vaine ostentation, point de langage indigne d'un homme grave; et ce n'était pas un médiocre succès que d'affranchir ces esprits troublés et superstitieux de leur folle terreur.
XVI. Il arriva quelque chose d'assez semblable pendant la longue guerre que se firent les Athéniens et les Lacédémoniens avec un si terrible acharnement. On nous rapporte que Périclès, qui par son crédit, son éloquence et son habile politique, était devenu le chef d'Athènes, voyant ses concitoyens consternés d'une éclipse de soleil qui les avait plongés dans des ténèbres subites, leur expliqua ce qu'il avait appris lui-même de son maître Anaxagore, qu'un pareil phénomène est dans l'ordre de la nature et se reproduit à des époques déterminées, lorsque le disque de la lune s'interpose tout entier entre le soleil et nous; et que s'il n'est pas amené à chaque renouvellement de la lune, il ne peut toutefois avoir lieu qu'à l'époque précise où la lune se renouvelle. Périclès décrivit aux Athéniens tous ces mouvements astronomiques; il leur en fit comprendre la raison, et dissipa leur terreur ; l'explication des éclipses de soleil par l'interposition de la lune était alors assez nouvelle et peu répandue. Thalès de Milet est, dit-on, le premier qui la proposa. Plus tard elle ne fut pas inconnue à notre poète Ennius, puisqu'il dit que vers l'an 350 de la fondation de Rome, aux nones de juin, le soleil fut dérobé aux hommes par la lune et les ténèbres. Aujourd'hui l'habileté des astronomes et la justesse de leurs calculs vont si loin, qu'à partir de ce jour, indiqué par Ennius et consigné dans les Grandes Annales, ils ont supputé toutes les éclipses de soleil antérieures jusqu'à celle des nones de juillet, arrivée dans le règne de Romulus, et qui répandit sur la terre cette nuit soudaine pendant laquelle le fondateur de Rome, enlevé au monde, subit probablement la loi commune, mais put aux yeux du vulgaire passer pour avoir été ravi au ciel par sa vertu surhumaine.
XVII. Tubéron l'interrompit : Ne voyez-vous pas, Scipion, que malgré le sentiment que vous exprimiez tout à l'heure ... (LACUNE) Scipion. ... Mais qu'est-ce que tout l'éclat des choses humaines, comparé aux magnificences de ce royaume des Dieux ? qu'est-ce que leur durée au prix de l'éternité? Et la gloire, qu'est-elle pour celui qui a vu combien la terre est petite, et encore quelle faible portion de sa surface est habitée par les hommes; qui a su comprendre la vanité de ces pauvres humains, perdus dans un imperceptible canton du monde, à tout jamais inconnus à des peuples entiers, et qui croient que l'univers va retentir du bruit de leur nom? Qu'est-ce que tous les biens de cette vie, pour celui qui ne consent pas même à regarder comme biens, ni champs, ni maisons, ni troupeaux, ni trésors, parce qu'il en trouve la jouissance médiocre, l'usage fort restreint, la possession incertaine, et que souvent les derniers hommes ont toutes ces richesses à profusion? Qui peut se dire véritablement heureux en ce monde? n'est-ce pas celui qui seul peut se reconnaître le maître souverain de toutes choses, non pas en vertu du droit civil, mais au nom du beau privilége des sages; non par un contrat tout couvert de formules, mais par la loi de nature, qui n'admet pour possesseurs des choses que ceux qui savent s'en servir? celui qui voit dans le commandement des armées, dans le consulat lui-même, des charges à accepter par patriotisme, et non des titres à ambitionner, de graves obligations à remplir, et non des honneurs ou de brillants avantages à poursuivre; qui peut enfin comme Scipion mon aïeul, au rapport de Caton, se rendre ce témoignage, qu'il n'est jamais plus actif que lorsqu'il ne fait rien, et jamais moins seul que dans la solitude? Qui pourrait croire en effet que Denys, détruisant par ses menées infatigables la liberté de sa patrie, accomplissait une plus grande oeuvre qu'Archimède son concitoyen, inventant dans son apparente inaction cette sphère dont nous parlions tout à l'heure? L'homme qui, au milieu de la foule, et en plein forum, ne trouve personne avec qui il lui soit agréable d'échanger ses pensées, n'est-il pas plus seul que celui qui, sans témoin, s'entretient avec lui-même, ou, se transportant dans la société des sages, converse avec eux, étudie avec délices leurs découvertes et leurs écrits? Pouvez-vous imaginer un mortel plus riche que celui à qui rien ne manque de ce que la nature réclame; plus puissant que celui qui vient à bout de tout ce qu'il désire; plus heureux que celui dont l'âme n'est agitée par aucun trouble; ou possédant une fortune plus solide que celui qui pourrait, suivant le proverbe, retirer avec lui tous ses trésors du naufrage? Est-il un commandement, une magistrature, une couronne comparable à la grandeur de l'homme qui regardant de haut toutes les choses humaines, et n'accordant de prix qu'à la sagesse, n'entretient sa pensée que d'objets éternels et divins? Il sait de science certaine que si rien n'est plus commun que le nom d'homme, ceux-là seuls devraient le porter qui ont reçu cette culture sans laquelle il n'est point d'homme. Et, à ce propos, il me revient un mot fort heureux de Platon, ou peut-être de quelque autre philosophe. La tempête l'avait jeté sur une plage inconnue et déserte; tandis que ses compagnons d'infortune étaient effrayés de ne pas savoir en quel lieu ils se trouvaient, il aperçut, dit-on, des figures de géométrie tracées sur le sable : "Bon courage, s'écria-t-il, je vois ici des vestiges humains!» Et à quoi les reconnaissait-il? Ce n'était certainement pas à la culture de la terre, mais aux traces d'une meilleure culture, celle de l'esprit. Voilà pourquoi , Tubéron, j'ai toujours eu tant de goût pour la science et les savants, et en particulier pour vos études favorites.
XVIII. Lélius adressant alors la parole à Scipion : Je n'oserais rien objecter à ce que vous venez de dire; et c'est beaucoup moins vous, ou Philus, ou Manilius ... (LACUNE) Nous avons eu dans la famille de Tubéron un ami bien digne de lui servir de modèle, «Elius Sextus, cet homme de tant de sens et de finesse» ; fin et sensé vraiment, et bien nommé par Ennius, non qu'il se creusât l'esprit à chercher ce qu'on ne peut découvrir, mais parce qu'il donnait à ceux qui l'interrogeaient des réponses qui leur soulageaient l'esprit et les tiraient d'affaire. Il livrait à l'astronomie de Gallus de rudes combats, et il avait toujours à la bouche ces vers d'Achille dans Iphigénie : «Tous ces astronomes étudient les mouvements de leurs constellations; c'est Jupiter, c'est la Chèvre, c'est le Scorpion et je ne sais quelle autre bête dont ils veulent voir surgir les cornes; ils ne voient point ce qui est à leurs pieds, et ils veulent lire dans les cieux.» Élius, que j'écoutais souvent et avec grand plaisir, disait encore que le Zéthus de Pacuvius lui paraissait trop ennemi de la science ; il goûtait davantage le Néoptolème d'Ennius, qui veut bien philosopher, mais doucement, car trop ne lui saurait plaire. Si cependant les études des Grecs ont tant de charmes pour vous, il en est de moins abstraites qui conviennent à un plus grand nombre d'esprits, et qui ont au moins une utilité pratique, soit pour notre conduite morale, soit pour le gouvernement des États. Quant aux sciences dont nous parlions, si elles sont bonnes à quelque chose, ce ne peut être qu'à exercer et aiguiser un peu l'esprit des jeunes gens, pour les rendre capables de travaux plus sérieux.
XIX. Tubéron. Je partage votre sentiment, Lélius; mais ces études plus sérieuses, quelles sont-elles dans votre pensée? — Lélius: Je vais vous le dire; mais je crains fort de m'exposer à vos dédains, car c'est vous, je me le rappelle, qui avez proposé à Scipion cette question sur un phénomène céleste, tandis que dans mon opinion il est bien plus important de nous occuper de ce qui est devant nos yeux. Eh quoi! le petit-fils de Paul-Émile, le neveu de Scipion l'Africain, le membre d'une si noble famille, le citoyen d'une si grande république, demande pourquoi l'on a vu deux soleils, et ne demande pas pourquoi nous voyons aujourd'hui dans un seul État deux sénats et presque deux peuples? Vous en êtes témoins comme moi, la mort de Tibérius Gracchus, et auparavant tous les actes de son tribunat, ont divisé le peuple romain en deux camps : les détracteurs et les envieux de Scipion , enrôlés d'abord sous la bannière de P. Crassus et d'Appius Claudius, n'en continuent pas moins, après la mort de ces deux chefs, à entretenir l'hostilité d'une partie du sénat contre nous, Metellus et Mucius en tête; les alliés se remuent, les Latins se soulèvent; on viole les traités; des triumvirs séditieux nous font voir chaque jour des nouveautés étranges; les gens de bien sont menacés dans leurs fortunes, de toutes parts il n'y a que périls : un homme, un homme seul pourrait les conjurer, mais on ne veut pas qu'il sauve son pays. Ainsi donc, jeunes gens, si vous m'en croyez, ne vous mettez pas en peine de ce second soleil : ou c'est une apparition trompeuse, ou c'est un prodige dont nous n'avons rien à redouter; n'espérez pas qu'il nous soit jamais donné de découvrir ces mystères, ou que leur découverte puisse nous rendre meilleurs ni plus heureux: mais l'unité du sénat, la concorde dans le peuple, voilà ce qui est possible, voilà ce dont la perte est une calamité publique; nous savons, nous voyons que cette calamité afflige Rome, et qu'en réunissant nos efforts, nous pouvons renaître à la vertu et au bonheur.
XX. Mucius. Que devons-nous donc apprendre, Lélius,pour être capables de faire ce que vous demandez? — Lélius: L'art de la politique, qui nous rend utiles à notre pays; car c'est là, selon moi, le plus magnifique emploi de la sagesse, la plus grande marque de la vertu, et le premier devoir de la vie. Ainsi, pour consacrer ces jours de fêtes aux entretiens qui peuvent être le plus profitables à notre chère patrie, prions Scipion de nous expliquer quelle est, à ses yeux, la meilleure forme de gouvernement. Nous examinerons ensuite d'autres questions, et lorsqu'elles seront suffisamment éclaircies, nous reviendrons, j'espère, par une voie naturelle, au grave sujet qui nous préoccupait à l'instant, et nous pourrons porter un jugement certain sur l'état critique où Rome est tombée.
XXI. Philus, Manilius et Mummius se joignirent avec empressement à Lélius. (LACUNE). ... comme si un autre ne pouvait tracer ici le modèle d'une autre république. LÉL. Si je me suis adressé à vous, c'est d'abord parce qu'il appartient naturellement au premier citoyen de l'État de parler de la république, en second lieu parce que je me souvenais que vous aviez eu de fréquents entretiens sur cette matière avec Panétius et devant Polybe, deux des plus profonds politiques de toute la Grèce; et qu'après maintes observations et réflexions, vous en étiez venu à conclure que de toutes les formes de gouvernement, celle que nous ont laissée nos ancêtres est incomparablement la meilleure. Préparé comme vous l'êtes sur cet important sujet, vous nous ferez à tous, car je puis répondre pour nos amis, un vrai plaisir en nous expliquant ce que vous pensez de la constitution et de la conduite des États.
XXII. Je dois avouer, Lélius, qu'aucun sujet de méditation n'a plus assidûment et plus vivement exercé mon esprit que celui même qui m'est aujourd'hui proposé par vous. Aussi bien, quand je vois dans toutes les carrières ceux qui sortent de la foule n'avoir d'autre pensée, d'autre soin, d'autre rêve que d'exceller dans leur genre, ne serais-je pas convaincu d'une inertie coupable, moi dont l'unique carrière, toute tracée par l'exemple de mon père et de mes aïeux, est de veiller aux intérêts publics et de conduire les affaires de l'État, si je consacrais au premier de tous les arts moins de veilles et de soins que le plus humble des artisans n'en donne à son métier? Mais je ne suis point satisfait des ouvrages politiques que nous ont laissés les plus grands philosophes et les plus beaux génies de la Grèce; et, d'un autre côté, je n'ose préférer mes propres idées à leurs systèmes. Écoutez-moi donc, je vous prie, non comme un homme à qui les livres des Grecs seraient entièrement inconnus, ou comme un esprit entêté de leurs théories, et commettant la faute, surtout en politique, de les préférer à nos antiques maximes, mais comme un Romain, qui doit à la sollicitude de son père une éducation libérale, qui est enflammé depuis son enfance du désir d'apprendre, et que l'expérience et les enseignements domestiques ont formé bien plus que les livres.
XXIII. Philus. Je suis convaincu, Scipion, qu'il est impossible d'avoir un génie plus heureux que le vôtre, et que pour l'expérience des grandes affaires politiques personne ne vous égale; nous savons d'ailleurs quelle a toujours été votre ardeur pour l'étude. Aussi dès que vous nous donnez l'assurance que vos méditations se sont portées sur l'art difficile et sur les théories dont nous parlons, je ne puis que remercier Lélius du fond de mon coeur ; car j'ai l'espérance que votre entretien nous instruira plus que ne feraient jamais tous les livres des Grecs. — Scipion. Vous promettez à l'avance des merveilles de mon discours. Savez-vous bien que c'est là mettre dans une position difficile celui qui doit parler de grandes choses? — Philus: Quelle que soit notre attente vous la surpasserez, comme c'est votre usage; et il n'est pas à craindre que vous, Scipion, en parlant de la république sentiez tarir vos idées.
XXIV. Scipion: J'essaierai donc de répondre à vos désirs dans la mesure de mes forces ; et, pour débuter, je suivrai une règle à laquelle je crois qu'il faut se conformer dans toutes les discussions, si l'on veut éviter l'erreur. Cette règle consiste, quand le nom de l'objet en question est parfaitement arrêté, à expliquer nettement ce qu'il signifie. Ce n'est qu'après être tombé d'accord sur cette définition que l'on doit entrer en matière; car avant de découvrir quelles qualités une chose doit avoir, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est. Ainsi donc, puisque nous voulons parler de la république, voyons d'abord ce qu'il faut entendre par république. — Lélius fit un signe d'approbation, et Scipion poursuivit : Mon intention n'est pas, en nous entretenant d'une chose si manifeste et si connue, de remonter aux premiers principes, comme font d'ordinaire les philosophes, d'aller prendre mon point de départ à la première union de l'homme et de la femme, aux premiers liens du sang et aux différents noeuds de parenté qui se formèrent bientôt après ; je ne veux pas non plus définir chacun des termes, ni en marquer minutieusement toutes les diverses acceptions : je sais que je parle à des hommes éclairés, et qui se sont montrés, dans la première république du monde, à la fois de grands citoyens et de grands guerriers, et je ne veux pas m'exposer à leur donner des explications plus obscures que la chose même que je prétends éclaircir. Je ne m'engage pas à vous faire, comme un maître de gymnase, une leçon où rien ne soit omis; je ne vous promets pas de tout dire sans négliger le moindre détail. — Lélius: Voilà bien la méthode que j'attendais de vous, Scipion.
XXV. Scipion: La chose publique, comme nous l'appelons, est la chose du peuple; un peuple n'est pas toute réunion d'hommes assemblés au hazard , mais seulement une société formée sous la sauvegarde des lois et dans un but d'utilité commune. Ce qui pousse surtout les hommes à se réunir, c'est moins leur faiblesse que le besoin impérieux de se trouver dans la société de leurs semblables. L'homme n'est pas fait pour vivre isolé, errant dans la solitude; mais sa nature le porte, lors même qu'il serait dans l'affluence de tous les biens ... (LACUNE).
XXVI. Toutes les choses excellentes ont des semences naturelles; ni les vertus, ni la société, ne reposent sur de simples conventions. Les diverses sociétés, formées en vertu de la loi naturelle que j'ai exposée, fixèrent d'abord leur séjour en un lieu déterminé et y établirent leurs demeures; ce lieu fortifié à la fois par la nature et par la main des hommes, et renfermant toutes ces demeures, entre lesquelles s'étendaient les places publiques et s'élevaient les temples, fut appelé forteresse ou ville. Or, tout peuple, c'est-à-dire toute société établie sur les principes que j'ai posés; toute cité, c'est-à-dire toute constitution d'un peuple, toute chose publique, qui est la chose du peuple, comme je l'ai dit déjà, a besoin, pour ne pas périr, d'être gouvernée par intelligence et conseil; et ce conseil doit se rapporter sans cesse et avant tout au principe même qui a produit la société. Il peut être exercé ou par un seul, ou par quelques hommes choisis, ou par la multitude entière. Lorsque le souverain pouvoir est dans les mains d'un seul, ce maître unique prend le nom de roi, et cette forme de gouvernement s'appelle royauté. Lorsqu'il est dans les mains de quelques hommes choisis, c'est le gouvernement aristocratique. Quand le peuple dispose de tout dans l'État, c'est le gouvernement populaire. Chacun de ces trois gouvernements peut, à la condition de maintenir dans toute sa force le lien qui a formé les sociétés humaines, devenir, je ne dirai pas parfait ni excellent, mais tolérable; et suivant les temps l'une ou l'autre de ces constitutions méritera la préférence. Un roi équitable et sage, une aristocratie digne de son nom, le peuple lui-même (quoique l'état populaire soit le moins bon de tous), s'il n'est aveuglé ni par l'iniquité ni par les passions, tous, en un mot, peuvent donner à la société une assiette assez régulière.
XXVII. Mais dans les monarchies la nation entière, à l'exception d'un seul, a trop peu de droits et de part aux affaires; sous le gouvernement des nobles, le peuple connaît à peine la liberté, puisqu'il ne participe pas aux conseils et n'exerce aucun pouvoir; et dans l'état populaire, quand même on y rencontrerait toute la justice et la modération possibles, l'égalité absolue n'en est pas moins de sa nature une iniquité permanente, puisqu'elle n'admet aucune distinction pour le mérite. Ainsi, que Cyrus, roi de Perse, ait montré une justice et une sagesse admirables, je ne puis cependant me persuader que son peuple se soit trouvé dans l'état le plus parfait sous la conduite et l'empire absolu d'un seul homme. Si l'on peut me montrer les Marseillais, nos clients, gouvernés avec la plus grande équité par quelques citoyens choisis et tout-puissants, je n'en trouve pas moins dans l'état du peuple, soumis à de tels maîtres, une image assez frappante de la servitude. Enfin lorsque les Athéniens, à une certaine époque, supprimèrent l'Aréopage, et ne voulurent plus reconnaître d'autre autorité que celle du peuple et de ses décrets, au milieu de cette égalité injurieuse au mérite, Athènes n'avait-elle pas perdu son plus bel ornement?
XXVIII. Et quand je parle ainsi de ces trois formes de gouvernement, ce ne sont pas les États bouleversés et déchirés que je juge, mais les sociétés florissantes. Dans la monarchie comme dans les deux autres, nous trouvons d'abord les inconvénients nécessaires dont j'ai parlé; mais bientôt on y peut découvrir d'autres germes plus graves d'imperfection et de ruine, car chacune de ces constitutions est toujours près de dégénérer en un fléau insupportable. A l'image de Cyrus, que je devrais appeler, pour bien dire, un roi supportable, mais que je nommerai, si vous le voulez, un monarque digne d'amour, succède en mon esprit le souvenir de Phalaris, ce monstre de cruauté; et je comprends que la domination absolue d'un seul est entraînée par une pente bien glissante vers cette odieuse tyrannie. A côté de cette aristocratie de Marseille, Athènes nous montre la faction des Trente. Enfin, dans cette même Athènes, pour ne pas citer d'autres peuples, la démocratie sans frein nous donne le triste spectacle d'une multitude qui s'emporte aux derniers excès de la fureur, et dont l'aveuglement ... (LACUNE).
XXIX. De l'anarchie sort le pouvoir des grands, ou une olygarchie factieuse, ou la royauté, ou très souvent même un état populaire; celui-ci, à son tour, donne naissance à quelques-uns de ceux que j'ai déjà nommés; et c'est ainsi que les sociétés semblent tourner dans un cercle fatal de changements et de vicissitudes. Le sage médite sur ces révolutions; mais l'homme qui a le don de prévoir les orages dont est menacé son pays, la force de lutter contre le torrent qui entraîne chefs et peuples, la puissance de l'arrêter ou d'en modérer le cours, celui-là est un grand citoyen, et j'oserais presque dire un demi-dieu. C'est ce qui me porte à regarder comme la meilleure forme de gouvernement cette forme mixte qui est composée des trois premières, se tempérant l'une l'autre.
XXX. Lélius. Je sais que c'est là votre sentiment arrêté, Scipion, car je vous l'ai entendu exprimer plus d'une fois; mais cependant, si ce n'est pas trop exiger, je voudrais apprendre de vous auquel de ces trois modes de gouvernement vous donnez la préférence. Je crois qu'il ne serait pas sans utilité ... (LACUNE).
XXXI. Scipion. ... telle est la nature et la volonté du souverain, telle est invariablement la société qu'il régit. Aussi n'y a-t-il que les États où le peuple a le pouvoir suprême qui puissent admettre la liberté; la liberté, le plus doux de tous les biens, et qui n'existe pas sans une égalité parfaite. Et comment serait-il possible de trouver cette égalité, je ne dis pas dans une monarchie où la servitude est manifeste et avouée, mais dans ces États où les citoyens ont toutes les apparences de la liberté? Ils donnent leurs suffrages, ils font des généraux, des magistrats; on les sollicite, on brigue leurs faveurs; mais ces faveurs, il faut bien qu'ils les accordent, bon gré mal gré; ce qu'ils prodiguent ainsi ne leur appartient jamais; car ils sont exclus du commandement des armées, des conseils de l'État, du jugement de toutes les causes importantes, et les hautes fonctions sont le privilége exclusif de la noblesse ou de la fortune. Chez un peuple libre, au contraire, comme à Rhodes, à Athènes, il n'est pas un seul citoyen qui ... (LACUNE).
XXXII. Qu'au milieu d'une nation il s'élève un ou plusieurs hommes riches et opulents, bientôt, disent les partisans de la démocratie, leur orgueil et leur dédain font naître des priviléges que reconnaît la foule des taches et des faibles, pliant sous l'arrogance des riches. Les mêmes politiques ajoutent qu'on ne peut rien imaginer de plus libre, de plus heureux, de plus excellent qu'un État où le peuple a conservé tous ses droits, parce qu'alors il est l'arbitre souverain des lois, des jugements, de la paix, de la guerre, des alliances, de la vie et de la fortune de chacun; voilà, disent-ils, le seul gouvernement qui mérite le nom de république, c'est-à-dire de chose du peuple. Aussi voit-on d'ordinaire le peuple chercher à s'affranchir du pouvoir des rois ou des patriciens, tandis qu'il est sans exemple qu'un peuple libre ait recouru à la royauté ou à la domination protectrice des grands. Ils prétendent que l'on serait fort injuste de condamner sans retour la cause poputaire qui a en haine des déréglements d'un peuple; qu'il n'y a rien de plus fort et de plus inébranlable qu'une république où règne la concorde, et où l'on ne connaît d'autre ambition que de maintenir la liberté de l'Etat, et de veiller à son salut; qu'enfin la concorde est très facile dans une société dont tous les membres ont le même intérêt, tandis que c'est la diversité d'intérêts qui partout donne naissance à la discorde. Aussi, à les entendre, jamais gouvernement aristocratique n'a offert de stabilité; encore bien moins en trouverait-on dans l'état monarchique, qui ne connaît ni foi ni loi, comme le dit Ennius. Puisque la loi est le lien de la société civile, et que le droit donné par la loi est le même pour tous, il n'y a plus de droits ni de règles dans une société dont les membres ne sont pas égaux. Si l'on ne veut point admettre l'égalité des fortunes, s'il faut avouer que celle des esprits est impossible, au moins doit-on établir l'égalité des droits entre tous les citoyens d'une même république. Qu'est-ce en effet qu'une société, si ce n'est la participation à de certains droits communs? (LACUNE).
XXXIII. Ces politiques vont jusqu'à refuser aux autres formes de gouvernement le nom dont elles veulent être appelées. Pourquoi donner le titre de roi, ce beau nom du monarque des cieux, à un homme avide de dominer et de commander seul à un peuple qu'il opprime? Le nom de tyran ne lui convient-il pas mieux? La tyrannie peut être douce, et la royauté insupportable; ce qui importe à des sujets, c'est de porter un joug commode, et non pas cruel : mais qu'ils ne soient pas sous le joug, c'est là ce qui ne se peut faire. Comment Lacédémone, à l'époque même où sa constitution politique passait pour uù chef-d'oeuvre, pouvait-elle avoir la certitude d'être gouvernée toujours par des rois bons et justes, quand il fallait qu'elle reçût invariablement pour maître le rejeton d'une souche royale? Quant à l'aristocratie, comment souffrir ces princes de l'Etat, qui ne tiennent pas du suffrage public, mais qui se décernent à eux-mêmes ce titre magnifique? Où ont-ils fait leurs preuves ces hommes qui s'arrogent la suprématie de la science, du talent, de la vertu? (LACUNE)
XXXIV. Si une société choisit au hasard ceux qui la doivent conduire, elle périra aussi promptement qu'un vaisseau dirigé par un des passagers que le sort aurait appelé au gouvernail. Un peuple libre choisira ceux à qui il veut se confier, et s'il pense à ses vrais intérêts, il fera choix des meilleurs citoyens; car c'est de leurs conseils, on n'en peut douter, que dépend le salut des États ; et la nature, tout en destinant les hommes qui ont le plus de caractère et de noblesse à conduire les faibles, a inspiré en même temps à la foule le besoin de voir à sa tête les hommes supérieurs. Mais on prétend que cette forme excellente de gouvernement est décréditée par les faux jugements du vulgaire, qui ne sachant discerner le vrai mérite, aussi rare peut-être à découvrir qu'à posséder, prend pour les premiers des hommes ceux qui ont de la fortune, de la puissance, ou qui portent un nom illustre. Une fois que cette erreur du peuple a donné à la puissance le rang que devait seule avoir la vertu, ces chefs de faux aloi gardent obstinément le nom d'aristocrates, qui ne leur convient en aucune façon. Car les richesses, l'éclat du nom, la puissance, sans la sagesse qui apprend à se gouverner soi-même et à conduire les autres, ne sont plus qu'une honteuse et insolente vanité; et il n'est pas au monde de plus triste spectacle que celui d'une société où l'on estime les hommes en proportion de leur fortune. Mais aussi que peut-on comparer à une république gouvernée par la vertu, alors que celui qui commande aux autres n'obéit lui-même à aucune passion ; alors qu'il ne donne à ses concitoyens aucun précepte dont l'exemple ne reluise en sa personne; qu'il n'impose au peuple aucune loi dont il ne soit l'observateur le plus fidèle; et que sa conduite entière peut être proposée comme une loi vivante à la société qu'il dirige? Si un seul homme pouvait satisfaire à tout à la fois, le concours de plusieurs deviendrait inutile; si tout un peuple pouvait voir le bien et le poursuivre d'un commun accord, on n'aurait pas besoin de faire choix de quelques chefs. La difficulté de former un sage conseil a fait passer le pouvoir du roi aux grands; les errements et la témérité des peuples l'ont transporté des mains de la foule dans celles du petit nombre. Ainsi, entre l'impuissance d'un seul et l'aveuglement de la multitude, l'aristocratie tient le milieu, et présente par sa position même les garanties de la plus parfaite modération. Sous son gouvernement tutélaire les peuples doivent être le plus heureux possible, vivre sans inquiétude ni tourments, puisqu'ils ont confié leur repos à des protecteurs dont le premier devoir est la vigilance, et dont la préoccupation constante est de ne point donner au peuple l'idée que les grands négligent ses intérêts. Quant à l'égalité absolue des droits, que poursuivent les peuples libres, elle n'est jamais qu'une utopie ; les nations les plus jalouses de leur liberté et les plus impatientes de tout frein accordent cependant une foule de distinctions, et savent parfaitement classer les hommes et faire acception du mérite. D'ailleurs cette égalité absolue serait le comble de l'iniquité. Essayez de mettre sur la même ligne les grands hommes et cette lie du peuple qui se trouve nécessairement partout, et vous reconnaîtrez que c'est par esprit d'équité commettre l'iniquité la plus révoltante. Dans les gouvernements aristocratiques, une pareille absurdité ne sera jamais à craindre. Voilà, Lélius, à peu près du moins, ce que disent les partisans et les admirateurs de l'aristocratie.
XXXV. Laelius. Mais vous, Scipion, lequel de ces trois gouvernements préférez-vous? — Scipion. Vous avez raison de me demander lequel je préfère, car je n'approuve aucun des trois séparément, et je mets fort au-dessus de chacun d'eux celui qui les réunit tous. Mais s'il fallait en choisir un exclusivement, je me prononcerais pour le gouvernement royal. Il semble que le titre de roi a quelque chose de paternel; il nous montre un chef de famille qui veille sur ses sujets comme sur ses propres enfants, qui protège son peuple avec amour, bien loin de le réduire en esclavage ; c'est un homme excellent et tout-puissant qui soutient et guide les petits et les faibles : est-il rien de plus raisonnable? Mais voici les grands qui réclament pour eux l'honneur de mieux accomplir cet ouvrage, et qui nous disent qu'il y a plus de lumières dans une assemblée que dans un seul homme, et tout autant d'équité et de bonne foi. Enfin voici le peuple qui nous crie, de toutes ses forces, qu'il ne veut obéir ni à un seul ni à plusieurs; que pour les animaux eux-mêmes rien n'est plus doux que la liberté, et qu'elle périt sous l'empire d'un roi comme sous la domination des grands. Ainsi un roi nous offre la tendresse d'un père, les grands leur sage conseil, le peuple la liberté; entre les trois le choix est difficile. — Laelius Je le crois comme vous; mais cependant, si cette difficulté n'est résolue, je ne vois pas comment nous pourrons aborder toutes celles qui suivent.
XXXVI. Scipion. J'imiterai donc Aratus, qui, au début de son grand ouvrage, commence par invoquer Jupiter. — Lélius. Pourquoi Jupiter? et quelle ressemblance y a-t-il entre le poème d'Aratus et notre entretien politique? — Scipion. Il n'y en a qu'une : c'est que nous devons, nous aussi, au début de nos recherches, élever notre pensée à celui que le monde entier, d'un commun accord, savants et ignorants, regarde comme le roi des Dieux et des hommes. — Pourquoi donc? dit Lélius. — Pourquoi? repartit Scipion ; vous pouvez en juger vous-même. En effet, ou les chefs des nations ont répandu parmi le peuple, pour l'intérêt des sociétés, cette croyance qu'il y a dans le ciel un maître souverain, qui d'un froncement de sourcil, comme dit Homère, ébranle l'Olympe, et que l'on adore comme le roi et le père de tous les êtres; et s'il en est ainsi, nous voyons que la plupart des nations, pour ne pas dire toutes, entrant dans l'esprit de leurs chefs, ont reconnu par un éclatant témoignage l'excellence de la royauté, puisqu'elles s'accordent à penser que tous les Dieux sont gouvernés par un seul monarque tout-puissant : ou si l'on prétend que ce sont là des fables accréditées par la superstition des peuples, consultons ces maîtres révérés de tous les gens instruits, ces hommes supérieurs qui ont vu de leurs yeux en quelque façon ce qu'à peine nos oreilles peuvent entendre. — De quels hommes voulez-vous parler? demanda Lélius. — Scipion. De ceux qui, en approfondissant tous les secrets de la nature, comprirent que le monde entier est gouverné par une intelligence ... (LACUNE).
XXXVII. ... Mais si vous voulez, Lélius, je vous produirai des témoins qui ne sont ni trop anciens ni barbares. - Lélius. Des témoins de cette sorte me conviendraient fort. — Scipion. Et d'abord, vous savez qu'il n'y a pas encore quatre cents ans que Rome n'est plus gouvernée par des rois. — Lélius. Je le sais, sans doute. — Scipion. Mais, selon vous, quatre cents ans d'âge est-ce beaucoup pour une ville ou pour un État? — Lélius. C'est à peine l'âge adulte. — Scipion. Ainsi donc, il y a quatre cents ans, Rome avait un roi? — Lélius. Et même un roi superbe. — Scipion. Mais avant celui-là?— Lélius. Un roi très juste, et ainsi des autres en remontant jusqu'à Romulus, qui régnait il y a six siècles. — Scip. Romulus lui-même est-il bien ancien? — Lélius. Nullement; car à son époque la Grèce était déjà bien près de vieillir. — Scipion. Romulus, dites-moi, régnait-il sur des barbares? — Lélius. S'il faut écouter les Grecs, pour qui tous les hommes sont ou des Grecs ou des barbares, je crains bien que Romulus n'ait été un roi de barbares; mais s'il faut juger un peuple par ses moeurs et non par sa langue, je ne crois pas les Romains plus barbares que les Grecs. D'ailleurs, reprit Scipion, pour le point qui nous occupe, c'est moins le témoignage d'une nation entière que celui des hommes éclairés que nous voulons consulter. Si donc il est constant qu'à une époque peu reculée, des hommes sages ont voulu être gouvernés par des rois, voilà bien, comme je vous le promettais, des témoins qui ne sont ni trop anciens ni barbares.
XXXVIII. Lélius. Je vois bien, Scipion, que vous ne manquez pas de témoins ; mais auprès de moi comme auprès de tous les juges, les preuves bien raisonnées valent mieux que les témoins. Scipion. Vous voulez des preuves, Lélius : eh bien ! votre propre expérience va vous en fournir. — Lélius. Quelle expérience? — Scipion. Dites-moi, vous êtes- vous jamais senti en colère? — Lélius. Plus souvent que je n'eusse voulu. — Scipion. Et lorsque vous êtes en colère, permettez-vous à cette passion de dominer votre âme? — Lélius. Non, par Hercule; mais j'imite alors cet Archytas de Tarente, qui arrivant à sa campagne et trouvant qu'en tout on y avait pris justement le contrepied de ses ordres : Malheureux, dit-il à son fermier, je t'aurais déjà roué de coups, si je n'étais en colère. — Parfaitement, dit Scipion. Archytas regardait donc la colère, celle du moins que la raison désarme, comme une certaine sédition de l'âme; et il voulait l'apaiser par la réflexion. Mettez-vous maintenant devant les yeux l'avarice, l'ambition, la vanité, toutes les passions, et vous comprendrez que si l'âme est gouvernée royalement, tout en elle sera soumis à l'empire de la raison (puisque la raison est la partie la plus excellente de l'âme ), et que, sous cet empire, il n'y a plus de place pour les passions, plus de place pour la colère et l'aveuglement. — Lélius. Rien n'est plus vrai. — Scipion. Approuvez-vous une âme ainsi réglée? — Lélius. On ne peut davantage. — Scipion. Vous ne pourriez donc souffrir que, méconnaissant la raison, l'âme s'abandonnât à ses passions qui sont sans nombre, ou se laissât emporter â la colère? — Lélius. A mon avis, rien de plus misérable qu'une telle âme et qu'un homme en proie à ses passions. — Scipion. Vous voulez donc qu'une royauté s'établisse dans l'âme humaine, et que la raison y règle tout souverainement? — Lélius. Sans nul doute. — Scipion. Comment donc pouvez-vous hésiter sur le gouvernement qui convient aux États? Ne voyez-vous pas que, dans une nation, si le pouvoir est partagé, il n'y a plus d'autorité souveraine? car la souveraineté, si on la divise, est anéantie.
XXXIX. Lélius. Mais, je vous prie, qu'importe le gouvernement d'un seul ou de plusieurs, si ce dernier est juste? — Scipion. Je vois que mes autorités n'ont pas produit grande impression sur vous : aussi suis-je bien résolu à ne plus invoquer, à l'appui de mon sentiment, que votre propre témoignage. — Lélius. Quel témoignage tirerez-vous de moi? — Scipion. J'ai remarqué dernièrement, lorsque nous étions ensemble à Formies, que vous enjoigniez formellement à vos esclaves de ne prendre les ordres que d'un seul chef. — Lélius. Oui sans doute, de mon fermier. — Scipion. Et à Rome, vos affaires sont-elles dans les mains de plusieurs intendants? — Lélius. Non, certes; je n'en ai qu'un seul. — Scipion. Enfin le gouvernement général de toute votre maison, le partagez-vous avec quelqu'un? — Lélius. Pas le moins du monde, j'espère. — Scipion. Que n'accordez-vous donc également que pour les sociétés l'empire d'un seul, lorsqu'il est équitable, est de tous le meilleur? — Lélius. Je me sens entraîné, et je me rends presque à votre avis.
XL. Scipion. Vous vous y rendrez bien mieux encore, Lélius, si laissant de côté la comparaison du vaisseau, du malade, qu'il vaut mieux confier à un seul pilote ou à un seul médecin expérimenté, que de le remettre à la direction de plusieurs, j'arrive à des considérations d'un ordre plus relevé. -- Là. Quelles considérations? — Scipion. Vous savez que c'est la cruauté et la domination superbe du seul Tarquin, qui a fait détester au peuple romain jusqu'au nom de roi? — Là. Je le sais. — Scipion. Vous n'ignorez pas non plus qu'après avoir chassé Tarquin, le peuple, enivré de sa liberté nouvelle, s'emporta à des excès dont bientôt j'aurai à vous entretenir longuement. On vit alors des innocents exilés, un grand nombre de citoyens dépouillés, des magistrats annuels, les faisceaux inclinés devant le peuple, la multitude jugeant en dernier ressort, la fameuse retraite au mont Aventin ; enfin une longue suite de mouvements et d'actes qui devaient aboutir à la souveraineté absolue du peuple. — Lélius. C'est la vérité. — Scipion. Mais tout cela se passait en temps de paix et de sécurité. Lorsqu'on n'a rien à craindre, un peu de licence est bien permise, témoin les malades attaqués légèrement, et les passagers d'un vaisseau qui ne court point de danger; mais quand la mer devient houleuse, quand la fièvre redouble, passagers et malades s'abandonnent à une main exercée. Ainsi le peuple de Rome, en paix et dans ses foyers, commande, menace ses magistrats, désobéit à leurs ordres, appelle de leur décision, les traduit devant son tribunal; en temps de guerre, on pourrait croire qu'il obéit à un roi; car l'intérêt du salut parle plus haut que la passion de l'indépendance. Bien mieux, dans les guerres importantes, nos ancêtres ont voulu que toute l'autorité fût réunie dans les mains d'un seul homme, dont le titre même indique l'extrême puissance. On le nomme dictateur, parce qu'un consul le proclame ("quia dicitur"); mais dans nos livres vous voyez, Lélius, qu'il est appelé le maître du peuple. —Là. C'est très vrai. — Scipion. Reconnaissons la sagesse de ces anciens ... (LACUNE).
XLI Lorsqu'un peuple a perdu un bon roi, alors, comme le dit Ennius en parlant de la mort d'un prince excellent, «les coeurs de fer sont émus jusqu'aux larmes; de tous côtés on entend ces cris de deuil : O Romulus, divin Romulus, père de la patrie, que le ciel nous avait donné! ô notre ami, notre dieu tutélaire, digne fils des immortels! Ils n'appellent ni maître ni seigneur celui qui leur a commandé avec tant de justice; ils ne lui donnent pas même le nom de roi; c'est la providence de la patrie, c'est un père, c'est un dieu. Et ces titres sont fondés; écoutez ce que le peuple ajoute : C'est à toi que nous devons la vie. Ils pensaient donc, ces anciens Romains, que la vie, l'honneur et la gloire sont donnés au peuple par la justice du roi. Leur postérité aurait conservé les mêmes sentiments, si ce caractère sacré s'était toujours maintenu dans la personne des rois; mais vous voyez que l'injuste domination d'un seul entraîna pour toujours la chute de la royauté. — Lélius. Je le vois, et il me tarde de connaître le cours de ces vicissitudes politiques, non seulement dans notre pays, mais dans toutes les sociétés possibles.
XLII. Scipion. Lorsque je vous aurai exposé mon sentiment sur la forme de gouvernement qui, de toutes, me paraît la meilleure, j'aurai à vous entretenir avec soin de ces grandes révolutions politiques; quoique je pense qu'elles doivent difficilement se produire dans un État gouverné comme je l'entends. Quant au pouvoir royal, en voici la première et la plus infaillible altération : dès qu'un roi devient injuste, la royauté disparaît, et fait place à la tyrannie, le pire des gouvernements et qui tient de si près au meilleur. Lorsque la tyrannie est abattue par les grands, ce qui est assez l'usage, l'Etat prend alors la seconde des trois formes générales ; c'est un conseil aristocratique qui veille aux intérêts du peuple avec une sollicitude paternelle, et qui a par cet endroit quelque chose de royal. Si c'est le peuple lui-même qui a tué ou chassé un tyran, il garde assez de modération, tant que le bon sens l'inspire; et comme il s'applaudit de ce qu'il a fait, il veut donner à l'Etat restauré par lui une certaine consistance. Mais si le peuple a porté une main violente sur un bon roi, ou, ce que l'on voit plus souvent, s'il a versé le sang des nobles, et soumis tout l'Etat à ses fureurs, il n'est point de tempête, point d'incendie, qui ne soient plus faciles à calmer que les emportements d'une multitude effrénée.
XLIII. Il arrive alors ce que Platon décrit avec des couleurs si vives, et que je voudrais exprimer d'après lui; je ne sais si notre langue s'y prêtera; du moins c'est un effort à tenter. "Lorsque, dit-il, le peuple est dévoré d'une soif intarissable d'indépendance, et que, servi par de perfides échansons, il a vidé jusqu'à la lie la coupe enivrante d'une liberté sans mélange; alors ses magistrats et ses chefs, s'ils ne sont relàchés et débonnaires, deviennent l'objet d'attaques, de poursuites, d'accusations terribles; il les appelle dominateurs, rois, tyrans." Je pense que vous connaissez ce passage. — Lélius. Je le savais par coeur. — Scipion. Voyons la suite : "Ceux qui obéissent aux magistrats sont insultés par le peuple, qui les nomme des esclaves volontaires; les magistrats, au contraire, qui affectent de descendre au niveau des simples citoyens, et les citoyens qui s'étudient à effacer toute différence entre eux et les magistrats, sont couverts de louanges et surchargés d'honneurs. Il faut nécessairement que dans une telle société la liberté afflue partout; qu'au sein des familles toute autorité disparaisse, et que les animaux eux-mêmes soient atteints de cette contagion. Le père craint son fils, le fils ne connaît plus son père; toute pudeur est proscrite, pour que la liberté soit entière; il n'y a plus de différence entre le citoyen et l'étranger ; le maître redoute ses élèves et les flatte, les élèves prennent leur maître en dédain; les jeunes gens s'arrogent l'autorité des vieillards; les vieillards prennent part aux amusements de la jeunesse, pour ne pas lui être odieux et à charge. Bientôt l'esclave se donne tous les airs d'un homme libre, la femme se croit l'égale de son mari ; et au milieu de cette indépendance universelle, il n'est pas jusqu'aux chiens, aux chevaux et aux ânes qui ne se trémoussent de liberté, et qui ne courent en bêtes libres sur la voie publique, forçant les hommes à leur laisser le passage. De cette licence illimitée il résulte enfin que les esprits deviennent si ombrageux et si délicats, qu'au moindre signe d'autorité ils s'irritent et regimbent, et que de proche en proche ils vont jusqu'au mépris des lois, afin d'être plus complétement libres de sujétion."
XLIV. Lélius. Vous avez, ce me semble, rendu avec une fidélité parfaite ce qu'a dit Platon. — Scipion. Pour reprendre maintenant la suite de nos idées, nous voyons (c'est Platon qui nous l'enseigne) que de cette extrême licence, réputée pour l'unique liberté, sort la tyrannie comme de sa souche naturelle. Le pouvoir excessif des grands amène la chute de l'aristocratie; tout pareillement l'excès de la liberté conduit un peuple à la servitude. Ne voyons-nous pas constamment pour l'état du ciel, pour les biens de la terre, pour la santé, qu'un extrême se tourne subitement en l'extrême contraire? c'est là surtout la destinée des États; l'extrême liberté pour les particuliers et pour les peuples se change bientôt en une extrême servitude. De la licence naît la tyrannie, et avec elle le plus injuste et le plus dur esclavage. Ce peuple indompté, cette hydre aux cent têtes se choisit bientôt contre les grands, dont le pouvoir est déjà abattu et les dignités abolies, un chef audacieux, impur, persécuteur impudent des hommes qui souvent ont le mieux mérité de leur patrie, prodiguant à la populace la fortune d'autrui et la sienne. Comme dans la vie privée il pourrait craindre pour sa tête, on lui donne des commandements, on les lui continue; bientôt sa personne est protégée par une garde, témoin Pisistrate à Athènes; enfin il devient le tyran de ceux mêmes qui l'ont élevé. S'il tombe sous les coups des bons citoyens, comme on l'a vu souvent, alors l'État est régénéré; s'il périt victime de quelques audacieux, la société est en proie à une faction, autre espèce de tyrannie qui succède encore parfois à ce beau gouvernement des nobles, lorsque l'aristocratie se corrompt et s'oublie. Ainsi le pouvoir est comme une balle que se renvoient tour à tour les rois aux tyrans, les tyrans aux grands ou au peuple, ceux-ci aux factions ou à de nouveaux tyrans; et jamais une forme politique n'est de bien longue durée dans un État.
XLV. Pour toutes ces raisons, je tiens donc que la royauté est de beaucoup préférable au gouvernement des grands ou du peuple; mais la royauté elle-même le cède dans mon esprit à une constitution politique qui réunirait ce que les trois premières ont de meilleur, et allierait dans une juste mesure les trois pouvoirs. J'aime que dans un État il y ait quelque chose de majestueux et de royal; qu'une part soit faite à l'influence des nobles, et que certaines choses soient réservées au jugement et à l'autorité du peuple. Cette forme de gouvernement a d'abord l'avantage de maintenir une grande égalité, bienfait dont un peuple libre ne peut être privé longtemps; elle a ensuite beaucoup de stabilité, tandis que les autres sont toujours près de s'altérer, la royauté inclinant vers la tyrannie, le pouvoir des grands vers l'oligarchie factieuse, et celui du peuple vers l'anarchie. Tandis que les autres constitutions se renversent et se succèdent sans fin, celle-ci, fondée sur un sage équilibre et qui n'exclut aucun pouvoir légitime, ne peut guère être sujette à toutes ces vicissitudes sans que les chefs de l'État n'aient commis de grandes fautes. On ne peut trouver de germe de révolution dans une société où chacun tient son rang naturel, y est solidement établi, et ne voit point au-dessous de place libre où il puisse tomber.
XLVI. Mais je crains, Lélius, et vous, mes sages amis, que si je m'arrête trop longtemps à ces questions générales, mon discours ne ressemble plutôt à la leçon d'un maître qu'au libre entretien d'un ami qui cherche la vérité avec vous. C'est pourquoi je vais vous parler de choses qui sont connues de tous, et qui ont été depuis longtemps l'objet de nos réflexions. Je le reconnais donc, je le sens, je le déclare, il n'est aucune forme de gouvernement qui, par sa constitution, son organisation, ses règles, puisse être comparée à celle que nos pères nous ont transmise et que nos ancêtres ont établie. Et puisque vous voulez entendre de ma bouche ce que vous savez si bien vous-mêmes, j'exposerai d'abord le système de la constitution romaine, je montrerai que de tous il est le plus excellent; et, proposant ainsi notre république pour modèle, j'essaierai de rapporter à cet exemple tout ce que j'ai à dire sur la meilleure forme de gouvernement. Si j'en viens à bout, si je puis toucher le but, je crois que j'aurai surabondamment rempli la tâche que Lélius m'a imposée.
XLVII. Lélius. Imposée, dites-vous! Mais s'il en est une qui vous convienne, c'est bien celle-là. Qui pouvait parler des institutions de nos ancêtres mieux que Scipion, issu d'un sang si glorieux? Qui aurait mieux que vous le droit de nous entretenir de la meilleure forme de gouvernement, de cet état prospère qui n'est pas le nôtre aujourd'hui, mais qui ne le pourrait devenir sans vous rendre aux premiers honneurs? A qui appartient-il enfin de nous parler d'avenir et de prévoyante sagesse, si ce n'est au héros qui a renversé deux puissantes rivales, la terreur de Rome, et garanti par là nos futures destinées?
I. Dès que Scipion vit tous ses amis impatients de l'entendre, il commença en ces termes : Je vous citerai d'abord une pensée du vieux Caton, pour qui, vous le savez, j'ai toujours éprouvé la plus vive tendresse et une admiration extrême, à l'ascendant duquel je me suis abandonné tout entier dès ma jeunesse, par les conseils de Paul-Émile et de mon père adoptif, joint à l'entraînement de mon goût, et que jamais je ne pus me lasser d'écouter, tant il avait d'expérience des affaires publiques dirigées par lui, et à Rome et dans les camps, avec une si grande gloire et pendant une si longue carrière; tant je trouvais son langage mesuré, grave et piquant à la fois, son esprit ardent à s'instruire, et à répandre ses trésors, sa vie entière en harmonie avec ses discours! Il disait souvent que ce qui faisait la supériorité du gouvernement de Rome sur celui des autres nations, c'est que celles-ci n'avaient reçu pour la plupart leurs institutions et leurs lois que d'un seul législateur, et comme d'une pièce; la Crète, de Minos; Lacédémone, de Lycurgue; Athènes, dont la constitution a subi tant de changements, de Thésée, puis de Dracon, de Solon, de Clisthènes, de bien d'autres encore, et enfin, lorsqu'elle périssait et se sentait mourante, d'un savant homme, Démétrius de Phalère, qui la ranima un instant; tandis que notre république n'a point été constituée par un seul esprit, mais par le concours d'un grand nombre; ni affermie par les exploits d'un seul homme, mais par plusieurs siècles et une longue suite de générations. Il ne peut se rencontrer au monde, nous répétait Caton, un génie assez vaste pour que rien ne lui échappe; et le concours de tous les esprits éclairés d'une époque ne saurait, en fait de prévoyance et de sagesse, suppléer aux leçons de l'expérience et du temps. Je vais donc, à son exemple, développer les origines du peuple romain; j'aime à prendre, vous le voyez, jusqu'aux expressions de Caton. Il me semble que j'atteindrai plus facilement le but qui nous est proposé, en vous montrant tour à tour la naissance, les premiers progrès, la jeunesse et la virilité de notre république, que si j'allais, comme le Socrate de Platon, imaginer un état chimérique.
II. Une approbation générale accueillit ces paroles de Scipion. Il reprit à l'instant: Est-il une autre nation qui ait une origine aussi éclatante, aussi fameuse dans le monde entier, que la fondation de notre cité par Romulus, fils de Mars? Nous devons en effet respecter une tradition qui a le privilége de l'antiquité et qui surtout est pleine de sagesse, et penser avec nos ancêtres que les bienfaiteurs du genre humain méritent la réputation non pas seulement d'avoir un esprit divin, mais d'être issus du sang des Dieux. On rapporte donc que Romulus, aussitôt après sa naissance, fut exposé avec son frère Rémus sur les bords du Tibre par l'ordre d'Amulius, roi d'Albe , qui craignait de voir un jour sa puissance ébranlée. Allaité près du fleuve par une bête sauvage, l'enfant fut bientôt recueilli par des pasteurs, qui l'élevèrent dans les travaux et la rudesse des champs. Il devint homme, et la vigueur de son corps aussi bien que la fierté de son âme lui donnèrent sur tous ses compagnons une telle supériorité, que tous ceux qui habitaient alors les campagnes où Rome s'étend aujourd'hui vinrent se ranger volontairement sous sa loi. Il se mit à leur tête, et, pour faire trêve aux récits fabuleux, l'histoire nous apprend qu'il enleva d'assaut Albe la Longue, ville forte et puissante dans ces temps, et qu'il fit périr le roi Amulius.
III. Après cet exploit, il songea pour la première fois à élever une ville suivant les rites sacrés, et à jeter les fondements d'un empire. Rien de plus important pour les destinées futures d'un empire que l'emplacement d'une cité; Romulus sut le choisir admirablement. Il ne rechercha point le voisinage de la mer, quoiqu'il lui fût très facile ou de s'avancer avec son armée aguerrie sur le territoire des Rutules et des Aborigènes, ou d'établir sa nouvelle ville à l'embouchure du Tibre, dans le lieu même où, longues années après, le roi Ancus conduisit une colonie. Mais cet homme d'un merveilleux génie comprit qu'une situation maritime n'est pas celle qui convient le mieux à une ville pour laquelle on ambitionne un avenir durable et une grande puissance. D'abord les villes maritimes sont exposées à beaucoup de périls qu'elles ne peuvent prévoir. Au milieu des terres, les ennemis qu'on attend le moins se trahissent toujours par quelques indices, et le sol nous apporte infailliblement le bruit de leurs pas : jamais il ne peut y avoir par terre d'attaque tellement subite, qu'on ne sache non seulement que l'ennemi arrive, mais quel est cet ennemi et d'où il vient; tandis que les flots peuvent porter dans une ville maritime une armée qui l'envahit, avant même qu'on n'ait soupçonné sa venue. Lorsque l'ennemi arrive par mer, aucun indice ne nous apprend qui il est, d'où il vient, ce qu'il veut; enfin, on ne peut reconnaître à aucun signe si c'est un ennemi ou un allié qui s'avance.
IV. Les villes maritimes ont à craindre aussi la corruption et l'altération des moeurs. Elles sont le rendez-vous des langues et des coutumes de toute la terre; les étrangers y apportent leurs moeurs en même temps que leurs marchandises; à la longue toutes les institutions nationales sont attaquées, aucune n'échappe. Ceux qui habitent les ports ne sont pas fixés à leurs foyers; leur esprit sans cesse agité, leur mobile espérance les emporte loin de leur pays; alors même qu'ils y ont posé le pied, leur pensée voyage et court le monde. Il n'est pas de cause qui ait plus influé sur la décadence et la ruine de Carthage et de Corinthe que cette vie errante et cette dispersion de leurs citoyens, qui abandonnaient, par amour de la navigation et du commerce, la culture des terres et le maniement des armes. D'un autre côté, les villes maritimes sont assiégées par le luxe; tout les y porte; le commerce et la victoire leur amènent tous les jours des séductions nouvelles. Et d'ailleurs tous ces rivages de la mer sont des lieux si charmants! on y respire le goût d'une vie fastueuse et molle; comment s'en défendre? Ce que j'ai dit de Corinthe, je crois qu'on pourrait le dire avec une parfaite vérité de la Grèce entière. Presque tout le Péloponnèse est maritime; si vous en exceptez le pays de Phliunte, toutes les contrées en sont baignées par la mer: hors du Péloponnèse je ne vois que les Enianes, les Doriens et les Dolopes qui ne touchent pas à la mer. Que dirai-je des îles de la Grèce? Elles semblent bercées par les flots qui les enveloppent, elles, leurs institutions et leurs moeurs. Mais ce n'est là, comme je l'ai déjà dit, que l'ancienne Grèce. Jetez les yeux sur les colonies qu'elle a fondées en Asie, en Thrace, en Italie, en Sicile, en Afrique : en trouverez-vous une seule, si ce n'est Magnésie, qui ne soit baignée par les eaux? Il semble qu'une ceinture détachée de la Grèce soit venue border toutes les contrées barbares. Car il n'y avait dans les temps anciens d'autres peuples maritimes que les Étrusques et les Carthaginois, les uns commerçants , les autres pirates. Il me paraît donc évident qu'il faut attribuer tous les maux et les révolutions des sociétés grecques à ces vices des cités maritimes que je viens de toucher en peu de mots. Mais, au milieu de ces graves inconvénients, il faut reconnaître un grand avantage : c'est que les productions de tous les pays du monde viennent comme d'elles-mêmes se réunir dans la ville que vous habitez, et qu'en retour vous pouvez porter ou envoyer par toute la terre les récoltes de vos campagnes.
V. Romulus pouvait-il donc, pour donner à sa ville naissante tous les avantages d'une position maritime et lui en sauver les inconvénients, être mieux inspiré qu'il ne le fut, en l'élevant sur les bords d'un fleuve dont les eaux toujours égales et ne tarissant jamais vont se verser dans la mer par une large embouchure; par la voie duquel la cité peut recevoir de la mer ce qui lui manque, et lui rendre en retour ce dont elle surabonde, et qui alimente perpétuellement nos marchés par la communication incessante qu'il établit entre la mer et Rome d'un côté, de l'autre entre la ville et l'intérieur des terres? Aussi je n'hésite pas à le croire, Romulus avait pressenti dès lors que sa nouvelle cité serait un jour le siége d'un immense empire. Imaginez cette ville située dans toute autre partie de l'Italie, et la domination romaine devient impossible.
VI. Quant aux fortifications naturelles de Rome, est-il un homme assez indifférent pour ne pas en avoir dans l'esprit une image nette et bien dessinée? La sage prévoyance de Romulus et des autres rois y a joint un mur d'enceinte qui vient se rattacher de toutes parts à des collines escarpées, rend inaccessible le passage qui s'ouvrait entre l'Esquilin et le Quirinal et que défend aujourd'hui un énorme rempart ceint d'un vaste fossé, et fait de notre citadelle entourée de précipices, protégée par ses rocs taillés à pic, une forteresse tellement inexpugnable, que toute cette effroyable tempête de l'invasion gauloise vint mourir à ses pieds. Romulus choisit d'ailleurs un lieu rempli de sources vives, et d'une salubrité remarquable au milieu d'une contrée malsaine. Les collines qui le protégent appellent et renouvellent l'air, et couvrent les vallées de leur ombre.
VII. Romulus sut promptement juger tous les avantages de cette position; il y bâtit une ville qu'il appela Rome, de son nom; et, pour affermir cette cité nouvelle, il concut et mit à exécution un dessein étrange et d'une hardiesse un peu sauvage, mais qui décèle le coup d'œil d'un grand homme, et d'un fondateur d'empire préparant sûrement la grandeur future de son peuple. De jeunes vierges sabines, de la meilleure naissance, étaient venues à Rome pour assister à la première célébration de nos jeux anniversaires que Romulus donnait dans le cirque; à son signal et sur son ordre, elles sont toutes enlevées, et unies par des mariages aux plus nobles familles. Cette injure arma les Sabins contre Rome; un combat fut livré; la victoire balançait, lorsqu'à la prière des Sabines enlevées, Romulus fit un traité avec Tatius, roi des Sabins. Par ce traité il reçut dans Rome les Sabins et leur culte, et partagea la puissance suprême avec leur roi.
VIII. Après la mort de Tatius, l'autorité revint tout entière dans les mains de Romulus. Déjà, du vivant de son collègue, il avait formé un conseil royal composé des premiers citoyens, que l'on appela Pères par affection; il avait divisé le peuple en trois tribus, qui portèrent son nom, celui de Tatius et celui de Lucumon, mort au côté de Romulus en combattant les Sabins; et en trente curies, désignées par les noms des Sabines qui avaient été médiatrices de la paix et de l'alliance. Romulus, disons-nous, avait formé toutes ces institutions du vivant de Tatius ; mais, après sa mort, il régna plus que jamais avec le concours des Pères et dirigé par leurs conseils.
IX. En agissant ainsi, Romulus prouva qu'il comprenait ce que naguère avait bien vu le législateur de Sparte, que la perfection du gouvernement royal et de la souveraineté d'un seul demande l'appui et le concours des meilleurs citoyens. Se faisant un soutien et comme un rempart de ce conseil, qui lui tenait lieu de sénat, il vainquit en plusieurs rencontres les nations voisines; et, sans conserver pour lui aucune de leurs dépouilles, il ne cessa d'enrichir ses concitoyens. En tout temps Romulus se montra religieux observateur des auspices, que nous maintenons aujourd'hui encore au grand profit de la république. Il prit lui-même les auspices pour fonder sa nouvelle ville, et c'est là l'origine sacrée de la cité romaine; et depuis, avant d'établir toutes ses institutions publiques, il choisit dans chacune des tribus un augure pour l'aider à consulter les auspices. Il voulut que les grands fussent les patrons du peuple et eussent chacun leur clientèle; disposition d'une grande utilité, comme je l'expliquerai bientôt. Enfin, il n'intro duisit dans ses lois pénales d'autres châtiments que des amendes de moutons et de boeufs (car toute la fortune d'alors consistait en troupeaux ou en terres, "pecus, locus", d'où sont venues pour désigner la richesse les expressions de "pecuniosi, locupletes"), et proscrivit la violence et les supplices.
X. Après avoir régné trente-sept ans et élevé ces deux solides colonnes de la république, les auspices et le sénat, Romulus disparut pendant une éclipse de soleil, et obtint cet insigne honneur qu'on le crut transporté au rang des Dieux : renommée merveilleuse pour un mortel, et qu'une vertu extraordinaire a pu seule mériter. Ce qui rend encore l'apothéose de Romulus plus admirable, c'est que tous les autres hommes dont on a fait des dieux ont vécu pendant des siècles de barbarie, où l'ignorance et la crédulité rendaient facile une pareille fiction; tandis que nous voyons Romulus, séparé de nous par moins de six siècles, appartenir à un âge où les lettres et les sciences avaient déjà pris un grand développement, et où les erreurs d'une civilisation naissante étaient depuis longtemps dissipées. Si l'on s'en rapporte à la supputation des annales grecques, Rome fut fondée la seconde année de la septième Olympiade, et par conséquent Romulus vivait à une époque où déjà la Grèce était pleine de poètes et de musiciens, et où l'on n'ajoutait guère de foi aux fables qui ne remontaient pas à une certaine antiquité. Car les lois de Lycurgue sont antérieures de cent huit ans à la première Olympiade, quoique plusieurs auteurs, trompés par une erreur de nom, aient attribué l'institution des Olympiades à Lycurgue lui-même; et Homère, suivant les calculs les moins élevés, vivait trente ans avant Lycurgue. Il est donc constant qu'Homère précéda Romulus d'un grand nombre d'années; et qu'au temps du fondateur de Rome, l'éducation des esprits, les lumières généralement répandues laissaient peu de place à une fiction nouvelle. La crédule antiquité a reçu beaucoup de fables grossières; mais cet âge déjà cultivé, prêt à rire de ce qui est impossible , se tint en garde contre les fictions (LACUNE)- On crut cependant à la divinité de Romulus dans un temps où l'expérience avait mûri les esprits, où l'homme se connaissait lui-même. Mais il avait montré tant de vertu et de génie, que le peuple n'hésita pas à se laisser persuader de lui ce que depuis bien des siècles on n'avait voulu croire d'aucun mortel, alors que Julius Proculus, un homme simple envoyé par les Pères, qui tenaient à écarter loin d'eux le soupçon de la mort de Romulus, vint déclarer dans l'assemblée publique que Romulus lui était apparu sur la colline que l'on appelle maintenant Quirinale, lui avait ordonné de demander au peuple qu'un temple lui fût élevé sur cette colline, ajoutant qu'il était dieu et s'appelait Quirinus.
XI. Voyez-vous donc comment la sage politique d'un seul a créé un nouveau peuple, et, loin de l'abandonner à ses premiers efforts, comme un enfant au berceau, a présidé à son développement, et l'a conduit jusqu'aux abords de la virilité? — Nous le voyons, dit Lélius; mais ce que nous voyons aussi, c'est que vous suivez une méthode toute nouvelle, que ne nous offre aucun des livres grecs. Le prince des philosophes et le plus parfait des écrivains s'est choisi lui-même un terrain entièrement libre, pour y construire une cité à sa guise ; création admirable sans doute, mais qui n'est pas faite pour des hommes et répugne à la réalité. Les autres, sans avoir les yeux fixés sur un modèle de république, ont traité successivement des diverses formes politiques et des constitutions sociales. Il me semble que vous voulez réunir les deux méthodes : dès le début, vous vous êtes élevé à des considérations que vous avez mieux aimé mettre dans la bouche des autres que de produire en votre nom, comme le fait Socrate dans les écrits de son disciple ; c'est ainsi, par exemple, que vous rapportez à des raisons profondes le choix que fit Romulus, par hasard ou par nécessité, de l'emplacement de Rome ; et maintenant, sans permettre à vos pensées de se perdre dans le vague, vous les dirigez toutes vers l'examen approfondi d'une seule république. Poursuivez donc votre route; il me semble déjà vous entendre expliquer l'histoire des autres rois, et nous montrer enfin la constitution romaine accomplie.
XII. Scipion reprit : Le sénat de Romulus, composé des premiers citoyens, que le roi avait assez élevés pour vouloir qu'ils fussent nommés Pères et leurs enfants patriciens, essaya, après la mort de Romulus, de gouverner sans roi la république; mais le peuple ne le souffrit point, et, dans l'ardeur des regrets que lui inspirait son premier chef, il ne cessa de demander un roi. Les sénateurs alors imaginèrent une espèce d'interrègne inconnu jusque-là dans l'histoire des nations; ils firent nommer un roi provisoire, qui leur offrait le double avantage de ne point laisser de lacune dans le gouvernement royal, et de ne point habituer le peuple à un seul et même maître; ces rois de passage ne goûtaient pas assez longtemps le pouvoir pour hésiter à s'en défaire, ou pour se rendre capables de le conserver. A cette époque, nos premiers Romains, ce peuple si nouveau, aperçurent un grand principe qui avait échappé à Lycurgue. Le législateur de Lacédémone , si toutefois cette question était de son ressort, décida que l'on ne devait point élire les rois, mais que le trône appartenait aux descendants, quels qu'ils fussent, de la race d'Hercule. Nos ancêtres, malgré toute leur rusticité, reconnurent que c'était la vertu et la sagesse, et non le sang, qui devaient faire les rois.
XIII. La renommée rapportait des merveilles de la sagesse de Numa Pompilius; c'était un Sabin; mais le peuple, sans vanité patriotique, choisit pour roi, sur la proposition même du sénat, ce vertueux étranger, et l'appela de Cures à Rome pour régner. A peine arrivé, quoique le peuple l'eût nommé roi dans les comices par curies, Numa fit confirmer son autorité par une nouvelle loi que les curies votèrent également; et comme il vit que les institutions de Romulus avaient enflammé les Romains pour la guerre, il jugea qu'il fallait peu à peu amortir cette ardeur et calmer leurs sens.
XIV. Et d'abord il distribua par tête aux citoyens les terres que Romulus avait conquises; il leur fit comprendre que, sans piller ni ravager, ils pouvaient, par la culture de leurs champs, vivre dans l'abondance des biens, et leur inspira l'amour de la tranquillité et de la paix, à l'ombre desquelles fleurissent la justice et la bonne foi, et dont l'influence tutélaire protége la culture des campagnes et la récolte des fruits de la terre. C'est à Numa que remonte l'institution des grands auspices; c'est lui qui porta de trois à cinq le nombre des augures, et qui choisit parmi les grands cinq pontifes qu'il préposa aux cérémonies sacrées; il fit rendre toutes ces lois dont nous conservons le dépôt, et qui soumirent au joug bienfaisant des cérémonies religieuses les esprits habitués à la guerre et ne respirant que combats; il créa les Flamines, les Saliens, le corps des Vestales, et régla saintement toutes les parties du culte public. Il voulut que les cérémonies sacrées fussent d'une observance difficile, mais d'un appareil très simple; il établit une foule de pratiques toutes indispensables, mais qui ne nécessitaient aucuns frais dispendieux; il multiplia les obligations religieuses; mais le pauvre put s'en acquitter aussi facilement que le riche. Il ouvrit des marchés, établit des jeux, rechercha tous les moyens de rapprocher et d'assembler les hommes. Par toutes les institutions il rappela à l'humanité et à la douceur ces esprits que la vie guerrière avait rendus cruels et farouches. Après avoir ainsi régné au milieu de la paix et de la concorde pendant trente-neuf ans (car nous suivrons de préférence le calcul de notre ami Polybe, le plus exact observateur des temps) , il mourut en laissant à Rome les deux garanties les plus solides d'un puissant avenir, la religion et l'humanité, mises en honneur par ses soins.
XV. Est-il vrai, dit alors Manilius à Scipion, est-il vrai, comme on le rapporte, que ce roi Numa fut disciple de Pythagore, ou tout au moins pythagoricien? Je l'ai souvent entendu dire aux vieillards, et je sais que c'est le sentiment public; mais je ne vois pas que nos annales autorisent suffisamment cette tradition. — (Scipion) Rien n'est plus faux, Manilius; et non seulement c'est une fiction, mais une grossière et absurde fiction : pour ma part, je ne connais rien de plus intolérable qu'un mensonge qui veut nous faire croire, non seulement ce qui n'est pas, mais ce qui de tous points est impossible. Il est avéré par l'histôire que Pythagore vint à Sybaris, à Crotone, et dans les différentes villes de la Grande-Grèce, la quatrième année du règne de Tarquin le Superbe. C'est dans la soixante-douzième Olympiade que se rencontrent à la fois le commencement du règne de Tarquin et l'arrivée de Pythagore. On voit donc, par un calcul facile, que Numa était mort depuis cent quarante ans environ lorsque Pythagore mit le pied en Italie; et sur ce point aucun doute ne s'est jamais élevé dans l'esprit de ceux qui ont étudié avec soin l'histoire des temps. — Dieux immortels, s'écria Manilius, quelle erreur, et combien elle est enracinée! Toutefois je ne ferai pas de difficulté à admettre que notre civilisation ne vienne pas d'outre-mer et qu'elle n'ait pas été importée à Rome, mais qu'elle soit l'oeuvre de notre génie propre et de nos vertus domestiques.
XVI. Vous le reconnaîtrez bien plus clairement encore, reprit Scipion, si vous observez la marche successive de la république, et si vous la voyez s'avancer vers la perfection par un progrès naturel et constant. Vous trouverez digne des plus grands éloges la sagesse de nos ancêtres, qui accueillirent plusieurs institutions étrangères, mais leur donnèrent un développement et une excellence qu'elles n'avaient jamais connus au lieu de leur origine; et vous comprendrez que ce n'est pas au hasard, mais au conseil et à la discipline, que le peuple romain doit cette puissance, dont la fortune, il est vrai, n'a point contrarié l'essor.
XVII. Après la mort de Numa, le peuple, sur la proposition d'un interroi, éleva Tullus Hostilius à la royauté, dans les comices par curies. Le nouveau roi, à l'exemple de Numa, fit confirmer sa puissance par une loi que les curies votèrent. Il s'acquit une grande réputation militaire, et fit de beaux exploits. Il construisit la place des comices et la curie, et les entoura des dépouilles des vaincus. On lui doit les formes légales des déclarations de guerre, et le droit sacré des féciaux, qui sanctionna cette institution si parfaitement juste; toute guerre qui n'avait point été déclarée suivant ces formalités fut réputée dès lors injuste et sacrilége. Mais remarquez, je vous prie, avec quelle sagesse nos rois surent comprendre qu'il fallait accorder certaines prérogatives au peuple; j'aurai beaucoup de preuves à vous en citer : en ce moment nous voyons Tullus ne pas oser prendre les insignes de la royauté sans le consentement du peuple, lui demander le droit de se faire précéder de douze licteurs avec leurs faisceaux ... (LACUNE)
XVIII. Lélius ... Dans votre discours, Scipion, la république ne s'avance pas lentement vers la perfection, elle y vole. — Scipion: Après la mort de Tullus, le peuple choisit pour roi Ancus Marcius, petit-fils de Numa par sa mère; Ancus fit, comme ses prédécesseurs, sanctionner sa puissance par une loi que votèrent les curies. Il vainquit les Latins et les reçut dans la cité romaine. Il enclava dans la ville les monts Aventin et Célius, fit le partage des terres qu'il avait conquises, déclara propriété publique les forêts voisines de la mer, dont la victoire l'avait rendu maître; fonda une ville à l'embouchure du Tibre et y envoya une colonie. Après avoir ainsi régné vingt-trois ans, il mourut. — Lélius: Voilà un roi qui mérite encore nos éloges; il faut avouer cependant que l'histoire romaine est obscure, puisque nous connaissons la mère d'Ancus et que nous ne savons quel était son père. — Scipion: Vous avez raison, mais pour tous ces temps, il n'y a guère que les noms des rois qui soient bien connus.
XIX. Pour la première fois, à cette époque, nous voyons une civilisation étrangère pénétrer dans Rome. Ce n'est pas un faible ruisseau qui s'introduit dans nos murs, mais un fleuve qui nous apporte à grands flots les lumières et les arts de la Grèce. Démaratus, un habitant de Corinthe, qui par son rang, son crédit, ses richesses, était sans difficulté le premier citoyen de l'État, ne pouvant souffrir la tyrannie de Cypsélus, s'enfuit avec de grands trésors, et vint s'établir à Tarquinies, une des villes les plus florissantes des Étrusques. Apprenant que la domination de Cypsélus s'affermissait à Corinthe, cet homme indépendant et énergique renonça pour jamais à sa patrie, se fit admettre au nombre des citoyens de Tarquinies, et fixa dans cette ville son établissement et son séjour. Il s'allia à une famille de ce pays, eut de son épouse deux fils qu'il éleva dans toutes les perfections de l'éducation grecque ... (LACUNE)
XX. ... On lui conféra aisément le droit de cité; par la politesse de ses moeurs et par son instruction il mérita l'amitié du roi Ancus, à tel point qu'il passait pour avoir toute la confiance de son maître, et partager en quelque façon avec lui l'autorité royale. Il avait d'ailleurs une exquise urbanité; il prodiguait à tous les citoyens secours, bons offices, largesses; c'était la providence du peuple. Aussi, après la mort de Marcius, les suffrages universels portèrent au trône L. Tarquin; car il avait ainsi remplacé le nom grec de sa famille, pour se conformer en tout aux usages d'un pays qui était devenu le sien. Dès qu'une loi eut confirmé son pouvoir, il doubla d'abord le nombre des sénateurs, appela ceux qui avaient déjà ce titre Pères des Anciennes Familles, et les fit toujours opiner les premiers; et ceux qui le reçurent de lui, Pères des Nouvelles Familles. Il établit ensuite l'ordre des chevaliers, tel qu'il s'est maintenu jusqu'à nos jours; mais il ne put, malgré son vif désir, changer les noms de "Titienses, Ramnenses" et "Luceres", parce que le fameux augure Attius Névius l'en dissuada. Nous savons que les Corinthiens naguère avaient grand soin de réserver et d'entretenir des chevaux pour le service de l'Etat, au moyen d'un impôt levé sur les mariés sans enfant et les veuves. Aux premières compagnies équestres Tarquin en ajouta de nouvelles, et le nombre des chevaliers fut alors de douze cents; mais il le doubla après avoir soumis les Èques, grande et redoutable nation, devenue menaçante pour le peuple romain. Il repoussa loin de Rome les Sabins qui l'assiégeaient, et remporta sur eux tout l'avantage de la guerre. Nous apprenons encore que le premier il institua les grands jeux, que l'on nomme jeux romains; que dans la guerre contre les Sabins, au fort d'une bataille, il fit voeu d'élever un temple à Jupiter très bon, très grand, et qu'il mourut après avoir régné quarante-huit ans.
XXI. Lélius: Tout ce que vous nous dites porte bien la vérité de ce mot de Caton : que la constitution de notre république n'est l'oeuvre ni d'un seul âge ni d'un seul homme; nous voyons combien chaque roi fonde d'établissements nouveaux, tous utiles à l'Etat. Mais voici venir celui des rois qui, à mon sens, a eu le plus grand génie politique. — Vous dites vrai, reprit Scipion; après la mort de Tarquin, Servius Tullius commença à régner sans un ordre du peuple. On le dit fils d'une esclave de Tarquinies et d'un client du roi; élevé dans la condition de sa mère, il servait à la table du prince; et dès ce moment on voyait briller les étincelles de son grand esprit, tant il montrait d'adresse dans son service et d'à-propos dans ses réponses. Aussi Tarquin, qui n'avait alors que de très jeunes enfants, lui témoignait une telle affection, que Servius passait généralement pour son fils. Il lui donna avec un soin extrême toute l'instruction que lui-même avait reçue, et lui apprit toutes les sciences et les arts de la Grèce. Lorsque Tarquin périt, victime des fils d'Ancus, Servius commença à régner, comme je l'ai dit, sans l'ordre du peuple; mais toutefois avec son consentement et sous son bon plaisir. On avait répandu le faux bruit que Tarquin survivait à sa blessure : Servius, dans tout l'appareil de la royauté, rendait la justice, acquittait de son argent les dettes du peuple, se montrait envers tous d'une grande affabilité, et déclarait que s'il rendait la justice, c'était au nom de Tarquin. Il ne se confia pas un seul instant au sénat. Mais après les funérailles de Tarquin il s'en référa à la décision du peuple : il fut nommé roi , et fit sanctionner son autorité par les curies. Sa première action fut de réprimer par les armes les insultes des Etrusques; ensuite ... (LACUNE)
XXII. ... Il créa dix-huit centuries de chevaliers du cens le plus élevé. Ensuite, après avoir séparé le corps nombreux des chevaliers de la masse du peuple, il divisa le peuple lui-même en cinq classes, et distingua les plus âgés des plus jeunes. Il régla tous ces ordres de manière à donner plus de valeur aux suffrages des riches qu'à ceux de la multitude, et il prit grand soin (ce que l'on ne doit jamais négliger dans la constitution d'un État) de ne pas laisser la puissance au nombre. Je vous expliquerais tout le travail de Servius, si vous ne le connaissiez déjà parfaitement. En deux mots, voici le système de cette politique : les centuries des chevaliers augmentées de six centuries nouvelles, et la première classe, en y ajoutant la centurie des charpentiers, que l'on y comprend à cause de leur extrême importance pour la ville, forment réunies quatre-vingt-neuf centuries : qu'il s'y joigne seulement huit centuries des cent quatre qui restent, et voilà une majorité qui fait loi et vaut pour tout le peuple. Les autres centuries, au nombre de quatre-vingt-seize, contiennent une multitude beaucoup plus considérable, qui n'est pas exclue des suffrages, ce qui serait tyrannique, mais qui ne peut avoir de prépondérance, ce qui serait dangereux. Servius choisit même avec soin les noms qu'il donne aux différentes classes de citoyens ; il appela les riches les imposés, parce qu'ils fournissaient l'impôt ("assiduos ab aere dando") ; et ceux qui ne possédaient pas plus de quinze cents as, ou qui même n'avaient à déclarer au cens rien de plus que leur tête, il les nomma prolétaires, pour faire voir que la république attendait d'eux en quelque façon une race ("proles"), une postérité. Or, dans chacune des quatre-vingt-seize dernières centuries il y avait plus de citoyens inscrits peut-être que dans toute la première classe. Par cette combinaison, personne n'était exclu du droit de suffrage, mais la prépondérance appartenait à ceux qui avaient le plus d'intérêt à la prospérité de la république. De plus, les soldats surnuméraires, les trompettes et les cors de l'armée, les prolétaires ... (LACUNE)
XXIII. (La meilleure forme de constitution politique est celle qui réunit dans un juste tempérament les trois sortes de gouvernement, royal, aristocratique et populaire, et qui n'irrite point par les châtiments des esprits rudes et intraitables.) Scipion: ... Telle fut à peu près Carthage, plus ancienne que Rome de soixante-cinq ans, puisqu'elle fut fondée trente-neuf ans avant la première Olympiade. Lycurgue, qui est encore beaucoup plus ancien, avait des vues semblables. Ce système mixte, où les trois formes de gouvernement se trouvent réunies, me paraît donc nous avoir été commun avec ces peuples. Mais il est un trait distinctif de la constitution romaine que je veux m'attacher à mettre en lumière, parce qu'aucune autre république ne nous offre rien de semblable. Nous venons de voir dans la Rome royale, nous retrouvons à Lacédémone et à Carthage le mélange des diverses formes de gouvernement, mais non pas leur équilibre. Dès lors qu'il y a dans un État un homme revêtu d'un pouvoir perpétuel, surtout de l'autorité royale, quand même on rencontrerait auprès de lui un sénat comme à Rome sous nos rois, et à Sparte sous les lois de Lycurgue, quand même le peuple aurait conservé quelques droits comme parmi nous à l'époque du gouvernement royal, cependant la royauté a toujours la prépondérance, et il est impossible qu'un tel État ne soit pas une monarchie et n'en porte pas le titre. Mais de toutes les formes de gouvernement, c'est la plus sujette à altération, parce qu'il suffit des fautes d'un seul homme pour la précipiter dans le plus funeste abus avec une facilité déplorable. Je suis fort loin d'attaquer la royauté en elle-même, et je ne sais trop si je ne la préférerais pas de beaucoup aux autres gouvernements simples, en supposant que je pusse approuver une constitution qui ne fût pas mixte. Mais la royauté ne mérite cette préférence qu'alors qu'elle est fidèle à son institution; et l'on en reconnaît le vrai caractère lorsque les citoyens doivent leur salut, le maintien de leur égalité et leur repos au pouvoir perpétuel, à la justice et à la haute sagesse d'un seul. Il manque beaucoup de choses au peuple sous la domination royale, et avant tout la liberté, qui ne consiste pas à avoir un bon maître, mais à n'en point avoir ... (LACUNE)
XXIV. ... Ce maître injuste et cruel, secondé par la fortune, vit dans les premières années tout lui succéder avec bonheur. Le Latium entier reconnut la supériorité de ses armes; il prit Suessa Pométia, une ville des plus opulentes; avec les immenses trésors qu'il en tira, il put acquitter le voeu de son père, et bâtir le Capitole; il fonda plusieurs colonies, et, fidèle aux usages de ses pères, il fit porter au temple de Delphes, en offrande à Apollon, des dons magnifiques, prémices des dépouilles de l'ennemi.
XXV. Ici nous allons assister à une de ces révolutions dont il nous faut étudier dès le principe le cours naturel et l'ordre des vicissitudes. Car l'objet par excellence de la sagesse politique, dont nous essayons de tracer les règles dans cette discussion, est de savoir par quelles routes directes ou détournées s'avancent les corps politiques, afin de pouvoir, en prévoyant leurs errements funestes, conjurer ou combattre leurs périls. Et d'abord le roi dont je parle, souillé du meurtre d'un excellent prince, avait l'esprit à demi perdu; tremblant lui-même à l'idée qu'il devait expier son crime par quelque châtiment terrible, il voulait que tout le monde tremblât sous lui. Exalté par ses victoires et ses grandes richesses, il se laissait aller aux derniers degrés de l'insolence, impuissant à régler ses moeurs et à contenir les passions des siens. Aussi arriva-t-il que son fils aîné ayant fait violence à Lucrèce, fille de Tricipitinus, épouse de Collatin, et cette femme noble et chaste s'étant donné la mort en réparation de cet outrage, un homme plein de vertu et de génie, L. Brutus, brisa le joug odieux qui opprimait ses concitoyens : homme privé, il prit en main la cause de toute la nation, et montra le premier parmi nous que, lorsqu'il faut sauver la liberté de la patrie, tout citoyen devient homme public. A sa voix, Rome entière se soulève; la vue du père de Lucrèce et de tous ses proches plongés dans le deuil, le souvenir de l'arrogance de Tarquin et de mille injures faites au peuple par le tyran et par ses fils, indignent les esprits , et l'exil est prononcé contre le roi, contre ses fils, et toute la famille des Turquins.
XXVI. Voyez-vous donc comment le roi fit place au despote, et comment, par la perversité d'un seul, une des meilleures formes de gouvernement devint la plus odieuse de toutes? Tel est bien le caractère du despote, que les Grecs nomment tyran; car ils n'accordent le titre de roi qu'à celui qui veille aux intérêts du peuple comme un père, et qui s'emploie sans cesse à rendre la condition de ses sujets la plus heureuse possible. La royauté est, comme je l'ai dit, une forme de gouvernement très digne d'éloges, mais qui malheureusement se trouve toujours sur une pente fort rapide et singulièrement dangereuse. Dès que l'autorité royale s'est changée en une domination injuste, il n'y a plus de roi, mais un tyran, c'est-à-dire le monstre le plus horrible, le plus hideux, le plus en abomination aux Dieux et aux hommes, que l'on puisse concevoir; il porte les traits d'un homme, mais il a le coeur plus cruel que le tigre. Comment reconnaître pour un homme celui qui ne veut entrer ni dans la communauté de droits qui fait les sociétés, ni dans la communauté de sentiments qui unit le genre humain? Mais nous trouverons une occasion plus convenable pour parler de la tyrannie lorsque nous aurons à nous élever contre les citoyens qui, au sein d'un Etat rendu à la liberté, osèrent aspirer à la domination.
XXVII. Vous venez donc de voir se former le premier tyran ; je conserve ce nom donné par les Grecs aux rois injustes, quoique nos Romains aient appelé rois sans distinction tous ceux qui avaient seuls une autorité perpétuelle sur les peuples. C'est ainsi que l'on accusa Spurius Cassius, M. Manlius et Spurius Mélius d'avoir voulu s'élever à la royauté, et que tout récemment encore Tib. Gracchus ... (LACUNE)
XXVIII. Lycurgue, à Lacédémone, donna le nom d'Anciens aux membres trop peu nombreux, puisqu'ils n'étaient que vingt-huit, d'un conseil à qui il attribua le droit suprême de délibération, tandis que le roi conservait le droit suprême de commandement. Nos ancêtres imitèrent son exemple, et traduisirent même son expression, en appelant Sénat ("Senatus") ceux qu'il avait nommés Anciens ("Senes") ; c'est ce que Romulus fit lui-même, nous l'avons déjà dit à l'égard des Pères qu'il avait institués. Cependant, au milieu d'une telle constitution, quoi qu'on fasse, la prépondérance appartient toujours à la royauté. Vous accordez quelques droits au peuple, comme Lycurgue et Romulus : croyez-vous donc lui donner toute la liberté qu'il rêve? Vous ne faites qu'irriter sa soif d'indépendance, en lui permettant de goûter cette liberté séduisante. En tout cas, on aura toujours à craindre que le roi (ce qui n'arrive que trop souvent) ne devienne un maître injuste. C'est donc pour un peuple une destinée fragile que celle qui dépend du bon vouloir et des inclinations d'un seul homme.
XXIX. Je vous ai montré le premier modèle du despote, et je vous ai fait observer l'origine de la tyrannie dans cet Etat que Romulus avait fondé sous la protection des Dieux, et non dans cette république dépeinte par l'éloquence de Platon, et conçue dans les promenades philosophiques de Socrate, afin de pouvoir opposer à Tarquin portant un coup mortel à l'autorité royale, non par l'usurpation d'une puissance nouvelle, mais par l'injuste emploi de son légitime empire, cet autre chef, bon, sage, éclairé sur les intérêts de l'État, jaloux de sa dignité, en un mot le véritable tuteur de la république ; car c'est ainsi que l'on doit nommer tous ceux qui savent régir et gouverner les nations. Reconnaissez l'homme dont je vous parle; c'est celui dont la sagesse et l'active vigilance sont les garanties de la fortune publique. A peine son nom a-t-il été prononcé jusqu'ici, mais plus d'une fois dans la suite nous aurons à parler de ses fonctions et de son pouvoir ... (LACUNE)
XXX. ... Platon veut que la plus parfaite égalité préside à la distribution des terres, à l'établissement des demeures; il circonscrit dans les plus étroites limites sa république, plus désirable que possible ; il nous présente enfin un modèle qui jamais n'existera, mais où nous lisons avec clarté les principes du gouvernement des États. Pour moi, si mes forces ne me trahissent pas, je veux appliquer ces mêmes principes, non plus au vain fantôme d'une cité imaginaire, mais à la plus puissante république du monde, et faire toucher en quelque façon du doigt les causes du bien et du mal dans l'ordre politique. Après que les rois eurent gouverné Rome pendant deux cent quarante années et un peu plus, en comptant les interrègnes, le peuple qui bannit Tarquin témoigna pour la royauté autant d'aversion qu'il avait montré d'attachement à ce gouvernement monarchique, à l'époque de la mort ou plutôt de la disparition de Romulus. Alors il n'avait pu se passer de roi; maintenant, après l'expulsion de Tarquin, le nom même de roi lui était odieux. (LACUNE)
XXXI. Ainsi cette belle constitution de Romulus, après être demeurée en vigueur pendant deux cent vingt ans environ ... Cette loi fut complétement abrogée. C'est dans cet esprit que nos ancêtres bannirent Collatin dont le seul crime était ses liens de parenté, et toute la famille des Tarquins, en haine de leur nom. C'est dans cet esprit également que P. Valérius fit le premier incliner ses faisceaux lorsqu'il parlait dans l'assemblée du peuple, et qu'il vint habiter au pied du mont Véli, lorsqu'il s'aperçut que le peuple ne voyait pas sans inquiétude s'élever la maison qu'il faisait bâtir sur la hauteur, au lieu même où avait habité le roi Tullus. Valérius enfin (et c'est ici qu'il se montra le plus digne de son titre de Publicola) proposa au peuple la première loi que votèrent les comices par centuries, pour interdire aux magistrats de mettre à mort ou de frapper de verges le citoyen romain qui en appelait au peuple. Le droit d'appel existait déjà sous les rois, comme l'attestent les livres des pontifes et ceux des augures; plusieurs dispositions des douze Tables prouvent aussi que l'on pouvait appeler de tout jugement et de toute condamnation ; enfin l'élection des magistrats eux-mêmes n'était pas sans appel : et ce qui l'établit clairement, c'est que l'histoire nous apprend comme un fait tout particulier que les décemvirs, chargés de donner des lois à Rome, ont été nommés sans appel. Lucius, Valérius Potitus et M. Horatius Barbatus, sagement populaires par amour de la concorde, ordonnèrent, par une loi de leur consulat, qu'aucun magistrat ne serait créé sans appel. Les trois lois Porcia, proposées par trois membres de la famille des Porcius, n'ajoutèrent, comme vous le savez, rien de nouveau que la sanction. Valérius donc, après la promulgation de cette loi sur l'appel au peuple, fit ôter immédiatement les haches des faisceaux consulaires, et le lendemain il se donna Sp. Lucrétius pour collègue. Spurius étant son aîné, il lui envoya les licteurs, et il décida le premier que chaque mois les mêmes faisceaux précéderaient alternativement l'un des consuls, pour qu'il n'y eût pas dans un État libre plus d'insignes du pouvoir qu'il n'y en avait eu sous les rois. Ce n'était pas un homme ordinaire, à mon sens, que celui qui sut ainsi, en accordant au peuple une liberté modérée, affermir l'autorité des grands. Si j'insiste de cette sorte sur des temps qui sont loin de nous et sur ces vieux souvenirs, ce n'est pas sans motifs; car je veux vous montrer dans ces personnages illustres, et dans ces événements si parfaitement connus, les modèles des grands politiques et les règles des grandes affaires, et préparer ainsi la théorie que je dois vous développer bientôt.
XXXII. Durant cette époque le sénat dirigeait donc la république; de telle sorte que peu de choses se faisaient par l'autorité du peuple, que la plupart des affaires se décidaient par la volonté des sénateurs, conformément à leurs maximes et à leurs traditions, et qu'enfin deux consuls avaient en main un pouvoir qui ne différait guère de celui des rois que parce qu'il expirait au bout d'une année. Les chefs de l'État maintenaient surtout avec beaucoup d'énergie une règle que l'on peut regarder comme la clef de voûte de la puissance patricienne, et en vertu de laquelle les délibérations du peuple n'avaient force de loi que lorsqu'elles étaient revêtues de la sanction du sénat. Vers ce même temps, et dix ans environ après les premiers consuls, la dictature fut instituée, et T. Larcius investi de cette magistrature nouvelle, qui avait tant de ressemblance avec la royauté. Cependant les principales familles conservaient sur toutes les affaires publiques une autorité souveraine acceptée par le peuple, et les armées de la république remportaient de grands succès sous la conduite de ces vaillants hommes, dictateurs ou consuls, appelés au commandement suprême.
XXXIII. Mais la nature des choses demandait que le peuple, affranchi du joug royal, cherchât à étendre ses droits : seize ans à peine étaient écoulés qu'il atteignit ce but, sous le consulat de Postumus Cominius et de Sp. Cassius. Peut-être la raison ne présida-t-elle pas à ce mouvement populaire; mais l'impulsion naturelle qui entraîne les États est souvent plus forte que la raison. Ne perdez jamais de vue ce que je vous disais en commençant : si dans une société la constitution n'a pas réparti avec une juste mesure les droits, les fonctions et les devoirs, de telle sorte que les magistrats aient assez de pouvoir, le conseil des grands assez d'autorité, et le peuple assez de liberté, on ne peut s'attendre à ce que l'ordre établi soit immuable. Pour en revenir à Rome, les dettes du peuple avaient amené le trouble dans l'État, et la multitude se retira d'abord sur le mont Sacré, puis sur l'Aventin. Les lois de Lycurgue elles-mêmes n'avaient pas eu le pouvoir de contenir l'effervescence des Grecs; il fallut créer à Sparte, sous le règne de Théopompe, cinq éphores, et en Crète les "Cosmes", pour les opposer aux rois, comme chez nous les tribuns pour faire échec à l'autorité consulaire.
XXXIV. Peut-être nos ancêtres auraient-ils pu trouver quelque remède à ce fléau de dettes. Peu de temps auparavant, Solon l'avait combattu à Athènes, et quelques années après notre sénat, indigné de la violence d'un créancier, libéra de sa pleine autorité tous les citoyens, et pourvut à ce qu'ils ne pussent retomber dans de pareilles chaînes à l'avenir; enfin, à toutes les époques où le peuple, ruiné par une calamité publique et dévoré par sa dette, fut réduit aux abois, on chercha dans l'intérêt commun un soulagement et des remèdes à ses maux. Mais alors on n'écouta point les conseils de cette sage politique, et l'on donna occasion au peuple d'obtenir par une révolte la création de deux tribuns, et d'affaiblir le pouvoir et l'autorité du sénat. Cependant les nobles conservèrent encore beaucoup d'ascendant; les grandes familles donnaient toujours à l'Etat ces hommes d'une sagesse consommée et d'un hardi courage, qui étaient le boulevard de la république. Savez-vous ce qui établissait principalement leur empire sur les esprits? C'est qu'au milieu des honneurs ils s'interdisaient tous plaisirs, et partageaient presque la pauvreté du peuple; c'est qu'ils se frayaient la route à une grande popularité politique, en obligeant, avec une application extrême, tous les citoyens de leur aide, de leurs conseils, de leur propre bien, dans les circonstances critiques de la vie privée.
XXXV. Telle était la situation de la république, lorsque Sp. Cassius, l'un des hommes les plus populaires que l'on vit jamais, fut accusé par le questeur d'affecter la royauté, et mis à mort, comme vous le savez, sur le témoignage de son père qui le déclarait coupable, et de l'aveu du peuple. Cinquante-quatre ans environ après l'établissement de la république, les consuls Sp. Tarpéius et A. Aternius firent une chose agréable au peuple, en proposant aux comices par centuries leur loi sur la consignation de l'amende. Vingt ans après, comme les censeurs L. Papirius et P. Pinarius, en appliquant ces amendes, confisquaient au profit de l'Etat les troupeaux d'une foule de particuliers, une loi qui permettait le rachat des troupeaux moyennant une légère somme d'argent fut portée par les consuls C. Julius et P. Papirius.
XXXVI. Mais quelques années auparavant, alors que le sénat exerçait une autorité presque sans limites, de l'aveu du peuple qui la respectait, on vit tout à coup un grand changement : les consuls et les tribuns du peuple abdiquèrent, et l'on créa sans appel dix magistrats investis du pouvoir suprême, pour gouverner la république et donner à Rome un code de lois. Après avoir rédigé dix tables de lois avec une sagesse et une équité merveilleuses, ces décemvirs se donnèrent à la fin de l'année dix successeurs, qui ne méritèrent pas la même réputation d'honneur et de justice. On cite cependant avec grands éloges ce trait de C. Julius, l'un d'eux. Un cadavre avait été déterré dans la chambre du patricien L. Sextius, et en présence du décemvir; Julius le déclarait; magistrat sans appel, il était tout puissant, et cependant il consentit à recevoir la caution de l'accusé, et déclara qu'il ne voudrait à aucun prix enfreindre cette belle loi, en vertu de laquelle le droit de prononcer sur l'existence d'un citoyen romain n'appartenait qu'à l'assemblée du peuple.
XXXVII. Une troisième année s'ouvrit. Les mêmes décemvirs conservèrent le pouvoir; ils n'avaient pas voulu se donner de successeurs. Mais la république se trouvait dans un de ces états qui ne peuvent durer, car il n'y avait point d'égalité entre les différents ordres de la nation ; tout le pouvoir était concentré dans la main des grands ; dix hommes, choisis parmi les premières familles, avaient l'autorité souveraine; point de tribuns du peuple pour les tenir en respect ; point d'autres magistrats admis à partager leur puissance; point d'appel au peuple contre des châtiments indignes; point de recours contre un arrêt de mort. Aussi leur tyranie amena-t-elle bientôt un grand désordre dans l'État et une révolution complète. Ils avaient ajouté deux tables de lois iniques : tandis que les alliances même entre deùx nations sont autorisées par tout le monde, ils avaient interdit de la façon la plus outrageante les mariages entre les deux ordres d'un même peuple; interdiction que leva plus tard le plébiscite de Canuléius ; enfin ils se montraient dans tout leur gouvernement exacteurs du peuple, cruels et débauchés. Vous savez tous, et nos monuments littéraires le célèbrent à l'envi, comment D. Virginius immola de sa main, en plein forum, sa fille vierge pour la soustraire à la passion infâme d'un de ces décemvirs, et se réfugia désespéré près de l'armée romaine, campée alors sur le mont Algide; comment les légions, renonçant à combattre l'ennemi, vinrent occuper d'àbord le mont Sacré, comme la multitude l'avait fait naguère dans une occasion semblable, ensuite le mont Aventin ... (lacune) ... Nos ancêtres l'ont fort approuvé et très sagement maintenu; c'est là du moins mon avis.
XXXVIII. Scipion s'interrompit un instant, et tous ses amis attendaient dans un religieux silence la suite de son discours. Tubéron s'enhardissant alors : Puisque mes aînés ne vous présentent aucune réflexion, je vous dirai moi-même, Scipion, ce que votre discours nous laisse à désirer. —Scipion : j'y consens, et de grand coeur. —Tubéron : vous venez, ce me semble, de faire l'éloge du gouvernement de Rome, tandis que Lélius vous avait demandé ce que vous pensiez de la politique en général. J'ajouterai même que votre discours ne nous a pas appris par quels principes, par quelles moeurs, par quelles lois nous pouvons affermir ou sauver cette constitution que vous admirez tant.
XXXIX. Scipion : je pense, Tubéron, que bientôt se présentera le véritable moment de parler de l'affermissement et de la conservation des États. Mais en ce qui touche la meilleure forme de gouvernement, je croyais avoir suffisamment répondu à la demande de Lélius. J'avais d'abord marqué trois sortes de gouvernement que la raison peut approuver, et trois autres toutes funestes, qui sont l'opposé des premières ; j'avais montré qu'aucun des trois gouvernements simples n'est le meilleur, et qu'il faut préférer à chacun d'eux celui qui les réunit et les tempère tous. Si j'ai proposé notre république pour exemple, ce n'était pas qu'elle dût me servir à déterminer en théorie la meilleure forme de gouvernement; car, pour établir les principes, les exemples ne sont point nécessaires; mais je voulais que l'histoire d'un grand État rendît palpables les enseignements un peu abstraits de la pure spéculation. Mais si vous avez le désir de vous représenter la meilleure forme de constitution sociale sans aucun modèle historique, jetez les yeux sur la nature; puisque l'image de ce peuple et de cette cité ... (LACUNE CONSIDERABLE)
XL. Scipion : celui que je cherche depuis longtemps et à qui j'ai hâte d'arriver. — Lélius : vous voulez parler du politique? — Scipion : vous l'avez dit. Lélius : vous en trouverez ici une assez belle réunion, à commencer par vous. — Scipion : plût aux Dieux que le sénat nous en offrit dans la même proportion ! Mais pour en venir aux qualités du politique, ne les trouvez-vous pas dans ces hommes que j'ai vus souvent en Afrique, assis sur le cou d'un animal monstrueux, gouverner et diriger leur énorme monture, et lui faire exécuter toutes sortes de mouvements sans violence, sans efforts, au moindre signe? — Lélius : je connais ces hommes, et je les ai vus souvent, quand j'étais votre lieutenant en Afrique. — Scipion : mais ce Carthaginois ou cet Indien ne gouverne qu'un seul animal, apprivoisé déjà, et qui se plie facilement au commandement de l'homme; tandis que ce guide intérieur que nous a donné la nature, cette partie de notre âme qu'on nomme la raison, doit dompter un monstre à mille têtes, farouche, intraitable, et dont il est bien rare de triompher. Il faut qu'elle soumette à ses lois cette ardente ... (LACUNE)
XLI. ...... 1. Qui se nourrit de sang, qui fait ses délices de la cruauté, et que le plus effroyable carnage rassasierait à peine. Nonius, iv, 178.
2. L'homme livré à ses désirs, emporté par ses passions, et qui se roule sur un lit de voluptés. Id. viii, 64.
3. Trois affections de l'âme entraînent l'homme à tous les crimes: la colère, la cupidité, la concupiscence. La colère a soif de vengeance; la cupidité, de richesses; la concupiscence, des voluptés. Lactance, Instit. vi, 19.
4. La quatrième forme du chagrin est la tristesse ou le deuil de l'âme qui se torture sans cesse elle-même. Nonius, ii, 32.
5. Les angoisses commencent lorsque l'âme succombe au fardeau de la misère, et se laisse aller à la lâcheté. Id. iii, 246.
6. De même qu'un cocher inhabile est renversé du char, écrasé, meurtri, mis en lambeaux. Id. iv, 154.
7. Les passions de l'âme ressemblent à un char attelé. Pour le bien diriger, le premier devoir du conducteur est de connaître la route: s'il est dans le bon chemin, quelle que soit la rapidité de sa course, il ne heurtera pas; mais s'il est dans le mauvais, avec quelque lenteur et quelque précaution qu'il avance, il s'embarrassera dans des terrains impraticables, ou il ira se perdre dans des précipices, ou pour le moins il se trouvera porté dans des lieux où il n'a que faire. Lactance, Inst. vii, 17.]
XLII. ... Lélius : je vois maintenant quelle tâche et quels devoirs vous imposez à cet homme dont j'attendais le portrait. — Scipion : à vrai dire, je ne lui impose qu'un seul devoir, car celui-là comprend tout le reste : c'est de s'étudier et se régler constamment lui-même, afin de pouvoir appeler les autres hommes à l'imiter, et de s'offrir lui-même, par l'éclatante pureté de son âme et de sa vie, comme un miroir à ses concitoyens. De même que la flûte et la lyre, la mélodie et les voix, de la diversité de leurs accents forment un concert que les oreilles exercées ne pourraient souffrir s'il était plein d'altérations ou de dissonances, et dont l'harmonie et la perfection résultent pourtant de l'accord d'un grand nombre de sons dissemblables; ainsi de l'alliance des différents ordres de l'État et de leur juste tempérament résulte ce concert politique qui naît, comme l'autre, de l'accord des éléments les plus opposés. Ce que l'on nomme harmonie dans la musique, dans l'État c'est la concorde, le lien le plus parfait de la société humaine, la garantie la plus sûre de la force des États. Mais sans la justice, la concorde est impossible ...
XLIII. [Lorsque Scipion eut exposé avec une certaine étendue combien la justice, est utile aux États et combien leur nuit l'injustice, Philus, un de ceux qui étaient présents à la discussion, prit la parole, et demanda que cette question fût approfondie, et que l'on présentât de nouvelles raisons en faveur de la justice, à cause de cette maxime, déjà fort répandue, Qu'il n'y a pas de gouvernement possible sans injustice.] S. Augustin, de Civ. Dei., ii, 2l.
XLIV. Scipion : je me rends très volontiers à votre désir, et je vous déclare même que nous n'avons rien dit jusqu'ici sur la république qui ne tombe à néant, et qu'il nous serait impossible de rien ajouter s'il ne demeure parfaitement établi, non seulement qu'il est faux de prétendre qu'on ne puisse gouverner sans injustice, mais qu'il est de toute vérité que sans une extrême justice il n'y a plus de gouvernement possible. Mais, si vous le trouvez bon, c'est assez pour aujourd'hui ; remettons la suite à demain, car il nous reste encore beaucoup de choses à dire. On se rangea à l'avis de Scipion et l'entretien de ce jour fut terminé.
ARGUMENT TIRÉ DE SAINT AUGUSTIN.
Cité de Dieu, L. II, C. 2l.
Le troisième livre s'ouvre par un grand débat. Philus soutient l'opinion de ceux qui pensaient que l'on ne peut gouverner les hommes sans injustice. Il se défend avec force de partager lui-même un tel sentiment; mais il prend en main la cause de l'injustice contre la justice, et il essaye de prouver par des raisons vraisemblables et par l'expérience que la première est utile au gouvernement des États, tandis que la seconde leur est entièrement inutile. Alors Lélius, à la prière de tout le monde, entreprend de défendre la justice, et démontre par tous les moyens possibles que rien n'est plus funeste aux sociétés que l'injustice, et que, sans un grand respect pour la justice, il est absolument impossible aux États de se gouverner et de vivre. Cette question suffisamment éclaircie, Scipion revient au sujet principal de l'entretien; il rappelle et met dans tout son jour la définition qu'il avait donnée de la république, selon lui la chose du peuple; il dit que l'on doit entendre par peuple non pas toute réunion d'hommes, mais une société formée sous la garantie du droit et dans un but d'utilité commune. Il montre combien les définitions sont utiles dans tout débat; et de celles qu'il a établies il conclut qu'un État est vraiment conforme à son institution, et se montre bien la chose du peuple, quand il est gouverné équitablement et sagement, ou par un roi, ou par quelques citoyens principaux, ou par le corps entier de la Nation. Il appelle tyran, à l'exemple des Grecs, le roi injuste; faction, l'aristocratie injuste; et ne trouvant pas de terme consacré pour qualifier un peuple injuste, il lui donne aussi le nom de tyran. Mais tandis que, dans la discussion de la veille, il avait appelé États corrompus ceux dont le maître est injuste, il va plus loin maintenant, et déclare, en conséquence même de ses définitions, que, sous de tels maîtres, il n'y a plus de société. Lorsqu'un tyran ou une faction domine, ce n'est plus, dit-il, la chose du peuple; et le peuple lui-même, quand il devient injuste, cesse d'être un peuple, parce qu'il ne présente plus alors l'image d'une société formée sous la garantie du droit et dans un but d'utilité commune, ce qui est, comme on l'a vu, la véritable définition du peuple.
I. [Dans le troisième livre de la République, Cicéron dit que la nature, plutôt marâtre que mère, a mis l'homme en ce monde avec un corps nu, frêle et débile, avec une âme dévouée aux chagrins, sujette aux terreurs, molle au travail, ouverte aux passions, mais au fond de laquelle cependant luit encore à demi étouffée une divine étincelle d'intelligence et de génie.] Saint Augustin, contre Julien le Pélagien, iv, 160.
[L'homme, qui est lié faible et désarmé, parvient cependant à se mettre en sûreté contre tous les antres animaux; tandis que les animaux les plus robustes, ceux mêmes qui supportent aisément toute l'inclémence du ciel, ne peuvent se défendre contre l'homme. On voit donc que la raison est plus utile a l'homme que leur forte nature ne l'est aux autres animaux, puisque ceux-ci, malgré la vigueur de leurs muscles et la dureté de leur corps, ne peuvent éviter de tomber sous nos coups ou de devenir nos esclaves...... Platon rend grâces à la nature de lui avoir donné la condition humaine......] Lactance, de Opif. Dei, c. 3.
II. ...... L'homme s'avançait lentement, il est porté avec une vitesse extraordinaire. Il ne poussait d'abord que des sons confus et inarticulés, l'intelligence les a débrouillés et rendus distincts; elle a attaché les mots aux choses, pour en être comme le signe; elle n réuni les hommes, auparavant dispersés, par ce lien délicieux du langage. Les articulations de la voix paraissaient infinies, mais cette même intelligence trouva l'art de les exprimer et de les représenter toutes au moyen d'un petit nombre de caractères, qui nous permettent de converser avec les absents, de faire connaître nos volontés, et de fixer dans des monuments le souvenir du passé. Le génie de l'homme découvrit ensuite la science des nombres, chose si nécessaire à la vie et qui seule est immuable et éternelle. Cette science nous conduisit à jeter un regard observateur sur les deux, et, sans nous consumer dans une contemplation stérile de mouvements astronomiques à faire le calcul des jours et des nuits......(LACUNE)
III. ...... Des hommes parurent enfin, dont l'esprit s'éleva plus haut, et put exécuter ou concevoir quelques grandes choses, qui fussent vraiment dignes de ce présent des Dieux. Regardez donc, si vous le voulez, comme de grands hommes ceux qui nous enseignent l'art de la vie; regardez-les comme les lumières des peuples, comme les précepteurs de la vérité et de la vertu, rien de plus légitime; pourvu que vous accordiez une partie de cette estime à la science du gouvernement, à ce grand art de la vie des peuples, sorti d'abord de l'expérience des hommes politiques, médité ensuite à l'ombre des écoles, et qui donne souvent aux esprits heureusement nés une vertu divine et une incroyable puissance. Lorsque de nobles âmes ont voulu joindre aux facultés qu'elles tenaient de la nature ou des institutions sociales les trésors de la science et la lumière des principes, comme firent les illustres personnages que j'introduis dans cet ouvrage, il n'est personne qui ne proclame leur incontestable supériorité. Quoi de plus admirable en effet que d'allier la pratique et l'expérience des grandes choses à l'étude et la méditation des arts de la vie? Peut-on imaginer rien de plus parfait qu'un Scipion, un Lélius, un Philus, tous ces grands hommes enfin qui pour ne négliger aucune partie de la véritable gloire, joignirent aux maximes de leurs ancêtres et aux traditions domestiques les enseignements étrangers dont Socrate fut le père? Je regarde donc comme accompli de tous points celui qui a voulu et qui a pu en même temps réunir au pieux héritage de nos ancêtres le bienfait de la science. Mais s'il fallait choisir entre ces deux voies de la sagesse, bien que beaucoup d'esprits puissent trouver plus heureuse une vie passée dans l'étude et la méditation des plus hautes vérités, mon suffrage serait acquis à cette vie active dont la gloire est plus solide, et qui produit des hommes comme M. Curius. «Que personne jamais n'a pu vaincre ni avec l'or ni avec le fer;» ou comme......(LACUNE)
IV. ...... La différence qu'il y eut entre les grands hommes des deux nations, c'est que chez les Grecs les semences de vertu furent développées par la parole et l'étude; chez nous, au contraire, par les institutions et les lois. Rome a produit un grand nombre, je ne dirai pas de sages, puisque c'est un titre dont la philosophie est si avare, mais d'hommes souverainement dignes de gloire, puisqu'ils ont pratiqué les préceptes et les leçons des sages; et si l'on songe au nombre des États florissants que le monde a connus et qu'il renferme encore, si l'on fait réflexion que le plus grand effort du génie est de fonder une nation capable d'avenir: à ne compter qu'un législateur par peuple, quelle multitude de grands hommes nous voyons subitement apparaître! Si nous voulons parcourir en esprit toutes les contrées de l'Italie, le Latium, le pays des Sabins et des Volsques, le Samnium, l'Étrurie, la Grande-Grèce; si nous jetons les yeux sur les Assyriens, les Perses, les Carthaginois......(LACUNE)
V. ...... Vous me chargez là d'une belle cause, dit Philus, en m'ordonnant de prendre la défense de l'injustice! — Craignez-vous donc sérieusement, lui répondit Lélius, que si nous vous entendons développer les arguments favoris des adversaires de la justice, nous ne vous prenions pour l'un des leurs, vous qui êtes parmi nous le plus parfait modèle de l'antique probité et de la foi romaine, vous dont tout le monde connaît la méthode habituelle d'examiner tour à tour les deux cotés de chaque question, pour arriver plus aisément à découvrir la vérité! — Eh bien, soit! dit Philus, je vous obéirai, et je prendrai un masque odieux pour vous plaire. On se fait bien d'autres violences quand on poursuit la fortune! nous qui recherchons la justice, dont le prix efface de beaucoup toutes les richesses du monde, nous ne devons reculer devant aucune épreuve. Plût aux Dieux qu'en parlant un langage qui n'est pas le mien, je pusse me servir aussi de la bouche d'un autre! Malheureusement il faut aujourd'hui que L. Philus reproduise ce que Carnéade, un Grec, un homme si habile à manier la parole......(LACUNE) [Ce n'est donc pas mes propres sentiments que j'exprimerai, mais je vous livrerai en quelque façon Carnéade, afin que vous puissiez réfuter ce raisonneur subtil, dont les chicanes savent embarrasser les meilleures causes.] Nonius, iv, 71.
VI. [Carnéade, philosophe académicien, savait discuter avec une grande force, une grande éloquence et une extrême finesse. Cicéron en parle avec beaucoup d'éloges, et Lucilius fait dire à Neptune, qui se perd dans une questions très difficile, qu'elle restera à tout jamais insoluble, quand même l'enfer rendrait exprès Carnéade au monde. Envoyé par les Athéniens en ambassade à Rome, Carnéade parla fort éloquemment de la justice, en présence de Galba et de Caton le Censeur, les deux plus grands orateurs de ce temps. Mais le lendemain il ruina complètement tout son discours de la veille, et décria la justice qu'il avait portée aux nues. Ce n'était pas là la gravité d'un philosophe, qui doit avoir des sentiments arrêtés et immuables; mais Carnéade voulait montrer toute la souplesse de son talent oratoire, exercé à soutenir également bien le pour et le contre, et qui le rendait capable de réfuter aisément tout ce qu'on lui voulait soutenir. Cicéron a mis dans la bouche de L. Furius l'argumentation de Carnéade contre la justice, sans doute parce que, traitant de la république, il avait le dessein d'amener la défense et l'éloge de cette vertu sans laquelle il était convaincu qu'on ne peut gouverner les États. Carnéade, au contraire, qui voulait réfuter Aristote et Platon, les deux plus fermes partisans de la justice, rassembla dans son premier discours tout ce qui était dit en faveur de cette cause, afin de pouvoir la ruiner ensuite, comme effectivement il y parvint.] Lactance, Instit., v, 14.
VII.[Un grand nombre de philosophes, Platon et Aristote en tête, ont dit mille choses à la louange de la justice, dont ils faisaient le plus magnifique portrait. C'est, disaient-ils, une vertu qui rend à chacun ce qui lui appartient, et maintient en tout la plus stricte équité; les autres vertus sont en quelque façon muettes, et demeurent renfermées dans l'âme; seule, la justice ne se dérobe point aux regards et ne se concentre point en elle-même, mais elle se produit toute au dehors, inspire à l'âme une bienveillance universelle, et cherche à multiplier ses bons offices. Comme si la justice ne convenait qu'aux juges et aux puissants, et non pas à tout le monde! Mais il n'est pas un seul homme, je dis même le dernier et le plus misérable, qui ne doive pratiquer la justice. Ces philosophes ignoraient en quoi consiste la justice, de quelle source elle vient, à quelle fin elle est destinée; c'est pourquoi ils ont regardé cette vertu suprême, qui est un bien commun à tous les hommes, comme le privilège d'un petit nombre, et ont dit que, n'étant à l'âme d'aucune utilité propre, elle se consacrait sans partage aux intérêts d'autrui. Il faut donc applaudir à Carnéade, dont le génie pénétrant et subtil mit à nu la faiblesse de leur doctrine, et donna le coup de grâce à cette justice, qui n'avait pas de fondement solide: non certes qu'il ne tînt la justice en estime, mais il voulait prouver qu'elle avait eu des défenseurs malhabiles, et qui prêtaient le flanc de tous côtés. Lactance, Epitom. c. 55. [La justice nous occupe des autres, elle se produit au dehors et se répand sur le monde.] Nonius, iv, 71. [Cette vertu, à la différence des autres, est tout entière consacrée aux intérêts d'autrui, qui l'absorbent.] Nonius, iv, 174.]
VIII. ...... L'autre (Aristote) a parlé de la justice seule dans quatre livres assez étendus. Quant à Chrysippe, je n'attendais de lui rien de grand, ni qui fût digne du sujet; il parle toujours à sa mode, s'embarrasse dans des minuties de langage, et ne touche jamais le fond des choses. Il était digne des héros de. la philosophie de relever cette vertu, la plus généreuse de toutes, si elle existe; la plus libérale, celle qui rend à l'homme ses semblables plus chers que lui-même, et par laquelle chacun de nous semble né non pour soi, mais pour le genre humain: il était digne d'eux de la placer sur un trône immortel, non loin de la sagesse. Et véritablement ce n'est ni la volonté qui leur a manqué (tant de livres laborieusement écrits en font foi), ni le talent, qu'ils avaient si relevé et d'une telle prééminence. Mais tout leur génie et leurs efforts ont été trahis par la faiblesse de leur cause. Il faut bien reconnaître un droit civil; mais le droit naturel, où le trouver? S'il existait, tous les hommes s'entendraient sur le juste et l'injuste, comme ils s'accordent sur le chaud et le froid, le doux et l'amer.
IX. Mais aujourd'hui, si quelqu'un de nous, emporté par des dragons ailés sur ce char dont parle Pacuvius, pouvait, du haut des airs, voir passer sous ses regards peuples, villes et contrées, quel spectacle s'offrirait à lui? Ici l'immuable Égypte, qui conserve dans ses archives le souvenir de tant de siècles et d'événements fameux, adore son bœuf Apis, et met au rang des dieux une foule de monstres et d'animaux de toute espèce. En face d'elle, la Gréée consacre des temples magnifiques à des idoles de forme humaine, commettant ainsi un indigne sacrilège, au jugement des Perses; car on prétend que Xerxès ne livra Athènes aux flammes que parce qu'il regardait comme un crime de tenir enfermés dans des murailles les Dieux, dont l'univers entier est la demeure. Plus tard, Philippe méditant la guerre contre les Perses, Alexandre accomplissant les desseins de son père, déclaraient qu'ils allaient venger les temples de la Grèce, temples que les Grecs eux-mêmes n'avaient pas voulu relever, pour laisser à la postérité un témoignage éternel de l'impiété des barbares. Combien d'hommes, comme les peuples de la Tauride sur le Pont-Euxin, comme le roi d'Égypte Busiris, comme les Gaulois, les Carthaginois, ont cru qu'il était pieux et agréable aux Dieux immortels de répandre le sang humain! Les règles de la justice et de la morale varient tellement, que les Crétois et les Étoliens tiennent en honneur te brigandage, et que les Lacédémoniens regardaient comme leur bien tous les champs où leur javelot pouvait atteindre. Les Athéniens juraient publiquement que toute terre portant des blés ou des oliviers leur appartenait de plein droit. Pour les Gaulois, c'est une honte de labourer la terre; aussi vont-ils à main armée couper la moisson sur les champs d'autrui. Nous autres enfin, les plus justes des hommes, nous défendons aux nations transalpines de planter la vigne et l'olivier, pour donner plus de prix à notre huile et à nos vins: c'est de la prudence, j'en conviens; mais direz-vous que ce soit de l'équité? Reconnaissons donc que la justice et la sagesse ne sont pas sœurs si germaines. Apprenez-le au moins de Lycurgue, ce législateur excellent, ce flambeau d'équité, qui fait cultiver les terres des riches par le peuple, comme par des serfs.
X. Si je voulais parcourir les lois, les institutions, les mœurs et les coutumes, je ne dis pas des divers pays du monde, mais d'une seule ville, et de Rome elle-même, je prouverais qu'elles ont mille fois changé. Ainsi le savant jurisconsulte qui m'écoute, Manilius, consulté aujourd'hui sur les legs et l'héritage des femmes, répondrait autrement qu'il ne faisait dans sa jeunesse, avant la loi Voconia, loi rendue dans l'intérêt des hommes, et qui est pleine d'injustice pour les femmes. Pourquoi donc une femme ne pourrait-elle pas posséder? Pourquoi une vestale a-t-elle le droit d'instituer héritier, tandis qu'une mère ne l'a pas? Pourquoi, s'il fallait mettre des bornes à la richesse des femmes, la fille de P. Crassus, en la supposant fille unique, hériterait-elle légalement de cent millions de sesterces, tandis que la mienne ne pourrait en posséder trois millions?......(LACUNE)
XI. ...... S'il y avait une justice naturelle, tous les hommes reconnaîtraient les mêmes lois, et dans un même peuple les lois ne changeraient pas avec les temps. Vous dites que le caractère du juste, de l'homme de bien, est d'obéir aux lois; mais à quelles lois? Serait-ce à toutes indistinctement? Mais la vertu n'admet point cette mobilité, et la nature est éternellement la même. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait l'autorité des lois humaines? Ce sont les prisons et les bourreaux, et non l'impression évidente de la justice. Il n'y a donc point de droit naturel; partant, ce n'est point la nature qui inspire aux hommes la justice. Direz-vous que les lois seules varient, mais que les gens de bien font naturellement ce qui est, et non ce que l'on croit juste? Il semble, en i effet, que le propre de l'homme vertueux et juste, | c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Voyons donc d'abord ce que nous devons aux bêtes; car des esprits qu'on ne peut tenir pour médiocres, de très-doctes et de très grands hommes, Pythagore et Empédocle, enseignent que tous les êtres animés ont les mêmes droits, et menacent de châtiments terribles l'homme qui porte les mains sur un animal. C'est donc un crime que de faire du mal à une bête, et ce crime......(LACUNE)
XII. [Alexandre demandait à un pirate quel mauvais génie le poussait à infester les mers avec son chétif brigantin. — Le même, lui répondit le pirate, qui t'envoie ravager le monde.] Nonius, IV, 226; xiii, 6.
...... La prudence nous engage à augmenter notre pouvoir, à accroître nos richesses, à étendre nos possessions. Comment Alexandre, ce grand capitaine, qui recula si loin les bornes de son empire, aurait-il pu, sans toucher au bien d'autrui, recueillir tant de jouissances exquises, étendre au loin sa domination, soumettre tous ces peuples à sa loi? La justice nous ordonne, au contraire, d'épargner tout le monde,de veiller aux intérêts du genre humain, de rendre à chacun ce qui lui appartient, de respecter les choses sacrées, les propriétés publiques et privées. Qu'arrive t-il? Si vous écoutez les conseils de la prudence, homme ou peuple, vous gagnez richesses, grandeurs, pouvoir, honneurs, autorité, royaumes. Puisque nous parlons ici de la république, nous pouvons trouver dans l'histoire des peuples de plus illustres exemples; et comme d'ailleurs tes nations et les individus sont gouvernés par les mêmes principes, je pense qu'il vaut mieux montrer suivant quelles règles de prudence un peuple se conduit. Pour ne rien dire des autres, jetons les yeux sur celui de Rome, et demandons-nous si c'est par la justice ou par la prudence que cet empire dont Scipion nous retraçait hier l'histoire depuis la première origine, et qui tient maintenant le monde entier sous ses lois, s'est élevé de ces obscurs commencements à ce faîte.....(LACUNE)
XIII. [Nous pouvons apprendre quelle différence il y a entre l'utilité et la justice dans l'histoire du peuple romain, qui, en déclarant la guerre par ses féciaux, en commettant légalement une foule d'injustices, en convoitant et ravissant toujours le bien d'autrui, s'est rendu le maître de tout l'univers.] Lactance, Instit., vi, 9. [Qu'est-ce que le bien d'un pays, si ce n'est le mal d'un autre? L'intérêt d'un peuple n'est-il pas d'étendre ses frontières par la force des armes, de porter au loin son empire, d'accroître ses revenus? Celui qui procure tous ces avantages à sa patrie, qui par la ruine des cités et l'anéantissement des peuples remplit le trésor public, confisque des terres, enrichit ses concitoyens, un tel homme est porté jusqu'aux nues; on trouve en lui la souveraine et parfaite vertu. Et cette erreur n'appartient pas seulement au peuple et aux ignorants, mais elle est partagée par les philosophes, qui vont jusqu'à donner des leçons d'injustice.] Lactance, Instit.,vi, 6.
XIV. ...... Tous ceux qui ont sur un peuple le pouvoir de vie et de mort sont des tyrans; mais ils aiment mieux prendre le nom du Dieu souverainement bon, et s'appeler rois. Lorsque certains hommes, élevés par leurs richesses, leur naissance ou leur crédit, sont les maîtres de l'État, c'est une faction; mais on lui donne le beau nom d'aristocratie. Si le peuple est l'arbitre suprême et tout-puissant, alors on dit que règne la liberté, et véritablement c'est la licence. Mais lorsque tout le monde se redoute dans un État, lorsque les individus et les ordres sont dans une défiance perpétuelle les uns des autres, alors il se forme une espèce de pacte entre le peuple et les grands, et l'on voit naître cette forme mixte de gouvernement dont Scipion nous faisait l'éloge. Car il faut bien comprendre que ce n'est ni la nature ni la volonté, mais la faiblesse, qui est mère de la justice. Donnez le choix à l'homme entre ces trois partis: faire le mal et ne point le souffrir, le faire et le souffrir, l'éviter sans le faire; lequel sera préféré?Le premier, faire le mal impunément. Et ensuite? l'éviter à la condition de ne point le faire. Le plus triste des trois est de passer sa vie dans une lutte continuelle, faisant le mal et le recevant tour à tour. Celui donc qui peut avoir le premier destin......(LACUNE)
XV. [Voici en substance les arguments de Carnéade: Les hommes se sont fait des lois pour servir leurs intérêts, lois qui varient selon les mœurs, qui changent dans une même nation, selon les temps; quant au droit naturel, c'est une chimère. Tous les hommes, et en général tous les êtres animés, n'ont d'autre mobile naturel que l'amour d'eux-mêmes. Il n'y a point de justice au monde; et si elle existait quelque part, ce serait une insigne folie pour un homme que de rendre service aux autres à son préjudice. Carnéade ajoutait: Si tous les peuples dont l'empire est florissant, si les Romains surtout, qui sont maîtres de l'univers, voulaient pratiquer la justice, c'est-à-dire restituer le bien d'autrui, il leur faudrait revenir à leurs anciennes cabanes, et végéter dans la pauvreté et la misère.] Lactance, Inst., v, 16...... Les peuples ne posséderaient plus un pouce de territoire, si ce n'est peut-être les Arcadiens et les Athéniens, qui, redoutant sans doute ce grand acte de justice dans l'avenir, ont imaginé de prétendre qu'ils étaient sortis de terre, comme ces rats qui naissent du sol dans les campagnes.
XVI. Parmi ceux qui prétendent nous réfuter, nous trouvons d'abord ces philosophes d'une bonne foi si parfaite, qui semblent ici avoir d'autant plus d'autorité que, dans une discussion où il s'agit de l'homme de bien, lequel, selon nous, est d'abord franc et ouvert, ils n'apportent ni finesse, ni fourberie, ni malice. Ils disent que si le sage est homme de bien, ce n'est pas que la bonté et la justice le séduisent par elles-mêmes, mais parce que la vie des gens de bien n'est agitée ni de craintes, ni de soucis, ni d'angoisses, ni de périls; tandis que les méchants sont toujours déchirés par quelques remords, et poursuivis de l'image des condamnations et des supplices. Ils disent qu'il n'est aucun avantage, aucun bien si précieux acquis par l'injustice, qui vaille les tourments qu'il cause, les terreurs sans cesse renouvelées de l'homme qui sent le glaive des lois suspendu sur sa tête. (LACUNE)
XVII. [Supposez, je vous prie, deux hommes, dont l'un soit un modèle de vertu, d'équité, de justice, de bonne foi, l'autre le plus insigne et le plus effronté scélérat du monde; supposez que leurs concitoyens soient tellement abusés qu'ils regardent l'homme de bien comme un misérable, un criminel, un infâme; le scélérat, au contraire, comme un homme d'un honneur et d'une probité parfaite; et qu'en conséquence de ce préjugé de tout un peuple l'homme de bien soit persécuté, traqué, jeté dans les fers, qu'on lui crève les yeux, qu'il soit condamné, lié, torturé, proscrit, mourant de faim, et que tant de misères paraissent à tous les yeux un juste châtiment; que le méchant, au contraire, soit loué, honoré, chéri de tous; qu'on lui prodigue les dignités, les commandements, la puissance, toutes les grandeurs et les biens à profusion, qu'il soit enfin dans l'opinion de tous le meilleur des hommes et le plus digne de la merveilleuse fortune: où est l'insensé qui hésiterait entre ces deux destins?] Lactant. Inst., I. v, c. 12.
XVIII. Ce qui est vrai des individus est vrai des peuples; il n'est pas une nation assez aveugle pour préférer la justice dans l'esclavage à la domination au prix de l'injustice. Je n'irai pas chercher mes preuves bien loin. Pendant mon consulat, j'appelai le peuple, d'après vos propres conseils, à se prononcer sur le traité de Numance. Tout le monde savait que Q. Pompée avait conclu ce traité, et que Mancinus s'était engagé comme lui. Celui-ci, le plus intègre des hommes, appuya la proposition, que je présentai au peuple sur les ordres mêmes du sénat; l'autre se défendit très-vivement. Où était l'honneur, la probité, la bonne foi? du côté de Mancinus; l'habileté, la politique, la prudence? du côté de Pompée......(LACUNE)
XIX. Après ces considérations générales, Carnéade venait à la discussion des faits: Si un homme de bien, disait-il, a un esclave fugitif ou une maison insalubre et malsaine, que seul il connaisse le vice de l'une et la fuite de l'autre, et qu'il veuille, pour cette raison, les mettre en vente, annoncera-t-il qu'il veut vendre un esclave fugitif, une maison insalubre; ou bien le cachera-t-il à l'acheteur? S'il l'annonce, on le regardera comme un honnête homme qui a la délicatesse de ne pas tromper, mais comme un sot qui ne placera sa marchandise qu'à vil prix, si toutefois il peut s'en défaire. S'il ne l'annonce pas, il fait preuve de prudence, puisque ses intérêts doivent y gagner; mais non de probité, puisqu'il trompe. Autre exemple: Si l'on rencontre un homme qui veut vendre de l'or ou de l'argent, croyant que c'est du clinquant ou du plomb, le laissera-t-on dans son erreur pour acheter bon marché, ou l'en tirera-t-on pour payer cher? Ne serait-ce pas une sottise que de mieux aimer compromettre sa bourse? — On devait conclure de là, selon Carnéade, que l'honnête homme est un sot, et que l'homme prudent n'est pas honnête.
XX. [Il proposait ensuite des exemples plus graves, où l'on voyait que souvent il en coûterait la vie pour pratiquer la justice. C'est ainsi qu'il disait: La justice défend à l'homme de tuer son semblable, de toucher au bien d'autrui. Que fera donc le juste si, dans un naufrage, il voit un homme plus faible que lui s'emparer d'une planche de salut? Ne lui fera-t-il pas lâcher cette planche pour y monter à son tour, s'en aider pour se sauver, surtout lorsqu'il n'y a aucun témoin en pleine mer? S'il est prudent, il le fera; car autrement il doit périr. S'il aime mieux mourir que de faire violence à son semblable, il agit selon les règles de la justice, mais il est insensé de sacrifier sa vie pour épargner celle d'autrui. De même si, dans une déroute, notre juste, poursuivi par l'ennemi, rencontre un blessé fuyant à cheval, épargnera-t-il la, vie de ce blessé pour attendre une mort certaine; ou le jettera-t-il à bas du cheval pour échapper aux mains des ennemis? S'il prend ce dernier parti, il est prudent, mais coupable; s'il ne le prend pas, il agit en homme de bien, mais en insensé. — Voilà comment Carnéade, divisant la justice en deux branches, l'une civile, l'autre naturelle, les détruit l'une et l'autre, en prouvant que la première est bien la prudence, mais non la justice, et que la seconde est bien la justice, mais non la prudence. Ce sont là des arguments captieux et empoisonnés que Cicéron n'a pu réfuter. Car lorsqu'il fait répondre à Furius par Lélius, qui plaide la cause de la justice, il laisse sans solution toutes ces difficultés, qu'il semble éviter comme autant de pièges.] Lactance, Instit., liv. v, c. 16.
XXI. ...... [J'accepterais volontiers cette tâche, Lélius, si je ne croyais que nos amis désirent, et si je ne souhaitais moi-même, vous voir prendre quelque part à cet entretien. Vous nous disiez hier, rappelez-vous-le, que vous parleriez peut-être plus que nous ne voudrions. C'était promettre l'impossible; mais tenez au moins une partie de votre parole, nous vous en prions tous.] Aulu-Gelle, i, 22.Lélius...... [Que nos jeunes gens se gardent bien d'écouter Carnéade, S'il pense ce qu'il dit! c'est un homme infâme; s'il ne le pense pas, ce que j'aime mieux croire, son discours n'en est pas moins horrible.] Nonius, iv, 236, 240.
XXII. [Il est une loi véritable, la droite raison conforme à la nature, immuable, éternelle, qui appelle l'homme au bien par ses commandements, et le détourne du mal par ses menaces; mais, soit qu'elle ordonne ou qu'elle défende, elle ne s'adresse pas vainement aux gens de bien, et elle n'a pas le crédit d'ébranler les méchants. On ne peut ni l'infirmer par d'autres lois, ni déroger a quelqu'un de ses préceptes, ni l'abroger tout entière; ni le sénat ni le peuple ne peuvent nous dégager de son empire; elle n'a pas besoin d'interprète qui l'explique; il n'y en aura pas une à Rome, une autre à Athènes, une aujourd'hui, une autre dans un siècle; mais une seule et même loi éternelle et inaltérable régit à la fois tous les peuples, dans tous les temps; l'univers entier est soumis à un seul maître, à un seul roi suprême, au Dieu tout-puissant, qui a conçu, médité, sanctionné cette loi: la méconnaître, c'est se fuir soi-même, renier sa nature, et par là seul subir les plus cruels châtiments, lors même qu'on échapperait aux supplices infligés par les hommes.] Lactance, Instit., vi, 8.
XXIII. [Dans le troisième livre de la République, on soutient, si je ne me trompe, qu'une sage république ne fait jamais la guerre que par fidélité à sa parole, ou pour son salut. Ailleurs Cicéron explique ce qu'il faut entendre par salut de l'État: Ces peines dont les hommes les plus grossiers, nous dit-il, sentent l'amertume, la pauvreté, l'exil, les fers, les tortures, tout citoyen peut s'en affranchir en un instant par la mort; mais la mort, qui termine aussi les malheurs des particuliers, est elle-même le plus grand malheur pour un État. Car un État doit être constitué de façon à vivre éternellement. Les républiques ne sont donc pas destinées à périr comme les hommes, pour qui la mort est non-seulement nécessaire, mais souvent même désirable. Lorsqu'un État disparait, s'abîme, est anéanti, c'est en quelque sorte, pour comparer les petites choses aux grandes, comme si le monde entier périssait et s'écroulait.] S.Augustin, de Civ. D. xxii, 5. [Cicéron dit dans le traité de la République. On doit considérer comme injuste toute guerre entreprise sans motifs. Quelques lignes après, il ajoute: Une guerre ne peut être juste, si elle n'est annoncée et publiquement déclarée, si on ne l'a fait précéder d'une demande en réparation Isidore, Orig., xvm, 1. [C'est en défendant ses alliés que le peuple romain a conquis l'empire du monde.] Nonius, ix, 6.
XXIV. [Dans ces mêmes livres de la République, la cause de la justice contre l'injustice est soutenue avec beaucoup de force et de chaleur. En plaidant la cause opposée, et en voulant démontrer qu'il n'y a d'existence et de prospérité pour les États que par l'injustice, Philus avait proposé, comme le plus solide fondement de sa doctrine, cet argument: II est injuste que les hommes soient soumis à leurs semblables et les servent; et cependant si un État puissant, dont l'empire s'étend au loin, ne commet cette injustice, il lui sera impossible de tenir ses provinces sous sa loi. On lui répond, au nom de la justice, que la domination dont il parle est juste, parce que la sujétion est un bien pour les peuples soumis, parce que l'autorité d'un maître leur est utile lorsqu'elle s'exerce avec équité et n'est pas confiée à des mains impures et tyranniques, parce qu'enfin la soumission doit être salutaire à des nations qui périssaient dans leur triste indépendance. Pour rendre plus manifeste la vérité de ce sentiment, Lélius montrait que c'était là une loi universelle, fondée sur la nature même, et disait: Pourquoi donc Dieu commande-t-il à l'homme, l'âme au corps, la raison aux passions et à toutes les parties mauvaises de notre nature?] Saint Augustin, de Civit. Dei, xix, 2l.
XXV. [Écoutez ce que dit Tullius avec tant de raison dans son troisième livre de la République; il veut montrer que l'homme peut légitimement commander à son semblable: Ne voyons-nous pas, dit-il, que partout la nature a établi l'empire de ce qui est excellent sur ce qui est de condition inférieure, et que rien n'est plus salutaire que cet empire? Pourquoi Dieu commande-t-il à l'homme, l'âme au corps, la raison aux passions, à la colère et à toutes les mauvaises parties de notre âme? — Un peu après, Tullius ajoute: II y a différentes sortes de commandements et d'obéissances qu'il faut savoir distinguer. On dit que l'âme commande au corps, et qu'elle commande aux passions; mais elle commande au corps comme un roi à ses concitoyens, un père à ses enfants; aux passions, comme un maître à ses esclaves, parce qu'elle les réprime violemment et les dompte. Les rois, les généraux, les magistrats, les pères, les peuples gouvernent leurs concitoyens et leurs alliés comme l'âme gouverne le corps; tandis que la dure autorité des maîtres, tenant leurs esclaves sous le joug, ressemble à celle de la meilleure partie de l'âme, je veux dire la raison, bridant les parties faibles ou vicieuses de cette même âme, telles que la colère, l'amour désordonné et les autres passions.] Saint Augustin, contre Julien, iv, 12. La sujétion de l'homme qui pourrait se commander à lui-même est injuste; mais je ne trouve aucune injustice à ce que ceux qui ne savent pas se gouverner soient tenus d'obéir. Nonius, ii, 313.
XXVI. Si vous savez, dit Carnéade, qu'il y ait un serpent caché en quelque endroit où va s'asseoir, sans y prendre garde, un homme à la mort duquel vous gagneriez, vous agirez eu malhonnête homme si vous ne l'avertissez pas du danger qu'il court; toutefois c'est impunément que vous garderiez le silence, car qui pourrait vous convaincre d'avoir connu le danger? Mais nous en avons assez dit pour montrer évidemment que si l'équité, la bonne foi, la justice ne viennent pas d'une impulsion naturelle et ne sont inspirées que par l'égoïsme, il n'est pas dans le monde un seul homme de bien. C'est d'ailleurs un sujet que nous avons fait traiter longuement par Lélius dans nos livres de la République. Cicéron, de Fin. n, 18. Si, comme vous le remarquez vous-même, nous avons eu raison de dire dans ces livres que rien n'est bien que ce qui est honnête, rien n'est mal que ce qui est honteux...... Cicéron, à Att., x, 4.
XXVII. Je vois avec grand plaisir que vous regardiez l'amour d'un père pour ses enfants comme inspiré par la nature. Il faut avouer que, si cet amour n'existait pas, les hommes seraient tous étrangers les uns aux autres; et s'il n'y a plus de liens entre les hommes, que devient la société? Mes enfants, dira Carnéade Je leur souhaite bonne fortune! Carnéade, êtes-vous donc un homme? Cependant j'aime encore mieux votre langage que celui de Lucius et de Patron qui rapportent tout à eux-mêmes, et déclarent qu'ils ne remueraient pas le bout du doigt pour le service d'un autre: honnêtes gens qui se figurent qu'on est homme de bien quand on évite tous les maux, et non pas quand on fait ce qui de sa nature est droit, et qui ne veulent pas comprendre que c'est de l'homme habile qu'ils nous parlent, et non de l'homme de bien! Mais je crois avoir expliqué tout ceci dans mes livres de la République: il est vrai, mon ami, qu'en les louant vous avez doublé mon courage. Cicéron, ad Att., vii, 2. Je suis de leur avis; une justice agitée et pleine de péril n'est pas celle du sage. Priscien, viii, p. 801.
XXVIII. Cicéron fait dire aussi à Lélius, qui défend la justice: La vertu veut être honorée; c'est la seule récompense qui lui convienne, encore la reçoit-elle sans exigence, et la demande-t-elle sans avidité. — Et dans un autre endroit: Quels trésors offrirez-vous à l'homme de bien? quelles dignités? quel royaume? Tous ces biens il les regarde comme périssables, et ceux qu'il possède comme divins. Si l'ingratitude d'un peuple, les menées d'une cabale ou la puissance de quelques ennemis peut dépouiller la vertu de ses récompenses, elle trouve en elle-même mille consolations délicieuses, elle est toujours assez ornée de sa propre beauté. Lactance, Instit. v, 18, 22. Hercule que sa vaillance a rendu fameux presque à l'égal de l'Africain et élevé au rang des Dieux. Lactance, Instit., 9. Dans le troisième livre de la République, Cicéron assure qu'Hercule et Romulus ont dépouillé la nature humaine pour prendre place parmi les Dieux; non, dit-il, que leur corps ait été transporté dans les cieux; car la nature ne permet pas que ce qui sort de la terre puisse se reposer ailleurs que dans la terre elle-même. Saint Augustin, de Civil. D., xxii, 4. Les hommes de cœur ont toujours recueilli les fruits de leur courage et de leur infatigable persévérance. Nonius, ii, 434. [Etait-ce une folie à Curius que de dédaigner les largesses de Pyrrhus, et de refuser l'or des Samnites?] Nonius, ii, 488. [Caton nous disait qu'il ne manquait pas, en arrivant dans ses terres de la Sabine, d'aller visiter le foyer près duquel était assis Curius, lorsque les Samnites, naguère ses ennemis, alors ses clients, vinrent lui offrir des présents qu'il rejeta.] Nonius, ii, xii, 19.
XXIX. ...... Gracchus respecta les droits de ses concitoyens; mais il méconnut ceux des alliés et des Latins, et foula aux pieds les traités. Si ces entreprises se renouvellent, si cette licence s'étend plus loin et ruine nos droits pour y faire succéder la violence; si un jour ceux qui nous obéissent encore par affection ne sont plus contenus que par la terreur, je tremble, non pas pour nous qui à notre âge n'avons plus guère de jours à offrir à notre pays, mais pour nos fils et pour l'immortalité de notre empire, immortalité qui nous était acquise avec les institutions et les mœurs de nos ancêtres.
XXX. Quand Lélius eut achevé de parler, tous ceux qui étaient présents lui témoignèrent l'extrême plaisir que leur avait fait son discours. Mais Scipion, plus charmé encore que les autres, et comme transporté de joie, lui dit: O Lélius! vous avez défendu bien des causes avec tant d'éloquence, que je n'aurais osé vous comparer ni Servius Galba notre collègue, que vous regardiez de son vivant comme le premier de nos orateurs, ni même aucun de ces grands maîtres d'Athènes. (LACUNE) ...... [Deux choses lui avaient manqué pour parler en public, l'assurance et la voix] ...... Nonius, iv, 7l. ...... [les gémissements des malheureux renfermés dans ses flancs faisaient mugir ce taureau] Scoliaste de Juvénal, p. 215.
XXXI. ...... Peut-on reconnaître une république, c'est-à-dire, la chose du peuple, dans une cité où tous les citoyens étaient opprimés par la cruauté d'un seul, où il n'y avait plus de droits, de concours, de société, où était anéanti tout ce qui fait un peuple? Tel fut également le destin de Syracuse. Cette ville admirable, que Timée appelle la plus grande de toutes les villes grecques et la plus belle du monde, cette citadelle incomparable, ce double port qui pénètre jusqu'au sein de In cité, ces quais étendus baignés par les eaux, ces larges rues, ces portiques, ces temples, ces murailles, toutes ces merveilles rassemblées ne faisaient pas que, sous la verge de Denys, Syracuse fût une république; car aucune d'elles n'appartenait au peuple, et le peuple lui-même appartenait à un seul homme. Ainsi donc là où domine un tyran, il faut conclure, non pas comme nous disions hier, que la société est mal gouvernée, mais, comme la raison nous y contraint, qu'il n'y a plus de société.
XXXII. Lélius. C'est parfaitement dit; et je vois déjà où tend ce discours. —Scipion. Vous voyez donc que sous l'empire absolu d'une faction on ne peut pas dire non plus qu'il y ait de société. — Lélius. C'est mon sentiment. — Scipion : El il ne peut y en avoir de plus juste. Qu'était devenue la république d'Athènes, je vous le demande, lorsqu'après cette grande guerre du Péloponnèse, elle fut soumise au pouvoir odieux des trente tyrans? L'ancienne gloire de la cité, les rares beautés de la ville, le théâtre, les gymnases, les portiques, les propylées si fameux, la citadelle, les admirables œuvres de Phidias, le port magnifique du Pirée, composaient-ils une république? — Nullement, dit Lélius, puisque le peuple était asservi, et n'avait de droits sur rien. — Scipion. Et quand nos décemvirs nommés sans appel, conservèrent le pouvoir pendant cette troisième année où la liberté perdit jusqu'à son dernier privilège? — Lélius. Il n'y avait plus de république, elle peuple alors s'arma pour reconquérir ses titres.
XXXIII. Je viens maintenant à cette troisième forme de gouvernement où nous trouverons peut-être quelques difficultés. Lorsque le peuple est le maître et dispose de tout en souverain, lorsque la multitude envoie à la mort qui elle veut, lorsqu'elle poursuit, dépouille, amasse, dissipe à son gré, pourriez-vous nier, Lélius, que ce ne soit là une république, puisque tout appartient au peuple, et que la république est, selon nous, la chose du peuple? — Lélius. Il n'est pas d'État à qui je refuse plus péremptoirement le nom de république, qu'à celui où la multitude est la souveraine maîtresse. Si nous avons pu déclarer qu'il n'y avait pas de république à Syracuse, à Agrigente, à Athènes, sous la domination des tyrans, et à Rome sous celle des décemvirs, je ne vois pas comment il serait permis d'en reconnaître sous le despotisme de la multitude. D'abord, Scipion, je n'appelle peuple, suivant votre excellente définition, qu'une société dont tous les membres participent à des droits communs; mais l'empire de la foule n'est pas moins tyrannique que celui d'un seul homme; et cette tyrannie est d'autant plus cruelle qu'il n'est pas de monstre plus terrible que cette bête féroce qui prend l'apparence et le nom du peuple. Or, il ne convient pas, lorsque les lois interdisent les furieux......(LACUNE)
XXXIV. On peut appliquer à l'aristocratie ce que nous venons de dire de la royauté, et prouver qu'elle aussi peut être une véritable république et la chose du peuple. — Elle le sera à plus forte raison, dit Mummius; car un roi, par cela même qu'il commande seul, ressemble plutôt à un maître; mais rien ne peut être plus heureux que l'État gouverné par une vertueuse aristocratie. Cependant j'aime mieux la royauté que l'entière indépendance du peuple, cette troisième forme de gouvernement, la plus vicieuse de lotîtes, et dont il vous reste encore à nous entretenir.
XXXV. Scipion. Je reconnais bien là, Mummius, votre aversion pour le gouvernement populaire. Et quoiqu'on puisse le traiter avec moins de sévérité que vous ne faites d'ordinaire, je vous accorderai volontiers que des trois c'est le moins digne d'éloges. Mais ce que je ne puis vous accorder, c'est que l'aristocratie vaille mieux que la royauté. Si un État est sagement gouverné, qu'importé que cette sagesse soit dans un seul ou dans plusieurs? Mais ici les mots nous font illusion; lorsqu'on parle d'aristocratie, il semble qu'il n'y ait rien de meilleur. En effet, que peut-on imaginer de meilleur que ce qui est excellent? Lorsqu'on parle de roi, les rois injustes se présentent à la pensée comme les autres; mais en ce moment il n'est nullement question des rois in- 334 justes, puisque nous recherchons quelle est la véritable nature du gouvernement royal. Pensez un peu à Romulus, à Numa, à Tullus, et peut-être la royauté vous paraîtra-t-elle sous un jour moins sombre. — Mummius. Quelle estime faites-vous donc du gouvernement populaire? — Scipion. Dites-moi, Spurius, cette ville de Rhodes, où nous nous trouvâmes naguère ensemble, vous offrait-elle l'image d'un véritable corps politique? — Mummius. Oui, sans doute; et d'un corps politique assez bien organisé. — Scipion. Vous avez raison; mais si vous vous en souvenez, tous les citoyens y étaient tour à tour peuple et sénateurs; ils remplissaient alternativement pendant quelques mois les fonctions populaires, et pendant d'autres mois les fonctions sénatoriales; ils recevaient des deux côtés un droit de séance; les mêmes hommes jugeaient au théâtre et dans le sénat les causes capitales et toutes les autres; enfin le sénat avait absolument le même pouvoir et la même autorité que le peuple......(LACUNE)
FRAGMENTS DU LIVRE TROISIÈME DONT LA PLACE EST INCERTAINE.
I. Il y a dans tout homme un principe désordonné que le plaisir exalte, que la douleur abat. Nonius, iv, 178.
II. Soit qu'ils éprouvent leur ame, soit qu'ils délibèrent à quel parti ils se porteront. Nonius, iv, 351.
III. Les Phéniciens les premiers, avec leur commerce et leurs marchandises, ont importé dans la Grèce l'avarice, le luxe et une foule de besoins insatiables.Id., v, 35.
IV. L'Assyrien Sardanapale, ce roi débauché, dont Tullius écrit dans son troisième livre de la République: Sardanapale, plus infâme encore par ses vices que par son nom. Le Scoliaste de Juvénal, x, 362.
V. Que signifie donc cette absurde exception, à moins qu'on ne veuille faire un monument d'architecture de l'Athos tout entier? Quel Athos, quel Olympe est aussi grand? Priscien, vi, p. 710.
Passages extraits de Saint Augustin, et dans lesquels l'auteur analyse la dernière partie du 3ème livre de la République, le plus souvent avec les propres expressions de Cicéron.
I. Je m'efforcerai en son lieu de prouver, suivant les définitions mêmes de la république et du peu que que Cicéron met dans la bouche de Scipion, et en m'autorisant des sentiments exprimés en mille endroits de la République ou par l'auteur ou par les personnages de ses dialogues, que jamais Rome n'a formé une véritable société, parce que jamais elle n'a connu la vraie justice. Mais, selon des définitions plus vraisemblables, on peut accorder qu'il y eut à Rome une certaine société selon les idées romaines, et prétendre 335 qu'elle a été mieux gouvernée par les anciens Romains que par les nouveaux. De Civil. Dei, ii, 2l.
II. Voici le moment de démontrer le plus brièvement et le plus clairement possible, comme j'ai pris l'engagement de le faire au second livre de cet ouvrage, que, suivant les définitions proposées par Scipion dans la République, il n'y a jamais eu de société politique à Rome. Il définit en quelques mots la république la chose du peuple, et le peuple une société formée sous la garantie des droits et dans un but d'utilité commune. Il explique ce qu'on doit entendre par garantie du droit, en montrant qu'un gouvernement ne peut donner cette garantie à un État sans la justice. Où la vraie justice ne règne pas, il n'y a donc pas de droit. Ajoutons encore que ce qui est conforme au droit se fait justement, et ce qui se fait injustement est contraire au droit. On ne doit pas regarder comme des droits les iniques conventions des hommes; car les Romains eux-mêmes disent qu'il n'y a de droit que celui qui découle de la justice comme de sa source, et qu'il est très-faux de soutenir, avec certains esprits mal faits, que le droit, c'est tout ce qui convient au plus fort. Ainsi donc, dans un État où la vraie justice ne règne pas, il n'y a point de société établie sous la garantie du droit; par conséquent il n'y a point de peuple tel que Scipion et Cicéron le définissent; et s'il n'y a point de peuple, il n'y a point de chose du peuple; l'État devient la chose de je ne sais quelle multitude, indigne du nom de peuple. Nous voyons enfin que si la république est la chose du peuple, le peuple une société formée sous la garantie du droit, et que si le droit disparaît avec la justice, il faut en conclure nécessairement que là où la justice ne règne pas, il n'y a point de république. Quant à la justice, c'est cette vertu qui rend à chacun ce qui lui appartient. De Civit. Dei, xix, 2l.

I. [Je vais essayer, puisque j'ai parlé du corps et de l'âme, d'expliquer, autant que l'insuffisance de mon esprit le permettra, en quoi l'un et l'autre consistent. C'est une tâche que je crois d'autant plus nécessaire d'entreprendre, que Cicéron, ce grand génie, l'a abordée lui-même dans le quatrième livre de la République, et a réduit aux plus étroites proportions un sujet si vaste, dont il effleure à peine les sommités. Et qu'on ne croie pas qu'il a laissé volontairement son ouvrage imparfait; il atteste lui-même qu'il y a apporté tout le soin possible. Dans le premier livre des Lois, où la matière est encore superficiellement touchée, il dit: C'est là un sujet qui a été, ce me semble, assez complètement traité par Scipion dans les livres que vous avez lus.] Lactance, de Opif. div., i. [Et l'intelligence elle-même qui prévoit l'avenir se souvient du passé.] Nonius, ix, 8. Voici une belle pensée de Cicéron: S'il n'est pas un homme, dit-il, qui n'aimât mieux mourir que de revêtir la figure d'un animal, tout en conservant une âme humaine, quel plus grand malheur n'est-ce pas que de cacher sous la figure d'un homme l'âme d'une bête féroce? Autant l'âme l'emporte sur le corps, autant, à mon avis, ce second destin est plus cruel que le premier. Lactance, v, 11. [Cicéron dit quelque part qu'il ne croit pas que le souverain bien soit le même pour un bé- 336 lier et pour Scipion l'Africain. S. Augustin, contra Julian.,iv, 12. Elle produit par son interposition l'ombre et la nuit, et nous permet ainsi de compter les jours et de nous reposer de nos travaux. Nonius, IV, 2. En automne la nature dispose la terre à recevoir la semence, en hiver elle la laisse reposer pour que les graines puissent germer, en été elle mûrit les fruits, adoucit les uns, cuit les autres. Nonius, iv, 293. Quand ils emploient les bergers à la garde des troupeaux. Nonius, ii, 691. Cicéron, dans le quatrième livre de la République, dit que bouvier vient de bœuf (armentum, et abeo armentarius.) Priscien.
II. ...... Quelle sagesse dans cette division des citoyens par ordres, par âges, par classes; dans cet établissement des chevaliers, qui peuvent décider la majorité des suffrages; dans cette constitution du sénat! Trop de gens veulent aujourd'hui renverser follement ces utiles barrières. Que dirons-nous de ces promoteurs d'un plébiscite qui ordonnerait de rendre les chevaux à l'État? N'est-ce pas une nouvelle occasion de prodigalités qu'ils recherchent?
III. Considérez maintenant combien tout le reste est sagement disposé pour assurer aux citoyens Ce bonheur public et à l'État cette pratique des vertus civiles, double but de toute société, et qu'une république doit perpétuellement s'efforcer d'atteindre parle secours des institutions et des lois. Examinons en premier lieu l'éducation de nos fils, c'est là un point sur lequel les Grecs ont essayé bien des tentatives impuissantes, et le seul à propos duquel Polybe notre hôte accuse la négligence de nos institutions. Nos lois n'ont rien décidé à cet égard; l'éducation chez nous n'est ni publique, ni commune: nos ancêtres l'ont ainsi voulu......(LACUNE) Cicéron nous apprend que les jeunes gens qui vont à la guerre sont mis sous la garde d'un surveillant qui les dirige pendant la première année. Servius, ad Æneid., v, 540.
IV. ...... Il était interdit au jeune homme de se montrer nu en public, tant on était jaloux de sauver la pudeur et de ne pas lui porter la moindre atteinte! Chez les Grecs, au contraire, quelle inconvenance dans les exercices du gymnase! que de coupables légèretés dans ces troupes de jeunes gens! que de rapports licencieux! que de liberté dans les amours! Je passe sous silence Elis et Thèbes, où les plus incroyables débauches sont publiquement autorisées. Lacédémone, qui, à cet égard, donne toutes licences aux jeunes gens, sauf la dernière, élève un bien faible rempart entre ce qu'elle permet et ce qu'elle défend; autant vaudrait mettre un voile entre taureaux et génisses. — Lélius : Je vois,Scipion, que, dans cette censure des mœurs grecques, vous aimez mieux vous attaquer aux cités les plus célèbres qu'à votre cher Platon; vous le respectez religieusement......
V. A tel point que Cicéron dit dans sa République que c'était un opprobre pour un jeune homme de n'avoir point d'amant...... Servius, ad Æneid., x, 325. Non-seulement comme à Sparte, où les enfants apprennent à voler et dérober. Nonius, i, 72. Notre Platon va plus loin encore que Lycurgue; il veut que tout soit en commun sans exception, et qu'un citoyen ne puisse dire absolument d'aucune chose qu'elle est sienne et lui appartient. Id., iv, 346. Pour moi, de la même manière que Platon renvoie de sa ville idéale Homère couronné de fleurs et couvert de parfums...... Id., iv, 201.
VI. Le jugement du censeur n'inflige guère à celui qu'il frappe d'autre châtiment que la honte. C'est pourquoi, comme il n'en résulte qu'une tache pour le nom, on dit que c'est une ignominie. Id., i, 93. Leur sévérité inspira d'abord une sorte d'épouvanté à la république. Id. v, 7. Qu'il n'y ait point, comme chez les Grecs, d'officier préposé à la surveillance des femmes, mais que le censeur apprenne aux hommes à les gouverner. Id., ix, 7. ...... Tant cette sage et puissante discipline donne de retenue; toutes les femmes s'abstiennent de vin. Id., i, 14. Si quelque femme avait une mauvaise réputation, ses parents lui refusaient toute marque de tendresse. Id., iv, 193. Du mot petere on a formé petulantia, et de procure, c'est-à-dire poscere, procacitas. Id., i, 89.
VII. Je ne veux pas que le même peuple soit le maître et le courtier du monde. Je crois que le meilleur revenu pour les familles et pour les États, c'est l'économie. Id., 165. Il me semble que la bonne foi (fides) est ainsi nommée de ce que par elle l'on fait (quum fit) ce qu'on a dit. Id., i, 94. Dans un citoyen d'un rang élevé et de grande naissance, la flatterie, le faste, l'ambition, sont des marques d'un pauvre caractère. Id., III, 27. Voyez dans les livres de la République comment un bon citoyen doit se dévouer sans bornes à son pays; voyez quels grands éloges Cicéron y donne à la frugalité et à la tempérance, à la chasteté, à l'honnêteté, à la pureté de mœurs. Saint-Augustin, Ep. xci, 3.
VIII. J'admire non-seulement la sagesse de ces dispositions, mais l'heureux choix des termes. S'ils ont un différend, dit la loi. Un différend n'est pas une querelle d'ennemis, mais un léger nuage entre amis. La loi pense donc qu'il peut y avoir entre des voisins quelque différend, mais jamais de querelle. Nonius, v, 34. Ils ne pensaient pas que la vie de l'homme se terminât avec ses soins terrestres; de là, dans le droit des pontifes, la sainteté de la sépulture. Id., ii, 805. Les Athéniens envoyèrent au supplice leurs généraux innocents, parce qu'ils n'avaient point donné la sépulture à ceux que la violence de la tempête les avait empêchés de retirer des flots. Id., iv, 158. Dans cette lutte fameuse, je n'ai point embrassé 338 la cause du peuple, mais celle des gens de bien. Id., xii, 4. On ne résiste pas facilement à un peuple puissant, soit qu'on ne lui accorde aucun droit, soit qu'on lui en donne trop peu. Priscien, xv, 4, 20. Fassent les Dieux, pour son bonheur, que ma prédiction soit vraie! Nonius, vii, 7.
IX. C'est en vain que Cicéron s'écriait en parlant des poètes: Quand ils sont couverts d'applaudissements et excitent l'enthousiasme du peuple, que leur vanité regarde comme un si grand maître et un juge si éclairé, quelles ténèbres ils répandent sur les esprits! quelles terreurs ils font naître! que de passions ils enflamment! Saint Augustin, de Civit. Dei, ii, 14. Cicéron dit qu'alors même qu'il vivrait deux fois l'âge d'un homme, il n'aurait pas un moment pour lire les poètes lyriques. Sénèque, Ep. 49.
X. Scipion dit dans le traité de la République: Comme nos ancêtres attachaient une idée déshonorante à la profession de comédien et à la vie d'un homme de théâtre, ils voulurent que ces sortes de gens fussent privés des honneurs du citoyen romain; et plus encore, que le censeur les chassât ignominieusement de leur tribu. Saint Augustin, de Civit. Dei, ii, 13. Cicéron nous fait connaître le sentiment des anciens Romains sur le théâtre dans ses livres de la République, où Scipion s'exprime ainsi: «Jamais la comédie, si les mœurs ne l'avaient autorisée, n'aurait pu faire applaudir sur le théâtre ses infâmes licences. Les anciens Grecs affichaient au moins ouvertement leur goût dépravé; chez eux une loi permettait à la comédie de tout dire et de nommer tout le monde.»Aussi l'Africain ajoute-t-il: «Quel homme n'a-t-elle pas atteint? sur qui n'a-t-elle pas frappé? qui a-t-elle épargné? Elle s'est attaquée, me dira-t-on, à d'indignes flatteurs du peuple, à des méchants, à des citoyens séditieux; elle a déchiré un Cléon, un Cléophonte, un Hyperbolus. On ne peut lui en savoir mauvais gré; quoiqu'il eût mieux valu que de tels hommes fussent notés par un censeur que par un poëte. Mais que Périclès, un si grand capitaine, un si fameux politique, l'âme et la gloire de sa patrie depuis tant d'années, ait été outragé dans des vers et ces vers récités sur la scène, cela n'est-il pas aussi révoltant que si Publius et Cnéius Scipion eussent été publiquement calomniés par Plaute ou Névius, et Caton par Cécilius?» Et quelques lignes après: «Nos lois des douze Tables, au contraire, qui prononcent en si peu de cas la peine capitale, ont voulu que le dernier supplice fût infligé à celui qui réciterait publiquement ou composerait des vers injurieux et diffamatoires. Rien de plus sage; car notre vie doit être soumise au jugement des magistrats, à leurs sentences légitimes, et non aux fantaisies des poètes; et s'il est permis de nous attaquer, c'est à la condition que nous puissions répondre et nous défendre devant un tribunal.» J'ai pensé que je devais reproduire ici ce passage du quatrième livre de la République, en supprimant toutefois quelques détails et en donnant un autre tour à quelques idées, pour en rendre l'intelligence plus facile. Cicéron ajoute encore de nouveaux développements, et termine en montrant que les anciens Romains ne voulaient qu'aucun homme vivant fût loué ou blâmé sur la scène. Saint Augustin, de Civil. Dei, ii, 9.
XI. Cicéron dit que la comédie est l'imitation de la vie, le miroir des mœurs, l'image de la vérité. Donat, de com. et trag. Dans le même livre de la République, on rapporte que chez les Athéniens, Eschine, un de leurs orateurs, après avoir joué des tragédies pendant sa jeunesse, prit part au gouvernement de la république; et qu'un autre acteur tragique, Aristodème, fut envoyé souvent près de Philippe, pour traiter avec lui, au nom d'Athènes, les importantes questions de paix et de guerre. Saint Augustin, de Civit. Dei, ii, 10.
I. Ce ne serait pas assez de dire qu'à cette époque la société romaine était pleine de désordres et de corruption, il faut convenir qu'il n'y avait plus de société à Rome. C'est ce que prouvent les principes établis alors dans un entretien sur la république, et soutenus par les plus grands citoyens de ce temps; c'est ce dont Tullius lui-même fait l'aveu au commencement du cinquième livre de son ouvrage, parlant en son propre nom, et sans recourir au manteau de Scipion ou d'un autre. Il cite d'abord ce vers du poëte Ennius: «Ce sont les anciennes mœurs et les héros qui font la grandeur de Rome.» Ce vers, dit-il, par sa brièveté et son étonnante justesse, me semble comme un oracle des Dieux. Car nos grands hommes sans les mœurs antiques, et nos mœurs sans de tels hommes, n'auraient pu fonder et maintenir si longtemps avec tant de gloire et de justice un si prodigieux empire. Aussi, avant notre âge, voyait-on les sages traditions de nos pères former les hommes excellents, et ces grands hommes, à leur tour, consolider les anciennes mœurs et les institutions des aïeux. Notre siècle, au contraire, après avoir reçu la république comme un tableau admirable, mais à demi effacé par l'injure des temps, non-seulement a négligé de lui rendre son premier éclat, mais n'a pas même pris le soin d'en conserver les lignes qui paraissaient encore, et d'en sauver les derniers vestiges. Que reste-t-il de ces anciennes mœurs qui faisaient, suivant Ennius, la grandeur de Rome? Elles sont tellement plongées dans l'oubli, que, bien loin de les pratiquer, personne ne les connaît plus parmi nous. Que dirai-je des hommes? Mais si les mœurs ont péri, c'est que les hommes leur ont manqué. Nous assistons à une grande ruine, et ce n'est pas assez d'en montrer les causes, la patrie nous en demande compte à nous-mêmes, et nous devons répondre devant elle à cette accusation capitale. Ce sont nos fautes et non pas nos malheurs qui ont anéanti cette république dont le nom seul subsiste encore.» Voilà l'aveu qui échappe à Cicéron, longtemps, il est vrai, après la mort de l'Africain, dont il fait le principal personnage de ses dialogues sur la République. Saint Augustin, de Civil. D., ii, 2l.
II. ...... Rien de plus royal que d'expliquer la justice aux hommes, que de leur donner l'interprétation de leurs droits; aussi les particuliers venaient-ils toujours se soumettre au jugement des rois. C'est pour cette raison que l'on réservait au milieu de l'État des champs, des bois, des âturages étendus et fertiles qui composaient un domaine royal, et qui étaient cultivés aux frais de la nation, pour que les rois ne fussent distraits par aucun intérêt privé des soins qu'ils devaient à leurs peuples. Nul particulier n'était juge ni arbitre des contestations; tout se décidait par le jugement des rois. Numa surtout me paraît avoir observé cet ancien usage des rois de la Grèce; les autres, tout en s'acquittant de cette fonction royale, étaient le plus souvent occupés à combattre, et s'intéressaient d'abord au droit de la guerre. Cette longue paix de Numa fut pour Rome la mère de la justice et de la religion; ce roi fut aussi un législateur, et vous savez que ses lois existent encore. Ce génie du législateur doit distinguer surtout le grand citoyen dont nous voulons tracer ici le modèle......
III. Un bon père de famille ne doit pas être étranger à l'agriculture, à l'art de bâtir, au calcul; il faudra qu'il mette la main à l'œuvre...... Nonius, ix, 5. ...... Scipion : Trouveriez-vous mauvais qu'un fermier connût la nature des plantes et des semences? Manilius. Nullement, pourvu que son ouvrage n'en souffrit point. — Scipion. Mais pensez-vous que ce soit là l'occupation naturelle d'un fermier? — Mantlius : Il s'en faut de beaucoup; car la culture des terres pourrait fort souvent languir. — Scipion. Eh bien! de même que le fermier étudie le sol et ses propriétés, de même qu'un intendant est versé dans les lettres, et que l'un et l'autre descendent des douces spéculations de la science aux travaux effectifs de la pratique, ainsi notre grand politique connaîtra le droit et la loi écrite; il remontera aux sources de l'un et de l'autre; mais il ne s'embarrassera point dans un labyrinthe de consultations, de lectures, de mémoires, qui l'enlèveraient à l'administration de la république et l'empêcheraient d'en être en quelque sorte le fermier. Il approfondira ce droit suprême et naturel, hors duquel il n'y a plus de justice; il abordera la science du droit civil, mais comme le pilote aborde l'astronomie et le médecin la physique: chacun d'eux emprunte à la science des lumières pour son art, mais il subordonne tout à la pratique. Le politique prendra garde......
IV. Dans ces États, les citoyens recherchent l'estime et la gloire, ils fuient la honte et l'opprobre. La crainte des châtiments, les menaces de la loi ont moins d'empire sur eux que ce sentiment d'honneur gravé par la nature dans le cœur de l'homme, et qui lui fait redouter tout blâme légitime. Le grand politique cherche à fortifier ce sentiment par l'opinion publique, à le rendre parfait par le secours des institutions et des mœurs; dans l'État qu'il fonde l'honneur doit être un frein plus puissant que la crainte. Tout ce que nous disons ici se rapporte à la gloire, et c'est un sujet fort riche que nous sommes loin d'avoir épuisé.
V. Quant à la vie privée et au bonheur domestique, toutes les institutions, mariages, familles, culte des Lares et Pénates, sont réglées de telle sorte dans cette cité que chacun participe aux avantages publics et jouit de ses propres biens, et qu'il est évident que le vrai bonheur ne se rencontre que dans un État social parfaitement établi, et que rien n'est comparable à la félicité d'une république bien constituée. Je ne puis donc trop m'étonner......
VI. Je médite continuellement sur le caractère 341 du grand homme d'État dont j'ai tracé dans la République un portrait assez fidèle, selon votre témoignage. Voyez-vous bien quel doit être l'objet constant de ses pensées et de ses soins? Vous savez ce que dit Scipion dans le cinquième livre: Comme le pilote se propose d'arriver au port, le médecin de rendre la santé, le général de vaincre l'ennemi, ainsi le politique travaille sans cesse au bonheur de ses concitoyens; il aspire à fixer parmi eux la richesse, la puissance, la gloire, la vertu. C'est là le plus noble et le plus magnifique emploi du génie de l'homme, et ce doit être son ouvrage. Cicéron, ad Attic. viii, 11. Et s'il en est ainsi, à quoi bon cet éloge accordé par vos philosophes au grand politique, qui consulte, à les entendre, beaucoup plutôt les intérêts du peuple que ses caprices? Saint Augustin, Ep. 104.
VII. Tullius ne l'a point caché dans son traité de la République: en parlant du grand citoyen, il dit qu'on doit le nourrir de gloire; et dans cet esprit, il rappelle que les anciens Romains ont fait bien des. merveilles par amour de la gloire. Id., De Civ. D., v, 13. Tullius dit dans sa République que le grand citoyen doit être nourri de gloire, et que la république est florissante tant qu'il est honoré de tous. Pierre de Poitiers,Epist. ad Calum. La vertu, le travail, la vie active, donnent à l'âme du grand homme toute sa perfection; à moins qu'une humeur trop vive, un caractère bouillant et intraitable ne l'emportent...... Nonius, iv, 2. C'est cette vertu qu'on appelle la force; elle comprend la grandeur d'âme, et le mépris de la douleur et de la mort. Id., iii, 70.
VIII. Marcellus était ardent et fougueux; Fabius, retenu et réfléchi. Id., iv, 261. Celui qui a connu sa violence et ses emportements terribles... Id., iv, 55. Ce qui arrive souvent non-seulement aux individus, mais aux nations les plus puissantes...... Id.., iv, 60. ... S'étendant jusqu'aux limites du monde. Charisius, i, p. 112. ... parce qu'il pourrait communiquer à vos familles les chagrins de sa vieillesse. Nonius, i, 1170.
IX. Cicéron dans la République: Le Lacédémonien Ménélas avait une douce et séduisante éloquence. Et dans un autre endroit: Qu'il cherche la brièveté dans le discours. Sènèque dans Aulu-Gelle, xii, 2. Il ne faut pas, comme Cicéron le dit si bien, qu'une perfide éloquence puisse surprendre la religion des juges. Nous citons ici ses propres paroles: Puisqu'il n'est rien dans un État qui doive être plus à l'abri de la corruption que les suffrages et les arrêts de la justice, je ne comprends pas pourquoi l'on châtie ceux qui les corrompent à prix d'argent, et l'on tient en grande estime ceux qui les corrompent par l'éloquence. Pour moi, je trouve les derniers corrupteurs plus dangereux et plus coupables que les premiers, parce que l'argent n'a aucune prise sur un juge intègre, tandis que l'éloquence peut le séduire. Ammien, Marcellin, xxx, 4. Quand Scipion eut exprimé ce sentiment, Mummius l'approuva fort; car il poussait peut-être à l'excès l'aversion pour les rhéteurs. Nonius, xii, 13.
I. Vous voulez que je vous fasse connaître toute
la prudence de ce chef de l'État ; vous savez d'abord
que le nom même de prudence vient de prévoir
(exprovidendo)......Nonius,I, 198.
Il faut qu'un grand citoyen se tienne toujours
prêt à combattre tout ce qui pourrait mettre le
trouble dans l'Etat, iv, 164.
Quand les citoyensse divisent,et que la nation
est dechirée en plusieurs partis, il y a sédition,
I, 96.
Dans une dissension civile, lorsque les gens
de bien l'emportent sur la multitude, je crois
qu'il faut peser et non compter les voix, XII, 4.
Les passions, ces dures maîtresses de l'âme,
nous commandent et nous arrachent des fautes
sans nombre : comme elles ne peuvent jamais
être assouvies, elles entraînent à tous les crimes
ceux qu'elles ont enflammésde leurs séductions,
V, 13.
II. C'est un trait d'autant plus digne d'éloges
que les deux collègues, étant sous le coup d'une
accusation pareille, trouvaient dans le peuple un
juge différemment prévenu pour chacun d'eux ;
aussi Gracchus semblait-il faire de sa faveur une
sauvegarde à l'impopularité de Claudius. Aulu-Gelle, vi, 16. Ce représentant illustre des premiers ordres
de l'Etat prononça ces tristes et nobles paroles,
que la postérité conserve comme un monument
de son grand caractère. Nonius, IV, 455.
Que tous les jours, comme il le dit lui-même,
mille citoyens descendissent au forum,
couverts de manteaux de pourpre, IX, 16.
Vous vous souvenez comment toutes les classes
pauvres se réunirent, et de leurs deniers rassemblèrent
subitement de quoi lui faire de belles funérailles. xii, 1.
Nos ancêtres ont voulu que le lien du mariage
fût solidement établi, xi, 34.
Il reste un discours de Lélius que nous avons
tous dans les mains, et où il montre combien les
vases des pontifes et les urnes de Samos sont
agréables aux Immortels, IV, 434.

III. Voici dans quelle circonstance Scipion fut amené à raconter un songe sur lequel (c'est lui qui le déclare) il avait longtemps gardé le silence le plus absolu. Lélius exprimait le regret de ne pas voir des statues élevées publiquement à Nasica, dont le courage avait délivré Rome d'un tyran. Scipion lui répondit, après quelques autres réflexions: Quoique les hommes de bien trouvent dans la conscience de leurs belles actions la plus parfaite récompense de leur vertu ; cependant cette divine vertu aspire à des honneurs plus durables, et à un prix mieux défendu contre les injures du temps, que ces statues attachées par un plomb vil à leur base, et ces triomphes dont les lauriers se fanent si vite.
- De quel prix parlez-vous donc? demanda Lélius.
- Scipion. Permettez-moi, puisque nous avons encore du loisir pendant ce troisième jour de fête, de vous faire un récit.
IV. Lorsque j'arrivai pour la première fois en Afrique, où j'étais, comme vous le savez, tribun des soldats dans la quatrième légion, sous le consul M. Manilius, je n'eus rien de plus empressé que de me rendre près du roi Masinissa, lié à notre famille par une étroite et bien légitime amitié.
Dès qu'il me vit, le vieux roi vint m'embrasser en pleurant, puis il leva les yeux au ciel, et s'écria: "Je te rends grâce, Soleil, roi de la nature, et vous tous, Dieux immortels, de ce qu'il me soit donné, avant de quitter cette vie, de voir dans mon royaume et à mon foyer P. Cornélius Scipion, dont le nom seul ranime mes vieux ans! Jamais, je vous en atteste, le souvenir de l'excellent ami, de l'invincible héros qui a illustré le nom des Scipions ne quitte un instant mon esprit." Je m'informai ensuite de son royaume; il me parla de notre république, et la journée entière s'écoula dans un entretien sans cesse renaissant.
V. Après un repas d'une magnificence royale, nous conversâmes encore jusque fort avant dans la nuit; le vieux roi ne parlait que de Scipion l'Africain, dont il rappelait toutes les actions et même les paroles. Nous nous retirâmes enfin pour prendre du repos. Accablé par la fatigue de la route et par la longueur de cette veille, je tombai bientôt dans un sommeil plus profond que de coutume. Tout à coup une apparition s'offrit à mon esprit, tout plein encore de l'objet de nos entretiens; c'est la vertu de nos pensées et de nos discours d'amener pendant le sommeil des illusions semblables à celles dont parle Ennius. Il vit Homère en songe, sans doute parce qu'il était sans cesse pendant le jour occupé de ce grand poëte. Quoi qu'il en soit, l'Africain m'apparut sous ces traits, que je connaissais moins pour l'avoir vu lui-même que pour avoir contemplé ses images. Je le reconnus aussitôt, et je fus saisi d'un frémissement subit; mais lui: Rassure-toi, Scipion, me dit-il ; bannis la crainte, et grave ce que je vais te dire dans ta mémoire.
VI. Vois-tu cette ville qui, forcée par mes armes de se soumettre au peuple romain, renouvelle nos anciennes guerres et ne peut souffrir le repos? (Et il me montrait Carthage d'un lieu élevé, tout brillant d'étoiles et resplendissant de clarté.) Tu viens aujourd'hui l'assiéger, presque confondu dans les rangs des soldats; dans deux ans, élevé à la dignité de consul, tu la détruiras jusqu'aux derniers fondements, et tu mériteras par ta valeur ce titre d'Africain que tu as reçu de nous par héritage. Après avoir renversé Carthage, tu seras appelé aux honneurs du triomphe, créé censeur; tu visiteras, comme ambassadeur du peuple romain, l'Egypte, la Syrie, l'Asie, la Grèce; tu seras nommé, pendant ton absence, consul pour la seconde fois; tu mettras fin à une guerre des plus importantes, tu ruineras Numance. Mais après avoir monté en triomphateur au Capitole, tu trouveras la république tout agitée par les menées de mon petit-fils.
VII. Alors, Scipion, ta prudence, ton génie, ta grande âme devront éclairer et soutenir ta patrie. Mais je vois, dans ces temps, une double route s'ouvrir et le destin hésiter. Lorsque, depuis ta naissance, huit fois sept révolutions du soleil se seront accomplies, et que ces deux nombres, tous deux parfaits, mais chacun pour des raisons différentes, auront, par leur cours et leur rencontre naturelle, complété pour toi une somme fatale, la république tout entière se tournera vers toi, et invoquera le nom de Scipion; c'est sur toi que se porteront les regards du sénat, des gens de bien, des alliés, des Latins; sur toi seul reposera le salut de l'État; enfin, dictateur, tu régénéreras la république, si tu peux échapper aux mains impies de tes proches. ? A ces mots Lélius s'écria; un douloureux gémissement s'éleva de tous côtés; mais Scipion, avec un doux sourire : Je vous en prie, dit-il, ne me réveillez pas; ne troublez pas ma vision; écoutez le reste.
VIII. Mais, continua mon père, pour que tu sentes redoubler ton ardeur à défendre l'État, sache que tous ceux qui ont sauvé, secouru, agrandi leur patrie, ont dans le ciel un lieu préparé d'avance, où ils jouiront d'une félicité sans terme. Car le Dieu suprême qui gouverne l'immense univers ne trouve rien sur la terre qui soit plus agréable à ses yeux que ces réunions d'hommes assemblés sous la garantie des lois, et que l'on nomme des cités. C'est du ciel que descendent ceux qui conduisent et qui conservent les nations, c'est au ciel qu'ils retournent.
IX. Ce discours de l'Africain avait jeté la terreur en mon âme; ce que je redoutais, ce n'était pas tant la mort que la trahison des miens; j'eus cependant la force de lui demander s'il vivait encore, lui et Paul-Émile mon père, et tous ceux que nous regardions comme éteints. ? La véritable vie, me répondit-il, commence pour ceux qui s'échappent des liens du corps où ils étaient captifs; mais ce que vous appelez la vie est réellement la mort. Regarde; voici ton père qui vient vers toi. ? Je vis mon père, et je fondis en larmes; mais lui, m'embrassant et me prodiguant ses caresses, me défendait de pleurer.
X. Dès que je pus retenir mes sanglots, je lui dis: O mon père, modèle de vertu et de sainteté, puisque la vie est près de vous, comme me l'apprend l'Africain, pourquoi resterais-je plus longtemps sur la terre ? Pourquoi ne pas me hâter de venir dans votre société céleste ? Non pas ainsi, mon fils, me répondit-il. Tant que Dieu, dont tout ce que tu vois est le temple, ne t'aura point délivré de ta prison corporelle, tu ne peux avoir accès dans ces demeures. La destination des hommes est de garder ce globe que tu vois situé au milieu du temple de Dieu, et qui s'appelle la Terre; ils ont reçu une âme tirée de ces feux éternels que vous nommez les étoiles et les astres, et qui, réduits en globes et. en sphères, animés par des intelligences divines, fournissent avec une incroyable rapidité leur course circulaire. C'est pourquoi, mon fils, toi et tous les hommes religieux, vous devez retenir votre âme dans les liens du corps; aucun de vous, sans le commandement de celui qui vous l'a donnée, ne peut sortir de cette vie mortelle; en la fuyant, vous paraîtriez abandonner le poste où Dieu vous a placés. Mais plutôt, Scipion, comme ton aïeul qui nous écoute, comme moi qui t'ai donné le jour, pense à vivre avec justice et piété, pense au culte que tu dois à tes parents et à tes proches, que tu dois surtout à la patrie. Une telle vie est la route qui te conduira au ciel et dans l'assemblée de ceux qui ont vécu, et qui maintenant, délivrés du corps, habitent le lieu que tu vois.
XI. Mon père me montrait ce cercle qui brille par son éclatante blancheur au milieu de tous les feux célestes, et que vous appelez, d'une expression empruntée aux Grecs, la Voie lactée. Du haut de cet orbe lumineux, je contemplai l'univers, et je le vis tout plein de magnificence et de merveilles. Des étoiles que l'on n'aperçoit point d'ici-bas parurent à mes regards, et la grandeur des corps célestes se dévoila à mes yeux; elle dépasse tout ce que l'homme a jamais pu soupçonner. De tous ces corps, le plus petit, qui est situé aux derniers confins du ciel, et le plus près de la terre, brillait d'une lumière empruntée; les globes étoilés l'emportaient de beaucoup sur la terre en grandeur. La terre elle-même me parut si petite, que notre empire, qui n'en touche qu'un point, me fit honte.
XII. Comme je la regardais attentivement: Eh bien ! mon fils, me dit-il, ton esprit sera-t-il donc toujours attaché à la terre ? Ne vois-tu pas dans quel temple tu es venu ? Ne vois-tu pas le monde entier renfermé dans neuf cercles ou plutôt dans neuf sphères qui se touchent ? La première et la plus élevée, celle qui embrasse toutes les autres, est le ciel lui-même, le Dieu suprême, qui modère et contient tout. Au ciel sont fixées toutes les étoiles qu'il emporte éternellement dans son cours. Plus bas roulent sept globes, entraînés par un mouvement contraire à celui du ciel. A la première de ces sphères est attachée l'étoile de Saturne; au-dessous brille cet astre propice au genre humain, et que nous nommons Jupiter; puis l'on rencontre Mars à la lueur sanglante, et que la terre redoute; ensuite, vers la moyenne région, le soleil, chef, roi, modérateur des autres astres, âme du monde, régulateur des temps, et dont le globe, d'une grandeur prodigieuse, pénètre et remplit l'immensité de sa lumière.
Il est suivi des deux sphères de Vénus et de Mercure, qui semblent lui faire escorte; enfin l'orbe inférieur est celui de la lune, qui roule enflammée aux rayons du soleil. Au-dessous d'elle il n'est plus rien que de mortel et de corruptible, à l'exception des âmes données à la race des hommes par un bienfait divin. Au-dessus de la lune, tout ce que tu vois est éternel. Le neuvième globe est celui de la terre, placée au centre du monde et le plus loin du ciel; elle demeure immobile, et tous les corps graves sont entraînés vers elle par leur propre poids.
XIII. Je contemplais toutes ces merveilles, perdu dans mon admiration. Lorsque je pus me recueillir: Quelle est donc, demandai-je à mon père, quelle est cette harmonie si puissante et si douce, au milieu de laquelle il semble que nous soyons plongés ? C'est l'harmonie, me dit-il, qui, formée d'intervalles inégaux, mais combinés avec une rare proportion, résulte de l'impulsion et du mouvement des sphères, et qui, fondant les tons graves et aigus dans un commun accord, fait de toutes ces notes si variées un mélodieux concert. De si grands mouvements ne peuvent s'accomplir en silence; et la nature a voulu qu'aux deux extrémités de l'échelle d'harmonie retentit d'un côté un son grave, et de l'autre une note aiguë. Ainsi la plus élevée des sphères, celle du firmament étoilé, dont la course est la plus rapide de toutes, fait entendre un son éclatant et aigu, tandis que l'orbe inférieur de la lune murmure un son grave et sourd: pour la terre, elle demeure immobile au centre du monde, invariablement fixée dans ce profond abîme. Les huit globes intermédiaires, parmi lesquels Mercure et Vénus ont la même vitesse, produisent sept tons sur des modes différents, et ce nombre qui les règle est le nœud de presque toutes choses. Les hommes qui ont su imiter cette harmonie par les sons de la lyre et les accords de la voix se sont ouvert la route vers ces régions célestes, leur ancienne patrie, aussi bien que tous les nobles génies qui ont fait luire au milieu des ténèbres de la vie humaine quelque rayon de la lumière divine. Mais les oreilles des hommes remplies de cette harmonie, ne savent plus l'entendre, et véritablement vous n'avez pas de sens plus imparfait que celui-là, vous autres mortels. C'est ainsi qu'aux lieux où le Nil se précipite des plus hautes montagnes, près de ces cataractes, comme on les nomme, des peuplades entières assourdies par ce fracas terrible ont perdu le pouvoir d'entendre. L'éclatant concert du monde entier est si prodigieux, que vos oreilles se ferment à cette harmonie, comme vos regards s'abaissent devant les feux du soleil, dont la lumière perçante vous éblouit et vous aveugle. ? Dans le ravissement où me jetait ce langage, je reportais cependant quelquefois mes regards sur la terre.
XIV. Je le vois, dit l'Africain, tu contemples encore la demeure et le séjour des hommes. Mais si la terre te semble petite, comme elle est en effet, relève tes yeux vers ces régions célestes ; méprise toutes les choses humaines. Quelle renommée, quelle gloire digne de tes vœux, peux-tu acquérir parmi les hommes? Tu vois quelles rares et étroites contrées ils occupent sur le globe terrestre, et quelles vastes solitudes séparent ces quelques taches que forment les points habités. Les hommes, dispersés sur la terre, sont tellement isolés les uns des autres, qu'entre les divers peuples il n'est point de communication possible. Tu les vois semés sur toutes les parties de cette sphère, perdus aux distances les plus lointaines, sur les plans les plus opposés : quelle gloire espérer de ceux pour qui l'on n'est pas?
XV. Tu vois ces zones qui paraissent envelopper et ceindre la terre; les deux d'entre elles qui sont aux extrémités du globe, et qui de part et d'autre s'appuient sur les pôles du ciel, tu les vois couvertes de frimas; la plus grande de toutes, celle qui est au milieu, est brûlée par les ardeurs du soleil. Deux seulement sont habitables: la zone australe où se trouvent les peuples vos antipodes, et qui est tout entière un monde étranger au vôtre; et celle où souffle l'aquilon, et dont vous ne couvrez encore qu'une si faible partie. Toute cette région que vous habitez, semblable à une bande étendue, mais étroite, forme une petite île, baignée par cette mer que vous appelez l' Atlantique, la grande Mer, l'Océan; et, malgré tous ces grands noms, tu vois que c'est à peine un lac médiocre.
Mais au milieu même de ces terres connues et fréquentées par les hommes, dis-moi si ton nom ou celui de quelqu'un de nous a jamais pu voler au-delà du Caucase, ou franchir les flots du Gange? Aux extrémités de l'orient et du couchant, aux derniers confins du septentrion et du midi, quel homme entendra jamais prononcer le nom de Scipion ? Retranche toutes les contrées où votre gloire ne pénétrera pas, et vois dans quelles étroites limites est renfermé pour elle cet univers qu'elle croit remplir. Ceux mêmes qui parlent de vous en parleront-ils longtemps?
XVI. Quand même les races futures répéteraient à l'envi les louanges de chacun de nous, quand même notre nom se transmettrait dans tout son éclat de génération en génération, les déluges et les embrasements qui doivent changer la face de la terre à des époques immuablement déterminées, ôteraient toujours à notre gloire d'être, je ne dis pas éternelle, mais durable. Et que t'importe d'ailleurs d'être célébré dans les siècles à venir, lorsque tu ne l'as pas été dans les temps écoulés, et par ces hommes tout aussi nombreux et incomparablement meilleurs ?
XVII. Apprends enfin que, parmi ceux qui peuvent être informés de notre gloire, il n'en est pas un dont l'esprit soit capable d'embrasser les souvenirs d'une année. Les hommes mesurent vulgairement l'année par la révolution du soleil, c'est-à-dire d'un seul astre. Mais lorsque tous les astres reviendront en concours au point d'où ils étaient partis, et ramèneront après de longs intervalles la même disposition de toutes les parties du ciel, alors sera véritablement accomplie une année du monde; et j'ose à peine dire combien cette année renferme de vos siècles. Le soleil disparut jadis aux yeux des hommes et sembla s'éteindre, lorsque l'âme de Romulus pénétra dans nos temples célestes. Eh bien ! lorsque le soleil s'éclipsera de nouveau au même point du ciel et dans les mêmes conjonctures, toutes les planètes et toutes les étoiles se trouvant rappelées dans la même position, une année sera complètement résolue. Mais sache que la vingtième partie de cette année véritable n'est pas encore écoulée.
XVIII. C'est pourquoi, si tu désespères de revenir dans ce séjour, où se trouvent tous les biens des grandes âmes, poursuis cette ombre qu'on appelle la gloire humaine, et qui peut à peine durer quelques jours d'une seule année. Mais si tu veux porter tes regards en haut et les fixer sur ton séjour naturel et ton éternelle patrie, ne donne aucun empire sur toi aux discours du vulgaire; élève tes vœux au-dessus des récompenses humaines ; que la vertu te montre le chemin de la véritable gloire, et t'y attire par ses charmes. C'est aux autres à savoir ce qu'ils devront dire de toi: ils en parleront sans doute; mais la plus belle renommée est tenue captive dans ces bornes étroites où votre monde est réduit; elle n'a pas le don de l'immortalité, elle périt avec les hommes et s'éteint dans l'oubli de la postérité.
XIX. Lorsqu'il eut ainsi parlé, O Scipion, lui dis-je, s'il est vrai que tes services rendus à la patrie nous ouvrent les portes du ciel, votre fils, qui depuis son enfance a marché sur vos traces et sur celles de Paul-Émile, et n'a peut-être pas manqué à ce difficile héritage de gloire, veut aujourd'hui redoubler d'efforts, à la vue de ce prix admirable ? Courage! me dit-il, et souviens-toi que si ton corps doit périr, toi, tu n'es pas mortel; cette forme sensible, ce n'est pas toi;ce qui fait l'homme, c'est l'âme, et non cette figure que l'on peut montrer du doigt. Sache donc que tu es dieu; car c'est être dieu que d'avoir la vigueur, de sentir, de se souvenir, de prévoir, de gouverner, de régir et de mouvoir le corps qui nous est attaché, comme le Dieu suprême gouverne le monde. Semblable à ce Dieu éternel qui meut le monde, en partie corruptible, l'âme immortelle meut le corps périssable.
XX. Ce qui se meut toujours est éternel; ce qui ne communique le mouvement qu'après l'avoir reçu, dès qu'il cesse de se mouvoir, doit infailliblement cesser de vivre. L'être qui se meut lui-même est donc le seul qui ne cesse jamais de se mouvoir, puisqu'il ne s'abandonne jamais lui-même. De plus, il est pour les autres êtres la source et le principe du mouvement. Or, un principe n'a pas d'origine; car c'est du principe que tout vient, et lui-même ne peut venir de rien autre ; car s'il était produit, il ne serait pas principe; s'il n'a point d'origine, il ne doit pas avoir de fin ; car un principe détruit ne pourrait être reproduit par un autre, ni faire sortir de lui-même un autre principe; car il faut que le principe préexiste à tout ce qui est produit. Ainsi le principe du mouvement est dans l'être qui se meut lui-même; or, un tel être ne peut avoir d'origine, ni de fin; car s'il périssait jamais, le ciel s'écroulerait, la nature entière s'arrêterait, sans pouvoir retrouver une force qui lui rendît sa première impulsion.
XXI. Il est donc évident que l'être qui se meut lui-même est éternel; et maintenant comment pourrait-on nier que cette faculté de se mouvoir soi-même ne soit un attribut de l'âme ? L'être qui reçoit l'impulsion du dehors est inanimé, mais l'être animé se meut par sa vertu propre, et par un principe intérieur qui appartient essentiellement à l'âme. Si donc, parmi tous les êtres, l'âme seule porte en elle le principe de son mouvement, il est certain qu'elle n'a point eu d'origine, et qu'elle est éternelle.
Exerce-la cette âme, aux fonctions les plus excellentes. Il n'en est pas de plus élevées que de veiller au salut de la patrie. L'âme accoutumée à ce noble exercice s'envole plus facilement vers sa demeure céleste; elle y est portée d'autant plus rapidement qu'elle se sera habituée, dans la prison du corps, à prendre son élan, à contempler les objets sublimes, à s'affranchir de ses liens terrestres. Mais lorsque la mort vient à frapper ces hommes vendus aux plaisirs, qui se sont faits les esclaves infâmes de leurs passions, et, poussés aveuglément par elles, ont violé toutes les lois divines et humaines, leurs âmes, dégagées du corps, errent misérablement autour de la terre, et ne reviennent dans ce séjour qu'après une expiation de plusieurs siècles.
A ces mots il disparut, et je m'éveillai.
FRAGMENTS DONT LA PLACE EST INCERTAINE DANS L'OUVRAGE.
I. Quoique l'état le plus désirable soit de conserver perpétuellement la fortune la plus florissante, cependant un bonheur uniforme ne se fait pas aussi bien sentir que le retour à un état prospère après, de dures infortunes et les angoisses du désespoir. Ammien Marcellin, xv, 5.
II. Une cité n'est pas autre chose qu'une multitude d'hommes réunis par la concorde. Saint Augustin, de Civit. Dei, I, 15.
III. Cicéron dans ses dialogues nomme les Africains infracteurs des traités. Scoliaste d'Horace, Od., IV, 8, 17.
IV. Il est difficile,Fannius,de louer un enfant ; car ce n'est pas lui qu'il faut louer, c'est l'avenir qu'il promet. Servius, ad AEn. II, 877.
V. Cicéron dit : L'interpellation de Philus nous oblige à tout reprendre depuis le premier mot (a calce) de notre discoure. — Les anciens appelaient calcem ce que nous nommons maintenant cretam (bornes) dans le Cirque. Sénèque, Ep. 108.
VI. Il cite ensuite plusieurs vers d'Ennius,et en premier lieu les deux suivants sur Scipion l'Africain : « Scipion, à qui jamais citoyen ou ennemi ne put rendre tout le bien ou tout le mal qu'il en avait reçu. » Id., ibid.
VII. On trouve dans les livres de la République cette epigramme : « S'il est permis à un mortel de pénétrerdans la demeure des Dieux, à moi seul est ouverte la porte de l'empyrée. « Id., ibid.
FIN DE L'OUVRAGE
![]()