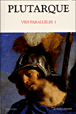 --->
Coriolan par Francesco Barbieri dit Le Guerchin, XV ème siècle, détail repris
dans un volume des œuvres de Plutarque publiées aux éditions Garnier-Flammarion.
--->
Coriolan par Francesco Barbieri dit Le Guerchin, XV ème siècle, détail repris
dans un volume des œuvres de Plutarque publiées aux éditions Garnier-Flammarion.
Coriolan
Coriolan : d'après les textes de Plutarque (traduction de Ricard, 1862) et de Tite-Live (traduction de M. Nisard, 1864), avec quelques extraits de Dion Cassius dans la traduction de E. Gros -Firmin Didot- 1845. Et, un texte de commentaire de G. Bloch de 1881.
De son vrai nom : Caius Marcius, son surnom de Coriolanus lui sera donné lors de la prise de la ville de Corioles (ville du Latium appartenant aux Volsques). Sa vie se serait déroulée au 5ème siècle avant J.C. Certains historiens pensent que son existence serait légendaire. Déjà Mommsen se posait la question : " Cette histoire est-elle vraie ? Je ne saurais l'affirmer : mais quoiqu'il en soit, au milieu même des détails naïfs où se complait la gloriole patriotique des annalistes de Rome, notre regard pénètre jusque dans le vif des plais et des hontes de ces temps. "
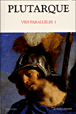 --->
Coriolan par Francesco Barbieri dit Le Guerchin, XV ème siècle, détail repris
dans un volume des œuvres de Plutarque publiées aux éditions Garnier-Flammarion.
--->
Coriolan par Francesco Barbieri dit Le Guerchin, XV ème siècle, détail repris
dans un volume des œuvres de Plutarque publiées aux éditions Garnier-Flammarion.
Son caractère était violent, il était très coléreux et opiniâtre, il ne revenait jamais sur ce qu'il avait décidé ; hautain et dur avec les autres, il était néanmoins très droit. On dit qu'il avait un goût plus prononcé que les autres Romains pour les armes. Il combattit et se fit remarquer par son courage contre Tarquin le Superbe, dernier roi de Rome, qui avait été chassé du trône et avait trouvé aide et protection chez les Etrusques. Il fut de toutes les guerres que Rome mena contre ses voisins.
Il prit très tôt le parti des nobles contre le peuple, ce dernier était la proie des usuriers et pour rembourser leurs dettes certains durent même se vendre comme esclaves pour s'acquitter de leur du, les plébéiens n'avaient plus rien à eux. Ils se révoltèrent et refusèrent de marcher contre les ennemis de la nouvelle République, Marcius qui commençait d'être très connu, demande aux magistrats d'écraser cette révolte dans l'œuf. C'est alors que les gens pauvres sortirent de la Ville et allèrent se réfugier sur le Mont Sacré. Le sénat leur envoya pour les calmer et les faire revenir un vieux sénateur : Ménérius Agrippa. Il leur raconta alors la fable qui devint fameuse par la suite de l'estomac contre le reste du corps. " Un jour, leur dit-il, tous les membres du corps humain se révoltèrent contre l'estomac ; ils se plaignaient qu'il demeurât seul oisif au milieu d'eux sans contribuer au service du corps, tandis qu'ils supportaient toute la peine et toute la fatigue pour fournir à ses appétits. L'estomac rit de leur folie, qui les empêchait de sentir que, s'il recevait seul toute la nourriture, c'était pour la renvoyer et la distribuer ensuite à chacun d'eux. Romains, ajouta-t-il, il en est de même du sénat par rapport à vous. Les affaires qu'il prépare, qu'il digère, pour ainsi dire, dans ses délibérations, afin de régler l'économie politique, vous apportent et vous distribuent à tous ce qui vous est utile et nécessaire. " Ce discours fit impression sur eux " Plutarque, Coriolan, 6. Il réconcilia le peuple avec les nobles, les plébéiens regagnèrent la Ville et recommencèrent à servir leur pays les armes à la main. Les pauvres demandèrent seulement à avoir une représentation, c'est de là que naquirent les tribuns de la plèbe. Marcius continua d'exprimer son mécontentement contre ce qu'il considérait comme une augmentation du pouvoir du peuple au détriment des patriciens.
La guerre reprit contre les Volsques. Devant leur capitale, Corioles, le commandant de l'armée romaine, le consul Cominius, partagea ses troupes en deux. Une partie devait, sous son commandement, aller affronter l'armée ennemie, l'autre partie, dont faisait partie Marcius, devait mettre le siège devant la ville. Il ranima le courage des Romains qui faiblissait devant une sortie des assiégés. " Pendant la retraite du peuple, les consuls Spurius Cassius et Postumus Cominius entrèrent en charge. Sous leur consulat, un traité fut fait avec les peuples Latins; pour le conclure, l'un d'eux resta à Rome; l'autre, envoyé contre les Volsques, bat et met en fuite les Volsques d'Antium, les chasse, les poursuit jusque dans la ville de Longula et s'empare de leurs murs. Il prend ensuite Polusca, autre ville des Volsques; puis il attaque Corioles avec une grande vigueur. Il y avait alors à l'armée un jeune patricien, Gnaeus Marcius, homme de conseil et d'action, qui depuis fut nommé Coriolan. Tandis que l'armée romaine assiégeait Corioles et portait toute son attention sur les habitants qu'elle tenait renfermés dans la ville, sans craindre aucune attaque extérieure, les légions Volsques, parties d'Antium, vinrent tout à coup fondre sur elle, et dans le même temps les ennemis firent une sortie de la place. Par hasard, Marcius était de garde. À la tête d'une troupe d'élite, il repousse l'attaque de l'ennemi sorti de ses murs, et, par la porte, qui est restée ouverte, s'élance impétueusement dans la ville. Là il fait un affreux carnage dans le quartier le plus voisin de la porte, et trouvant du feu sous sa main, il incendie les maisons qui dominent le rempart. Les cris que la frayeur arrache aussitôt aux assiégés, se mêlant aux lamentations des femmes et des enfants, augmentent le courage des Romains et jettent le trouble dans l'armée des Volsques, qui voient au pouvoir de l'ennemi la ville qu'ils étaient venus secourir. C'est ainsi que les Volsques d'Antium furent battus et que la ville de Corioles fut prise. La gloire de Marcius éclipsa tellement celle du consul… " Tite-Live, II, 33.
La ville une fois prise, il partit avec quelques autres guerriers rejoindre le consul qui était en rase campagne prêt à affronter l'armée des Volsques.
" Un certain Marcius s'était couvert de gloire en combattant contre les Volsques : le consul lui offrit pour récompense beaucoup d'argent et un grand nombre de prisonniers. Marcius refusa tout à l'exception d'une couronne et d'un cheval de guerre : quant aux prisonniers, il n'en demanda qu'un seul qui était son ami et lui rendit la liberté " Dion Cassius, I, I, XXXVI.
Elle fut vaincue et encore une fois Marcius s'illustra de belle manière. Ses nombreux combats et sa vaillance lui valurent le respect de tous. Il était très connu et voulut être élu consul, tout le monde s'accordait pour prédire sa réussite. Mais il se présenta devant les électeurs, entouré des membres du Sénat et des patriciens dès lors le peuple lui refusa ses suffrages et élit d'autres consuls.
" Coriolan brigua le consulat ; mais il ne put l'obtenir et fut vivement courroucé contre le peuple : cet échec et sa haine pour les tribuns dont la puissance était redoutable le poussaient à parler contre les plébéiens, plus hardiment que tous ceux qui pouvaient lui être comparés par leur mérite. Une violente famine survint… " Dion Cassius, I, I, XXXVII.
Coriolan rentra chez lui la rage au cœur. (Mommsen met cet épisode au crédit de la future trahison de Coriolan).
A cette époque, Rome souffrait d'une importante disette, le tyran de Syracuse, Gélon, envoya du blé pour soulager la Ville. Le peuple s'attendait à ce qu'il lui soit distribué gratuitement. Coriolan s'éleva vivement contre cette mesure que certains sénateurs soutenaient. " Cette année, alors qu'on était entièrement rassuré contre la guerre du dehors, que les dissensions intérieures étaient apaisées, un autre fléau bien plus redoutable fondit sur Rome : les terres étant demeurées incultes pendant la retraite du peuple sur le mont Sacré, les grains renchérirent et il s'ensuivit une famine, telle qu'en éprouvent des assiégés…L'année suivante, sous le consulat de Marcus Minucius et d'Aulus Sempronius, une grande quantité de blé arriva de Sicile, et on délibéra dans le sénat sur le prix auquel on le livrerait au peuple. Plusieurs sénateurs pensaient que l'occasion était venue d'abaisser le peuple et de ressaisir les droits qu'il avait arrachés aux patriciens par sa retraite et par la violence. À leur tête était Marcius Coriolan, ennemi déclaré de la puissance tribunitienne : "S'ils veulent les grains à l'ancien prix, dit-il, qu'ils rendent au sénat ses anciens droits; pourquoi vois-je ici des magistrats plébéiens ?... J'ose vous répondre que, domptés par l'excès du mal, ils iront d'eux-mêmes labourer nos terres, bien loin d'en empêcher la culture par une scission à main armée." …Le sénat trouva l'avis trop violent, et la multitude, dans sa colère, fut au moment de courir aux armes…: "On les attaquait maintenant par la famine, comme des ennemis; on leur enlevait la subsistance et la nourriture. Le blé étranger, seule ressource qu'ils devaient à une faveur inespérée de la fortune, on le leur arrachait de la bouche, s'ils ne consentaient à livrer leurs tribuns pieds et mains liés à Gnaeus Marcius, si le peuple romain ne présentait lui-même son dos aux verges du licteur. Marcius était pour eux un bourreau qui ne leur laissait le choix que de la mort ou de l'esclavage." Ils se seraient jetés sur lui à la sortie du sénat, si les tribuns ne l'eussent, fort à propos, cité à comparaître devant le peuple. " Tite-Live, II, 34.
" Coriolan, déjà plein de mépris pour le peuple, ne permit pas que le blé, transporté à Rome de plusieurs pays et en grande partie envoyé gratuitement par les rois de Sicile, fût distribué comme on le demandait. Les tribuns, dont il désirait la ruine avant tout, l'accusèrent de tyrannie auprès de la multitude et le firent condamner à l'exil, malgré les unanimes réclamations des patriciens, indignés de ce que le peuple osait rendre un pareil jugement contre leur ordre. " Dion Cassius, I, I, XXXVII.
Devant l'agitation extrême du peuple, les consuls décidèrent de vendre le blé à bas prix. Les tribuns de la plèbe demandèrent la mise en accusation de Coriolan pour avoir voulu ruiner l'autorité du peuple et fait en sorte que les seuls les patriciens aient droit à la parole. Ce dernier, au lieu de se défendre humblement répliqua avec le plus profond mépris et la plus grande hauteur à tel point qu'ils, après s'être concertés, le condamnèrent à mort. Leur sentence provoqua un risque d'affrontement, risque de voir le sang répandu entre partisans des uns et partisans des patriciens, en présence de ces risques, ils la reportèrent, un nouveau jugement devant les comices tributes fut décidé, il en résulta une peine de bannissement perpétuel. Face à cette condamnation, Coriolan resta de marbre, hautain et impassible. Après avoir fait ses adieux à sa femme et à sa mère, il quitta la ville accompagnée par des patriciens de ses amis. Il passa quelques temps dans des terres qu'il possédait près de Rome et il partit chez les Volsques. Il alla trouver un grand ennemi des Romains à Antium : Tullus Amphidius. Tous deux cogitèrent pour créer des causes à une nouvelle guerre entre leurs deux peuples. Le prétexte en fut l'obligation pour tous les Volsques de sortir de Rome, ils étaient venus spécialement pour la célébration des Grands Jeux. Poussés par Tullus et Coriolan, ils se décidèrent à faire la guerre malgré une trêve qui avait été proclamé pour deux ans. Elle fut mené conjointement par Tullus Et Coriolan qui, pour ce dernier, avait gagné toute la confiance des Volsques. Il fit épargner les terres des patriciens dans le but d'accroître la dissension entre les plébéiens et ces derniers. Ayant décidé d'un commun accord que Marcius envahirait les terre ce de Rome pendant que Tullus garderait des troupes pour protéger le territoire volsque, Coriolan marcha contre la cité de Circé, colonie romaine, puis il alla attaquer les latins pensant que Rome viendrait au secours de ses alliés, ce qu'elle ne fit pas. Il mit le siège devant Lavinium, la ville fondée par Enée, et dont étaient issus les Romains puis il marcha sur Rome. Cette dernière lui envoya une députation, constituée de ses amis et de ses proches pour lui demander d'épargner la Ville. Leur ayant dicté des conditions draconiennes à satisfaire dans les trente jours, il s'éloigna. Passé ce délai, il revint devant Rome. Le sénat lui envoya une seconde ambassade pour lui demander de guider les Volsques hors des frontières romaines. Il refusa tout comme les Romains refusaient d'accéder à ses demandes qui favorisaient trop un peuple ennemi. Devant une telle obstination, Rome envoya une troisième députation composée de prêtres revêtus de leurs habits sacerdotaux, elle se heurta aux mêmes réponses. La Ville terrorisée s'apprêta à se défendre. C'est à ce moment que les femmes romaines, agissant de leur propre chef, sous la conduite d'une certaine Valérie, sœur de Publicola à qui les Romains devaient beaucoup, allèrent trouver la mère et la femme de Coriolan pour leur demander leur intercession. Ces dernières, accompagnées d'autres femmes, se rendirent immédiatement au camp des Volsques où Coriolan fut vaincue par la tendresse et l'émotion.
" Alors, les dames romaines se rendent en foule auprès de Véturie, mère de Coriolan, et de Volumnie sa femme. Cette démarche fut-elle le résultat d'une délibération publique, ou l'effet d'une crainte naturelle à ce sexe ? Je ne saurais le décider. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles obtinrent que Véturie, malgré son grand âge, et Volumnie, portant dans ses bras deux fils qu'elle avait eus de Marcius, viendraient avec elles dans le camp des ennemis, et que, femmes, elles défendissent, par les larmes et les prières, cette ville que les hommes ne pouvaient défendre par les armes. Dès qu'elles furent arrivées devant le camp, et qu'on eut annoncé à Coriolan qu'une troupe nombreuse de femmes se présente; lui que, ni la majesté de la république, dans la personne de ses ambassadeurs, ni l'appareil touchant et sacré de la religion, dans la personne de ses prêtres, n'avait pu émouvoir, se promettait d'être plus insensible encore à des larmes féminines. Mais, quelqu'un de sa suite ayant reconnu, dans la foule, Véturie, remarquable par l'excès de sa douleur, debout au milieu de sa bru et de ses petits-enfants, vint lui dire : "Si mes yeux ne me trompent, ta mère, ta femme et tes enfants sont ici." Coriolan, éperdu et comme hors de lui-même, s'élance de son siège, et court au-devant de sa mère pour l'embrasser; mais elle, passant tout à coup des prières à l'indignation : "Arrête, lui dit-elle, avant de recevoir tes embrassements, que je sache si je viens auprès d'un ennemi ou d'un fils; et si dans ton camp je suis ta captive ou ta mère ? N'ai-je donc tant vécu, ne suis-je parvenue à cette déplorable vieillesse, que pour te voir exilé, puis armé contre ta patrie ? As-tu bien pu ravager cette terre qui t'a donné le jour, et qui t'a nourri ? Malgré ton ressentiment et tes menaces, ton courroux, en franchissant nos frontières, ne s'est pas apaisé à la vue de Rome; tu ne t'es pas dit : derrière ces murailles sont ma maison, mes pénates, ma mère, ma femme et mes enfants ? Ainsi donc, si je n'avais point été mère, Rome ne serait point assiégée; si je n'avais point de fils, je mourrais libre dans une patrie libre. Pour moi, désormais, je n'ai plus rien à craindre qui ne soit plus honteux pour toi, que malheureux pour ta mère, et quelque malheureuse que je sois, je ne le serai pas longtemps. Mais, ces enfants, songe à eux : si tu persistes, une mort prématurée les attend ou une longue servitude." À ces mots, l'épouse et les enfants de Coriolan l'embrassent; les larmes que versent toutes ces femmes, leurs gémissements sur leur sort et sur celui de la patrie, brisent enfin ce cœur inflexible; après avoir serré sa famille dans ses bras, il la congédie, et va camper à une plus grande distance de Rome; ensuite, il fit sortir les légions du territoire romain, et périt, dit-on, victime de la haine qu'il venait d'encourir. " Tite-Live, II, 40.
Version de Dion Cassius : " Les femmes, je veux dire Volumnie, épouse de Coriolan, Véturie sa mère et les dames romaines les plus illustres se rendirent dans son camp avec ses propres enfants ; mais loin de l'amener à transiger au sujet du pays conquis sur les Volsques, elles ne purent même le faire consentir à son retour. A peine instruit de leur arrivée, il les admit en sa présence et leur permit de parler. Voici comment l'entrevue se passa : toutes les femmes gardaient le silence et tombaient en larmes. Véturie s'écria : "Que signifient, mon fils, ton étonnement et ta surprise ? Nous ne sommes pas venues en transfuges : c'est la patrie qui nous envoie : nous serons toujours ta mère, ta femme, tes enfants, si tu te laisses fléchir ; sinon, nous ne serons plus que ton butin. Si ta colère tient ferme encore, massacre-nous dans les premières. Pourquoi détourner ton front à ces paroles ? Ignores-tu que naguère livrées, dans Rome, à la douleur et aux larmes, nous les avons interrompues pour venir te voir ? Réconcilie-toi avec nous, et ne poursuis plus de ta haine tes concitoyens, tes amis, nos temples, nos tombeaux. Ne marche plus contre ta patrie avec un coeur ennemi ; ne va pas assiéger une ville où tu es né, où tu as été élevé, où tu as reçu le glorieux surnom de Coriolan. Cède à mes paroles, mon fils : ne me congédie point sans avoir exaucé ma prière ; si tu ne veux me voir tomber à tes pieds.
Ainsi parla Véturie, et des larmes coulent de ses yeux. Elle déchire ensuite ses vêtements, découvre son sein et portant ses mains sur son flanc : "Voilà, s'écrie-t-elle, mon fils, le flanc qui t'a mis au jour et le sein qui t'a nourri." A ces mots, la femme de Coriolan, ses enfants, toutes les dames romaines pleurent ensemble. Il partage leur douleur : à peine peut-il résister encore, et, prenant sa mère dans ses bras et la couvrant de baisers : "Oui, ma mère, dit-il, je t'obéis : tu triomphes de ton fils ; c'est toi que les Romains devront remercier. Pour moi, je ne saurai supporter les regards de ceux qui ont payé de l'exil les plus grands services ; jamais je ne rentrerai dans Rome. Que la patrie te tienne lieu de fils ; tu l'as voulu : moi, je vivrai loin de vous." En prononçant ces mots, il se leva ; soit qu'il craignît la foule qui l'entourait, soit qu'il eût honte d'avoir pris les armes contre ses concitoyens. Il refusa de retourner dans sa patrie. " I, I, XXXIX.
Il évacua les abords de Rome et ramena les Volsques chez eux ce qui ne se fit pas sans murmures de leur part. Les Romains furent ivres de joie et remercièrent les femmes qui s'étaient ainsi entremises, ils firent construire, en souvenir de cet événement un temple dédié à La Fortune Féminine. " Pour perpétuer le souvenir de cet événement, un temple fut élevé, et on le consacra à la fortune des femmes. Ensuite les Volsques, secondés par les Èques, reparurent sur le territoire romain; mais les Èques ne voulurent pas obéir plus longtemps à Attius Tullius. " Tite-Live, II, 40. Les Volsques, divisés entre ceux qui donnaient raison à Coriolan et les autres, menés par Tullus qui parlaient hautement de trahison, l'assassinèrent.
" …et périt, dit-on, victime de la haine qu'il venait d'encourir. D'autres historiens rapportent sa mort d'une manière différente. Je lis dans Fabius, le plus ancien de tous, qu'il vécut jusqu'à un âge avancé… " Tite-Live, II, 40.
Version de Dion Cassius : " Il refusa de retourner dans sa patrie ; comme on lui proposait, et se retira dans le pays des Vosques où il finit ses jours, victime d'un piège ou accablé par les ans. " I, I, XL.
Les Romains, une fois apprise la nouvelle, restèrent impassibles, seules les femmes portèrent le deuil.
Il est toutefois à noter que ces réçits ne sont aux yeux de quelqu'un comme Mommsen qu'un roman forgé de toutes pièces et que son historicité est fortement mise en doute par la grande majeure partie des historiens.
QUELQUES MOTS sur LA LEGENDE DE CORIOLAN.
Par G. Bloch
Mélanges de l'école française de Rome, Année 1881, Volume 1, Numéro 1 venant du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Direction de l'enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation
 --- Le Guerchin, 1646.
--- Le Guerchin, 1646.
L'histoire des premiers siècles de Rome n'offre pas d'épisode plus intéressant que celui de Coriolan. Elle n'en offre pas non plus qui ait plus justement éveillé les défiances de la critique. Après avoir contesté tel ou tel point de détail, elle en est arrivée à rejeter le récit d'un bout à l'autre comme entièrement apocryphe. C'est la conclusion de M. Mommsen dans son article de l' Hermes (1), reproduit au tome II des Romische Forschungen (2) . E lle vaut la peine, comme tout ce qu'écrit un tel maître, d'être examinée de près (3).
Le récit de Tite-Live, de Denys, de Plutarque, n'est aux yeux de M. Mommsen qu'un roman, forgé vers la première moitié du cinquième siècle de Rome au plus tôt. Le surnom de Coriolan en est la preuve. C'est à cette date en effet que s'introduisit l'usage de donner aux généraux de ces surnoms rappelant le souvenir de leurs victoires. A la même époque, l'histoire était encore la propriété exclusive du collège pontifical; mais ce collège venait de s'ouvrir à la plèbe, et parmi les quatre premiers pontifes plébéiens créés en 454 U. C. 300 avant J.C., on trouve un Marcius, C. Marcius Rutilus. On voit par là comment ce récit, tiré des archives domestiques des Marcii plébéiens, a pu prendre place d'assez bonne heure dans l'histoire officielle.
(1) Die Erzählung von Cn. Marcius Coriolanu .Hermes, b d. 4 (1870), p. l-26.
(2) P. 113-152.
(3) Voir un mémoire de M. Bonghi, résumé dans le t. 3 des Transunti de l'Académie royale des Lincei, juin 1879, pages 253-4..
L'écho des grandes luttes d'où était sortie la Rome nouvelle retentissait encore dans toutes les mémoires, et déjà à l'orgueil du triomphe s'ajoutait chez les nobles plébéiens une faiblesse tous les jours plus commune: ils étaient fiers d'avoir vaincu le patriciat, et pourtant ce même patriciat, ils voulaient en être sortis, ils ne reculaient devant aucun mensonge pour imposer cette prétention aux contemporains et à la postérité. Ce sentiment complexe et même contradictoire s'accuse dans la table de Coriolan. Les Marcii y sont glorifiés dans leur prétendue origine patricienne ; mais ce qui domine, c'est la glorification de la plèbe. La plèbe est le vrai héros du drame. La revendication de ses droits et l'humiliation du patriciat dans la personne d'un de ses plus illustres représentants, tout est là. Le procès de Coriolan n'a pas été imaginé pour autre chose. Ce n'est qu'une de ces anecdotes que les Romains plaçaient volontiers à l'origine de leurs coutumes
publiques et privées de manière à en mieux prouver la légitimité. C'est ainsi que le procès d'Horace, absous grâce à l'intervention populaire, est le fondement du droit de provocatio. De même le procès de Coriolan établit la compétence criminelle des comices tribute.
Si nous faisons abstraction des hypothèses qui échappent en quelque sorte à la discussion, il y a dans cette théorie deux points qui appellent la critique. D'abord ce qui est relatif au procès de Coriolan. On peut se demander en premier lieu si l'assimilation entre ce procès et celui d'Horace est fondée. Outre que le procès d'Horace appartient à la période mythique, le droit de provocatio dont il passe pour avoir été la première application, est resté depuis le commencement de la république une des pierres angulaires de la constitution romaine. Nous admettrons donc, si l'on veut, que ce peuple, respectueux de la tradition au point de se reconnaître comme légitime ce qui est consacré par elle, a désiré mettre sous ce couvert un principe si essentiel, et que le procès d'Horace n'a pas d'autre raison d'être. Mais il n'en est pas de même de la juridiction criminelle des comices tributes, laquelle disparut après la législation décemvirale (1). Dès lors pourquoi s'efforcer de
justifier par un précédent un droit depuis si longtemps oublié? Encore s'il avait été jamais question de le restaurer. Mais on ne voit pas que la démocratie, si favorable pourtant aux empiétements des comices tributes sur les centuriates, y ait pensé. Ses efforts pour restreindre l'arbitraire du magistrat prirent une autre direction. Elle se préoccupa plutôt de développer et d'assurer la juridiction des comices centuriates, ainsi qu'en témoignent toutes ces lois de provocatione dont la série se poursuit depuis Valerius Publicola jusqu'à C. Gracchus. Cette indifférence pour un droit qui avait été d'abord le palladium des libertés plébéienne se conçoit. La juridiction criminelle des comices tributes répondait à une situation tout, à fait particulière et qui ne tarda pas à se modifier. Elle ne ressemblait en rien à celle des comices
centuriates. Elle procédait d'un principe tout, différent. Ce n'était pas la souveraineté populaire se substituant à son délégué afin de prévenir les excès du pouvoir. C'était la vengeance de la plèbe atteignant le patricien coupable d'avoir rompu le traité conclu entre la Rome patricienne et la Rome plébéienne. Cette juridiction dut tomber aussitôt que l'état de guerre dont elle était issue tendit, à se transformer et qu'un premier rapprochement s'opéra entre les deux peuples.
M. Mommsen compte deux procès qui nous montrent cette juridiction en exercice: celui de Coriolan en 263 U.C. -491 et celui de Caeso Quinctius en 293 U.C. - 461.
(1) Willems. Droit public, p. 177, 4° édit.
Mais n'y a-t-il pas eu dans l'intervalle d'autres procès du même, genre, moins retentissants, il est vrai, ceux de T. Menenius, de Sp. Servilius, de C. Manlius et L. Furius, et d'App. Claudius ? Quoiqu'il en soit, M. Mommsen admet la réalité du procès de Quinctius. Dans ce cas, il semble qu'il devenait inutile de supposer celui de Coriolan, et que le premier suffisait pour fonder sur un fait la compétence criminelle des comices tributes.
Denys donne ce détail à propos du verdict rendu contre Coriolan : « Vingt et une tribus furent appelées à voter. Marcius en eut neuf en sa faveur, de sorte que, s'il en avait eu deux de plus, il était acquitté, grâce au partage égal des voix, ainsi que la loi le voulait. »
Ce texte est inintelligible. Neuf plus deux font onze qui sont, la moitié de vingt-deux, non de vingt et un, nombre qui, du reste, n'est pas divisible par deux. M. Mommsen fait à ce sujet le raisonnement suivant. La légende voulait que Coriolan eût été jugé par vingt tribus et condamné par la majorité la plus petite possible, c'est-à-dire par onze voix contre neuf. Cependant la légende était contredite par la chronique, qui disait qu'à partir de 259 U.C.-495, il y avait eu, non pas vingt tribus, mais vingt et une. Qu'a fait Denys ? Le nombre total des tribus étant ainsi renforcé d'une unité, il a cru qu'il n'avait, pour concilier les données de la légende et celles de la chronique, qu'à renforcer aussi d'une unité le nombre de voix nécessaires pour l'acquittement, et par là il est tombé dans une inextricable confusion. N'est-ce pas là cependant attribuer à Denys une faute de calcul bien grossière, ou une tentative non moins grossière pour donner le change à ses lecteurs ? Ne vaudrait-il pas mieux tout expliquer par une altération du texte, comme au reste M. Mommsen lui-même l'a tenté autrefois? Dans son mémoire sur les Tribus romaines, il propose de lire vingt tribus. Cette correction supprime toute contradiction dans l'auteur grec. En effet, il fait dire plus loin à Coriolan qu'il a été condamné à une majorité de deux voix . O n sait d'autre part qu'il s'est trouvé neuf voix pour l'absoudre 9+2 = 11, ce qui, ajouté aux neuf voix favorables, donne un total de vingt. Cette correction est-elle admissible au point de vue historique ? M. Mommsen s'attache à prouver que le nombre des tribus était bien de vingt au temps de Coriolan. Son argumentation, indépendamment de la raison qu'il tire du texte même de Denys, se ramène à deux points: 1" l'étude des manuscrits démontre que le texte de Tite-Live, II. 21 : R omae tribus una et viginti factae doit se lire : Romae tribus factae ces mots una et viginti étant interpolés; 2" la tribu Crustumina, avec son nom géographique, ne peut pas être contemporaine des seize tribus rustiques créées en 259 U.C. -495.et portant chacune le nom d'une gens patricienne. La création de cette dix-septième tribu marque une période nouvelle dans l'extension du territoire de Rome. Telle est la théorie exposée; par M. Mommsen dans son mémoire sur les Tribus. S'il l'a abandonnée depuis, c'est sans doute à bon escient. Laissons de côté la question des manuscrits, qui échappe à notre compétence. Il suffit de remarquer qu'elle a été tranchée dans un sens différent par les éditions qui font autorité (Madvig, Weissenborn). Mais, en ce qui concerne la tribu Crustumina, on ne peut oublier que la prise de la ville de Crustumeria est placée par Tite-Live en 255 U.C. -499. Par conséquent la tribu dont cette ville était le centre devait exister en 255 U.C. -499. II est permis sans doute de contester cette date : on sait que la chronologie militaire de cette époque est aussi confuse que problématique; mais il n'en est pas tout-à-fait de même des dates données pour l'institution des différentes tribus. Les faits auxquels elles se rapportent ne sont pas de ceux que négligeaient les vieilles annales ou que l'imagination pouvait se plaire à dénaturer. Or, de 259 U.C.- 495 à 367 U.C.- 387, on ne créa point de tribu nouvelle. Cette dernière année seulement, on en créa quatre qui, ajoutées aux anciennes (1) portèrent le nombre total à vingt-cinq. Il y avait donc en 259 U.C. – 495 vingt et une tribus, dont la Crustumina , à moins que cette, dernière n'ait été formée entre 259 U.C. -495 et 367 U.C. -337 et que Tite-Live ait négligé de le dire ou l'ait ignoré. Mais négligence et ignorance. les deux sont également invraisemblables. La correction proposée d'abord par M. Mommsen ne parait donc pas en effet devoir être reprise.
Il en est une autre à laquelle on ne parait pas avoir pensé. Plutarque fait condamner Coriolan à une majorité de trois voix, c'est-à-dire, en admettant ce nombre de vingt et une tribus, par douze contre neuf. Quand il donnait ce chiffre, il avait sous les yeux la phrase de Denys car il suit cet auteur de point en point si bien qu'il ne semble pas avoir puisé à une autre source. L'alternative est donc ouverte entre ces deux hypothèses: on bien Plutarque a corrigé Denys de la manière la plus simple, en substituant, ou bien il l'a copié textuellement, et le texte de Denys, altéré plus tard par la négligence d'un copiste portait autre chose. La deuxième hypothèse est peu vraisemblable, car, ainsi qu'on l'a déjà fait observer, le nombre deux est répété ailleurs (2), et il serait par trop singulier que deux fois la même faute de copie se fût
reproduite à propos du même chiffre. Il est plus probable que Denys a commis la première fois une inadvertance, où sa mémoire trop fidèle l'a fait retomber une seconde fois.
(I) Tite-Live, VI 5.
(2) Denys VIII, 5.
C'est cette inadvertance que Plutarque a corrigée, devinant sans effort et restituant de la manière la plus naturelle la véritable pensée de son auteur. De toute façon il y a là, par la faute de Denys ou d'un autre, un lapsus, seule cause de toutes les obscurités de ce texte sur lequel on a tant discuté.
Une de ces obscurités tient à un défaut de précision dans la langue de l'historien. Il dit que, si aux tribus favorables il s'en était ajouté deux, on serait arrivé à un
partage égal des voix qui aurait eu pour conséquence l'acquittement. Mettez trois tribus au lieu de deux, conformément à la leçon suggérée par Plutarque, ce partage égal n'en est pas moins impossible avec vingt et une tribus. Supposez, vingt tribus, en maintenant pour le reste le texte de Denys, vous vous heurtez à une autre
difficulté ; car les deux voix ajoutées aux neuf favorables doivent être retranchées des onze contraires. Les termes sont intervertis. Coriolan, condamné naguères par onze voix, et acquitté par neuf, est maintenant condamné par neuf et acquitté par onze; mais, pas plus dans un cas que dans l'autre, les voix ne sont partagées. Ainsi, à moins de prêter à Denys une absurdité flagrante, il faudra toujours interpréter sa phrase dans un sens différent de celui qui se présente au premier abord. Sur ce point, nous n'avons qu'à emprunter à M. Mommsen l'explication qu'il a proposée déjà dans son mémoire sur les Tribus. Il s'agit de bien entendre le mot « poa/jAOov ». Il signifie qu'on ajoute aux voix favorables un certain nombre de voix prises, non point parmi les opposantes, mais en dehors, en sus. Neuf tribus se prononcent pour l'acquittement, douze pour la condamnation. Différence trois. Imaginez donc trois tribus supplémentaires, et faites-les passer du côté des neuf tribus favorables: vous aurez un nombre de voix pour l'acquittement égal à celui des voix qui ont condamné. Il n'y a pas autre chose au fond du raisonnement de Denys, raisonnement obscur dans la forme, oiseux dans le fond, bizarre de toute manière, et dont on peut dire, après qu'on s'est évertué à le comprendre, qu'il ne vaut pas la peine qu'il a coûté.
Si nous comprenons bien la théorie de M.Mommsen, il y a contradiction entre la légende et la chronique, et entre la chronique et l'histoire vraie. La légende ajoute au drame toutes les circonstances qui peuvent le rendre plus poignant. Coriolan a failli être absous grâce au partage égal des voix. Il s'en est fallu d'une seulement qu'il ne l'ait été. Or, ceci n'a pu arriver que s'il a été jugé par vingt tribus.
D'autre part la chronique veut qu'il y ait eu vingt et une tribus en 259 U.C. -495, date présumée du procès. C'est la chronique qui a tort, et la légende qui a raison. Le nombre des tribus à cette date était bien de vingt. Mais alors plus de procès : vingt tribus n'ont pu former les comices tributes. Les Romains voulaient un nombre impair, afin d'éviter précisément ce partage égal des voix dont la légende fait une dernière chance de salut pour l'accusé. Les comices tributes sont donc d'institution postérieure. Ils ont été établis par Publilius Volero (288 U.C. - 471), dont il est dit qu'il fit voter les plébéiens par tribus et non plus par curies, comme c'était l'usage auparavant. La même mesure coïncide avec la création de la vingt et unième tribu.
Cette double contradiction existe-t-elle en effet? Et, si elle existe, dans quelle mesure l'authenticité de la traduction en est-elle infirmée ? Il faut se reporter à ce qui précède. La contradiction entre les données de la légende et celles de la chronique résulte pour M. Mommsen du calcul qu'il prête à Denys afin de la résoudre. Mais si ce calcul n'a, jamais été dans la pensée de notre auteur, l'hypothèse pèche par la base. La légende n'affirme rien sur le nombre des tribus, car ce partage égal des voix, qui ne peut être réalisé qu'avec le nombre vingt, ce n'est pas elle qui en suppose la possibilité, c'est Denys, par le raisonnement dont M. Mommsen lui-même a donné la clé. La légende ne dit qu'une chose, c'est que Coriolan a été condamné par la plus faible majorité.
D'ailleurs, quand tous les détails du procès seraient de pure fantaisie, s'ensuivrait-il que le procès n'ait pas eu lieu ? La distinction entre la chronique et l'histoire vraie ne parait pas moins contestable.
La chronique donne pour (259 U.C. - 495) le nombre de vingt et une tribus. On l'a vu, s'il y a un point .sur lequel elle mérite d'être crue, c'est celui-là. Qu'oppose-t-on à son témoignage? Une interprétation du plébiscite de Volero qui n'est pas conforme aux textes, car pour Tite-Live (1) comme pour Denys (2) ce plébiscite n'a en d'autre objet que de transférer l'élection des tribuns des comices curiates aux comices tributes. Et pourquoi cette conjecture ? Parce que, les tribus n'étant que vingt en 259 U.C. -495, il faut trouver pour la création des comices tributes une date moins ancienne. Mais c'est ce qu'il faudrait démontrer. Et quand on aurait démontré qu'il n'y avait pas plus de vingt tribus avant en suppose la possibilité, c'est Denys, par le raisonnement dont M. Mommsen lui-même a donné la clé. La légende ne dit qu'une chose, c'est que Coriolan a été condamné par la plus faible majorité.
D'ailleurs, quand tous les détails du procès seraient de pure fantaisie, s'ensuivrait-il que le procès n'ait pas eu lieu ? La distinction entre la chronique et l'histoire vraie ne parait pas moins contestable.
La chronique donne pour (259 U.C. -495) le nombre de vingt et une tribus. On l'a vu, s'il y a un point sur lequel elle mérite d'être crue, c'est celui-là. Qu'oppose-t-on à son témoignage? Une interprétation du plébiscite de Volero qui n'est pas conforme aux textes, car pour Tite-Live (1) comme pour Denys (2) ce plébiscite n'a en d'autre objet que de transférer l'élection des tribuns des comices curiates aux comices tributes. Et pourquoi cette conjecture ? Parce que, les tribus n'étant que vingt en 259 U.C. -495, il faut trouver pour la création des comices tributes une date moins ancienne. Mais c'est ce qu'il faudrait démontrer. Et quand on aurait démontré qu'il n'y avait pas plus de vingt tribus avant 283 U.C. —471, on n'aurait rien fait. Il faudrait encore fournir la preuve de cette assertion que les tribus ne pouvaient être constituées en comices à moins d'être en nombre impair. A ce compte, les trente curies n'auraient donc jamais pu former les comices curiates.
Admettons pourtant que les comices tributes n'ont pas existé avant cette date (v. 2H3). Quand cela serait, qu'en conclure, sinon que les annalistes ont place le procès de Coriolan quelques années trop tôt? Une telle conclusion devrait paraître assez indifférente pour qui a reconnu très justement que la marque propre de cette histoire est d'être placée en dehors de toute chronologie.
(1) II, 56 . 58.
(2) IX, 49.
Après l'objection tirée des circonstances du procès, vient celle qui est fournie par le surnom de Coriolan. Il y a là, dit-on, un anachronisme. Il est vrai; mais l'anachronisme n'est pas dans le surnom lui-même: rien n'est plus commun dans la noblesse patricienne que ces surnoms tirés des noms de lieux (I). Il est exclusivement dans l'interprétation qui en a été donnée. Ainsi nous ne sommes pas autorisés à dire que Marcius n'a pas existé ou ne s'est pas appelé Coriolan , mais seulement qu'il ne s'est pas appelé Coriolan pour s'être emparé de la ville de Corioli. Il y a longtemps qu'on a fait justice de cet épisode (2), dont l'idée a été suggérée précisément par ce surnom, entendu comme il pouvait l'être au cinquième siècle. Le mystérieux artisan de la légende a travaillé sur un mot. De ce mot il a tiré tout le prologue du drame ; mais le drame est indépendant du prologue et peut subsister sans lui (3).
Il subsiste en effet: seulement la réalité est plus humble que la fiction. Il faut en revenir aux conclusions de Niebuhr et de Schwegler (4). Sous leur timidité apparente, elles témoignent d'un sens historique profond. L'aventure de Coriolan n'a été qu'un incident d'importance médiocre, dont l'imagination populaire s'est emparée, sans qu'on puisse dire pourquoi, qu'elle a transformé et agrandi petit à petit, où elle a résumé enfin, dans un tableau digne d'inspirer Shakespeare, les souvenirs de la Rome d'autrefois, de ses mœurs violentes et austères. Croire que ce beau récit a été forgé de toutes pièces par la vanité nobiliaire d'une famille, c'est en vérité faire à cette famille un bien grand honneur. Ne sait-on pas aussi dans quelles conditions se forment les légendes?
(1) V. Willems, Sénat de la République. rom. t. 1, p. 11 etc.
(2) V.Schwegler, Röm. Gesch.II, p. 363 etc.
(3) Une des raisons alléguées par M. Mommsen (Röm Forsch. I, p. 101) contre la réalité du personnage de Coriolan, c'est qu'on ne connaît point d'autres Marcii plébéiens. M. Willems y a répondu (Sénat I, p. 83 n. 3 et p. 85, n. 4).
(4) V. Schwegler, II, p. 309-384.
Quel poète que ce plébéien inconnu dont le souffle aurait animé ces figures touchantes et héroïques! Le vrai poète ici, le seul, c'est tout le monde; c'est ce poète qui, partant d'un fait réel, s'est mis à broder sur ce fond, facile à féconder en raison de sa pauvreté même (1). La défaite de Roland à Roncevaux ne tient qu'une bien petite place dans l'histoire, et pourtant tout l'éblouissement du règne de Charlemagne a fini par se concentrer autour de cette personnalité effacée et de ce combat obscur.
(1) M. Bonghi remarque avec raison (1. c.) que tous, patriciens et plébéiens, avaient dû adopter et enrichir une légende qui flattait égaiement les passions des deux partis.
G. Bloch
![]()
sommaire