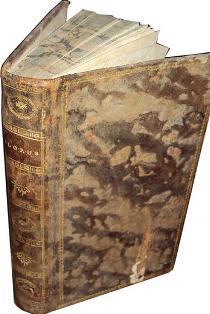
ABREGE de L'HISTOIRE ROMAINE
par
FLORUS
Nisart
1865
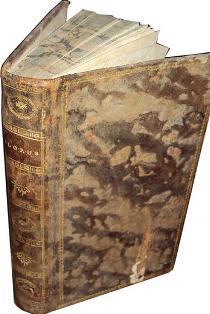
LIVRE PREMIER.
Avant-propos.
Le peuple romain, depuis le roi Romulus jusqu'à César Auguste, a, pendant sept cents ans , accompli tant de choses dans la paix et dans la guerre, que, si l'on compare la grandeur de son empire avec sa durée, on le croira plus ancien. Il a porté ses armes si avant dans l'univers, qu'en lisant ses annales ce n'est pas l'histoire d'un seul peuple que l'on apprend, mais celle du genre humain. Il a été en butte à tant d'agitations et de périls, que, pour établir sa puissance, le courage et la fortune semblent avoir réuni leurs efforts. Aussi ce sont principalement ses progrès qu'il importe de connaître : cependant, comme le plus grand obstacle à une entreprise est son étendue, et que la diversité des objets émousse l'attention, j'imiterai l'art de ceux qui peignent les contrées de la terre; j'embrasserai, comme dans un cadre étroit, le tableau entier de l'empire; et j'ajouterai, je l'espère, à l'admiration qu'inspire le peuple roi, si je parviens à retracer dans ses proportions et dans son ensemble son universelle grandeur. Si donc l'on considère le peuple romain comme un seul homme, si l'on envisage toute la suite de son âge, sa naissance, son adolescence, la fleur, pour ainsi dire, de sa jeunesse, et enfin l'espèce de vieillesse où il est arrivé, on trouvera son existence partagée en quatre phases et périodes. Son premier âge se passa sous les rois, dans l'espace de près de deux cent cinquante années, pendant lesquelles il lutta, autour de son berceau, contre les nations voisines. Ce sera là son enfance. L'âge suivant, depuis le consulat de Brutus et de Collatin jusqura celui d'Appius Claudius et de Quinctus Fulvius, embrasse deux cent cinquante ans, durant lesquels il subjugua l'Italie. Cette période agitée fut féconde en guerriers, en combats; aussi peut-on l'appeler son adolescence. De là, jusqu'à César Auguste, s'écoulèrent deux cents années, qu'il employa à pacifier tout l'univers. C'est alors la jeunesse de l'empire et sa robuste maturité. Depuis César Auguste jusqu'à nos jours, on ne compte pas beaucoup moins de deux cents ans, pendant lesquels l'inertie des Césars l'a en quelque sorte fait vieillir et décroitre entièrement. Mais, sous le règne de Trajan, il retrouve ses forces, et, contre toute espérance, ce vieil empire, comme rendu à ta jeunesse, reprend sa vigueur.
I. - De Romulus. - (An de Rome 1-58.) - Le premier fondateur et de Rome et de l'empire fut Romulus, né de Mars et de Rhéa Sylvia. Cette vestale en fit l'aveu pendant sa grossesse; et l'on n'en douta bientôt plus, lorsqu'ayant été, par l'ordre d'Amulius, jeté dans le fleuve avec Rémus, son frère, il ne put y trouver la mort : le Tibre arréta son cours; et une louve, abandonnant ses petits, accourut aux cris de ces enfants, leur présenta ses mamelles, et leur servit de mère. C'est ainsi que Faustulus, berger du roi, les trouva auprès d'un arbre; il les emporta dans sa cabane, et les éleva. Albe était alors la capitale du Latium. Iule l'avait bâtie, dédaignant Lavinium, fondée par son père Énée. Amulius, quatorzième descendant de ces rois, régnait, après avoir chassé son frère Numitor, dont la fille était mère de Romulus. Celui-ci, dans le premier feu de sa jeunesse, renverse du trône son oncle Amulius, et y replace son aieul. Chérissant le fleuve et les montagnes qui l'avaient vu élever, il y méditait la fondation d'une nouvelle ville. Rémus et lui étaient jumeaux; pour savoir lequel dès deux lui donnerait son nom et ses lois, ils convinrent d'avoir recours aux dieux. Rémus se place sur le mont Aventin, son frère sur le mont Palatin. Rémus, le premier, aperçoit six vautours; mais Romulus en voit ensuite douze. Vainqueur par cet augure, il presse les travaux de sa ville, plein de l'espoir qu'elle sera belliqueuse: ainsi le lui promettaient ces oiseaux habitués au sang et au carnage. Pour la défense de la nouvelle ville, un retranchement semblait suffire; Rémus se moque de cette étroite barrière, et la franchit d'un saut par dérision ; il est tué, et l'on doute si ce n'est pas par l'ordre de son frère. II fut du moins la première victime qui consacra de son sang les murailles de la ville naissante. C'était plutôt l'image d'une ville qu'une ville véritable que Romulus avait créée; les habitants manquaient. Dans le voisinage était un bois sacré; il en fait un asile ; et soudain accourent une multitude prodigieuse d'hommes, des pâtres latins et toscans, quelques étrangers d'outre-mer, des Phrygiens qui, sous la conduite d'Énée, et des Arcadiens qui, sous celle d'Évandre, s'étaient répandus dans le pays. De ces éléments divers il composa un seul corps, et il en fit le peuple romain. Une seule génération devait être la durée de ce peuple d'hommes. Il demanda donc des épouses à ses voisins; et, ne les ayant pas obtenues, il les enleva de vive force. On feignit, dans ce dessein, de célébrer des jeux équestres : les jeunes filles, qui étaient venues à ce spectacle, devinrent la proie des Romains, et en même temps une cause de guerre. Les Véiens furent battus et mis en fuite. On prit et on ruina la ville des Céniniens. De plus, les dépouilles opimes de leur roi furent rapportées à Jupiter Férétrien par les mains du roi de Rome. Une jeune fille livra les portes de la ville aux Sabins : ce n'était pas par trahison; seulement, elle leur avait demandé, pour prix de son action, ce qu'ils portaient à leur bras gauche, sans désigner leurs boucliers ou leurs bracelets. Les Sabins, pour dégager leur parole et punir en même temps sa perfidie, l'accablèrent sous leurs boucliers. Quand, par ce moyen, ils eurent été introduits dans les murs, il se livra, sur la place publique, un combat si sanglant, que Romulus pria Jupiter "d'arrêter la fuite honteuse des siens." De là, le temple et le nom de Jupiter Stator. Enfin, au milieu du carnage, les femmes enlevées se précipitèrent, les cheveux épars, entre les combattants. La paix fut faite alors avec Tatius, et l'alliance conclue : par un retour surprenant, les ennemis, abandonnant leurs foyers, passèrent dans la nouvelle ville, et apportèrent, pour dot, à leurs gendres, les richesses de leurs aïeux. Rome, ayant en peu de temps accru ses forces, voici la forme que le roi, dans sa haute sagesse, imposa à la république. La jeunesse, divisée par tribus, était toujours à cheval et sous les armes, prête à combattre au premier signal; le conseil de la république fut confié aux vieillards, que leur autorité fit appeler Pères, et leur âge Sénateurs. Cet ordre établi, un jour que Romulus tenait une assemblée hors de la ville, près du marais de Capréa, tout à coup il disparut à tous les regards. Quelques-uns pensent qu'il fut, à cause de l'àpreté de son caractère, mis en pièces par le sénat, mais un orage qui s'éleva et une éclipse de soleil donnèrent à cet événement l'apparence d'une apothéose. Julius Proculus accrédita bientôt cette idée, en affirmant que Romulus s'était fait voir à lui sous une forme plus auguste que pendant sa vie; qu'il voulait qu'on l'honorât désormais comme une divinité; que, dans le ciel, il s'appelait Quirinus, les dieux l'ayant ainsi arrêté; qu'à ce prix, Rome deviendrait la maîtresse des nations.
II.- De Numa Pompilius. - (An de Rome 59.) - A Romulus succéda Numa Pompilius, qui vivait à Cures, chez les Sabins où les Romains allèrent d'eux-mêmes le chercher, sur la réputation de son insigne piété. Ce fut lui qui leur enseigna les sacrifices, les cérémonies, et tout le culte des dieux immortels; qui établit les pontifes, les augures, les saliens et les autres sacerdoces du peuple romain; qui divisa l'année en douze mois, et les jours en fases et néfastes ; lui enfin qui institua les boucliers sacrés, le Palladium, quelques autres gages mystérieux de l'empire, le Janus au double visage, et surtout le feu de Vesta, dont il commit l'entretien à des vierges, afin qu'à l'image des astres du ciel, cette flamme tutélaire ne cessât de veiller. Il attribua toutes ces choses aux conseils de la déesse Égérie, pour que les Romains, encore barbares, les accueillissent avec plus de respect. Enfin, il sut si bien apprivoiser ce peuple farouche , qu'un empire fondé par la violence et l'usurpation fut gouverné par la religion et la justice.
III.- De Tullus Hostilius. - (An de Rome 82.) - Numa Pompilius eut pour successeur Tullus Hostilius, à qui l'on donna librement le trône pour honorer son courage. Il fonda toute la discipline militaire et l'art de la guerre. Lorsqu'il eut parfaitement exercé la jeunesse, il osa provoquer les Albains, peuple redoutable, et qui avait longtemps tenu le premier rang. Mais comme, par l'égalité de leurs forces, les deux nations s'affaiblissaient dans de fréquents combats, on voulut abréger la guerre; trois frères de part et d'autre, les Horaces et les Curiaces, furent chargés des destinées de leur pays. La lutte incertaine, mais glorieuse, eut une issue miraculeuse. D'un côté, en effet, les trois combattants étaient blessés; de l'autre, deux avaient été tués; l'Horace qui survivait ajouta la ruse au courage; pour diviser l'ennemi, il feignit de prendre la fuite; et fondant sur ceux qui le suivaient à des distances inégales, il les terrassa l'un après l'autre. Ainsi, gloire donnée à peu de nations! la main d'un seul homme nous obtint la victoire ; il la souilla bientôt par un parricide. Il vit sa soeur pleurer auprès de lui sur les dépouilles d'un Curiace, son fiancé, mais l'ennemi de Rome. Horace punit par le fer les larmes intempestives de cette jeune fille. Les lois réclamèrent le châtiment du coupable; mais la valeur fit oublier le parricide, et le crime disparut devant la gloire. Cependant les Albains ne furent pas longtemps fidèles : car, dans une guerre contre les Fidénates, où, d'après le traité, ils servaient comme auxiliaires, ils attendirent, immobiles entre les deux armées, que la fortune se déclarât. Mais l'adroit Hostilius vit à peine ces alliés s'avancer vers l'ennemi, que, pour rassurer les esprits, il feignit d'avoir lui-même ordonné ce mouvement, feinte qui remplit d'espérance nos soldats, et les Fidénates d'effroi. Le dessein des traîtres demeura ainsi sans effet. Les ennemis, ayant donc été vaincus, l'infracteur du traité, Mettus Fufétius, fut lié entre deux chars et écartelé par des chevaux fougueux. Quant à la ville d'Albe, mère, il est vrai, mais rivale de la nôtre, Tullus la fit raser, après avoir transféré à Rome ses richesses et même sa population ; de sorte qu'il sembla moins avoir détruit une cité qui avait avec Rome des liens de parenté, qu'avoir réuni les membres d'un même corps.
IV.- D'Ancus Marcius.- (An de Rome 114.) - Ensuite vint Ancus Marcius, petit-fils de Numa, dont il eut le caractère. Il entoura d'une muraille les retranchements de la ville, joignit par un pont les rives du Tibre qui la traverse, et fonda une colonie à Ostie, à l'embouchure même de ce fleuve; sans doute son esprit pressentait déjà que les richesses et les productions du monde entier y seraient reçues comme dans l'entrepôt maritime de Rome.
V.- De Tarquin l'Ancien.- (An de Rome 159.) - Tarquin l'Ancien, qui lui succéda, quoique d'une famille venue d'au-delà des mers, osa aspirer au trône ; il le dut à son adresse et à l'élégance de ses mœurs. Originaire de Corinthe, il alliait la subtilité grecque à la souplesse italienne. Il rehaussa la majesté du sénat en multipliant ses membres, et, par de nouvelles centuries, il étendit les tribus dont Attius Navius, savant augure, lui défendait d'augmenter le nombre. Le roi, pour l'éprouver, lui demande "si la chose à laquelle il pensait en ce moment pouvait s'exécuter." Navius, ayant consulté son art, répond qu'elle est possible. "Eh bien! dit le roi, je songeais en moi-même si je pourrais couper ce caillou avec un rasoir." - "Vous le pouvez, repartit l'augure; " il le coupa en effet. Depuis ce temps, la dignité d'augure fut sacrée pour les Romains. Tarquin ne fut pas moins entreprenant dans la guerre que dans la paix. Il subjugua les douze peuples de l'Étrurie dans de nombreux combats. De là nous sont venus les faisceaux, les toges des souverains magistrats, les chaises curules, les anneaux, les colliers des chevaliers, les manteaux militaires, la robe prétexte; de là aussi le char doré des triomphateurs, trainé par quatre chevaux, les robes peintes, les tuniques à palmes; enfin tous les ornements et les insignes qui relèvent la dignité de l'empire.
VI.- De Servius Tullius.- (An de Rome 175.) - Servius Tullius se saisit ensuite du gouvernement de Rome, malgré l'obscurité de sa naissance, et quoiqu'il fût né d'une mère esclave. Tanaquil, epouse de Tarquin, avait cultivé, par une éducation libérale, l'heureux naturel de ce jeune homme; une flamme, qu'elle avait vue autour de sa tête, lui avait présagé son illustration future. Dans les derniers moments de Tarquin, Servius fut, par les soins de la reine, mis à la place du roi, comme à titre provisoire; et il gouverna avec tant d'habileté un royaume acquis par la ruse, qu'il parut l'avoir légitimement obtenu. Ce fut par lui que le peuple romain fut soumis au cens, rangé par classes, distribué en curies et en colléges. Ce roi établit, par la supériorité de sa sagesse, un tel ordre dans la république; que tous les détails sur le patrimoine, la dignité, l'âge, les professions et les emplois de chacun étaient portés sur des tables; de cette manière, cette grande cité fut réglée avec autant d'exactitude que la maison du moindre particulier.
VII. - Tarquin-le-Superbe. - (An de Rome 220.) - Le dernier de tous les rois fut Tarquin, à qui son caractère fit donner le surnom de Superbe. Le trône de son aïeul était occupé par Servius ; il aima mieux le ravir que l'attendre : après avoir fait assassiner ce roi , il n'exerça pas mieux qu'il ne l'avait acquise une puissance obtenue par le crime. Sa femme Tullie ne répugnait pas à ses sanguinaires habitudes : comme elle accourait, dans son char, saluer roi son époux, elle fit passer sur le corps sanglant de son père ses chevaux épouvantés. Quant à Tarquin, il décima le sénat par des meurtres, accabla tous les Romains d'un orgueil plus insupportable aux gens de bien que la cruauté; et quand il eut lassé sa fureur par des violences domestiques, il la tourna enfin contre les ennemis. Ainsi furent prises dans le Latium de fortes places, Ardée, Ocriculum, Gabie, Suessa Pometia. Alors même il fut cruel envers les siens. Il n'hésita pas à faire battre de verges son fils, afin que, passant chez les ennemis comme transfuge, il gagnât leur confiance. Après avoir été reçu dans Gabie, comme Tarquin l'avait désiré, ce jeune homme envoya prendre les ordres de son père, lequel lui répondit en abattant. avec une baguette les têtes des pavots les plus élevés qui se trouvaient là voulant faire entendre par là, ô excès d'orgueil ! qu'il l'allait tuer les prerniers de la ville. Toutefois, il bâtit un temple avec les dépouilles des villes qu'il avait prises. Lorsqu'on l'inaugura, les autres dieux cédèrent leur place; mais, o prodige ! la Jeunesse et le dieu Terme firent résistance. Les devins interprétèrent favorablement l'opiniâtreté de ces divinités, qui promettaient ainsi à Rome une puissance inébranlable et éternelle. Mais ce qui parut plus étrange encore, c'est qu'en creusant les fondations du temple, on trouva une tête d'homme: personne ne douta qu'un prodige aussi éclatant n'annonçât que Rome serait le siégé de l'empire et la tête de l'univers. Le peuple romain souffrit l'orgueil du roi, tant que l'incontinence ne s'y joignit pas. Il ne put supporter ce dernier outrage de la part de ses enfants. L'un d'eux ayant déshonoré Lucrèce, la plus illustre des femmes, cette Romaine expia sa honte en se poignardant. Alors fut abrogée la puissance des rois.
VIII. Voilà le premier âge du peuple romain, et pour ainsi dire son enfance; il la passa sous sept rois, dont le génie différent fut, par un heureux arrangement des destins, approprié aux intérêts et aux besoins de la république. En effet, quel génie plus ardent que celui de Romulus? Il fallait un tel homme pour saisir le gouvernement. Quel prince plus religieux que Numa? le bien de l'état le demandait ainsi, afin qu'un peuple farouche fût adouci par la crainte des dieux. Combien le créateur de l'art militaire, Tullius, n'était-il pas nécessaire à des hommes belliqueux? La science devait perfectionner leur courage. De quelle utilité ne fut pas, dans Ancus, le goùt des constructions? Il donna à la ville une colonie pour son agrandissement, un pont pour la facilité des communications, un mur pour sa défense. Quant aux ornements et aux insignes de Tarquin, combien leur usage seul n'a-t-il pas ajouté à la dignité du peuple roi? Le cens établi par Servius n'eut-il pas pour effet d'apprendre à la république à se connaître elle-même? Enfin l'intolérable domination de Tarquin le Superbe, loin d'avoir été sans résultat, en fut au contraire un très avantageux ; elle fit que le peuple, soulevé par les outrages, s'enflamma d'amour pour la liberté.
IX. (An de Rome 214.) - Ainsi, sous la conduite et par les conseils de Brutus et de Collatin, à qui Lucrèce, en mourant, avait confié le soin de sa vengeauce, le peuple romain, excité, comme par une inspiration des dieux, à punir l'outrage fait à la liberté et à la pudeur, déposa aussitôt le roi, pilla ses biens, consacra son domaine à Mars, protecteur de Rome, et transféra aux vengeurs de sa liberté la suprème puissance dont il changea toutefois le nom et les droits. En effet, de perpétuelle, elle devint annuelle; unique auparavant, elle fut partagée; on voulait préveoir la corruption attachée à l'unité ou à la durée du pouvoir; le nom de rois fit place à celui de consuls, qui rappelait à ces magistrats qu'ils ne devaient consulter que les intérêts de leurs concitoyens. Tel fut l'excès de la joie qu'inspira la liberté nouvelle, qu'à peine put-on croire au changement opéré dans l'état; et qu'à cause de son nom seulement et de sa naissance royale, un des consuls se vit enlever ses faisceaux et banni de la ville. Valérius Poplicola, qui lui fut substitué, travailla avec le plus grand zèle à augmenter la majesté d'un peuple libre. Il fit abaisser ses faisceaux devant lui, dans les assemblées, et lui donna le droit d'appel contre les consuls eux-mêmes. Enfin, de peur qu'on ne prit ombrage de ce que sa maison, placée sur une éminence, offrait l'apparence d'une citadelle, il la fit rebâtir dans la plaine. Quant à Brutus, ce fut par le sang de sa famille et par le parricide qu'il s'éleva au faite de la faveur populaire. Ayant découvert que ses fils travaillaient à rappeler les rois dans la ville, il les fit trainer sur la place publique, battre de verges au milieu de l'assemblée du peuple, et frapper de la hache. Il parut, aux yeux de tous, être ainsi devenu le père de la patrie, et avoir, à la place de ses enfants, adopté le peuple romain. Libre désormais, Rome prit les armes contre les étrangers, d'abord pour sa liberté, bientôt après pour ses limites, ensuite pour ses alliés, enfin pour la gloire et pour l'empire, contre les continuelles attaques des nations voisines. En effet, sans territoire qu'ils pussent appeler le sol de la patrie, ayant à combattre au sortir même de leurs murs, placés entre le Latium et l'Étrurie, comme entre deux grands chemins, les Romains à toutes leurs portes rencontraient un ennemi; mais toujours marchant de proche en proche, ils subjuguèrent les unes après les autres les nations voisines, et rangèrent toute l'Italie, sous leur domination.
X. - Guerre contre Porsena, roi des Étrusques. - (An de Rome 246 ). - Après l'expulsion des rois, ce fut d'abord pour la liberté que Rome prit les armes. Porsena, roi des Érusques, s'avançait à la tête d'une puissante armée, et ramenait avec lui les Tarquins. Mais, malgré le fer et la famine qui pressaient les Romains, malgré la prise du Janicule, d'où ce roi, déjà maître des portes de leur ville, paraissait les dominer, on se soutint, on le repoussa. Bien plus, on le frappa de tant d'étonnement, que, supérieur en forces, il se hâta de conclure, avec des ennemis à demi-vaincus, un traité d'alliance. Alors parurent ces modèles et ces prodiges de l'intrépidité romaine, Horatius, Mucius et Clélie, prodiges qui, s'ils n'étaient consignés dans nos annales, passeraient aujourd'hui pour des fables. Horatius Coclès, n'ayant pu repousser lui seul les ennemis qui le pressaient de toutes parts, fait couper le pont où il combattait, et passe le Tibre à la nage sans abandonner ses armes. Mucius Scévola pénètre par ruse dans le camp du roi; mais croyant le frapper, c'est un de ses courtisans qu'il atteint. On l'arrête; il met sa main dans un brasier ardent, et redoublant par un adroit mensonge la terreur qu'il inspire : "Tu vois, dit-il au roi, à quel homme te as échappé; Eh bien ! nous sommes trois cents qui avons fait le même serment." Pendant cette action, chose prodigieuse ! il était impassible, et le roi tremblait comme si c'eût été sa main que dévorait la flamme. Voilà ce que firent les hommes ; mais les deux sexes rivalisèrent de gloire, et les jeunes filles eurent aussi leur héroïsme. Clélie, une de celles qu'on avait données en otage à Porsena, échappée à ses gardes, traversa à cheval le fleuve de la patrie. Enfin le roi, effrayé de tant de prodiges de courage , s'éloigna des Romains, et les laissa libres. Les Tarquins continuèrent la guerre jusqu'au moment où Aruns, fils du roi, fut tué de la main de Brutus, lequel, blessé en même temps par son ennemi , expira sur son corps, comme s'il eût voulu montrer qu'il poursuivait l'adultère jusqu'aux enfers.
XI. - Guerre contre les Latins. - (An de Rome 253 - 298 ). - Les Latins soutenaient aussi les Tarquins par un esprit de rivalité et d'envie contre un peuple qu'ils auraient voulu, puisqu'il dominait au dehors, voir du moins esclave dans ses murs. Tout le Latium se leva donc, sous la conduite de Mamilius de Tusculum, comme pour venger le roi. On combattit près du lac Régille; la victoire fut longtemps douteuse; enfin le dictateur Postumius, recourant, pour la décider, à un moyen nouveau et ingénieux , jeta une enseigne au milieu des ennemis, afin que les Romains se précipitassent pour la reprendre. Cossus, maître de la cavalerie, par un expédient également sans exemple, fit ôter les freins des chevaux, pour faciliter l'impétuosité de leur course. Telle fut enfin la fureur du combat, que la renommée y mentionna l'intervention des dieux, comme spectateurs ; l'on en vit deux montés sur des chevaux blancs; personne ne douta que ce ne fussent Castor et Pollux. Aussi, le général leur adressa-t-il ses voeux : pour prix de la victoire, il leur promit et leur éleva des temples qui furent comme la solde de ces divins compagnons d'armes. Jusqu'ici Rome avait combattu pour la liberté: bientôt elle fit pour ses limites, et contre les mêmes Latins: une guerre sans fin et sans relàche. Sora et Algidum, qui le croirait? furent la terreur des Romains; Satricum et Corniculum, furent des provinces romaines. Je rougis de le dire, mais nous avons triomphé de Vérule et de Bovile. Nous n'allions à Tibur , maintenant faubourg de Rome, et à Préneste, nos délices d'été, qu'après avoir fait des voeux au Capitole. Alors Fésules était pour les Romains ce que Carres fut depuis; le bois d'Aricie était leur forêt Hercynienne; Frégelles, leur Gesoriacum; le Tibre, leur Euphrate. Coriole même, quelle honte ! Coriole, réduite par les armes, fut un si beau titre de gloire, que le vainqueur de cette place, Caïus Marcius, joignit à son nom celui de Coriolan, comme s'il eût conquis Numance ou l'Afrique. On voit encore dans le Forum les dépouilles d'Antium, que Ménius suspendit à la tribune aux harangues, après la prise de la flotte ennemie; si toutefois l'on peut appeler flotte six navires armés d'éperons; mais ce nombre suffisait, dans ces premiers temps, pour une guerre maritime. Les plus opiniâtres des Latins furent les Éques et les Volsques; c'étaient, pour ainsi dire, des ennemis de tous les jours. Mais celui qui contribua le plus à les dompter fut Lucius Quinctius, ce dictateur tiré de la charrue, et dont la valeur extraordinaire sauva le consul Marcus Minucius, assiégé et déjà presque pris dans son camp. On était alors dans la saison des semailles; et le licteur trouva ce patricien courbé sur sa charrue et occupé du labourage. C'est de là que, s'élançant aux combats, Quinctius, pour y conserver quelque image de ses travaux rustiques, traita les vaincus comme un troupeau, en les faisant passer sous le joug. L'expédition ainsi terminée, on vit retourner à ses boeufs ce laboureur décoré d'un triomphe. Grands dieux! quelle rapidité! une guerre, en quinze jours, commencée et finie, comme si le dictateur eût voulu se hâter de retourner à ses travaux interrompus.
XII. - Guerre contre les Étrusques, les Falisques et les Fidénates. - (An de Rome 274 - 560.) - Les Véiens, peuple de l'Étrurie, nos ennemis perpétuels, armaient chaque année. Tant d'acharnement porta la famille des Fabius à lever contre eux une troupe vraiment extraordinaire, et à soutenir seule les frais de la guerre. Sa défaite ne fut que trop signalée. Trois cents guerriers, armée patricienne, furent taillés en pièces près du Crémère; et le nom de scélérate désigna la porte qui leur ouvrit, à leur départ, le chemin du combat. Mais ce désastre fut expié par d'éclatantes victoires; et nos divers généraux prirent de très fortes places, avec des circonstances, il est vrai, bien différentes. La soumission des Falisques fut volontaire. Les Fidénates périrent dans les flammes qu'ils avaient allumées; les Véiens furent pris et entièrement exterminés. Les Falisques, pendant qu'on les tenait assiégés, durent accorder une juste admiration à la loyauté de notre général, lequel, faisant charger de chaînes un maître d'école qui voulait livrer sa patrie, s'empressa de le leur renvoyer avec les enfants qu'il avait amenés. Il savait en effet, cet homme sage et vertueux, qu'il n'y a de véritable victoire que celle qui s'obtient sans violer la bonne foi et sans porter atteinte à l'honneur. Les Fidénates, inférieurs aux Romains dans les combats, crurent les frapper d'épouvante, en s'avançant comme des furieux , armés de torches, et hérissés de bandelettes de diverses couleurs qui s'agitaient en forme de serpents ; mais ce lugubre appareil fut le présage de leur destruction. Quant aux Véiens, un siégé de dix ans indique assez leur puissance. Alors, pour la première fois, on hiverna sous des tentes faites de peaux, et l'on distribua une solde pendant les quartiers d'hiver: le soldat s'était engagé, par un serment, volontaire, "à ne rentrer dans Rome qu'après avoir pris Véies." Les dépouilles du roi Lars Tolumnius furent portées à Jupiter Férétrien. Enfin, sans escalade et sans assaut, mais par la mine et par des travaux souterrains, fut consommée la ruine de Véies. Le butin parut si considérable que la dixième partie en fut envoyée à Apollon Pythien, et que tout le peuple romain fut convié au pillage de la ville. Voilà ce que Véies était alors; qui se rappelle aujourd'hui qu'elle ait existé? quels débris en reste-t-il? quel vestige? Il faut toute l'autorité des annales pour nous persuader qu'il y eut une ville de Véies.
XIII. - Guerre coutre les Gaulois. - (An de Rome 364 - 369 ). - Alors, soit jalousie des dieux, soit arrêt du destin, le cours rapide des conquêtes de Rome fut un instant interrompu par une incursion des Gaulois Sénonais. Je ne sais si cette époque fut plus funeste aux Romains, par leurs désastres, que glorieuse par les épreuves où elle mit leurs vertus. Telle fut du moins la grandeur de leurs maux, que je les croirais envoyés par les dieux immortels, pour éprouver si la vertu romaine méritait l'empire du monde. Les Gaulois Sénonais, nation d'un naturel farouche, et de mœurs grossières, étaient par leur taille gigantesque, ainsi que par leurs armes énormes, si effrayants de toute manière, qu'ils semblaient nés uniquement pour l'extermination des hommes et la destruction des villes. Parties autrefois des extrémités de la terre et des rivages de l'Océan, qui ceint l'univers, leurs innombrables hordes, après avoir tout dévasté sur leur passage, s'étaient établies entre les Alpes et le Pô ; et, non contents de ces conquêtes, ils se promenaient dans l'Italie. Ils assiégeaient alors Clusium. Le peuple romain intervint en faveur de ses alliés et de ses amis. Il envoya des ambassadeurs, selon l'usage. Mais quelle justice attendre des Barbares? ils se montrent plus arrogants: ils se tournent. contre nous, et la guerre s'allume. Dès lors, abandonnant Clusium, ils marchent sur Rome jusqu'au fleuve Allia, où le consul Fabius les arrête avec une armée. Aucune défaite ne fut, sans contredit, plus horrible. Aussi Rome, dans ses fastes, plaça-t-elle cette journée au nombre des jours funestes. Les Gaulois, après la déroute de notre armée, approchaient déjà des murs de la ville. Elle était sans défense. C'est alors, ou jamais, qu'éclata le courage romain. D'abord les vieillards qui avaient été élevés aux premiers honneurs se rassemblèrent dans le Forum. Là, tandis que le pontife prononcait les solennelles imprécations, ils se dévouèrent aux dieux Mânes ; et, de retour dans leurs demeures, revêtus de la robe magistrale et des ornements les plus pompeux, ils se placèrent sur leurs chaises curules, voulant, lorsque viendrait l'ennemi, mourir dans toute leur dignité. Les pontifes et les flamines enlèvent tout ce que les temples renferment de plus révéré; ils en cachent une partie dans des tonneaux qu'ils enfouissent sous terre, et, chargeant le reste sur des chariots, ils le transportent loin de la ville. Les vierges attachées an sacerdoce de Vesta accompagnent, pieds nus, la fuite des objets sacrés. On dit cependant que ce cortége fugitif fut recueilli par un plébéien, Lucius Albinus, qui fit descendre de son chariot sa femme et ses enfants , pour y placer les prêtresses; tant il est vrai que, même dans les dernières extrémités, la religion publique l'emportait alors sur les affections particulières. Quant à la jeunesse, qui, on le sait, se composait à peine de mille hommes, elle se retrancha, sous la conduite de Manlius, dans la citadelle du mont Capitolin; et là, comme en présence de Jupiter, ils le conjurèrent "puisqu'ils s'étaient réunis pour défendre son temple, d'accorder à leur valeur l'appui de sa diviriité." Cependant les Gaulois arrivent; la ville était ouverte; ils pénètrent en tremblant d'abord, de peur de quelque embûche secrète; bientôt, ne voyant qu'une solitude, ils s'élancent avec des cris aussi terribles que leur impétuosité, et se répandent de tous côtés dans les maisons ouvertes. Assis sur leurs chaises curules et revêtus de la prétexte, les vieillards leur semblent des dieux et des génies, et ils se prosternent devant eux ; bientôt, reconnaissant que ce sont des hommes, qui d'ailleurs ne daignent pas leur répondre, ils les immolent avec cruauté, embrasent les maisons; et, la flamme et le fer à la main, ils mettent la ville au niveau du sol. Pendant six mois, qui le croirait? Les Barbares restèrent comme suspendus autour d'un seul roc, faisant le jour, la nuit même, de nombreuses tentatives pour l'emporter. Une nuit enfin qu'ils y pénétraient, Manlius, éveillé par les cris d'une oie, les rejeta du haut du rocher; et, afin de leur ôter tout espoir par une apparente confiance, il lança, malgré l'extrême disette, des pains par dessus les murs de la citadelle. Il fit même, dans un jour consacré, sortir du Capitole, à travers les gardes ennemis, le pontife Fabius, qui avait un sacrifice solennel à faire sur le mont Quirinal. Fabius revint sans blessure au milieu des traits des ennemis, sous la protection divine et il annonça que les dieux étaient propices. Fatigués enfin de la longueur du siège, les Barbares nous vendent leur retraite au prix de mille livres d'or; ils ont même l'insolence d'ajouter encore à de faux poids celui d'une épée; puis, comme ils répétaient dans leur orgueil : "Malheur aux vaincus!" soudain Camille les attaque par derrière, et en fait un tel carnage qu'il efface dans des torrents de sang gaulois toutes les traces de l'incendie. Grâces soient rendues aux dieux immortels, même pour cet affreux désastre. Sous ce feu disparurent les cabanes de pasteurs; sous la flamme, la pauvreté de Romulus. Cet embrasement d'une cité, le domicile prédestiné des hommes et des dieux, eut-il un autre résultat que de la montrer non pas détruite, non pas ruinée, mais plutôt purifiée et consacrée? Ainsi donc, sauvée par Manlius et rétablie par Camille, Rome se releva plus fière et plus terrible pour ses voisins. Et d'abord, c'était peu d'avoir chassé de la ville cette race de Gaulois; les voyant encore traîner par toute l'Italie les vastes débris de leur naufrage, les Romains les poursuivirent si vivement, sous la conduite de Camille, qu'il ne reste plus aujourd'hui aucun vestige des Sénonais. On les massacra une première fois près de l'Anio, où Manlius, dans un combat singulier contre un de ces Barbares, lui arracha, entre autres dépouilles, un collier d'or : de là le nom de Torquatus. Ils furent encore défaits aux champs Pomptins; là, dans un semblable combat, Lucius Valérius, secondé par un oiseau sacré qui s'attacha au casque du Gaulois, conquit les dépouilles de son ennemi et le surnom de Corvinus. Enfin, quelques années après, les derniers restes de ce peuple furent anéantis en Etrurie, par Dolabella, près le lac de Vadimon, afin qu'il n'existât plus dans cette nation un seul homme qui pût se glorifier d'avoir incendié la ville de Rome.
XIV. - Guerre contre les Latins. - (An de Rome 414-417) - Des Gaulois on marcha contre les Latins, sous le consulat de Manlius Torquatus et de Décius Mus. La jalousie du commandement avait toujours rendu ces peuples ennemis de Rome; mais alors, l'incendie de cette ville la leur faisant mépriser, ils réclamaient le droit de cité, la participation au gouvernement et aux magistratures; et ils osaient plus que nous combattre. Ils cèdent à nos armes; qui pourra s'en étonner, quand on voit l'un des consuls faire mourir son fils pour avoir combattu contre son ordre, et montrer qu'il attache à la discipline plus de prix qu'à la victoire; l'autre, comme par une inspiration divine, se couvrir la tête d'un voile, se dévouer aux dieux Mânes devant le premier rang de l'armée, se précipiter au milieu des traits innombrables des ennemis, et nous frayer, par les traces de son sang, un nouveau chemin vers la victoire ?
XV. - Guerre contre les Sabins. - (An de Rome 465) - Les Latins soumis, on attaqua les Sabins qui, oubliant l'alliance contractée sous Titus Tatius, et entraînés à la guerre par une sorte de contagion, s'étaient joints aux Latins. Mais le consul Curius Dentatus porta le fer et le feu dans toute la contrée qui s'étend entre le Nar, l'Anio, et les fontaines Vélines, jusqu'à la mer Adriatique. Cette victoire fit passer tant d'hommes, tant de territoire sous la puissance de Rome, que le vainqueur lui-même ne pouvait décider laquelle de cette double conquête était la plus considérable.
XVI. - Guerre contre les Samnites. - (An de Rome 410) - Touché des prières de la Campanie, le peuple romain, non pour son intérêt, mais, ce qui est plus beau, pour celui de ses alliés, attaqua ensuite les Samnites. Il existait une alliance conclue avec chacun de ces deux peuples; mais les Campaniens avaient rendu la leur plus sacrée et plus importante par la cession de tous leurs biens. Ainsi donc Rome fit la guerre aux Samnites comme pour elle-même. De toutes les contrées non seulement de l'Italie, mais de l'univers entier, la plus belle est la Campanie. Rien de plus doux que son climat; un double printemps y fleurit chaque année. Rien de plus fertile que son territoire; aussi dit-on que Bacchus et Cérès y rivalisent. Point de mer plus hospitalière. Là sont les ports renommés de Caïète, de Misène, de Baies, aux sources toujours tièdes ; le Lucrin et l'Averne, où la mer semble venir se reposer. Là sont ces monts couronnés de vignobles, le Gaurus, le Falerne, le Massique, et, le plus beau de tous, le Vésuve, rival des feux de l'Etna. Près de la mer sont les villes de Formies, Cumes, Pouzzoles, Naples, Herculanum, Pompéii, et, la première de toutes, Capoue, comptée jadis au rang des trois plus grandes cités du monde, avec Rome et Carthage. C'est pour cette ville, pour ces contrées, que le peuple romain envahit le territoire des Samnites. Veut-on connaître l'opulence de ce peuple? il prodiguait jusqu'à la recherche l'or et l'argent sur ses armes, et les couleurs sur ses vêtements. Sa perfidie? il combattait en dressant des piéges dans les bois et dans les montagnes; son acharnement et sa fureur? c'était par des lois inviolables, et par le sang de victimes humaines, qu'il s'excitait à la ruine de Rome. Son opiniâtreté? rompant six fois le traité, il ne se montrait que plus animé après ses défaites. Toutefois, il ne fallut que cinquante ans aux Fabius, aux Papirius et à leurs fils, pour le soumettre et le dompter; on dispersa tellement les ruines mêmes de ces villes, que l'on cherche aujourd'hui le Samnium dans le Samnium, et qu'il est difficile de retrouver le pays qui a fourni la matière de vingt-quatre triomphes. Rome n'en reçut pas moins de cette nation un affront célèbre et fameux aux Fourches Caudines, sous les consuls Véturius et Postumius. Enfermée par surprise dans ce défilé, notre armée ne pouvait en sortir; le général ennemi, Pontius, tout étonné d'une occasion si belle, consulta son père Hérennius, qui lui conseilla sagement "de laisser aller ou de tuer tous les Romains." Pontius aima mieux les désarmer et les faire passer sous le joug; ce n'était pas seulement dédaigner leur amitié en retour d'un bienfait, c'était rendre, par un affront, leur inimitié plus terrible. Bientôt les consuls, se livrant d'eux-mêmes par une magnanime résolution, effacent la honte du traité; le soldat, avide de vengeance, se précipite, sous la conduite de Papirius, les épées nues, spectacle effrayant ! et, pendant la marche même, il prélude au combat par des frémissements de fureur. "Dans l'action, tous les yeux lançaient des flammes, " comme l'ennemi l'attesta; et l'on ne mit fin au carnage qu'après avoir imposé le même joug aux ennemis et à leur général captif.
XVII - Guerre contre les Etrusques et les Samnites. - (An de Rome 458) - Jusque-là le peuple romain n'avait fait la guerre qu'à une seule nation à la fois; bientôt il les combattit en masse, et sut cependant faire face à toutes. Les douze peuples de l'Étrurie, les Ombriens, le plus ancien peuple de l'Italie, qui avait jusqu'à cette époque échappé à nos armes; le reste des Samnites se conjurèrent tout à coup pour l'extinction du nom romain. La terreur fut à son comble devant la ligue de tant de nations si puissantes. Les enseignes de quatre armées ennemies flottaient au loin dans l'Étrurie. Entre elles et nous s'étendait la forêt Ciminienne, jusqu'alors impénétrable, comme celles de Calydon ou d'Hercynie. Ce passage était si redouté, que le sénat défendit au consul d'oser s'engager au milieu de tant de périls. Mais rien ne put effrayer le général ; et il envoya son frère en avant pour reconnaître les avenues de la forêt. Celui-ci, sous l'habit d'un berger, observa tout pendant la nuit, et revint annoncer que le passage était sûr. C'est ainsi que Fabius Maximus se tira sans danger d'une guerre si aventureuse. Il surprit tout à coup les ennemis en désordre et dispersés; et, s'étant emparé des hauteurs, il les foudroya sans effort à ses pieds. Ce fut comme une image de cette guerre où, du haut des cieux et du sein des nuages, la foudre était lancée sur les enfants de la terre. Toutefois, cette victoire ne laissa pas d'être sanglante; car Décius, l'un des consuls, accablé par l'ennemi dans le fond d'une vallée, dévoua, à l'exemple de son père, sa tête aux dieux Mânes; et, au prix de ce sacrifice solennel, ordinaire dans sa famille, il racheta la victoire.
XVIII. - Guerre contre Tarente et contre le roi Pyrrhus. - (An de Rome 471 - 481) Vient ensuite la guerre de Tarente, que l'on croirait, d'après ce titre et ce nom, dirigée contre un seul peuple; mais qui, par la victoire, en embrasse plusieurs. En effet, les Campaniens, les Apuliens, les Lucaniens, les Tarentins, auteurs de cette guerre, c'est-à-dire l'Italie entière, et, avec tous ces états, Pyrrhus, le plus illustre roi de la Grèce, furent comme enveloppés dans une ruine commune ; de sorte qu'en même temps cette guerre consommait la conquête de l'Italie, et était le prélude de nos triomphes d'outre-mer. Tarente, ouvrage des Lacédémoniens, autrefois capitale de la Calabre , de l'Apulie et de toute la Lucanie, est aussi renommée pour sa grandeur, ses remparts et son port, qu'admirable par sa position : en effet, située à l'entrée même du golfe Adriatique, elle envoie ses vaisseaux dans toutes les contrées, dans l'Istrie, l'Illyrie, l'Épire, l'Achaïe, l'Afrique, la Sicile. Au-dessus du port, et en vue de la mer, s'élève un vaste théâtre, qui fut l'origine de tous les désastres de cette ville malheureuse. Les Tarentins y célébraient par hasard des jeux, lorsqu'ils aperçurent une flotte romaine ramant vers le rivage; persuadés que ce sont des ennemis, ils se lèvent aussitôt, et, sans réfléchir, ils se répandent en injures. "Qui sont, disent-ils, et d'où viennent ces Romains?" Ce n'est pas assez : des ambassadeurs étaient venus porter de justes plaintes; on en insulte la majesté par un outrage obscène et qu'il serait honteux de rapporter ; ce fut le signal de la guerre. L'appareil en fut formidable, par le grand nombre de peuples qui se levèrent à la fois en faveur des Tarentins; Pyrrhus, plus ardent que tous les autres, et brûlant de venger une ville à moitié grecque, qui avait les Lacédémoniens pour fondateurs, venait par mer et par terre, avec toutes les forces de l'Épire, de la Thessalie, de la Macédoine, avec des éléphants jusqu'alors inconnus, et ajoutait encore à la force de ses guerriers, de ses chevaux et de ses armes, la terreur qu'inspiraient ces animaux. Ce fut près d'Héraclée, sur les bords du Liris, fleuve de la Campanie, et sous les ordres du consul Lévinus, que se livra le premier combat. Il fut si terrible qu'Obsidius , commandant de la cavalerie Férentine, ayant chargé le roi, le mit en désordre et le força de sortir de la mêlée, dépouillé des marques de sa dignité. C'en était fait de Pyrrhus, lorsqu'accoururent les éléphants qui changèrent, pour les Romains, le combat en spectacle. Leur masse, leur difformité, leur odeur inconnue, leur cri aigu, épouvantèrent les chevaux qui, croyant ces ennemis nouveaux plus redoutables qu'ils n'étaient en effet, causèrent, par leur fuite, une vaste et sanglante déroute. On combattit ensuite avec plus de succès, près d'Asculum, en Apulie, sous les consuls Curius et Fabricius. Déjà en effet l'épouvante occasionnée par les éléphants s'était dissipée; et Caius Minucius, hastaire de la quatrième légion, en coupant la trompe de l'un d'eux, avait montré que ces animaux pouvaient mourir. Dès lors on les accabla aussi de traits, et des torches lancées contre les tours couvrirent les bataillons ennemis tout en tiers de débris enflammés. Le carnage ne finit que quand la nuit sépara les combattants, et le roi lui-même, blessé à l'épaule, et porté par ses gardes sur son bouclier, fut le dernier à fuir. Une dernière bataille fut livrée en Lucanie par les mêmes généraux que j'ai nommés plus haut, dans les plaines qu'on nomme Arusines; mais ici la victoire fut complète, et, pour la décider, le hasard fit ce que d'ailleurs eût fait la valeur romaine. Les éléphants étaient de nouveau placés sur le front de l'armée; un d'eux, tout jeune encore, fut grièvement blessé d'un trait qui lui perça la tête; il tourna le dos, et écrasa, dans sa course, les soldats de cette armée. A ses cris douloureux, sa mère le reconnut et s'élança comme pour le venger. Tout lui parait ennemi, et, par sa lourde masse, elle porte le désordre autour d'elle. Ainsi ces mêmes animaux , qui avaient enlevé la première victoire et balancé la seconde, nous livrèrent la troisième sans résistance. Ce ne fut pas seulement par les armes et sur les champs de bataille, mais encore dans nos conseils et au sein de notre ville, que l'on eut à combattre Pyrrus. Ce roi artificieux ayant, dès sa première victoire, reconnu la valeur romaine, désespéra dès lors d'en triompher par les armes , et recourut à la ruse. En conséquence, il brûla nos morts, traita les prisonniers avec bonté, et les rendit sans rançon. Ayant ensuite envoyé des ambassadeurs à Rome, il s'efforça par tous les moyens de conclure un traité et d'acquérir notre amitié. Mais, dans la paix comme dans la guerre, au dedans comme au dehors, dans toutes les occasions, on vit éclater la vertu romaine ; et, plus qu'aucune autre, la victoire de Tarente montra le courage du peuple romain, la sagesse du sénat, la magnanimité de nos généraux. Quels hommes c'étaient en effet que ceux qui, dans la première bataille, furent, nous dit-on, écrasés sous les pieds des éléphants ! Tous avaient reçu leurs blessures à la poitrine ; quelques- uns étaient morts sur leurs ennemis ; l'épée était restée dans leurs mains, la menace sur leurs visages, et, dans la mort même, leur courroux vivait encore. Aussi Pyrrhus dit-il plein d'admiration : "Combien la conquête de l'univers serait facile, ou à moi avec des soldats romains, ou, aux Romains avec un roi tel que moi !" Et quelle activité, dans ceux qui survécurent, pour former une nouvelle armée! " Je le vois, dit encore Pyrrhus, je suis né sous la constellation d'Hercule; comme celles de l'hydre de Lerne, toutes les têtes abattues de mes ennemis renaissent de leur sang." Quelle grandeur encore dans ce sénat ! Témoin la réponse de ses ambassadeurs chassés de Rome avec leurs présents, après le discours d'Appius Coecus; Pyrrhus leur demandait ce qu'ils pensaient de la demeure de ses ennemis; ils avouèrent "que Rome leur avait paru un temple et le sénat une assemblée de rois." Enfin, quels généraux que les nôtres ! Voyez-les dans leur camp : Curius renvoie le médecin de Pyrrhus, qui voulait lui vendre la tête de ce prince ; et Fabricius rejette l'offre, que lui fait le roi, d'une partie de ses états. Voyez-les dans la paix : Curius préfère ses vases d'argile à l'or des Samnites , et Fabricius, dans l'austérité de sa censure, condamne comme un luxe excessif les dix livres de vaisselle d'argent que possédait Rufinus, personnage consulaire. Qui s'étonnera qu'avec ces mœurs, et avec le courage de ses soldats, le peuple romain ait été vainqueur, et que, dans les quatre années de la seule guerre de Tarente, il ait réduit sous sa domination la plus grande partie de l'Italie, les peuples les plus courageux, les villes les plus opulentes et les contrées les plus fertiles? Quoi de plus incroyable que cette guerre, si l'on en compare le commencement et l'issue? Vainqueur dans un premier combat, Pyrrhus, pendant que toute l'Italie tremble, dévaste la Campanie, les bords du Liris et Frégelles; des hauteurs de Préneste, il contemple Rome à demi subjuguée, et, à la distance de vingt milles, il remplit de fumée et de poussière les yeux des citoyens épouvantés. Ensuite, deux fois chassé de son camp, blessé deux fois, repoussé par mer et par terre jusque dans la Grèce, sa patrie, il nous laisse la paix et le repos; et telles sont les dépouilles de tant de nations opulentes, que Rome ne peut contenir les fruits de sa victoire. Jamais, en effet, jamais triomphe plus beau, plus magnifique, n'était entré dans ses murs. Jusqu'à ce jour, on n'avait vu que le bétail des Volsques, les troupeaux des Sabins, les chariots des Gaulois, les armes brisées des Samnites. Alors on remarquait comme captifs des Molosses, des Thessaliens, des Macédoniens, des guerriers du Bruttium, de l'Apulie, de la Lucanie; et, comme ornement de cette pompe, l'or, la pourpre, des statues; des tableaux, et ce qui faisait les délices de Tarente. Mais rien ne fut plus agréable au peuple romain que la vue de ces monstres qu'il avait tant redoutés, des éléphants chargés de leurs tours, et qui, loin d'être étrangers au sentiment de la captivité, suivaient, la tête baissée, les chevaux victorieux.
XIX. - Guerre contre les Picentins. - (An de Rome 485) - Toute l'Italie jouit bientôt de la paix; car, après Tarente, qui eût osé la rompre? Mais les Romains voulurent attaquer et poursuivre les alliés de leurs ennemis. Alors on dompta les Picentins, et on prit leur capitale, Asculum, sous le commandement de Sempronius, qui, ayant senti trembler le champ de bataille pendant l'action, apaisa la déesse Tellus par la promesse d'un temple.
XX. - Guerre contre les Sallentins. - (An de Rome 486). A la soumission des Picentins succéda celle des Sallentins et de Brundusium, capitale du pays, fameuse par son port; ce fut la conquête de Marcus Atilius. Dans cette guerre, la déesse des bergers, Palès, demanda un temple pour prix de la victoire.
XXI. - Guerre contre les Volsiniens. (An de Rome 488). - Le dernier des peuples de l'Italie qui se rangea sous notre domination fut les Volsiniens, les plus riches des Etrusques. Ils implorèrent le secours de Rome contre leurs anciens esclaves qui, tournant contre leurs maîtres la liberté qu'ils en avaient reçue, s'étaient arrogé le pouvoir, et dominaient dans la république. Mais ils furent châtiés par notre général, Fabius Gurgès.
XXII. - Des séditions. - C'est là le second âge et comme l'adolescence du peuple romain ; il était alors dans toute sa force, et l'on voyait en lui la fleur d'un ardent et impétueux courage. Il conservait encore quelque chose de la rudesse des pâtres; il respirait une sorte de fierté indomptable. Aussi vit-on l'armée de Postumius, frustrée du butin qu'il lui avait promis, se révolter dans son camp et lapider son général; celle d'Appius Claudius ne pas vouloir vaincre quand elle le pouvait ; et la plus grande partie du peuple, soulevée par Voleron, refuser de s'enrôler, et briser les faisceaux du consul. Aussi les plus illustres patriciens, pour s'être opposés à la volonté de la multitude, furent-ils punis par l'exil; témoin Coriolan, qui exigeait qu'on cultivât les terres, et qui, au reste, aurait cruellement vengé son injure par les armes, si, le voyant prêt à planter ses étendards sur les murs de Rome, sa mère Véturie ne l'eût désarmé par ses larmes: témoin Camille lui-même, soupçonné d'avoir fait entre le peuple et l'armée une injuste répartition du butin de Véies. Mais, meilleur citoyen que Coriolan, il alla languir dans la ville qu'il avait prise, et vengea bientôt des Gaulois ses concitoyens suppliants. Le peuple soutint aussi contre le sénat une lutte violente, injuste et funeste ; abandonnant ses foyers, il fit à sa patrie la menace de la changer en solitude et de l'ensevelir sous ses ruines.
XXIII. - Première sédition. - (An de Rome 259-260). - La première dissension civile eut pour motif la tyrannie des usuriers, qui faisaient battre leurs débiteurs comme des esclaves. Le peuple en armes se retira sur le mont sacré; et ce ne fut qu'avec peine, et après avoir obtenu des tribuns qu'il fut ramené par l'autorité de Ménénius Agrippa, homme éloquent et sage. Il reste, de sa harangue antique, l'apologue qui fut assez puissant pour rétablir la concorde: "Autrefois, dit-il, les membres du corps humain se séparèrent, se plaignant que; tandis qu'ils avaient tous des fonctions à remplir, l'estomac seul demeurât oisif. Devenus languissants par suite de cette séparation, ils tirent la paix quand ils eurent senti que, grâce au travail de l'estomac le sang, formé du suc des aliments, circulait dans leurs veines.
XXIV. - Deuxième sédition. - (An de Rome 502 - 504). - La licence du décemvirat alluma dans le sein même de Rome la seconde sédition. Dix des principaux citoyens avaient été choisis pour rédiger, d'après la volonté du peuple les lois apportées de la Grèce; déjà tout le droit était classé dans les douze tables; mais possédés comme d'une fureur royale, ils retenaient les faisceaux qu'on leur avait livrés. Plus audacieux que les autres, Appius en vint à un tel degré d'insolence, qu'il destinait à sa brutalité une jeune fille de condition libre, oubliant et Lucrèce et les rois et le Code de lois que lui-même avait composé. Voyant donc sa fille frappée par un jugement, et traînée en servitude, Virginius n'hésite pas; il la tue de sa main au milieu du Forum; et, faisant avancer ses compagnons d'armes avec leurs enseignes, du haut du mont Aventin il assiége les décemvirs, et précipite toute cette puissance dans les prisons et dans les fers.
XXV. - Troisième sédition. - (An de Rome 508). - La troisième sédition fut excitée par l'ambition des mariages et par la prétention des plébéiens, de s'allier aux patriciens; cette dissension éclata sur le mont Janicule, à l'instigation de Canuléius, tribun du peuple
XXVI. - Quatrième sédition. - (An de Rome 577-582). - La quatrième sédition eut sa source dans la passion des honneurs, les plébéiens voulant avoir part aux magistratures. Fabius Ambustus, père de deux filles, avait marié l'une à Sulpicius, d'origine patricienne, l'autre au plébéien Stolon. Celle-ci, entendant un jour dans la maison de sa soeur, le bruit des verges du licteur, inconnu dans la sienne, en ressentit une frayeur dont elle fut raillée par l'épouse de Sulpicius d'une manière assez piquante. Elle ne put supporter l'affront ; aussi son mari , parvenu au tribunat, arracha-t-il au sénat, malgré sa résistance, le partage des honneurs et des magistratures. Au reste, jusque dans ces séditions, le peuple roi est digne d'admiration. En effet, tantôt c'est pour la liberté, tantôt pour la pudeur , ici pour la noblesse de la naissance, là pour la majeste et l'éclat des honneurs, qu'il a combattu tour à tour : mais, au milieu de toutes ces luttes, il ne fut de nul intérêt gardien plus vigilant que de la liberté; et aucune largesse offerte pour prix de cette liberté ne put le corrompre, bien que du sein d'une multitude nombreuse et toujours croissante, il apparût de temps à autre des citoyens dangereux. Spurius Cassius et Mélius, soupçonnés d'aspirer à la royauté, l'un par la proposition de la loi Agraire, l'autre par ses libéralités, furent punis par une mort prompte. Ce fut son père même qui fit subir à Spurius son supplice; Mélius fut tué au milieu du Forum par le maître de la cavalerie, Servilius Ahala, d'après l'ordre du dictateur Quinctius. Quant à Manlius, le sauveur du Capitole, qui, pour avoir libéré la plupart des débiteurs, affectait une hauteur contraire à l'égalité, il fut précipité de cette forteresse qu'il avait défendue. Tel fut le peuple romain au dedans et au dehors, dans la paix et dans la guerre, pendant la fougue de son adolescence , c'est-à-dire dans le second âge de l'empire, intervalle durant lequel il soumit par ses armes toute l'Italie, depuis les Alpes jusqu'au détroit.

LIVRE DEUXIEME
I. - Exorde.- L'Italie est domptée et soumise. Le peuple romain, âgé d'environ cinq cents ans, est arrivé au complet développement de son adolescence. On trouve alors, véritablement en lui la vigueur et la virilité dans toute la force du terme, et il commence à être assez puissant pour se mesurer avec l'univers. Ainsi, par une étonnante et incroyable destinée, ce peuple qui lutta près de cinq cents ans en son pays, - tant il avait été difficile de donner un maître à l'Italie, - ne mit ensuite que deux cents ans pour promener en Afrique, en Europe, en Asie, enfin dans le monde entier, la guerre et la victoire.
II. - Première Guerre Punique.- Vainqueur de l'Italie, le peuple romain s'était donc avancé jusqu'au détroit de Sicile. Semblable à un incendie dont les flammes, après avoir ravagé les forêts sur leur passage, sont coupées par la rencontre d'un cours d'eau, il s'arrêta un moment. Mais bientôt il aperçoit tout près de lui une très riche proie, qui semblait avoir été séparée et comme arrachée de son Italie ; il brûle d'un tel désir de la posséder que, ne pouvant la réunir à l'Italie ni par une digue ni par des ponts, il décida d'avoir recours aux armes et à la guerre pour la réunir et la rendre à son continent. Voici d'ailleurs que d'eux-mêmes les destins lui ouvrent la route : l'occasion se présenta, lorsque la tyrannie des Carthaginois provoqua les plaintes de Messine, une ville de Sicile, leur alliée. Tout autant que les Romains, les Carthaginois convoitaient la Sicile ; et au même moment, avec une ambition et des forces égales, ces deux peuples aspiraient à la domination du monde. Rome prit donc les armes, sous prétexte de secourir ses alliés, mais en réalité parce qu'elle était attirée par cette proie. Bien qu'effrayé par la nouveauté de l'entreprise, ce peuple grossier, ce peuple de bergers, qui n'avait jamais quitté le continent, montra, - tant le courage est une source de confiance ! - que peu importe à des braves de combattre à cheval ou sur des navires, sur terre ou sur mer. Sous le consulat d'Appius Claudius, il franchit pour la première fois ce détroit qui devait sa sinistre réputation à des monstres fabuleux et à la violente agitation de ses eaux. Mais il fut si peu effrayé qu'il vit dans cette violence même des eaux déchaînées une faveur de la fortune. Tout de suite, sans perdre un instant, il bat Hiéron de Syracuse avec une telle rapidité que, de son propre aveu, ce prince fut vaincu avant d'avoir vu l'ennemi. Sous le consulat de Duillius et de Cornélius, il osa même combattre sur mer. La rapidité avec laquelle il équipa alors une flotte fut à elle seule un présage de victoire. Moins de soixante jours après qu'on eut abattu les arbres, une flotte de cent soixante navires était à l'ancre. On pouvait croire qu'elle n'avait pas été façonnée par la main de l'homme, mais que la faveur des dieux avait changé et métamorphosé les arbres en navires. Le combat offrit, à la vérité, un spectacle merveilleux. Les navires rapides de l'ennemi, qui semblaient voler sur les eaux, furent arrêtés par les nôtres, pesants et lents. Ses marins ne purent tirer parti de leur habileté à briser les rames et à échapper par la fuite aux coups d'éperons. On jeta sur l'ennemi ces mains de fer, et ces solides machines dont il s'était tant moqué avant la bataille, et il fut obligé de combattre comme sur la terre ferme. Vainqueurs auprès des îles Lipari, après avoir coulé ou mis en fuite la flotte ennemie, les Romains célébrèrent, pour la première fois, un triomphe maritime, qui est resté célèbre. Quelle ne fut pas leur joie ! Duillius, qui commandait la flotte, ne se contenta pas d'un seul jour de triomphe. Il voulut pendant toute sa vie être précédé, lorsqu'il reviendrait de manger, de la lueur des flambeaux et du son des flûtes, comme s'il eût triomphé tous les jours. La magnifique victoire de Duillius fit paraître légère l'échec de l'autre consul, Cornélius Asina, victime d'une surprise. Mandé par l'ennemi sous le faux prétexte d'une entrevue, il tomba dans un piège, fournissant ainsi la preuve de la perfidie punique. Le dictateur Calatinus chassa presque toutes les garnisons carthaginoises, notamment celles d'Agrigente, de Drépane, de Panorme, d'Eryx et de Lilybée. Une seule fois, nous éprouvâmes une crainte sérieuse, près du bois de Camérinum, mais le courage remarquable du tribun militaire Calpurnius Flamma nous tira du danger. Avec une troupe d'élite de trois cents hommes, il s'empara d'une hauteur occupée par l'ennemi et retint l'adversaire assez longtemps pour permettre à toute notre armée d'échapper. Cet éclatant succès lui valut une gloire égale à celle des Thermopyles et de Léonidas. La gloire de notre concitoyen fut même plus grande, car il survécut à cet exploit, s'il n'écrivit rien avec son sang. Alors que la Sicile était déjà une province de la banlieue de Rome, la guerre s'étendit plus loin, et le consul Lucius Cornélius Scipion passa en Sardaigne, puis dans la Corse, une île qui s'y rattache. Par la destruction d'Olbia dans la première, d'Aléria dans la seconde, il épouvanta les habitants, et partout, sur terre et sur mer, il chassa si bien les Carthaginois qu'il ne restait plus à vaincre que l'Afrique elle-même. Sous la conduite de Marcus Atilius Régulus, déjà la guerre faisait voile vers l'Afrique. Plus d'un Romain, au seul nom de la guerre punique, avait pâli de terreur. Le tribun Nautius augmentait encore cette crainte. Le général en chef le menaça de la hache, s'il n'obéissait pas, et la crainte de la mort lui donna la hardiesse de s'embarquer. Bientôt ensuite les vents et les rames hâtèrent la marche de la flotte, et l'arrivée de l'ennemi épouvanta si fort les Carthaginois que Carthage faillit être prise les portes ouvertes. La guerre commença par la prise de Clipea, la première ville qui se présente sur le rivage carthaginois, et qui constitue une sorte de citadelle et d'observatoire. Elle fut dévastée avec plus de trois cents autres forteresses. En même temps que les hommes, on combattit aussi des monstres. Né, semblait-il, pour venger l'Afrique, un serpent d'une taille prodigieuse désola notre camp installé sur les bords du Bagrada. Mais partout victorieux, Régulus avait répandu au loin la terreur de son nom ; il avait tué ou gardait prisonniers une grande quantité de soldats avec leurs chefs eux-mêmes ; une flotte chargée d'un immense butin et lourde de la matière d'un triomphe avait déjà été envoyée à Rome, et Carthage elle-même, le foyer de la guerre, se voyait assiégée et pressée par un ennemi campé à ses portes. Ici la fortune nous abandonna un moment afin d'accroître les preuves du courage romain, dont la grandeur se révèle d'ordinaire dans les épreuves. Les ennemis appelèrent à leur secours des étrangers ; Sparte leur envoya Xanthippe, et nous fûmes vaincus par ce très habile capitaine. Les Romains subirent une honteuse défaite, dont ils ne connaissaient pas encore d'exemple : leur intrépide général tomba vivant aux mains de l'ennemi. Mais il ne se laissa pas abattre par une telle infortune. Il ne se laissa ébranler ni par les prisons de Carthage, ni par l'ambassade dont on le chargea. Il combattit en effet les propositions que l'ennemi lui avait confiées et conseilla au sénat de ne pas conclure la paix et de ne pas accepter l'échange des prisonniers. Mais ni son retour volontaire chez les ennemis, ni les épouvantables tortures qu'il endura dans sa prison ou sur la croix ne rabaissèrent sa grandeur. Que dis-je ? toutes ces épreuves le firent admirer davantage. Ne fut-il pas victorieux de ses vainqueurs, et si Carthage ne fut pas vaincue, ne triompha-t-il pas de la fortune ? Le peuple romain, de son côté, mit plus d'ardeur et d'acharnement à venger Régulus qu'à obtenir la victoire. Sous le consulat de Métellus, les Carthaginois relevèrent la tête et reportèrent la guerre en Sicile. Près de Panorme, Métellus en fit un tel carnage que désormais ils renoncèrent à toute prétention sur cette île. L'importance considérable de cette victoire fut attestée par la capture d'une centaine d'éléphants. C'eût été un gros butin, même si ce troupeau avait été pris non à la guerre, mais à la chasse. Le consul Appius Claudius fut vaincu moins par les ennemis que par les dieux eux-mêmes, dont il avait méprisé les auspices ; sa flotte fut tout de suite engloutie à l'endroit même où il avait fait jeter les poulets sacrés, sous prétexte qu'ils lui défendaient d'engager la bataille. Le consul Marcus Fabius Butéon défit sur la mer d'Afrique, près d'Egimure, une flotte ennemie qui faisait alors voile vers l'Italie. Quel beau triomphe la tempête nous ravit, lorsque notre flotte, chargée d'un riche butin, fut poussée par des vents contraires, et remplit des débris de son naufrage l'Afrique, les Syrtes et les rivages de toutes les îles situées entre ces deux régions ! Le désastre fut grand, mais il ne fut pas sans quelque gloire pour le peuple-roi. La tempête lui déroba la victoire, et son triomphe fut anéanti par un naufrage. Et cependant, lorsque le butin fait sur les Carthaginois flottait sur la mer devant tous les promontoires et toutes les îles, c'était encore un triomphe pour le peuple romain. Le consul Lutatius Catulus mit enfin un terme à la guerre près des îles Egates. Ce fut la plus grande des batailles navales. Il y avait là, en effet, une flotte lourdement chargée de vivres, de soldats, de machines et d'armes, qui semblait porter Carthage tout entière ; et ce fut là sa perte. La flotte romaine rapide, légère, agile, ressemblait en quelque sorte à une armée dans un camp. On eût dit un combat de cavalerie dans lequel les rames remplaçaient les rênes, et les coups que portaient çà et là les mobiles éperons donnaient l'impression qu'ils étaient vivants. Ainsi les vaisseaux ennemis furent en peu de temps mis en pièces et couvrirent de leur naufrage toute la mer qui s'étend entre la Sicile et la Sardaigne. Enfin cette victoire fut si complète qu'il ne fut plus question de détruire les murailles ennemies. Il parut superflu d'aller renverser une citadelle et des remparts, puisque Carthage avait déjà été détruite sur mer.
III. -Guerre contre les Ligures.-. La guerre punique achevée, il y eut un très court répit, comme pour reprendre haleine. Afin de donner la preuve que c'était bien la paix et qu'elle déposait sincèrement les armes, Rome, pour la première fois depuis Numa, ferma le temple de Janus ; mais elle le rouvrit tout à coup, aussitôt après. Car déjà les Ligures, les Gaulois Insubres, ainsi que les Illyriens nous harcelaient. Ces peuples situés au pied des Alpes, c'est-à-dire à l'entrée même des gorges de l'Italie, semblaient continuellement excités par un dieu qui ne voulait pas laisser rouiller ni moisir nos armes. Bref, ces deux ennemis que nous rencontrions chaque jour et presque sur notre territoire se chargeaient de l'instruction militaire de nos jeunes soldats et tous deux furent pour ainsi dire la pierre sur laquelle le peuple romain aiguisait le fer de son courage. Les Ligures, qui habitent immédiatement au pied des Alpes, entre le Var et le Macra, et se dissimulent au milieu de fourrés broussailleux, étaient encore plus difficiles à trouver qu'à vaincre. Protégé par la nature du pays et par sa rapidité à fuir, ce peuple infatigable et agile se livrait, suivant les occasions, au brigandage plus qu'à la guerre. Nous éprouvâmes de longues et nombreuses difficultés à atteindre les Saluviens, les Décéates, les Oxubiens, les Euburiates, les Ingaunes. Enfin Fulvius entoura leurs retraites d'un cercle de feu, Bébius les fit descendre en plaine, et Postumius les désarma si bien qu'il leur laissa à peine du fer pour cultiver la terre.
IV. -Guerre contre les Gaulois.- Les Gaulois Insubres et les peuples voisins des Alpes avaient un naturel de bêtes sauvages et une taille plus qu'humaine. Mais l'expérience a montré que si au premier choc, ils sont supérieurs à des hommes, au second ils sont inférieurs à des femmes. Leurs corps, nourris sous le climat humide des Alpes, présentent certaines ressemblances avec les neiges du pays. A peine échauffés par le combat, ils sont immédiatement trempés de sueur, et au moindre mouvement, ils fondent comme la neige sous les rayons du soleil. Ils avaient souvent fait le serment, qu'ils renouvelèrent sous leur chef Britomare, de ne point détacher leurs baudriers avant d'être montés au Capitole. C'est ce qui advint. Emilius, leur vainqueur, les leur enleva en effet au Capitole. Bientôt après sous la conduite d'Arioviste, ils vouèrent à leur dieu Mars un collier qui serait pris sur les dépouilles de nos soldats. Jupiter s'empara de ce voeu, car c'est avec les colliers des Gaulois que Flaminius éleva un trophée d'or à Jupiter. Sous leur roi Viridomare, ils avaient promis à Vulcain les armes romaines. Leur voeu se réalisa d'une manière toute différente. Leur roi fut tué et Marcellus suspendit dans le temple de Jupiter Férétrien les dépouilles opimes, alors offertes pour la troisième fois depuis Romulus, notre ancêtre.
V. -Guerre contre les Illyriens.- Les Illyriens ou Liburniens vivent au pied des dernières pentes des Alpes, entre les fleuves Arsia et Titius, et leur territoire s'étend très loin sur toute la côte de l'Adriatique. Gouvernés par une reine, Teutana, ces peuples, non contents de leurs brigandages, ajoutèrent le crime à leurs excès. Des ambassadeurs romains leur réclamant justice pour leurs méfaits, ils les massacrent, non pas avec l'épée, mais à coups de hache, comme des victimes ; les commandants de nos navires sont brûlés vifs, et, pour comble d'indignité, par l'ordre d'une femme. C'est pourquoi notre général Cnéus Fulvius Centimalus soumit le pays tout entier. En faisant périr sous la hache les premiers de leurs citoyens, nous vengeâmes les mânes de nos ambassadeurs.
VI. -Seconde Guerre Punique.- Depuis la première guerre punique, il y avait eu à peine quatre années de repos, lorsqu'éclata la seconde guerre, moins longue il est vrai, elle ne dura pas plus de dix-huit ans, mais bien plus terrible et marquée par des désastres si affreux, que si l'on compare les pertes des deux peuples, le peuple vainqueur paraîtra plutôt le vaincu. Il était particulièrement douloureux pour un peuple illustre d'avoir perdu l'empire de la mer, d'avoir été dépouillé de ses îles, et de payer des tributs au lieu de continuer à en imposer. Aussi Annibal encore enfant avait-il, sur l'autel, juré à son père de venger sa patrie ; et il n'attendait que l'occasion. Pour faire naître un motif de guerre, il choisit Sagonte, antique et opulente ville d'Espagne, illustre mais triste monument de fidélité aux Romains. Un traité commun aux deux peuples lui avait assuré son indépendance. Annibal, cherchant de nouveaux prétextes de troubles, la détruisit de ses propres mains et par celles de ses habitants, afin de s'ouvrir par la rupture du traité la route de l'Italie. Les Romains ont le plus grand respect pour les traités. Apprenant qu'une ville alliée est assiégée, ils n'oublient pas qu'ils ont également conclu un traité avec les Carthaginois. Aussi ne courent-ils pas tout de suite aux armes, mais ils aiment mieux exposer d'abord leurs plaintes en se conformant aux usages établis. Cependant depuis neuf mois déjà les Sagontins étaient épuisés par la faim, les machines et les combats ; leur fidélité se changeant finalement en frénésie, ils élèvent sur la place publique un immense bûcher, et s'y font périr par le fer et par le feu, avec les leurs et toutes leurs richesses. Les Romains demandent justice d'Hannibal, responsable d'une telle calamité. Voyant les Carthaginois user de détours : "Que tardez-vous ? dit Fabius, le chef de l'ambassade ; dans le pli de cette toge, je porte la guerre et la paix ; laquelle choisissez-vous ?" - "La guerre !" répondent-ils à grands cris. - "Voici donc la guerre." dit Fabius. Et ayant secoué en plein sénat le devant de sa robe, il le laissa retomber non sans terrifier les spectateurs, comme s'il portait réellement la guerre dans ce pli. L'issue de la guerre répondit à ces débuts. Comme si de pareils sacrifices expiatoires avaient été réclamés par les dernières imprécations des Sagontins au milieu du massacre et de l'embrasement fameux de la cité, leurs mânes furent vengés par la dévastation de l'Italie, la captivité de l'Afrique, la mort des chefs et des rois qui soutinrent cette guerre. Une fois que l'Espagne eut vu se lever la violente tempête que fut cette funeste et sanglante guerre punique, dès que la foudre depuis longtemps destinée aux Romains eut été forgée dans l'incendie de Sagonte, aussitôt, emporté par une force impétueuse, l'orage déchira les flancs des Alpes, et descendit en Italie du haut de ces neiges d'une fabuleuse altitude, comme s'il tombait du ciel. Les premiers grondements de l'ouragan s'entendirent entre le Pô et le Tessin, et le fracas fut tout de suite épouvantable. L'armée de Scipion fut mise en déroute. Notre général, blessé, serait lui-même tombé aux mains de l'ennemi, si son fils, encore vêtu de la prétexte, ne l'avait secouru et arraché à la mort même. Ce jeune homme, c'est le futur Scipion, qui grandit alors pour la ruine de l'Afrique et qui tirera son nom des malheurs de ce pays. Au Tessin succède la Trébie. Ici, la deuxième tourmente de la guerre punique s'abat sur le consul Sempronius. Les ennemis profitèrent alors très habilement d'une journée froide et neigeuse. Chose étrange ! Après s'être d'abord chauffés au feu, puis frottés d'huile, ces hommes qui venaient du soleil du midi nous vainquirent par notre hiver même. Le lac Trasimène vit tomber la troisième foudre d'Hannibal sur les troupes de Flaminius. Ce fut un nouvel artifice de la ruse carthaginoise. Dissimulée par le brouillard du lac et les broussailles des marais, sa cavalerie attaqua tout à coup, par derrière, nos soldats occupés à se battre. Mais nous ne pouvons nous plaindre des dieux. La défaite qui menaçait un chef téméraire avait été annoncée par des essaims d'abeilles qui se posèrent sur nos enseignes, par les aigles qui refusèrent d'avancer et par un violent tremblement de terre qu'on ressentit dès le commencement de la bataille. Peut-être d'ailleurs cet ébranlement du sol était-il dû aux évolutions des cavaliers et des fantassins et aux chocs violents des armes. La quatrième blessure (celle qui faillit être mortelle à notre empire) fut reçue à Cannes, un village d'Apulie jusque-là inconnu, que la grandeur de notre désastre tira de l'obscurité et qui dut sa célébrité au massacre de soixante mille Romains. Là tout s'entendit pour la perte de notre malheureuse armée : le général, la terre, le ciel, le jour, la nature entière. Annibal ne se contenta point d'envoyer de faux transfuges qui massacrèrent ensuite nos combattants par derrière. Ce rusé général observa la nature des lieux dans ces vastes plaines et remarqua que le soleil y était très vif, la poussière très abondante et que l'Eurus y soufflait à des intervalles toujours réguliers. Il rangea son armée de telle manière que les Romains devaient lutter contre tous ces désavantages ; quant à lui, comme s'il eût disposé de l'appui du ciel même, il combattait avec l'aide du vent, de la poussière et du soleil. Deux très grandes armées furent ainsi massacrées, l'ennemi se rassasia de carnage, et il fallut qu'Hannibal dît à ses soldats : "Ne frappez plus !" L'un de nos deux généraux échappa à la mort, l'autre fut tué ; on ne sait lequel montra la plus grande âme. Paulus eut honte de vivre, Varron ne désespéra pas. Rien ne prouva mieux notre défaite que l'Aufide plusieurs jours ensanglanté, le pont de cadavres élevé sur le torrent de Vergelles par l'ordre d'Hannibal, l'envoi à Carthage de deux boisseaux d'anneaux, l'étrange mesure qui servit à évaluer les pertes de nos chevaliers. Cette journée aurait été sans aucun doute la dernière de Rome, et moins de cinq jours après Annibal aurait pu manger au Capitole, si, selon le mot attribué au Carthaginois Maharbal, fils d'Himilcon, il avait su profiter de la victoire aussi bien qu'il savait vaincre, Mais, comme on le répète souvent, le destin d'une ville appelée à gouverner le monde, ou le mauvais génie d'Hannibal et les dieux ennemis de Carthage l'entraînèrent dans une autre direction. Alors qu'il pouvait exploiter sa victoire, il aima mieux en jouir, et, laissant Rome, il parcourut la Campanie et la région de Tarente. Son ardeur et celle de son armée ne tardèrent pas à s'y affaiblir, et l'on a dit avec raison que Capoue fut la défaite de Cannes d'Hannibal. Qui le croirait ? Cet adversaire que les Alpes n'avaient pu vaincre et que nos armes n'avaient pu dompter se laissa subjuguer par le soleil de la Campanie et les sources tièdes de Baïes. Cependant les Romains respirent et sortent pour ainsi dire du tombeau. Les armes manquaient, on arrache celles des temples. Il n'y avait plus de soldats, on affranchit des esclaves, et on les enrôle. Le trésor était vide ; les sénateurs s'empressent d'offrir leurs biens à l'Etat et ne gardent comme or que celui des bulles et d'un seul anneau. Les chevaliers suivent leur exemple, et les tribus imitent les chevaliers. Enfin les registres et la main des greffiers suffirent à peine, lorsque sous le consulat de Lévinus et de Marcellus, les particuliers apportèrent leurs richesses au trésor public. Bien plus, dans l'élection des magistrats, quelle ne fut pas la sagesse des centuries, lorsque les plus jeunes demandèrent conseil aux anciens pour le choix des consuls. C'est que pour combattre un ennemi tant de fois victorieux et si rusé, le courage, ne suffisait pas ; il fallait aussi utiliser tous les conseils dont on disposait. Le premier espoir de l'empire revenant à lui et pour ainsi dire recouvrant la vie, fut Fabius, qui trouva une méthode nouvelle pour triompher d'Hannibal : c'était de refuser la bataille. Cela lui valut le surnom nouveau et salutaire à l'Etat de Temporisateur ; et cela lui valut aussi d'être appelé par le peuple le Bouclier de l'Empire. C'est ainsi que par tout le Samnium, dans les bois de Falerne et de Gaurus, il épuisa si bien Annibal que sa lenteur consuma celui que le courage ne pouvait briser. Puis l'armée de Claudius Marcellus osa même en venir aux mains avec lui. Elle l'attaqua, lui infligea une défaite dans son pays de Campanie et lui fit lever le siège de Nole. A son tour, Sempronius Gracchus osa le suivre à travers la Lucanie et le serrer de près dans sa retraite. Et cependant - ô honte ! - il n'avait qu'une armée d'esclaves, car telle était l'extrémité où nous avaient réduits nos malheurs. Mais ces esclaves qui avaient reçu des Romains la liberté les sauvèrent de la servitude. Etonnante confiance au milieu de tant de malheurs, ou plutôt extraordinaire courage et force d'âme du peuple romain ! La situation était si critique, si inquiétante, qu'il pouvait craindre pour son pays d'Italie. Il osa cependant tourner ses regards vers d'autres contrées. L'ennemi le prenant à la gorge parcourait la Campanie et l'Apulie, et faisait du centre de l'Italie une seconde Afrique. Rome non seulement lui tenait tête, mais au même moment, en Sicile, en Sardaigne, en Espagne, de tous côtés dans le monde elle envoyait des armées. On confia à Marcellus la conquête de la Sicile. La résistance ne fut pas longue ; toute l'île, en effet, fut vaincue dans une seule ville. Bien que défendue par le génie d'Archimède, sa capitale, la grande et célèbre Syracuse, jusqu'alors invincible, finit par céder. Son triple mur, ses trois citadelles, son beau port de marbre et la fontaine bien connue d'Aréthuse, ne lui servirent qu'à être épargnée par son vainqueur qui admirait sa beauté. Gracchus s'empara de la Sardaigne. Le naturel farouche de ses habitants, ni la grandeur prodigieuse de ses montagnes insensées - tel est en effet leur nom - ne purent la sauver. On ravagea ses villes, et la première de ses villes, Caralis, afin de dompter au moins par le regret de voir sa patrie détruite, ce peuple opiniâtre, qui méprisait la mort. Envoyés en Espagne, Cneus et Publius Scipion avaient arraché presque tout le pays aux Carthaginois. Mais victimes des pièges de la perfidie punique, ils l'avaient reperdu, après avoir néanmoins brisé la puissance carthaginoise en de nombreux combats. Les Carthaginois leur dressèrent des embûches : l'un d'eux fut tué au moment où il traçait son camp, l'autre, qui s'était réfugié dans une tour, y périt au milieu des flammes. Scipion fut donc envoyé avec une armée pour venger son père et son oncle ; déjà, les destins avaient décidé qu'il tirerait de l'Afrique un nom illustre. Cette belliqueuse Espagne, célèbre par ses guerriers et ses combats, cette pépinière de soldats ennemis, cette province qui avait fait l'éducation d'Hannibal dès ses premières années, il la reconquit tout entière - chose à peine croyable ! - depuis les Pyrénées jusqu'aux colonnes d'Hercule et à l'Océan, et on ne saurait dire si ce fut avec plus de rapidité ou de bonheur. La conquête fut si prompte que quatre années y suffirent ; quant à sa facilité, une seule ville en fournit la preuve. La Carthage d'Espagne fut assiégée et prise le même jour, et la facilité de ce succès fut le présage de la victoire qu'il devait remporter en Afrique. Il est cependant certain que la soumission de la province est due surtout à l'extraordinaire continence de notre général. Ayant parmi ses prisonniers des garçons et des jeunes filles d'une remarquable beauté, il les rendit aux barbares, et ne permit même pas qu'on les fît venir en sa présence, de peur de paraître avoir effleuré seulement des yeux leur pureté virginale. Ainsi se comportaient les armées du peuple romain en différents pays éloignés. Cependant Hannibal restait attaché aux entrailles de l'Italie et on ne pouvait l'en arracher. Bien des peuples étaient passés à l'ennemi, et ainsi ce chef si redoutable se servait contre les Romains des forces mêmes de l'Italie. Nous l'avions cependant déjà chassé de bien des villes et de bien des pays ; déjà Tarente nous était revenue ; déjà Capoue, le séjour et la seconde patrie d'Hannibal, allait tomber entre nos mains, Capoue, dont la perte causa tant de douleur au général carthaginois, qu'il tourna toutes ses forces contre Rome. O peuple digne de l'empire du monde, digne de la sympathie et de l'admiration de tous les hommes et de tous les dieux ! Les pires angoisses l'étreignent, mais il ne renonce pas à son entreprise, et malgré ses craintes pour sa capitale elle-même, il n'abandonne point Capoue. Il y laisse une partie de son armée sous les ordres du consul Appius, pendant que l'autre partie suit Flaccus à Rome ; et ainsi le peuple romain combattait loin d'elle et près d'elle en même temps. Ne nous étonnons donc point si, au moment où Annibal levait son camp à trois milles de Rome, les dieux, oui les dieux - je l'avouerai sans honte - l'arrêtèrent une seconde fois. A chacun de ses mouvements, il tomba une si grande quantité de pluie, il s'éleva de si violentes tempêtes, qu'il semblait qu'une force divine écartait l'ennemi non du ciel, mais des murs mêmes de la ville et du Capitole. Alors il prit la fuite, et s'en alla se réfugier tout au fond de l'Italie, abandonnant une ville devant laquelle il avait failli se prosterner. Un fait, insignifiant en lui-même, suffit pour prouver la grandeur d'âme du peuple romain. Durant les jours mêmes où Annibal assiégeait la ville, le champ où il campait fut mis en vente à Rome, et, proposé aux enchères, il trouva un acheteur. Annibal de son côté voulut feindre la même confiance et mit aux enchères les comptoirs des banquiers de Rome, mais aucun acquéreur ne se présenta. C'était, on le voit, un nouveau présage des destins. Mais un tel courage, une telle faveur des dieux allaient être inutiles. Asdrubal, frère d'Hannibal, arrivait d'Espagne avec une nouvelle armée, des forces nouvelles, et l'appareil d'une nouvelle guerre. Nous étions perdus sans aucun doute, si ce général avait fait sa jonction avec son frère. Mais à peine était-il descendu des Alpes, qu'au moment où il s'apprêtait à camper près du Métaure, il fut battu à son tour par les troupes réunies de Claudius Néron et de Livius Salinator. Néron contenait Annibal, alors refoulé tout au fond de l'Italie, Livius avait conduit son armée dans une direction tout opposée c'est-à-dire tout à fait à l'entrée même de l'Italie. Un très grand espace, l'Italie dans toute sa longueur, séparait les deux consuls. Comment purent-ils se concerter et réunir si rapidement leurs troupes pour tomber à l'improviste sur l'ennemi avec toutes leurs forces sans attirer l'attention d'Hannibal ? Il est difficile de le dire. Mais quand Annibal apprit la nouvelle et aperçut la tête de son frère qu'on avait jetée devant son camp : "Je reconnais, dit-il, l'infortune de Carthage" Ce fut le premier aveu arraché à cet homme, et comme un présage du destin imminent. On fut désormais certain qu'Hannibal, de son propre aveu, pouvait être vaincu. Mais tant de succès remplirent de confiance le peuple romain, et il avait surtout à coeur de vaincre un ennemi si redoutable dans son pays d'Afrique. Sous la conduite de Scipion, il tourna donc toutes ses forces vers l'Afrique même, et il entreprit d'imiter Annibal et de venger sur l'Afrique les malheurs de son pays d'Italie. Bonté divine ! Quelles troupes que celles d'Asdrubal ! Quels cavaliers que ceux de Syphax, roi de Numidie ! Il les vainquit cependant. Qu'ils étaient puissants et vastes les camps de ces deux généraux ! Il les incendia et les détruisit en une seule nuit. Bref, il n'est plus seulement à trois milles de Carthage ; il ébranle même les portes de la ville qu'il assiège ! Cette diversion arracha de l'Italie Annibal qui s'y attachait de tout son poids. Il n'y eut point sous l'empire romain un plus grand jour que celui où les deux généraux les plus grands de tous ceux qui ont existé avant ou depuis cette guerre, et vainqueurs, l'un de l'Italie, l'autre de l'Espagne, déployèrent leurs enseignes rivales, et rangèrent leurs armées face à face. Ils eurent cependant d'abord une entrevue pour discuter les conditions de la paix. Ils demeurèrent longtemps immobiles, comme paralysés par une admiration mutuelle. Mais la paix ne put être conclue et les trompettes donnèrent le signal. Il est reconnu de l'aveu des deux chefs, qu'on n'aurait pas pu mieux disposer une armée ni combattre avec plus d'ardeur. Scipion le proclama pour l'armée d'Hannibal et Annibal pour l'armée de Scipion. Cependant Annibal succomba ; l'Afrique fut le prix de la victoire, et tout de suite après l'univers eut le sort de l'Afrique.
VII. -Première Guerre de Macédoine.- Carthage vaincue, la défaite ne fut plus une honte pour personne. Tout de suite après, la Macédoine, la Grèce, la Syrie et toutes les autres nations furent entraînées, si j'ose dire, par l'irrésistible torrent de la fortune ; mais les premiers de tous furent les Macédoniens qui avaient autrefois aspiré à l'empire du monde. Aussi bien que Philippe fût alors leur roi, les Romains pensaient-ils cependant combattre un autre Alexandre. La guerre de Macédoine dut son importance au nom de son peuple, plus qu'à la résistance dont il fit preuve. Elle eut pour première cause le traité par lequel Philippe longtemps auparavant, avait conclu une alliance avec Hannibal, alors maître de l'Italie. Ce motif devint plus puissant, lorsque les Athéniens implorèrent notre secours contre les violences du roi, qui, abusant des droits du vainqueur, s'attaquait aux temples, aux autels et même aux tombeaux. Le sénat décida de porter assistance à d'aussi illustres suppliants. Déjà les rois et les princes, les peuples et les nations invoquaient l'appui de notre ville. Pour la première fois, sous le consulat de Lévinus la flotte romaine entra dans la mer d'Ionie, et parcourut tout le rivage de la Grèce comme un cortège triomphal. Elle étalait les dépouilles de la Sicile, de la Sardaigne ; de l'Espagne, de l'Afrique, et un laurier poussé sur la poupe du navire amiral constituait une promesse certaine de victoire. Nous reçûmes le concours spontané d'Attale, roi de Pergame, et celui des Rhodiens, peuple de marins dont la flotte battait l'ennemi sur mer, tandis que les cavaliers et les fantassins du consul le battaient partout sur le continent. Philippe fut deux fois vaincu, deux fois mis en fuite, deux fois dépouillé de son camp. Mais rien n'effraya plus les Macédoniens que le seul aspect de leurs blessures. Produites non point par des traits, ni par des flèches ou de faibles armes grecques mais par d'énormes javelots et de non moins grandes épées, elles étaient plusieurs fois mortelles. Sous la conduite de Flamininus, nous franchîmes donc les montagnes jusqu'alors inaccessibles de Chaonie, l'Aous qui coule entre des rives escarpées, et les barrières mêmes de la Macédoine. C'était déjà remporter une victoire que d'y entrer. Car le roi n'osa plus jamais en venir aux mains: près des collines appelées Cynocéphales, un seul combat - et encore ce ne fut pas un véritable combat - suffit pour l'écraser. Le consul lui accorda la paix et lui laissa son royaume ; et pour ne plus avoir à craindre d'hostilités de ce côté, il soumit Thèbes, l'Eubée, et mit un terme aux agressions de Nabis, tyran de Lacédémone. Mais il rétablit la Grèce en son premier état, et lui permit de vivre sous ses propres lois et de jouir de son antique liberté. Quels cris de joie, quelles acclamations, lorsque tout à coup au théâtre de Némée, pendant les jeux quinquennaux, le héraut publia ce décret ! Quel concours d'applaudissements enthousiastes ! Que de fleurs ils répandirent aux pieds du consul ! Et toujours, toujours ils demandaient au héraut de répéter les mots qui proclamaient la liberté de l'Achaïe. Et cette décision du consul les charmait aussi agréablement que les sons les plus mélodieux de la flûte ou de la lyre.
VIII. - Guerre de Syrie contre le Roi Antiochus.- L'Asie succomba tout de suite après la Macédoine, et Antiochus après le roi Philippe. Il semble que ce fût un effet du hasard, ou plutôt un plan délibéré de la fortune, et que les occasions se présentaient d'elles-mêmes pour que notre domination qui s'était avancée d'Afrique en Europe, s'avançât aussi d'Europe en Asie, et pour que la suite même de nos victoires se réglât sur la disposition de l'univers. La renommée ne nous présenta jamais une guerre sous un jour plus redoutable. On se rappelait les Perses et l'Orient, Xerxès et Darius ; on entendait raconter qu'ils avaient percé des montagnes inaccessibles et couvert la mer de leurs navires. Ajoutez à tout cela l'effroi causé par les menaces célestes : l'Apollon de Cumes se couvrait continuellement de sueur. C'était, il est vrai l'effet de l'intérêt que le dieu portait à sa chère Asie et de la crainte qu'il éprouvait pour elle. Aucune région, assurément, n'est plus peuplée, plus riche, plus belliqueuse que la Syrie. Mais elle était tombée entre les mains d'un roi si lâche que le plus grand honneur que connut Antiochus fut d'avoir été vaincu par les Romains. Deux hommes poussèrent le roi à cette guerre : Thoas, chef des Etoliens, qui reprochait aux Romains de l'avoir mal payé de son concours militaire contre la Macédoine, et Annibal, qui, vaincu en Afrique et fugitif ne pouvait supporter la paix et cherchait par toute la terre des ennemis au peuple romain. Quels grands dangers nous aurions courus, si le roi s'était fié à ses conseils c'est-à-dire si ce malheureux Annibal avait disposé des forces de l'Asie ! Mais le roi, confiant en sa puissance et en son titre de roi se contenta de provoquer la guerre. L'Europe, déjà, appartenait incontestablement aux Romains par le droit de la guerre. Cependant, Antiochus réclamait à titre d'héritage la ville de Lysimachie, bâtie sur la côte thrace par ses ancêtres. Ce fut en quelque sorte l'astre qui souleva la tempête de la guerre d'Asie. Mais le plus puissant des rois se contenta d'avoir courageusement déclaré la guerre. Après avoir quitté l'Asie avec un fracas et un tumulte extraordinaires, après s'être emparé tout de suite des îles et des rivages de la Grèce il s'abandonna à l'oisiveté et au plaisir, comme s'il était déjà vainqueur. L'île d'Eubée n'est séparée du continent que par un petit détroit qui a été formé par le flux et le reflux de l'Euripe. C'est là qu'il fit dresser ses pavillons d'or et de soie, et en écoutant le murmure du détroit, il mariait au bruit des eaux les sons des flûtes et des lyres. Il se faisait apporter de tous côtés des roses, en plein milieu de l'hiver, et pour se donner un peu des airs de général, il faisait des levées de jeunes filles et de jeunes garçons. Un tel roi était déjà vaincu par sa mollesse. Le consul Acilius Glabrion, à la tête de l'armée romaine, alla pour l'attaquer dans son île. La seule nouvelle de son arrivée le força à quitter l'île aussitôt. Malgré sa fuite précipitée Antiochus fut rejoint auprès des Thermopyles, à l'endroit que la glorieuse mort de trois cents Lacédémoniens a rendu célèbre. Sans profiter de l'avantage de la position, il ne chercha même pas à résister, et dut abandonner à son adversaire la mer et la terre. Tout de suite, et sans perdre un instant, on marche vers la Syrie. La flotte royale était sous les ordres de Polyxénide et d'Hannibal, - car le roi ne pouvait même pas être spectateur d'un combat. Emilius Régillus, notre général, avec l'aide des marins rhodiens, la détruit entièrement. Qu'Athènes ne soit pas si fière : nous avons vaincu Xerxès dans Antiochus, avec Emilius nous avons égalé Thémistocle, Ephèse peut remplacer Salamine. Le consul Scipion, que son frère, le célèbre Africain, naguère vainqueur de Carthage, avait voulu accompagner en qualité de lieutenant, reçoit alors la mission d'en finir avec le roi. Déjà Antiochus nous avait abandonné toute la mer, mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Scipion campe près du Méandre et du Mont Sipyle. Le roi s'y trouvait déjà et ses forces et celles de ses alliés étaient prodigieuses. Il disposait de trois cent mille fantassins et d'un nombre proportionné de cavaliers et de chars armés de faux. En outre, des éléphants d'une taille gigantesque, tout brillants d'or, de pourpre, d'argent et de l'ivoire de leurs défenses, couvraient comme d'un rempart les deux ailes de son armée. Mais toutes ces troupes étaient embarrassées par leur propre nombre ; de plus, une pluie survenue tout à coup avait, par une chance extraordinaire, détérioré les arcs des Perses. Ce fut d'abord le désordre dans les rangs de l'ennemi, puis la fuite, et pour nous le triomphe. On accorda au roi vaincu et suppliant la paix et une partie de son royaume ; on le fit d'autant plus volontiers qu'il s'était laissé vaincre plus facilement.
IX. - Guerre d'Etolie.- A la guerre de Syrie succéda nécessairement celle d'Etolie. Antiochus vaincu, Rome poursuivait ceux qui avaient allumé la guerre d'Asie. Fulvius Nobilior fut donc chargé de nous venger. Immédiatement, il attaque avec ses machines les remparts d'Ambracie, la capitale du pays, et l'ancienne résidence de Pyrrhus. La ville se rendit aussitôt. Les Athéniens et les Rhodiens joignirent leurs prières à celles des Étoliens, et nous n'avions pas oublié que ce peuple avait été notre allié, nous décidâmes de lui pardonner. La guerre s'étendit cependant plus loin dans les pays voisins, sur tout le territoire de Céphallénie et de Zacynthe, et sur toutes les îles de cette mer, entre les monts Cerauniens et le cap Malée. Ce fut un complément de la guerre d'Etolie.
X. - Guerre d'Istrie.- Après les Etoliens, ce fut le tour des Istriens, qui les avaient aidés dans la guerre précédente. Les premiers combats furent favorables aux ennemis, mais ces succès furent la cause de leur perte. Ayant pris le camp de Cnéus Manlius, ils se jetèrent sur un riche butin. La plupart d'entre eux se livraient aux festins et à la joie, et l'ivresse leur avait fait oublier la situation et l'endroit où ils se trouvaient, lorsque Appius Pulcher les attaqua et leur fit rendre avec le sang et la vie une victoire mal assurée. Aepulon lui-même, leur roi, fut jeté sur un cheval, mais il était ivre, sa tête chancelait et il perdait l'équilibre. Sa surprise ne fut pas moindre que sa douleur, lorsqu'il apprit à son réveil qu'il était prisonnier.
XI. - Guerre contre les Gallo-Grecs.-La Galatie fut entraînée, elle aussi, dans l'écroulement de la Syrie. Ses habitants avaient-ils réellement aidé Antiochus, ou Manlius Vulso, désireux de triompher imagina-t-il cette intervention ? On ne sait. Toujours est-il qu'on lui refusa le triomphe malgré sa victoire, parce qu'il ne put faire approuver le motif de cette guerre. D'ailleurs, comme son nom seul l'indique, la nation gallo-grecque est une nation mélangée et abâtardie ; les restes des Gaulois qui, sous la conduite de Brennus, avaient dévasté la Grèce, se dirigèrent vers l'Orient et s'établirent au centre de l'Asie. Mais de même que les plantes dégénèrent quand on les change de terrain, le naturel sauvage de ce peuple fut amolli par le charme voluptueux de l'Asie. Aussi suffit-il de deux batailles pour les vaincre et les mettre en fuite, bien qu'à l'arrivée de l'ennemi ils eussent abandonné leurs demeures pour se retirer sur de très hautes montagnes. Les Tolostobogiens avaient occupé l'Olympe, les Tectosages, le Magaba. Chassés à coups de frondes et de flèches, les deux peuples se rendirent et conclurent une éternelle paix. On ne les enchaîna que par une sorte de miracle, car ils cherchaient à mordre et à briser leurs chaînes, et ils se présentaient mutuellement la gorge pour s'étrangler. La femme d'Orgiagonte, leur roi, déshonorée par un centurion, accomplit une action mémorable : elle s'échappa de sa prison, fit trancher la tête du soldat, et la porta à son mari.
XII. - Deuxième guerre de Macédoine.- Pendant que tant d'autres nations étaient entraînées par la chute de la Syrie, la Macédoine releva la tête. Le souvenir de son ancienne gloire excitait ce peuple si courageux, et à Philippe avait succédé son fils Persée, qui jugeait indigne de son peuple de considérer la Macédoine comme vaincue pour toujours par une seule défaite. Le soulèvement de la Macédoine fut beaucoup plus violent sous le règne de ce prince que sous celui de son père. Ils avaient, en effet, attiré les Thraces dans leur parti, et ainsi les forces des Thraces secondaient l'habileté macédonienne, tandis que la discipline macédonienne réglait la fougueuse intrépidité des Thraces. A ces avantages s'ajoutait la sagesse du roi qui, après avoir observé la configuration de son pays du haut de l'Hémus, plaça des troupes dans les lieux escarpés et entoura si bien la Macédoine d'un rempart d'armes et de fer qu'il semblait n'avoir laissé d'accès qu'à des ennemis qui viendraient du ciel. Cependant l'armée romaine, conduite par le consul Marcius Philippe, entra dans cette province. Ayant reconnu soigneusement les voies d'accès, elle franchit le marais d'Ascuris et les hauteurs de Perrhébie et pénétra dans ces contrées qui semblaient inaccessibles même aux oiseaux. Le roi se croyait en sécurité et ne craignait nullement une telle invasion. L'irruption soudaine de l'ennemi le surprit, et son épouvante fut telle qu'il fit jeter tout son argent à la mer de peur de le perdre et brûler sa flotte pour lui éviter l'incendie. Le consul Paulus, se heurtant à des garnisons plus importantes et plus nombreuses, surprit la Macédoine par d'autres passages. L'habileté de notre général lui inspira un heureux stratagème : il menaça le pays par un côté et l'envahit soudainement par un autre. Son arrivée inspira au roi une telle frayeur qu'il n'osa plus faire la guerre en personne, et en confia la conduite à ses généraux. Vaincu en son absence, il s'enfuit sur les mers, puis dans l'île de Samothrace, croyant trouver une sauvegarde dans la sainteté bien connue du lieu, comme si des temples et des autels eussent pu protéger celui qui n'avait pu l'être ni par ses montagnes ni par ses armées. Jamais roi ne conserva plus longtemps le sentiment de sa fortune passée. Réduit à supplier, et écrivant à notre général du temple où il s'était réfugié, il signa sa lettre en ajoutant à son nom son titre de roi. Jamais aussi personne n'eut pour un souverain prisonnier plus de déférence que Paulus. Lorsque le prince ennemi parut en sa présence, il le reçut dans sa tente, l'invita à sa table et conseilla à ses enfants de redouter la toute-puissance capricieuse de la fortune. Le triomphe sur la Macédoine fut l'un des plus beaux que célébra et que vit jamais le peuple romain : le spectacle dura trois jours. Le premier jour défilèrent les statues et les tableaux, le second, les armes et l'argent, le troisième les prisonniers et le roi lui-même, encore tout éperdu et comme frappé de stupeur par une catastrophe soudaine. Au reste, le peuple romain avait connu la joie de cette victoire bien longtemps avant de recevoir la lettre du vainqueur. Le jour même où Persée fut vaincu en Macédoine, Rome apprit la nouvelle. Deux jeunes cavaliers, avec des chevaux blancs, lavaient près du lac de Juturne la poussière et le sang dont ils étaient souillés. C'est eux qui annoncèrent notre victoire. On crut généralement que c'étaient Castor et Pollux, car ils étaient deux ; qu'ils avaient pris part au combat, car ils étaient couverts de sang, et qu'ils arrivaient de Macédoine, car ils étaient encore hors d'haleine.
XIII. - Seconde guerre d'Illyrie.- La guerre de Macédoine entraîna par contagion la guerre avec les Illyriens. Le roi Persée avait acheté leur concours militaire et les avait chargés de harceler par derrière l'armée romaine. Le préteur Anicius les soumit rapidement. La destruction de Scodra, capitale du pays, suffit pour les amener à se rendre aussitôt. Bref, cette guerre fut achevée avant que Rome sût qu'elle était entreprise.
XIV. - Troisième guerre de Macédoine.- Par une sorte de fatalité, comme si les Carthaginois et les Macédoniens s'étaient entendus pour se faire battre encore une troisième fois, ces deux peuples reprirent en même temps les armes. Mais les Macédoniens furent les premiers à secouer le joug, et cette campagne fut un peu plus pénible que la précédente parce qu'on la jugea méprisable. La cause de cette guerre est presque de celles dont on rougit. Un homme de la plus basse condition, Andriscus, avait pris en même temps la couronne et les armes. On ne sait s'il était libre ou esclave, mais il était certainement mercenaire. On lui donnait généralement le nom de Philippe à cause de sa ressemblance avec Philippe, fils de Persée, et non seulement il avait le physique et le nom du roi, mais il était animé d'un courage également royal. Le peuple romain méprisa d'abord ses entreprises, et, se contentant d'envoyer contre lui le préteur Juventius, il attaqua témérairement un adversaire solidement appuyé par les forces puissantes de la Macédoine et de la Thrace réunies. Rome, que n'avaient pu vaincre des rois véritables, fut ainsi vaincue par un roi imaginaire, par un roi de théâtre. Mais le consul Hétallus vengea complètement la perte du préteur et se sa légion. Il punit la Macédoine de la servitude ; quant à l'auteur de la guerre qui lui fut livré par un petit roi thrace auprès duquel il s'était réfugié, Métellus le ramena à Rome, chargé de chaînes. Dans son malheur, Andriscus obtint encore de la fortune la faveur de voir le peuple romain triompher de lui, comme d'un roi véritable.
XV. Troisième guerre punique.- La troisième guerre contre l'Afrique fut de courte durée - quatre ans suffirent pour l'achever - et par rapport aux précédentes, la moins pénible, car on eut à lutter moins contre les armées que contre les murs mêmes de Carthage ; mais par son résultat elle fut certainement la plus importante : Carthage, en effet, finit avec elle. Si on veut d'ailleurs déterminer l'importance relative de ces trois périodes, la première vit s'engager la guerre, la seconde la fit avancer d'une manière décisive, la troisième la termina. Cette guerre fut provoquée par l'attitude de Carthage qui, violant les clauses du traité, avait équipé une flotte et une armée. C'était, il est vrai, pour résister aux Numides, car souvent Massinissa venait jeter l'épouvante sur son territoire. Mais ce roi était soutenu par Rome dont il était le fidèle allié. En décidant la guerre, on examina les suites à donner à notre victoire. Caton animé d'une haine implacable, proclamait qu'il fallait détruire Carthage, même quand on lui demandait son avis sur une autre question ; Scipion Nasica voulait au contraire qu'on la conservât, de peur que, délivrée de la crainte d'une ville rivale, Rome, trop heureuse, ne s'abandonnât à la mollesse. Le sénat choisit un moyen terme : Carthage changerait seulement de place. Il ne pouvait, semblait-il, y avoir rien de plus beau que de voir subsister une Carthage, qui ne serait pas à craindre. Sous le consulat de Manilius et de Censorinus, le peuple romain attaqua donc Carthage. Rome leur ayant laissé espérer la paix, les Carthaginois livrèrent volontairement leur flotte, qui fut incendiée sous les yeux mêmes de la ville. Les principaux citoyens furent alors convoqués et reçurent l'ordre de quitter leur pays, s'ils voulaient avoir la vie sauve. Cette atroce proposition souleva leur colère, et ils aimèrent mieux s'exposer aux pires extrémités. Ce fut aussitôt dans toute la ville un deuil général ; d'une seule voix on cria aux armes, et on prit la résolution d'épuiser tous les moyens de défense. Il ne leur restait plus d'espoir, mais ils aimaient mieux voir leur patrie détruite par les mains de l'ennemi plutôt que par les leurs. On jugera de la fureur des assiégés quand on saura que pour construire une nouvelle flotte ils démolirent les toits de leurs maisons ; dans les ateliers, ils forgèrent l'or et l'argent pour remplacer l'airain et le fer ; enfin pour faire les cordages des machines de guerre, toutes les femmes donnèrent leurs cheveux. Ensuite le consul Mancinus pressa vivement le siège par terre et par mer. Les ports furent fermés ; le premier, le second, puis le troisième mur virent leurs défenses emportées. Mais la citadelle, nommée Byrsa, constituait comme une seconde ville, qui résistait encore. Bien que la destruction de la ville fût presque achevée, cependant le nom des Scipions semblait attaché aux destins de l'Afrique. Jetant donc les yeux sur un autre Scipion, la république romaine réclamait de lui la fin de la guerre. Paul le Macédonique était son père, mais le fils du grand Africain l'avait adopté pour la gloire de sa maison, et le destin voulut que la ville qu'avait ébranlée l'aïeul fût renversée par le petit-fils. Mais comme les morsures des animaux sont ordinairement les plus dangereuses au moment où ils vont mourir, Carthage à moitié détruite nous causa plus d'embarras que lorsqu'elle était dans toute sa force. Après avoir refoulé tous les ennemis dans la citadelle, les Romains avaient également bloqué le port du côté de la mer. Les Carthaginois creusèrent alors un deuxième port d'un autre côté de la ville. Ce n'était pas pour fuir, mais à l'endroit même par où personne ne supposait qu'il leur fût possible de passer, on vit tout à coup sortir une flotte qui semblait née comme par enchantement. Chaque jour, chaque nuit apparaissaient des môles nouveaux, de nouveaux engins, de nouvelles troupes d'hommes décidés à mourir. Ainsi d'un feu étouffé sous la cendre la flamme jaillit tout à coup. Enfin, quand il n'y eut plus d'espoir, trente-six mille hommes se rendirent, et, chose à peine croyable, Asdrubal était à leur tête. Combien plus grand fut le courage d'une femme, l'épouse du général ! Prenant dans ses bras ses deux enfants, elle se jeta du haut de sa maison au milieu de l'incendie, à l'exemple de la reine qui fonda Carthage. La durée de l'incendie, à elle seule, permet de juger de la grandeur de la ville détruite. C'est à peine si après dix-sept jours entiers on put éteindre les flammes que les ennemis avaient eux-mêmes allumées dans leurs maisons et dans leurs temples. Puisqu'ils ne pouvaient arracher leur ville aux Romains, les Carthaginois leur consumèrent leur triomphe.
XVI. - Guerre d' Achaïe.-. Comme si le cours de ce siècle eût été destiné à la destruction des villes, la ruine de Carthage fut immédiatement suivie de celle de Corinthe, la capitale de l'Achaïe, l'ornement de la Grèce, et placée comme en spectacle entre deux mers, la mer Ionienne et la mer Egée. Quelle indignité de notre part ! Cette ville fut accablée avant d'être mise régulièrement au nombre des ennemis. Critolaus fut la cause de cette guerre : ayant reçu de Rome la liberté, il s'en servit contre elle, et outragea ses ambassadeurs par des paroles, peut-être même par des violences. Métellus, alors spécialement occupé à régler les affaires de Macédoine, fut chargé de nous venger, et ainsi commença la guerre d'Achaïe. Le consul Métellus défit d'abord l'armée de Critolaus dans les vastes plaines de l'Elide, tout le long de l'Alphée. Une seule bataille avait terminé la guerre, et déjà Corinthe même redoutait un siège. Mais, ô caprices du destin ! Métellus avait combattu, Mummius vint cueillir les fruits de la victoire. Il défit complètement l'armée de Diéus, un autre général de Corinthe, à l'entrée même de l'isthme et ensanglanta les deux ports. La ville, abandonnée par ses habitants, fut d'abord pillée, puis détruite au son de la trompette. Que de statues, d'étoffes, de tableaux furent enlevés, incendiés et dispersés ! Que de richesses livrées au pillage et aux flammes ! On s'en fera une idée, si l'on songe que tout ce qu'il y a dans l'univers de l'airain si vanté de Corinthe provient de l'incendie. Le bûcher qui consuma cette ville si opulente produisit un airain d'une qualité supérieure, formé du mélange d'un très grand nombre de statues et d'idoles, qui, fondues par le feu, coulèrent pêle-mêle en ruisseaux d'airain, d'or et d'argent.
XVII. - Expéditions d'Espagne.- De même que Corinthe avait suivi Carthage, Numance suivit Corinthe. Dès lors il ne resta plus rien dans l'univers qui eût échappé à l'atteinte de nos armes. Après l'incendie de ces deux villes illustres, les hostilités s'étendirent au loin et de tous les côtés, non plus successivement, mais partout à la fois, comme si une seule guerre avait éclaté dans le monde entier. Il semblait que les flammes de ces deux villes, poussées par les vents, avaient été dispersées dans toute la terre pour y allumer la guerre. L'Espagne n'eut jamais la pensée de se soulever tout entière contre nous, jamais elle ne se décida à opposer toutes ses forces aux nôtres, ni à nous disputer l'empire, ni à défendre ouvertement sa liberté. Sinon, protégée par le double rempart de la mer et des Pyrénées, elle eût été inaccessible grâce à sa position naturelle. Mais elle fut attaquée par les Romains avant de se connaître elle-même, et, seule de toutes nos provinces, elle ne se rendit compte de ses forces qu'après sa défaite. On s'y battit pendant près de deux cents ans, des premiers Scipions jusqu'à Auguste, non pas sans interruption ni sans relâche, mais selon que les circonstances nous y contraignaient. Tout d'abord même, ce n'est pas avec les Espagnols, mais avec les Carthaginois que nous luttâmes en Espagne. C'est ainsi que se propagea le mal et que naquit cette suite de guerres. Les enseignes romaines franchirent pour la première fois les Pyrénées sous le commandement de Publius et de Cnéus Scipion, qui en de sanglantes batailles défirent Hannon et Asdrubal, frère d'Annibal. L'Espagne allait être emportée du premier coup, si ces deux braves généraux, au milieu même de leur victoire, n'avaient péri, victimes de la mauvaise foi punique, après avoir été victorieux sur terre et sur mer. L'Espagne était donc comme une province nouvelle et encore entièrement indépendante, lorsque le célèbre Scipion, le futur Africain, y pénétra pour venger son père et son oncle. Il prit immédiatement Carthagène et d'autres villes, et non content d'avoir chassé les Carthaginois, il fit de l'Espagne une province tributaire de Rome ; il soumit à notre empire tous les peuples en deçà et au delà de l'Ebre, et, le premier des généraux romains, il porta nos armes victorieuses jusqu'à Gadès et aux rivages de l'Océan. Il est plus difficile de conserver une province que de la conquérir. Aussi envoya-t-on des généraux dans les différentes parties du pays contre des peuples extrêmement farouches, jusque-là encore libres, et par suite incapables de supporter le joug ; il fallut de pénibles efforts et de sanglants combats pour leur apprendre à endurer la servitude. Caton, le censeur bien connu, brisa en quelques combats les Celtibères, le peuple le plus fort de l'Espagne. Gracchus, l'illustre père des Gracques, punit ces mêmes peuples par la destruction de cent cinquante de leurs villes. Le fameux Métellus, qui avait mérité le surnom de Macédonique, mérita aussi celui de Celtibérien à la suite de la prise mémorable de Contrébie et du pardon plus glorieux encore, qu'il accorda à Nertobrige. Lucullus dompta les Turdules et les Vaccéens ; le jeune Scipion avait déjà tué en combat singulier leur roi qui l'avait provoqué, et il avait remporté les dépouilles opimes. Décimus Brutus, s'avançant un peu plus loin, soumit les Celtes, les Lusitaniens, tous les peuples de la Galice et la région du fleuve de l'Oubli, redouté des soldats. Il parcourut en vainqueur le rivage de l'océan et ne revint sur ses pas qu'après avoir vu le soleil se coucher dans la mer, et ses rayons disparaître sous les eaux ; ce ne fut d'ailleurs pas sans la crainte d'avoir commis un sacrilège, ni sans éprouver une religieuse horreur. Mais toutes les difficultés de la guerre nous attendaient chez les Lusitaniens et les Numantins ; et cela s'explique, parce que seuls parmi les Espagnols ces deux peuples trouvèrent des chefs. Il en eût été de même avec tous les Celtibères, si Olyndicus, le chef de leur révolte, n'avait péri au commencement de la guerre. Cet homme qui se serait illustré par sa ruse et son audace, si le sort l'eût favorisé, agitait une lance d'argent qu'il prétendait avoir reçue du ciel, et ses allures de prophète avaient attiré à lui tous les esprits. Mais comme par une témérité bien digne de lui il s'était approché de notre camp à la tombée de la nuit, la sentinelle qui montait la garde près de la tente du consul le frappa d'un coup de javelot. Viriathe, de son côté, releva le courage des Lusitaniens. Cet homme, dont l'adresse était remarquable, et qui de chasseur était devenu brigand, puis tout d'un coup de brigand, général et chef d'armée, aurait été le Romulus de l'Espagne, si la fortune lui avait été favorable. Non content de défendre la liberté de ses concitoyens, pendant quatorze ans il dévasta par le fer et par le feu tous les pays situés en deçà et au delà de l'Ebre et du Tage, attaqua même le camp de nos préteurs et nos garnisons, extermina presque complètement l'armée de Claudius Unimanus, et, avec les trabées et les faisceaux qu'il nous avait pris, il éleva dans ses montagnes de superbes trophées. Le consul Fabius Maximus avait enfin réussi à l'écraser, mais Popilius, son successeur, déshonora notre victoire. Impatient de mettre fin à la guerre, et bien que Viriathe fût complètement abattu et réduit à se rendre, il eut recours à la ruse, à la trahison et au poignard de ses familiers. Il accrut ainsi la gloire de son ennemi en laissant supposer qu'on ne pouvait le vaincre par d'autres moyens.
XVIII. - Guerre de Numance.-Numance, inférieure en richesses à Carthage, Capoue et Corinthe, les égalait cependant toutes les trois par la renommée et la considération que lui valait son courage, et elle était, à bien juger, le plus grand ornement de l'Espagne. Sans murailles, sans tours, située sur un tertre peu élevé aux bords d'un fleuve, avec quatre mille Celtibériens, elle résista seule pendant onze ans aux efforts de quarante mille hommes ; et non seulement elle leur résista, mais elle leur porta plus d'une fois des coups terribles et leur imposa des traités déshonorants. Enfin, comme on la jugeait invincible, il fallut avoir recours à celui qui avait détruit Carthage. Jamais, à dire vrai, motif de guerre ne fut plus injuste. Les Numantins avaient accueilli les habitants de Ségida, leurs alliés et leurs parents, qui avaient échappé aux Romains, et ils avaient vainement intercédé en leur faveur. Bien qu'ils n'eussent pris part à aucune guerre, les Romains leur ordonnèrent de déposer les armes ; leur alliance était à ce prix. Les barbares accueillirent cette proposition comme si on voulait leur couper les mains. Et tout de suite, sous la conduite d'un chef intrépide nommé Mégaravicus, ils prirent les armes. Ils attaquèrent Pompée, mais aimèrent mieux traiter avec lui alors qu'ils auraient pu l'écraser. Ils attaquèrent ensuite Hostilius Mancinus, à qui ils infligèrent également de si nombreuses défaites que personne, dans son armée, ne pouvait supporter les regards ou la voix d'un Numantin. Cependant, cette fois encore ils aimèrent mieux traiter et se contentèrent de prendre leurs armes à des troupes qu'ils auraient pu exterminer. Mais le traité de Numance, tout autant que celui des Fourches Caudines, couvrait d'opprobre et de honte le peuple romain, qui effaça la souillure de ce dernier affront en livrant Mancinus aux ennemis. Puis, confiant une armée à Scipion, que l'incendie de Carthage avait entraîné pour la destruction des villes, il fit enfin éclater sa vengeance. Mais Scipion eut alors à soutenir de plus rudes combats dans son camp que dans la plaine et avec nos soldats qu'avec les Numantins. Il accabla ses hommes de travaux continuels, excessifs et surtout serviles ; il les obligea à porter une plus lourde charge de pieux, puisqu'ils ne savaient pas porter leurs armes, et à se salir de boue, puisqu'ils ne voulaient pas se salir de sang. En outre, il fit disparaître les courtisanes, les valets d'armée et tous les bagages qui n'étaient pas indispensables. Tant vaut le général, tant vaut l'armée, on a raison de le dire. La discipline rétablie, il engagea la bataille, et il arriva ce qu'on n'avait jamais espéré voir : on vit fuir les Numantins. Ils étaient même disposés à se rendre si on leur avait imposé des conditions acceptables pour des hommes. Mais Scipion voulait une victoire véritable et sans réserve. Réduits à la dernière extrémité, ils décidèrent d'abord de courir au combat pour y trouver la mort. Auparavant dans une sorte de repas funèbre, ils s'étaient gorgés de viande à demi crue et de célia : ainsi nomment-ils une boisson indigène tirée du froment. Mais notre général devina leur intention et refusa le combat à des gens qui voulaient mourir. Il entoura la ville d'un fossé, d'une palissade et de quatre camps. Les habitants, accablés par la famine, supplièrent alors notre général de leur accorder la bataille et la mort qui convient à des guerriers. N'ayant pas obtenu cette satisfaction, ils résolurent de faire une sortie. Un très grand nombre périrent ainsi dans la mêlée ; les survivants, torturés par la faim, se nourrirent quelque temps de leurs cadavres. Enfin ils prirent le parti de s'enfuir ; mais leurs femmes leur enlevèrent cette dernière ressource en coupant les sangles de leurs chevaux : ce fut un crime odieux, commis par amour. Renonçant alors à tout espoir d'échapper, ils s'abandonnèrent aux derniers excès de la rage et de la fureur, et finalement sous la conduite de Rhécogène, ils se détruisirent eux, les leurs et leur patrie, par le fer, le poison et l'incendie qu'ils avaient allumé partout. Gloire à cette cité si vaillante, et, à mon avis, si heureuse dans son malheur même ! Elle défendit loyalement ses alliés ; avec ses seules ressources elle résista si longtemps à un peuple soutenu par les forces de l'univers. Enfin, abattue par le plus grand des généraux, elle ne laissa dans sa chute aucun sujet de joie à l'ennemi. Pas un seul Numantin ne put être emmené chargé de chaînes. Il n'y eut pas de butin, car ils étaient très pauvres, et ils brûlèrent eux-mêmes leurs armes. Rome ne triompha que d'un nom.
XIX. - Conclusion.- Jusqu'ici le peuple romain s'est montré noble, glorieux pieux, intègre et magnifique. Le siècle qui reste à parcourir offre un spectacle aussi imposant, mais aussi plus de troubles et de hontes, car les vices se développent en même temps que la grandeur de l'empire. Si l'on fait deux parts de son troisième âge que nous avons évalué à deux cents ans et pendant lequel il fit la guerre au delà des mers, les cent premières années qu'il employa à dompter l'Afrique, la Macédoine, la Sicile, l'Espagne mériteraient à juste titre le nom de siècle d'or pour parler comme les poètes ; les cent années suivantes seraient véritablement l'âge de fer et de sang et même quelque chose de plus cruel encore. Aux guerres contre Jugurtha, contre les Cimbres, contre Mithridate, contre les Parthes contre les pirates, aux guerres contre les Gaulois et les Germains, qui élevèrent sa gloire jusqu'aux astres, se mêlèrent les assassinats des Gracques et de Drusus, puis la guerre des esclaves, et pour comble de honte, celle des gladiateurs. Enfin il tourna ses armes contre lui-même, et par les mains de Marius et de Sylla, et plus récemment par celles de Pompée et de César, comme s'il était pris d'un accès de rage furieuse, il commit le sacrilège de se déchirer lui-même. Bien que tous ces événements soient liés et confondus cependant, pour leur donner plus de clarté et pour que les crimes n'obscurcissent par les vertus, nous les exposerons séparément, et, suivant le plan indiqué, nous commencerons par les guerres justes et légitimes entreprises contre les nations étrangères. Ainsi on verra clairement la grandeur de l'empire s'accroître de jour en jour ; puis nous reviendrons aux luttes criminelles entre citoyens, guerres infâmes et sacrilèges.
.jpg)
LIVRE TROISIEME
I. -Guerre d' Asie.- Vainqueur de l'Espagne à l'Occident, le peuple romain était en paix avec l'Orient. Bien mieux, par une chance extraordinaire et jusqu'alors inconnue, des rois lui laissaient en héritage leurs richesses et en même temps leurs royaumes tout entiers. Attale, roi de Pergame, fils du roi Eumène, notre ancien allié et compagnon d'armes, laissa ce testament : "J'institue le peuple romain héritier de mes biens. Au roi, appartiennent les biens suivants... " Ayant donc recueilli l'héritage, le peuple romain avait acquis cette province non point par la guerre ni par les armes, mais, ce qui est plus légitime, en vertu d'un testament. Il la perdit cependant et la recouvra avec une égale facilité. Aristonicus, fier jeune homme de sang royal, gagne facilement à sa cause la plupart de ces villes accoutumées à obéir à des rois, il triomphe de la résistance de quelques autres, comme Mynde, Samos, Colophon. En outre, il bat l'armée du préteur Crassus, et le fait lui-même prisonnier. Mais Crassus ne démentit point l'honneur de sa famille et du nom romain ; il creva avec une baguette l'oeil de son gardien et réussit de la sorte à se faire tuer par le barbare furieux. Bientôt après, Aristonicus fut vaincu et pris par Perperna ; et pendant sa captivité on le maintint en prison. Aquilius régla les derniers restes de la guerre d'Asie et fut assez criminel pour empoisonner les fontaines, afin d'obtenir la capitulation de certaines villes. Il hâta ainsi, mais déshonora en même temps sa victoire. Au mépris des lois divines et des usages de nos ancêtres, il souilla par ces poisons infâmes l'honneur jusqu'alors sans tâche des armes romaines.
II. - Guerre contre Jugurtha.- Telle était la situation en Orient. Mais le midi ne connaissait pas la même tranquillité. Qui se fût attendu, après la destruction de Carthage, à une autre guerre en Afrique. Cependant la Numidie s'agita violemment, et Jugurtha provoqua nos craintes après Hannibal. Ce prince artificieux, voyant le peuple romain invincible par les armes, l'attaqua avec l'argent. Mais contrairement à l'attente générale, le sort voulut que le plus rusé des rois fût lui-même pris par la ruse. Petit-fils de Massinissa et fils adoptif de Micipsa, il était dévoré de l'ambition de régner et avait décidé de tuer ses frères. Il ne les craignait pas plus que le Sénat et le peuple romain qui avait le royaume numide sous sa protection et dans sa clientèle. Son premier crime fut exécuté par trahison, et une fois qu'on lui eut apporté la tête d'Hiempsal, il se tourna contre Adherbal qui se réfugia à Rome. Il envoya de l'argent par ses ambassadeurs et gagna le sénat à sa cause. Ce fut là sa première victoire sur nous. On délégua ensuite des commissaires pour partager le royaume entre Adherbal et lui. Il eut recours aux mêmes armes et triompha, en la personne de Scaurus, des moeurs mêmes de l'empire romain. Il consomma alors audacieusement son crime inachevé. Mais les forfaits ne restent pas longtemps cachés. La corruption criminelle des commissaires fut dévoilée et on résolut la guerre contre le fratricide. On expédia d'abord en Numidie le consul Calpurnius Bestia. Mais le roi savait par expérience que l'or était plus puissant que les armes contre les Romains, et il acheta la paix. Accusé de ce crime, et cité par le sénat à comparaître sous la garantie de la foi publique, il osa à la fois se présenter et faire assassiner par un émissaire Massiva, son concurrent au trône de Massinissa. Ce fut un autre motif de guerre contre le roi. Le soin de notre vengeance fut cette fois confié à Albinus. Mais, ô déshonneur, le Numide corrompit également l'armée de son frère ; la fuite volontaire des nôtres lui donna la victoire et lui livra notre camp. Pour leur avoir laissé la vie sauve il leur imposa ensuite un traité honteux et renvoya une armée qu'il avait achetée. Enfin, Métellus se lève pour venger moins l'empire que l'honneur romain. L'ennemi, très adroitement, cherche à se dérober, tantôt par la prière, tantôt par la menace, tantôt par la fuite, simulée ou véritable. Métellus l'attaque par ses propres armes. Non content de ravager les campagnes et les bourgs, il se jette sur les principales villes de Numidie. Sans doute, il échoue dans une attaque contre Zama, mais il pille Thala, où étaient entassés des armes et les trésors du roi. Puis il prend au roi ses villes, le chasse de ses Etats et de son royaume, et le poursuit en Maurétanie et en Gétulie. Enfin Marius augmenta considérablement ses troupes en enrôlant des prolétaires -- car il était lui-même de naissance obscure -- et il attaqua le roi déjà en déroute et très affaibli. Il éprouva cependant à le vaincre autant de difficultés que s'il avait attaqué un ennemi encore intact et dans toute sa force. La ville de Capsa, qui avait été fondée par Hercule au milieu de l'Afrique, et que la soif, les serpents et les sables protégeaient aussi bien qu'un rempart, par une chance extraordinaire, tomba en son pouvoir ; et un Ligurien le fit pénétrer dans la ville de Mulucha, placée sur un roc montagneux d'un abord très difficile et jusque-là inaccessible. Bientôt après, Jugurtha, et avec lui Bocchus, roi de Maurétanie, qui, fidèle aux liens du sang, défendait le Numide, subirent près de la ville de Cirta une lourde défaite. Mais Bocchus, désespérant du succès, craignit d'être entraîné dans le désastre d'autrui, et acheta l'alliance et l'amitié des Romains en leur livrant le roi. C'est ainsi que le plus fourbe des rois, victime du piège que lui tendit son beau-père, fut remis entre les mains de Sylla. Le peuple romain put enfin voir Jugurtha couvert de chaînes dans le cortège triomphal. Quant à Jugurtha, il vit lui aussi, mais vaincu et enchaîné, cette ville qu'il avait appelée vénale, et dont il avait faussement prédit qu'elle périrait si elle trouvait un jour un acheteur. Si elle fut à vendre, elle trouva un acheteur. Elle lui échappa ; c'est une preuve certaine qu'elle ne périra point.
III. - Guerre contre les Allobroges.- Tels furent les événements au midi. Mais le peuple romain dut soutenir des combats beaucoup plus terribles et plus nombreux vers le nord {lacune}. Rien de plus redoutable que cette région. Le caractère des habitants y est aussi rude que le climat. De toute cette contrée septentrionale, à droite, à gauche et au centre de furieux ennemis s'élancèrent contre nous. Parmi les peuples transalpins, les Salluviens les premiers éprouvèrent la force de nos armes ; car leurs incursions provoquaient les plaintes de la ville de Marseille, notre très fidèle alliée et amie. Puis ce furent les Allobroges et les Arvernes contre lesquels les Eduens nous adressèrent des plaintes analogues, en réclamant notre aide et notre secours. Nous eûmes pour témoins de nos victoires sur ces deux peuples l'Isère, la Sorgue et le Rhône, le plus rapide des fleuves Rien n'épouvanta plus les Barbares que nos éléphants, dignes adversaires de ces nations farouches. On remarqua tout particulièrement dans le cortège triomphal leur roi Bituitus avec ses armes de diverses couleurs et son char d'argent, comme au jour du combat. On jugera de la joie extraordinaire qu'excitèrent ces deux victoires quand on saura que Domitius Aenobarbus et Fabius Maximus élevèrent des tours de pierre sur l'emplacement même des champs de bataille et y dressèrent des trophées ornés d'armes ennemies. Cet usage était inconnu de nos ancêtres. Jamais, en effet, le peuple romain n'insulta à la défaite d'un ennemi vaincu.
IV. - Guerre contre les Cimbres, les Teutons et les Tigurins.- Les Cimbres, les Teutons et les Tigurins, partis des extrémités de la Gaule et fuyant les inondations de l’Océan, cherchaient de nouvelles demeures par tout l'univers. Repoussés de la Gaule et de l'Espagne, ils voulurent passer en Italie et envoyèrent des ambassadeurs au camp de Silanus et de là au Sénat. Ils demandaient au peuple de Mars de leur accorder quelques terres à titre de solde ; en échange, ils mettraient à son entière disposition leurs bras et leurs armes. Mais quelles terres pouvait donner le peuple romain chez qui les lois agraires allaient provoquer la guerre civile ? Aussi n'obtinrent-ils pas satisfaction, et ils décidèrent de prendre par les armes ce qu'ils n'avaient pu avoir par la prière. Silanus ne put soutenir le premier choc des barbares, Manlius ne put soutenir le second, ni Cépion le troisième. Tous trois furent mis en fuite et chassés de leurs camps. Tout était perdu, si ce siècle n'eût, par bonheur, produit Marius. Marius lui-même n'osa pas les attaquer aussitôt. Il retint ses soldats dans le camp, attendant que cette rage invincible et cette violence impétueuse qui tiennent lieu de courage aux barbares se fussent affaiblies. Ils se retirèrent donc en injuriant les nôtres et avec une telle certitude de prendre Rome qu'ils leur demandèrent s'ils n'avaient rien à faire dire à leurs femmes. Et prompts à exécuter leurs menaces, ils se divisent en trois corps et s'avancent à travers les Alpes, la barrière de l'Italie. Avec une rapidité extraordinaire, Marius s'empare aussitôt des chemins les plus courts et prévient l'ennemi. Il rejoint d'abord les Teutons au pied même des Alpes, dans un endroit appelé Aix, et les écrase. Quelle bataille, grands dieux ! La vallée et le fleuve qui la traverse étaient au pouvoir de l'ennemi, les nôtres n'avaient pas d'eau. Notre général l'avait-il fait exprès, ou fut-ce une erreur dont il sut tirer parti ? On l'ignore. Mais il est certain que la nécessité accrut le courage des nôtres et leur donna la victoire. Les soldats, en effet, réclamaient de l'eau. "Si vous êtes des hommes, voyez, dit Marius, vous en avez là-bas." Aussi l'ardeur des combattants fut-elle si grande, et on massacra tellement d'ennemis que dans la rivière ensanglantée les Romains victorieux ne burent pas moins de sang que d'eau. Le roi Teutobodus lui-même, habitué à sauter successivement sur quatre ou six chevaux, put à peine en monter un pour s'enfuir. Il fut pris dans un bois voisin et constitua le plus beau spectacle du triomphe. Sa taille gigantesque s'élevait au-dessus des trophées conquis sur lui. Les Teutons exterminés, Marius se tourna contre les Cimbres. Déjà -- qui le croirait ? -- malgré l'hiver qui rend les Alpes plus hautes, ils étaient descendus en Italie en roulant comme une avalanche du haut des montagnes du Tridentum. Avec une stupidité toute barbare, ils voulurent d'abord franchir l'Adige à la nage, sans ponts ni bateaux, mais quand ils eurent vainement essayé d'arrêter le courant avec leurs mains et leurs boucliers, ils y jetèrent une grande quantité d'arbres et passèrent. Si les colonnes ennemies s'étaient aussitôt dirigées sur Rome, le danger aurait été très grand. Mais en Vénétie, une des régions les plus agréables de l'Italie, la douceur du sol et du climat affaiblit leur vigueur. Ils s'amollirent aussi par l'usage du pain, de la viande cuite et de vins délicieux. Marius choisit ce moment pour les attaquer. Ils demandèrent à notre général de fixer le jour du combat, il leur assigna le lendemain. La rencontre eut lieu dans une très large plaine appelée la plaine Raudienne. L'ennemi perdit soixante-cinq mille hommes, les Romains, moins de trois cents. Toute la journée on massacra des barbares. A son tour le général romain, ajoutant l'artifice à la valeur, emprunta à Hannibal la tactique qu'il avait suivie à Cannes. Tout d'abord il profita d'un jour où le brouillard lui permit de tomber à l'improviste sur les ennemis, et où le vent leur lançait la poussière dans les yeux et la figure. Enfin il tourna son armée face à l'orient, et les prisonniers nous apprirent par la suite que les rayons du soleil réfléchis par les casques des Romains donnaient l'impression que le ciel était en feu. La lutte avec leurs femmes ne fut pas moins violente. Elles s'étaient entourées d'un rempart de chariots et de voitures, du haut duquel elles combattaient avec des haches et de longues perches. Leur mort fut aussi belle que leur résistance. Elles envoyèrent à Marius une délégation chargée de demander pour elles la liberté et le sacerdoce. N'ayant pas obtenu satisfaction -- car nos coutumes religieuses ne le permettaient pas, -- elles étouffèrent et écrasèrent pêle-mêle leurs enfants en bas-âge, puis elles s'entre-tuèrent les unes les autres, ou bien, formant un lien avec leurs cheveux, elles se pendirent aux arbres ou au timon de leurs chariots. Leur roi Boiorix combattit avec courage au premier rang et fit payer chèrement sa mort. La troisième colonne, celle des Tigurins, qui s'était postée comme en réserve sur les sommets des Alpes Noriques, se dispersa dans des directions différentes et disparut en fuyant honteusement et en pillant sur son passage. Cette nouvelle si agréable, si heureuse, de la délivrance de l'Italie et du salut de l'empire, le peuple romain ne l'apprit pas, comme d'habitude, par des hommes, mais, s'il est permis de le croire, par les dieux eux-mêmes. Le jour de la bataille, on aperçut devant le temple de Castor et de Pollux des jeunes gens couronnés de laurier qui remirent une lettre au préteur. Au même moment la foule qui assistait à un combat de gladiateurs applaudit à sa manière habituelle en criant : Bravo ! Peut-il y avoir rien de plus étonnant, de plus admirable ? Il semblait que du haut de ses montagnes, Rome assistait au spectacle de la guerre, et à l'instant même où les Cimbres succombaient dans la bataille, le peuple applaudissait dans la ville.
V. - Guerre contre les Thraces.- Les dieux voulurent qu'après les Macédoniens, nous eussions la révolte des Thraces, leurs anciens tributaires. Non contents d'attaquer les provinces voisines comme la Thessalie et la Dalmatie, ils s'avancèrent jusqu'à l'Adriatique. Contenus par cette limite que la nature semblait leur opposer, ils brandirent et lancèrent leurs traits contre les eaux elles-mêmes. Pendant tout ce temps, il n'est point de cruautés qu'ils n'aient exercées contre leurs prisonniers. Ils offraient aux dieux des libations de sang humain, buvaient dans des crânes et déshonoraient par des outrages de toutes sortes la mort de leurs victimes qu'ils faisaient périr tantôt par le feu, tantôt par la fumée ; ils faisaient même avorter les femmes enceintes à force de tortures. Les plus cruels de tous les Thraces furent les Scordisques. Ils alliaient la ruse à la vigueur, et la disposition de leurs forêts et de leurs montagnes convenait bien à leur naturel. De là vient que non seulement ils battirent ou mirent en fuite, mais, chose prodigieuse, ils anéantirent toute l'armée que Caton avait conduite contre eux. Didius les ayant trouvés en désordre et dispersés afin de piller en toute liberté, les refoula dans leur pays de Thrace. Drusus les repoussa plus loin encore et leur interdit le passage du Danube. Minucius ravagea toute la région de l'Hèbre, mais il perdit beaucoup de monde en faisant avancer sa cavalerie sur la glace perfide du fleuve. Vulson pénétra jusqu'au Rhodope et au Caucase. Curion atteignit la Dacie, mais il eut peur de ses forêts ténébreuses. Appius pénétra chez les Sarmates. Lucullus atteignit les dernières limites du pays le Tanaïs et le Palus-Méotide. On ne put dompter ces ennemis particulièrement cruels qu'en appliquant leurs procédés. On tortura donc les prisonniers par le feu et par le fer. Mais ce qui parut le plus affreux à ces barbares, c'est qu'après leur avoir coupé les mains on les laissait libres, et on les forçait à survivre à leur supplice.
VI. - Guerre contre Mithridate.- Les peuples pontiques habitent entre les régions du nord et le Pont-Euxin dont ils tirent leur nom. Le plus ancien roi de ces peuples et de ces régions fut Aeetas, puis ce fut Artabaze, issu des Sept Perses, et ensuite Mithridate, de beaucoup le plus grand de tous. Quatre ans avaient suffi pour venir à bout de Pyrrhus, quatorze ans pour triompher d'Hannibal. Mithridate résista pendant quarante ans ; il fallut trois guerres sanglantes pour le vaincre, et le bonheur de Sylla, le courage de Lucullus et la grandeur de Pompée pour l'abattre définitivement. A notre ambassadeur Cassius, il avait donné comme prétexte de cette guerre les attentats de Nicomède de Bithynie contre ses frontières. En réalité, emporté par une violente ambition, il brûlait du désir d'être le maître de toute l'Asie, et, si possible, de l'Europe. Nos vices semblaient lui donner les espoirs les plus justifiés. Nous étions alors divisés par les guerres civiles, et l'occasion paraissait propice. Marius, Sylla, Sertorius lui montraient de loin le flanc désarmé de l'empire. Alors que Rome était affaiblie par ses blessures et ses troubles politiques, tout-à-coup, comme s'il avait choisi le moment favorable, il fait soudainement éclater sur les Romains fatigués et divisés l'orage de la guerre du Pont qui semble venir des lointains sommets du nord. Le premier effort de la guerre emporte aussitôt la Bithynie, puis une pareille épouvante s'empare de l'Asie. Immédiatement, les villes et les peuples soumis à notre domination se rangent aux côtés du roi. Il est partout, presse ses alliés, et la cruauté lui tint lieu de courage. Est-il rien de plus atroce que l'un de ses édits par lequel il ordonnait le massacre de tous les citoyens romains qui se trouvaient en Asie ? Les maisons, les temples, les autels, tous les droits humains et divins furent alors violés. Mais cette épouvante de l'Asie ouvrait aussi au roi le chemin de l'Europe. Il envoie en avant ses généraux Archélaus et Néoptolème, et à l'exception de Rhodes, qui resta plus fidèle à notre cause, toutes les autres Cyclades, Délos, l'Eubée, Athènes même, la gloire de la Grèce, tombent en son pouvoir. Déjà sur l'Italie, sur la ville même de Rome soufflait le vent de la panique que soulevait le roi. Lucius Sylla s'empresse de courir à sa rencontre. Cet excellent général repousse sans difficulté l'élan de l'ennemi, en lui opposant une impétuosité égale à la sienne. Tout d'abord, -- qui le croirait ? -- la ville d'Athènes, la mère des moissons, se voit contrainte par le blocus et par la faim à se nourrir de chair humaine. Il détruit bientôt le port du Pirée, entouré de plus de six murailles et après avoir dompté les plus ingrats des hommes, il déclara qu'il les épargnait cependant en considération de leurs ancêtres, pour leurs cérémonies sacrées et pour leur renommée. Puis il chasse de l'Eubée et de la Béotie les garnisons du roi et disperse toutes ses troupes aux deux combats de Chéronée et d'Orchomène. Tout de suite, il passe en Asie et écrase le roi lui-même. Il eût achevé la ruine de Mithridate s'il n'avait préféré un triomphe rapide à un triomphe véritable. Voici l'état où Sylla laissait alors l'Asie. Il conclut avec le Pont un traité par lequel le roi rendait la Bithynie à Nicomède, la Cappadoce à Ariobarzane. L'Asie retombait sous notre domination, comme précédemment. Mais Mithridate n'était que repoussé. Cet échec irrita plutôt qu'il n'abattit les Pontins. L'Asie et l'Europe avaient en quelque sorte éveillé l'appétit du roi. Il ne les considérait plus comme des provinces étrangères mais ces pays qu'il avait perdus, il les revendiquait comme si on les lui avait arrachés par la force. Comme les flammes d'un incendie mal éteint se raniment avec plus de violence, Mithridate revenait attaquer l'Asie avec des troupes plus nombreuses et toutes les ressources de son royaume dont il couvrait la mer, la terre et les fleuves. Cyzique, ville bien connue par sa citadelle, ses murailles, son port et ses tours de marbre, est l'ornement du rivage asiatique. C'était pour le roi comme une autre Rome, qu'il attaqua avec toutes ses forces. Mais les assiégés furent encouragés dans leur résistance par un messager qui leur annonça l'approche de Lucullus. Chose incroyable ! Ce messager traversa la flotte ennemie, soutenu par une outre qu'il dirigeait avec ses pieds, et échappa aux navires ennemis qui, le voyant de loin, le prirent pour une baleine. Bientôt la victoire changea de camp. Par suite de la longueur du siège, l'armée du roi souffrit de la famine, et la famine amena la peste. Le roi se retira, poursuivi par Lucullus, qui fit un tel massacre de ses troupes que le Granique et l'Esape en étaient teints de sang. Ce prince rusé, qui n'ignorait pas la cupidité romaine, ordonna à ses soldats en fuite de disperser les bagages et l'argent pour retarder la poursuite du vainqueur. Sa fuite ne fut pas plus heureuse sur mer que sur terre. Sa flotte se composait de plus de cent navires qu'alourdissait un immense appareil de guerre. Une tempête qui l'assaillit sur le Pont-Euxin brisa ses navires et lui infligea un désastre aussi terrible qu'une bataille navale. Il semblait que Lucullus s'était entendu avec les flots et les tempêtes et avait chargé les vents d'achever la ruine de Mithridate. Toutes les forces de ce roi très puissant étaient anéanties, mais les revers augmentaient son courage. Il se tourna alors vers les nations voisines, et il enveloppa presque tout l'Orient et le Nord dans sa ruine. Il essaya d'attirer à lui les Hibères, les Caspiens, les Albaniens et les deux Arménies. La fortune cherchait ainsi à donner à Pompée, son favori, un nom et des titres glorieux. Voyant que l'Asie était de nouveau agitée et embrasée, et que les rois y succédaient aux rois, Pompée jugea qu'il n'y avait pas de temps à perdre, et, prévenant la jonction des forces ennemies, il fit immédiatement construire un pont de bateaux, et le premier de tous il franchit l'Euphrate. Il attaqua le roi fugitif au centre de l'Arménie et eut la chance extraordinaire de détruire ses forces en une seule bataille. Ce combat se déroula la nuit, et la lune y prit part. Comme si elle combattait pour nous, cette déesse brillait derrière les ennemis et en face des Romains. Les soldats de Mithridate visaient par erreur leurs propres ombres qui étaient fort longues, croyant atteindre l'ennemi. Cette nuit consomma la ruine de Mithridate. Toute sa puissance resta désormais brisée, malgré toutes les tentatives qu'il entreprit, tel un serpent qui, la tête broyée, menace encore avec sa queue. Après avoir échappé à l'ennemi, il pensa joindre à lui tous les pays qui s'étendent entre la Colchide et le Bosphore, puis traverser en courant la Thrace, la Macédoine et la Grèce, et tomber à l'improviste sur l'Italie. Mais ce ne fut qu'un projet, car la défection de ses sujets et la trahison de son fils Pharnace en prévinrent l'exécution, et, après avoir inutilement essayé le poison, il se tua de son épée. Cependant le grand Pompée poursuivait les restes des rebelles asiatiques et parcourait, comme d'un vol rapide, dès contrées et des peuples différents. Vers l'Orient, il poursuivit les Arméniens, s'empara d'Artaxate, la capitale de ce peuple, et laissa son royaume à Tigrane, venu en suppliant. Au nord, il se dirigea vers la Scythie, guidé par les étoiles comme sur mer ; il soumit la Colchide, pardonna à l'Ibérie et épargna les Albaniens. Campé au pied du Caucase, il contraignit leur roi Orode à descendre dans la plaine, cependant qu'Arthoce, roi d'Ibérie, devait lui payer tribut et lui donner ses enfants en otage. Il fit à son tour des présents à Orode qui lui avait envoyé spontanément d'Albanie un lit d'or et d'autres présents. Puis, se tournant vers le sud, il franchit en Syrie le Liban, dépassa Damas, et conduisit les enseignes romaines à travers ces bois renommés par leurs parfums et à travers ces forêts célèbres par leur encens et leur baume. Les Arabes vinrent recevoir ses ordres. Les Juifs essayèrent de défendre Jérusalem, mais Pompée y pénétra également et il vit le célèbre et mystérieux sanctuaire de cette nation impie et le voile d'or qui le recouvre entièrement. Deux frères se disputaient la couronne ; choisi pour arbitre, Pompée donna le trône à Hircanus ; et comme Aristobule réclamait à nouveau le pouvoir, il le jeta en prison. C'est ainsi que sous la conduite de Pompée le peuple romain parcourut l'Asie entière dans toute son étendue, et la province qui limitait notre empire en devint le centre. Excepté les Parthes, qui préférèrent traiter avec nous et les Indiens qui ne nous connaissaient pas encore, toute la partie de l'Asie située entre la mer Rouge, la mer Caspienne et l'Océan, domptée ou subjuguée, reconnaissait le pouvoir de Pompée.
VII. - Guerre contre les pirates.- Pendant que le peuple romain était occupé dans les différentes parties du monde, les Ciliciens avaient envahi les mers. Supprimant tout trafic, brisant les traités qui unissent les hommes, ils avaient fermé les mers aussi bien que la tempête. Les troubles de l'Asie, agitée par la guerre de Mithridate, leur donnaient cette audace effrénée et criminelle. Profitant du désordre causé par une guerre étrangère, et de la haine qu'inspirait le roi ennemi, ils exerçaient impunément leurs brigandages. Tout d'abord, conduits par Isidore, ils se contentèrent des mers voisines ; puis ils étendirent leur piraterie entre la Crète et Cyrène, l'Achaïe et le golfe de Malée, qu'ils appelaient le golfe d'Or à cause du butin qu'ils y faisaient. On envoya contre eux Publius Servilius, dont les lourds vaisseaux de guerre réussirent à disperser leurs légers et rapides brigantins ; mais ce fut une sanglante victoire. Non content de les avoir chassés de la mer, il détruisit les plus fortes de leurs villes, où ils entassaient depuis longtemps leur butin, Phasélis, Olympe, Isaure même, la forteresse de la Cilicie. Le sentiment des grandes difficultés qu'il avait dû surmonter lui rendit particulièrement cher le surnom d'Isaurique. Cependant ces nombreuses défaites ne domptèrent pas les pirates, qui ne purent se résoudre à vivre sur le continent. Mais semblables à certains animaux auxquels leur double nature permet d'habiter l'eau et la terre, à peine l'ennemi s'était-il retiré, qu'ils ne voulurent plus rester sur la terre ferme et, s'élançant à nouveau sur l'eau, leur élément, ils poussèrent leur course encore plus loin qu'auparavant et cherchèrent par leur arrivée soudaine à jeter l'épouvante sur les côtes de la Sicile et même de la Campanie. C'est alors qu'on jugea qu'il appartenait à Pompée de vaincre les Ciliciens, et cette mission lui fut confiée comme un complément de la guerre contre Mithridate. Le fléau de la piraterie était dispersé sur toutes les mers. Voulant détruire les pirates d'un seul coup et pour toujours, il fit, avant de les attaquer, des préparatifs plus qu'humains. Ses vaisseaux et ceux des Rhodiens, nos alliés, formèrent une flotte immense, qui partagée entre un grand nombre de lieutenants et de préfets, s'empara des passages du Pont-Euxin et de l'Océan. Gellius fut chargé de la mer Tyrrhénienne, Plotius de celle de Sicile ; Atilius bloqua le golfe de Ligurie, Pommponius celui des Gaules, Torquatus la mer des Baléares, Tiberius Néron le détroit de Gadès, tout à l'entrée de notre mer ; Lentulus Marcellinus la mer de Libye, les jeunes Pompée celle d'Egypte, Terentius Varron l'Adriatique ; Métellus, la mer Egée, la mer Noire et la mer de Pamphylie ; Cépion, celle d'Asie ; Porcius Caton obstrua l'entrée de la Propontide avec ses vaisseaux et la ferma comme avec une porte. Ainsi par toute la mer, dans les ports, les golfes, les repaires, les retraites, les promontoires, les détroits, les péninsules, tout ce qu'il y avait de pirates fut enfermé et pris comme dans un filet. Quant à Pompée, il se tourna contre la Cilicie, l'origine et le foyer de la guerre. Les ennemis ne refusèrent point le combat ; ce n'est pas qu'ils pensaient nous vaincre, mais ils semblaient n'avoir eu cette audace que parce qu'ils étaient cernés. Ils se bornèrent cependant à soutenir le premier choc ; puis lorsqu'ils se virent assaillis de tous les côtés par les éperons de nos vaisseaux, ils jetèrent aussitôt leurs armes et leurs rames, et battant des mains tous ensemble en signe de supplication, ils demandèrent la vie sauve. Jamais nous ne remportâmes une victoire si peu sanglante, et jamais nation ne nous fut désormais plus fidèle. Ce résultat fut obtenu grâce à la rare sagesse de notre général, qui refoula ce peuple de marins loin de la vue de la mer et l'enchaîna, pour ainsi dire, aux champs du continent. Du même coup, il rendit l'usage de la mer aux vaisseaux, et à la terre ses habitants. Que faut-il le plus admirer dans cette victoire ? Sa rapidité ? Elle fut acquise en quarante jours. -- Son bonheur ? Nous ne perdîmes pas un seul navire. -- Ses résultats durables ? Il n'y eut plus désormais de pirates.
VIII. - Guerre de Crète.- La guerre de Crète, à dire vrai, fut entreprise par le seul désir de vaincre une île célèbre. Elle semblait avoir favorisé Mithridate ; nous décidâmes de nous en venger par les armes. Marcus Antonius l'envahit le premier avec une telle espérance et une telle assurance de la victoire qu'il portait sur ses navires plus de chaînes que d'armes. Il fut puni de sa sottise. La plupart de ses navires tombèrent aux mains de l'ennemi. Les Crétois attachèrent et pendirent les prisonniers aux vergues et aux cordages, puis déployant toutes leurs voiles, ils regagnèrent leurs ports en triomphateurs. Plus tard, Métellus mit toute l'île à feu et à sang, et repoussa les habitants dans leurs forteresses et dans leurs villes, telles que Cnossos, Eleuthère et Cydonie, que les Grecs appellent ordinairement la mère des villes. Il traitait si cruellement les prisonniers que la plupart des assiégés s'empoisonnèrent, et les autres firent porter leur soumission à Pompée absent. Pompée, alors occupé en Asie, leur envoya son lieutenant Antoine, mais il ne put rien faire dans une province qui appartenait à un autre. Métellus n'en exerça que plus rigoureusement contre les ennemis les droits du vainqueur. Après avoir battu Lasthène et Panarès, les généraux de Cydonie, il revint à Rome victorieux, et ne remporta cependant de cette fameuse victoire que le surnom de Crétique.
IX. -Guerre contre les Baléares.- La famille de Métellus le Macédonique avait pris l'habitude de tirer des surnoms des guerres qu'elle faisait. L’un des fils ayant été surnommé le Crétique, un autre ne tarda pas à recevoir le nom de Baléarique. Les Baléares, atteints de la rage de la piraterie, infestaient alors les mers. C'étaient des êtres farouches et sauvages, et on s'étonne qu'ils aient osé seulement regarder la mer du haut de leurs rochers. Ils montaient sur des radeaux grossièrement construits, et leurs attaques soudaines jetaient l'épouvante parmi les navigateurs qui longeaient leurs côtes. Quand ils virent arriver de la haute mer la flotte romaine, ils pensèrent que c'était une proie pour eux, et ils osèrent se porter à sa rencontre. Ils commencèrent l'attaque, en la couvrant d'une grêle de pierres et de cailloux. Chacun d'eux combat avec trois frondes. La justesse de leurs coups n'étonnera personne, car c'est l'arme unique de cette nation, le seul exercice auquel elle se livre dès sa plus tendre enfance. Un garçon ne reçoit d'autre nourriture que celle que sa mère a proposée par but à sa fronde, et qu'il a réussi à atteindre. Mais leurs pierres n'effrayèrent pas longtemps les Romains. Quand on en vint à l'abordage, et qu'ils sentirent nos éperons et les javelots qui tombaient sur eux, ils se mirent à crier comme des troupeaux et s'enfuirent vers le rivage. Ils se dispersèrent dans les collines voisines et il fallut les chercher pour les vaincre.
X. - Expédition contre Chypre.- L'heure fatale des îles était arrivée. Chypre, à son tour, fut prise sans combat. Cette ville, depuis longtemps célèbre par ses grandes richesses et aussi par le culte qu'elle rendait à Vénus, avait alors pour roi Ptolémée. Elle passait, et non à tort, pour posséder une telle opulence que le peuple vainqueur des nations et dispensateur des royaumes prononça, sur la proposition du tribun de la plèbe Publius Clodius, la confiscation des biens d'un roi allié, encore vivant. A cette nouvelle, le roi hâta par le poison la fin de sa vie. Passant par l'embouchure du Tibre, Porcius Caton transporta à Rome sur des liburnes les richesses de Chypre, qui grossirent plus qu'aucun triomphe le trésor du peuple romain.
XI. - Guerre des Gaules.- Quand l'Asie eut été soumise par Pompée, la fortune confia à César le soin d'en finir avec l'Europe. Or, il restait les peuples les plus cruels, les Gaulois et les Germains, et, bien que séparée de tout l'univers, la Bretagne trouva cependant un vainqueur. Les Helvètes furent les premiers qui commencèrent à troubler la Gaule. Situés entre le Rhône et le Rhin, ils ne possédaient qu'un territoire insuffisant et ils vinrent solliciter un nouvel emplacement. Ils avaient brûlé leurs villes, s'engageant ainsi à ne pas revenir. César demanda un délai pour réfléchir, et détruisit, dans l'intervalle le pont du Rhône. Il arrêta ainsi dans sa fuite cette nation très belliqueuse, et la fit rentrer aussitôt dans son pays, tout comme un berger ramène ses troupeaux à l'étable. La guerre contre les Belges, qui suivit, fut beaucoup plus sanglante, car ce peuple combattait pour sa liberté. Si les soldats romains s'y firent souvent remarquer par leur valeur, leur général s'y distingua tout particulièrement. Comme son armée pliait, prête à prendre la fuite, il arracha des mains d'un fuyard son bouclier, vola au premier rang, et son intervention personnelle rétablit le combat. Puis ce fut la guerre navale avec les Vénètes. Mais César dut lutter contre l'océan plus que contre leurs navires, qui, grossiers et informes, faisaient naufrage au moindre choc de nos éperons. Mais la bataille continua sur la grève, lorsque, suivant son mouvement habituel, l'océan se retira au milieu même du combat, semblant ainsi s'opposer à la guerre. César dut aussi employer une tactique différente selon la nature des peuples et des lieux. Les Aquitains, nation rusée, se retiraient dans des cavernes ; il les y fit enfermer. Les Morins se dispersaient dans les forêts, il y fit mettre le feu. Qu'on ne dise pas que les Gaulois sont seulement farouches ; ils pratiquent aussi la ruse. Indutiomare souleva les Trévires, et Ambiorix, les Eburons. Tous deux, pendant l'absence de César, s'entendirent pour attaquer ses lieutenants. Mais Dolabella repoussa courageusement le premier et rapporta la tête du roi barbare. Le second nous ayant tendu une embuscade dans une vallée nous surprit et nous écrasa. Notre camp fut pillé, et nous perdîmes les lieutenants Aurunculéius Cotta et Titurius Sabinus. Nous ne pûmes par la suite tirer vengeance de ce roi, car il s'enfuit de l'autre côté du Rhin et y resta toujours caché. Aussi le Rhin ne fut-il pas à l'abri de nos attaques ; on ne pouvait le laisser impunément recéler et protéger nos ennemis. La première guerre contre les Germains fut entreprise pour les motifs les plus légitimes ; les Eduens, en effet, se plaignaient de leurs incursions. Quelle n'était pas la présomption d'Arioviste ? Comme nos députés lui disaient de venir trouver César : "Quel est César ?" répondit-il. "S'il veut me voir, qu'il vienne. Que lui importent les affaires de la Germanie, notre pays ? Est-ce que je me mêle de celles des Romains ? " Aussi ce peuple inconnu répandit-il un tel effroi dans notre camp que partout, même dans les tentes des officiers, on faisait son testament. Mais ces corps gigantesques offraient à nos épées et à nos projectiles d'autant plus de prise qu'ils étaient plus grands. Rien ne peut, mieux que le fait suivant, donner une idée exacte de l'ardeur de nos soldats pendant le combat. Les barbares élevaient leur bouclier au-dessus de leur tête et formaient ainsi la tortue. Les Romains sautèrent alors sur ces boucliers et de là leur plongeaient l'épée dans la gorge. Les Tenctères se plaignaient aussi des Germains. César se décide alors à passer la Moselle, et le Rhin lui-même sur un pont de bateaux, et cherche l'ennemi dans la forêt hercynienne. Mais toute la nation s'était dispersée dans les bois et les marais, si grand était l'effroi provoqué de l'autre côté de la rive par l'apparition soudaine des Romains. César franchit une deuxième fois le Rhin sur un pont qu'il fit construire. L'épouvante des ennemis fut plus grande encore. En voyant ce pont qui semblait un joug imposé à leur fleuve prisonnier, les Germains s'enfuirent de nouveau dans les forêts et les marécages, et le plus grand ennui de César fut de ne trouver personne à vaincre. Après avoir tout réglé sur terre et sur mer, il tourna les yeux vers l'océan, et, comme si le monde conquis ne suffisait pas aux Romains, il songea à en conquérir un autre. Il rassembla donc une flotte et il passa en Bretagne avec une rapidité étonnante : ayant quitté le port des Morins à la troisième veille, il aborda dans l'île avant midi. Son arrivée remplit de tumulte le rivage ennemi, et les Bretons, affolés à la vue de ce spectacle nouveau, faisaient voler leurs chars de tous côtés. Cet affolement nous tint lieu de victoire. Ils livrèrent en tremblant des armes et des otages à César qui serait allé plus loin, si l'océan n'eût châtié par un naufrage l'audace de sa flotte. Il revint donc en Gaule, accrut sa flotte, augmenta ses troupes, affronta de nouveau le même Océan et les mêmes Bretons qu'il poursuivit jusque dans les forêts de Calédonie, et jeta en prison l'un de leurs rois, Cassivellaunus. Se contentant de ces succès - car il se préoccupait moins de l'acquisition d'une province que de sa gloire, - il revint avec un plus riche butin que la première fois. L'Océan lui-même, plus tranquille, favorisa son retour, comme s'il s'avouait vaincu. Mais la plus grande et en même temps la dernière de toutes les ligues gauloises fut celle où les Arvernes, les Bituriges, les Carnutes et les Séquanes se coalisèrent sous la direction d'un chef que sa taille, ses armes et son courage rendaient terrible et dont le nom même semblait fait pour engendrer l'épouvante, Vercingétorix. Aux jours de fêtes et dans les assemblées, quand il les voyait réunis en très grand nombre dans les bois, il les excitait par des paroles véhémentes à recouvrer leur ancienne liberté. César n'était pas là ; il levait alors des troupes à Ravenne. L'hiver avait accru la hauteur des Alpes, et les Gaulois pensaient que le passage était fermé. Mais immédiatement, à la première nouvelle du soulèvement, César, avec une heureuse témérité, franchit des montagnes jusqu'alors jugées inaccessibles, et par des routes et des neiges que nul homme n'avait foulées, il pénétra en Gaule avec quelques troupes légères. Il rassembla ses légions dispersées dans des quartiers d'hiver éloignés, et il se trouva au milieu de la Gaule avant qu'on ne craignît son retour à la frontière. Il attaque alors les principaux centres de la guerre ; il détruit Avaricum, défendue par quarante mille hommes, et malgré les efforts de deux cent cinquante mille Gaulois il incendie et anéantit Alésia. C'est autour de Gergovie, en Auvergne, que porta tout le poids de la guerre. Quatre-vingt mille hommes protégés par des murs, une citadelle et des rochers escarpés, défendaient cette très grande ville. Mais César l'entoura d'un retranchement garni de pieux et d'un fossé dans lequel il détourna le fleuve qui l'arrose ; il construisit en outre un immense parapet de dix-huit tours, et il commença par affamer la ville. Quand les assiégés osèrent tenter des sorties, ils succombèrent sur le retranchement sous les épées et les pieux de nos soldats ; enfin, ils durent se rendre. Leur roi lui-même, le plus bel ornement de la victoire, vint en suppliant au camp romain, sur son cheval dont il jeta les ornements, en même temps que ses propres armes, aux pieds de César. "Ils sont à toi, dit-il, je suis brave, mais tu es plus brave, et tu m'as vaincu."
XII. - Guerre des Parthes.- Pendant que grâce à César il soumettait les Gaulois dans le nord, le peuple romain, en Orient, reçut des Parthes une cruelle blessure. Mais nous ne pouvons nous plaindre de la fortune, notre désastre n'admet pas cette consolation. Malgré l'opposition des dieux et des hommes, le consul Crassus désirait ardemment s'emparer de l'or des Parthes ; sa cupidité fut punie par le massacre de onze légions et la perte de sa propre vie. Le tribun du peuple Métellus l'avait, à son départ, voué aux furies vengeresses ; à sa sortie de Zeugma, ses enseignes, emportées par un tourbillon soudain, furent englouties dans l'Euphrate. Il campait à Nicéphore, lorsque des ambassadeurs du roi Orode vinrent lui rappeler les traités conclus avec Pompée et Sylla. Mais Crassus, avide de posséder les trésors du roi, ne daigna pas fournir le moindre prétexte, même imaginaire, et répondit qu'il répondrait à Séleucie. Aussi les dieux, vengeurs des traités, favorisèrent-ils les ruses et le courage des ennemis. Tout d'abord, il s'écarta de l'Euphrate qui, seul, pouvait transporter ses vivres et le protéger par derrière ; il se fiait alors à un prétendu transfuge, le Syrien Mazara. Ce même individu, choisi pour guide, conduisit ensuite l'armée au milieu de vastes plaines, afin de l'exposer de partout aux coups de l'ennemi. A peine était-il arrivé à Carres, que les généraux du roi, Sillace et Suréna montrèrent de toutes parts leurs enseignes étincelantes d'or et de soie. Aussitôt nous fûmes enveloppés de tous les côtés par la cavalerie parthe qui fit pleuvoir sur nous une grêle de traits. Tel fut l'affreux carnage qui anéantit notre armée. Notre général lui-même, appelé à une entrevue, serait, à un signal donné, tombé vivant aux mains de l'ennemi, sans la résistance des tribuns qui obligea les barbares à le tuer pour prévenir sa fuite. L'ennemi emporta d'ailleurs sa tête qui lui servit d'objet de risée. Le fils du général périt, frappé de la même manière, presque sous les yeux de son père. Les débris de cette malheureuse armée, fuyant au hasard, se dispersèrent en Arménie, en Cilicie, en Syrie, et c'est à peine s'il resta quelqu'un pour aller annoncer la nouvelle du désastre. La main droite de Crassus, et sa tête séparée du tronc, furent apportées au roi qui se livra à une odieuse plaisanterie, d'ailleurs trop méritée. Il lui versa dans la bouche de l'or fondu afin que, même après sa mort, l'or consumât le corps désormais insensible de cet homme, dont le coeur avait brûlé de la soif de l'or pendant sa vie.
XIII. -Récapitulation.- Tel est le troisième âge du peuple romain, celui qu'il passa au delà des mers, et pendant lequel il osa sortir de l'Italie et promena ses armes dans le monde entier. Les cent premières années de cet âge furent une époque de justice et de vertu, et, comme nous l'avons dit, un siècle d'or sans turpitude et sans crime. La vie pastorale, dans toute son intégrité et dans toute son innocence, ainsi que la crainte de l'ennemi Carthaginois toujours menaçant maintenaient les anciennes moeurs. Les cent années suivantes que nous avons fait commencer à la destruction de Carthage, de Corinthe et de Numance et à l'héritage asiatique du roi Attale, pour les terminer à César, à Pompée et à Auguste, leur successeur - dont nous parlerons - connaissent la gloire de magnifiques exploits militaires, mais aussi la misère et la honte de nos malheurs domestiques. Sans doute, la Gaule, la Thrace la Cilicie, la Cappadoce, des provinces très riches et très puissantes, ainsi que l'Arménie et la Bretagne furent des conquêtes sinon utiles, du moins brillantes, qui ont valu à l'empire de beaux titres de gloire. Ces conquêtes furent belles et honorables. Mais la même époque a vu les luttes intestines entre les citoyens, les guerres avec les alliés, les esclaves, les gladiateurs, les dissensions du sénat tout entier divisé contre lui-même, et tout cela provoque la honte et la pitié. Je ne sais s'il n'eût pas été préférable pour le peuple romain de se contenter de la Sicile et de l'Afrique, ou même de se passer de ces provinces et de se borner à être le maître dans son pays d'Italie plutôt que de s'agrandir au point de succomber sous ses propres forces. Quelle fut, en effet, l'origine des guerres civiles, sinon l'excès de la prospérité ? La Syrie vaincue nous corrompit la première, puis ce fut l'héritage asiatique du roi de Pergame. Cette opulence et ces richesses portèrent un coup fatal aux moeurs de l'époque et entraînèrent la ruine de la république qui fut submergée et comme engloutie par ses propres vices. Pourquoi le peuple romain eût-il demandé à ses tribuns des terres et des vivres, s'il n'y avait été forcé par la famine que le luxe avait amenée ? De là sont venues les deux séditions des Gracques, et la troisième sédition, celle d'Apuleius. Les chevaliers se seraient-ils séparés du sénat à cause des lois judiciaires, si leur cupidité n'avait vu dans les revenus de l'Etat et même dans les jugements une source de profits ? C'est ce qui nous valut Drusus, la promesse du droit de cité aux Latins, et par suite la guerre sociale. Les guerres serviles ne viennent-elles pas du grand nombre des esclaves ? Des armées de gladiateurs se seraient-elles dressées contre leurs maîtres, si, afin de gagner la faveur d'un peuple passionné pour les spectacles, de folles libéralités n'avaient fait un art de ce qui servait autrefois au supplice des ennemis ? Pour parler maintenant de vices qui paraissent plus imposants, la recherche des honneurs n'a-t-elle pas été inspirée par ces mêmes richesses ? Ce fut l'origine des orages provoqués par Marius et Sylla. Le magnifique appareil des festins, les coûteuses largesses ne procèdent-ils pas de l'opulence d'où devait bientôt naître la pauvreté qui poussa Catilina contre sa patrie ? Enfin cet ardent désir de l'empire et de la domination n'a-t-il pas lui-même sa source dans l'excès des richesses ? Or, c'est lui qui arma César et Pompée de ces torches furieuses destinées à ruiner la république. Tous ces troubles qui éclatèrent à l'intérieur de l'État romain, nous les avons séparés des guerres étrangères et légitimes, et nous les exposerons successivement.
XIV.-Séditions provoquées par les tribuns.- Toutes les séditions ont eu pour origine et pour cause la puissance des tribuns. Sous prétexte de protéger la plèbe qu'ils étaient chargés de défendre, ils ne cherchaient qu'à acquérir pour eux-mêmes le pouvoir absolu et tâchaient de gagner l'affection et la faveur du peuple par des lois sur le partage des terres, sur les distributions de blé et sur l'administration de la justice. Ces lois avaient toutes une apparence d'équité. Quoi de plus juste, en effet, que de faire rendre à la plèbe les biens que lui avaient pris les patriciens et d'empêcher ainsi le peuple vainqueur des nations et maître de l'univers, de vivre en banni loin de ses champs et de ses foyers ? Quoi de plus équitable que de nourrir aux frais du trésor un peuple tombé dans la pauvreté ? Quoi de plus efficace pour maintenir l'indépendance entre les deux ordres que de confier au sénat le gouvernement des provinces et de donner à l'ordre équestre le droit de juger sans appel ? Mais ces réformes entraînaient de funestes conséquences, et la malheureuse république était le prix de sa propre ruine. Car en transférant du sénat aux chevaliers le pouvoir de juger, on supprimait les impôts, c'est-à-dire le patrimoine de l'empire, et les achats de blé épuisaient le trésor, le nerf même de l'État. Comment pouvait-on remettre la plèbe en possession de ses champs, sans ruiner les propriétaires actuels, qui faisaient, eux aussi, partie du peuple ? Ils tenaient ces domaines de leurs ancêtres, et le temps donnait à cette possession une sorte de caractère légitime.
XV. - Sédition de Tiberius Gracchus.- Tibérius Gracchus alluma le premier la torche des guerres civiles. Sa naissance, sa beauté, son éloquence le mettaient sans contredit au premier rang. Craignit-il d'être livré à l'ennemi, comme Mancinus, dont il avait garanti le traité, et se jeta-t-il pour cela dans le parti populaire ? ou se laissa-t-il guider par le sentiment de la justice et du bien et par la compassion qu'il éprouvait pour la plèbe chassée de ses terres, et ne voulut-il plus que le peuple vainqueur des nations et maître du monde fût banni de ses demeures et de ses foyers ? Quelles que fussent ses raisons, il s'attaqua à une entreprise considérable. Le jour où il proposa sa loi, entouré d'une foule immense, il monta à la tribune. Toute la noblesse s'était présentée en foule à cette assemblée, et elle avait des tribuns dans son parti. Mais quand il vit Cnaeus Octavius s'opposer à ses lois, sans respect pour la personne d'un collègue ni pour le droit de sa charge, il le fait arrêter, le chasse de la tribune, le menace de le faire mourir sur-le-champ et lui inspire une telle épouvante qu'il le force à se démettre de ses fonctions. Il fut ainsi nommé triumvir pour la répartition des terres. Pour achever la réalisation de son projet, le jour des comices il voulut faire proroger ses pouvoirs. Mais les nobles se portent à sa rencontre, accompagnés de ceux qu'il avait dépossédés de leurs champs, et on commence à se massacrer sur le forum. Tibérius se réfugie au Capitole, et porte la main à sa tête pour exhorter le peuple à défendre sa vie. Mais ce geste laisse croire qu'il réclame la royauté et le diadème. Scipion Nasica entraîne alors le peuple aux armes et le fait mettre à mort, comme il semblait le mériter.
XVI. -Sédition de Caius Graccus.- Caïus Gracchus entreprend aussitôt de venger la mort et les lois de son frère, et ne montre pas moins d'ardeur ni de violence. Comme Tibérius, il a recours au désordre et à la terreur ; il engage la plèbe à reprendre les terres de ses ancêtres et promet au peuple, pour assurer sa subsistance, la succession récente d'Attale. Un second tribunat lui avait donné un pouvoir excessif et tyrannique et il était soutenu par la faveur populaire. Le tribun Minucius ayant osé s'opposer à ses lois, Caïus, soutenu par une troupe de partisans, s'empare du Capitole, fatal à sa famille. Il en est chassé par le massacre de ses compagnons et se retire sur l'Aventin. Mais là encore il se heurte au parti du sénat, et le consul Opimius le fait mettre à mort. On insulta même ses restes inanimés, et la tête inviolable d'un tribun du peuple fut payée au poids de l'or à ses assassins.
XVII. - Sédition d'Apuleius.- Apuléius Saturninus n'en continua pas moins à soutenir les lois des Gracques, tant il y était encouragé par Marius, toujours ennemi de la noblesse et dont l'audace était encore accrue par un nouveau consulat. Il fit assassiner en pleine assemblée des comices A. Ninnius son compétiteur au tribunat, et s'efforça de faire nommer à sa place un homme sans tribu, sans répondant et sans nom, Caïus Gracchus, qui sous un titre supposé s'introduisait lui-même dans la famille des Gracques. Tout fier d'avoir impunément prodigué tant de grossiers outrages, il déploya une telle violence pour faire passer les lois des Gracques, qu'il força les sénateurs eux-mêmes à jurer de les respecter, menaçant d'interdire l'eau et le feu à ceux qui refuseraient de le faire. Il s'en trouva cependant un pour préférer l'exil. Le bannissement de Métellus consterna toute la noblesse. Maître absolu depuis trois ans, il se livra à de telles folies qu'il troubla même les comices consulaires par un nouveau meurtre. Pour élever au consulat Glaucia, le ministre de ses fureurs, il fit assassiner Caïus Memmius, son concurrent, et il apprit avec joie qu'au milieu du tumulte ses compagnons lui avaient donné à lui-même le titre de roi. Mais le sénat conspire sa perte. Marius lui-même, alors consul, ne pouvant le défendre, se déclare contre lui. On se bat sur le forum. Saturninus en est chassé et s'empare du Capitole ; mais on lui coupe les conduites d'eau et on l'y assiège. Il envoie des députés donner au sénat l'assurance de son repentir, descend de la citadelle avec les chefs de son parti, et il est reçu dans la Curie. Mais le peuple s'y précipite, l'accable de coups de bâtons et de pierres, et mutile son cadavre.
XVIII. - Sédition de Drusus.- Enfin Livius Drusus s'efforça de faire triompher ces mêmes lois en se servant non seulement de la puissance tribunitienne, mais aussi de l'autorité du sénat et du consentement de toute l'Italie. Mais en faisant succéder une prétention à une autre, il alluma un incendie si violent qu'il n'en put arrêter la première flamme ; et emporté par une mort soudaine, il laissa à ses descendants la guerre pour héritage. Par la loi judiciaire, les Gracques avaient divisé le peuple romain et donné deux têtes à l'État. Les chevaliers romains disposaient d'une puissance considérable ; ils tenaient entre leurs mains la destinée et la fortune des principaux citoyens et détournaient les revenus de la république qu'ils pillaient selon leur bon plaisir. Le sénat, affaibli par l'exil de Métellus et la condamnation de Rutilius, avait perdu tout l'éclat de sa majesté. Dans cet état de choses, Servilius Cépion et Livius Drusus, deux hommes égaux en ressources, en courage et en dignité - (et cette égalité même avait provoqué la jalousie de Livius Drusus) - prirent le premier le parti des chevaliers, le second celui du sénat. Les enseignes, les aigles, les étendards étaient déployés de part et d'autre, et à l'intérieur d'une même ville, les citoyens semblaient former deux camps ennemis. Cépion, le premier, attaqua le sénat et choisit, pour les accuser de brigue, Scaurus et Philippe, princes de la noblesse. Pour résister à ces attaques, Drusus attira le peuple dans son parti, en reprenant les lois des Gracques, en même temps qu'il gagnait les alliés à celui du peuple en leur promettant le droit de cité. On rapporte du même Drusus cette parole "qu'il n'avait rien laissé à distribuer, à moins de vouloir partager la boue ou l'air". Quand le jour de la promulgation fut arrivé, on vit tout à coup apparaître une telle quantité d'hommes, qu'une armée ennemie semblait être venue occuper la ville. Le consul Philippe osa cependant proposer une loi contraire, mais un huissier le saisit à la gorge et ne lâcha prise qu'après lui avoir fait sortir le sang par la bouche et par les yeux. Grâce à ces violences, les lois furent proposées et votées. Mais les alliés demandèrent immédiatement le prix de leur intervention. Drusus, incapable de tenir sa promesse, était affligé de ses téméraires innovations, lorsque la mort vint fort à propos le tirer de cette situation dangereuse. Les alliés, les armes à la main, n'en continuèrent pas moins à réclamer du peuple romain l'exécution des promesses de Drusus.
XIX. - Guerre sociale.- On peut l'appeler guerre sociale pour en atténuer l'horreur, mais, à dire vrai, ce fut une guerre civile. Le peuple romain étant un mélange d'Étrusques, de Latins et de Sabins, et tenant par le sang à tous ces peuples, a formé un seul corps avec ces différents membres et un tout avec ces éléments variés. La révolte des alliés à l'intérieur de l'Italie était donc aussi criminelle que celle des citoyens à l'intérieur de Rome. Les alliés réclamaient très justement le droit de cité dans une ville qui devait son accroissement à leurs forces. Drusus, poussé par ses vues ambitieuses, leur avait donné cet espoir. Quand il eut été assassiné chez lui, la même torche qui alluma son bûcher enflamma les alliés, qui prirent les armes pour attaquer Rome. Qu'y a-t-il de plus malheureux que cette affreuse guerre ? Qu'y a-t-il de plus triste ? Tout le Latium et le Picénum, toute l'Étrurie et la Campanie, l'Italie enfin se soulevait contre Rome, sa mère et sa nourrice. Nos alliés les plus braves et les plus fidèles avaient réuni toutes leurs forces, et se rangeaient chacun sous les étendards de ces chefs extraordinaires sortis des municipes. Poppédius conduisait les Marses ; Afranius, les Latins ; Plotius les Ombriens ; Egnatius, les Etrusques ; Télésinus les Samnites et les Lucaniens. Le peuple, arbitre des rois et des nations, ne pouvait se gouverner lui-même, et Rome, victorieuse de l'Asie et de l'Europe était attaquée par Corfinium. Les révoltés décidèrent d'abord d'immoler sur le mont Albain, le jour des féries latines, les consuls Julius César et Marcius Philippus, au milieu des sacrifices et des autels. Le secret de cette conjuration criminelle ayant été trahi, toute la fureur des conjurés éclata dans Asculum, où pendant la célébration des jeux ils égorgèrent tous les représentants de Rome qui s'y trouvaient. Ce fut le serment par lequel ils s'engagèrent dans cette guerre impie. Poppédius, le chef et l'instigateur de la guerre, parcourut toutes les régions de l'Italie, et de tous les côtés la trompette guerrière retentit parmi les peuples et les villes. Ni Hannibal ni Pyrrhus ne firent tant de ravages. Ocriculum, Grumentum, Fésules, Carséoles, Esernie, Nucérie, Picence furent saccagées, mises à feu et à sang. Les troupes de Rutilius, celles de Cépion furent défaites. Julius César lui-même, ayant perdu son armée, fut rapporté à Rome tout sanglant et comme le triste cortège traversait la ville, il succomba dans la rue. Mais le peuple romain, dont la fortune toujours grande est plus grande encore dans l'adversité, se relève enfin avec toutes ses forces. Il attaque chaque peuple séparément. Caton disperse les Etrusques, Gabinius les Marses, Carbon les Lucaniens, Sylla les Samnites. Pompéius Strabon porte de tous les côtés le fer et le feu, et ne s'arrête de massacrer qu'après avoir rasé Asculum et ainsi apaisé les mânes de tant d'armées et de consuls, et les dieux de tant de villes saccagées.
XX. - Guerre contre les esclaves.- Si la guerre sociale était sacrilège, on la fit du moins contre des hommes de condition et de naissance libres. Mais qui pourrait ne pas s'indigner en voyant le peuple-roi combattre des esclaves ? Dans les commencements de Rome, une première guerre servile fut tentée à l'intérieur même de la ville par le Sabin Herdonius, alors que l'État était en proie aux séditions tribunitiennes. Herdonius occupa le Capitole, qui fut repris par le Consul. Mais ce fut une émeute plutôt qu'une guerre. Qui eût cru que plus tard, lorsque l'empire s'étendait dans les contrées les plus diverses, une guerre servile ensanglanterait la Sicile beaucoup plus cruellement que la guerre punique ? La province de Sicile est une contrée fertile ; c'était en quelque sorte un faubourg de Rome, et les citoyens romains y possédaient de vastes domaines. Ils y entretenaient de nombreux esclaves indispensables à la culture de leurs terres, et ces cultivateurs à la chaîne furent la cause de la guerre. Un Syrien, nommé Eunus - (la grandeur des désastres qu'il causa nous empêche d'oublier son nom) - simula l'enthousiasme prophétique, et, jurant par les cheveux de la déesse syrienne, appela les esclaves, comme par l'ordre des dieux, à la liberté et aux armes. Pour prouver qu'il était inspiré par une divinité, il dissimulait dans sa bouche une noix remplie de soufre allumé, sur laquelle il soufflait légèrement, et il jetait ainsi des flammes en parlant. Ce prodige lui permit de rassembler autour de lui d'abord deux mille esclaves qu'il avait rencontrés, puis, les armes à la main, il brisa les portes des prisons et se constitua une armée de plus de soixante mille hommes. Pour couronner ses forfaits, il se para d'ornements royaux. Il désola par d'affreux pillages les petites forteresses, les villages et les villes. Bien plus, et ce fut pour nous le comble de la honte, il s'empara des camps de nos prêteurs. Je ne rougirai point de les nommer : c'étaient les camps de Manlius, de Lentulus, de Pison, d'Hypsée. Ainsi des esclaves, qui auraient dû être ramenés par des hommes lancés à leur poursuite, poursuivaient eux-mêmes des généraux prétoriens qu'ils avaient vaincus et mis en fuite. Ils furent enfin châtiés par notre général Perperna. Il les vainquit près d'Henna, finit par les bloquer dans la ville et les réduisit par la famine, qui fut suivie de la peste. Ce qui restait de brigands fut chargé de fers et de chaînes, et mis en croix. Perperna, leur vainqueur, se contenta d'une ovation, afin de ne pas souiller la dignité du triomphe par l'inscription d'une victoire remportée sur des esclaves. A peine l'île avait-elle repris haleine, que tout de suite sous le préteur Servilius la révolte recommença, non plus avec un Syrien, mais avec un Cilicien. Le pâtre Athénion, après avoir assassiné son maître, délivre de leur prison ses compagnons d'esclavage, et les range sous ses enseignes. Portant une robe de pourpre et un bâton d'argent, le front ceint d'un bandeau royal, il rassemble une armée au moins aussi nombreuse que celle de son fanatique prédécesseur, et, comme s'il voulait le venger, il se montre encore beaucoup plus cruel, torturant les maîtres et surtout les esclaves, qu'il traite comme des transfuges. Il battit aussi des armées prétoriennes, prit le camp de Servilius, et le camp de Lucullus. Mais Titus Aquilius, à l'exemple de Perperna, le réduisit à l'extrémité en lui coupant les vivres et détruisit facilement par les armes des troupes affaiblies par la faim. Elles se seraient rendues si la crainte des supplices ne leur eût fait préférer une mort volontaire. On ne put même infliger à leur chef aucun supplice, bien qu'il fût tombé vivant entre nos mains. Entouré d'une foule de soldats qui se disputaient cette proie, il fut, dans la lutte, déchiré entre leurs mains.
XXI. - Guerre contre Spartacus.- On supporterait peut-être encore la honte d'une guerre contre des esclaves. S'ils sont, par leur condition, exposés à toutes les servitudes, ils n'en sont pas moins comme une seconde espèce d'hommes, et nous les associons aux avantages de notre liberté. Mais quel nom donner à la guerre provoquée par Spartacus ? Je ne sais ; car des esclaves y servirent, des gladiateurs y commandèrent. Les premiers étaient de la plus basse condition, les seconds de la pire des conditions, et de tels adversaires accrurent les malheurs de Rome par la honte dont ils les couvrirent. Spartacus, Crixus, OEnomaus, après avoir brisé les portes de l'école de Lentulus, s'enfuirent de Capoue avec trente hommes au plus de leur espèce. Ils appelèrent les esclaves sous leurs drapeaux et réunirent tout de suite plus de dix mille hommes. Non contents de s'être évadés, ils aspiraient maintenant à la vengeance. Telles des bêtes sauvages, ils s'installèrent d'abord sur le Vésuve. Assiégés là par Clodius Glaber, ils se glissèrent le long des gorges caverneuses de la montagne à l'aide de liens de sarments et descendirent jusqu'au pied ; puis s'élançant par une issue invisible, ils s'emparèrent tout à coup du camp de notre général qui ne s'attendait pas à une pareille attaque. Ce fut ensuite le tour du camp de Varénus, puis de celui de Thoranius. Ils parcoururent toute la Campanie, et non contents de piller les fermes et les villages, ils commirent d'effroyables massacres à Nole et à Nucérie, à Thurium et à Métaponte. Leurs troupes grossissaient chaque jour, et ils formaient déjà une véritable armée. Avec de l'osier et des peaux de bêtes, ils se fabriquèrent de grossiers boucliers ; et le fer de leurs chaînes, refondu, leur servit à forger des épées et des traits. Pour qu'il ne leur manquât rien de ce qui convenait à une armée régulière, ils se saisirent aussi des troupeaux de chevaux qu'ils rencontrèrent, se constituèrent une cavalerie, et ils offrirent à leur chef les insignes et les faisceaux pris à nos préteurs. Spartacus ne les refusa point, Spartacus, un ancien Thrace tributaire devenu soldat, de soldat déserteur, ensuite brigand, puis, en considération de sa force, gladiateur. Il célébra les funérailles de ses officiers morts en combattant avec la pompe réservée aux généraux, et il força des prisonniers à combattre, les armes à la main, autour de leur bûcher. Cet ancien gladiateur espérait effacer ainsi l'infamie de tout son passé en donnant à son tour des jeux de gladiateurs. Puis il osa attaquer des armées consulaires ; il écrasa celle de Lentulus dans l'Apennin, et près de Modène il détruisit le camp de Caïus Crassus. Enorgueilli par ces victoires, il songea à marcher sur Rome, et cette seule pensée suffit à nous couvrir de honte. Enfin, toutes les forces de l'empire se dressèrent contre un vil gladiateur, et Licinius Crassus vengea l'honneur romain. Repoussés et mis en fuite, les ennemis, - je rougis de leur donner ce nom - se réfugièrent à l'extrémité de l'Italie. Enfermés dans les environs de la pointe du Bruttium, ils se disposaient à fuir en Sicile. N'ayant pas de navires, ils construisirent des radeaux avec des poutres et attachèrent ensemble des tonneaux avec de l'osier ; mais l'extrême violence du courant fit échouer leur tentative. Enfin, ils se jetèrent sur les Romains et moururent en braves. Comme il convenait aux soldats d'un gladiateur, ils ne demandèrent pas de quartier. Spartacus lui-même combattit vaillamment et mourut au premier rang, comme un vrai général.
XXII. - Guerre civile de Marius.- Il ne restait plus au peuple romain, pour combler la mesure de ses maux, qu'à tirer contre lui-même, dans Rome, un fer parricide, et à considérer le centre de la ville et le forum comme une arène où les citoyens lutteraient contre les citoyens, à la manière des gladiateurs. Cependant ma douleur serait moins vive si des chefs plébéiens ou du moins des nobles méprisables avaient dirigé cette criminelle entreprise. Mais, ô forfait ! - quels hommes et quels généraux ce furent ! Marius et Sylla, la gloire et l'ornement de leur siècle, prêtèrent l'éclat de leur nom au pire des attentats. La guerre civile de Marius ou de Sylla éclata, pour ainsi dire, sous l'influence de trois astres différents. Ce fut d'abord une agitation faible et légère, plutôt qu'une guerre, les chefs se contentant d'exercer contre eux-mêmes leur cruauté ; le second orage fut plus violent et plus sanglant, le vainqueur déchirant les entrailles du sénat lui-même ; le dernier dépassa la violence des luttes civiles et même des guerres contre les ennemis : la fureur des armes était soutenue par toutes les forces de l'Italie, et les haines se déchaînèrent, jusqu'au moment où il n'y eut plus personne à assassiner. L'origine et la cause de cette guerre furent cette soif insatiable des honneurs qui poussa Marius à solliciter, en vertu de la loi Sulpicia, la mission confiée à Sylla. Ne pouvant supporter cet affront, Sylla ramène aussitôt ses légions, et, laissant provisoirement Mithridate, il fait entrer dans Rome, par la porte Esquiline et la porte Colline, ses troupes divisées en deux colonnes. Mais les consuls Sulpicius et Albinovanus lui opposent leurs troupes, et des pierres et des traits lui sont lancés de toutes parts du haut des murailles. Il s'ouvre un chemin en semant partout l'incendie. La citadelle du Capitole qui avait échappé aux Carthaginois et même aux Gaulois Sénons tombe entre ses mains, et il s'y établit en vainqueur. Alors un sénatus-consulte déclare ses adversaires ennemis publics, et il fait légalement mettre à mort le tribun resté à Rome et d'autres citoyens du parti adverse. Marius s'échappa en fuyant sous un habit d'esclave, ou, pour mieux dire, la fortune le réserva pour une autre guerre. Sous le consulat de Cornélius Cinna et de Cnéus Octavius, l'incendie mal éteint se ralluma. La discorde éclata entre les deux consuls, lorsqu'on proposa au peuple de rappeler les citoyens que le sénat avait déclarés ennemis publics. L'assemblée était même entourée d'hommes en armes, mais la victoire de ceux qui préféraient la paix et le repos obligea Cinna à quitter Rome et à se réfugier auprès de ses partisans. Marius revient d'Afrique, grandi par sa disgrâce : sa prison, ses chaînes, sa fuite, son exil avaient donné à sa dignité quelque chose de terrible. Au seul nom d'un si grand capitaine, on accourt de toutes parts. Mais, ô honte ! il arme des esclaves, même des esclaves échappés de prison, et ce général malheureux trouve facilement une armée. Il revendique ainsi par la force sa patrie d'où la force l'avait chassé, et sa conduite pouvait paraître légitime s'il n'eût souillé sa cause par sa cruauté. Mais il revenait le coeur plein de haine contre les dieux et les hommes. Tout de suite, il tombe sur Ostie, la cliente et la nourrice de Rome ; il s'en empare immédiatement, la pille et y fait un épouvantable carnage. Bientôt quatre armées entrent dans Rome : Cinna, Marius, Carbon, Sertorius étaient à la tête de chacune d'elles. Dès que toutes les troupes d'Octavius eurent été chassées du Janicule, on donna aussitôt le signal pour le massacre des principaux citoyens, et Rome fut traitée avec un peu plus de barbarie qu'une ville de Carthaginois ou de Cimbres. La tête du consul Octavius est exposée devant la tribune aux harangues, celle de l'ancien consul Antoine sur la table même de Marius. Les deux Césars sont égorgés par Fimbria près de l'autel de leurs dieux domestiques ; les deux Crassus, le père et le fils, sont tués sous les yeux l'un de l'autre. Les crocs des bourreaux traînèrent Bébius et Numitorius au milieu du forum. Catulus respira des vapeurs asphyxiantes pour échapper aux outrages de ses ennemis. Mérula, prêtre de Jupiter, arrosa dans le Capitole les yeux mêmes du dieu avec le sang qui jaillissait de ses veines. Ancharius fut percé de coups à la vue même de Marius, qui ne lui avait pas tendu, pour répondre à son salut, sa main, arbitre des destinées. Tous ces sénateurs périrent entre les calendes et les ides de janvier, pendant ce septième consulat de Marius. Que serait-il arrivé, s'il avait achevé son année consulaire ? Sous le consulat de Scipion et de Norbanus, le troisième orage des guerres civiles éclata dans toute sa fureur. D'un côté, huit légions et cinq cents cohortes étaient sous les armes ; de l'autre Sylla accourait d'Asie avec son armée victorieuse. Et quand Marius avait été si barbare envers les partisans de Sylla, que de cruautés ne fallait-il pas pour venger Sylla de Marius ? La première bataille se livra près de Capoue, sur les bords du Vulturne. Tout de suite, l'armée de Norbanus fut mise en déroute, et Scipion perdit aussitôt toutes ses troupes, trompées par l'espoir de la paix. Alors le jeune Marius et Carbon, tous deux consuls, semblent désespérer de la victoire. Mais ils ne veulent pas mourir sans vengeance et préludent à leurs funérailles en répandant le sang des sénateurs. Ils investissent la Curie et tirent du Sénat, comme d'une prison, les victimes destinées à être égorgées. Que de meurtres sur le forum, dans le Cirque, et dans l'intérieur des temples ! Le grand-prêtre Mucius Scévola qui tenait embrassé l'autel de Vesta faillit avoir le feu sacré pour sépulture. Lamponius et Télésinus, chefs des Samnites, ravagent la Campanie et l'Étrurie plus cruellement que Pyrrhus et Hannibal, et, sous prétexte de soutenir un parti, ils se vengent des Romains. Toutes les troupes ennemies furent écrasées à Sacriport et près de la Porte Colline : là fut défait Marius, ici Télésinus. Cependant les massacres ne finirent point avec la guerre. Les épées restaient tirées même pendant la paix, et on frappa des citoyens qui s'étaient rendus volontairement. Que Sylla ait massacré à Sacriport et près de la Porte Colline plus de soixante-dix mille hommes, passe encore ; c'était la guerre. Mais il fit tuer dans un édifice public quatre mille citoyens désarmés qui s'étaient rendus : ce massacre exécuté en pleine paix n'est-il pas plus atroce ? Et qui pourrait faire le compte de toutes ces victimes assassinées partout dans Rome, au gré des meurtriers ? Enfin Fufidius ayant rappelé à Sylla qu'il fallait laisser la vie à quelques citoyens pour avoir à qui commander, on vit paraître cette longue liste qui ordonnait la mort de deux mille hommes, choisis parmi l'élite des chevaliers et du Sénat. C'était le premier exemple de ce genre d'édit. Il m'en coûte de raconter, après ces horreurs, les outrages qui accompagnèrent la mort de Carbon, celle de Soranus, celles de Plétorius et de Vénuleius. Bébius fut mis en pièces non par le fer, mais par les mains de ses meurtriers, véritables bêtes sauvages. Près du tombeau de Catulus, Marius, le frère même du général, eut les yeux crevés, les mains et les jambes brisées, et on le laissa quelque temps en cet état, pour qu'il se sentît mourir par tous ses membres. Quand on eut presque renoncé aux supplices individuels, on vendit à l'encan les municipes les plus florissants de l'Italie : Spolète, Interamnium, Préneste, Florence. Quant à Sulmone, une vieille ville, alliée et amie de Rome, elle fut victime d'un attentat abominable. Sylla ne la prend point d'assaut ni ne l'assiège pas conformément au droit de la guerre ; mais de même qu'on fait conduire au supplice les condamnés à mort, il ordonne la destruction de la ville, après l'avoir condamnée.
XXIII. - Guerre contre Sertorius.- La guerre contre Sertorius fut-elle autre chose qu'un héritage de la proscription de Sylla ? Faut-il l'appeler guerre étrangère ou guerre civile ? Je ne sais. Car elle fut faite par des Lusitaniens et des Celtibériens, sous la conduite d'un général romain. Exilé et fuyant la liste fatale, cet homme d'un grand mais malheureux courage bouleversa les mers et les terres de ses funestes projets. Il tenta la fortune en Afrique et aux îles Baléares, et pénétra dans l'Océan jusqu'aux îles Fortunées. Enfin, il arma l'Espagne. Un homme de coeur s'entend facilement avec des hommes de coeur. La valeur du soldat espagnol ne se fit jamais mieux remarquer que sous un général romain. D'ailleurs, non content d'avoir soulevé l'Espagne, Sertorius tourna les yeux vers Mithridate et les peuples du Pont, et fournit une flotte à ce prince. Que ne pouvait-on craindre d'un si grand ennemi, auquel Rome ne pouvait résister avec un seul général ? A Métellus, on adjoignit Cnéus Pompée, et ces deux chefs finirent par écraser ses troupes, après les avoir poursuivies presque par toute l'Espagne. Les combats furent nombreux, mais toujours sans résultat décisif, et s'il succomba enfin, ce ne fut pas sur le champ de bataille, mais parce qu'il fut trahi et assassiné par les siens. Les premiers combats furent livrés par les lieutenants des deux partis. Domitius et Thorius d'un côté, les deux Herculéius de l'autre, préludèrent à la guerre. Mais ces derniers furent défaits près de Ségovie, les autres sur les bords de l'Ana. Les généraux se mesurèrent alors eux-mêmes, et essuyèrent tour à tour une égale défaite près de Laurone et de Sucrone. Ils se mirent ensuite, les uns à ravager les campagnes, les autres à détruire les villes, et la malheureuse Espagne portait la peine de la discorde qui régnait entre les généraux romains. Enfin, quand Sertorius eut été victime de la trahison des siens, quand Perperna eut été vaincu et livré, les Romains reçurent aussi la soumission des villes d'Osca, Thermes, Ulia, Valence, Auxume et Calagurris, qui avait connu toutes les horreurs de la famine. Ainsi l'Espagne recouvra la paix. Les généraux victorieux voulurent voir dans cette guerre une guerre étrangère plutôt qu'une guerre civile, afin d'obtenir le triomphe.
XXIV. - Guerre civile de Lepidus.- Sous le consulat de Marcus Lépidus et de Quintus Catulus, il s'éleva une guerre civile, qui fut éteinte presque avant d'éclater. Mais si courte que fût sa durée elle ne s'en alluma pas moins au bûcher même de Sylla. Avide de nouveautés, Lépidus eut la présomption de vouloir abolir les actes d'un si grand personnage. Il n'aurait pas eu tort, s'il avait pu le faire sans grand dommage pour la république. Le droit de la guerre avait permis à Sylla, alors dictateur, de proscrire ses ennemis. En rappelant ceux qui survivaient, Lépidus ne les appelait-il pas aux armes ? Sylla avait vendu aux enchères les biens des citoyens condamnés ; cette vente, si injuste fût-elle, était légale. Les restituer, c'était sans aucun doute ébranler l'État enfin rendu à la paix. Malade et blessée, la république avait avant tout besoin de repos et, en voulant soigner ses blessures, on risquait de les rouvrir. Après que les harangues séditieuses de Lépidus eurent jeté dans la ville la même terreur que la trompette guerrière, Lépidus partit en Étrurie et y leva une armée qu'il fit marcher sur Rome. Mais déjà le pont Milvius et le Janicule avaient été occupés par une autre armée que commandaient Lutatius Catulus et Cnéus Pompée, chefs et porte-drapeaux du parti de Sylla. Ils le repoussèrent dès le premier choc, et le sénat le déclara ennemi public. Lépidus s'enfuit sans verser de sang et se retira en Étrurie, puis en Sardaigne, où il mourut de maladie et de regret. De leur côté, les vainqueurs, donnant un exemple rare dans les guerres civiles, se contentèrent d'avoir rétabli la paix.

LIVRE QUATRIEME
I.- Guerre contre Catilina.- La débauche, puis la ruine de son patrimoine qui en résulta, et en même temps l'occasion propice que fournissait l'éloignement des armées romaines, alors dispersées aux extrémités du monde, inspirèrent à Catilina le criminel projet d'opprimer sa patrie. Il voulait poignarder les sénateurs, égorger les consuls, semer partout l'incendie dans la ville, piller le trésor, enfin détruire de fond en comble toute la république, et dépasser par ses forfaits tout ce que semblait avoir souhaité Hannibal. Et quels furent, grands dieux ! les complices de cet attentat ! Il était lui-même patricien, mais c'est peu encore, à côté des Curius, des Porcius, des Sylla, des Céthégus, des Autronius, des Varguntéius et des Longinus, ces illustres familles, ces ornements du sénat ! Il y avait aussi Lentulus, alors préteur ! Et tous ces grands personnages furent les complices de son crime monstrueux. Les conjurés scellèrent leur accord en buvant du sang humain dans des coupes qu'ils se passaient de main en main : infâme sacrilège qui ne fut dépassé que par celui auquel ils s'engageaient. C'en était fait d'un si bel empire, si ce complot ne s'était heurté aux consuls Cicéron et Antoine, dont l'un découvrit la conjuration par son activité et l'autre l'étouffa par la force. Cet épouvantable forfait fut dénoncé par Fulvie, une courtisane méprisable, mais moins criminelle que ces parricides. Le consul convoque le sénat, et accuse le coupable, présent dans l'assemblée. Mais il ne réussit qu'à laisser échapper l'ennemi qui menace publiquement et ouvertement d'éteindre sous les ruines l'incendie allumé contre lui. Catilina va rejoindre l'armée que Manlius lui a préparée en Étrurie, décidé à marcher sur Rome. Lentulus, pensant obtenir pour lui-même la royauté promise à sa famille par les oracles sibyllins dispose dans toute la ville, au jour fixé par Catilina, des soldats, des torches et des armes. Ne se contentant pas d'une conjuration domestique, il sollicite le concours des députés Allobroges, qui se trouvaient alors à Rome. La fureur des conjurés eût franchi les Alpes, si une seconde trahison, celle de Vulturcius, n'eût livré la lettre du préteur. Cicéron fait aussitôt arrêter les barbares. Le préteur est convaincu en plein sénat. On délibère sur le supplice à infliger aux conjurés. César conseille la clémence, par égard pour leur dignité, Caton propose de punir leur crime. Tous les sénateurs se rangent à ce dernier avis, et les parricides sont étranglés dans leur prison. Bien que la conjuration eût été en partie étouffée, Catilina ne renonce pas à son entreprise. Il déploie ses étendards, et de l'Étrurie, il marche contre sa patrie. Mais il rencontre l'armée d'Antoine qui l'écrase. L'issue du combat révéla l'acharnement des rebelles : pas un seul ennemi ne survécut à la bataille. Chacun d'eux, après sa mort, couvrait de son cadavre la place qu'il avait occupée dans le combat. On trouva Catilina loin des siens, au milieu de cadavres ennemis : c'eût été une très belle mort, s'il était ainsi tombé pour sa patrie.
II. - Guerre civile de César et de Pompée.- Presque tout l'univers était pacifié, et l'empire romain était trop puissant pour être écrasé par une force étrangère. Mais la fortune, jalouse du peuple-roi, l'arma lui-même pour sa propre ruine. La rage de Marius et de Cinna avait été, à l'intérieur de Rome, le prélude et comme l'essai des guerres civiles. L'orage provoqué par Sylla avait éclaté sur une plus grande étendue, sans dépasser toutefois l'Italie. Les fureurs de César et de Pompée enveloppèrent Rome, l'Italie, les peuples, les nations, enfin toute l'étendue de l'empire comme dans une sorte de déluge ou d'embrasement. On ne saurait leur donner le nom de guerre civile, pas même celui de guerre sociale ; ce n'est cependant pas une guerre étrangère ; c'est quelque chose qui les comprend toutes, c'est même quelque chose de plus qu'une guerre. Considère-t-on les chefs ? tout le sénat y participe ; les armées ? on voit d'un côté onze, de l'autre dix-huit légions, toute la fleur et la force du sang italien ; les troupes fournies par les alliés ? ici, vous avez les Gaulois et les Germains, là Déjotarus, Ariobarzane, Tarchondimotus, Cotys et Rhascypolis, toutes les forces de la Thrace, de la Cappadoce, de la Macédoine, de la Cilicie, de la Grèce et de tout l'Orient. Quant à la durée de la guerre, elle fut de quatre ans, court espace pour tant de désastres. Veut-on savoir les lieux et les pays où elle se déroula ? Elle commença en Italie, d'où elle se détourna vers la Gaule et l'Espagne ; puis revenant de l'Occident, elle concentra toute sa violence en Épire et en Thessalie ; de là elle s'élança tout à coup sur l'Égypte, puis regarda vers l'Asie et s'abattit sur l'Afrique ; enfin elle revint vers l'Espagne où elle finit par expirer. Mais les haines des partis ne cessèrent pas avec la guerre. Elles se calmèrent seulement, lorsque dans Rome même, au milieu du sénat, le sang du vainqueur eut assouvi la haine des vaincus. La cause d'une pareille calamité fut, comme pour toutes les autres, l'excès de la prospérité. Sous le consulat de Quintus Métellus et de Lucius Afranius, alors que Rome imposait partout sa domination au monde entier et chantait sur les théâtres de Pompée les récentes victoires et les triomphes du Pont et de l'Arménie, la puissance excessive de Pompée provoqua l'ordinaire jalousie des citoyens oisifs. Métellus furieux d'avoir vu diminuer l'éclat de son triomphe de Crète, et Caton, toujours adversaire des citoyens puissants, dénigraient Pompée et critiquaient ses actes. Égaré par le ressentiment, Pompée chercha des appuis pour maintenir son crédit. Crassus brillait alors par sa naissance, ses richesses et son crédit ; il voulait cependant devenir plus puissant encore. César s'élevait grâce à son éloquence, à son courage, et aussi grâce à son consulat. Pompée, toutefois, les dépassait tous les deux. César voulait donc fonder, Crassus accroître, Pompée conserver sa puissance. Tous les trois également avides du pouvoir, ils s'entendirent facilement pour s'emparer de la république. Ils se prêtèrent mutuellement l'appui de leurs forces dans l'intérêt de leur gloire particulière, et César s'empara de la Gaule, Crassus de l'Asie, Pompée de l'Espagne. Ils disposaient de trois puissantes armées, et trois chefs possédaient ainsi en commun l'empire du monde. Cette domination dura loyalement pendant dix ans, parce qu'une crainte mutuelle maintenait leur union. Mais la mort de Crassus chez les Parthes et celle de Julie, fille de César, qui par les liens de son mariage avec Pompée était un gage de concorde entre le gendre et le beau-père, firent éclater soudain leur jalousie. La puissance de César inquiétait déjà Pompée, et César ne pouvait supporter l'autorité de Pompée. L'un ne voulait pas d'égal, l'autre ne voulait pas de maître, et dans leur rivalité sacrilège, ils se disputaient le premier rang, comme si la fortune d'un si grand empire ne pouvait suffire à deux hommes. Sous le consulat de Lentulus et de Marcellus, l'alliance fut rompue pour la première fois. Le sénat, c'est-à-dire Pompée, délibérait sur le remplacement de César. Celui-ci ne refusait pas un successeur, si on tenait compte de sa candidature dans les prochains comices. Mais Pompée, par de sourdes intrigues, voulait lui faire refuser en son absence le consulat qu'il lui avait fait naguère décerner par les dix tribuns. On exigeait qu'il vînt briguer cette magistrature selon l'antique usage. César, de son côté, réclamait l'exécution du décret, affirmant que si les engagements n'étaient pas respectés, il ne congédierait point son armée. On le déclara alors ennemi public. Cette mesure l'exaspéra, et il décida de défendre par les armes ce qu'il avait acquis par les armes. Le premier théâtre de la guerre civile fut l'Italie. Pompée n'avait mis que de faibles garnisons dans les places fortes. Rien ne résista à l'attaque soudaine de César. La trompette guerrière sonna d'abord à Ariminum. Libon fut chassé de l'Etrurie, Thermus de l'Ombrie, Domitius de Corfinium. La guerre se fût terminée sans effusion de sang, s'il avait réussi à prendre Pompée dans Brundisium. Celui-ci allait tomber en son pouvoir, lorsqu'il s'échappa la nuit en franchissant les digues qui bloquaient le port. O honte ! Le premier des sénateurs, l'arbitre de la paix et de la guerre parcourait cette mer dont il avait triomphé, monté sur un vaisseau délabré et presque désarmé, et il fuyait ! L'abandon de l'Italie par Pompée n'était pas plus déshonorant que l'abandon de Rome par le Sénat. César entre dans cette ville que la peur avait rendue presque déserte et se nomma lui-même consul. Les tribuns tardant trop à lui ouvrir le trésor sacré, il en brise les portes et s'empare des revenus et du patrimoine du peuple romain avant de s'emparer de l'empire. Une fois Pompée chassé et mis en fuite, il aima mieux régler les affaires des provinces que de se lancer à sa poursuite, et pour assurer son ravitaillement, il fit occuper la Sicile et la Sardaigne par ses lieutenants. Il n'avait pas de guerre à redouter du côté de la Gaule, car il y avait lui-même établi la paix. Mais comme il y passait pour aller combattre en Espagne les armées de Pompée, Marseille osa lui fermer ses portes. La malheureuse ! Elle désirait la paix, et la crainte de la guerre la précipita dans la guerre. Comme elle était défendue par de solides murailles, César donna l'ordre de la lui soumettre en son absence. Cette ville grecque n'avait point la mollesse que laissait supposer son nom, et ses habitants osèrent forcer les retranchements de l'ennemi, incendier ses machines, et même attaquer sa flotte. Mais Brutus chargé de cette guerre les vainquit et les dompta sur terre et sur mer. Ils se rendirent bientôt, et on leur enleva tous leurs biens, excepté celui qu'ils préféraient à tous, la liberté. La guerre d'Espagne contre les lieutenants de Pompée, Pétréius et Afranius, fut indécise et mêlée de succès divers, mais peu sanglante. Ces généraux campaient à Ilerda sur les bords de la Sègre. César entreprit de les bloquer et de couper leurs communications avec la ville. Cependant, les inondations du fleuve au printemps empêchaient l'arrivée des vivres. Son camp souffrit de la famine, et l'assiégeant était lui-même comme assiégé. Mais lorsque le fleuve redevint paisible et ouvrit les plaines aux pillages et aux combats, il recommença à presser vigoureusement les ennemis, les poursuivit dans leur retraite vers la Celtibérie, les enferma à l'intérieur d'un rempart palissadé, et les souffrances de la soif les obligèrent à se rendre. Ainsi fut reconquise l'Espagne citérieure. L'Espagne ultérieure suivit bientôt. Que pouvait faire une seule légion, quand cinq n'avaient pu résister ? Varron se rendit volontairement, et Gadès, le détroit, l'Océan, tout reconnut la fortune de César. Cependant en son absence, le sort osa lui être un moment contraire en Illyrie et en Afrique, comme s'il voulait rehausser par quelques échecs l'éclat de ses succès. Dolabella et Antoine avaient reçu l'ordre d'occuper les embouchures de la mer Adriatique, et avaient établi leur camp, le premier sur la côte d'Illyrie, le second sur celle de Curicta. Mais Pompée était maître de presque toute la mer, et son lieutenant Octavius Libo les surprit et les enveloppa tous deux avec des forces navales considérables. La faim contraignit Antoine à se rendre. Des radeaux que Basilus avait envoyés à son secours, faute de vaisseaux, furent pris comme dans un filet par un nouvel artifice des Ciliciens alliés de Pompée, qui tendirent des câbles dans la mer. Cependant l'agitation des flots en dégagea deux. Un radeau, qui portait des Opitergins resta engravé dans les bas-fonds et laissa à la postérité un exemple mémorable. Il y avait là mille hommes à peine qui résistèrent pendant toute une journée aux attaques d'une armée qui les entourait de toutes parts. Après d'inutiles efforts de courage ils suivirent les exhortations du tribun Vultéius et s'entre-tuèrent les uns les autres plutôt que de se rendre. Tels furent également en Afrique le courage et l'infortune de Curion. Envoyé pour reconquérir cette province, il était fier d'avoir repoussé et mis en fuite Varus, mais surpris par l'arrivée soudaine du roi Juba, il ne put résister à la cavalerie des Maures. Vaincu, il pouvait encore échapper par la fuite, mais le sentiment de l'honneur le poussa à accompagner dans la mort l'armée qu'il avait perdue par sa témérité. Mais déjà la fortune réclame le couple qui lui est réservé. Pompée avait choisi l'Epire pour théâtre de la guerre, et César ne se faisait pas attendre. Après avoir tout réglé derrière lui, sans se laisser arrêter par les tempêtes du milieu de l'hiver, il franchit la mer pour gagner le champ de bataille. Il établit son camp près d'Oricum. Par suite du manque de bateaux, une partie de ses soldats étaient restés avec Antoine à Brundusium, et tardaient à le rejoindre. Brûlant d'impatience, il va les chercher, et il n'hésite pas, malgré une mer démontée par l'ouragan, à s'embarquer seul et en pleine nuit sur un léger navire. On connaît la réponse qu'il fit au pilote épouvanté par un pareil danger : "Que crains-tu ? tu portes César " Toutes les troupes sont réunies de part et d'autre ; les deux camps sont voisins, mais les deux chefs ont des projets différents. César, naturellement ardent, et désireux d'en finir, présente la bataille à l'ennemi, le provoque et le harcèle. Tantôt il bloque le camp de Pompée et l'entoure d'un retranchement de seize milles ; (mais en quoi ce blocus pouvait-il gêner une armée à qui la mer était ouverte et apportait toutes les provisions en abondance ?) - tantôt il attaque Dyrrachium, entreprise vaine contre une ville que sa situation rendait imprenable. En outre, il livre des escarmouches continuelles à chaque sortie de l'ennemi ; (c'est alors que brilla l'incomparable courage du centurion Scévola, qui reçut cent vingt traits sur son bouclier) ; enfin il pille et ravage les villes alliées de Pompée, Oricum, Gomphos et d'autres forteresses de Thessalie. Pompée, au contraire, traîne les choses en longueur, temporise, cherche à user par le manque de vivres un ennemi cerné de toutes parts, et en même temps à affaiblir l'ardente impétuosité de son chef. Mais il doit bientôt renoncer aux avantages de cette sage tactique. Les soldats blâment son inaction, les alliés, sa lenteur, les chefs, son ambition. Ainsi les destins se précipitent, la Thessalie est choisie comme champ de bataille, et les plaines de Philippes vont décider du sort de Rome, de l'empire et du genre humain. Jamais ailleurs la fortune ne vit le peuple romain rassembler tant de forces, tant de nobles personnages. Plus de trois cent mille hommes étaient en présence, sans compter les auxiliaires fournis par les rois et par les alliés. Jamais une catastrophe imminente ne fut annoncée par des prodiges plus évidents : fuite des victimes, des essaims sur les enseignes, des ténèbres en plein jour. Le général lui-même, dans un rêve nocturne, entendit en son théâtre des applaudissements qui ressemblaient à des lamentations, et le matin, - sinistre présage ! - on le vit sur la place d'armes vêtu d'un manteau noir. Jamais l'armée de César ne montra plus d'ardeur ni plus d'allégresse ; c'est d'elle que vinrent et le signal de la bataille et les premiers traits. On remarqua que Crastinus engagea le combat en lançant son javelot. On le retrouva parmi les cadavres, frappé d'une épée qui était restée enfoncée dans sa bouche, et la singularité de sa blessure attestait l'acharnement furieux avec lequel il avait combattu. Mais l'issue de la bataille fut plus étonnante encore. Pompée disposait d'une cavalerie si abondante qu'il pensait envelopper facilement César. Or, il fut enveloppé lui-même. Le combat était depuis longtemps indécis, lorsque Pompée donna à la cavalerie placée à l'une des ailes, l'ordre de se déployer et de charger. Mais soudain, un signal donné par César, les cohortes germaines se précipitèrent avec une telle furie sur les cavaliers débandés que ceux-ci semblaient des fantassins attaqués par des cavaliers. Cette déroute sanglante de la cavalerie en fuite entraîna celle de l'infanterie légère. Alors la terreur s'étendit dans tous les rangs, le désordre gagna tous les bataillons, et le carnage fut achevé comme par l'effort d'un seul bras. Rien ne fut plus fatal à Pompée que la grandeur même de son armée. César se prodigua dans cette bataille, et il fit à la fois son devoir de général en chef et son devoir de soldat. On a recueilli deux paroles qu'il prononça en passant à cheval, l'une cruelle, mais habile et propre à assurer la victoire : "Soldat, frappe au visage", l'autre destinée à lui attirer la popularité : "Epargne les citoyens" , alors qu'il les poursuivait lui-même. Heureux encore Pompée dans son malheur, s'il eût été emporté par la même fortune que son armée ! Mais il survécut à sa gloire, pour connaître un déshonneur plus grand encore. Il s'enfuit à cheval à travers les vallées de la Thessalie et aborda à Lesbos sur une petite barque. A Syhèdres, un rocher désert de la Cilicie, il se demanda s'il fuirait chez les Parthes, en Afrique ou en Egypte ; enfin, sur le rivage de Pélouse, il périt sur l'ordre du plus misérable des rois que conseillaient des eunuques, et qui mit le comble à son malheur en le faisant égorger par Septimius, un déserteur de son armée, sous les yeux de sa femme et de ses enfants. Qui n'aurait cru la guerre finie avec Pompée ? Cependant, les cendres de l'incendie de Thessalie se rallumèrent avec beaucoup plus de force et de violence. L'Egypte s'arma contre César, sans être cependant du parti de Pompée. Ptolémée, roi d'Alexandrie, avait commis le plus grand crime de la guerre civile et conclu avec César un traité d'alliance, dont le gage avait été la tête de Pompée. La fortune cherchait à venger les mânes d'un personnage si illustre, et elle en trouva l'occasion. Cléopâtre, soeur du roi, se jeta aux genoux de César et réclama sa part du royaume. La jeune princesse avait pour elle et sa beauté, rendue plus séduisante encore par l'injustice dont elle semblait avoir été victime, et la haine inspirée par le roi, qui avait sacrifié Pompée à la fortune d'un parti, et non à César, qu'il n'aurait certainement pas hésité à frapper de la même manière, s'il y avait trouvé son intérêt. Lorsque César eut ordonné de rétablir Cléopâtre sur le trône, il fut aussitôt assiégé dans le palais par les assassins mêmes de Pompée. N'ayant qu'une poignée de soldats, il soutint, avec un courage admirable, l'effort d'une nombreuse armée. Tout d'abord il met le feu aux bâtiments voisins et au port, et détourne ainsi l'attaque des ennemis qui le pressent ; puis il se sauve tout à coup dans la presqu'île du Phare. Mais il est jeté à la mer ; par une chance extraordinaire, il rejoint à la nage sa flotte qui stationnait tout près de là. Il avait laissé son manteau au milieu des flots, soit par un effet du hasard, soit à dessein pour offrir un but aux traits et aux pierres que lui lançaient les ennemis. Recueilli par les soldats de sa flotte, il attaque alors les ennemis partout à la fois et apaise les mânes de son gendre en lui immolant une nation lâche et perfide. Théodote, le précepteur du roi et l'instigateur de toute cette guerre, ainsi que Photin et Ganymède, des monstres qui n'étaient même pas des hommes, fuient de différents côtés sur mer et sur terre, et périssent diversement. Le cadavre du roi lui-même fut retrouvé enseveli dans la vase, et on le reconnut à la cuirasse d'or dont il était orné. De nouveaux troubles s'élevèrent également en Asie du côté du Pont, comme si la fortune avait voulu ruiner le royaume de Mithridate en faisant vaincre le père par Pompée et le fils par César. Le roi Pharnace, comptant plus sur nos discordes que sur son courage, se ruait sur la Cappadoce avec son armée. Mais César l'attaque, et en un seul combat - et ce ne fut même pas un véritable combat - , il l'écrase, semblable à la foudre qui, en un seul et même instant, tombe, frappe et disparaît. Et César pouvait se vanter à juste titre d'avoir vaincu l'ennemi avant de l'avoir vu. Telles furent ses victoires sur les étrangers. Mais en Afrique il dut livrer aux citoyens romains des combats beaucoup plus sanglants que celui de Pharsale. Le remous de la fuite avaient chassé dans cette province les débris du naufrage de Pompée, et à dire vrai, c'étaient moins des débris que tout l'appareil d'une guerre. Les forces de Pompée avaient été dispersées plutôt qu'écrasées ; le désastre même de leur chef avait resserré leur union. Les généraux qui succédaient à Pompée n'étaient pas indignes de lui et les noms qui remplaçaient le sien sonnaient encore assez haut, puisque c'étaient ceux de Caton et de Scipion. Juba, roi de Mauritanie, joignit ses troupes aux leurs, sans doute pour donner plus d'ampleur à la victoire de César. Thapsus ne différa de Pharsale que parce que ce fut une plus belle victoire ; et l'élan des soldats de César fut d'autant plus impétueux qu'ils s'indignaient de voir que la violence de la guerre s'était accrue depuis la mort de Pompée. Enfin, ce qui n'était jamais arrivé, les trompettes n'attendirent pas l'ordre du général pour sonner la charge. Le carnage commença par Juba. Ses éléphants encore étrangers aux combats et nouvellement tirés de leurs forêts, s'affolèrent au bruit soudain des clairons et se retournèrent contre les leurs. Aussitôt l'armée prit la fuite. Les chefs ne montrèrent pas plus de courage, mais tous surent du moins mourir glorieusement. Scipion fuyait sur un navire, mais rejoint par les ennemis, il se perça le corps de son épée. Quelqu'un demandant où il était, il répondit ces mots : "Le général est bien." Juba se réfugia dans son palais ; il offrit le lendemain un splendide festin à Pétréius qui l'avait accompagné dans sa fuite, et a milieu même du repas, il pria son hôte de le tuer. Pétréius tua le roi, puis se tua lui-même, et les restes des mets de ce repas funèbre furent arrosés d'un sang royal, mêlé au sang romain. Caton n'assista pas à cette bataille. Il campait près du Bagrada et gardait Utique qui est comme la seconde clef de l'Afrique. Mais quand il apprit la défaite de son parti, il se donna la mort sans hésitation, comme il convient à un sage, et même avec joie. Après avoir embrassé et congédié son fils et ses compagnons, il lut jusque dans la nuit, à la lueur d'une lampe, le dialogue où Platon enseigne l'immortalité de l'âme, et se reposa quelques instants. Puis, vers la première veille, il tira son épée, se découvrit la poitrine et se frappa deux fois. Les médecins ayant osé profaner de leurs remèdes les blessures de ce grand homme, il les laissa faire pour se débarrasser de leur présence, puis rouvrit ses plaies. Le sang jaillit avec violence, et ses mains mourantes restèrent plongées dans la blessure qu'il s'était faite deux fois. Comme si l'on n'avait combattu nulle part encore, les partis reprirent les armes. Autant l'Afrique avait dépassé la Thessalie, autant l'Espagne surpassa l'Afrique. Le parti de Pompée possédait un avantage considérable, celui d'avoir deux frères à sa tête, c'est-à-dire deux Pompée au lieu d'un seul. Aussi la guerre ne fut-elle nulle part plus acharnée, ni la victoire plus incertaine. Les lieutenants Varus et Didius, en vinrent les premiers aux mains, à l'embouchure même de l'Océan. Mais leurs vaisseaux eurent moins à lutter entre eux que contre la mer. Comme s'il eût voulu châtier nos fureurs civiques, l'Océan détruisit les deux flottes par un naufrage. Quel horrible spectacle que cette lutte simultanée des flots, de la tempête, des hommes, des vaisseaux et de leurs agrès ! Joignez à cela l'aspect effrayant des lieux : la côte d'Espagne et celle de Mauritanie se tournant l'une vers l'autre pour se réunir, le spectacle effrayant des deux mers, la mer intérieure et la mer extérieure, les colonnes d'Hercule dominant les flots, et partout en même temps les fureurs de la guerre jointes à celles de la tempête. Bientôt après, de part et d'autre, on courut assiéger différentes villes, et ces malheureuses furent punies par les deux partis de leur alliance avec les Romains. Munda fut la dernière de toutes les batailles. César n'y trouva point son bonheur accoutumé, et le combat fut longtemps incertain et inquiétant ; la fortune avait bien l'air de délibérer. Avant la bataille, César lui-même avait paru triste, contrairement à son habitude. Peut-être réfléchissait-il à la fragilité humaine, peut-être se défiait-il de cette trop longue suite de succès, ou craignait-il, après avoir commencé comme Pompée, de finir comme lui. Au milieu même de la mêlée, il se produisit un incident, dont personne ne se rappelait d'exemple. Longtemps, avec des avantages égaux, les adversaires n'avaient cherché qu'à se massacrer. Tout à coup, au plus fort du combat, il se fit un profond silence, comme s'il y avait eu accord entre les deux armées et comme si tous se demandaient quand finirait cette guerre. Enfin - et ce spectacle honteux était nouveau pour les yeux de César - le corps des vétérans, éprouvé par quatorze années de campagnes, recula, et, s'il ne s'était pas encore enfui, on sentait bien que la honte le retenait plutôt que le courage. A cette vue, César, laissant son cheval, s'élance comme un furieux vers la première ligne. Il saisit les fuyards, rassure les porte-enseignes, leur prodigue les supplications, les encouragements, les reproches, et parcourt toute son armée des yeux, du geste et de la voix. On raconte que dans cet affolement il songea à prendre un parti désespéré, et son visage laissa voir clairement qu'il était décidé à se donner la mort. Mais cinq cohortes ennemies envoyées par Labiénus pour défendre le camp menacé traversèrent le champ de bataille, et ce mouvement avait l'apparence d'une fuite. César crut-il qu'elles fuyaient réellement, ou sut-il, en chef habile, exploiter cette apparence ? Toujours est-il qu'il se jette sur les cohortes comme sur une troupe en fuite, et relève le courage des siens en même temps qu'il abat celui de l'ennemi. Car ses soldats, se jugeant vainqueurs, poursuivent plus vivement les Pompéiens, qui, croyant à la fuite des leurs, se mettent à fuir à leur tour. On jugera du carnage qui fut fait des ennemis, ainsi que de la colère et de la rage des vainqueurs par le trait suivant. Les survivants ayant fui la mêlée pour se réfugier à Munda, César ordonna de les y bloquer immédiatement, et on forma un retranchement d'un amas de cadavres, joints ensemble par les javelots et les traits dont ils étaient percés : action révoltante même chez des barbares. Les fils de Pompée désespérèrent de la victoire. Cnéus s'enfuit du combat, blessé à la jambe et chercha à gagner des lieux déserts et écartés. Mais rejoint par Césonius près de la ville de Laurone, il résista en homme qui n'avait pas encore perdu tout espoir, et il fut tué. Quant à Sextus, la fortune le cacha en Celtibérie et le réserva pour d'autres guerres après la mort de César. César rentre victorieux dans sa patrie. Dans son premier triomphe, celui qu'il remporta sur la Gaule, figuraient le Rhin, le Rhône et l'Océan représenté en or, sous la forme d'un prisonnier. Il avait cueilli son second laurier en Egypte ; dans ce triomphe, on porta les images du Nil, d'Arsinoé et du Phare, qui semblait étinceler de tous ses feux. Le troisième triomphe fut celui qu'il remporta sur Pharnace et le Pont. Le quatrième montrait Juba, la Mauritanie et l'Espagne deux fois soumise. Rien ne rappela Pharsale, Thapsus et Munda. Et pourtant, combien plus grandes étaient ces victoires dont il ne triomphait pas. Enfin la guerre cessa. La paix qui suivit ne fut pas ensanglantée, et la clémence de César racheta les atrocités de la guerre. Il ne fit mourir personne, excepté Afranius (c'était assez de lui avoir pardonné une fois), Faustus Sylla (Pompée l'avait appris à craindre ses gendres), et la fille de Pompée avec les jeunes enfants qu'elle avait eus de Sylla : il assurait ainsi la tranquillité de l'avenir. Aussi les Romains reconnaissants accumulèrent-ils tous les honneurs sur la tête de leur prince. Il eut des statues autour des temples, le droit de porter au théâtre une couronne ornée de rayons, une place d'honneur au sénat, un pinacle sur sa maison ; son nom fut donné à l'un des mois de l'année. On y ajouta le titre de père de la patrie et de dictateur perpétuel. Enfin, sans qu'on puisse savoir s'ils étaient d'intelligence, le consul Antoine lui offrit devant la tribune aux harangues les insignes de la royauté. Tous ces honneurs s'accumulaient sur sa tête comme les ornements sur celle d'une victime destinée à la mort. La clémence du prince ne put triompher de la haine, et le pouvoir même qu'il avait de leur faire du bien pesait à des hommes libres. On ne supporta pas plus longtemps son despotisme, mais Brutus et Cassius, et d'autres sénateurs s'entendirent pour l'assassiner. O puissance du destin ! Le bruit de la conjuration s'était répandu au loin ; un billet avait même été donné à César ce jour-là, et sur cent victimes, il n'avait pu trouver un seul présage favorable. Il vint cependant au sénat, songeant à une expédition contre les Parthes. Il était assis sur sa chaise curule lorsque les sénateurs se jetèrent sur lui et l'abattirent de vingt-trois coups de poignard. Et ainsi, l'homme qui avait inondé l'univers du sang de ses concitoyens inonda enfin lui-même la curie de son propre sang.
III. -César Auguste.- Le peuple romain, après l'assassinat de César et de Pompée, semblait avoir recouvré son ancienne liberté. Il l'aurait recouvrée, si Pompée n'avait point laissé d'enfants ni César d'héritier ; ou, ce qui fut plus funeste encore, si Antoine, l'ancien collègue de César, devenu l'émule de sa puissance, n'eût survécu pour embraser et bouleverser le siècle suivant. Sextus réclame l'héritage paternel, et jette l'épouvante sur toute la mer. Octave, pour venger la mort de son père, doit ébranler de nouveau la Thessalie ; l'inconstant Antoine tantôt s'indigne de voir Octave succéder à César ; tantôt par amour pour Cléopâtre, il s'abaisse jusqu'à la royauté. Le peuple romain ne put alors trouver son salut qu'en se réfugiant dans la servitude. Félicitons-nous cependant, autant que le permettent de pareils désordres, que le pouvoir suprême soit tombé de préférence aux mains d'Octave César Auguste qui, par sa sagesse et son habileté remit l'ordre dans le corps de l'empire ébranlé et bouleversé de toutes parts. Jamais, à coup sûr, l'Etat n'aurait pu retrouver son unité ni son ensemble, s'il n'eût été régi par la volonté d'un seul, qui en fût comme l'âme et l'esprit. Sous le consulat de Marc-Antoine et de Publius Dolabella, alors que la fortune transférait l'empire romain aux Césars, il y eut dans l'Etat des troubles variés et nombreux. Et comme il arrive d'ordinaire dans la révolution annuelle du ciel, lorsque les mouvements des astres se traduisent par le tonnerre, et leurs changements par la tempête, ainsi cette transformation du gouvernement de Rome, c'est-à-dire du genre humain, provoqua de violentes secousses ; et toutes sortes de dangers, des guerres civiles, étrangères, serviles, continentales et maritimes agitèrent tout le corps de l'empire.
IV. - Guerre de Modène.- La première cause des troubles civils fut le testament de César. Antoine, le second héritier, furieux de la préférence accordée à Octave, avait entrepris une guerre implacable contre l'adoption de ce fougueux jeune homme. Il avait en face de lui un adversaire de dix-huit ans à peine, que son âge exposait et livrait à l'injustice. Il jouissait lui-même d'une grande considération due à son titre de compagnon d'armes de César. Aussi ne cessait-il de lui voler des morceaux de son héritage, de l'accabler d'outrages, et d'empêcher par tous les moyens son adoption dans la famille des Jules. Enfin, il prit ouvertement les armes pour écraser son jeune adversaire, et déjà, avec une armée qu'il avait préparée, il bloquait dans la Gaule Cisalpine Décimus Brutus, qui s'opposait à ses desseins. Mais Octave César, que son âge, l'injustice subie et la majesté du nom qu'il avait pris rendaient populaire rappelle les vétérans aux armes, et bien que simple citoyen, il ose - qui l'eût cru ? - attaquer un consul ; il délivre Brutus assiégé dans Modène, et s'empare du camp d'Antoine. Il se fit alors remarquer par sa belle attitude. Couvert de sang et de blessures, il revint dans son camp en rapportant sur ses épaules une aigle que lui avait remise un porte-enseigne mourant.
V. - Guerre de Pérouse.- Une seconde guerre fut provoquée par le partage des terres que César accorda aux vétérans de son père, pour prix de leurs services. Antoine, naturellement porté au mal, était encore excité par sa femme Fulvie, qui ceignit alors l'épée avec une audace toute virile. Il soulève les colons chassés de leurs terres et prend de nouveau les armes. César le fait déclarer ennemi public, non plus par les suffrages de quelques particuliers, mais par le sénat tout entier, l'attaque, l'oblige à s'enfermer dans Pérouse, et le force à se rendre, après lui avoir fait endurer les plus affreuses horreurs de la famine.
VI. - Le triumvirat.- A0ntoine à lui seul était déjà dangereux pour la paix, et dangereux pour le bien de l'Etat. Or, Lépide se joignit à lui, comme la flamme à l'incendie. Que pouvait faire César contre deux consuls et deux armées ? Il lui fallut s'associer à leur pacte sanglant. Ils avaient tous trois des projets aussi différents que leurs caractères. Lépide aspirait à profiter du bouleversement de l'Etat pour satisfaire sa soif des richesses. Antoine voulait se venger de ceux qui l'avaient déclaré ennemi public, César voulait venger son père et immoler Cassius et Brutus à ses Mânes indignés. Telles furent les raisons de cette paix conclue entre les trois chefs. Au confluent de deux rivières, entre Pérouse et Bologne, ils joignent leurs mains en signe d'alliance et reçoivent les saluts des trois armées. Imitant un exemple funeste, ils forment un triumvirat, et la république opprimée par leurs violences, voit renaître les proscriptions de Sylla. Une des moindres atrocités fut le massacre de cent quarante sénateurs. On fit périr dans des conditions atroces, cruelles, lamentables, des malheureux qui fuyaient par tout l'univers. Peut-on assez gémir sur de pareilles horreurs ? Antoine proscrit son oncle Lucius César, et Lépide son frère Lucius Paulus ! L'exposition des têtes des victimes sur la tribune aux harangues était maintenant pour Rome un spectacle ordinaire. Cependant la ville ne put retenir ses larmes quand elle aperçut la tête coupée de Cicéron sur cette tribune dont il avait été le maître, et on accourait pour le regarder comme autrefois pour l'entendre. Ces meurtres étaient ordonnés par Antoine et Lépide. César se contenta de faire périr les assassins de son père et il ne le fit que parce que le meurtre du dictateur aurait paru légitime s'il n'était pas vengé.
VII. - Guerre contre Brutus et Cassius.- . Brutus et Cassius, en immolant César, semblaient avoir chassé du trône un nouveau Tarquin ; mais ce parricide consomma la perte de cette liberté qu'ils s'étaient surtout proposé de rétablir. Après le meurtre, redoutant non sans raison les vétérans de César, ils s'étaient réfugiés aussitôt du sénat au Capitole. En effet, ce n'est pas la volonté qui manquait à ces soldats, mais ils n'avaient pas encore de chef pour venger leur général. D'ailleurs, comme il était évident que cette vengeance ensanglanterait la république, on décida d'y renoncer, bien qu'on désapprouvât le crime, et, sur les conseils de Cicéron, on rendit un décret d'amnistie. Cependant, pour ne pas avoir à supporter la vue de la douleur publique, ils se retirèrent dans les provinces de Syrie et de Macédoine qui leur avaient été données par ce même César qu'ils avaient assassiné, et dont la vengeance fut ainsi différée plutôt qu'abandonnée. Quand les triumvirs eurent réglé les affaires de l'Etat, moins comme elles devaient que comme elles pouvaient l'être, César et Antoine laissèrent à Lépide la défense de la ville et se préparèrent à marcher contre Cassius et Brutus. Ceux-ci avaient rassemblé des troupes nombreuses et occupé la même plaine qui avait été fatale à Pompée. Cette fois encore des signes manifestes annoncèrent aux vaincus la défaite qui les menaçait. Un essaim s'abattit sur les enseignes ; des oiseaux habitués à se repaître de cadavres volaient autour du camp qu'ils considéraient déjà comme leur proie, et en marchant au combat les soldats rencontrèrent un Ethiopien, présage incontestablement funèbre. Brutus lui-même, pendant la nuit, se livrait à la lumière d'une lampe, à ses méditations accoutumées, lorsqu'un noir fantôme lui apparut. "Qui es-tu ?", lui demanda Brutus.--"Ton mauvais génie", répondit-il, et il disparut à ses yeux étonnés. Il y avait également des présages dans le camp de César, mais ils étaient meilleurs. Les oiseaux, les victimes, tout promettait le succès. Mais rien ne fut plus salutaire que le songe qui conseilla au médecin de César de le faire sortir du camp, qui risquait d'être pris, et qui le fut en effet. Car une fois la bataille engagée, la mêlée continua pendant quelque temps avec une égale ardeur. D'un côté, les deux chefs étaient présents ; de l'autre, César et Antoine avaient été tenus à l'écart du combat, le premier par la maladie, le second par la crainte et la lâcheté. Mais l'invincible fortune de la victime et de son vengeur soutint leur parti, comme le prouva l'issue du combat. La bataille fut d'abord extrêmement douteuse, et le péril égal des deux côtés. Le camp de César et celui de Cassius furent pris également. Mais comme la fortune est plus puissante que la vertu ! Combien est vraie cette dernière parole de Brutus mourant : "La vertu n'est qu'un vain mot !" C'est une méprise qui donna la victoire dans ce combat. En même temps que pliait l'aile qu'il commandait, Cassius aperçut des cavaliers qui revenaient à toute allure après avoir pris le camp de César. Il crut qu'ils fuyaient et se retira sur une éminence. Puis la poussière, le bruit, et aussi l'approche de la nuit l'empêchèrent de distinguer ce qui se passait. Un éclaireur qu'il avait envoyé aux renseignements tardant à lui rapporter des nouvelles, il pensa que c'en était fait de son parti, et il se fit trancher la tête par l'un des siens. Avec Cassius, Brutus perdit tout son courage ; et pour ne pas manquer à ses engagements (ils avaient résolu, en effet, de ne pas survivre à leur défaite) il se fit percer le flanc par l'un de ses compagnons. N'est-on pas étonné de voir que ces deux hommes, si sages et si braves, n'ont pas eux-mêmes mis fin à leur vie ? Peut-être la croyance de leur secte les empêchait-elle de se souiller les mains ; peut-être croyaient-ils que pour délivrer leurs âmes si courageuses et si pieuses, ils devaient se contenter de prendre la décision et laisser à d'autres le crime de l'exécution.
VIII. - Guerre contre Sextius Pompée.- . Les meurtriers de César étaient détruits, mais il restait encore la famille de Pompée. L'un de ses fils avait péri en Espagne ; l'autre avait dû son salut à la fuite. Ce dernier avait rassemblé les restes de cette guerre malheureuse et armé jusqu'aux esclaves ; il occupait la Sicile et la Sardaigne. Déjà sa flotte s'était établie au centre de la Méditerranée. Quelle différence entre le père et le fils ! L'un avait exterminé les Ciliciens, l'autre demandait à la piraterie de le protéger. Il ravagea Pouzzoles, Formies, Vulturne, enfin toute la Campanie, Ponties et Aenarie, et même l'embouchure du Tibre; puis, attaquant les navires de César, il les incendia et les coula. Il avait d'ailleurs pour auxiliaires Ménas et Ménécrate, de vils esclaves qu'il avait mis à la tête de sa flotte et qui faisaient la guerre de course le long des côtes. En reconnaissance de tous ces succès il immola à Pélore cent boeufs ornés d'or et précipita dans la mer un cheval vivant également couvert d'or. Il faisait ces présents à Neptune, afin que le maître de la mer le laissât régner sur la sienne. Enfin, les dangers courus furent si grands, qu'on dut conclure un traité de paix avec l'ennemi, si toutefois le fils de Pompée était un ennemi. Ce fut une grande, mais brève joie, lorsque sur la digue de Baïes on signa un accord pour son retour et la restitution de ses biens. Il invita ses adversaires à sa table sur son navire et par une allusion spirituelle où il critiquait sa destinée, il leur dit qu'il les recevait dans ses carènes. Son père avait en effet habité à Rome dans le quartier bien connu des Carènes, alors que sa maison à lui et ses pénates voguaient sur les flots. Mais Antoine avait pour l'or une passion insatiable. Les biens de Pompée qu'il avait acquis avaient été dissipés et il ne pouvait respecter l'accord. Il commença à ne pas exécuter les clauses du traité. Sextus recommença de nouveau la guerre, et on fit appel à toutes les forces de l'empire pour rassembler contre le jeune homme une flotte dont la préparation à elle seule fut magnifique. On coupa la voie Herculéenne, on creusa les bords du Lucrin qui fut transformé en un port ; puis on ouvrit ses rives en son milieu, on le réunit à l'Averne et sur la surface calme de ces eaux la flotte s'entraîna à la guerre navale. Attaqué par un formidable appareil de guerre, le jeune homme fut écrasé dans le détroit de Sicile, et il eût emporté dans la mort la réputation d'un grand capitaine, s'il n'eût point de nouveau tenté la fortune, bien que ce soit l'indice d'un grand caractère que de toujours espérer. Réduit à la dernière extrémité, il s'enfuit et fit voile vers l'Asie, où il devait tomber entre les mains et dans les chaînes de ses ennemis, et, ce qui est le comble de l'infortune pour un brave, périr à leur gré sous les coups d'un assassin. Jamais fuite, depuis Xerxès, n'avait été plus lamentable. Maître peu auparavant de trois cent cinquante navires, il n'en avait plus que six ou sept pour accompagner sa fuite. Il avait fait éteindre le fanal du navire-amiral, jeté son anneau dans la mer, et portait de tous les côtés des regards épouvantés ; et cependant il ne craignait que la mort.
IX.- Guerre de Vendidius contre les Parthes.- Par la mort de Cassius et de Brutus, César avait ruiné le parti de Pompée ; par celle de Sextus, il en avait complètement effacé le nom. Cependant il n'avait pu établir définitivement la paix, et il restait un écueil, un obstacle, qui retardait le retour de la sécurité publique : c'était Antoine. Cet homme hâta d'ailleurs lui-même sa perte par ses vices, et, s'abandonnant à tous les excès de l'ambition et de la débauche, il délivra d'abord ses ennemis, puis ses concitoyens, enfin son siècle de la terreur qu'inspirait son nom. La défaite de Crassus avait rendu confiance aux Parthes, et ils avaient appris avec joie les discordes civiles du peuple romain. Aussi n'hésitèrent-ils pas à nous attaquer à la première occasion qui se présenta. Ils y furent d'ailleurs poussés par Labiénus, que Cassius et Brutus avaient envoyé - ô folie criminelle ! - pour solliciter le secours de ces ennemis. Conduits par Pacorus, le fils du roi, ils avaient dispersé les garnisons d'Antoine dont le lieutenant Saxa se tua de son épée pour ne pas tomber entre leurs mains. Enfin, la Syrie nous fut enlevée et le mal allait s'étendre plus loin - car les ennemis, sous le nom d'auxiliaires, triomphaient par eux-mêmes, mais Ventidius, un autre lieutenant d'Antoine, eut le bonheur incroyable de massacrer les troupes de Labiénus, Pacorus lui-même, et toute la cavalerie parthe dans la vaste région située entre l'Oronte et l'Euphrate. Plus de vingt mille hommes périrent. Le succès fut obtenu grâce à l'habileté de notre général qui feignit d'avoir peur et laissa les ennemis s'approcher de son camp à moins d'une portée de trait, si bien qu'ils ne purent faire usage de leurs flèches. Leur roi mourut en combattant très vaillamment. Sa tête fut aussitôt portée dans toutes les villes qui avaient fait défection, et la Syrie fut reconquise sans combat. C'est ainsi que la mort de Pacorus vengea la défaite de Crassus.
X. - Guerre d'Antoine contre les Parthes.- Les Parthes et les Romains avaient ainsi mesuré leurs forces et s'en étaient donné des preuves mutuelles par le désastre de Crassus et de Pacorus. Ayant l'un pour l'autre un égal respect, ils renouvelèrent leur alliance et Antoine signa lui-même le traité avec leur roi. Mais la vanité d'Antoine ne connaissait point de bornes ; il ambitionnait les titres de gloire et voulait faire inscrire les noms de l'Araxe et de l'Euphrate au bas de ses images. Sans sujet, sans raison, sans le moindre semblant de déclaration de guerre, comme si la fourberie entrait dans la tactique d'un général, il quitte tout à coup la Syrie et se précipite sur les Parthes. Ce peuple, qui savait unir la ruse à la bravoure, fait semblant d'avoir peur et de s'enfuir dans les plaines. Antoine se croit vainqueur et le poursuit. Mais tout à coup, vers le soir, une petite troupe ennemie s'abat à l'improviste, comme une pluie d'orage, sur les soldats fatigués de leur marche, et couvre deux légions de traits qui pleuvent de tous les côtés. Ce n'était rien encore à côté du désastre qui nous attendait le lendemain, si les dieux n'avaient eu pitié de nous. Un Romain, échappé au désastre de Crassus, et portant le costume parthe, s'approche à cheval du camp d'Antoine, salue les soldats en latin, bannit par ce moyen la défiance de leurs esprits et leur révèle le danger qui les menace. "Le roi doit bientôt arriver avec toutes ses troupes ; il faut retourner en arrière et gagner les montagnes ; même ainsi, l'armée romaine n'échappera peut-être pas à l'ennemi." Et ainsi l'attaque ennemie qui suivit fut moins violente qu'on pouvait le craindre. Elle se produisit cependant, et le reste de nos troupes eût été détruit, si nos soldats accablés par les traits qui tombaient drus comme grêle n'avaient eu par hasard l'idée de se mettre à genoux et de se couvrir la tête de leurs boucliers, laissant croire ainsi qu'ils étaient morts. Les Parthes détendirent alors leurs arcs, et quand les Romains se relevèrent, les barbares furent frappés d'un tel étonnement que l'un d'eux s'écria : "Allez, Romains, et retirez-vous sains et saufs ; vous méritez bien votre réputation de vainqueurs des nations, puisque vous avez échappé aux flèches des Parthes." Le chemin du retour nous fut ensuite aussi funeste que l'ennemi. Tout d'abord on y souffrit de la soif ; puis les eaux saumâtres furent pour certains plus dangereuses encore ; enfin l'eau douce elle-même devint nuisible parce que nos soldats affaiblis en buvaient avec avidité. Ce furent ensuite les chaleurs d'Arménie, puis les neiges de Cappadoce, et le changement subit de climat produisit sur eux l'effet de la peste. De seize légions, à peine le tiers survivait. Antoine vit plusieurs fois son argenterie mise en pièces à coups de hache, et à plusieurs reprises, il supplia son gladiateur de le tuer. Enfin cet illustre général se réfugia en Syrie. Là, par un incroyable égarement d'esprit, il se montra plus arrogant que jamais, comme s'il avait triomphé de l'ennemi, en réussissant à lui échapper.
XI. - Guerre avec Antoine et Cléopatre.- La fureur d'Antoine n'avait pu être détruite par son ambition ; elle fut éteinte par son amour du luxe et de la débauche. Après son expédition contre les Parthes, il prit la guerre en horreur et vécut dans l'oisiveté. Il s'éprit de Cléopâtre, et, comme après une victoire, il se reposait de ses fatigues dans les bras de cette reine. L'Egyptienne demande à ce général ivre l'empire romain comme prix de ses caresses. Antoine le lui promet comme si les Romains étaient plus faciles à vaincre que les Parthes. Il se prépare donc à conquérir le pouvoir, et il le fait ouvertement. Il oublie sa patrie, son nom, sa toge, ses faisceaux ; et devenu l'esclave de ce monstre fatal, il renonce, pour lui plaire, à ses sentiments, à son costume et à ses principes. Un sceptre d'or à la main, un cimeterre au côté, une robe de pourpre attachée par d'énormes pierres précieuses, il ne lui manquait que le diadème, pour que, roi lui-même, il pût posséder une reine. Au premier bruit de ces nouveaux mouvements, César s'était embarqué à Brundusium pour aller au-devant de la guerre. Ayant placé son camp en Epire, il avait bloqué avec sa flotte tout le rivage d'Actium, l'île de Leucade et le mont Leucate, ainsi que les deux pointes du golfe d'Ambracie. Nous avions au moins quatre cents navires, les ennemis en avaient à peine deux cents, mais dont la grandeur compensait l'infériorité numérique. Ils possédaient en effet de six à neuf rangs de rameurs, et ils étaient en outre surmontés de tours à plusieurs étages, ce qui les faisait ressembler à des forteresses ou à des villes ; leur poids faisait gémir la mer et les vents se fatiguaient à les pousser. Leur masse même leur fut fatale. Les navires de César avaient de deux à six rangs de rameurs tout au plus ; ils étaient propres à toutes les évolutions qu'on pouvait exiger d'eux ; ils attaquaient, reculaient, viraient facilement. Se mettant à plusieurs en même temps contre un seul de ces lourds vaisseaux, inhabiles à toute manoeuvre, ils les accablaient de traits et de coups d'éperons et leur lançaient aussi des torches enflammées. Ils n'eurent aucun mal à les disperser. La grandeur des forces ennemies apparut surtout après la victoire. Les débris de cette immense flotte détruite par la guerre voguaient sur toute la mer, et les dépouilles recouvertes de la pourpre et de l'or des Arabes, des Sabéens et de mille peuples d'Asie étaient continuellement rejetées sur les côtes par les flots que poussaient les vents. La reine donna la première le signal de la fuite et gagna la haute mer sur son vaisseau à pourpre d'or et à voile de pourpre. Antoine la suivit bientôt. Mais César s'élance sur leurs traces. En vain, ils avaient préparé leur fuite sur l'océan, en vain des garnisons avaient été chargées de défendre Parétonium et Péluse, ces deux promontoires de l'Egypte ; tout fut inutile, et ils allaient tomber aux mains de César. Le premier, Antoine se tua de son épée. La reine, se jetant aux pieds de César, essaya de séduire les yeux du vainqueur. Peine inutile ! Sa beauté ne put triompher de la continence du prince. Ce qui la préoccupait, ce n'était pas d'avoir la vie sauve, - qu'on lui offrait d'ailleurs - mais elle voulait garder une partie du royaume. Quand César ne lui eut laissé aucun espoir, et qu'elle se vit réservée pour le triomphe, elle profita de la négligence de ses gardes et se réfugia dans un mausolée (c'est le nom qu'on donne dans le pays aux tombeaux des rois). Elle s'y revêtit, suivant sa coutume, de ses plus beaux ornements, et s'étendit sur un lit funèbre tout rempli de parfums auprès de son cher Antoine. Puis elle se fit piquer les veines par des serpents, et succomba à une mort semblable au sommeil.
XII. - Guerre contre les nations étrangères. - Telle fut la fin des guerres civiles. On ne se battit plus désormais que contre les nations étrangères, qui, voyant l'empire fort occupé de ses propres maux, se soulevaient en diverses contrées de l'univers. La paix était en effet récente, et ces peuples qui n'étaient pas encore habitués au frein de la servitude secouaient leurs têtes fières et altières pour se dérober au joug qu'on venait de leur imposer. Les peuples qui habitaient dans les régions du nord se montraient les plus farouches : c'étaient les Noriques, les Illyriens, les Pannoniens, les Dalmates, les Mésiens, les Thraces et les Daces, les Sarmates et les Germains. Les Noriques tiraient leur confiance de la hauteur des Alpes ; ils pensaient que la guerre ne pouvait escalader leurs rochers et leurs neiges. Mais César confia à son beau-fils Claudius Drusus le soin de pacifier entièrement tous les peuples de cette contrée, les Breunes, les Usennes et les Vindéliciens. On jugera de la sauvagerie de ces nations des Alpes par celle de leurs femmes : manquant de traits, elles écrasaient contre la terre leurs jeunes enfants et les lançaient à la tête de nos soldats. Les Illyriens vivent également au pied des Alpes dont ils gardent les plus profondes vallées, comme les barrières de leur pays ; des torrents impétueux les environnent. César se chargea lui-même de cette expédition, et fit construire des ponts. Les eaux et l'ennemi jettent le trouble dans son armée. Voyant un soldat qui hésite à monter, il lui arrache son bouclier des mains et s'avance le premier. Sa troupe le suit, mais le pont faiblit et s'écroule sous le nombre. Blessé aux mains et aux jambes, plus imposant à cause du sang dont il est couvert et plus auguste à cause du danger couru, il taille en pièces l'ennemi qui fuit devant lui. Les Pannoniens sont protégés par le rempart de deux fleuves impétueux, la Drave et la Save. Ils pillaient les pays voisins, puis se réfugiaient entre leurs rives. César envoya Vinnius pour les dompter. Ils furent écrasés sur les bords des deux fleuves. Les armes des vaincus ne furent point brûlées selon l'usage de la guerre. On les brisa, on les jeta dans le courant, et elles allèrent annoncer le nom de César à ceux qui résistaient encore. Les Dalmates vivent surtout dans les forêts ; aussi se livrent-ils sans frein au brigandage. Le consul Marcius, en leur brûlant autrefois leur ville Delminium, avait pour ainsi dire abattu la tête du pays. Plus tard Asinius Pollion - le second des orateurs - leur avait enlevé leurs troupeaux, leurs armes et leurs champs. Mais Auguste chargea Vibius d'achever leur soumission. Celui-ci força ce peuple farouche à creuser la terre et à tirer l'or de ses entrailles. Cette nation, la plus cupide de toutes, se livre d'ailleurs à cette recherche avec une telle ardeur et une telle activité, qu'elle semble l'extraire pour son propre usage. La cruauté et la sauvagerie des Mésiens, les plus barbares d'entre les barbares, produisent une impression d'horreur. Un de leurs chefs, avant la bataille, réclama le silence. "Qui êtes-vous ? ," dit-il. - "Les Romains, maîtres des nations ", lui fut-il répondu." Il en sera ainsi dit-il, quand vous nous aurez vaincus." Marcus Crassus en accepta l'augure. Aussitôt, avant le combat, les barbares immolent un cheval, et font le voeu d'offrir aux dieux les entrailles des généraux tués, et de s'en nourrir ensuite. Je crois bien que les dieux les entendirent car les Mésiens ne purent même pas soutenir le son de la trompette. Un de ceux qui leur inspira le plus de frayeur fut le centurion Cornilius, dont l'humeur extravagante et quelque peu sauvage devait frapper l'imagination de ces êtres semblables à lui. Il portait sur son casque une torche allumée, et les secousses que provoquaient les mouvements de son corps laissaient croire que des flammes sortaient de sa tête en feu. Les Thraces s'étaient déjà souvent révoltés auparavant ; mais leur révolte était alors dirigée par leur roi Rhoemetalcès. Ce dernier avait fait adopter à ces barbares les enseignes, la discipline et même les armes des Romains. Mais entièrement domptés par Pison, ils montrèrent leur rage jusque dans la captivité, car ils essayaient de mordre leurs chaînes avec une sauvagerie dont ils se punissaient eux-mêmes. Les Daces habitent dans les montagnes. Par l'ordre de leur roi Cotison, toutes les fois que la glace réunissait les rives du Danube, ils avaient l'habitude de descendre piller les pays voisins. César Auguste décida d'éloigner une nation dont il était si difficile d'approcher. Il envoya donc Lentulus, qui les repoussa de l'autre côté du fleuve et installa en deçà des garnisons. Ainsi la Dacie fut, sinon vaincue, du moins repoussée et sa conquête remise à plus tard. Les Sarmates parcourent à cheval de vastes plaines. Le même Lentulus se contenta de leur fermer le passage du Danube. Ils ne possèdent que des neiges, des frimas et des forêts. Telle est leur barbarie qu'ils ne conçoivent même pas l'état de paix. Quant à la Germanie, plût au ciel que César eût attaché moins d'importance à sa conquête ! Nous eûmes plus de honte à la perdre que de gloire à la soumettre. Mais sachant que César, son père, avait passé deux fois le Rhin sur un pont pour y chercher l'ennemi, il voulut en faire une province pour honorer sa mémoire. Il y eût réussi, si les barbares avaient pu supporter nos vices comme notre domination. Drusus, envoyé dans cette province, dompta d'abord les Usipètes ; puis il parcourut le pays des Tenchtères et des Cattes ; et sur un tertre élevé, il dressa un trophée des riches dépouilles remportées sur les Marcomans. Puis il attaqua en même temps des peuples très puissants, les Chérusques, les Suèves et les Sygambres. Ils avaient mis en croix vingt centurions, et ce crime avait été comme le serment par lequel ils s'étaient engagés à la guerre. Sûrs de la victoire, ils s'entendirent pour se partager d'avance le butin. Les Chérusques avaient choisi les chevaux, les Suèves, l'or et l'argent, les Sygambres, les prisonniers. Mais ce fut le contraire qui se produisit. Drusus, vainqueur, distribua et vendit comme butin leurs chevaux, leurs troupeaux, leurs colliers et leurs personnes mêmes. En outre, pour défendre la province, il établit des garnisons et des petits postes partout sur les bords de la Meuse, de l'Elbe et du Veser. Le long du Rhin, il éleva plus de cinquante ouvrages fortifiés ; il fit construire des ponts à Bonn et à Mayence, et des flottes pour les protéger. Il ouvrit aux Romains la forêt hercynienne, jusqu'alors inconnue et inaccessible. Enfin, la paix régnait si bien en Germanie que les hommes semblaient changés, le pays tout autre, et le ciel lui-même plus doux et plus agréable qu'auparavant. Enfin ce n'est point par flatterie, mais par reconnaissance pour les services rendus, qu'à la mort de ce jeune héros le sénat lui accorda une distinction jusque-là sans exemple, en lui décernant lui-même un surnom tiré de la province qu'il avait soumise. Mais il est plus difficile de garder les provinces que de les conquérir. La force les soumet, la justice les conserve. Aussi notre joie fut-elle de courte durée. Les Germains étaient vaincus plutôt que domptés, et sous un général tel que Drusus, ils s'inclinaient devant la supériorité de nos moeurs plutôt que devant celle de nos armes. Mais après la mort de Drusus, Quintilius Varus leur devint odieux par ses caprices et son orgueil, non moins que par sa cruauté. Il osa les réunir en assemblée et commit l'imprudence de leur rendre la justice, comme s'il eût suffi des verges d'un licteur et de la voix d'un huissier pour réprimer l'humeur violente de ces barbares. Mais les Germains depuis longtemps regrettaient de voir leurs épées rouillées et leurs chevaux oisifs. Dès qu'ils se rendirent compte que nos toges et nos lois étaient plus cruelles que nos armes, ils se soulevèrent sous la conduite d'Arminius. Cependant Varus avait une telle confiance dans le maintien de la paix, qu'il resta indifférent aux renseignements que Ségeste l'un des chefs germains, lui révéla sur la conjuration. Il ne prévoyait ni ne craignait rien de tel, et dans une sécurité trompeuse il les citait à son tribunal, lorsqu'ils l'attaquent à l'improviste et se jettent partout sur ses troupes. Son camp est emporté, ses trois légions sont écrasées. Varus, après le désastre, eut le même destin et montra le même courage que Paulus après la journée de Cannes. Rien de plus sanglant que ce carnage dans les marais et dans les bois, rien de plus révoltant que les outrages des barbares, surtout à l'égard des avocats. Aux uns ils crevaient les yeux, aux autres ils coupaient les mains. A l'un d'eux ils cousirent la bouche, après lui avoir d'abord coupé la langue, qu'un barbare tenait à la main, en disant : "Vipère, cesse enfin de siffler." Le cadavre même du consul, que la piété des soldats avait enterré, fut exhumé. Les barbares possèdent encore des drapeaux et deux aigles. Quant à la troisième, un porte-enseigne l'arracha de sa pique avant qu'elle ne tombât entre les mains de l'ennemi, la dissimula à l'intérieur de son baudrier, et alla se cacher dans un marais ensanglanté. Ce désastre obligea l'empire, que n'avait pu arrêter le rivage de l'océan, à s'arrêter sur les bords du Rhin. Tels furent les événements au Septentrion. Au midi, il y eut des troubles plutôt que des guerres. Les révoltes des Musulames et des Gétules, voisins des Syrtes, furent réprimées par Cossus, qui y gagna le surnom de Gétulique, plus grand que la victoire remportée. Le soin de soumettre les Marmarides et les Garamantes fut confié à Quirinius. Il aurait pu revenir lui aussi avec le surnom de Marmarique, mais il apprécia plus modestement sa victoire. En Orient, on éprouva plus de difficultés avec les Arméniens. L'empereur envoya contre eux l'un des deux Césars, ses petits-fils. Tous deux eurent une courte destinée, et celle de l'un d'eux fut en outre sans gloire. Lucius mourut de maladie à Marseille. Caïus succomba en Syrie d'une blessure reçue en reconquérant l'Arménie qui se rangeait aux côtés des Parthes. Les Arméniens, après la défaite de leur roi Tigrane, n'avaient été habitués par Pompée qu'à une seule espèce de servitude : c'était de recevoir de nous leurs gouverneurs. Ce droit, dont l'exercice avait été interrompu, Caïus le recouvra à la suite d'un court mais sanglant combat. Car Domnès, qui gouvernait au nom du roi la ville d'Artagère, feignit de trahir son maître, et s'approchant de Caïus occupé à lire un mémoire qu'il venait de lui présenter et qui contenait, d'après lui, l'inventaire des trésors du royaume, il tira tout à coup son épée et l'en frappa. Caïus se rétablit de sa blessure, mais pour peu de temps. Le barbare, serré de tous côtés par nos soldats irrités, se perça de son épée, puis se précipita sur un bûcher, accordant d'avance satisfaction aux mânes de César qui lui survivait. A l'occident, presque toute l'Espagne était pacifiée, excepté la région qui touche à l'extrémité des Pyrénées et que baigne l'Océan Citérieur. Là, deux nations très puissantes, les Cantabres et les Asturiens, vivaient indépendantes de notre empire. Les Cantabres se soulevèrent les premiers et montrèrent le plus d'opiniâtreté et d'acharnement dans leur révolte. Non contents de défendre leur liberté, ils essayaient encore d'asservir leurs voisins et harcelaient de leurs fréquentes attaques les Vaccéens, les Turmoges et les Autrigones. Quand Auguste apprit ces violences, il ne confia pas l'expédition à d'autres ; il s'en chargea lui-même. Il vint en personne à Ségisame et y établit son camp ; puis ayant divisé son armée en trois corps il cerna toute la Cantabrie, et soumit cette nation sauvage en l'enveloppant d'une sorte de filet, comme on fait pour les animaux. Il ne laissa pas plus de repos aux barbares du côté de l'Océan et il les attaqua aussi par derrière avec sa flotte. La première bataille contre les Cantabres se livra sous les murs de Bergida. Les ennemis s'enfuirent aussitôt sur le mont Vindius, dont le sommet était si haut qu'ils se figuraient que les flots de l'océan y monteraient plutôt que les armes romaines. Aracelium résista vigoureusement à un troisième assaut, mais finit cependant par être prise. Bloqués sur le mont Médulle, que les Romains avaient entouré d'un fossé ininterrompu de quinze milles et pressaient de tous les côtés en même temps, les barbares, se voyant réduits aux dernières extrémités, avancèrent leur mort à l'envi l'un de l'autre, au milieu d'un festin, par le feu, le fer et un poison que les gens du pays ont l'habitude de tirer de l'if. La plus grande partie d'entre eux échappèrent ainsi à la captivité qui, à cette époque, paraissait plus pénible que la mort à des peuples indomptés. Ces succès de ses lieutenants Antistius, Furnius et Agrippa, Auguste les apprit à Tarragone, une ville de la côte où il avait ses quartiers d'hiver. Il se rendit lui-même sur les lieux, fit descendre les uns de leurs montagnes, exigea des autres des otages, et vendit le reste à l'encan, selon le droit de la guerre. Le sénat jugea cette victoire digne du laurier et du char triomphal. Mais César était déjà assez grand pour dédaigner d'accroître sa gloire par un triomphe. Cependant les Asturiens, formant une armée considérable, étaient descendus de leurs montagnes couvertes de neiges. Cette fois, les barbares ne semblaient pas vouloir fondre sur nous avec leur témérité habituelle. Ils établirent leur camp sur les bords de l'Astura, divisèrent leur armée en trois corps et se préparèrent à attaquer en même temps les trois camps des Romains. La lutte aurait été douteuse et sanglante, et nous pouvions souhaiter tout au plus un carnage égal de part et d'autre, car ces ennemis étaient braves, et leur marche aussi inattendue que prudente. Heureusement, les Brigécins les trahirent et prévinrent Carisius qui se porta à leur rencontre avec son armée. C'était déjà une victoire que d'avoir surpris leurs projets ; encore fallut-il livrer un sanglant combat. Les restes de l'armée en déroute se réfugièrent dans la très puissante ville de Lancia. On s'y battit avec un tel acharnement que les soldats, une fois maîtres de la place, voulaient la brûler ; le général eut bien du mal à la sauver, en leur représentant que cette ville, si elle était conservée, rappellerait bien mieux leur victoire que si elle était détruite par le feu. Telle fut la fin des guerres d'Auguste, telle fut aussi la fin des révoltes de l'Espagne. Cette province montra une fidélité inébranlable et vécut dans une paix perpétuelle grâce au changement survenu dans le caractère des habitants désormais plus amis de la paix, et aussi grâce à l'habile politique de César, qui redoutant la confiance que leur donnaient les montagnes où ils se réfugiaient les obligea à fixer leurs habitations et leur séjour dans les cantonnements établis dans la plaine. On s'aperçut bientôt de la sagesse de cette décision qui s'adaptait si bien à la nature du pays, dont les environs renferment de l'or, du borax, du minium et d'autres matières colorantes. César fit donc exploiter le sol. C'est en les cherchant pour les autres que les Asturiens commencèrent à connaître les ressources et les richesses cachées dans les profondeurs de la terre. Toutes les nations étaient pacifiées à l'occident et au midi, ainsi qu'au nord, du moins entre le Rhin et le Danube, et à l'orient, entre le Cyrus et l'Euphrate. Les autres peuples encore indépendants sentaient eux aussi la grandeur de notre empire et respectaient le peuple romain vainqueur des nations. Les Scythes et les Sarmates envoyèrent des ambassadeurs pour demander notre amitié. Les Sères mêmes et les Indiens qui habitent sous le soleil, nous apportèrent des pierres précieuses et des perles. Parmi leurs présents, ils traînaient avec eux des éléphants et ils faisaient surtout valoir la longueur du voyage qu'ils avaient mis quatre ans à accomplir ; leur teint laissait d'ailleurs bien voir qu'ils venaient d'un autre hémisphère. Enfin, les Parthes, semblant regretter leur victoire, rapportèrent d'eux-mêmes les enseignes qu'ils avaient prises lors du désastre de Crassus. Ainsi donc, partout le genre humain tout entier jouissait d'une paix ou d'une alliance durable et universelle, et en l'an 700 de la fondation de Rome, César Auguste osa enfin fermer le temple de Janus aux deux visages, qui n'avait été fermé que deux fois avant lui, sous le règne de Numa et après notre première victoire sur Carthage. Puis il se consacra à la paix, et essaya de contenir par l'autorité et la sévérité de lois nombreuses un siècle porté à tous les vices et qui s'abandonnait à la mollesse. Tant de services éminents lui valurent le titre de dictateur perpétuel et de père de la patrie. Le sénat délibéra même si, pour avoir fondé l'empire, il ne serait pas appelé Romulus. Mais on jugea plus saint et plus vénérable le nom d'Auguste , parce que ce titre, même pendant sa vie terrestre faisait déjà de lui un dieu.
FIN DE L'OUVRAGE
![]()