




PANÉGYRIQUE DE TRAJAN
prononcé
PAR PLINE (le jeune) CONSUL.
Panckoucke, 1879
 |
 |
 |
 |
 |
|---|
I. Pères conscrits, c'est une sage coutume que nous ont transmise nos ancêtres, de consacrer nos discours comme nos actions, en invoquant d'abord les immortels, puisque l'assistance, l'inspiration des dieux et les honneurs qu'on leur rend peuvent seuls assurer la justice et le succès des entreprises humaines. Et qui doit être plus religieux observateur de cette coutume qu'un consul? et en quelle occasion y doit-il être plus fidèle, que lorsque, par l'ordre du sénat et au nom de la république, il est chargé d'offrir des actions de grâces au meilleur de tous les princes ? En effet, un prince qui, par la pureté et l'innocence de ses mœurs, nous représente si bien les dieux, n'est-il pas le présent le plus rare et le plus précieux qu'ils aient pu nous faire ? Quand on aurait douté jusqu'ici si c'est le ciel ou le hasard qui donne des souverains à la terre, pourrait-on maintenant ne pas convenir que nous ne devons le notre qu'à la protection de quelque divinité? Ce n'est point par l'ordre impénétrable des destins qu'il règne ; c'est Jupiter lui-même qui l'a choisi, qui l'a donné aux Romains prosternés devant ses autels, et dans ce temple où nous éprouvons tous les jours qu'il n'est pas moins présent que dans le ciel. La justice et la religion veulent donc que j'implore votre secours, puissant maître des dieux, qui, après avoir fondé cet empire, le soutenez encore si visiblement ; faites qu'il n'échappe rien dans mon discours qui ne soit digne d'un consul, du sénat et de l'empereur! faites que la franchise, la vérité éclatent dans mes paroles, et que cet hommage paraisse aussi exempt de flatterie qu'il est libre et volontaire !
II. Je crois que, lorsqu'il s'agit de parler de notre prince, la première attention, non seulement d'un consul, mais de tous les bons citoyens, doit être de n'en rien dire qui semble avoir pu se dire d'un autre. Bannissons ces expressions, que la crainte nous arrachait; ne parlons plus le langage de la servitude : nous n'en ressentons plus les malheurs. Changeons nos discours publics sur le prince, puisque nos entretiens secrets ont changé. Que la différence des temps se manifeste par la différence de notre style, et que l'on reconnaisse, aux seules formes de nos actions de grâces, à qui et sous quel règne elles ont été rendues. Loin de nous l'adulation qui élève des autels aux princes, et les érige en divinités : ce n'est point à un tyran, à un maître que ce discours s'adresse ; c'est à un citoyen, à un père. L'empereur nous traite comme ses égaux et, d'autant plus au dessus de nous qu'il veut bien s'égaler à nous, il n'oublie jamais qu'il est homme, et qu'il commande à des hommes. Sentons aussi tout notre bonheur, jouissons-en de manière à montrer que nous en sommes dignes, et ne cessons point de nous dire qu'il serait honteux de rendre plus d'obéissance aux princes qui nous tiennent dans l'esclavage, qu'à, ceux qui se plaisent à nous faire jouir de la liberté. Il paraît assez que le peuple romain sait mettre de la différence (3) entre les princes qui le gouvernent. Les applaudissements qu'il prodiguait autrefois à la beauté d'un efféminé, il les donne aujourd'hui à la valeur d'un héros et ses acclamations, si souvent profanées à vanter le geste ou la voix d'un tyran (4), sont aujourd'hui consacrées à célébrer la piété, la modération et la clémence d'un empereur. Nous-mêmes, est-ce sa divinité, ou sa bonté, sa tempérance, sa douceur, que nous élevons au ciel, au gré de notre amour et de notre joie? Et n'avons-nous pas agi en citoyens, en sénateurs, quand nous lui avons donné ce surnom de « très-bons » , que l'orgueil de ses prédécesseurs lui a rendu propre et particulier ? N'est-ce pas le traiter avec une libre égalité, que de vanter tour-à-tour son bonheur et le nôtre ? que de proclamer à la fois et les vertus que nous lui demandons, et les vœux que nous faisons pour lui, comme si ses vertus étaient la condition de nos louanges (5)? Aussi nos acclamations lui arrachent des larmes et le font rougir de modestie : il sent bien que c'est à Trajan, et non à l'empereur, qu'elles s'adressent.
III. Essayons donc chacun en particulier de conserver, dans nos éloges préparés, cette mesure que nous avons gardée dans les transports de notre subite allégresse et sachons que le plus agréable des remerçiments, c'est celui qui ressemble le plus à ces sortes d'acclamations qu'on n'a pas eu le temps de concerter. Pour moi, je réglerai mon discours sur la modestie du prince, et je serai moins attentif à faire justice à ses vertus qu'à ménager sa délicatesse.
Quelle gloire plus grande pour un prince ! quelle gloire plus nouvelle! Je vais lui offrir des remerciments solennels, et j'appréhende bien plus de lui paraître trop prodigue que trop avare d'éloges! C'est là ma seule peine, c'est le seul embarras que j'éprouve. Car il est facile de rendre des actions de grâces à un empereur qui le mérite : je n'ai point à craindre qu'en louant son affabilité, sa frugalité, sa clémence, sa libéralité, son amour pour la vertu, sa continence, ses travaux, sa valeur, il me soupçonne de lui reprocher son arrogance, son luxe, sa cruauté, son avarice, sa jalousie, sa débauche, sa mollesse et sa lâcheté. Enfin, je n'ai pas peur de paraître froid ou zélé, selon que mon discours aura été plus ou moins chargé de louanges. Je sais que les dieux mêmes ne sont pas si touchés des prières éloquentes, que de l'innocence de la vie et que celui qui porte dans leurs temples une conscience pure, leur plaît bien plus que celui qui n'y porte que des hymnes ingénieusement composés.
IV. Mais il est juste d'obéir au décret du sénat, qui, toujours attentif au bien public, a institué ces actions de grâces, afin que, par la bouche du consul, les bons princes apprennent ce qu'on approuve en eux, et les mauvais, ce qu'on y désire. C'est un devoir qui devient d'autant plus important et plus nécessaire, qu'aujourd'hui le père de la patrie ne permet point aux particuliers de faire son éloge, et qu'il en ôterait la liberté à la république elle-même s'il pouvait se résoudre à défendre ce que le sénat autorise. C'est également un trait de votre modération, César, de le défendre ailleurs et de le souffrir ici. En effet, vous acceptez un hommage bien-moins que vous ne donnez à ceux qui vous l'offrent un témoignage de déférence (6) : vous cédez à notre tendresse. Nous pouvions nous taire sur vos bienfaits mais vous vous croyez obligé d'en entendre l'éloge.
J'ai souvent cherché, pères conscrits, à me former l'idée d'un prince chargé de l'empire du monde, également propre à commander sur terre et sur mer, dans la paix et dans la guerre et j'avoue qu'en l'imaginant au gré de mes désirs, tel qu'il put soutenir dignement une puissance comparable à celle des dieux, je n'ai pu jamais le concevoir aussi grand que notre empereur. L'un s'est illustré dans la guerre, mais il s'est avili dans la paix, l'autre s'est acquis dans Rome une gloire qu'il a perdue dans les armées. Celui-là s'est fait respecter, mais en répandant la terreur, celui-ci s'est fait aimer, mais en poussant la douceur jusqu'à la faiblesse (7). Tel a su se concilier dans l'intérieur de sa maison une estime qu'il n'a pu conserver en public, tel autre s'est acquis une réputation en public qu'il a mal soutenue dans sa maison. Enfin, jusqu'à ce jour, nous n'en avions point vu dont les vertus aient été sans aucun mélange des vices qui les avoisinent Mais quelle alliance de toutes les rares qualités, quel accord de tous les genres de gloire n'admirons-nous point dans notre prince? Sa gaîté prend-elle rien sur l'austérité de ses mœurs ? son affabilité, sur la majesté de son extérieur ? Sa taille, sa démarche, ses traits, cette fleur de santé qui brille encore dans un âge mûr ; ses cheveux, que les dieux semblent n'avoir fait blanchir avant le temps que pour le rendre plus respectable : tout cela n'annonce-t-il pas un souverain à tout l'univers ?
V. Tel devait être un prince qui ne s'est point élevé sur les ruines de la république par les malheurs de la guerre civile, ni par la fureur des armes, mais que nous destinaient la paix, l'adoption, et les dieux enfin devenus propices. Et n'est-il pas juste aussi qu'il y ait de la différence entre le prince que les hommes choisissent et celui que les dieux leur donnent? Pouvaient-ils se déclarer en votre faveur d'une manière plus éclatante qu'ils le firent lorsque vous partîtes pour aller prendre le commandement de l'armée? La destinée des autres empereurs avait été révélée, ou par les entrailles d'un grand nombre de victimes, ou par le vol heureux des oiseaux. Pour vous, dans le temps que, selon la coutume, vous montiez au Capitole, les acclamations des citoyens, qui, sans le savoir, concouraient au dessein des dieux, vous présagèrent l'empire. Le peuple en foule vous attendait à la porte du temple. Elle s'ouvrit et à peine étiez-vous entré que les Romains, croyant saluer Jupiter (8), vous proclamèrent empereur, comme, depuis, l'événement l'a bien fait connaître. Ce présage fut compris de tout le monde : vous seul ne voulûtes pas l'entendre, vous refusiez l'empire dont vous étiez d'autant plus digne que vous le refusiez. Il fallait donc que vous fussiez contraint, et vous ne pouviez l'être que par le péril de la patrie et par la crainte de voir la république renversée. Vous aviez résolu de ne vous point charger de l'empire tant qu'il y aurait quelque autre moyen de le sauver. Ainsi, je n'en doute pas, les dieux n'ont permis cette sédition, qui s'est élevée depuis peu dans le camp, que parce qu'on ne pouvait, sans un grand effort et sans vous faire craindre pour l'état, triompher de votre modestie. Mais comme jamais la mer ne paraît plus belle qu'après la tempête, ni le ciel plus serein qu'après l'orage, on dirait aussi que ces troubles qui ont précédé votre avènement à l'empire, n'ont fait qu'en augmenter l'éclat. Telles sont les vicissitudes des choses humaines : le bonheur prend sa naissance dans l'infortune, et l'infortune à son tour naît du bonheur. Dieu nous cache la source des biens et des maux, et leurs principes ont souvent des apparences bien différentes de ce qu'ils sont.
VI. C'est un grand opprobre pour notre siècle, je l'avoue, c'est une grande plaie pour la république, qu'on ait pu voir un empereur, le père commun du genre humain, investi, pris, enfermé : que le pouvoir de conserver la vie à des citoyens ait été arraché à un vieillard que sa douceur devait faire respecter enfin, qu'on ait pu dépouiller un bon prince de la première prérogative de l'empire, du droit de ne rien faire contre sa volonté. Cependant si c'était la seule voie qui pût vous élever à l'empire, j'oserai presque dire que nous n'avons point à nous plaindre. La discipline militaire a été corrompue, mais pour être rétablie et réparée de vos mains. Un dangereux exemple a été donné, pour que vous lui en opposassiez un autre à jamais mémorable. Un prince a été forcé de sacrifier ceux qu'il voulait sauver, afin de nous donner un autre prince contre lequel la violence ne pût rien ? Il y a longtemps que vous méritiez d'être adopté mais, si vous l'eussiez été plus tôt, nous ignorerions encore tout ce que vous doit l'empire. Il fallait attendre le moment où l'on ne pût douter que vous receviez bien moins que vous ne donniez. La république, près de tomber, s'est appuyée sur vous. L'empereur, accablé du poids de l'empire, vous a conjuré de le soutenir, vous avez été, par votre adoption, rappelé de votre gouvernement, comme autrefois, dans les besoins pressants de la république, on appelait à son secours les plus fameux capitaines engagés dans des guerres éloignées et étrangères : c'est ainsi que votre auguste père et vous, vous avez fait en même temps une action immortelle, lui, en vous donnant l'empire, vous, en le lui rendant. Seul donc, jusqu'à ce jour, vous avez la gloire de vous être acquitté, en recevant un tel bienfait, de la reconnaissance qu'il impose, que dis-je? d'avoir plus fait que le bienfaiteur même : en vous élevant à l'empire, il vous imposa seulement de nouveaux soins, en y montant, vous lui assurâtes le repos.
VII. O route nouvelle, route vraiment inconnue pour parvenir à l'empire! ce n'est ni votre ambition, ni votre crainte, c'est l'intérêt, c'est la sûreté du prince même qui vous fait empereur. Mais, quoique vous paraissiez arrivé au comble des grandeurs, vous avez quitté beaucoup plus que vous n'avez acquis : vous avez cessé de jouir des douceurs de la vie privée sous un bon prince. Vous avez été associé à des travaux et à des inquiétudes car ce ne sont ni les charmes ni l'éclat de cette dignité suprême qui vous l'ont fait accepter, on ne vous y a élevé que pour vous en imposer toutes les charges, et vous n'avez consenti à être empereur que lorsqu'un autre regrettait de l'être. L'alliance et l'amitié n'ont eu nulle part à votre adoption. Rien ne vous liait l'un à l'autre, que vos vertus, qui vous rendaient dignes, l'un d'être choisi, l'autre de faire un tel choix. Vous n'avez pas été adopté, comme l'ont été plusieurs autres, par la complaisance d'un mari pour une femme (9). C'est l'empereur, et non votre beau-père, qui vous adopte et Nerva est devenu votre père par les mêmes sentiments qui le rendaient le père commun de tous les hommes.
C'est ainsi qu'un sage prince, qui se donne un fils, doit le choisir. Quoi donc ! quand il s'agira de se destiner un successeur à qui l'on puisse confier la tutelle du sénat et du peuple romain (10), les légions, les provinces, les alliés, ne jettera-t-on les yeux que sur les enfants de sa femme? se renfermera-t-on dans sa maison pour y chercher un homme digne de gouverner le monde ? ne croira-t-on point au contraire ne pouvoir jamais trop curieusement parcourir toutes les plus illustres familles? et n'y reconnaîtra-t-on pas, pour son plus proche parent, pour son meilleur ami, celui qu'on y aura trouvé le plus accompli, le plus semblable aux dieux immortels? C'est entre tous qu'il faut choisir celui qui doit commander à tous. On pourrait se contenter d'un héritier, quel qu'il fut, s'il ne fallait que donner un maître à de vils esclaves mais, lorsqu'il s'agit de donner un prince à tout l'univers, il y aurait de l'orgueil et de la tyrannie à ne pas adopter celui que son mérite aurait élevé à l'empire, quand même on ne l'aurait pas adopté. C'est ce qu'a fait Nerva, il a été persuadé que si le discernement n'avait pas plus de part à l'adoption qu'à la naissance, il n'y aurait aucune différence à faire entre l'une et l'autre, si ce n'est peut-être qu'on vous pardonne bien plus des enfants mal nés que des enfants mal choisis.
VIII Pour éviter un tel malheur, il n'a pas examiné seulement ce que les hommes en penseraient, il a consulté les dieux mêmes. Aussi votre adoption, qui devait, non pas perpétuer notre esclavage, mais fonder notre liberté, notre sûreté, tout notre bonheur, n'a pas été faite dans l'appartement de l'empereur et auprès de son lit nuptial : elle a été faite dans le temple et devant le lit sacré de Jupiter (11). C'est aux dieux qu'il en faut rapporter toute la gloire, c'est leur ouvrage. Ce sont eux qui gouvernent et vous et Nerva, vous n'avez été, dans votre adoption, que leurs ministres, vous n'avez fait tous deux que leur obéir. On avait apporté de la Pannonie la nouvelle d'une victoire, les dieux, qui voulaient, par les marques mêmes du triomphe, illustrer le commencement du règne d'un prince invincible, avaient conduit Nerva au temple, pour y consacrer ses lauriers, lorsque tout à coup, plus grand et plus majestueux qu'il ne l'avait jamais été, à la face des dieux et au milieu des acclamations du peuple, il vous déclara son fils, ou plutôt son unique ressource dans la conjoncture où il se trouvait. Alors, comme s'il eût abdiqué l'empire (en effet, partager l'empire, c'est presque l'abdiquer, et peut-être même que le partage en est plus difficile que l'abdication), on le vit plein de joie et de confiance. On eût dit que vous étiez présent, que vous lui aviez communiqué votre jeunesse et votre courage, et qu'en appuyant sur vous et sa personne et la république, il avait repris de nouvelles forces.
Aussitôt le tumulte s'apaisa. Ce n'est point à l'adoption, mais au mérite de la personne adoptée qu'on doit un tel miracle. Nerva n'eût pris que de fausses mesures, s'il eût fait un autre choix. Et ne nous souvenons-nous pas que naguère, loin d'étouffer les troubles, l'adoption même les fit naître (12) ? Si celle-ci fût tombée sur tout autre que sur vous, elle n'eût fait qu'irriter les esprits et allumer davantage le feu de la rébellion. Peut-on s'imaginer qu'un prince qui manque d'autorité pour se faire respecter, en ait assez pour disposer de l'empire, s'il ne la tient toute de celui à qui il le donne ? A peine fils de Nerva, vous êtes créé César, vous êtes créé empereur, vous êtes revêtu de la puissance sacrée des tribuns et c'est ce que, dans ces derniers temps, un père véritable n'avait fait que pour un de ses fils seulement (13).
IX. Quel éloge pour votre modération, qu'on ait osé vous choisir, non pas seulement pour successeur, mais encore pour associé à l'empire! car il ne dépend pas d'un souverain de n'avoir point de successeur, mais il dépend toujours de lui de n'avoir point d'associé, La postérité le pourra-t-elle croire ? Un homme de race patricienne, né d'un consulaire, d'un triomphateur, un homme qui commandait une armée brave, nombreuse, dévouée à tous ses intérêts, est parvenu à l'empire et ce ne sont pas ses troupes qui l'y ont élevé ! Croira-t-elle qu'il ait été gouverneur de la Germanie, et que ce soit de Rome qu'il ait reçu le titre de Germanique! qu'enfin il n'ait rien entrepris, rien fait lui-même pour être élu empereur si ce n'est de le mériter et d'obéir !
Car vous avez obéi, César ; c'est votre obéissance qui vous a fait prince et votre soumission n'a jamais mieux éclaté, que quand vous avez consenti à gouverner. Déjà on vous avait proclamé César, empereur ; déjà on vous avait donné le nom de Germanique, et vous étiez encore éloigné, et vous l'ignoriez et, décoré de si grands titres, vous n'étiez encore, autant qu'il dépendait de vous, qu'un homme privé. Ce serait beaucoup, si je disais que vous ne saviez pas que vous dussiez être empereur. Eh bien! vous étiez empereur, et vous ne le saviez pas!
Quand vous en apprîtes la nouvelle, vous eussiez mieux aimé rester ce que vous étiez : mais vous n'en aviez pas la liberté ; un citoyen pouvait-il désobéir à son prince, un lieutenant à son général, un fils à son père? Que serait devenue la discipline ? que serait devenue cette coutume que nos ancêtres nous ont transmise, d'être toujours également prêts à exécuter tous les ordres de celui qui commande? Vous saviez qu'il pouvait vous donner successivement différents gouvernements, qu'après une guerre finie, il pouvait vous charger d'une autre et vous ne doutiez pas qu'il n'eût le droit de vous rappeler pour gouverner l'empire, comme il l'avait eu de vous faire partir pour commander l'armée, qu'enfin, soit qu'il vous envoyât pour exécuter ses ordres, soit qu'il vous rappelât pour partager son rang, la gloire de l'obéissance était égale, et qu'elle était même plus grande à faire ce qui vous plaisait le moins.
X. Ce qui donnait, à vos yeux, plus d'autorité aux ordres de Nerva, c'est le péril même qui menaçait sa puissance : ce que les autres lui refusaient de soumission, ne vous paraissait qu'un nouvel engagement de redoubler la vôtre. Vous étiez informé d'ailleurs que le sénat et le peuple vous souhaitaient avec une égale ardeur, que votre élection n'était point l'ouvrage de l'empereur seul, et que les vœux communs de tout le monde vous appelaient à l'empire. S'il vous nomma le premier, ce ne fut que par un privilège dû au prince mais il ne fît que ce que nous aurions tous fait, si nous en avions eu le pouvoir. Et sans doute on n'eût pas tant applaudi à votre adoption, si on ne l'eût pas unanimement désirée.
Et vous, avec quelle modération n'avez-vous point usé de votre fortune et de votre puissance? Si l'on consultait les statues, les inscriptions publiques, nos étendards, vous étiez empereur. Si l'on regardait votre modestie, vos travaux, votre vigilance, vous ne paraissiez qu'un général, un lieutenant, un soldat. On vous voyait, comme auparavant, marcher à pied à la tête de vos enseignes et votre adoption n'éclatait que par votre zèle, par votre respect vraiment filial pour l'empereur, et par les vœux que vous ne cessiez de former pour jouir longtemps de la gloire de lui obéir et de lui plaire. Quoique les dieux vous eussent élevé à la première place, vous souhaitiez de demeurer et même de vieillir dans la seconde et vous ne vouliez vous regarder que comme un homme privé, tant qu'un autre serait empereur avec vous. Vos vœux n'ont été exaucés qu'autant qu'ils devaient l'être pour la gloire d'un si bon et si vertueux prince. Il a été rappelé au ciel, de peur que son nom, consacré par une pensée toute divine, ne fût ensuite profané par quelque chose d'humain. Une action si mémorable méritait bien en effet d'être la dernière de sa vie. On ne pouvait trop tôt placer entre les immortels celui, qui l'avait faite, et laisser douter aux siècles à venir s'il n'était pas déjà dieu quand il la fit Ainsi, comblé d'honneurs et de gloire, ce père de la patrie, qui n'a jamais mieux mérité de l'être, que lorsqu'il voulut devenir le vôtre, après avoir assez éprouvé que vous pouviez dignement soutenir la grandeur et la majesté de l'empire, laissa Trajan à la terre, et la terre à Trajan ; d'autant plus cher et plus regrettable, qu'il avait plus fait pour n'être pas regretté.
XI. Votre tendresse lui donna les larmes qu'un fils doit à la mémoire de son père, et bientôt vous lui élevâtes des temples, mais guidé par un plus noble sentiment que les princes vos prédécesseurs, qui rendirent le même honneur à celui dont ils occupaient la place. Si Tibère dressa des autels à Auguste, ce ne fut que pour avoir prétexte d'accuser d'impiété ceux qui attaqueraient la mémoire de ce prince. Si Néron plaça Claudius au ciel, ce fut moins pour l'honorer que pour se jouer des immortels. Enfin, si Titus déifia Vespasien, et Domitien Titus, ils ne voulaient que se faire regarder, l'un comme fils, l'autre comme frère d'un dieu. Pour vous, quand vous mettez Nerva au rang des immortels, ce n'est ni pour inspirer de la crainte aux citoyens, ni pour faire injure aux dieux, ni pour vous faire honneur à vous-même, c'est parce que vous êtes persuadé que les dieux ont rendu cette justice à ses vertus. Il faut l'avouer, un tel culte perd beaucoup de son prix, quand on le reçoit de ceux qui croient le partager.
Mais, quelque soin que vous ayez pris de dresser des autels à Nerva, de lui assigner des prêtres, et de placer le lit sacré dans son temple (14) rien n'établit mieux sa divinité que votre vie. Car dans un prince qui meurt après avoir choisi son successeur, la preuve la plus certaine de divinité, c'est que ce successeur soit digne de l'être. L'immortalité de votre père vous a-t-elle inspiré la moindre vanité? Vous a-t-on vu imiter ces derniers princes, qui ne se faisaient de la divinité de leurs pères qu'un titre d'orgueil et de mollesse? ou plutôt n'avez-vous pas continué de marcher avec ardeur sur les traces de ces anciens et fameux capitaines qui ont fondé l'empire romain? Nos ennemis, qui en désolaient la frontière (15), commençaient à le mépriser et nous n'étions jamais plus assurés qu'ils n'avaient point été défaits, que quand on triomphait d'eux. Enflés de leurs succès, ils avaient secoué le joug ; ce n'était plus pour les tenir dans l'obéissance, mais pour défendre notre liberté, que nous combattions. Nous ne pouvions plus même conclure de trêves qu'à des conditions égales (16) et, pour les contenir, il fallait recevoir leurs lois.
XII Mais aujourd'hui, avec la crainte et l'épouvante, l'esprit de soumission est rentré en eux. Ils s'aperçoivent bien qu'ils ont maintenant en tête un de ces généraux des premiers siècles, où il ne fallait pas moins qu'un champ couvert de morts, qu'une mer rouge de carnage pour mériter le nom d' imperator . Nous avons donc des otages que nous n'achetons point et nous ne faisons plus de ces traités qui, par des pertes réelles, et par des tributs honteux, nous donnaient droit de faire parade de victoires imaginaires. On nous supplie, on nous conjure, nous accordons, nous refusons, selon que la majesté de l'empire le demande : obtient-on, l'on nous rend grâces : refusons-nous, on n'ose pas se plaindre. Et comment auraient-ils l'audace de murmurer, eux qui savent que, dans le temps le plus favorable aux barbares, et le plus contraire aux Romains, lorsque le Danube glacé expose nos provinces à leurs incursions, et que ces peuples féroces sont encore mieux défendus par leur climat que par leurs armes, vous avez campé sur leur territoire ? Aux premières nouvelles de votre approche, comme si la saison eût tout à coup changé, ne les vit-on pas s'enfermer dans leurs antres, pendant que leurs rives étaient ravagées par nos légions, prêtes, si vous l'aviez voulu permettre, à pénétrer plus avant, et, s'emparant des avantages de l'ennemi, à lui rendre l'hiver aussi funeste qu'il le rendait naguère à nos armées.
XIII. Pendant que vous étiez ainsi la terreur des barbares, quelle admiration, quel amour n'inspiriez-vous pas à vos soldats! Ils vous voyaient partager la faim et la soif avec eux, et, dans les exercices militaires, vous couvrir comme eux de poussière et de sueur. Fallait-il dans ces jeux guerriers lancer un javelot ou en soutenir l'atteinte, vous ne vous distinguiez d'eux que par la force et par l'adresse. Touché de leur courage, charmé toutes les fois que le coup le mieux asséné tombait sur votre casque ou sur votre bouclier, vous combliez d'éloges ceux qui l'avaient porté ; vous les excitiez à ne rien craindre et à faire encore mieux et que ne tentaient-ils point, sous les yeux d'un général qui prenait la peine de les former lui-même? Avez-vous jamais laissé à un autre le soin d'examiner leurs armes, d'éprouver leurs traits? Et s'il s'en trouvait quelqu'un qui parût trop pesant au soldat, ne le lanciez-vous pas vous-même pour en faire l'essai? Qui apporta jamais plus d'attention à consoler les malheureux, à secourir les malades? Vous êtes-vous jamais retiré dans votre quartier, avant d'avoir visité tous les autres? Avez-vous jamais cherché le repos, avant de l'avoir assuré à toute l'armée?
Qu'il se trouvât un tel général au milieu des Fabricius, des Scipions et des Camilles, je m'en étonnerais moins. Les grands exemples alors réveilleraient son ardeur et une vertu plus haute que la sienne allumerait incessamment dans son âme une noble émulation mais aujourd'hui que nous n'aimons plus les combats que dans les spectacles, que nous en avons fait un vain plaisir, au lieu d'un mâle exercice (17), et qu'enfin nous ne sommes plus instruits à manier les armes par des vétérans qu'ont illustrés des récompenses accordées à leur courage, mais par quelque misérable maître d'escrime, venu de Grèce, combien il est glorieux d'avoir seul conservé les moeurs et les vertus de nos pères, de n'avoir d'autre modèle à se proposer, d'autre rival à combattre que soi-même, et, quand seul on occupe la première place, d'avoir seul tout ce qui la mérite!
XIV. Remontons jusqu'aux commencements et aux préludes de tant de gloire. A peine, César, sortiez-vous de l'enfance, que déjà, dans l'expédition de votre père contre les Parthes, vos exploits donnèrent un nouvel éclat à ses lauriers, déjà vous étiez digne du nom de Germanique. Bientôt la seule terreur qui se répandit à la nouvelle de votre approche suffit pour réprimer les Parthes. Votre réputation ne tarda guère à s'étendre des bords de l'Euphrate aux bords du Rhin, vous parcouriez toute la terre, devancé par votre renommée, toujours plus illustre et plus grand pour les peuples qui vous voyaient les derniers et cependant vous n'étiez pas encore empereur, ni fils d'une divinité. Pour pénétrer en Germanie, que de nations à traverser (18) ! que de pays à parcourir! Il vous fallait franchir les Pyrénées et les Alpes, et d'autres montagnes qui paraîtraient affreuses, si on ne les comparait pas à celles-là. C'étaient autant de barrières insurmontables qui défendaient les Germains. Pendant que vous conduisiez, ou plutôt (tant votre marche était rapide!) que vous faisiez voler vos légions pour une expédition si éloignée, vous est-il arrivé de monter sur un char, ou de vous servir d'un cheval? Vous en aviez pourtant qui suivaient et qui marchaient avec les autres mais ce n'était que pour honorer votre rang, et non pour vous épargner des fatigues. Vous ne vous en serviez que pour les courses, et pour les autres exercices militaires, que vous aimiez à faire dans les campagnes voisines de votre camp, lorsque la marche de l'armée était suspendue.
Que doit-on admirer le plus dans de tels travaux, ou l'entreprise, ou l'exécution ? Quelles louanges ne mérite pas votre persévérance? Mais combien en doit -on plus à ce noble courage, qui ne vous a pas seulement laissé craindre de ne pouvoir persévérer! Aussi je ne doute point que ce prince efféminé (19) qui vous rappelait de l'Espagne, comme le seul capable de faire tête à de si redoutables ennemis, ce prince qui portait envie aux vertus d'autrui, dans le temps même qu'il ne pouvait s'en passer pour se soutenir, n'ait été alors aussi rempli d'admiration pour vous, que le fut autrefois pour Hercule ce tyran cruel (20), qui, en le livrant à tant de périls, le couvrit de tant de gloire. Comme ce héros infatigable, marchant d'exploits en exploits, chaque expédition vous faisait juger digne d'en entreprendre une autre.
XV. Dans la fleur de votre jeunesse, et n'étant encore que simple tribun militaire, vous aviez déjà fait briller un mâle courage aux deux extrémités de la terre : il semblait dès lors que la fortune vous avertît de préparer, par un long et complet apprentissage, les leçons que vous deviez bientôt donner aux autres. Car vous ne vous êtes pas contenté de voir un camp, et de servir quelques années : vous vous êtes si bien acquitté de votre charge de tribun, que peu après vous eussiez pu être général, et qu'appelé à commander, vous n'auriez eu rien de plus à apprendre. Vous aviez étudié pendant dix campagnes les mœurs des peuples, la situation des pays, l'avantage des lieux, et vous vous êtes accoutumé à supporter la différence des climats et des eaux. Qui pourrait dire combien de fois il a fallu renouveler vos chevaux et vos armes?
Un temps viendra donc où nos neveux s'empresseront d'aller voir, et de faire voir à leurs enfants, les plaines arrosées de vos sueurs, les arbres qui ont prêté leur ombre à vos repas militaires, les antres qui ont protégé votre sommeil, les maisons qui ont possédé un hôte si illustre. Enfin, on montrera vos traces dans ces lieux avec autant d'empressement que vous y cherchiez celles des capitaines fameux (21). Cet honneur vous est réservé pour l'avenir (22) : revenons au présent. Est-il un soldat, pour peu qu'il ait fait la guerre, qui ne puisse se vanter d'avoir eu l'honneur de servir avec vous, avant que de servir sous vous? De là vient que vous les appelez presque tous par leur nom, qu'ils n'ont point fait d'exploits que vous n'aimiez à raconter, et que vous leur épargnez la peine de vous rappeler les blessures qu'ils ont reçues pour la république, puisque, témoin de leur dévouement, vous l'avez aussitôt honoré de vos éloges.
XVI. Mais combien n'en devons-nous pas à votre modération ! Nourri dans le goût de la gloire militaire, vous aimez la paix. On ne vous voit pas, plein du triomphe de votre père, et fier d'avoir été adopté le jour même que l 'on consacrait vos lauriers à Jupiter, chercher sans cesse les occasions de triompher. Vous ne craignez ni ne provoquez la guerre. Quelle grandeur, César, de s'arrêter sur les rives du Danube, quand on est sûr qu'il n'y a qu'à le passer pour vaincre! de ne point souhaiter le combat, devant des ennemis qui l 'évitent ! Quel honneur à la fois pour votre courage et votre modération! vous ne voulez point combattre, c'est modération ; vos ennemis ne le veulent pas eux - mêmes, c'est l'effet de votre courage. Le Capitole ne recevra donc plus maintenant de chars vides de vainqueurs ; il ne verra plus de vains simulacres de la victoire mais il recevra un empereur rapportant une gloire solide et véritable, la paix, la tranquillité et la soumission des peuples, si pleine et si entière qu'il n'aura pas eu même d'ennemis à vaincre. Est-il un triomphe plus beau? Car enfin nous ne pouvons vaincre, sans reconnaître qu'on a méprisé notre puissance. Que si quelque roi barbare (23) pouvait être assez téméraire ou assez insensé pour s'attirer votre indignation, fût-il défendu par les plus vastes mers, par des fleuves immenses, par des montagnes inaccessibles, il ne tardera guère à éprouver que ce sont de faibles remparts contre votre valeur et il se verra si promptement accablé, que, dans son étonnement, il lui semblera qu'à votre aspect les montagnes se sont aplanies, les fleuves se sont retirés, la mer a disparu, et que ce sont, non pas nos flottes, mais nos villes elles-mêmes qui ont fondu sur ses états.
XVII. Il me semble déjà voir un triomphe, dont la pompe n'est plus ornée, comme auparavant, des dépouilles de nos provinces, et des richesses arrachées à nos alliés mais dont la marche est retardée par le poids des armes ennemies et par les chaînes des rois captifs. Je lis les terribles noms des capitaines vaincus, et je vois des hommes qui ne démentent point ces noms fameux. J 'aperçois déjà leurs audacieuses entreprises retracées par de vives images, qu'ils suivent les mains liées (2 4). Vous, César, élevé sur un char, devant lequel on porte les boucliers qui ont été percés de vos traits, vous semblez encore poursuivre ces nations vaincues. Les dépouilles mêmes d'un général tombé sous vos coups ne vous manqueraient pas, s'il était quelqu'un de leurs rois assez hardi pour se mesurer avec vous, et pour ne point craindre, je ne dis point vos javelots, mais vos regards et vos menaces, lors même qu'il serait séparé de vous par le champ de bataille et par son armée tout entière. Vous venez de mériter, par votre modération (25), que, forcé par la majesté de l'empire soit à déclarer la guerre, soit à la repousser, l'on vous fasse la justice de croire que vous n'avez pas vaincu pour triompher, mais que vous ne triomphez que parce que vous avez vaincu.
XVIII. Une idée m'en rappelle une autre. Qu'il est honorable d'avoir rétabli la discipline militaire, presque entièrement détruite par la corruption du dernier siècle, par la mollesse des chefs, par l'insolence du soldat, et par le mépris de l'autorité! On peut aujourd'hui sans péril mériter l'admiration ou l'attachement des troupes. Un commandant n'a plus à craindre d'être aimé ou d'être haï des soldats. Également en sûreté contre leur haine et contre leur amour, il presse les ouvrages, il dirige leurs exercices, il prend soin que les armes soient en bon état, les hommes bien dressés, les camps bien retranchés. Car nous n'avons plus un prince qui s'imagine être menacé par les préparatifs que l'on fait contre les barbares : cette défiance convenait à ceux qui, nous traitant en ennemis, pouvaient craindre d'être traités de même à leur tour. De tels princes se plaisent à voir s'éteindre notre amour pour les armes, notre corps s'amollir avec notre courage (26), et nos épées s'émousser par notre indolence aussi nos généraux appréhendaient bien plus les embûches de leurs empereurs, que celles des rois barbares ; le glaive de leurs propres soldats, que celui de leurs ennemis.
XIX. Comme entre les astres, les plus grands ne paraissent point sans obscurcir les plus petits, ainsi l'empereur ne se montre pas sans effacer ses lieutenants. Vous seul, vous avez su vous faire une sorte de grandeur, qui ne dérobe rien à celle des autres. En votre présence, chacun a retenu toute l'autorité qu'il avait en votre absence. Il est arrivé même à la plupart, que la considération qu'on avait pour eux, s'est augmentée par celle que vous leur avez marquée. Egalement chéri de la noblesse et du peuple, vous avez tellement confondu le soldat avec l'empereur, que vous n'avez point inspiré d'ardeur aux troupes que vous n'ayez sentie, point ordonné de travaux que vous n'ayez partagés. Heureux ceux qui vous servent! vous n'en connaissez point le zèle et la capacité sur la foi d'autrui et sur ce que vous en avez entendu dire, vous en jugez par vous-même, et sur ce que vous leur avez vu faire. Ils ont le bonheur que, lorsqu'ils sont absents, vous vous en rapportez moins, sur ce qui les touche, aux autres qu'à vous-même.
XX. Enfin, les vœux et l'empressement du peuple romain vous ont forcé à revenir, l'amour de la patrie l'a emporté sur votre amour pour l'armée mais que d'ordre et de tranquillité dans votre marche! pouvait-on s'apercevoir que vous reveniez d'une expédition militaire? Je ne vous louerai point de ce que votre retour n'a alarmé ni les maris, ni les pères. Cette pureté de mœurs, que les autres ont voulu feindre, vous est si naturelle, qu'on ne peut vous en faire un mérite. Les voitures qu'on devait vous fournir étaient réclamées sans désordre : nulle délicatesse sur vos logements, votre nourriture était celle de tous les autres, votre suite était sage et tranquille. On eût dit que quelque grand capitaine, ou que Trajan même allait joindre son armée, tant l'empereur avait su conserver les vertus du général (27)! Qu'il avait été différent naguère le voyage, ou plutôt l'incursion de ce prince qui a tout ravagé sur son passage, chassé les citoyens de leurs maisons, pillé, brûlé, détruit tout, avec autant de fureur qu'auraient pu faire des ennemis, ou les barbares mêmes qu'il fuyait! Il fallait que les provinces apprissent qu'une telle marche avait été la marche de Domitien, et non de l'empereur. Ce n'est donc pas pour votre gloire, c'est pour l'intérêt de l'empire, que, par votre édit, vous avez ordonné le remboursement de toute la dépense qui avait été faite pour son voyage et pour le vôtre. Il est bon qu'un empereur s'accoutume à compter avec la république, qu'en traversant nos provinces, il songe qu'il rendra compte de sa marche, qu'enfin il déclare publiquement la dépense qu'il aura faite. Il arrivera de là, qu'il craindra de dépenser ce qu'il aurait honte de déclarer. D'ailleurs, il importe que les princes qui viendront après vous ne puissent ignorer combien votre voyage a coûté, et qu'ayant devant les yeux votre exemple et celui de Domitien, ils se souviennent que leur réputation sera réglée sur le choix qu'ils auront fait de l'un ou de l'autre de ces modèles.
XXI. Tant de biens dont vous nous comblez ne vous avaient-ils pas justement mérité de nouveaux honneurs et de nouveaux titres? Cependant vous refusiez encore le nom de père de la patrie. Quels combats n'a-t-il point fallu livrer à votre modestie ! et que vous avez longtemps résisté! Ce nom que les autres princes n'ont pas hésité de prendre avec celui de César et d'empereur, dès le jour de leur avènement, vous l'avez constamment rejeté, jusqu'à ce que vous-même, malgré le peu de prix que vous attachiez à vos bienfaits, vous ayez été obligé de convenir que vous le méritiez. Ainsi donc, seul entre tous, vous avez été père de la patrie, avant de l'avoir été proclamé par la voix publique (28). Nos suffrages secrets, nos cœurs vous déféraient déjà ce titre, et il eût semblé peu important au zèle des citoyens quel nom l'on vous donnât, s'il n'y eût eu une espèce d'ingratitude à vous appeler empereur et César, alors qu'ils trouvaient en vous un véritable père. Avec quelle douceur, avec quelle humanité ne soutenez-vous pas ce nom? Ne vivez-vous pas avec nous comme un père avec ses enfants ? Vous partez homme privé, vous revenez empereur ; nous vous reconnaissons, et vous nous reconnaissez. Vous ne vous apercevez pas qu'il soit survenu aucun changement ni dans votre état, ni dans le nôtre, vous vous faites l'égal de tous, et vous ne vous montrez le plus grand que par vos vertus.
XXII. Que dirai-je de ce jour où vous entrâtes dans Rome, si ardemment désiré, si impatiemment attendu? Et la manière même dont vous être entré, combien n'excita-t-elle pas de surprise et de plaisir (29)! Nous avions vu les autres empereurs, non-seulement trainés sur un char par quatre chevaux blancs, mais, ce qui est le comble de l'orgueil, portés sur les épaules des hommes. Pour vous, vous deviez à la seule majesté de votre taille, de dominer sur tout ce qui vous entourait, vous avez triomphé en quelque sorte de la vanité de vos prédécesseurs, tandis qu'ils ne semblaient triompher que de notre patience. Aussi n'y eut-il personne que son âge, son sexe ou sa santé pût empêcher de courir à un spectacle si nouveau. Les enfants s'empressaient de vous connaître, les jeunes gens de vous montrer, les vieillards de vous admirer, les malades mêmes, sans égard pour les ordres de leurs médecins, se tenaient sur votre passage, on eût dit qu'ils allaient à la guérison et à la santé. Les uns s'écriaient qu'ils avaient assez vécu, puisqu'ils vous avaient vu, les autres disaient que c'était maintenant qu'il était doux de vivre, les femmes se réjouissaient d'avoir mis au monde des enfants, voyant à quel prince elles avaient donné des citoyens, à quel général elles avaient donné des soldats. On voyait les toits plier sous le poids des spectateurs. Les places même où l'on ne pouvait se tenir qu'à demi suspendu, étaient occupées. La foule dont les rues étaient pleines, vous laissait à peine un étroit passage : le peuple faisait éclater sa joie à vos cotés, et vous trouviez partout les mêmes transports, et les mêmes acclamations. Il était bien juste que la joie de tout le monde fût égale, puisque vous étiez également venu pour tout le monde : et cependant elle semblait redoubler à mesure que vous avanciez, et pour ainsi dire à chaque pas que vous faisiez.
XXIII. Qui ne fut charmé de voir qu'à votre retour vous embrassiez les sénateurs, comme ils vous avaient embrassé à votre départ? qu'il n'y avait personne de distingué dans l'ordre des chevaliers, à qui vous ne fissiez l'honneur, et sans qu'il fût besoin d'aider votre mémoire, de le nommer par son nom (30)? qu'enfin ceux qui avaient le bonheur d'être auparavant sous votre protection (31) , semblaient recevoir de vous plus de témoignages de bienveillance qu'à l'ordinaire. Mais ce qui enchantait surtout les citoyens, c'est que votre marche était lente et tranquille, autant que le permettait la foule qui ne se rassasiait point de vous voir : c'est qu'il n'était personne dont cette multitude avide pût s'approcher plus librement que de vous (32) et que, dès le premier jour de votre empire, on vous venait confier votre garde à votre peuple. Car vous n'étiez pas au milieu d'une troupe de gens armés, mais environné de tous cotés, tantôt d'une partie du sénat, tantôt de l'élite des chevaliers, selon que la foule des chevaliers ou des sénateurs se grossissait autour de vous. Vous suiviez vos licteurs, qui vous devançaient, sans trouble et sans bruit. Car l'air et la douceur de vos soldats ne permettaient point de les distinguer du peuple.
Mais lorsque vous commençâtes à monter au Capitole, comme on se rappela avec douceur le jour de votre adoption ! Quelle joie surtout pour ceux qui vous avaient autrefois salué comme empereur dans ce même lieu! Je crois, pour moi, qu'alors seulement (33) le dieu lui-même goûta dans toute son étendue le plaisir de son ouvrage. Enfin, quand on vous vit prendre le même chemin qu'avait suivi votre auguste père pour aller révéler le secret, des dieux qui vous destinaient à l'empire, quels ravissements de toute l'assemblée! Les acclamations recommencèrent ; on eût dit que ce jour était celui de votre adoption. Que d'autels fumants par toute la ville, que de victimes offertes (34) que de vœux réunis pour le bonheur d'un seul homme! Ne voyait-on pas que chacun, en demandant votre conservation aux dieux, croyait leur demander la sienne et celle de ses enfants? De là, vous prîtes le chemin du palais impérial mais avec la même contenance, avec aussi peu de faste, que si vous fussiez retourné dans votre maison particulière. Enfin, chacun se retira pour se livrer à de nouveaux transports dans le sein de sa famille, où rien n'oblige à feindre la joie que l'on ne ressent pas.
XXIV. Un tel commencement eût été difficile à soutenir pour tout autre. Mais vous, plus admirable et meilleur de jour en jour, vous tenez ce que les autres princes se contentent de promettre. Par un privilège qui vous est propre (35) , le temps ne fait qu'augmenter vos vertus et notre amour. Vous avez su, en effet, unir des qualités bien contraires, la fermeté d'un homme qui gouverne depuis longtemps, et la retenue d'un homme qui commence à gouverner. Vous n'abaissez pas les citoyens jusqu'à leur permettre de vous embrasser les genoux et vous ne rendez pas le salut, en présentant votre main à baiser. L'empereur a conservé l'affabilité et la simplicité du sujet. Vous marchiez à pied, vous y marchez encore, vous aimiez les plus rudes travaux, vous les aimez de même, et la fortune, qui a tout changé autour de vous, n'a rien changé en vous (36) . On peut maintenant sans crainte, quand le prince paraît en public, s'arrêter pour le voir, se trouver sur son passage, l'accompagner, continuer son chemin. Vous vous promenez au milieu de nous, sans paraître sentir l'honneur que vous nous faites (37), et vous vous rendez accessible, sans dessein de vous en prévaloir (38). Chacun vous aborde et vous parle autant qu'il lui plaît et sa seule discrétion, et non votre impatience, règle la longueur de son discours.
Nous sommes soumis à vos ordres, mais c'est de la même manière que nous le sommes aux lois. Car elles s'opposent à nos dérèglements, elles répriment nos passions mais nous vivons avec elles, et elles ne sont parmi nous que pour nous. Vous êtes au dessus de nous, comme la magistrature et la puissance publique : elles dominent sur les hommes, mais sans cesser d'être avec eux. La vanité des autres princes, et la crainte de mettre entre eux et nous quelque égalité, leur avaient fait perdre l'usage des jambes. Porté sur les épaules de leurs esclaves, ils semblaient marcher sur nos têtes. Mais vous, la renommée, la gloire, l'amour des citoyens, la liberté vous placent au dessus de ces princes, et, en confondant sur la terre vos pas avec les nôtres (39) , vous avez su cependant vous élever jusqu'au ciel.
XXV. Je ne crains pas, Pères conscrits, de vous paraître trop long, puisqu'on ne peut trop souhaiter que les bienfaits dont nous rendons grâces au prince soient infinis. Il y aurait plus de respect à les passer tout-à-fait sous silence, et à les laisser tout entiers à vos réflexions, qu'à les toucher légèrement et en passant car le silence a cet avantage sur les discours faibles, qu'il ne fait rien perdre de la vérité. Je ne dirai pourtant qu'un mot des libéralités que vous avez faites au peuple, mais telles que vous les lui aviez promises, quoique les troupes n'eussent reçu qu'une partie des dons qui leur avaient été destinés. N'y a-t-il pas de la grandeur d'âme à avoir plus d'exactitude envers ceux qui peuvent en exiger le moins? Ce n'est pas que, dans cette diversité même, on ne puisse dire que vous avez tenu la balance égale : les soldats n'ont rien eu à envier au peuple, parce que, s'ils n'ont reçu qu'une partie, ils l'ont reçue plus tôt, ni le peuple aux soldats, parce que, s'il a reçu plus tard, il a tout reçu.
Mais avec quelle attention vos bienfaits n'ont-ils pas été distribués? Quel soin n'avez-vous pas pris (40) pour les répandre de telle sorte que tout le monde pût s'en ressentir? Ils sont parvenus jusqu'à ceux qui, depuis votre édit, avaient été substitués à la place des citoyens rayés du rôle public et on a ainsi égalé aux autres, ceux même à qui on n'avait rien promis. L'un était retenu par des affaires, l'autre par sa santé, celui-ci était arrêté par la mer, celui-là par des fleuves débordés : on les attendit (41). Vous avez voulu que ni la maladie, ni les occupations, ni l'éloignement, ne fussent un obstacle à vos bienfaits. Il a été libre à chacun de venir recevoir quand il a pu, quand il a voulu. Quoi de plus magnifique et de plus digne de vous, César, que d'avoir su, par votre libéralité, rapprocher en quelque sorte les pays les plus éloignés, réunir des hommes que séparaient des espaces immenses, prévoir et surmonter tous les obstacles, tromper la malignité de la fortune, et faire en sorte que, dans le temps que vous avez répandu vos largesses sur les citoyens, aucun n'ait pu sentir qu'il était homme, sans s'apercevoir qu'il était Romain !
XXVI. Le jour marqué pour la distribution, des essaims d'enfants, futurs citoyens de la république, avaient coutume d'attendre que le prince sortît, et d'occuper toutes les rues par où il devait passer. Les pères, pour les exposer à sa vue, prenaient soin de les élever au dessus de leurs têtes, et de leur apprendre quelques paroles flatteuses, qui étaient fidèlement répétées. Mais la plupart trouvaient les oreilles du prince fermées à leurs prières et, ignorant ce qu'ils avaient demandé, ignorant ce qu'on leur refusait, ils étaient renvoyés à l'âge où ils seraient mieux instruits. Mais vous, César, vous n'avez pas même attendu que l'on vous priât et, quoique cette jeunesse romaine eût été un spectacle très agréable à vos yeux, vous avez voulu que leurs noms fussent reçus et écrits dans les registres publics, avant qu'on vous les eût présentés. C'est ainsi que dès leur enfance, et par le soin que vous preniez de leur éducation, ils ont appris à vous reconnaître pour le père commun. C'est ainsi qu'ont été élevés à vos dépens ceux qu'on élevait pour vous ; que vous avez donné des aliments à ceux qui devaient un jour mériter votre solde, et que tous ont été aussi redevables à vous seul, que chacun d'eux l'était à ses propres parents. C'est connaître la vraie gloire, César, que de contribuer à soutenir ainsi les espérances du nom romain car nulle sorte de dépense n'est plus digne d'un grand prince, d'un prince qui doit être immortel, que celle qu'il consacre à la postérité. De grandes récompenses et de grandes peines inspirent également aux riches le désir d'avoir des enfants (42) . Une seule raison peut y engager les pauvres, c'est qu'ils aient un bon prince. Mais, quelque bon qu'il soit, il précipite la chute de l'empire, si sa main libérale ne fait vivre ceux qui ne sont nés que sur la foi de son humanité. Comme la tête n'est jamais ferme si on laisse tomber le corps en défaillance, de même aussi l'on protège inutilement la noblesse, si l'on néglige le peuple.
Il est aisé de comprendre la joie que vous ressentîtes, quand vous fûtes accueilli par les acclamations des pères et de leurs enfants, des jeunes gens et des vieillards. Quel plaisir pour vous, la première fois que ces jeunes citoyens se firent entendre à vous, et que ce fut pour vous remercier de n'avoir rien à vous, demander Mais ce qui surpasse tout le reste, c'est que sous votre empire il soit à la fois agréable et utile d'avoir des enfants (43).
XXVII. Les pères ne craignent plus pour leurs fils d'autres accidents que ceux qui sont inséparables de la condition humaine : on ne compte plus la cruauté du prince entre les maux inévitables. C'est véritablement un grand attrait pour souhaiter des enfants, que de savoir qu'ils leur manqueront ni d'aliments, ni des autres secours nécessaires à la vie mais ce qui invite bien plus encore, c'est de savoir qu'ils vivront libres et en sûreté. Ainsi, que le prince ne donne rien, pourvu qu'il n'enlève rien, qu'il se dispense de nourrir les citoyens, pourvu qu'il les laisse vivre, et la république ne manquera pas de pères qui souhaiteront des enfants. Au contraire, qu'il donne et qu'il ôte, qu'il nourrisse et qu'il tue, il réduira bientôt chacun, non seulement à craindre d'avoir des enfants, mais encore à s'affliger de la vie de son propre père et de la sienne même.
Aussi ce que je loue le plus dans votre libéralité, c'est qu'elle n'est exercée qu'à vos dépens. Vous prenez dans votre trésor les présents que vous faites au peuple, les aliments que vous lui donnez. Vous ne nourrissez point les enfants des Romains, comme les bêtes féroces nourrissent leurs petits, c'est-à-dire de sang et de carnage. Chacun reçoit avec d'autant plus de plaisir, qu'il sait qu'on ne lui donne point la dépouille d'un autre, et que, lorsque, tant de citoyens s'enrichissent, le prince seul en est plus pauvre et encore ne s'appauvrit-il pas car, tout ce qu'ont les autres est à lui, et il possède autant que tous les citoyens ensemble.
XXVIII. Tant d'autres actions glorieuses ne me permettent point de m'arreter .............................................. (44) . Mais ai-je assez admiré qu'en répandant ainsi des largesses, vous n'ayez
point eu à distraire l'indignation publique de quelque attentat dont vous vous sentiez coupable, ni à faire taire
des bruits sinistres et fâcheux, en tournant les discours
des citoyens sur un sujet plus gai? Point de faute, point
de trait de cruauté à racheter par vos présents (45) ? Point de
crime pour lequel vos bienfaits eussent à demander l'impunité : c'est l'amour des citoyens, et non leur indulgence, que vos libéralités ont eu pour objet et le peuple romain s'est retiré d'auprès de vous, d'autant plus
comblé de vos grâces, qu'elles ne lui coûtaient aucune
complaisance. Plein de joie et de sécurité, vous donniezà des gens qui n'étaient pas moins contents et moins tranquilles que vous et ce que les autres princes ne jetaient
au peuple indigné que pour modérer sa haine, vous l'avez offert avec des mains aussi pures que celles qui le
recevaient.
Le nombre de ces enfants, nés d'une honnête famille (46), et que le prince a cherchés, trouvés , admis à partager ses bienfaits, n'est guère au dessous de cinq mille. On les élève aux frais de l'état, pour être un jour une ressource dans la guerre, un ornement dans la paix, et pour leur apprendre à aimer leur patrie, non seulement à titre de citoyens, mais encore comme recevant d'elle la nourriture. Par eux nos tribus, par eux nos camps se rempliront, d'eux naîtront des fils à qui ce secours public ne sera plus nécessaire. Puissent les dieux, César, vous donner une aussi longue vie que vous le méritez ! Puissent-ils vous conserver cette grandeur d'âme qu'ils vous ont donnée! et nous verrons s'augmenter de jour en jour cette génération nouvelle qui a part à vos largesses. Car enfin la jeunesse romaine se multiplie visiblement tous les jours, non que les pères aiment mieux les enfants, mais parce que le prince aime mieux les citoyens. Vous ferez des libéralités, vous distribuerez des aliments, si vous le voulez : il sera toujours certain que c'est pour vous que naissent ces enfants.
XXIX. N'est-ce point une libéralité continuelle, que cette abondance extraordinaire dont vous nous faites jouir? Autrefois Pompée, pour l'avoir ramenée dans Rome, n'acquit pas moins de gloire que pour avoir aboli les brigues dans l'élection des magistrats, purgé les mers de pirates, triomphé de l'Orient et de l'Occident. Et il ne se montrait certainement pas meilleur citoyen (47) que le père de la patrie, qui aujourd'hui, par son ascendant, sa sagesse, sa vertu, sait si bien assurer les routes et ouvrir les ports, qui rend à la terre ses chemins, à la mer ses rivages, aux rivages leurs mers, et réunit si étroitement toutes les nations par le commerce, que les productions particulières de chaque pays semblent maintenant communes à toutes les contrées. Ne voyons nous pas que, sans rien ravir à personne, chaque année fournit abondamment à nos besoins ? Car nous n'avons plus de ces moissons qui, après avoir été arrachées à nos alliés comme à des ennemis, et malgré toutes leurs plaintes, étaient destinées à périr dans des greniers. Nos alliés s'empressent à nous apporter les productions de leur sol, de leur climat, les récoltes de leur année, et ils n'ont point à craindre que des subsides extraordinaires les empêchent d'acquitter les anciens. Le fisc achète tout ce qu'il paraît acheter. De là cette abondance de grains au prix convenu avec les vendeurs, dans les enchères publiques, de là des marchés qui regorgent sans que les provinces en soient affamées.
XXX. L'Egypte se vantait de ne point devoir la richesse de ses récoltes au ciel ni aux pluies, toujours baignée et fertilisée par les seules eaux de son fleuve, elle se couvrait de si abondantes moissons, qu'elle semblait pouvoir le disputer à jamais aux terres les plus fécondes. Une sécheresse imprévue la réduisit à une honteuse stérilité. Le Nil s'était lentement et faiblement débordé : il ressemblait encore aux plus grands fleuves mais ce n'était plus une mer, comme dans les autres années. Il arriva de là qu'une partie des contrées qu'il avait coutume d'inonder (48) se couvrit d'une épaisse et brûlante poussière. En vain l'Egypte, voyant que ce père de la fécondité avait mis à l'abondance des bornes aussi étroites qu'à son débordement, implora le ciel, et invoqua les nues. Car non seulement ce fleuve, qui aime tant à se répandre, ne s'était point élevé jusque sur les collines qu'il avait coutume d'abreuver mais il ne s'était pas même arrêté dans les endroits les plus bas : il s'en était brusquement retiré et ces terres, trop peu trempées, ne réussirent pas mieux que les plus sèches. Cette malheureuse province, privée de son inondation, c'est-à-dire de sa fécondité, vous adressa donc, César, les vœux qu'elle avait coutume d'adresser à son fleuve, et elle ne ressentit cette calamité que le temps qu'il fallait pour vous en instruire. Que les hommes de votre siècle éprouvent, quelques disgrâces, votre puissance agit si promptement, votre bonté est toujours si attentive et si prête, qu'il leur suffit, pour être secourus et soulagés, que vous connaissiez leurs besoins.
XXXI. Je souhaite à toutes les nations des années abondantes et des terres fertiles mais je ne puis m'empêcher de croire que la fortune, en désolant ainsi l'Egypte, a voulu éprouver jusqu'où s'étendaient votre pouvoir et votre vigilance. Car vous méritez que tout seconde vos désirs et, lorsqu'il arrive quelque événement contraire, n'est-il pas évident que c'est un champ ouvert à vos vertus, et une matière préparée à vos louanges, puisque, si la prospérité fait briller notre bonheur, l'adversité est l'épreuve de notre sagesse? On répétait depuis longtemps que Rome ne pouvait subsister sans le secours de l'Egypte. Cette nation vaine et superbe se glorifiait de nourrir ses vainqueurs, et de porter dans son fleuve et ses vaisseaux notre abondance ou notre famine (49). Nous avons rendu à l'Egypte ses richesses relie a repris les blés quelle nous avait envoyés, elle a remporté les moissons que nous avions reçues d'elle. Qu'elle apprenne, donc, et qu'elle reconnaisse, sur la foi de son expérience, que ce sont des tributs qu'elle nous paie, et non des aliments qu'elle nous donne, quelle sache qu'elle n'est point nécessaire au peuple romain, et cependant qu'elle lui reste soumise. Le Nil peut, s'il le veut, à l'avenir se renfermer dans son lit, et y demeurer comme les autres fleuves : qu'importe pour les Romains, et même pour l'Egypte! on verra seulement ses vaisseaux voguer vers l'Italie vides et tels qu'ils étaient naguère à leur retour, et la quitter pleins et chargés, tels qu'ils y abordaient autrefois. On se servira de la mer d'une manière différente : c'est de Rome en Egypte que nous demanderons des vents favorables et une prompte navigation. On devait regarder comme un prodige, César, que la paresse du Nil, que la stérilité de l'Egypte ne se fût pas fait sentir à Rome. Vous avez porté votre prévoyance et vos soins bien plus loin ; on ne s'en est pas ressenti même en Egypte, et vous avez ainsi fait voir que nous pouvions bien nous passer d'elle, et qu'elle ne pouvait se passer de nous. C'en était fait de cette province si féconde, si elle eût été libre. Honteuse d'une stérilité qui lui était inconnue, elle ne rougissait pas moins de sa famine qu'elle n'en était tourmentée (50). Vos généreux soins ont également servi ses besoins et sa pudeur. Les laboureurs ne pouvaient se lasser d'admirer leurs greniers remplis de blés qu'ils n'avaient point moissonnés, ni comprendre de quelle contrée de l'Egypte cette moisson avait été rapportée, et quel autre fleuve avait pu la produire (51), tant votre sagesse avait su corriger la malignité (52) de la terre, et contraindre le Nil de répondre à leur vœux (53) ! II s'est souvent débordé plus avantageusement pour les Égyptiens, mais du moins il n'a jamais coulé plus glorieusement pour nous.
XXXII. Peuples de la terre, reconnaissez maintenant votre bonheur, d'être soumis à l'empire romain. Nous avons un prince qui dispose de la fécondité, qui la porte à son gré où la conjoncture et le besoin la demandent, qui ne nourrit, ne protège pas avec moins de soin une nation séparée de nous par de vastes mers, que si elle faisait partie du peuple romain. Le ciel lui-même ne répand jamais ses faveurs si également, qu'il rende à la fois toutes les terres fertiles. Mais si notre empereur ne bannit pas la stérilité de toutes les régions du monde, du moins il en détourne les maux qu'elle traîne à sa suite, s'il ne donne pas à tous les pays la fertilité, du moins il leur en assure tous les avantages. Il sait si bien lier l'Orient à l'Occident par un échange de richesses (54), que les peuples, quels qu'ils soient, jouissent de tout ce que produisent les différents climats, et de tout ce qui peut flatter les désirs de l'homme : ils éprouvent combien il est plus avantageux d'obéir à un seul, que d'être esclaves d'une liberté qui les divise (55). Tant que les peuples jouissent isolément de leurs biens, ils sont seuls à supporter tout le poids de leurs maux. Dès qu'ils sont réunis, tous leurs biens, mêlés et confondus, sont à tout le monde, et les maux ne tombent sur personne. Toutefois, je conjure la divinité qui protège l'Egypte, ou le génie qui préside à ses eaux, de ne point abuser de la libéralité de notre prince, de recevoir favorablement dans leur sein les semences qu'on lui confie, et de nous payer notre secours avec usure. Non que nous exigions un dédommagement, mais nous espérons qu'ils penseront nous le devoir, et que moins nous réclamerons, plus ils se croiront obligés de faire oublier une année stérile par une longue suite d'années abondantes.
XXXIII. Après avoir ainsi pourvu aux besoins des citoyens et des alliés, vous n'avez pas négligé leurs plaisirs. Vous avez donné un spectacle, non pas de ceux qui peuvent nous amollir et nous efféminer, mais de ceux qui sont propres à nous enflammer le courage, à nous familiariser avec de nobles blessures, et à nous inspirer le mépris de la mort même. Vous nous avez montré l'amour de la gloire, et l'ardeur de vaincre, jusque dans l'âme des scélérats et des esclaves. Quelle magnificence, quelle justice n'avez-vous pas fait éclater en cette occasion! Toujours exempt de partialité, toujours maître de vos passions, vous avez accordé ce qu'on souhaitait, vous avez offert ce qu'on ne vous demandait pas ; vous avez même invité à le désirer. Un spectacle a été suivi d'un autre, et toujours dans le temps qu'on s'y attendait le moins. Jamais vit-on plus de liberté dans les applaudissements, plus de sûreté à se déclarer selon son inclination? Nous a-t-on fait un crime, comme sous d'autres empereurs, d'avoir pris un gladiateur en aversion? Quel qu'un des spectateurs a-t-il été donné lui-même en spectacle? et a-t-il été assez malheureux pour expier des plaisirs funestes par de cruels supplices? Qu 'il était insensé, et qu'il connaissait mal la véritable grandeur, ce tyran (56) qui venait recueillir dans le cirque des accusations de lèse-majesté! qui s'imaginait qu'on lui manquait de respect, si l'on n'avait pas de vénération pour de vils athlètes! parler contre eux, c'était blasphémer contre, et commettre un sacrilège! il se plaçait au rang des dieux, et mettait les gladiateurs au même rang que lui !
XXXIV. Mais vous César, vous nous avez donné un autre genre de spectacle, aussi beau que ceux-là étaient exécrables. Nous avons vu la troupe des délateurs exposée à nos yeux comme une troupe de voleurs et d'assassins. Ce n'est point dans des lieux écartés, et sur les grands chemins, qu'ils avaient tendu leurs pièges, ils s'étaient répandus dans les tribunaux et jusque dans les temples. Aucun testament n'était sûr, aucune situation ne mettait à l'abri de leurs manœuvres : ceux qui avaient des enfants, et ceux qui n'en avaient pas, couraient un égal danger. Avec l'avarice des princes, ce fléau s'était accru. Il a frappé vos regards et, comme naguère vous aviez rétabli le calme parmi les troupes mutinées, vous avez su rappeler la paix dans le forum. Vous avez coupé la racine de ce mal intestin et, par une sage sévérité, vous avez empêché que Rome ne dût sa ruine aux lois qui doivent la conserver.
Ainsi, quoique votre fortune, de concert avec votre magnificence, nous ait fait voir, tantôt ce que peuvent la force et le courage des hommes, tantôt ce que les bêtes féroces ont de plus cruel et de plus monstrueux, souvent jusqu'où peut aller l'art de les apprivoiser, et qu'enfin vous nous ayez rendu communes ces richesses immenses que vos prédécesseurs renfermaient et nous cachaient avec tant de soin, vous ne nous avez offert rien de plus agréable, rien de plus digne de votre siècle, que le spectacle de ces délateurs, forcés de se montrer à découvert et la tête renversée. Nous prenions plaisir à les reconnaître et à jouir de leur douleur, lorsqu'en les faisant marcher sur le sang des criminels, comme des victimes justement destinées à expier les alarmes et les calamités publiques, on les traînait à des supplices plus lents et plus cruels que la mort. On les a jetés sur les premiers vaisseaux que le hasard a présentés, et on les a livrés à la merci des tempêtes. C'est ainsi, qu'on leur a permis de quitter et de fuir des terres qu'ils avaient désolées. On a voulu que si les vents et les flots en poussaient quelqu'un sur des rochers ou sur des côtes inhabitées, il languît sur ces écueils déserts et ces rivages affreux, qu'il y traînât une vie malheureuse et agitée, tourmentée du repos dont il laissait jouir toute la terre.
XXXV. Spectacle mémorable ! Une flotte chargée de délateurs, est livrée aux fureurs des vents ! Elle est forcée de déployer ses voiles aux tempêtes, et de suivre les flots irrités sur tous les rochers où ils la jetteront! Quel plaisir de regarder du port ces infâmes vaisseaux dispersés d'abord en le quittant ! et, à la vue de la mer même (57) de rendre grâces au prince qui, sans compromettre sa clémence, avait confié la vengeance des hommes aux dieux de la mer! C'est alors que l'on connut parfaitement ce que peut la différence des temps. Les scélérats languissent sur ces mêmes rochers, où tant de gens de bien avaient langui autrefois et ces funestes îles qui n'avaient jamais été peuplées que délateurs injustement bannis, ne sont plus remplies que de délateurs (58). Mais vous ne vous êtes pas contenté d'en purger vôtre siècle, vous en avez encore affranchi tous les siècles à venir, par la variété des peines dont vous les avez enveloppés. Ils voulaient dépouiller les autres de leurs biens, qu'ils soient dépouillés des leurs. Ils prenaient plaisir à les faire périr dans l'exil, qu'ils y périssent eux-mêmes. Qu'ils n'en soient pas quittes, comme auparavant, pour présenter leur visage impudent (59), leur front d'airain, au fer rouge dont on les marquait en vain, et dont ils bravaient l'outrage mais qu'ils apprennent à craindre des peines proportionnées aux récompenses qu'ils attendent (60), que leur crainte égale leurs espérances, et qu'ils ressentent autant de frayeur qu'ils en causaient.
Titus, sans doute, avait pourvu avec beaucoup de courage à votre sûreté et à notre vengeance et ce bienfait lui avait mérité une place entre les dieux mais combien méritez-vous -mieux cet honneur, vous qui avez ajouté de nouvelles faveurs à celles qui lui ont fait élever des autels? Quelle difficulté surtout n'y deviez-vous pas trouver, après que Nerva, si digne d'avoir un fils et un successeur tel que vous, eut ajouté à l'édit de Titus tant d'articles importants ! On eût dit qu'il ne laissait rien à faire à ceux qui le suivaient ; cependant vous avez si utilement étendu son édit, qu'il semble qu'on n'avait fait aucune loi sur ce sujet avant vous (61). Aurait-on pu vous, remercier assez, quand vous auriez répandu sur nous chacune de ces grâces en différents temps ? Et vous nous les avez prodiguées toutes à la fois ! semblable au soleil (62), qui ne communique point seulement une portion de sa lumière, et qui ne la fait point briller seulement pour quelques hommes, mais qui la donne à tous et tout entière au même instant.
XXXVI. Qu'il est agréable de voir le trésor public tranquille, sans procès, et tel qu'il était avant les délateurs ! C'est maintenant que je reconnais pour un temple le lieu où on le garde. Je retrouve le dieu qu'on y adore (63). Ce n'est plus cet infâme réceptacle, des dépouilles sanglantes de nos citoyens. Il est encore un endroit sur la terre, où, sous un bon prince, ceux qui croient défendre légitimement le trésor, trouvent moins de faveur que ceux mêmes qui méconnaissent ses droits. Les lois cependant demeurent dans toute leur force ; l'utilité publique ne reçoit aucune atteinte, le crime n'est point impuni mais la calomnie n'est plus en sûreté. Une seule chose a été changée : on craignait les délateurs, on ne craindra plus que les lois.
Mais peut-être protégez-vous plus votre trésor, particulier que le trésor public. Au contraire, vous le favorisez d'autant moins, que vous croyez avoir plus de droit sur votre bien que sur celui de la république. On peut appeler en justice l'agent de vos affaires, et même l'intendant-général, de votre maison. Car vous avez voulu qu 'il y eût un tribunal où l'on pût plaider les affaires qui concernent le prince, et ce tribunal n'est différent des autres que par la majesté de celui contre qui l'on plaide. Le sort donne des juges au fisc comme au particulier. Il est permis de les récuser, on peut s'écrier qu'on ne veut point de celui-là, parce qu'il est timide, et qu'il ne connaît pas assez le bonheur de son siècle : on peut dire que l'on veut bien de celui-ci, parce qu'il aime noblement César. La puissance et la liberté sont assujetties aux mêmes lois et, ce qu'on ne peut trop louer en vous, le fisc est le plus souvent condamné, le fisc, dont la cause n'est jamais mauvaise que sous un bon prince. C'est sans doute une insigne faveur que vous nous faites mais une autre bien plus grande, c'est que vous choisissez si bien vos intendants, que la plupart de vos citoyens ne veulent point d'autres juges. Chacun a pourtant la liberté de ne les point choisir. En nous les donnant, votre faveur ne nous impose pas la loi de les accepter. Vous savez que ce qui met le comble aux bienfaits du prince, c'est la liberté de n'en point user.
XXXVIL Les besoins de l'empire avaient forcé d'établir plusieurs impôts utiles au public, mais très onéreux aux particuliers. Celui du vingtième des successions (64), qui était une charge légère et facile pour des héritiers étrangers, en était une très pesante pour les héritiers du sang. On l'a donc laissé subsister pour les uns, on l'a aboli pour les autres. Il était aisé de s'imaginer que les hommes ne consentiraient qu'avec une peine extrême, ou plutôt qu'ils ne consentiraient point qu'on leur enlevât quelque partie d'un bien que le sang, la naissance, la famille semblaient leur assurer ; d'un bien qui ne leur a jamais paru étranger et incertain, mais qu'ils ont regardé de tout temps comme un bien propre et toujours possédé, et destiné à passer, après eux, à leurs héritiers naturels. On admettait cette distinction en faveur de ceux qui jouissaient pleinement du droit des citoyens romains mais l'exception ne s'étendait point à ceux qui étaient devenus citoyens par une loi particulière (65) ou par une grâce du prince : ils étaient traités comme étrangers, par rapport même à leurs plus proches et à leurs plus intimes parais, s'ils n'avaient en même temps obtenu le privilège qu'on appelait le droit de famille.
Ainsi un bienfait éclatant devenait une cruelle rigueur (66) et l'honneur d'être citoyen romain les mettait au même état que s'ils eussent été divisés, qu'ils se fussent haïs, ou qu'ils n'eussent point eu d'enfants puisque, sans diminuer leur tendresse, il semblait leur en arracher, les plus précieux gages. Cependant on en trouvait plusieurs parmi eux qui étaient si épris du nom romain, qu'ils croyaient ne le point payer trop du vingtième des successions qui pouvaient leur échoir, et même de la perte de toutes leurs alliances. Mais plus ils estimaient un tel privilège, plus ils méritaient d'en jouir gratuitement. Votre auguste père ordonna donc que, lorsque les enfants succéderaient à leurs mères, et les mères à leurs enfants, ils ne paieraient aucun vingtième, quoique, avec le nom de citoyen romain, ils n'eussent pas reçu le droit de famille. Il fit la même ordonnance pour les fils qui succéderaient à leurs pères, pourvu qu'ils fussent sous la puissance paternelle. Il crut qu'il y aurait de l'abus, de la barbarie, et même une espèce d'impiété, de mêler le nom du publicain avec de tels noms. Il jugea qu'on ne pouvait, sans crime, rompre les nœuds sacrés qui unissent le père au fils, en mettant en quelque sorte entre eux le droit du fisc et qu'en un mot il n'y avait point d'impôt assez utile à l'état, pour mériter qu'on rendît les pères étrangers à leurs enfants, et les enfants à leurs pères.
XXXVIII. Nerva, par cet édit, fit peut-être moins qu'on ne devait attendre d'un si bon prince mais il ne fit pas moins qu'il ne convenait à un si bon père. Près d'adopter le citoyen le plus vertueux de la république, ne devait-il pas à sa tendresse paternelle d'essayer seulement, ou plutôt d'indiquer à son fils certaines améliorations,en lui laissant abondamment et presque sans partage la gloire de ces nouveaux bienfaits ? Votre libéralité a donc aussitôt après ajouté à la grâce qu'il nous avait faite, la même immunité pour le père qui succédait à son fils, que celle qui avait été accordée au fils qui succédait à son père : vous n'avez pas voulu que le père, au moment qu'il cesse de l'être, perdît jusqu'à l'avantage de l'avoir été. Il était digne de vous, César, de ne pas souffrir que l'on mît un impôt sur les larmes des pères. Qu'ils possèdent sans restriction tous les biens de leurs enfants et, puisqu'ils supportent seuls la douleur de la perte, qu'ils soient seuls appelés à l'héritage de la fortune, qu'on ne les oblige pas, à l'instant même qu'ils sont frappés d'un coup si cruel, d'en venir au calcul d'un partage, et de savoir tout ce que leurs fils ont laissé.
C'est ajouter un nouveau prix au bienfait du prince, pères conscrits, que de montrer combien la raison y a eu de part : sans elle, je ne vois plus qu'ambition, vanité, prodigalité, et toute autre chose plutôt qu'un bienfait. Il convenait donc à. votre humanité de soulager les chagrins d'un père, et de ne pas permettre qu'à la douleur de n'avoir plus de fils, on en ajoutât une nouvelle. C'est bien un assez grand malheur pour un père, que d'être le seul héritier de son fils. Que serait-ce d'avoir un cohéritier que son fils ne lui a point donné ? D 'ailleurs, après que Nerva avait, en faveur des enfants, affranchi de l'impôt du vingtième la succession des pères, il était raisonnable qu'en faveur des pères on en affranchît aussi la succession des enfants. Car pourquoi marquer plus d'égard pour les descendants que pour leurs ancêtres ? et pourquoi ne pas faire remonter jusqu'aux uns la justice qu'on faisait aux autres? Vous avez retranché, César, cette exception qui limitait l'immunité accordée aux pères héritiers de leurs enfants, au seul cas où le fils se trouverait avoir été sous la puissance paternelle quand il est mort. Vous avez, si je ne me trompe, considéré que la loi de la nature tenait les enfants dans une perpétuelle dépendance de leurs pères, et qu'elle n'avait point entre les hommes, comme entre les bêtes, donné l'empire aux plus forts.
XXXIX. C'était peu pour vous d'avoir exempté de l'impôt ce premier degré de parenté, vous avez accordé le même privilège au second. Vous avez voulu que le frère recueillît la succession entière de sa sœur, et la sœur la succession de son frère, le petit-fils ou la petite-fille, les biens de son aïeul ou de son aïeule, et l'aïeul ou l'aïeule, ceux de leur petit-fils ou de leur petite-fille. Vous avez fait la même grâce à ceux qui n'avaient qu'imparfaitement le droit de citoyen romain : vous leur avez, à tous ensemble, à tous également, conservé les avantages qu'ils tenaient de la nature, et que les précédents empereurs se faisaient demander, bien moins pour avoir le plaisir de les accorder que pour les refuser. Il est aisé de comprendre combien il y a de grandeur et de bonté à rassembler ainsi, à réunir, à ressusciter en quelque sorte ces parentés brisées, et pour ainsi dire mutilées (67). Quelle magnificence, d'offrir ce que les autres princes refusaient ! d'accorder à tous ce que naguère pas un n'obtenait ! enfin de s'ôter ainsi à soi-même tant d'occasions de paraître généreux, et de se faire des droits à la reconnaissance ! Le prince a cru sans doute qu'il y avait de l'indignité à vouloir que l'on tînt d'un homme ce qu'on ne doit tenir que des dieux. Vous êtes frère et sœur, aïeul et petits-fils, pourquoi donc demander à l'être (68) vo us l'êtes par vous-mêmes. La modération naturelle de Trajan l'a porté à croire qu'il n'était pas moins odieux de donner la succession d'autrui que de l'ôter. Que personne ne craigne donc plus d'entrer dans la magistrature, ou de devenir citoyen romain. Cet honneur ne retranchera plus du corps de leur famille ceux qui l'auront obtenu. Ils pourront acquérir un nouvel éclat, sans perdre rien des droits que le sang leur donne.
XL. Enfin, le parent le plus éloigné, et dans le degré même ou l'alliance commence à s'éteindre, participe à cette immunité car on ne peut l'assujettir au vingtième, si la succession qu'il a recueillie n'excède une certaine somme marquée par ledit de l'empereur. La succession peu considérable en est affranchie, l'héritier pourra, s'il le veut, dans sa reconnaissance, employer tous les biens dont il hérite, aux obsèques ou au tombeau de son bienfaiteur, il n'aura ni réformateur ni surveillant. Que l'on jouisse désormais, sans crainte et sans péril, du modeste héritage auquel on est appelé (69) . L'impôt se lève aujourd'hui à de telles conditions qu'il ne menace que la seule opulence. La dureté de la loi se change en faveur. On souhaite ce qu'on craignait : il n'y a plus d'héritier qui désire être sujet au paiement du vingtième. La prévoyance a été portée encore plus loin ; les héritiers qui devaient l'impôt avant la publication de l'édit, mais qui ne l'avaient pas encore payé, ne paieront rien. Le S dieux, tout puissants qu'ils sont, ne peuvent rien sur le passé ; vous, vous avez su le corriger, en remettant le vingtième à ceux qui ne l'auraient pas dû, s'ils n'eussent hérité que depuis votre édit. Vous nous avez mis en quelque sorte au même état que si nous n'avions pas eu de mauvais prince (70). Avec de tels sentiments, si la nature l'eût permis, n'eussiez-vous pas rendu et la vie et les biens à tant d'hommes proscrits injustement, vous qui avez défendu d'exiger rien de ce qui se trouverait dû avant votre avènement à l'empire ? Un autre aurait fait un crime de ce retardement, et l'aurait puni de la peine du double ou du quadruple : mais vous, vous croyez qu'on n'est pas moins blâmable à exiger le paiement d'un impôt injustement établi, qu'à établir l'impôt lui-même.
XLI. Vous porterez, César, tout le poids du consulat : car lorsque je songe à tant de contributions abolies, aux gratifications que les soldats ont reçues, aux largesses prodiguées au peuple, au bannissement des délateurs, à la diminution des subsides, il me semble qu'il faudrait vous demander (71), si vous avez bien calculé les revenus de l'empire, et si la frugalité du prince peut seule balancer tant de dépenses et de libéralités. Comment se fait-il que d'autres princes, lorsque rien n'échappait à leurs rapines, et que rien de ce qu'ils avaient ravi ne sortait de leurs mains, aient cependant manqué de tout, comme s'il n'eussent dépouillé personne et que vous, qui n'ôtez rien à personne, et qui répandez à pleines mains sur tout le monde, vous ayez tant de superflu? Les princes n'ont jamais manqué de gens qui soutinssent les droits du fisc avec hauteur et avec dureté mais, quoique ces princes fussent d'eux-mêmes assez avides pour se passer de maîtres qui les éclairassent sur leurs intérêts, il est pourtant vrai que nous leur en avons servi, et qu'ils tiennent de nous-mêmes la plupart des connaissances dont ils ont abusé contre nous. Pour vous, inaccessible à toute sorte d'adulation, votre oreille est fermée surtout aux conseils de l'avarice. Ces flatteurs cupides se taisent et demeurent en repos ou plutôt, il n'y a plus de flatteurs depuis qu'il n'y a plus de prince qui les écoute. Vous voyez donc que, si nous vous devons beaucoup pour la pureté de vos mœurs, nous vous devons encore plus pour l'innocence des nôtres.
XLII. Les lois Voconia et Julia (72) enrichissaient moins le fisc et le trésor public que l'accusation de lèse-majesté, le seul crime de tous ceux à qui on ne pouvait en reprocher aucun. C'est une crainte dont vous nous avez délivrés, content d'une grandeur qui ne fut jamais moins connue que des princes gardiens si rigides de leur dignité. Vous avez rendu aux amis leur fidélité, aux enfants leur tendresse, aux esclaves leur soumission. Les amis respectent l'amitié, les enfants obéissent, les esclaves sentent qu'ils ont des maîtres. Car aujourd'hui, c'est nous que le prince honore de sa bienveillance, et non pas nos esclaves. Le père de la patrie ne s'imagine point trouver plus de dévouement dans un esclave étranger que dans un citoyen. Personne n'a plus à craindre un calomniateur domestique et, en mettant le sceau à une loi si salutaire, vous nous avez en quelque sorte épargné les maux d'une nouvelle, guerre contre nos esclaves. C'est un bienfait pour eux comme pour nous car si vous assurez notre repos, vous ajoutez à leur fidélité. Vous ne voulez pas qu'on vous en loue mais quand il faudrait supprimer l'éloge, n'est-il pas doux de rappeler ce souvenir, après avoir vécu sous ce prince qui subornait lui-même les esclaves, qui leur suggérait les crimes qu'ils devaient imputer à leurs maîtres, et qu'il voulait faire servir de prétexte à ses cruautés? sort affreux et inévitable pour quiconque avait des esclaves semblables au prince!
XLIII. Il faut compter entre tant de bienfaits, que nos testaments sont affranchis de toute crainte : on ne voit plus l'empereur toujours seul héritier de tout le monde, tantôt pour avoir été désigné, tantôt pour ne l'avoir pas été (73) : vous n'êtes pas appelé à des successions par des testaments ou faux ou injustes. Vous ne voyez point tourner à votre profit le ressentiment, le mauvais naturel, l'emportement d'un testateur. Si quelqu'un vous nomme son héritier, ce n'est point par haine pour un autre, mais par amour pour vous. Ceux que vous honorez de votre bienveillance, se souviennent de vous dans leurs testaments ceux que vous ne connaissez pas, vous oublient et toute la différence qui se trouve entre ce que vous étiez et ce que vous êtes, c'est qu'aujourd'hui un plus grand nombre de personnes vous aiment, parce que vous en aimez vous-même un plus grand nombre.
Continuez à suivre cette route, César et vous éprouverez qu'il est plus avantageux et plus sûr, je ne dis pas seulement pour la réputation, mais aussi pour l'intérêt du prince, de faire souhaiter aux citoyens de l'avoir pour héritier, que de les y forcer. Votre auguste père, et vous-même, vous avez répandu une infinité de bienfaits. Quoique plus d'un ingrat vous ait oublié en mourant, les héritiers de cet ingrat jouissent pourtant de ses biens sans inquiétude, et il ne vous en revient que de la gloire car, si la reconnaissance rend la générosité plus douce, l'ingratitude la rend plus honorable. Mais quel prince, avant vous, s'est avisé de préférer cette gloire aux richesses? Qui d'entre eux n'a pas toujours continué de compter entre ses biens ceux qu'il nous avait donnés? ou plutôt les présents de nos Césars, comme ceux des rois, ne ressemblaient-ils pas à des hameçons, à des filets cachés sous un appât trompeur, puisqu'ils s'attachaient et s'enlaçaient en quelque sorte aux richesses des particuliers qui les recevaient, et tiraient à eux tout ce qu'ils avaient touché ?
XLIV. Oh! qu'il est avantageux de n'arriver à la prospérité qu'à travers les disgrâces ! Vous avez vécu au milieu de nous ; vous avez ressenti mêmes alarmes ; vous avez couru mêmes dangers : c'était alors le sort commun de tous les gens de bien. Vous savez par expérience combien les mauvais princes sont en horreur à ceux-mêmes qui les rendent mauvais. Vous n'avez pas oublié ce que vous désiriez, ce que vous détestiez avec nous. Vous êtes empereur, comme vous jugiez qu'il le fallait être, quand vous n'étiez que simple particulier. Que dis-je ? vous portez vos vertus plus loin que vous ne souhaitiez qu'un autre les portât. Quel heureux changement ! Autrefois le comble de nos vœux était d'avoir un prince qui valût mieux que le plus méchant et nous voilà réduits à n'en pouvoir plus souffrir à l'avenir, s'il n'est le plus vertueux de tous les hommes. Il n'y aura donc plus personne qui vous connaisse, et qui se connaisse lui-même assez mal pour désirer la place que vous occupez. Il sera plus aisé de trouver un homme qui vous succède, qu'un homme qui souhaite de vous succéder. Qui se chargerait volontiers de tous les soins qui vous occupent? qui ne tremblerait d'entrer en comparaison avec vous? Vous avez vous-même éprouvé combien est pesante la succession d'un bon prince, et ce fut votre excuse, quand Nerva voulut vous adopter? (74). Est-il donc facile d'imiter un prince sous lequel personne n'achète sa sûreté au prix de son honneur? On peut maintenant vivre avec dignité, et vivre sans péril. Là prudence n'oblige plus lé sage à se tenir dans l'ombre : la vertu peut se promettre aujourd'hui les mêmes avantages dont elle jouissait dans le temps ou régnait la liberté et les bonnes actions ont d'autres récompenses que le secret témoignage de la conscience. Vous aimez la fermeté dans les citoyens et, loin de chercher, Comme d'autres princes, à abaisser, à détruire la noble fierté des sentiments, vous vous plaisez à l'entretenir et à l'élever. C'était beaucoup que la probité ne fût point funeste : elle est maintenant utile. C'est elle que vous honorez des emplois, des sacerdoces, des gouvernements ; elle prospère aujourd'hui, soutenue de votre amitié et de votre estime. Le prix proposé aux talents et aux vertus stimule les bons et attire les médians : car les hommes sont bons ou méchants, suivant qu'ils voient récompenser la vertu ou le vice. Bien peu ont un naturel assez heureux pour ne pas faire dépendre de leur intérêt leur ardeur pour la gloire et leur horreur pour l'infamie. La plupart, lorsqu'ils voient donner à l'oisiveté, à la mollesse, à la débauche les prix du travail, de la vigilance, de la modération, ne songent à les obtenir que par les mêmes voies qui ont réussi aux autres : ils s'efforcent de paraître semblables à ceux dont ils envient la fortune et, à force de leur vouloir ressembler, ils leur ressemblent.
 |
 |
 |
 |
 |
|---|
XLV. Vos prédécesseurs, si l'on en excepte votre auguste père, et peut-être un ou deux avec lui (et c'est en dire trop), aimaient bien plus les vices que les vertus des citoyens. Chacun se plaît naturellement à se retrouver dans les autres et ils étaient d'ailleurs persuadés qu'avec des inclinations serviles, on souffre plus patiemment l'esclavage. Ils prodiguaient tout aux hommes de ce caractère : les bons, ils les ensevelissaient dans l'ombre et l'indifférence, et ne permettaient qu'aux délations et aux dangers de les mettre en lumière. Vous, prince, c'est parmi les hommes les plus vertueux que vous choisissez vos amis et en vérité il est bien juste qu'ils soient aimés d'un bon prince, après avoir été persécutés par un mauvais. Sachant combien diffèrent de nature la tyrannie et l'autorité légitime, vous comprenez qu'un prince ne saurait avoir de sujets plus dévoués que les plus irréconciliables ennemis des tyrans. Ce sont donc les personnes de ce caractère que vous avancez, que vous élevez, pour servir de modèles, et pour apprendre à tout le monde quelle conduite vous vous proposez, quel genre d'hommes est selon votre cœur. C'est par cette, raison que vous n'avez jamais voulu exercer la censure, ni être chargé de l'inspection des mœurs, Vous aimez mieux éprouver sur nous le pouvoir des bienfaits, que celui des leçons. Et d'ailleurs je ne sais si le prince ne fait pas plus pour les mœurs en nous laissant la liberté d'être hommes de bien, qu'en nous obligeant à l'être. Souples sous sa main, il nous plie selon son gré au vice ou à la vertu, et nous prenons, pour ainsi dire, la forme qui lui plaît. On veut être aimé du maître, on veut avoir son estime, et on l'espérerait en vain, si on ne lui ressemblait pas. Enfin, tel est l'effet de cette constante, déférence, que les mœurs d'un seul homme forment les mœurs publiques? (75). Heureusement que la nature ne nous a pas assez maltraités, pour que nous ne puissions imiter un bon prince, comme nous pourrions en imiter un mauvais. Continuez donc, César, et vos principes, vos actions auront l'influence et l'effet de la censure. En effet, la vie du prince est une censure, et une censure perpétuelle : elle nous guide, elle nous dirige, et nous avons moins besoin de commandements que d'exemples. La crainte enseigne mal à bien vivre. Les exemples ont plus d'autorité : ils ont surtout cet avantage, de prouver qu'ils ne conseillent rien qui ne soit possible.
XLVI. Quelle crainte en effet aurait pu faire ce qu'a fait la seule vénération qu'on a pour vous ? Un de vos prédécesseurs a obtenu des Romains qu'ils laissassent abolir le spectacle des pantomimes (76) mais il n'a pu obtenir que les Romains le désirassent. Pour vous, on vous a supplié de faire ce qu'un autre prince forçait de souffrir. On a reçu, de vous comme un bienfait, ce qu'on avait toléré comme une nécessité. On vous a demandé de bannir du théâtre ces hommes dissolus, aussi unanimement qu'on avait supplié votre auguste père de les rétablir. Vœux également louables : il fallait rappeler les pantomimes qu'un mauvais prince avait bannis, et les chasser après les avoir rappelés car lorsqu'un scélérat agit bien, c'est toujours une sage précaution que de faire sentir que l'on condamne l'auteur, quoique l'action soit approuvée. On a donc vu ce même peuple qui avait autrefois applaudi à un empereur comédien, détester jusque dans le pantomime cet art honteux et ces talents indignes de notre siècle. Il est donc prouvé que le caractère du prince règle les mœurs même du vulgaire, puisqu'il peut s'élever jusqu'à la plus austère vertu, si le prince s'y élève le premier. Jouissez, César, de la gloire d'une telle sagesse, qui nous fait donner aujourd'hui le nom de mœurs à ce qu'on appelait autrefois abus de pouvoir et violence. Ceux qui avaient besoin qu'on réprimât leurs désordres ont été leurs propres censeurs : ceux qu'il fallait réformer se sont réformés eux-mêmes. Aussi personne ne murmure-t-il contre votre sévérité, quoiqu'on soit libre de murmurer mais tel sont les hommes, ils ne se plaignent jamais moins d'un prince, que lorsque la plainte est le plus permise, et sous vos lois, d'ailleurs, tous les hommes sont également contents. Les bons sont comblés d'honneurs, et, ce qui est le gage de la tranquillité d'un état, les médians ne craignent, ni ne sont craints. Vous remédiez aux abus mais l'auteur même du mal en implore la réforme et ceux que vous ramenez au bien vous ont encore cette obligation, que vous ne semblez pas les avoir forcés.
XLVII Et la conduite, les mœurs de la jeunesse, avec quel soin digne d'un prince vous vous appliquez à les former ! que de considération pour les rhéteurs ! que d'estime vous témoignez aux philosophes ! Comme elles ont retrouvé sous votre empire et la vie, et la force, et une patrie, ces nobles études que la barbarie des derniers temps punissait de l'exil, alors qu'un prince, auquel sa conscience reprochait tous les vices, bannissait par pudeur autant que par haine les sciences, ennemies de la corruption ! Mais vous, prince, vous les accueillez dans votre sein, vous vous plaisez à les entendre car elles ne prescrivent pas de devoir que vous ne remplissiez, et vous les aimez autant qu'elles vous honorent. Est-il un homme ami des lettres qui ne loue surtout, parmi tant de vertus, votre soin de vous rendre accessible tous? Il y eut sans doute de la grandeur à faire graver, comme le fit votre père, sur ce palais qui avant vous et lui n'était qu'une forteresse impénétrable, ce titre nouveau d'édifice public mais ce n'eût été qu'une vaine inscription, s'il n'eût adopté un successeur qui puisse y habiter comme en public. Que cette inscription est bien d'accord avec vos mœurs ! À voir ce que vous faites, on dirait que pas autre que vous ne la fit graver ? Car est-il un forum, un temple plus ouvert au peuple? Plus que le Capitole, plus que cette enceinte même où fut consacrée votre adoption, votre palais est public et commun à tous les citoyens. Point de barrières à franchir, point d'affronts successifs à essuyer : on ne trouve plus, après avoir passé cent portes, des difficultés nouvelles, des obstacles toujours renaissants. Tout est calme et pour ceux qui viennent à vous et pour ceux qui vous quittent, mais surtout pour ceux qui sont près de vous. Il règne partout un si profond silence, tant de décence et de réserve, que du palais on rapporte dans sa modeste demeure, sous son humble toit, des exemples d'ordre et de tranquillité.
XLVIII Vous-même, avec quelle honte ne recevez-vous pas, n'attendez-vous pas tout le monde! Peut-on comprendre que, chargé de tous les soins de l'empire, vous ayez tant de temps à nous donner? Aussi nous ne nous présentons plus au prince, comme autrefois, la frayeur, peinte sur le visage, et craignant que le moindre retard né soit puni du dernier supplice : nous paraissons devant lui quand il nous plaît, et toujours avec joie et confiance. Nous pouvons nous en dispenser, si nous croyons être retenus par quelque affaire plus pressante. Vous prévenez toujours nos excuses, et vous nous épargnez le soin d'en chercher car vous êtes bien persuadé que personne ne se refusé volontairement la satisfaction de vous voir et c'est aussi ce qui vous fait accorder ce plaisir avec plus de complaisance et de libéralité. Après vous avoir rendu nos premiers respects, on ne nous voit point pressés de fuir et de vous laisser à votre solitude : nous demeurons, nous nous arrêtons, comme sous un toit commun à tous les citoyens, dans, ce même palais que la terreur environnait naguère, lorsque ce monstre cruel s'y enfermait, comme, dans son antre, pour se désaltérer du sang de ses proches, où qu'il s'élançait de sa retraite pour se rassasier du carnage des plus illustres citoyens. L'horreur et la menace en gardaient les portes, et l'on tremblait également d'être admis et d'être exclus. Sa rencontre seule et sa vue inspiraient l'effroi : l'orgueil éclatait sur son front et la fureur dans ses yeux, une pâleur efféminée était répandue sur son corps et son impudence se déguisait sous la rougeur de son front (77). Personne n'osait l'approcher ni lui adresser la parole. Toujours renfermé dans les ténèbres d'un mystérieux asile, il ne sortait de sa solitude que pour désoler Rome.
XLIX. Cependant, dans ces mêmes murs qui lui semblaient assurer son salut, il enferma avec lui la ruse, les embûches et le dieu vengeur des crimes. Le châtiment a su écarter ou forcer les gardes, et à travers tant d'obstacles et de détours, il a pénétré avec autant de facilité, que si toutes les avenues eussent été libres et toutes les portes ouvertes. A quoi lui servirent alors et sa divinité et ces réduits secrets, ces cruelles retraites, où le précipitaient la crainte et la haine des hommes ? Oh ! combien trouve-t-on plus de sûreté dans ce palais, aujourd'hui qu'il est protégé, non plus par la terreur, mais par l'amour des sujets, non plus par des barrières et par sa propre solitude, mais par la foule des citoyens ! L'expérience nous apprend donc que la plus fidèle garde du prince, c'est l'innocence de sa vie. Une citadelle, un retranchement qui ne se force jamais, c'est de n'en avoir aucun besoin. En vain celui qui ne veut pas se faire aimer, se fera craindre, les armes dont il menace invitent à s'en servir contre lui. Vous voit-on ne passer avec nous et sous nos yeux que le temps des affair Ne sommes-nous pas au milieu de vos divertissements? ne les partageons-nous pas ? ne mangez-vous pas en public et avec nous ? n'y trouvons-nous pas le même plaisir que vous? n'aimez-vous pas à nous adresser la parole et à nous répondre ? Et lorsque votre frugalité voudrait vous faire abréger le repas, votre bonté pour nous ne vous oblige-t-elle pas à le prolonger? car vous ne venez point, après avoir mangé en particulier, vous présenter à votre table, en homme qui ne s'y propose que de regarder et de censurer les convives. On ne vous voit point, après avoir pris la précaution de vous rassasier en secret, jeter plutôt qu'offrir, à des gens à jeun, des mets auxquels vous dédaignez vous-même de toucher, et fatigué de la durée d'un repas où l'orgueil fait jouer un personnage si contraint, courir en nous quittant vous replonger dans la crapule d'une débauche clandestine. Aussi ce n'est ni la magnificence de votre vaisselle, ni l'ordonnance de vos festins que nous admirons, mais la douceur et les charmes d'une aimable conversation, qui ne lasse jamais, parce que tout y est naturel et vrai, et que la solidité s'y unit à l'agrément. Nous ne sommes plus au temps où les mystères d'une superstition étrangère (78) e t une licence indécente obsédaient la table du prince. D'aimables provocations, une gaîté décente, d'instructives discussions en ont pris la place. Aussi votre sommeil est-il court, et vous donnez le moins de temps qu'il vous est possible à tout ce qui vous tient éloigné de nous.
L. Mais pendant que vous nous faites tant de parts de vos biens, avec quelle liberté nous laissez-vous jouir des nôtres ! Vous ne chassez pas de leurs héritages les anciens possesseurs, pour enfermer dans vos immenses domaines les étangs, les lacs et même les forêts entières : les fontaines, les rivières et les mers ne sont plus réservées pour être le spectacle d'un seul homme. César voit des biens qui ne sont pas à lui et ses propriétés sont aujourd'hui moins étendues que son empire. Il emploie aux besoins de l'état une partie de ses richesses particulières, que ses prédécesseurs ne gardaient que pour empêcher les autres d'en jouir? Aujourd'hui ce sont des grands qui habitent les maisons des grands : la demeure des plus illustres citoyens n'est plus abandonnée à un vil esclave, ou prête à tomber en ruines par un honteux délaissement. Nous pouvons contempler de magnifiques bâtiments, restaurés et embellis par vos ordres. C'est un grand service rendu aux hommes et aux édifices mêmes, que de conserver et de peupler ces nobles habitations, de préserver de la destruction ces grands monuments, en ressuscitant les intentions qui les firent élever. Tout muets, tout insensibles qu'ils sont, ils paraissent sentir leur état, et se réjouir d'être entretenus avec soin, d'être habités, enfin d'appartenir à un maître qui les connaît (79). On a publié au nom de César une longue liste des objets qu'il expose en vente et on ne peut y jeter les yeux, sans détester l'avarice du malheureux qui, au milieu de tant de biens superflus, ne cessait point d'en désirer de nouveaux. C'était alors un crime capital d'avoir une maison commode ou une terre agréable. Aujourd'hui, Trajan cherche des maîtres a ces mêmes maisons : il les met lui-même en possession. Ces jardins d'un grand empereur, qui n'ont été depuis possédés que par les Césars, nous les disputons à l'enchère, nous les achetons, nous les habitons. Telle est la bonté du prince et le bonheur des temps, que Trajan nous croit dignes de posséder ce que possédaient les empereurs, et que nous pouvons en paraître dignes sans danger. Et c'est peu de permettre aux citoyens d'acheter ce qui leur plaît, vous prévenez leurs désirs par les dons les plus précieux : persuadé que rien n'est plus à vous que ce que vous tenez de ceux que vous aimiez, vous prenez plaisir à nous enrichir de ce que votre adoption ou des testaments particuliers vous ont acquis.
LI. Vous êtes aussi réservé à élever de nouveaux édifices, qu'attentif à entretenir les anciens. Les maisons des particuliers sont en sûreté : elles ne sont plus menacées par, les prodigieuses masses de pierres que l'on transporte, et les temples n'en sont plus ébranlés. Vous croyez avoir toujours assez et même trop et, succédant à un prince très économe, vous trouvez encore à retrancher sur ce qu'il vous a laissé comme nécessaire. D'ailleurs, ce que Nerva dérobait à son usage, il le devait à la fortune qui l'avait élevé à l'empire : vous dérobez au vôtre ce que vous avez hérité de votre père. Mais quelle magnificence ne montrez-vous pas dans les ouvrages publics? Ici un portique, là un temple se trouvent élevés avec une célérité qui dérobe aux yeux le travail de la construction, et il semble qu'au lieu de les avoir entièrement bâtis, on n'ait fait qu'y mettre la dernière main. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que ce vaste cirque, dont la beauté le dispute aux plus superbes maisons des dieux? Quel lieu plus digne de recevoir le peuple vainqueur du monde? Le cirque lui-même ne sera pas moins admiré que les spectacles qui s'y donnent mais ce qui frappera surtout, c'est une égalité de places qui semble confondre le prince avec les citoyens. Point de distinction, partout, la plus parfaite uniformité, César n'a pas de place qui lui soit plus spécialement destinée que le spectacle même. Les Romains pourront donc vous voir aussi librement que vous les voyez. Il leur sera permis de contempler, non la loge fermée du prince, mais le prince lui-même, assis au milieu du peuple, du peuple pour qui vous avez fait construire cinq mille places nouvelles : car le nombre des citoyens s'est accru par tant de libéralités, et il devait s'accroître plus encore sur la foi de vos bienfaits.
LII. Si quelqu'autre empereur nous eût fait la moindre de ces faveurs, il y a longtemps que sa statue d'or ou d'ivoire, ornée d'une couronne de rayons, aurait place sur les autels au milieu de nos dieux, et il n'y aurait point pour lui de victimes ni trop grandes, ni trop augustes. Pour vous, on ne vous voit entrer dans les temples que pour prier et pour adorer et vous tenez à honneur que vos statues, comme pour veiller à leur garde, en occupent les avenues, et les portes, Ainsi, les dieux conservent toute leur prééminence sur les hommes, parce que vous ne prétendez pas à la gloire des dieux (80) . Aussi ne voyons-nous, dans le vestibule du temple de Jupiter, qu'une ou deux de vos statues, encore ne sont-elles que de bronze. Naguère même, l'entrée, les degrés, l'intérieur des temples resplendissaient de statues d'or et d'argent : on profanait ces enceintes sacrées, en y mêlant aux images des immortels celles d'un prince incestueux. Vous, Trajan, vous avez à peine quelques statues en bronze mais elles égaleront le temple même en durée ; tandis que ces innombrables statues d'or ont satisfait par leur chute et leur ruine à la haine et à la joie publiques. On se plaisait à briser contre terre, ces têtes orgueilleuses, à les poursuivre avec le fer, à les déchirer avec la hache, comme si chaque coup eût fait jaillir le sang et produit la douleur. Personne ne fut assez maître d'une joie si longtemps attendue, pour ne pas goûter comme une vengeance le plaisir devoir ces membres déchirés, ces corps mutilés, ces hideuses et cruelles images, jetées dans les flammes, pour faire servir à l'usage et au plaisir des hommes ce qui avait été si longtemps l'objet de leur horreur. Ce même respect que vous avez pour les dieux n'a pu vous permettre de recevoir nos actions de grâces dans votre palais et en présence de votre génie tutélaire. Vous avez voulu que ce fut dans le temple de Jupiter, persuadé que nous tenons de lui seul tous les biens que nous vous devons, et qu'il faut rendre grâces de vos bienfaits à celui qui vous a donné aux Romains. Autrefois on arrêtait sur la route une partie des victimes que l'on conduisait au Capitole : on les enlevait aux dieux, pour les immoler à un cruel tyran, et leur sang coulait devant ses statues aussi abondamment qu'il répandait lui-même celui des hommes.
LIII. Tout ce que je dis ici et tout ce que j'ai dit auparavant des autres princes, pères conscrits, a pour but de montrer combien leurs mœurs, si heureusement réformées par Trajan, étaient dépravées et corrompues par un long usage : la .comparaison, d'ailleurs, sert à rehausser l'éloge. J'ajouterai que c'est le premier devoir d'un bon citoyen envers un prince vertueux, de ne pas épargner ceux qui se sont montrés ennemis de la vertu : car on n'aime pas assez un bon prince, quand on ne déteste pas les mauvais. Enfin, n'est-ce pas le plus bel éloge de celui qui nous gouverne, que l'on puisse sous son empire se déclarer contre les princes coupables? Notre douleur nous a-t-elle permis d'oublier que récemment encore Néron a trouvé des vengeurs (81) ? Qui venge la mort d'un tel prince souffrira-t-il qu'on en censure la vie ou qu'on en attaque la réputation, et ne s'appliquera-t-il pas tout ce qu'on dira d'un empereur qui lui ressemble ? C'est donc un bienfait que je compare à tous ceux que nous tenons de vous et qui en efface même la plupart, que de nous laisser la liberté de nous venger chaque jour sur la mémoire des mauvais princes, et de faire entendre, par leur exemple, à ceux qui pourraient leur ressembler, qu'il n'y a ni temps, ni lieu, qui puisse mettre leurs mânes en repos et les garantir des imprécations de la postérité. Ne craignons donc point, pères conscrits, de nous abandonner trop et aux transports de notre joie présente, et aux mouvements d'une douleur excitée par le souvenir de nos maux passés. On ne peut trop faire l'un et l'autre sous un bon prince. Que nos entretiens domestiques, que nos discours, que nos actions de grâces soient remplis de ces sentiments et souvenons-nous sans cesse qu'on ne loue jamais mieux le prince vivant, que lorsqu'on blâme plus librement ceux de ses prédécesseurs qui l'ont mérité car lorsque la postérité se tait sur un mauvais prince, elle accuse celui qui gouverne de lui ressembler.
LIV. Que restait-il à imaginer à la flatterie, après avoir mêlé les louanges des empereurs aux spectacles, aux jeux (82), et jusqu'à ces honteuses danses qu'ils accompagnaient de postures et de chansons, si infâmes? Quelle indignité d'entendre en même temps le consul dans le sénat et le bouffon sur le théâtre prononcer l'éloge de l'empereur! Vous avez défendu à de tels gens de profaner votre nom : vous avez abandonné le soin de votre gloire à des muses plus nobles et à nos éternelles Annales, rejetant ces adulations honteuses et passagères. Que dis-je? votre nom sera d'autant plus vénéré au théâtre qu'il sera moins souvent dans la bouche des comédiens. Mais comment admirer votre mépris pour ces louanges, quand on vous voit ne recevoir qu'en partie, ou souvent refuser tout-à-fait les honneurs même que nous vous décernons? Auparavant on ne pouvait traiter dans le sénat de l'affaire la plus commune, la plus ordinaire, sans que ceux qui étaient obligés d'opiner s'arrêtassent longuement sur l'éloge des princes. On ne nous faisait délibérer que sur la nécessité d'augmenter le nombre des gladiateurs, d'instituer des collèges d'artisans et, comme si les frontières de l'empire eussent été reculées, nous élevions des arcs de triomphe d'une telle hauteur, que les inscriptions gravées sur le fronton en étaient plus élevées que le faîte des temples ou bien nous désignions plusieurs de nos mois à la fois par le nom des Césars (83) , Ils le souffraient, ils s'en réjouissaient, comme s'ils l'eussent mérité. Mais aujourd'hui, qui d'entre nous, oubliant le sujet de la délibération, consume le temps de dire son avis à louer le prince? C'est votre seule modération qui nous a rendu ce courage. Nous ne faisons que vous obéir en nous assemblant au sénat, non plus pour faire assaut de flatterie, mais pour nous efforcer à l'envi de remplir tous les devoirs de la justice, disposés à rendre hommage à Votre sincérité et à votre noble franchise, en croyant que vous voulez ou ne voulez pas en effet ce que vous dites vouloir ou ne vouloir pas. Nous commençons , nous finissons nos avis dans le sénat par où, sous un autre prince, on ne pouvait ni commencer ni finir. D'autres ont pu refuser quelques-uns des honneurs qui leur étaient déférés mais aucun, avant vous n'a montré assez de grandeur d'âme pour persuader qu'il n 'avait pas voulu qu'on les lui décernât. Ce que je regarde donc comme le plus grand de tous les éloges, c'est que votre nom n'est pas gravé sur le marbre ou sur la pierre, mais qu'il est conservé dans les monuments éternels de la gloire.
LV. On dira dans tous les siècles, qu'il y a eu un prince, à qui des hommes, pendant sa vie et au temps de sa puissance, ne décernèrent que des honneurs médiocres, et à qui, plus souvent, ils n'en décernèrent aucun. Certes, si nous voulons le disputer au temps où ces adulations étaient une nécessité, nous serons facilement vaincus. La dissimulation est plus ingénieuse à inventer que la franchise, la servitude que la liberté, la crainte que l'amour. D'ailleurs, après que la flatterie a depuis longtemps épuisé tout ce qu on pouvait imaginer de nouveaux honneurs, quel autre plus grand nous reste-t-il à vous offrir, que d'oser ne point parler, de vous?
Si quelquefois il est échappé à notre zèle de rompre le silence, et à votre modestie de céder à notre empressement, parmi les honneurs que nous vous avons décernés, quels sont ceux que vous avez acceptés? Vous avez montré à tous que ce n'est ni par orgueil ni par dégoût que vous refusez les plus grands honneurs, puisque vous ne dédaignez pas les moindres. C'est là, César, quelque chose de plus glorieux que de les rejeter tous. Il y a une sorte de vanité à les refuser tous : il n'y a que de la modestie à choisir les moins éclatants. Un si sage tempérament est également avantageux et à nous et au trésor public ; à nous, puisque vous nous affranchissez ainsi de tout soupçon (84) ; au trésor public, puisque vous craignez de l'épuiser, en prince qui n'est point disposé à le remplir des dépouilles de citoyens innocents. On vous élève des statues, comme on en élevait autrefois à ces illustres Romains, qui avaient rendu quelque signalé service à la patrie. Celles de Trajan sont de la même matière que celles des Brutus et des Camilles : aussi la raison qui les a fait élever n'est-elle pas différente. Ils chassèrent autrefois les rois de Rome, et ils repoussèrent de ses murs un ennemi victorieux : Trajan en éloigne la tyrannie ; il nous défend contre tous les maux que l'esclavage traîne à sa suite et il ne se tient à la première place que pour empêcher qu'un maître ne l'occupe. À considérer votre sagesse, on s'étonne moins que vous rejetiez, ou que vous tempériez ces honneurs fragiles et périssables. Vous savez ce qui assure à un prince la vraie gloire, la gloire immortelle, vous savez quels sont les honneurs qui ne craignent ni le feu, ni le temps, ni l'envie des successeurs. Il n'est point d'arcs de triomphe, de statues, d'autels, de temples même qui ne périssent, et qui enfin ne soient oubliés. Si le temps les épargne, la postérité souvent les néglige ou les condamne. Mais celui qui a le courage de mépriser l'ambition, et de mettre un frein à une puissance accoutumée à n'en point avoir, voit sa renommée croître avec les siècles, et il n'est jamais tant loué que de ceux, qui sont le moins forcés à le louer. D'ailleurs, dès qu'un homme arrive au principat, sa renommée, bonne ou mauvaise, est éternelle (85). Ce n'est donc pas la perpétuité de son nom qu'il doit désirer : son nom, quoi qu'il puisse faire, ne périra pas, ce qu'il doit souhaiter, c'est un nom honorable. Or, il ne peut l'attendre que du mérite et de la vertu, et non des images ou des statues. Disons même, pour descendre à de moindres avantages, que les traits et la figure des princes se gravent et se conservent plus sûrement dans le cœur des hommes que sur l'or et sur l'argent. C'est un privilège dont vous jouissez pleinement, vous dont le visage riant et l'air aimable sont toujours rappelés dans nos discours, présens à nos yeux, gravés dans nos cœurs.
LVI. Vous l'avez sans doute remarqué, pères conscrits, je ne choisis pas les faits que je rapporte, C'est moins les actions de Trajan que Trajan lui-même que je veux louer. Un mauvais prince peut faire une action louable mais nul autre qu'un bon prince ne mérite d'être loué. Aussi, noble César, ce qui vous est le plus glorieux, c'est qu'en vous rendant des actions de grâces, on n'a rien à cacher, rien à omettre. Y a-t-il un seul acte de votre gouvernement qu'il faille ou toucher légèrement, ou passer sous silence? quel moment, quel instant de votre vie n'est pas marqué par quelque bienfait, et n'est pas digne de louanges ? Ne vivez-vous pas de telle sorte, que votre éloge le plus beau, ce sera votre histoire la plus fidèle (86) ? c ' est ce qui fait que mon discours est déjà si
étendu, quoique je n'aie parlé que des deux premières années de votre empire. Que n'ai-je pas dit déjà de votre modestie, et cependant que ne me reste-t-il pas encore à vous
dire! Vous avez accepté un second consulat, parce qu'il
vous était déféré et par votre prince et par votre père (87).
Mais après que les dieux vous eurent rendu maître de vous,
en mettant en vos seules mains la souveraine puissance,
vous refusâtes un troisième consulat, que vous pouviez
si dignement remplir. Il y a de la grandeur à refuser les
dignités, mais il y en a plus encore à refuser la gloire. Faut-
il vous admirer dans l'exercice, ou dans le refus du consulat? Vous l'avez exercé, non pas dans le doux loisir de la
ville, et dans le sein de la paix, mais au milieu des nations barbares. Tels on voyait nos anciens Romains quitter les ornements consulaires pour prendre les insignes
du général, et poursuivre la victoire jusque dans des contrées inconnues. Oh! qu'il était honorable pour l'empire,
qu'il était glorieux pour vous, de voir nos alliés vous
demander justice dans leur patrie! Qu'il est agréable de
revoir, après tant de siècles, le consul assis sur un tribunal de gazon, environné à la fois d'étendards, de piques et de faisceaux! Combien n'ajoutaient pas à la majesté de nos spectacles et la diversité des vêtements et
celle des langages, et ces harangues dont la plupart avait
besoin d'interprètes! Rien de plus magnifique, rien de
plus grand que de juger les citoyens au milieu de Rome
tranquille : que sera-ce de prononcer sur les différends
des ennemis au milieu des vastes pays que l'on a subjugués? de paraître paisible et sans inquiétude sur leurs
rives menaçantes? de mépriser leurs vains frémissements?
de leur inspirer la terreur qu ils croyaient nous donner ? et de les contenir autant par la présence de la toge, que par la force des armes? Ce n'est donc pas à vos images qu'ils portaient les hommages dus à l'empereur; c'était à vous-même qu'ils les adressaient et ce nom, que les autres acquéraient que pour avoir dompté les ennemis, vous l'aviez mérité pour les avoir méprisés.
LVII. C'est ainsi que vous avez exercé le consulat. Mais le refus que vous en avez fait depuis ne vous a pas été moins glorieux. Vous l'avez refusé au commencement de votre principat, comme si vous eussiez été déjà comblé et rassasié de dignités. Vos prédécesseurs, en arrivant à l'empire, s'appropriaient le consulat destiné à d'autres. On en a vu même (88), sur la fin de leur gouvernement, l'arracher, après un long exercice, à ceux qu'ils en avaient eux-mêmes décorés. Cette dignité, que les princes, au commencement et à la fin de leur règne, désirent avec assez de passion pour la ravir, vous la cédez à d'autres, lors même qu'elle n'est aux mains de personne. Quoi donc! eût-il été odieux de voir Trajan, ou remplir un troisième consulat, ou en exercer un premier depuis qu'il était prince? Vous étiez déjà empereur, quand vous avez été fait consul pour la seconde fois mais un autre partageait l'empire avec vous, et on ne peut de ce second consulat vous faire d'autre honneur ou tirer d'autre exemple que celui de la soumission. Oui, César, Rome, qui a vu des citoyens consuls pour la cinquième ou pour la sixième fois (et je ne parle pas ici de ceux qui furent nommés par la brigue et la violence, lorsque la liberté rendait le dernier soupir (89), je parle de ceux à qui on portait le consulat dans leurs retraites rustiques), cette même Rome vous a vu, souverain de l'univers, refuser un troisième Consulat comme un fardeau trop pesant. Ainsi vous montrez encore plus de modestie que les Papirius et les Quintius, vous qui êtes Auguste, César et père de la patrie. Mais la république les appelait à cet honneur. Et la république ne vous y appelait-elle pas? Le sénat, le consulat lui-même, qui devait recevoir de vous un nouvel éclat, ne vous invitaient-ils pas à l 'accepter?
LVIII. Je ne vous propose pas l'exemple de ce prince (90) , qui en se continuant incessamment dans le consulat, semblait de tant d'années n'en avoir fait qu'une seule. Je ne veux vous comparer qu'aux consuls créés par d'autres que par eux-mêmes. Lorsque vous refusiez un troisième consulat, nous avions dans le sénat un consul qui l'était pour la troisième fois (91). Nos vœux unanimes exigeaient-ils trop de votre modestie, quand ils vous demandaient de vouloir bien être autant de fois consul, que l'avait été un sénateur? c'eût été trop de modestie, même quand vous n'auriez été qu'homme privé. Car enfin le fils d'un consulaire, d'un triomphateur, s'élève-t-il donc si haut en obtenant le consulat? Ne lui est-il pas dû? n'est-il pas dû à sa seule naissance? Mais vous vouliez qu'il fût permis à des particuliers de consacrer le commencement de l'année, et d'ouvrir les fastes : vous vouliez que ce fût pour vous un gage assuré du retour de la liberté, de voir un autre consul que César. Ainsi fut marquée la première année de liberté, après l'expulsion des rois ; ainsi l'affranchissement de Rome inscrivit autrefois dans les fastes des noms d'hommes privés. Malheureux ces princes que l'ambition dévorait, qui étaient toujours consuls, comme ils étaient toujours princes! Mais ce n'était pas même l'ambition, c'était une basse et lâche envie qui les poussait à s'emparer en quelque sorte de toutes les années, et à ne transmettre à d'autres l'éclat de la pourpre souveraine, qu'après en avoir enlevé le premier lustre. Que devons-nous admirer le plus en vous, ou de la grandeur d'âme, ou de la modestie, ou de la bonté? Quelle grandeur d'âme ne faut-il pas pour s'éloigner d'un honneur toujours si vivement désiré ! quelle modestie pour le céder ! quelle bonté pour prendre tant de plaisir à en jouir dans les autres!
LIX. Mais il est temps de vous donner vous-même au consulat, pour l'agrandir en l'exerçant. Le refuser trop souvent pourrait être suspect et donner lieu de croire que vous le jugez au dessous de vous. Nous sommes tous persuadés que vous ne l'avez refusé, que par la haute idée que vous vous en faites mais vous ne le persuaderez point, aux autres, si vous ne l'acceptez quelquefois. Quand vous ne voulez point souffrir qu'on vous érige des arcs de triomphe, des trophées, ou des statues, il faut le pardonner à votre modestie car enfin ces honneurs ne se rapportent qu'à vous. Mais aujourd'hui ce que nous vous demandons, c'est d'enseigner aux princes qui viendront après vous, à renoncer à la mollesse, à interrompre quelquefois le cours de leurs plaisirs, à se réveiller pour quelques moments du doux sommeil où s'endort leur bonheur,à se revêtir de la pourpre, quand ils s'en emparent, au lieu de la donner, à occuper le siège curule qu'ils retiennent pour eux, à être enfin ce qu'ils ont désiré d'être, et à ne vouloir pas être consuls, seulement pour l'avoir été. Je sais que vous avez exercé un second consulat. Vous pouvez vous en prévaloir auprès des armées, des provinces, et des autres peuples, mais non auprès de nous. Nous avons ouï dire que vous aviez parfaitement rempli tous les devoirs d'un bon consul mais nous l'avons seulement ouï dire. On assure que personne ne porta jamais plus loin la justice, l'humanité, la modération mais c'est la renommée qui le publie : n'est-il pas juste que nous en jugions une fois par nous-mêmes, et que nous ne soyons pas toujours réduits à l'en croire? N'aurons-nous joui des douceurs de votre consulat que loin de vous ? Souffrez que nous éprouvions si ce second consulat n'a rien diminué de votre modestie. Six mois suffisent pour changer les mœurs des hommes, il en faut moins pour corrompre celles des princes. Les philosophes nous apprennent que celui qui possède parfaitement une vertu les possède toutes mais nous souhaitons connaître par expérience, si c'est aussi la même chose, d'être un bon consul et un bon prince. Car, outre qu'il est très difficile d'embrasser deux pouvoirs suprêmes et de les embrasser à la fois, il y a ici entre l'un et l'autre une sorte d'opposition, puisque le prince doit autant ressembler à l'homme privé que le consul en doit différer (92) .
LX. Je crois entrevoir que la principale raison qui vous fit refuser le consulat l'année dernière, c'est qu'absent vous n'auriez pu l'exercer. Mais aujourd'hui que vous êtes rendu à Rome et à, nos vœux, comment pourriez-vous mieux justifier notre admiration pour vos rares qualités ? C'est peu que vous veniez au sénat, si vous ne le convoquez ; que vous y assistiez, si vous n'y présidez ; que vous entendiez les avis, si vous ne les recueillez. Voulez-vous rendre à cet auguste tribunal des consuls toute son ancienne majesté, daignez-y monter. Voulez-vous assurer le respect de la magistrature, l'autorité des lois, la retenue des orateurs, qu'ils aient à parler devant vous (93) . Il ne faut point vous le dissimuler : l'intérêt qu'aurait la république, si vous étiez homme privé, à vous voir consul plutôt que simple sénateur, elle l'a maintenant à vous voir prince et consul tout ensemble. Tant de puissantes raisons, quoique longtemps combattues par votre modestie, ont fini par l'emporter. Mais comment votre modestie s'est-elle rendue? Ce n'a pas été pour vous égaler aux particuliers, mais pour élever les particuliers j usqu'à vous. Vous avez accepté un troisième consulat, pour en pouvoir donner un troisième à quelqu'un. Vous saviez que la modération, la bienséance ne permettait pas aux sénateurs d'être trois fois consul, s'ils ne recevaient l'exemple de celui auquel ils étaient associés. Les princes autrefois accordaient à peine cet honneur, dont ils étaient avares, à leurs compagnons de guerre et de dangers : vous l'avez accordé à des hommes éminents (94) , mais dont les services vous avaient été rendus dans la paix. Il est vrai, César, qu'ils avaient signalé leur zèle et leur fidélité pour vous mais où est le prince qui entre ses devoirs compte la reconnaissance, ou qui aime les personnes à qui il en doit? Pour vous, César, vous avouez vos dettes, et vous les acquittez. Quand vous accordez le consulat pour la troisième fois, vous ne croyez pas agir en grand prince, mais en ami qui craint d'être ingrat. On peut dire même que vous rehaussez quelquefois de toute la grandeur de votre fortune l'importance des plus médiocres services. Car vous faites croire que vous avez reçu autant que vous rendez. Comment vous remercier dignement de tant de bontés ? si ce n'est en souhaitant de voir vos sujets accroître votre reconnaissance pour eux par leur zèle à vous servir, de sorte qu'on puisse éternellement douter s'il est plus utile aux Romains de recevoir de vous que de vous donner.
LXI. Quand je vous voyais, assis près d'un collègue déjà trois fois consul, prendre l'avis d'un homme désigné consul pour la troisième fois, je me retraçais l'antique sénat de Rome. Que ces deux hommes me paraissaient élevés ! que le prince me semblait grand! La hauteur des corps décroît à côté des corps qui les surpassent : il en est de même des pouvoirs, les plus éminents s'abaissent à côté de votre suprême puissance et plus on les approche de votre rang, plus ils descendent de leur propre hauteur. Cependant, quoique vous n'ayez pu, selon vos désirs, égaler à vous ces illustres personnages, vous les avez pourtant élevés si haut, qu'ils paraissaient autant au dessus des autres que vous étiez au dessus d'eux.
Que, dans la même année que vous avez été consul, vous n'ayez déféré un troisième consulat qu'à un seul homme, ce serait toujours un témoignage de votre grandeur d'âme car si c'est le souverain bonheur de pouvoir faire tout le bien qu'on veut, c'est le comble de la magnanimité de vouloir faire tout le bien qu'on peut : si celui qui a mérité pour la troisième fois cette suprême magistrature est digne d'éloges, celui de qui il l'a obtenue en est plus digne encore. On ne mérite point un tel honneur sans avoir de grandes vertus mais on ne le donne point aux autres sans en avoir soi-même encore de plus grandes. Que sera-ce donc d'avoir pu honorer deux hommes ensemble de ce troisième consulat, d'avoir placé deux collègues sous l'influence de votre caractère sacré? car, on ne peut en douter, vous n'avez prolongé votre consulat qu'afin d'embrasser également le consulat de tous deux, et d'être à tous deux leur collègue. Depuis peu ils avaient tous deux reçu un second consulat des mains de votre auguste père, et c'était presque le recevoir des vôtres. Les faisceaux, qu'ils ne venaient que de quitter, paraissaient encore présents à leurs yeux : à peine avaient-ils cessé d'entendre le cri des licteurs qui les précédaient, qu'ils sont de nouveau élevés sur la chaise curule, et revêtus de la pourpre. Ainsi autrefois lorsque l'ennemi était proche, et que la république en danger demandait un homme à qui les charges eussent donné de l'expérience, on ne rendait pas le consulat aux mêmes hommes, mais on rendait les mêmes hommes au consulat. Tel est votre amour pour le bien, qu'il accomplit seul tout ce qu'on a fait autrefois par nécessité. Ces deux illustres personnages venaient de quitter les ornements consulaires ; vous voulez qu'ils les reprennent : ils venaient de renvoyer leurs licteurs, vous ordonnez qu'ils les rappellent : les félicitations de leurs amis étaient à peine terminées, il faut les renouveler. Est-ce là un cœur d'homme? Un homme a-t-il donc ce pouvoir de continuer,-de prolonger la joie, d'en perpétuer les transports, et de ne laisser entre les dons de deux consulats que le temps nécessaire pour achever le premier? Puissiez-vous en user toujours de la sorte! puissent votre grand cœur et votre fortune ne se lasser jamais ! puissiez-vous souvent accorder cette dignité pour la troisième fois, et puisse-t-il arriver qu'après avoir fait ce juste honneur à un très grand nombre de citoyens, il en reste encore un nombre plus grand qui le mérite!
LXII. Les faveurs accordées à ceux qui en sont dignes ne leur donnent pas plus de joie qu'à ceux qui leur ressemblent. C'est ce que l'on a pu reconnaître particulièrement dans le consulat de ces deux hommes illustres. La justice qui leur a été faite a été vivement sentie, non seulement par une partie du sénat, mais par le sénat entier, et chaque sénateur paraissait aussi touché que s'il avait donné ou reçu lui-même cet honneur car ceux que le prince récompense sont les mêmes hommes que le sénat désigna les premiers, lorsqu'il eut à nommer les plus vertueux citoyens, pour réformer les dépenses de l'état (95) et ce sont les importants services qu'ils ont rendus dans cette commission qui leur ont si justement acquis l'estime de César. N'avons-nous pas plus d'une fois éprouvé que la faveur du sénat est aussi souvent nuisible qu'avantageuse auprès du prince ? Naguère encore, n'avons-nous pas remarqué qu'on ne pouvait sans le dernier péril donner à croire au prince qu'on était estimé, aimé du sénat ? Il haïssait ceux que nous aimions, et nous haïssions ceux qu'il aimait. Aujourd'hui le prince et le sénat aiment à l'envi le plus digne : ils se le désignent l'un à l'autre avec un égal empressement ; ils s'en rapportent à leur mutuel témoignage et, ce qui est la plus infaillible marque d'une union parfaite, nos affections concourent pour les mêmes personnes. Vous pouvez donc, pères conscrits, vous déclarer ouvertement, aimer avec constance, il ne s'agit plus de cacher votre amour, de peur qu'il ne soit funeste, ou de dissimuler votre haine, de peur qu'elle ne serve. César approuve et condamne ce que vous approuvez et ce que vous condamnez ; présents, absents, il vous fait l'honneur de vous consulter. Ceux qu'il a élevés au consulat pour la troisième fois sont les mêmes que vous aviez élus, et il a gardé l'ordre que vous aviez suivi. Mais, dans cette élection, que César n'aime rien tant que les personnes qui sont chères au sénat, ou qu'il leur donne la préférence sur d'autres qu'il aime davantage, cela doit vous flatter également. La vieillesse peut se promettre des récompenses, la jeunesse se proposer des modèles ; les jeunes gens peuvent assidûment et sans péril cultiver les hommes illustres. Plus on s'attache à ceux que le sénat honore, plus on gagne auprès du prince. Il croit que l'attachement qu'on a pour eux se tourne en vénération pour lui et il ne trouverait nulle gloire à être plus grand que tous les autres, si ceux au dessus desquels il est placé n'étaient eux-mêmes de très grands hommes. Daignez, César, tenir toujours la même conduite, jugez des hommes par leur réputation ; n'écoutez, ne regardez qu'elle et ne faites point d'attention à des discours secrets, à des bruits incertains, qui ne sont jamais plus dangereux que pour ceux qui veulent bien y prêter l'oreille. Il est bien plus sûr d'ajouter foi au public qu'aux particuliers ; les particuliers peuvent tromper ou être trompés eux-mêmes mais jamais personne n'a trompé tout le monde, jamais tout le monde n'a trompé personne.
LXIII . Je reviens à votre consulat ou plutôt je dois parler d'abord de circonstances relatives à ce consulat, mais qui l'ont précédé. Je dirai surtout que vous avez assisté aux comices où l'on vous a élu ; noble candidature, où vous sembliez moins aspirer au consulat qu'à la gloire, à l'immortalité, au privilège de donner des exemples qui fussent suivis par les bons princes, et lus avec surprise par les mauvais. Le peuple romain vous a vu dans cet antique sanctuaire de sa puissance. Vous avez patiemment essuyé ces longues formules des comices, dont les lenteurs naguère encore nous semblaient dérisoires (96) . En un mot, on vous a fait consul, comme l'un de ceux que, vous élevez au consulat. Qui de vos prédécesseurs a rendu cet honneur au consulat ou au peuple? Les uns, appesantis par le sommeil et gorgés encore des débauches de la veille, attendaient les nouvelles de leurs comices. Les autres veillaient, à la vérité, et ne pouvaient dormir mais, au fond de leur palais, ils préparaient l'exil ou la mort des consuls mêmes qui proclamaient leur consulat. Ambition fausse et ignorante de la vraie grandeur ! rechercher un honneur que l'on méprise, mépriser l'honneur que l'on recherche! Voir de ses jardins le Champ-de-Mars et l'assemblée des comices, et en rester aussi éloigné que si l'on en était séparé par le Rhin et le Danube! Craignaient-ils donc, ces princes indignes, de voir donner les suffrages après les avoir désirés ? et, contents d'avoir commandé qu'on leur déférât le consulat, enviaient-ils à une ville libre jusqu'à de vaines apparences de liberté? Enfin pouvaient-ils se résoudre à se cacher et à s'éloigner de l'assemblée publique, comme s'il se fat agi, non de leur décerner le consulat, mais de leur ôter l'empire? Ils auraient cru, ces orgueilleux despotes, cesser d'être princes, en paraissant un instant sénateurs : ou plutôt, avouons-le, la plupart étaient retenus moins par l'orgueil que par la crainte. Auraient-ils bien osé, pendant que leur conscience leur reprochait des incestes et les plus honteuses débauches, profaner les auspices, et souiller, par leur infâme présence, ce champ consacré à Mars? Ils n'avaient pas encore porté si loin le mépris des dieux et des hommes, qu'ils pussent se résoudre à soutenir dans un si grand jour leur présence et leurs regards. Votre piété et l'innocence de vos mœurs vous ont conseillé au contraire de vous offrir, dans ce lieu sacré, au jugement des dieux et des hommes.
LXIV. D'autres ont mérité le consulat avant de l'obtenir : vous, César, vous l'avez mérité en le recevant. Ane considérer en vous que le prince, la cérémonie était terminée, et le peuple commençait à s'ébranler pour se retirer, lorsque l'on fut surpris de vous voir approcher du tribunal où le consul était assis, pour prêter entre ses mains un serment que vos prédécesseurs n'avaient connu qu'en le faisant prêter à d'autres. Voyez combien il était important que vous ne refusassiez pas le consulat ? Si vous l'eussiez refusé, aurions-nous pu vous croire capable d'une telle magnanimité ? Je ne puis, pères conscrits, revenir de mon étonnement : je ne sais encore si j'en dois croire mes yeux et mes oreilles et je me demande quelquefois si j'ai bien vu, si j'ai bien entendu. Quoi! l'empereur! quoi! César Auguste! quoi! le souverain pontife est debout devant le consul! Il est debout, et le consul demeure assis, sans se troubler, sans s'étonner, comme s'il se conformait à un ancien usage! Le consul, sur son siège, dicte au prince le serment et le prince le répète, il prononce, il articule distinctement toutes les paroles consacrées, pour dévouer sa personne et sa maison à la colère des dieux, s'il manque volontairement à ses promesses. Que vos successeurs aient le courage de_suivre un tel exemple, ou qu'ils ne l'aient pas, votre gloire, César, sera toujours égale. Peut-on vanter assez la modestie qui vous a fait agir à votre troisième consulat comme à votre premier, qui a dicté la même conduite au prince qu'au particulier, à l'empereur, qu'au sujet? Je ne sais, non je ne sais ce que je dois admirer le plus, ou que personne ne vous ait donné l'exemple du serment que vous avez prêté, ou qu'un autre vous en ait dicté la formule.
LXV. A la tribune même, vous vous êtes engagé par un semblable serment à obéir aux lois ; aux lois, qui n'ont jamais été faites pour le prince ; mais vous ne voulez pas avoir plus de privilèges que nous et c'est pour cela même que nous voulons vous en voir plus qu'à nous. J'apprends donc (97), aujourd'hui, que le prince n'est pas au dessus des lois, mais que les lois sont au dessus du prince. César consul, n'a pas plus de droit que les autres consuls. Il jure l'observation des lois à la face des dieux attentifs : (à qui doivent-ils plus d'attention qu'à César?) il la jure en présence de ceux qui doivent un jour faire le même serment, et personne, il le sait, ne doit plus religieusement observer ses serments, que celui à qui il importe le plus qu'il n'y ait point de parjures. Aussi avez-vous, en sortant du consulat, juré publiquement, que vous n'aviez rien fait contre les lois. Il y avait eu sans doute beaucoup de grandeur à le promettre mais il y en a eu bien davantage à rester fidèle à sa promesse. Monter si souvent au tribunal ; vous montrer dans ce lieu où l'arrogance des autres princes ne leur permettait pas de paraître, accepter, déposer en ce lieu la magistrature, ce sont des actions d'autant plus dignes de vous, qu'elles sont plus éloignées de la conduite de ces princes, qui, après avoir exercé le consulat quelques jours, et même sans l'avoir exercé, se hâtaient de l'abdiquer par un édit. Cet édit tenait lieu d'assemblée, de discours public, de serment. C'est ainsi qu'ils finissaient comme ils avaient commencé et l'on ne comprenait qu'ils avaient été consuls, que parce que le consulat n'avait pas été rempli par d'autres.
LXVI. Je n'ai pas eu dessein, pères conscrits, de passer sous silence tout ce qu'a fait le prince pendant son consulat. J 'ai voulu seulement rassembler dans un même endroit tout ce qui regardait les serments qu'il a prêtés car il ne faut pas, comme dans un sujet d'éloge sec et stérile, étendre, amplifier la même louange, et y revenir plus d'une fois. Le premier jour de votre consulat avait lui, et l'on vous avait vu entrer dans, cette assemblée, exhorter le corps entier du sénat et les sénateurs en particulier, à reprendre l'ancienne liberté, à partager avec vous les soins de l'empire, à veiller de concert et à travailler avec ardeur au bien public. Tous les princes avant vous avaient tenu le même langage, et on ne les avait pas crus (98). On avait sous les yeux les fréquents naufrages de ceux qui, voguant sur la foi d'un calme trompeur, avaient été accablés par une tempête imprévue. Quelle mer, en effet, plus perfide que les ca resses de ces princes légers et infidèles, dont la haine est moins à redouter que l'amitié (99) ? Mais à votre voix nous marchons pleins d'ardeur et de confiance. Vous voulez que nous soyons libres, nous le serons ; vous voulez que nous exprimions librement toutes nos pensées, nous le ferons. Car ce n'est pas une lâcheté, une inertie habituelle qui nous ont réduits au repos, jusqu'à ce jour. La crainte, la terreur, et cette expérience, triste fruit du malheur, nous instruisait assez qu'il fallait détourner d'une république, hélas ! qui n'existait plus, et nos yeux, et nos oreilles, et notre esprit. Mais aujourd'hui, soutenus par votre bras, et rassurés par vos promesses, nous ouvrons notre bouche fermée par un long esclavage, et nous délions notre langue enchaînée par tant de maux. En effet, vous voulez que nous soyons tels que vous l'ordonnez : dans vos exhortations, nul artifice, nul piège qui puisse tromper la confiance, au risque de celui qui la trompe car jamais prince n'a été trompé, sans avoir d'abord trompé lui-même.
LXVII. Tels sont les sentiments du père de la patrie, ceux qu'il me semble avoir exprimés dans son discours et dans la manière même dont il l'a prononcé. Quelle solidité de pensées ! quelles expressions simples et vraies ! quelle fermeté dans la voix ! quelle candeur sur son visage! que ses regards, que ses gestes, que son air et sa contenance inspiraient de confiance ! Ne craignons donc point qu'il se démente. Toutes les fois que nous userons de la liberté qu'il nous a donnée, il se souviendra que nous lui obéissons. Il ne nous traitera point d'imprudents, si nous montrons un courage que la seule innocence de son siècle nous inspire : il n'a pas oublié que nous savions nous conduire autrement sous un mauvais prince. Nous avions coutume de faire aux dieux des vœux publics pour l'éternelle durée de l'empire, pour le salut du peuple (100) pour la conservation du prince. Que dis-je? nous ne les faisions pour l'empire qu'en les faisant pour l'empereur. Pourrait-on ne pas remarquer en quels termes ces mêmes vœux ont été conçus pour vous (101) ? « Si vous gouvernez avec justice, et uniquement pour l'avantage de la république. » O vœux dignes d'être éternellement formés, éternellement exaucés ! Les dieux, par votre entremise, César, ont contracté avec la république l'engagement de veiller à votre conservation, tant que vous-même veillerez à celle de la patrie et si vous trahissiez ses intérêts, de détourner de vous leurs regards protecteurs, vous abandonnant aux vœux secrets des citoyens (102). Les autres souhaitaient de survivre à la république, et faisaient tout ce qu'il fallait pour y réussir. Pour vous, vous n'aimez la vie qu'autant que votre salut est lié à celui de l'état. Vous ne souffrez point que l'on fasse des vœux pour vous, s'ils ne sont premièrement utiles à ceux qui les font. Chaque année vous demandez aux dieux de vous juger, et de cesser de vous être favorables, si vous cessez d'être tel que vous étiez quand vous fûtes élu. Rassuré par votre conscience, vous ne craignez pas, César, de ne vouloir la protection des dieux qu'autant que vous en serez digne et vous, n'ignorez pas cependant que personne ne sait aussi bien que les dieux si vous la méritez. Ne vous semble-t-il pas, pères conscrits, que jour et nuit l'empereur se dit : « J'ai moi-même armé contre moi le bras du préfet de mes gardes, si l'utilité des peuples le demandé : je n'ai point même conjuré le courroux ou l'oubli des dieux; j'ai fait plus, je les ai suppliés de ne souffrir jamais que la république fît pour moi des vœux malgré elle ou que, si elle en faisait, ils ne fussent point écoutés (103). »
LXVIII. Votre conservation, César, vous est donc bien glorieuse, puisqu'elle est un gage de l'assentiment des dieux. Ne leur ayant demandé de veiller sur votre vie, qu'autant que votre gouvernement serait juste, ils attestent, en la conservant, que vous gouvernez justement. Vous passerez, dans la joie et dans la tranquillité, des jours que les autres empereurs passaient dans le trouble et dans la crainte. Comme ils se défiaient de notre patience, ils n'attendaient qu'avec une inquiétude mortelle les courriers qui devaient leur apporter le renouvellement de nos vœux, ou plutôt de la servitude publique. Si quelqu'un avait été retardé par le débordement des fleuves, par une fonte de neiges, ou par des tempêtes, ils croyaient aussitôt que tout ce qu'ils méritaient était arrivé. Dans leur frayeur, ils arrêtaient leur soupçons également sur tout le monde car le mauvais prince voit un successeur dans tous ceux qui sont plus dignes que lui de gouverner et comme il n'est personne qui n'en soit plus digne, il n'est personne qu'il ne redoute. La lenteur des courriers, le retardement des nouvelles que vous attendez, ne vous causent point de ces alarmes. Engagé par serment à tout le monde, vous ne doutez pas que tout le monde ne s'engage à vous. Personne ne se refuse cet avantage. Nous vous aimons autant que vous le méritez mais c'est pour nous, et non pour vous, que nous vous aimons. Et puissions-nous, César, ne voir jamais luire le jour où nos serments nous arrachent des vœux, qu'aujourd'hui nos intérêts nous demandent. Quelle sauvegarde honteuse pour un prince, que celle qu'on peut se prévaloir de lui donner ! N'avons-nous pas à nous plaindre que les princes haïs soient les seuls qui aiment à pénétrer dans le secret de nos cœurs? Si les bons princes s'y appliquaient comme les mauvais, quelle admiration pour vous, quelle joie, quel enthousiasme ne découvririez-vous pas? quels discours vous entendriez dans le sein de nos familles, au milieu de nos femmes, de nos enfants, devant nos autels domestiques et nos foyers ! Vous sauriez qu'en public nous épargnons votre délicatesse et que l'amour et la haine, d'ailleurs si opposés, ont cela de commun , que, si en secret on s'abandonne à tous les emportements de sa haine contre les mauvais empereurs, on se livre aussi à tout l'excès de son amour pour les bons.
LXIX. Vous avez pu, cependant, juger vous-même de notre opinion et de nos sentiments, autant qu'il était permis de nous juger en votre présence, le jour où vous montrâtes tant de bonté, tant d'égards pour tous les candidats, que la joie de l'un ne fut pas troublée par la tristesse de l'autre. Ceux-ci s'en retournèrent pleins de joie, ceux-là, pleins d'espérance : on eut beaucoup de gens à féliciter, personne à consoler. Que de dignité dans le discours que vous adressâtes à la jeune noblesse, pour l'exhorter à rechercher les suffrages du sénat, à lui adresser ses demandes, et à n'attendre du prince aucun honneur qui n'eût été d'abord sollicité au sénat! Vous ajoutâtes, dans cet endroit, pour ceux qui pouvaient avoir besoin d'exemple, qu'ils se réglassent sur vous. Grand exemple, César, et non moins difficile à suivre pour ceux qui aspirent aux honneurs, que pour les princes mêmes! Vit-on jamais un candidat montrer une seule fois pour le sénat la même déférence que vous lui avez montrée toute votre vie, et particulièrement lorsque vous eûtes à prononcer contre ceux qui aspiraient aux honneurs? N'est-ce pas par déférence pour le sénat, que vous avez donné à des jeunes gens d'illustre origine un honneur dû à leur naissance, mais dont leur âge semblait les exclure ? Enfin le temps est venu où la noblesse, loin d'être avilie,est illustrée par le prince : ces descendants des grands hommes, ces derniers rejetons de la liberté romaine, César ne les opprime, ni ne les craint : il fait plus ; il avance pour eux le temps des honneurs, il les rend aux dignités et à l'éclat de leurs ancêtres. S'il reste quelque héritier d'une noble famille, d'une antique illustration, il le soutient, il l'élève, il le produit au profit de la chose publique. On honore, on célèbre des noms illustres arrachés à l'oubli : c'est à César qu'on le doit, c'est à lui (104) appartient de conserver comme de donner la noblesse.
LXX. L'un des candidats avait été questeur dans un gouvernement et il avait su, par la sagesse de son administration, créer un revenu à une cité très importante (105). Vous avez voulu que le sénat en fût informé. Car pourquoi, sous un prince dont la vertu donne plus d'éclat à ses ancêtres qu'il n'en a reçu d'eux, ceux qui illustrent leurs descendants seront-ils moins dignes de faveur que ceux qui ont été illustrés par leurs pères? Que vous méritez de pouvoir toujours rendre de tels témoignages de nos magistrats, et d'engager moins à la vertu par la punition des méchants, que par les récompenses assurées aux gens de bien ! Vous avez excité une noble émulation dans l'âme des jeunes gens, vous leur avez inspiré une vive passion d'imiter ce qu'ils entendent louer. C'est un sentiment qui est entré dans tous les esprits, dès qu'on a su que vous étiez instruit de tout, ce qui se faisait de bien dans les gouvernements. Il est utile et encourageant pour les administrateurs des provinces de pouvoir compter sur la plus flatteuse récompense de leur désintéressement et de leur zèle, sur l'attention et sur l'approbation du prince (106). Jusqu'à présent, les cœurs nobles et droits avaient été, non pas détournés du bien, mais découragés par une réflexion malheureusement trop fondée. Qu'importe, se disait-on, que je prenne tant de soin de bien faire? César, n'en saura rien, ou, s'il le sait, il n'en parlera jamais. Qu'attendre de princes si négligents ou si envieux? Les scélérats ne voyant aucun châtiment à craindre, les gens de bien aucune récompense à espérer, il arrivait que rien ne détournait les uns du crime, et que tout dégoûtait les autres de la vertu. Mais aujourd'hui, si quelqu'un a sagement gouverné une province, on lui offre la charge qu'il a justement méritée. Le champ des honneurs et de la gloire est ouvert à tout le monde. Chacun peut y rechercher ce qu'il désire, et ne devoir qu'à lui-même ce qu'il obtient, Vous avez pour jamais banni des provinces la crainte des concussions, et la cruelle nécessité d'en demander justice car si la reconnaissance des provinces n'est pas sans fruit pour les magistrats, elles n'auront bientôt plus à se plaindre d'aucun d'eux. D'ailleurs n'est-il pas évident (107) que rien ne sert mieux un candidat dans la recherche d'une charge, que la chargé qu'il a déjà exercée ? Ce sont les magistratures et les honneurs qui conduisent le plus sûrement aux honneurs et aux magistratures. Je veux que celui qui a gouverné une province, ne produise pas seulement des lettres de ses amis, ou des témoignages particuliers que le crédit et l'intrigue ont pu arracher : je lui demande des décrets publics des colonies ou des cités, j'aime à joindre à la recommandation des hommes consulaires qui le présentent, le suffrage des villes, des peuples et des nations entières (108). La meilleure recommandation pour un candidat, ce sont les actions de grâces qu'on lui a décernées.
LXXI. Mais parlons des applaudissements, des transports de joie du sénat, lorsqu'on vous vit descendre de votre tribunal, aller au devant des candidats que vous veniez de nommer, les embrasser, et vous confondre dans la foule des sénateurs qui les félicitaient! et cette conduite doit-elle plutôt exciter notre admiration pour vous, que notre haine contre ceux qui nous ont obligés à la regarder comme un grand exemple ? Attachés à leur tribunal, ils nous présentaient nonchalamment la main à baiser, et semblaient encore nous accorder une faveur. Nous avons vu, spectacle nouveau, debout l'un devant l'autre, et sur un terrain égal (109) , le prince et le candidat ! nous avons vu celui qui distribuait les honneurs se mêler avec ceux qui les recevaient! Quelle vérité dans l'exclamation qui échappa au sénat étonné! Il en est d'autant plus grand, d'autant plus auguste ! Il ne reste en effet à celui qui est parvenu au comble des honneurs, qu'un seul moyen pour s'élever ; c'est que, sûr de sa propre grandeur, il en sache descendre. De tous les périls qui menacent la fortune des princes, celui qu'ils doivent craindre le moins, c'est de s'avilir en s'abaissant. Pour moi, ce qui m'a paru plus admirable encore que votre bonté même, ce sont les soins, délicats qu'elle s'imposait. En vain votre discours occupait et vos yeux et votre voix et votre main : comme si leurs, fonctions eussent été confiées à un autre, on vous voyait attentif à donner toutes les marques de la plus affectueuse bienveillance (110). Et même lorsque ceux qui recommandaient les candidats accueillaient leurs noms par les suffrages accoutumés (111), vous joigniez vos éloges aux leurs, et de la bouche du prince on entendait l'approbation du sénateur : ce témoignage que nous nous plaisions à rendre au prince en faveur de ceux qui nous en paraissaient dignes, c'était le prince qui le rendait au sénat. En déclarant les candidats d' excellent citoyens, vous les rendiez tels en effet, en louant leur vie, vous approuviez le jugement du sénat, et il sentait que vos éloges lui étaient aussi honorables qu'à ceux qui en étaient l'objet.
LXXII. Ne devons-nous donc pas changer l'ordre des vœux que vous avez adressés aux dieux immortels, que ces comices assurassent, notre bonheur, celui de la république et le vôtre? Ne devons-nous pas les prier, que tout ce que vous faites, tout ce que vous ferez à l'avenir, soit utile à vous, à l'état et à nous? ou pour renfermer ces trois vœux dans un seul, ne demandons que votre bonheur, ce sera demander celui de la république et le nôtre. Un temps a été, et il n'a duré que trop, où notre bonheur et notre malheur ne se réglaient point sur celui du prince. Maintenant, tristesse et joie, tout nous est commun et si vous ne pouvez être heureux sans nous, nous ne pouvons l'être sans vous. S'il en était autrement, auriez vous ajouté à la fin de votre prière publique : que vous ne demandez aux dieux leur protection que si vous continuez a mériter notre amour? Oui, César, l'amour des citoyens vous est si cher, que dans l'ordre de vos souhaits, vous le mettez le premier, et que vous ne désirez d'être aimé des dieux, qu'autant que votre peuplé vous aimera. Aussi le sort des princes qui vous ont précédé a-t-il bien montré que les dieux n'aiment que ceux qui savent se faire aimer des hommes. Il était difficile que nos louanges pussent égaler de tels vœux : elles les ont cependant égalés. J'en appelle à ces acclamations que nous inspirèrent la vivacité de notre amour, l'ardeur de notre enthousiasme. Ce n'était pas notre esprit, c'était votre vertu et vos grandes actions qui nous fournissaient ces expressions que la flatterie ne saurait trouver, que la terreur n'a jamais arrachées. Quel prince nous inspirera jamais assez de crainte pour nous faire imiter ces transports, ou assez d'amour pour nous les arracher ? Vous avez connu les contraintes de la servitude : qu'avez-vous entendu jamais, qu'avez-vous dit de pareil ? La crainte, il est vrai, sait inventer mais ce qu'elle invente paraît forcé. L'inquiétude et la tranquillité ne parlent point la même langue. On n'est pas inspiré de même dans la joie et dans la tristesse. L'expression de l'une ne peut convenir à l'autre. Le bonheur a son langage, comme l'infortune a le sien : et quand l'un pourrait dire les mêmes choses que l'autre, il ne les dirait pas de même.
LXXIII. Vous avez été témoin de la joie qui brillait dans nos jeux : le désordre des toges et des vêtements attestait l'ardeur de nos transports (112). Le sénat retentissait de nos cris et il n'y avait point d'endroits si reculés où ils ne pénétrassent. Qui de nous ne s'élança pas de sa place? qui de nous s'aperçut qu'il en était sorti? que de choses faites spontanément, ou plutôt par un entraînement et une force irrésistibles! Car la joie, comme les autres passions, ne nous laisse pas toujours maîtres de nous-mêmes. Votre modestie fit d'inutiles efforts pour mettre des bornes à notre enthousiasme : plus vous le vouliez retenir, plus il s'emportait : non qu'on ait oublié, César, le respect qui vous est dû mais c'est que s'il dépend de vous de nous donner de la joie, il ne dépend pas de nous d'en régler les transports. Les pleurs que vous avez versés ont rendu justice à la sincérité de nos acclamations. Nous vous avons vu les yeux mouillés, le front baissé de pudeur et de joie, le visage rouge de modestie et nous en avons demandé avec plus d'ardeur que vous ayez toujours même sujet de larmes, même rougeur, sur le front (113). Animons pour un moment ce temple, ces lieux sacrés, et demandons-leur s'ils ont jamais vu pleurer le prince. Mais ils ont vu souvent pleurer le sénat. Votre exemple sera gênant pour vos successeurs mais il le sera aussi pour nos descendant Ceux-ci exigeront des princes qu'ils méritent les mêmes éloges que vous, et ceux-là s'indigneront de ne les pas entendre.
LXXIV. Quelle expression plus vraie pourrais-je employer que celle dont se servit tout le sénat, heureux prince ! Ce n'était pas alors votre puissance, c'était la grandeur de votre âme que nous admirions car le comble du vrai bonheur, c'est d'en paraître digne (114). Mais, entre tant de paroles pleines de sagesse et de dignité que le sénat prononça ce jour-là, on remarqua surtout celles-ci : Croyez-nous-en, croyez-vous en vous-même. C'était beaucoup compter sur nous, mais sur vous plus encore. Un homme en effet peut en tromper un autre : personne ne s'est jamais trompé lui-même, s'il a eu le courage de sonder son cœur, et de se demander ce qu'il mérite. Ainsi ce qui rendait nos discours suspects auprès des mauvais princes leur donne créance auprès des bons. En vain nous faisions tout ce que l'affection a coutume de faire, ils en croyaient leur conscience, et se disaient qu'ils n'étaient pas aimés. À nos vœux nous avons ajouté celui-ci : Que les dieux vous aiment comme vous nous aimez ! Oserait-on ainsi parler de soi à un prince dont on serait médiocrement aimé? Tous les vœux que nous avons formés pour nous, c'est que les dieux nous aimassent comme vous nous aimez. Et au milieu de ces vœux, ne nous sommes-nous pas écriés avec vérité, que nous étions heureux ? Est-il en effet un bonheur plus grand que de n'avoir point à souhaiter que l'empereur nous aime, mais seulement que nous soyons aussi chers aux immortels, que nous le sommes à l'empereur? Cette ville si pieuse et toujours si digne de la bonté des dieux, croit aujourd'hui qu'il ne manquera rien à sa félicité, si les dieux veulent bien en sa faveur imiter César.
LXXV. Mais pourquoi m'arrêter plus longtemps à rassembler et à suivre chacune de ces circonstances ? Prétendrais-je donc, pères conscrits, rappeler dans ma mémoire, ou renfermer dans une harangue tout ce que vous avez fait insérer dans les actes publics, et graver sur l'airain, pour en conserver un éternel souvenir? Auparavant on ne faisait cet honneur qu'aux seuls discours prononcés par le prince. Nos acclamations ne sortaient point de ce palais : elles n'auraient été glorieuses, ni pour le sénat ni pour l'empereur. Mais la gloire et l'utilité de Rome demandaient également que celles-ci se répandissent par tout le monde, et passassent à la postérité. Il nous importait que toute la terre fut témoin de notre reconnaissance, et la partageât avec nous, qu'on reconnût en nous le courage de juger les bons et les mauvais princes, même avant leur mort, qu'enfin l'expérience fît voir que nous avions été autrefois malheureux, mais non pas ingrats, puisque les occasions d'être reconnaissants nous avaient manqué. Avec quelle vivacité, avec quelles instances, avec quels cris ne vous a-t-on pas supplié de vouloir bien ne pas supprimer le souvenir de vos bienfaits et les témoignages de notre dévouement? de vouloir bien conserver un exemple qui pût servir de règle aux siècles à venir? Que les princes apprennent à distinguer les vraies acclamations d'avec les fausses, et qu'ils vous aient éternellement l'obligation de ne pouvoir plus s'y tromper. Ils n'ont plus un chemin à se faire pour aller à la renommée, ils n'ont qu'à ne point quitter celui qui leur a été tracé : ils n'ont plus à bannir la flatterie, il leur suffit de ne la plus ramener. Ils connaissent à présent et ce qu'ils doivent faire, et ce qu'ils méritent d'entendre, s'ils font ce qu'ils doivent. Que puis-je ajouter aux vœux que j'ai faits avec tout le sénat, si ce n'est de souhaiter que la joie qui parut alors dans vos yeux puisse ne sortir jamais de votre cœur? Ne cessez jamais d'aimer ce jour et préparez-vous-en, s'il se peut, de plus beaux encore. Puissiez-vous enfin mériter et entendre de nouveaux éloges ! Car on ne peut répéter les mêmes louanges que pour les mêmes actions.
LXXVI. Disons maintenant combien elle fut digne de Rome antique, de Rome consulaire, l'assemblée du sénat, où, pendant trois jours entiers, vous avez présidé ce corps auguste (115), en vous renfermant dans les seules fonctions de consul ! Chacun put demander ce qu'il voulut, contredire, se ranger d'un autre avis, et proposer en sûreté ce qu'il croyait utile à l'état. Nous fumes tous consultés : on compta nos voix, et l'on adopta, non le premier avis, mais le meilleur. Auparavant, qui aurait osé parler, qui aurait osé ouvrir la bouche, excepté ces misérables qu'on interrogeait les premiers? Les autres, interdits et immobiles, avec quelle douleur, avec quel saisissement supportaient-ils cette nécessité de souscrire, sans parler, sans quitter leur siège, à l'opinion qui leur était dictée! Un seul opinait pour tous, et tous, et lui-même, désapprouvaient l'avis qu'il osait ouvrir : tant il est vrai que rien ne déplaît davantage à tous, que ces décrets qui passent comme si tous les approuvaient ! Peut-être l'empereur dans le sénat s'imposait-il quelques dehors de respect, mais à peine sorti, il rentrait dans son rang de prince et les devoirs du consulat étaient repoussés, négligés, dédaignés. Trajan, au contraire, les remplissait comme s'il n'eût été que consul, et il ne trouvait au dessous de lui que ce qui était au dessous de la dignité consulaire. Lorsqu'il sortait de sa demeure, il ne voulait être retardé ni par la pompe orgueilleuse de la majesté souveraine, ni par la foule embarrassante des hérauts et des licteurs. Il s'arrêtait seulement un instant sur le seuil, pour consulter le vol des oiseaux et adorer ces avertissements du ciel. Personne n'était repoussé, personne n'était écarté : les passants étaient si respectés, les licteurs si retenus, que plus d'une fois le cortège d'un particulier arrêta celui de l'empereur et du consul. Sa suite était si modeste et si peu nombreuse, qu'on aurait cru voir un de ces grands hommes de l'ancienne Rome, consul sous un prince bon et clément.
LXXVII. On le voyait aller le plus souvent au forum, mais souvent aussi au Champ-de-Mars (116). Car il assistait lui-même aux comices pour l'élection des consuls, et il prenait autant de plaisir à les proclamer, qu'il, en avait eu à leur réserver cet honneur. Ils étaient debout devant le tribunal de l'empereur, comme il l'avait été devant le tribunal des consuls. Il leur faisait prêter le serment dans les mêmes termes qu'il l'avait prêté lui-même et il ne l'exigeait si exactement, que parce qu'il en connaissait tout le pouvoir. Le reste du temps, il l'employait à rendre la justice. Et sur son tribunal quelle scrupuleuse équité? quel respect pour les lois? Quelqu'un venait-il réclamer l'autorité du souverain ; il répondait qu'il était consul. Point de magistrature, point d'autorité dont il ait affaibli les droits, et dont il n'ait plutôt étendu les privilèges. Il renvoyait la plupart des affaires aux préteurs, qu'il appelait ses collègues, non pour affecter des manières populaires, et pour plaire à ceux qui l'écoutaient, mais parce qu'il les regardait comme tels. Il avait une si haute opinion de cette charge qu'il ne croyait pas faire plus d'honneur à ceux qui 1'exerçaient, en les traitant de collègues, qu'en les appelant préteurs. Et quelle n'était pas son assiduité à rendre publiquement justice sur le tribunal consulaire ! Il semblait délassé et fortifié par le travail. Qui d'entre nous se consume de tant de soins et de fatigues ? qui se dévoue aussi entièrement aux devoirs, de la charge qu'il a désirée, et se montre aussi capable de les remplir ? Aussi est-il bien juste que celui qui fait les consuls, soit si fort au dessus d'eux. On aurait reproché à la fortune même, que celui qui peut donner les magistratures, ne pût pas les exercer. Il faut que celui qui fait les consuls, les instruise, et qu'en les élevant à un si grand honneur, il puisse leur persuader qu'il connaît parfaitement tout le prix de ce qu'il leur donne : ils sentiront ainsi l'importance des fonctions qui leur sont confiées.
 |
 |
 |
 |
|---|
LXXVIII C'est là ce qui justifie encore le sénat de vous avoir prié, de vous avoir ordonné d'accepter un quatrième consulat. Un tel ordre ne peut vous paraître suspect de flatterie. Votre déférence pour le sénat l'autorise à vous le donner, vous le pouvez croire : dans aucune autre occasion, il n'aurait plus de droit de la réclamer, dans aucun autre son vœu ne serait plus obligatoire pour vous. Comme celle des autres hommes, la vie des princes, de ceux même qui se croient des dieux, est courte et fragile. Il n'est donc rien qu'un prince vertueux ne doive tenter pour être, même après sa mort, utile à la république, en lui laissant de grands exemples de modération et de justice et qui peut mieux en donner qu'un consul ? Vous voulez rappeler et ramener la liberté : quel honneur devez-vous plus aimer, quel titre devez-vous prendre plus souvent que celui que la liberté reconquise a trouvé le premier ? Il n'est pas moins, digne d'un citoyen d'être à la fois prince et consul, que d'être seulement consul. Ménagez enfin la délicatesse de vos collègues (je dis vos collègues : c'est ainsi que vous parlez, et que vous voulez que nous parlions). Le souvenir de leur troisième consulat pèsera toujours à leur modestie, tant qu'ils ne vous auront pas vu encore une fois consul car il est impossible que des particuliers n'aient pas trop d'un honneur qui suffit au prince. Cédez donc à nos instances, César et vous qui vous rendez notre intercesseur auprès des dieux, ne rejetez pas nos vœux, quand il est en votre pouvoir de les exaucer.
LXXIX. C'est peut-être assez pour vous d'un troisième consulat mais c'est parce qu'il vous suffit, que ce n'est pas assez pour nous. En exerçant le consulat, vous n'avez fait que nous inspirer le désir de vous voir encore plusieurs fois consul. Nous le souhaiterions moins vivement, si nous ignorions comment vous vous en acquitterez. Mieux eût valu pour nous ne jamais goûter le bonheur de vous avoir, pour consul, que d'en être privés aujourd'hui. Nous sera-t-il accordé de jouir encore de votre consulat? de vous faire entendre les mêmes actions de grâces? d'écouter les mêmes réponses? d'éprouver la joie que vous ressentez vous-même? Verrons-nous présider aux transports publics celui qui en est l'auteur et l'objet? le verrons-nous, selon sa coutume, tenter inutilement d'arrêter les éclats de notre zèle? L'heureux, l'agréable spectacle, que ce combat entre la modestie du prince, et l'amour du sénat, quel qu'en soit le succès (117)! Pour moi, je me promets une sorte de bonheur inconnu, et plus doux que celui que nous avons senti. Car pourrait-on ne pas comprendre que notre prince sera toujours d'autant meilleur consul, qu'il l'aura été plus souvent? Un autre, s'il ne se fut pas entièrement abandonné à l'oisiveté et à la mollesse, aurait cherché du moins, dans ses travaux, quelque délassement, quelques instants de loisir. Mais Trajan, à peine affranchi des devoirs de consul, révient aux devoirs de prince et il donne avec tant d'application à chacune de ces places ce qu'elle demande, que l'empereur ne paraît rien prendre sur le consul, ni le consul sur l'empereur. Nous voyons avec quelle bonté, il va au devant des requêtes de nos provinces, et même des prières de chaque ville ! L'audience s'obtient sans difficulté, et la réponse ne se fait pas attendre. On est admis aussitôt, aussitôt expédié : enfin les députations n'assiègent plus en vain les portes du palais.
LXXX. Que dirai-je de cette douce sévérité et de cette sage clémence que vous montrez dans tous vos ju-gemens? Vous ne siégez point sur un tribunal pour enrichir le fisc et vous ne cherchez, dans vos décisions, que la satisfaction d'avoir bien jugé. Ceux qui plaident devant vous craignent moins la perte de leurs biens que celle de votre estime, moins inquiets de l'opinion que vous aurez de leur cause, que de celle que vous concevrez d'eux. O le digne emploi d'un prince et d'un consul, que de réconcilier les villes rivales, et de contenir les peuples soulevés, plus encore par la force de la raison, que par l'autorité du commandement ! de réparer les injustices des magistrats, et de faire que ce qui devait ne pas être ne paraisse pas avoir été ! enfin, avec la rapidité du soleil, d'être présent à tout, d'entendre tout, et de quelque endroit qu'on vous invoque, de porter secours aussitôt, à l'exemple des dieux! C'est ainsi sans doute que l'auteur des choses exerce son pouvoir souverain, quand il abaisse ses regards sur la terre, et daigne associer les affaires des hommes à celles dont il s'occupe dans le ciel. Aujourd'hui, il se repose sur vous de ce soin ; vous le représentez ici et, après vous avoir chargé de tout ce qui regarde les hommes, il s'est réservé tout entier pour le ciel. Oui, César, vous le remplacez ici-bas, vous suffisez à l'accomplissement de ses ordres, puisque chacun de vos jours nous est aussi utile qu'il vous est glorieux.
LXXXI. Si quelquefois vous avez satisfait aux affaires qui vous arrivent de toutes parts, vous ne cherchez de délassement que dans le changement de travail. Quels sont vos divertissements ? De chasser dans les forêts les plus épaisses, d'y lancer, d'y suivre à la trace les bêtes fauves entre les rochers, et jusque sur le sommet des montagnes les plus escarpées, d'y monter légèrement, sans être précédé, sans être aidé de personne et parmi ces mâles exercices, de visiter nos bois sacrés, et d'y porter vos pieux hommages aux divinités qui les habitent. C'était autrefois le premier essai, le plus doux plaisir de la jeunesse, et de ceux surtout qui se destinaient aux armes, de poursuivre à la course les bêtes fugitives, de vaincre par la force les plus courageuses, de surprendre par adresse les plus rusées : dans la paix, il était glorieux de préserver les campagnes de la fureur des bêtes féroces, et de protéger contre leur irruption les travaux du laboureur. C'est un honneur que s'attribuaient les princes mêmes qui n'y pouvaient prétendre : ils domptaient la férocité des bêtes fauves par une longue prison puis ils les faisaient lâcher, pour les forcer ensuite avec une fausse adresse dont on se moquait avec raison. Trajan joint la peine de les chercher à celle de les prendre et le plus grand, le plus agréable plaisir pour lui, c'est de les trouver. Que s'il se plaît quelquefois à montrer sur la mer la même force de corps, vous ne le voyez point suivre des yeux ou de la main les voiles flottantes. Tantôt il s'assied lui-même au gouvernail, tantôt il dispute au plus robuste rameur l'honneur de rompre l'impétuosité des vagues, de dompter la fureur des vents, et de surmonter avec la rame l'obstacle des flots soulevés (118) .
LXXXII. Qu'un tel empereur ressemble peu à celui qui ne se promenait jamais sur les eaux tranquilles et dormantes du lac d'Albe, ou de Bayes, sans être importuné du mouvement et du bruit des rames, et sans tressaillir, à chaque coup, d'une honteuse frayeur (119) ! Immobile et loin de tout bruit, il était donc traîné, comme une victime expiatoire, dans un navire attaché à un autre. Spectacle honteux! un empereur était traîné à la suite d'un autre vaisseau, comme dans un vaisseau captif! Les fleuves mêmes et les rivières ont été témoins de cette infamie. Le Danube et le Rhin se plaisaient à promener ainsi notre honte. Et il était aussi déshonorant pour l'empire qu'un tel spectacle fût étalé devant les aigles romaines, devant nos drapeaux, devant notre rive, qu'aux yeux des ennemis, de ces ennemis qui aiment à parcourir sur des barques, ou à traverser en nageant ces mêmes fleuves, hérissés de glaçons ou débordés dans les campagnes, aussi bien que lorsqu'ils ont repris leurs cours, et se sont renfermés dans leur lit. Ce n'est pas que la force du corps, mérite par elle-même de grandes louanges mais si le corps est animé par une âme encore plus forte, par une âme que les faveurs de la fortune ne puissent amollir, ni l'opulence du rang suprême pousser au luxe et à la mollesse, alors que cette force se déploie sur les montagnes ou sur la mer, j'admirerai un corps qui se plaît dans les fatigues, des membres qui se fortifient dans les travaux. Je remarque, en remontant jusqu'aux siècles les plus reculés, que ceux qui épousaient les déesses, ou qui étaient enfants des dieux, n'ont pas été plus illustrés par l'éclat de leur origine ou de leur alliance (120) que par ces nobles travaux. Je me représente quelles doivent être les sérieuses occupations d'un empereur, pour qui de tels exercices ne sont que des amusements et des jeux car il est des plaisirs par lesquels on peut fort sainement juger de la sagesse, de l'innocence, de la modestie d'un homme. Le plus déréglé sait se donner quelques dehors de gravité dans ses occupations mais le loisir nous montre tels que nous sommes. Les autres princes n'employaient-ils pas tout le leur au jeu, à la débauche et au luxe? Pour se délasser, ils faisaient succéder à leur application aux affaires, leur application aux vices.
LXXXIII. Une haute fortune a cela de particulier, qu'elle découvre, qu'elle éclaire toutes nos actions : elle ouvre à la renommée non seulement le palais des princes, mais l'intérieur même de leur demeure,leurs retraites les plus cachées. Pour vous, César, rien ne peut vous être plus glorieux que d'être vu dans le secret. Il faut admirer sans doute les actions dont vous nous rendez tous témoins mais ce que vous renfermez dans l'intérieur de votre vie privée n'est pas moins admirable. Il est beau de vous défendre vous-même de la contagion des vices, il est plus beau encore d'en garantir ceux qui vous approchent. On le sait : il est plus difficile de faire pratiquer la vertu que de la pratiquer soi-même. Qu'il est donc glorieux pour le plus vertueux des princes de rendre ceux qui l'entourent aussi vertueux que lui ! C'est une tache pour beaucoup d'hommes illustres d'avoir mal choisi leur femme, ou de n'avoir, pas su la répudier (121). Ainsi leur honte domestique ternissait tout l'éclat qu'ils avaient acquis au dehors et parce qu'ils étaient des maris trop indulgents, on ne les regardait que comme des hommes médiocres. Pour vous, César, la femme (122) que vous avez épousée ajoute à votre gloire : rien de si accompli, rien de si respectable qu'elle. Si le grand pontife avait à se choisir une femme, ne faudrait-il pas que son choix tombât, sur elle, ou sur une femme semblable (123)? Et comment en trouver une semblable? Paraît-elle se ressentir de votre élévation, si ce n'est, par la joie qu'elle éprouve? Rien approche-t-il de la constante vénération qu'elle montre, non pour votre puissance, mais pour votre personne? Vous êtes toujours l'un pour l'autre ce que vous étiez naguère : vous avez l'un pour l'autre la même estime et tout ce que votre fortune ajoute à votre bonheur, c'est de vous avoir appris à tous deux combien vous êtes dignes d'en jouir. Quelle simplicité dans sa parure, et dans le cortège qui la suit ! quelle affabilité dans ses manières ! C'est l'ouvrage de son mari ; c'est à lui qu'elle doit ces heureuses habitudes, ces leçons salutaires : car il suffit à la gloire d'une épouse de savoir suivre les sages conseils. La terreur et le faste ne marchent pas à votre suite : elle le sait, et aucune pompe n'accompagne ses pas. Elle voit l'empereur allant à pied dans Rome, elle l'imite, autant que le permet la faiblesse de son sexe. Il lui conviendrait de vivre de la sorte, quand vous en useriez autrement mais quand un mari montre tant de modération, combien ne doit pas avoir de retenue une femme qui le respecte et qui se respecte elle-même ?
LXXXIV. Et votre sœur (124), qu'elle sait bien se souvenir que Trajan est son frère! Comme on reconnaît en elle votre droiture, votre franchise, votre candeur! Si on la compare à votre auguste épouse, on ne pourra dire s'il est plus utile, pour vivre vertueux, d'avoir un heureux naturel, ou un excellent maître? Rien n'est plus propre à faire naître des dissensions, que cette rivalité ordinaire entre les femmes, qui naît souvent entre parents, qui s'entretient par l'égalité, qui s'irrite par la jalousie, et dégénère enfin en haine implacable. C'est ce qui doit nous faire regarder comme un prodige de vertu, qu'entre deux femmes qui habitent la même maison, dont la fortune est égale, on ne voie jamais la moindre dispute. Elles se respectent, elles se cèdent tour-à-tour et, quoique toutes deux vous aiment très tendrement, elles pensent n'avoir aucun intérêt à connaître laquelle des deux vous aimez le plus. Même volonté, même conduite, rien qui puisse vous faire apercevoir que ce sont deux personnes. Elles s'étudient à l'envi à vous imiter, à suivre vos traces et elles n'ont toutes deux les mêmes mœurs, que parce qu'elles ont les votres. De là vient cette modération qui ne se dément point, de là vient qu'elles n'ont à craindre aucun changement de car elles ne courent point risque de se voir contraintes à rentrer dans la vie privée, puisqu'elles n'en sont jamais sorties. Le titre d'Augustes leur avait été offert par le sénat; elles l'ont unanimement rejeté, tant que vous avez refusé le nom de Père de la patrie. Peut-être croyaient - elles que les titres d'Augustes étaient moins honorables pour elles, que ceux de femme et de sœur de Trajan. Mais quelle que soit la raison qui leur a inspiré tant de modestie, c'est parce qu'elles ne sont pas appelées de ce nom, qu'elles sont plus dignes d'en être honorées dans nos cœurs. Car quelles femmes méritent mieux nos éloges, que celles qui savent mettre le véritable honneur, non dans la magnificence des titres, mais dans l'approbation publique, et qui, par le refus qu'elles font des plus grands noms, n'en voient aucun au dessus d'elles ?
LXXXV. L'amitié, ce bien le plus ancien dont jouissent les mortels, était bannie du commerce ordinaire de la vie, et remplacée par les flatteries, les trompeuses caresses, et des dehors d'amitié plus dangereux que la haine. Si le nom d'amitié était encore connu dans la maison des princes, il n'y était qu'un objet de mépris et de raillerie. Quelle amitié pouvait régner entre des personnes, dont les uns se croyaient maîtres, les autres esclaves? Tous l'avez rappelée d'un long exil. Vous avez des amis, parce que vous savez être ami. Car un prince ne commande point l'amitié, comme il peut commander le reste. Ce sentiment veut être libre : il est généreux, ennemi de la contrainte, et il exige rigoureusement autant qu'il donne. Le prince peut être quelquefois haï de ceux qu'il ne hait pas mais, s'il n'aime, il n'est pas possible qu'il soit aimé. Vous aimez donc, puisqu'on vous aime : et c'est cette affection réciproque, aussi honorable pour vous que pour vos amis, qui fait toute votre gloire. Devenu supérieur, vous descendez à tous les devoirs de l'amitié, vous abaissez l'empereur jusqu'à l'ami. Que dis-je ? vous n'êtes jamais plus empereur que quand l'amitié semble vous faire oublier votre rang. Car la fortune des princes a besoin de beaucoup d'amis, et c'est un des soins les plus importants d'un prince que de s'en acquérir. Restez toujours attaché à cette opinion ; qu'entre tant d'autres vertus que vous possédez, celle-là vous soit toujours particulièrement précieuse et ne vous laissez jamais persuader que de tous les sentiments la haine est le seul qui n'avilit pas les princes (125). C'est un des plus grands plaisirs de la vie que celui d'être aimé, mais le plaisir d'aimer n'est pas moins grand. Vous jouissez pleinement de l'un et de l'autre; et si vous aimez avec ardeur, on vous aime encore plus tendrement. C'est que d'abord il est plus facile à plusieurs d'en aimer un seul, qu'à un seul d'en aimer plusieurs. Ensuite, vous avez tant d'occasions de faire du bien à vos amis, qu'ils ne peuvent, sans ingratitude, se dispenser de vous aimer plus qu'ils ne sont aimés de vous.
LXXXVI. Ici, je ne puis m'empêcher de parler de la violence que vous vous êtes faite pour épargner un refus à un ami (126). Il était digne, par ses vertus, de la tendresse que vous aviez pour lui : vous avez forcé votre cœur à lui accorder la retraite qu'il demandait, comme si vous n'eussiez pas eu le droit de le retenir. Vos regrets vous ont appris à quel point vous l'aimiez : en déférant, en cédant à son vœu, vous avez senti votre âme se déchirer. Ainsi donc on aura vu pour la première fois, dans cette opposition de volontés entre le prince et l'ami du prince, celle de l'ami prévaloir. Action digne de souvenir, digne d'être immortalisée par l'histoire ! Choisir un préfet du prétoire, non entre ceux qui briguent cette charge, mais entre ceux qui s'en éloignent, et qui la craignent! quand on l'a dignement choisi, le rendre à la vie privée, qu'il aime toujours avec passion ! et pendant que vous ne cessez de vous livrer vous-même à tous les soins de l'empire, n'envier point, aux autres la douceur d'un agréable repos ! C'est maintenant, César, que nous comprenons tout ce que vous doit la république, pour tant de soins et de travaux, quand nous voyons demander et obtenir le repos, comme le plus désirable des biens. Quelle n'était pas, m'a-t-on dit, votre douleur, quand vous avez accompagné votre ami à son départ! Car vous avez voulu l'accompagner, et vous n'avez pas pu vous empêcher de l'embrasser sur le rivage. César s'est arrêté dans ce lieu, où tous les yeux ont pu juger de ses tendres sentiments et, après avoir souhaité des vents favorables et un prompt retour à son ami, s'il lui arrivait toutefois de le désirer lui-même, il l'accompagna de ses vœux et de ses larmes longtemps après son départ. Je ne dis rien de vos libéralités : quelles libéralités pouvaient égaler cette sollicitude, cette résignation du prince? Un si rare dévouement méritait que votre ami se reprochât son courage comme une dureté et je ne doute pas qu'il n'ait été plus d'une fois prêt à regagner le port et il l'eût fait, s'il n'eût été persuadé que le plaisir de rester auprès du prince, parmi ses plus intimés amis, avait quelque chose de moins vif et de moins flatteur que celui de regretter un prince qui nous regrette. Ainsi il goûte à la fois, et toute la douceur d'une si glorieuse récompense, et tout l'honneur d'une abdication plus glorieuse encore. Et vous, César, par votre bonté, vous aurez à jamais prévenu le soupçon de retenir quelqu'un contre son gré.
LXXXVII Il était digne d'un citoyen, digne surtout du père de la patrie, de ne jamais contraindre, et de se souvenir toujours qu'il n'est point de puissance à laquelle on ne préfère la liberté. Il était digne de vous, César, de confier les charges à des hommes qui souhaitent de les quitter, d'accorder, quoique malgré vous, le bienfait de la retraite à ceux qui le demandent, de ne point croire, que vos amis, en cherchant le loisir, ne songent qu'à s'éloigner de vous, enfin, de trouver toujours des hommes à appeler du repos aux affaires, des affaires au repos. Et vous, que le père de la patrie daigne regarder avec bienveillance, entretenez soigneusement l'estime qu'il a pour vous : c'est un soin qui vous regarde, car le prince, lorsqu'il a prouvé par un seul ami qu'il sait aimer avec choix, est justifié d'en aimer d'autres un peu moins. Et comment pourrait-on l'aimer médiocrement, lui qui ne prescrit point de lois dans l'amitié, mais qui les reçoit? L'un veut être aimé présent, l'autre absent : il les aime tous deux de la manière qui leur plaît. L'assiduité n'attire point son dégoût, ni l'absence son oubli. Chacun conserve toujours la place qu'il a méritée et les traits des absents échapperaient plutôt à sa mémoire que l'amitié qu'il a pour eux ne sortirait de son cœur.
LXXXVIII. La plupart de nos empereurs, tyrans des citoyens, étaient esclaves de leurs affranchis (127): ils se gouvernaient par leurs conseils, par leurs caprices, ils n'entendaient, ils ne parlaient que par eux. Par eux, on obtenait la préture, le sacerdoce et le consulat : ou plutôt, c'était à eux qu'il fallait les demander. Vous, vous avez beaucoup d'égards pour vos affranchis, mais vous ne les considérez que comme des affranchis et vous croyez qu'ils sont assez honorés, s'ils passent pour gens de bien. Vous savez que rien ne trahit mieux la petitesse du prince que la grandeur des affranchis. Et d'abord vous n'employez personne qui n'ait mérité d'être distingué, ou par vous, ou par votre père, ou par quelque citoyen recommandable (128). Ensuite, vous les formez chaque jour à ne pas se mesurer à votre fortune, mais à la leur, et ils méritent d'autant mieux notre considération, que nous ne sommes pas forcés de la leur accorder. Est-ce avec justice que le sénat et le peuple romain vous ont nommé le Très-Bon? Il ne fallait point être fort ingénieux, ni prendre bien de la peine pour trouver ce surnom : pourquoi donc ne l'a-t-on pas donné à vos prédécesseurs ? C'est qu'aucun d'eux ne l'avait encore mérité. On n'aurait pas été si longtemps à l'imaginer, si l'on eût trouvé à l'appliquer. Était-il plus désirable d'être appelé L' Heureux, surnom qui se donne à la fortune , et non aux mœurs ? Y avait-il plus d'avantage à être appelé graud , nom qui attire plus d'envie qu'il ne donne d'éclat? Un prince très bon, en vous adoptant, vous a reconnu digne de lui et le sénat a confirmé son jugement, lorsqu'il vous a surnommé le Très-Bon. Ce nom ne vous est pas moins propre que celui que vous tenez de votre illustre père. Le nom de Trajan ne vous désigne pas plus clairement que celui de Très-Bon. C'est ainsi qu'autrefois la frugalité désignait les Pisons, la sagesse les Lélius, la piété les Metellus. Toutes ces différentes vertus sont renfermées dans le nom qui vous a été déféré. Car nul ne peut être estimé très bon, s'il n'est en tous genres de vertus, au dessus de ceux qui ont excellé dans chacune. C'est donc avec justice qu'à tous vos autres titres on a ajouté celui-ci, comme au dessus de tous les autres. Car être empereur, être César, être Auguste, c'est infiniment moins que d'être meilleur que tous les empereurs, tous les Césars et tous les Augustes. Aussi le premier nom sous lequel nous invoquons le père des dieux et des hommes, c'est celui de Très-Bon ; celui de Très-Grand ne vient qu'après. Ce titre vous fait donc d'autant plus d'honneur, que certainement vous n'êtes pas moins le plus grand, que le meilleur de tous les princes. Vous avez acquis un nom qui ne saurait passer à d'autres : porté par un bon prince, il semblerait encore usurpé, donné à un mauvais prince, il ne tromperait personne. Que tous vos successeurs s'en décorent, on reconnaîtra toujours qu'il ne peut appartenir qu'à vous. Comme le nom d'Auguste rappelle celui qui l'a porté le premier, ainsi le nom de Très-Bon ne frappera plus les oreilles des hommes, sans leur, rappeler l'idée de vous et toutes les fois que la postérité sera obligée de donner à un prince le nom de Très-Bon, elle se souviendra de celui qui a vraiment mérité ce titre.
LXXXIX. Divin Nerva, quelle est maintenant votre joie, quand vous voyez celui que vous aviez choisi comme le plus digne, être aujourd'hui le meilleur des hommes, comme il en reçoit le nom! Quel plaisir pour vous d'avoir un fils que l'on vous compare et qui l'emporte sur vous! Car rien ne prouve mieux la grandeur de votre âme, que de n'avoir pas craint de choisir un prince qui vous efface encore en grandeur. Et vous, à qui notre empereur doit le jour, illustre Trajan, (qui avez place au moins entre les héros, si vous ne l'avez pas entre les dieux), quelle satisfaction ne goûtez-vous pas, quand vous voyez un tribun, un guerrier que vous avez- formé, devenu un si grand empereur un si glorieux prince, et que, dans un paisible débat, vous balancez avec Nerva l'honneur de lui avoir donné naissance et l'honneur de lui avoir donné l'empire (129) ! Applaudissez-vous l'un et l'autre du service immense que vous avez rendu à la république. Quoique les vertus du fils aient obtenu à l'un les ornements du triomphe, et à l'autre une place parmi les dieux votre gloire n'est pas moindre, méritée par lui, que si vous l'aviez méritée par vous-même.
XC. Je sais, pères conscrits, que les bons citoyens, et surtout les consuls, doivent être bien plus touchés des bienfaits répandus sur la république, que des bienfaits répandus sur eux-mêmes car s'il est plus juste et plus beau de haïr un tyran, pour le mal qu'il fait à la patrie que pour l'injure qui nous est personnelle, il est aussi plus généreux d'aimer les bons princes pour leurs bienfaits envers le genre humain que pour leurs bienfaits envers quelques hommes. Cependant, puisque l'usage autorise les consuls, après les actions de grâces rendues au nom de la république, à rappeler en leur propre nom ce qu'ils doivent au prince, permettez-moi de m'acquitter de ce devoir pour mon illustre collègue Cornutus Tertullus, autant que pour moi. Pourquoi ne remercierais-je pas pour lui, quand je dois pour lui autant que pour moi-même? quand surtout, dans l'amitié qui nous unit, l'empereur n'aurait pas accordé à un seul les grâces qu'il a faites à tous deux, sans que nous lui eussions été tous deux également redevables. Tous deux, nous avions vu autrefois un tyran, avide des dépouilles et du sang des meilleurs citoyens, massacrer à nos côtés nos plus chers amis (131), et les éclats de sa foudre retentir près de nous. Comme nous nous faisions un honneur d'avoir les mêmes amis, nous nous faisions un devoir de pleurer les mêmes malheurs : nous partagions alors la douleur et la crainte, comme nous partageons aujourd'hui l'espérance et la joie. Nerva crut qu'il devait honorer nos disgrâces : quoique nous fussions peu connus il vit en nous des gens de bien, et voulut nous élever aux charges publiques, regardant comme un témoignage du changement de temps, qu'on vît briller alors ceux qui souhaitaient d'être oubliés du prince.
XCI. Nous n'avions pas encore passé deux ans dans d'importantes et pénibles fonctions (133) quand vous nous offrîtes le consulat, ô le meilleur des princes, le plus généreux des empereurs! Il semble que vous avez voulu ajouter à la gloire d'une si haute distinction, celle de n'avoir pas eu le temps de la désirer ; tant il y a de différence entre vous et ces empereurs, qui croyaient augmenter le prix de leurs grâces par la difficulté de les obtenir! Ils s'imaginaient relever les dignités en flétrissant d'avance, par le découragement, par le dégoût, par des retards aussi pénibles qu'un refus, ceux auxquels ils devaient les accorder. La modestie ne nous permet pas de rappeler ici ce que vous avez daigné dire à notre avantage, quand vous nous avez égalés aux anciens consuls de la république, pour notre amour du bien et notre dévouement aux intérêts de l'État. Nous n'osons pas examiner si c'est avec justice, car il ne nous appartient pas de vous contredire et nous ne pourrions, sans blesser la bienséance, reconnaître que la vérité n'a point manqué à ces éloges magnifiques, dont vous nous avez comblés. Tout ce que nous pouvons dire sur ce sujet, c est que vous méritez de faire des consuls à qui ils puissent convenir. Mais entre tant de bienfaits (pardonnez-nous si nous vous le disons),le plus agréable, c'est que nous vous devions d'être encore une fois collègues. Ainsi le demandait notre amitié réciproque, la conformité de nos goûts et de nos principes, si semblables, - nous pouvons le dire, que la gloire de notre union en est diminuée : car il ne serait pas moins étonnant de nous voir opposés l'un à l'autre, que de voir l'un ou l'autre de nous n'être pas d'accord avec lui-même. Il n'est donc pas extraordinaire que nous nous réjouissions du consulat l'un de l'autre, comme si chacun de nous en avait obtenu un second. S'il y a quelque différence, c'est que ceux qui sont faits consuls une seconde fois ne jouissent que successivement de leurs deux consulats tandis que nous, nous les recevons, nous les exerçons à la fois : chacun de nous jouit du consulat de l'autre; nous sommes,.en même temps, deux fois consuls.
XCII. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans la grâce que vous nous avez faite, c'est que, pour nous donner le consulat, vous n'ayez pas attendu que nous fussions sortis de la charge de préfet du trésor public ; vous avez augmenté une dignité par l'autre, vous ne nous avez pas seulement continué les honneurs, vous les avez doublés et une charge a prévenu la fin de l'autre, comme si c'eût été peu de la suivre. Vous avez eu si bonne opinion de notre intégrité, que vous avez cru ne rien faire contre les règles ordinaires, en ne souffrant pas qu'après avoir exercé une charge très importante, nous demeurassions hommes privés. Ce n'est pas tout, dans votre bonté, vous nous avez portés au consulat la même année que vous ? On verra donc nos noms écrits à la suite du vôtre, et placés dans les mêmes fastes. Vous n'avez pas dédaigné de présider à l'assemblée où nous avons été nommés, et de nous dicter vous-même les formules consacrées. Consuls par votre choix, c'est encore votre voix qui nous a proclamés : nous devions le consulat à vos suffrages dans le sénat, vous avez voulu déclarer notre élection dans le Champ-de-Mars. Et quelle gloire pour nous d'avoir été élus dans ce mois qu'embellit le jour de votre naissance ! Quel honneur que d'avoir à célébrer ce jour, que trois grands évènements consacrent à la joie immortelle du peuple romain ! ce jour qui nous a délivrés d'un très mauvais prince, qui nous en a donné un très bon, et qui en a vu naître un meilleur (134). Vous nous verrez donc montés fièrement sur un char, nous avancer avec une magnificence inaccoutumée, au milieu des auspices favorables, et des transports unanimes, incertains de quel côté ils éclatent avec plus d'ardeur.
XCIII. Ce qui met le comble à tant de grâces, vous souffrez que ceux que vous avez faits consuls le soient en effet. Nul danger, nulle crainte inspirée par le prince ne refroidit, n'abat le courage des consuls. Nous n'entendrons point ce que nous voudrions ne point entendre : nous n'ordonnerons rien malgré nous : le respect dû au consulat lui est conservé tout entier et l'autorité des consuls ne nuira point à leur sûreté. Si cette suprême magistrature perd quelque chose avec nous, ce ne sera pas la faute du siècle, ce sera la nôtre. Car il n'y a aucun obstacle de la part du prince à ce que nous exercions le consulat comme on l'exerçait avant le principat. Comment vous remercier dignement pour de tels bienfaits, si ce n'est de n'oublier jamais que nous avons été consuls et que nous l'avons été par votre choix ? de penser, d'opiner comme il convient à des consulaires, de montrer, par notre zèle à servir la république, que nous croyons que la république existe en effet, de ne lui dérober ni nos conseils ni nos soins, de ne point croire qu'avec le consulat finissent nos devoirs envers la patrie, mais de le regarder comme un lien nouveau qui nous attache à ses intérêts, enfin de croire qu'il nous impose des travaux et des veilles, comme il nous a donné la considération et la dignité ?
XCIV. En terminant ce discours, j'ose vous prier, dieux tutélaires et protecteurs de cet empire, vous surtout, Jupiter Capitolin, d'exaucer les vœux du consul, vous demandant, au nom du monde entier, de veiller sur vos propres bienfaits et d'en éterniser la durée. Vous avez été touchés des imprécations que nous faisions contre un mauvais prince, ne rejetez pas les vœux que nous faisons pour un prince qui lui ressemble si peu : nous ne vous fatiguerons point par leur nombre. Nous ne vous demandons ni la paix au dehors de l'empire, ni la tranquillité publique au dedans, ni une vie exempte de périls, ni des richesses, ni des honneurs. Nous ne formons qu'un simple vœu, qui seul comprend tous les autres, ce vœu c'est le salut du prince. Ce n'est point vous imposer une sollicitude nouvelle. N'est-ce pas vous seul qui l'avez visiblement conservé, lorsqu'il a échappé à la fureur de ce monstre si avide du sang romain? N'est-ce point par votre secours, alors que tout ce qu'il y avait de grand dans la république était ébranlé ou abattu, qu'il a pu se soutenir seul, lui le plus grand de tous par ses vertus? Il a été oublié par un prince barbare, lui qui a fixé les regards d'un bon prince ! Pouviez-vous plus clairement annoncer votre choix, qu'en lui donnant vos honneurs et votre nom, lorsqu'il alla prendre le commandement de l'armée (135). C ' est vous qui par la b ouche de Nerva, l'avez déclaré son fils, c'est vous qui nous l'avez donné pour père, et qui l'avez choisi pour votre grand pontife. C'est donc avec confiance, dieu tout-puissant, que je vous conjure, selon le vœu même du prince, de le conserver à nos neveux et à nos descendants, tant qu'il gouverne l'État dans l'intérêt de tous, et de lui réserver pour successeur un fils qu'il ait formé, et qu'il ait su rendre tel qu'il en choisirait un, s'il l'adoptait. Que si les destinées envient ce bonheur à notre postérité, puissent vos inspirations régler le choix qu'il fera d'un successeur! Puissiez-vous lui en donner un digne d'être adopté dans le Capitole!
XCV. Pour vous, sénateurs, des monuments publics attestent tout ce que je vous dois. Vous avez daigné louer ma tranquillité dans le tribunat, ma modération dans la préture : vous avez tous rendu un glorieux témoignage à ma fermeté dans la défense de nos alliés, dont vous m'aviez confié la cause (136). Enfin vous approuvâtes mon élection au consulat avec de telles acclamations, que je sens quels efforts je dois faire pour remplir, pour soutenir, pour surpasser même votre attente. C'est, je le sais, l'exercice même d'une charge, qui prouve si on la méritait. Daignez seulement seconder mes efforts, et m'accorder votre confiance, s'il est vrai qu'après m'être élevé assez rapidement aux honneurs sous un prince dissimulé, avant qu'il eût fait éclater sa haine contre les gens de bien, je sus m'arrêter tout à coup dès qu'il leva le masque; si j'ai préféré le chemin le plus long pour arriver aux suprêmes dignités, quoique je n'ignorasse pas comment on pouvait l'abréger, si je partage la sécurité et le bonheur qu'offre aux bons citoyens l'époque où nous vivons, comme j'ai partagé dans les temps malheureux leurs inquiétudes et leurs larmes, enfin, si j'aime le meilleur des princes autant que j'étais haï du plus méchant. Fidèle observateur du respect qui vous est dû, je me regarderai toujours, non point comme un consul et un futur consulaire, mais comme un candidat au consulat.
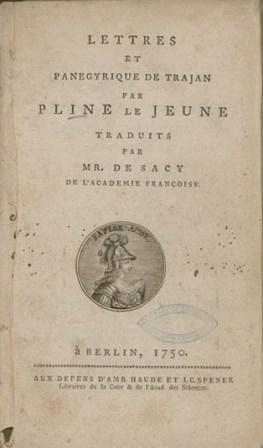 |
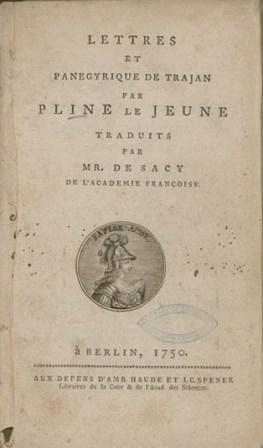 |
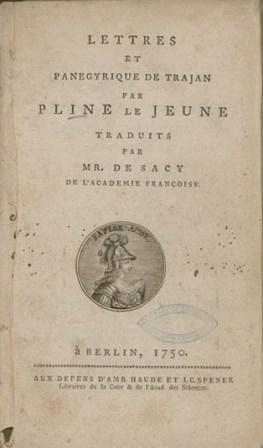 |
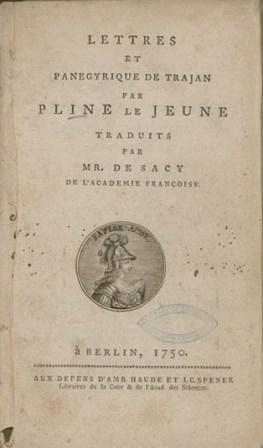 |
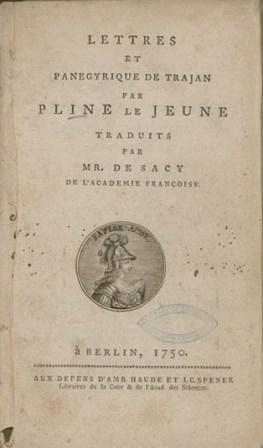 |
|---|
NOTES.
Les notes, en petit nombre, suivies des lettres D. S. sont de De Sacy, ou ont été empruntées du moins aux précédentes éditions de sa traduction Toutes les autres sont nouvelles, et appartiennent à l'édition que nous publions.
1. Pères conscrits. De Sacy a traduit messieurs, appellation trop appropriée aux usages de la société moderne, et qui ne convient pas plus aux sénateurs romains que celle de patres conscripti ne conviendrait aux membres de la chambre des pairs. Ceci rappelle que, dans Shakspeare, Antoine et César sont salués du nom de mylords.
2. C'est Jupiter lui-même qui l'a choisi J'ai adopté la leçon de Gessner comme plus favorable à l'intelligence de la phrase. La leçon commune, suivie par De Sacy, est repertus, electus est, quippe, etc.
3 Sait mettre de la différence. C'est ainsi qu'il faut entendre dilectum. Cicéron a dit dans le même sens, de Offic, I , 41 : Habere delectum civis et peregrini, et de Fin., 1, 10 : Earum rerum hic tenetur a sapiente delectus. Forcellini fait remarquer que, dans ces exemples, dilectus pourrait se mettre à la place de delectus : c'est la leçon d'excellentes éditions et de très anciens manuscrits. Il est certain qu'on trouve plusieurs fois dilectus dans Festus, entre autres au mot lacus : Ut in dilectu, censuve primi nominantur Valerius, Salvius, etc.
4. La beauté d'un efféminé, etc. Domitien se piquait d'être beau, Néron d'être excellent comédien.
5 Comme si ses vertus, etc. Tout ce passage, depuis quid nos ipsi? divinitatem principis nostri, an humanitatem, etc., ne me semble pas avoir été entendu par De Sacy. Il traduit : Nous-mêmes, selon que l'amour ou la joie nous transporte, n'élevons-nous pas jusqu'au ciel, et d'une commune voix, tantôt son air majestueux, tantôt sa douceur, et tantôt sa modération et sa tempérance ? Cette phrase, ainsi entendue, ne se lie plus avec la précédente. Le peuple romain, a dit Pline, sait mettre de la différence entre les princes qui le gouvernent, les applaudissements qu'il prodiguait à la voix ou à la beauté d'un tyran, il les donne aujourd'hui à la valeur, à la religion , à la clémence de Trajan. « Et nous, nous sénateurs, ajoute-t-il, ce n'est plus la divinité du prince que nous célébrons, au lieu de cette flatterie adressée aux Domitien et aux Néron, nous louons la douceur, la modération de notre prince. » Cette interprétation est commandée, avons-nous dit, par la liaison des idées, elle ne l'est pas moins par le texte même, qui porte divinitatem, an humanitatem, et non divinitatem, aut humanitatem.— phrase suivante est ainsi traduite dans De Sacy : qu'y a-t-il d'ailleurs qui convienne mieux à un citoyen et à un sénateur, etc. Je vois là encore un contresens et un défaut de liaison dans les idées. Il est toujours question de la liberté de langage que le peuple et le sénat ont recouvrée sous Trajan. Civile et senatorium se rapportent, non à l'empereur qui reçoit le surnom de très bon, mais à ceux qui le lui défèrent. N'est-ce pas agir en citoyens, en sénateurs d'un état libre, que de donner au prince ce modeste surnom d' Optimus qu'aurait dédaigné l'arrogance de ses prédécesseurs ? Même contresens dans la phrase qui suit : quam commune, quam ex aequo, quod felices nos, felicem illum praedicamus, ne signifie pas, pourrait-on se récrier plus unanimement que nous le faisons sur son bonheur et sur le notre ? mais, n'est-ce pas agir, en quelque sorte, avec notre prince sur le pied d'égalité (ex aequo), que de vanter tour à tour son bonheur et le nôtre ? etc. De Sacy n'a pas senti que, depuis et populus quidem, jusqu'à nisi fuerit, comprecamur, il n'y a qu'une seule et même idée, continuée et résumée dans les deux phrases qui suivent : sentit sibi, non principi dici, et temperamentum omnes in illo subito pietatis calore servavimus.
6. En effet, vous acceptez, etc. La traduction portait : Ce n'est pas vous qui nous obligez à vous rendre cet honneur, c'est nous qui vous contraignons à le recevoir. C'était, je crois, un contresens. « Ce n'est pas moins un trait de modération, dit Pline, d'avoir souffert ici votre éloge, que de l'avoir défendu ailleurs : en effet, en l'acceptant, vous nous donnez une preuve de déférence, vous cédez à notre tendresse, s'il nous est libre de nous taire, il ne vous l'est pas tout-à-fait autant de vous refuser à nos éloges. » Tout cela est bien lié, et je ne sais pourquoi cette phrase a tant exercé les commentateurs. Non a te ipsi tibi honor iste habetur, quand tu permets qu'on te rende de solennelles actions de grâces, ce n'est pas un honneur que tu te rends à toi-même : agentibus habetur, tu le rends à ceux dont tu acceptes l'hommage. Cette explication répond à la question d'Ernesti, sur le sens de a te tibi honor habetur, et rend sa correction inutile : il voulait qu'on lût : Non enim tibi honor iste, sed a te agentibus habetur?
7. « Celui-là s'est fait respecter », etc. Il y avait encore un contresens dans la traduction : « Celui-là s'est attiré le respect par la crainte, disait M. De Sacy, celui-ci l'amour par la douceur. » Il est vrai qu'au lieu de humilitate, il lisait humanitate mais humilitate est le mot propre, comme l'ont bien senti Schwarz et Gesner. Ici, comme dans les phrases précédentes et suivantes, à côté d'une grande qualité, on place le défaut qui en diminue l'éclat.
8. Croyant saluer Jupiter, etc. Il y avait dans le temple une statue consacrée à Jupiter empereur. C'est ce Jupiter que le peuple entendait saluer, et c'est dans cette équivoque qu'est le présage. (D. S.)
9. Par la complaisance d'un mari pour une femme. Auguste adopta Tibère par complaisance pour Livie sa femme, et l'empereur Claude adopta Néron à la sollicitation d'Agrippine.
10. La tutelle du sénat et du peuple romain. Quoique le texte joint à la traduction de De Sacy porte senatum populumque romanum, il avait traduit comme s'il y avait senatus populique romani, les alliés du sénat et du peuple romain. En conservant la leçon des plus anciens manuscrits et des meilleures éditions, j'ai changé la traduction : les empereurs, comme l'a fort bien remarqué Gesner, avaient le sénat et le peuple sous leur direction et leur tutelle, l'expression de Pline est donc juste.
11. Devant le lit sacré de Jupiter. Les païens avaient dans les temples un lit consacré à la divinité qu'on y adorait.
12. L'adoption même les fit naître. Il désigne Pison, adopté par Galba.
13. Pour un de ses fils seulement. Vespasien, en faveur de Titus.
14. Placer le lit sacré dans son temple. Voir la note 11.
15. Nos ennemis qui en désolaient la frontière. Dans le texte, cujus pulsi fugatique se rapporte à imperium, et il faut convenir que pellere et fugare imperium est d'une latinité bien suspecte. J.-F. Gronovius proposait d'ajouter, après contempserant, ces mots : quoniam imperator is.
16. Qu'à des conditions égales. Pourquoi De Sacy a-t-il changé le sens en disant : Nous ne pouvions plus même conclure de trêves à des conditions égales ! C'était une disgrâce et un avilissement pour les Romains de traiter à droit égal avec les autres peuples. Gesner a cité fort à propos, pour appuyer, le sens de cette phrase, les deux passages suivants ( Suet. in Tiber., §. 53) : Sinon dominaris,fitiola, injuriam te accipere existimas; Tacit., Ann., iv, 5a : Ideo laedi, quia non regnaret.
17.Que nous en avons fait un vain plaisir, etc. Je crois que De Sacy n'avait pas entendu la phrase. Il traduit : Que les charmes de la volupté nous rendent les travaux de la guerre insupportables. Il me semble que l'opposition a labore ad voluplatem ne fait que développer l'opposition précédente a manibus ad oculos. Nous n'aimons plus les combats, dit Pline, comme exercice du courage et de la force (labore, manibus), mais comme plaisir des yeux (vo luptatem, oculos). Cette idée est encore reproduite dans la phrase suivante.
18. Pour pénétrer en Germanie, etc. J'ai supprimé dans le texte le mot Hispaniam, ajouté par quelques éditeurs : aucun manuscrit n'offre cette leçon. Les manuscrits et les premières éditions ont Germaniamque mais Schwarz et Gesner ont fort bien remarqué que que pouvait avoir été mis pour quidem, par une abréviation très usitée. J'ai changé aussi tout cet endroit dans la traduction, d e Sacy avait traduit : Vous reçûtes ordre de passer dans la Germanie (phrase qui ne se trouve pas dans le texte), il vous fallait traverser des pays immenses, et marcher au milieu d'une infinité de nations (version languissante et chargée de mots), il vous faudrait franchir les Pyrénées et les Alpes qui semblaient opposer des barrières insurmontables à votre passage. Dans le texte, dirimunt muniuntque a pour sujet plurimae gentes ac prope infinie vastitas interjacentis poli, non moins que Pyrenaeus et Alpes, Trajan était en Espagne quand il fut appelé en Germanie : voilà ce qui explique le détail Pyrenaeus et Alpes muniunt Germaniam.
19. Ce prince efféminé. Domitien.
20. Ce tyran cruel. Eurysthée.
21. Avec autant d'empressement que vous y cherchiez, etc. Bossuet semble avoir imité ce passage dans son oraison funèbre du prince de Condé : « Les campements de César firent son étude. Je me souviens qu'il nous ravissait en nous racontant comme en Catalogne, dans les lieux où ce fameux capitaine, par l'avantage des postes, contraignit cinq légions romaines et deux chefs expe rimentés à poser les armes sans combats, lui-même il avait été reconnaître les rivières et les montagnes qui servirent à ce grand dessein et jamais un si digne maître n'avait expliqué par de si doctes leçons les Commentaires de César. Les capitaines des siècles futurs lui rendront un honneur semblable. On viendra étudier sur les lieux ce que l'histoire racontera du campement de Piéton, etc., etc. »
22. Cet honneur vous est réservé pour l'avenir. C'est, à mon avis, le vrai sens du texte. Pline vient de parler de la gloire future de Trajan : Veniet ergo tempus, etc. Il se sert de cette transition, verumhaec olim in praesentia quidem, etc., pour revenir à l'éloge de la gloire actuelle de son héros. De Sacy a traduit : Mais c'est trop nous arrêter sur le passé, venons au présent.
23. Quelque roi barbare. Décébale, roi des Daces, qui alors menaçait l'empire, et de qui Trajan triompha depuis.
24. Retracées par de vives images, etc. De Sacy a traduit tout simplement : représentées au naturel ; il ajoute : et chacun d'eux, les mains liées, marche ensuite. Cela ne pouvait rester. J 'ai cherché à exprimer l'idée représentée par fercula. Dans son sens le plus général, et conformément à son étymologie (ferre), ferculum dé signe tout objet sur lequel on transporte. Il est employé pour signifier tantôt les plateaux sur lesquels on apportait les mets et les plats d'un service ( PetRoN., xxxv, 66 ; Sueton., in August., 74 ), tantôt les cadres sur lesquels s'élevaient les dépouilles et les images qui contribuaient à la pompe des triomphes (Cic, Offic. 1, 36 ; Suet., in Jul. 37).
25. Vous venez de mériter, par votre modération, etc. Sur les bords du Rhin.
26. Notre corps s'amollir avec notre courage. De Sacy avait traduit : notre courage s'amollit avec notre corps. Ce renversement de la phrase latine m'a paru nuire au sens. La gradation la plus naturelle est ici du moral au physique, de l'esprit au corps. Ces princes se plaisaient à voir s'éteindre l'ardeur des Romains pour la guerre, et leurs corps même s'amollir avec leur courage.
27. Les vertus du général. J 'ai trouvé dans le texte inter imperatorem factum et futurum : j'ai ajouté brevi, me conformant à la leçon de toutes les autres éditions, et vraisemblablement de tous les manuscrits.
28. Vous êtes donc le seul, etc. Rollin admire cette pensée de Pline, dont voici la traduction littérale : Vous êtes le seul à qui il est arrivé d ' être le père de la patrie avant de le devenir. Ne faut-il pas plutôt citer ce trait comme un exemple du faux éclat répandu dans tout son style ?
29. Et la manière même, etc. De Sacy avait traduit : Vit-on jamais entrée plus surprenante et plus agréable ? ce qui n'est pas tout-à-fait le sens du latin : Jam hoc ipsum, quod ingressus es, quam mirum laetumque ! nam priores invehi et importari solebant. Qui ne voit que toute l'idée est dans l'opposition des mots ingredi et invehi? « Cela seul, dit Pline, que vous soyez entré (à pied), est digne d'admiration et d'étonnement car les autres empereurs s'étaient fait ou porter ou traîner. » J'ai rendu, autant que j'ai pu, cette opposition de mots, qui avait tout-à-fait disparu dans la version du traducteur.
30. De le nommer par son nom. C'était l'usage à Rome, pour faire honneur à quelqu'un, de le saluer par son propre nom. (D. S.)
31. D'être auparavant sous votre protection. Le texte dit sous
votre clientelle. Les petits, à Rome, se choisissaient un patron,
dont ils se disaient les clients. (D. S.)
32. C'est qu'il n'était personne, etc. De Sacy n'a pas, ce me semble, entendu cet endroit, il traduit : c'est que le peuple, dans l'impatience d'aller au devant de vous, tombait sur vous. Adstare signifie seulement se tenir auprès comme dans ce vers de Térence (Phorm. , act. v, se. 8 , v. 27 ) : .... ad fores Suspenso gradu ire perrexi ; accessi, adstiti, Animam compressi, aurem admovi. Ordinairement adstare se construit avec une préposition (Cic, pro Arch., 10) : Quum Alexander in Sigaeo ad Achillis tumulum adstitisset. Cependant, la préposition étant renfermée déjà dans le verbe, on peut dire fort correctement adstare aliquem. Priscien (1. 18, p. 1181 du Recueil de Putschius ) établit que adstitit illum locum est aussi latin que adstitit illiloco et que adstitit circa illum locum.
33. Alors seulement. J'ai rétabli tunc dans le texte : c'est la leçon que De Sacy avait adoptée. Dans d'anciennes éditions, dans Schwarz et dans Gesner, on trouve deum tuum, qu'on interprétait en imaginant que Pline avait voulu désigner Nerva. L'expression, ainsi entendue, ne serait-elle pas obscure et forcée ?
34. Que de victimes offertes! De Sacy a lu sans doute augusta, et cependant le texte joint à sa traduction portait angusta, qui a été adopté aussi par Arntzenius et Schwarz.
35. Par un privilège qui vous est propre. Le traducteur avait
omis une partie fort importante de l'idée, solum te : c'est le complément de la phrase précédente, onerasset alium, etc.
36. La fortune, qui a tout changé autour de vous, etc. Au lieu de eademque omnia, j'ai rétabli dans le texte, d'après les meilleures éditions, eadem, quae omnia.
37. Sans paraître sentir l'honneur que vous nous faites. De Sacy avait traduit, comme si vous étiez un de nous : c'est un contresens, contingere emporte une idée de faveur, de bienveillance, ou au moins d'heureux hasard. Vous « vous vous promenez parmi nous, sans paraître savoir que c'est une faveur pour nous. » C'est en ce sens, comme l'a remarqué Gesner, que Martial a dit, XII , 6 : Contigit Ausoniae procerum mitissimus aulae Nerva et que Pline lui-même a dit, c. 14 : Apud eos semper major et clarior, quibus postea contigisses.
38. Vous vous rendez accessible, sans dessein de vous en prévaloir. Je crois cette version plus exacte que celle de De Sacy, et l'on voit bien que ce n'est point par vanité que vous vous familiarisez. Imputet est pris dans le même sens que c. 3g, où il est expliqué par les mots qui l'accompagnent : Ipsum sibi eripere tot beneficiorum occasiones, tam numerosam obligandi imputandique materiam.
39. Et en confondant sur la terre, etc. J'ai adopté humus ista
communis, qui est approuvé par Ernesti. J'ai pour moi Gesner,
Gierig et Arntzenius : il me semble qu'avec leur leçon, le sens est plus clair et la phrase plus naturelle.
40. Quel soin n'avez-vous pas pris, etc. Dans le texte de Schaefer, il y a quantae curae, que j'aime moins que quantaeque curae : les deux phrases me semblent plus convenablement liées par la conjonction.
41. On les attendit. Nous avons laissé dans le texte exspectatus est. Cette leçon nous semble avoir plus de vivacité que exspectatum est provisumque, adopté par plusieurs éditeurs, et entre autres par Schaefer.
42. Le désir d'avoir des enfants. Les Romains donnaient des privilèges à ceux qui avaient un certain nombre d'enfants, et établissaient des amendes contre ceux qui ne se mariaient pas. (D. S.)
43. Il soit à la fois agréable et utile, etc. J'ai lu libeat et expediat. Le texte joint à la traduction de De Sacy portait libeat, expediat.
44. Tant d'autres actions, etc. De Sacy avait traduit : Il est temps dépasser a d'autres actions sans nombre et non moins glorieuses ; ce qui est incorrect et même inexact : car le latin ne dit pas seulement, il est temps de passer à d'autres actions, il exprime le motif qui détermine l'auteur à ne pas s'arrêter plus longtemps sur les traits honorables dont il vient de parler. Ta vie est si féconde en actions glorieuses (numerosa gloria tua), que je suis obligé de passer à l'éloge d'autres faits et d'autres vertus (alio me vocat).
45. Point de faute, etc. Le traducteur avait supprimé cette phrase, je ne sais pourquoi : l'idée se répète dans la phrase suivante mais cette reproduction de la même idée sous des formes variées est un des traits caractéristiques du style de Pline le jeune, et il faut bien se garder de l'effacer.
46. Nés d'une honnête famille. Le texte dit ingenuorum: c'était proprement ceux dont l'aïeul était de condition libre. (D. S.)
47. Et il ne se montrait pas, etc. Tel est le sens de civilius, comme dans cette phrase de Suétone (Tiber., c. II ) : Genus vitae civile admodum instituit, sine lictore aut viatore gymnasia obambulans et ces vers d'Ovide ( Trist., IV, élég. 4 , v.13 ) : Ipse pater patrie, (quid enim civilius illo?) Sustinet in nostro carmine saepe legi. De Sacy a donc traduit mal-à-propos, et il ne rendit pas ce service à la république avec plus de douceur, il n'y apporta pas plus d'application, de sagesse et de soin. Observez qu'il y a encore un contresens dans la seconde partie de cette phrase : elle se rapport ex clusivement à Trajan. Pompée, citoyen d'une république, n'a pas plus respecté la liberté républicaine en rendant tant d'importants services à la patrie, que Trajan, empereur, qui a tout fait par l'ascendant de ses vertus et de sa sagesse, sans avoir recours à la force des armes et aux ordres absolus.
48. Qu'il avait coutume d'inonder. J'ai rétabli dans le texte mergi palanti amne, fourni par plusieurs manuscrits et plusieurs anciennes éditions. D'autres portent mergi repararique amne, qui s'entend fort bien. Gesner et Schaefer ont réuni les deux leçons, mergi repararique palanti amne. J'ai cru devoir m'en tenir à celle que De Sacy a adoptée pour sa traduction.
49. Déporter dans son fleuve et ses vaisseaux, etc. De Sacy avait lu in suis manibus, et avait traduit de tenir en ses mains et dans le sein de son fleuve, etc. J'ai préféré in navibus, qui est approuvé par la plupart des commentateurs, et qui offre un sens plus naturel.
50. Elle ne rougissait pas moins, etc. Au lieu de qua torquebatur, j'ai lu, avec les meilleurs critiques, quam torquebatur, qui présente un plus beau sens.
51. Quel autre fleuve, etc. Juste Lipse lisait à tort alius annus : j'ai changé cette leçon en alius amnis, que De Sacy avait d'ailleurs adopté pour sa traduction.
52. La malignité. Le texte joint à la traduction de De Sacy porte nec benigna mais il a traduit comme s'il y eût eu nec maligna : cette dernière leçon est celle de toutes les bonnes éditions.
53. Et contraindre le Nil, etc. Ernesti et Gesner ont suspendu le sens après obsequens Nilus, et j'avoue que je regarde cette leçon comme la seule admissible : obsequens Nilus complète l'idée de nec maligna tellus, et les deux parties de cette phrase correspondent parfaitement aux deux parties de la phrase précédente, quibus de campis et alius amnis. Schaefer, qui a suivi la ponctuation de Gesner, voudrait cependant que Nilus fût répété.... et obsequens Nilus : Nilus Aegypto quidem, etc. Mais il faudrait que cette répétition fût autorisée par les manuscrits.
54. Par un échange de richesses. De Sacy a lu ae ternis commeatibus, et a traduit en conséquence par les nœuds d'une perpétuelle correspondance. J'ai lu alternis avec Juste Lipse, Gesner et Ernesti : l'ensemble des idées demande cette leçon, elle est d'accord avec in vicem, avec societatis atque permixtis.
55. Esclaves d'une liberté, etc. J'ai suivi la leçon de Gesner, qui m'a paru pleine d'élégance et d'énergie : servire libertati est une fort belle expression, qu'il faudrait introduire même quand elle ne serait qu'une conjecture. De Sacy et la plupart des commentateurs, ont lu libertate.
56. Ce tyran = Domitien.
57. A la vue de la mer même. Il y avait dans le texte de De Sacy et apud illum, ipsum mare. Je n'entends pas cette leçon, et je ne la trouve nulle part. J'ai suivi l'édition de Schaefer.
58. Ne sont plus remplies que de délateurs. Racine s'est emparé de cette idée (Britannicus , act. 1, scèn. 2) : Les déserts, autrefois peuplés de sénateurs, Ne sont plus habités que par leurs délateurs.
59. Leur visage impudent. J'ai trouvé dans la traduction, leur visage livide : ce n'est pas le sens de exsanguem frontem. Exsanguem expliqué par le mot suivant, ferream, signifie évidemment, qui ne sait pas rougir. Racine a dit encore dans le même sens (Phèdre, act, III, scèn. 3), un front qui ne rougit jamais.
60. Qu'ils apprennent à craindre, etc. De Sacy a lu spectent, j'ai préféré, avec Schwarz, exspectent.
61. Eut ajouté à l' édit de Titus, etc. Voici le texte joint à la traduction de De Sacy : Id hoc magis arduum fuit, quod imperator Nerva, te filio, te successore dignissimus, perquam magna quaedam edicto Titi adstruxerat nihilque reliquisse, nisi tibi, videhatur, qui tam multa, etc. J'ai changé, d'après Schaefer, plusieurs détails de ce passage, c'est, je crois, au profit du sens et de la latinité.
62. Semblable au soleil. Au lieu de ut sol, ut dies, j'ai adopté la leçon des meilleures éditions, ut sol et dies.
63. Le dieu qu'on y adore. Le trésor public était dans le temple de Saturne.
64. Celui du vingtième, etc. C'était un impôt qui assujétissait
celui qui recueillait une succession à en payer la vingtième partie
au fisc. L'empereur Gratien l'abrogea.
65.Par une loi particulière, etc. Il y a dans le texte: Non seu perLatium in civitatem, seu bénéficia principis venissent. Les Latins avaient obtenu le droit de cité mais ce droit, acquis par leurs services et leur fidélité, ne fut jamais aussi étendu que celui dont jouissaient les citoyens de Rome, et on distingua toujours jus Latii de jus dvitatis.
66. Un bienfait éclatant, etc. Le traducteur avait supprimé cette phrase, sans doute parce que l'idée se reproduit dans les développements qui suivent mais je répète que c'est la manière propre de l'écrivain latin , et qu'il faut la conserver.
67. Et pour ainsi dire mutilées. C'est le sens de laceras. Les membres d'une même famille, dit Pline, étaient divisés et séparés l'un de l'autre : Trajan a su les rassembler, les réunir, et ainsi recréer et ressusciter ce corps si cruellement mutilé. De Sacy a traduit laceras par « anéanties » ce qui n'est pas d'accord avec l'ensemble de la comparaison et l'image du texte latin.
68. Vous êtes frère et sœur, etc. Les manuscrits et les éditions
ne s'accordent pas sur cet endroit ; les uns portent sorores estis et
frater, avus et nepotes, les autres, sorores estis et frater, avi et
nepotes. Gierig a suivi la conjecture d'un critique, qui voulait
qu'on lût soror estis et frater, avus et nepos. J'ai gardé le texte
de De Sacy. Je ne crois pas, au reste, que ce traducteur ait bien compris la phrase, voici sa version : Que vous manque-t-il
donc pour jouir des droits attachés à ces titres, et que vous avez
de vous-même? Le latin dit bien plus : «Pourquoi demander a un
homme ce que les dieux vous ont donné? Vous êtes sœur et frère
par la nature, pourquoi demander à être sœur et frère? »
69. Que l'on jouisse désormais, etc. Le texte joint à la version de De Sacy portait cujuscunque modica pecunia ex hereditate alicui obvenerit, je l'ai corrigé d'après Schaefer : du reste, les deux leçons présentent le même sens. Cependant De Sacy, d'après une autre leçon assez répandue (cujuscunque modi ea pecunia ex hereditate alicujus obvenerit), avait traduit : A quelque somme que montent les biens de la succession, quand il les aura employés de la sorte, il n'aura point de recherche à craindre. Cette idée ne se lie nullement avec les précédentes : elle est même tout-à-fait fausse car si la succession passait une certaine somme, l'héritier, eût-il voulu l'employer tout entière à honorer son bienfaiteur, n'en était pas moins obligé d'en payer avant tout le vingtième au trésor.
70. Vous nous avez mis en quelque sorte au même état, etc. Malgré le sens que De Sacy avait adopté, on avait admis dans le texte : quod non esset postea debiturus, id est, effecisti ne, etc.
71. Il faudrait vous demander, etc.; et non pas, comme on l'avait traduit, peu s'en faut que je ne vous demande : c'est à l'État que Trajan doit rendre compte du maniement des deniers publics. Videris interrogandus, il semble qu'on doive vous citer pour ré pondre sur votre administration : ce qui s'accorde très bien avec la première phrase du chapitre, feres curam et sollicitudinem consularem.
72. Les lois Voconia et Julia. (Voyez Cic, Verr., 1, 42 , et TACITE., Annales .,III ,25.)
73. Tantôt pour avoir été désigné, etc. Cette partie de la phrase ne se trouvait pas dans la traduction de De Sacy, son texte portait seulement : nec unus omnium nunc quia scriptus heres. C'est du moins ce qui est affirmé dans une note placée au bas du texte joint à sa traduction.
74. Et ce fut votre excuse, etc. De Sacy traduisait, d'après un autre texte : quoique l'adoption seule, et non votre ambition, vous en eût chargé. Au lieu d' adoptati, j'ai lu avec Gesner et Schae fer, adoptanti, que portent la plupart des manuscrits, et qui forme d'ailleurs un sens plus naturel.
75. Les mœurs d'un seul homme, etc. Nous n'avions ici, pour
bien traduire, qu'à copier Massillon, qui semble avoir imité tout
ce morceau dans son premier sermon, sur les exemples des grands
(Petit carême, premier sermon). Claudien a dit aussi (IV Consul.
Honor., v.299 ) : Componitur orbis Régis ad exemplum ; nec sic inflectere sensus Humanos edicta valent, ut vita regentis.
76. Abolir le spectacle des pantomimes. Néron exila ceux qui cabalaient pour ou contre les pantomimes, et les pantomimes eux-mêmes, qui excitaient ces factions ( Suet. in Ner.,XVI ). Domitien défendit le théâtre aux histrions, et ne leur permit de jouer que dans les maisons particulières ( Suet. in Domit.,VII ).
77 . Sous la rougeur de son front. (Voyez Suétone, Vie de Domitien, c.XVIII.)
78. Les mystères d'une superstition étrangère. On a pensé que Pline désigne ici les mystères de Cybèle et de Bellone, dont il est parlé dans Juvénal, sat. VI, v. 511 et suivants, ou peut-être les Agapes ou festins des chrétiens de la primitive Église. Quant à l'expression qui sait, la licence indécente, elle est justifiée par des détails que Suétone nous a transmis. C'est ainsi qu'il dit (Vie de Tibère, c. XLII ) que les convives, étaient servis par de jeunes filles nues.
79. Un maître qui les connaît. Le texte joint à la traduction de De Sacy portait domini non servientis : c'est la leçon de Gierig. De Sacy avait traduit d'après celle que nous avons rétablie, et qu'approuvait Ernesti.
80. Vous ne prétendez pas, etc. Le texte portait non sis adeptus : j'ai suivi la leçon de Schaefer.
81. Néron a trouvé des vengeurs. Suétone (Vie de Domitien, c. 14).
82. Aux jeux. De Sacy avait traduit aux débauches, admettant sans doute dans le texte comessassionibus , au lieu de commissionibus. (Voyez, sur le sens de commissio, Cic. ad Attic., xv, 26 ; Macrob. , Saturn., II , 7; Suét., Vie de Calig., c. 20, et Pline lui-même, VII , 24.)
83. Nous désignions plusieurs de nos mois, etc. Outre Jules César et Auguste, qui avaient laissé leurs noms à deux des mois de l'année, Caligula, en mémoire de son père, avait voulu donner celui de Germanicus au mois de septembre ( Suét ., c. i5); Néron avait imposé le sien au mois d'avril ( Suét ., c. 55); Domitien avait à la fois donne ceux de Germanicus et de Domitien aux mois de septembre et d'octobre. Voyez aussi Martial., IX,2, et Macrobe, Saturn., I , 12.
84. A nous, puisque, etc. Dans les éditions anciennes, le texte porte seulement ae rario prodes , quod sumptibus, etc. C'est d'après cette dernière leçon que De Sacy avait traduit, j'ai suivi l'édition de Schaefer.
85. D'ailleurs, dès qu'un homme, etc. Cette phrase, omise par De Sacy, l'est aussi dans beaucoup d'éditions.
86. Ce sera votre histoire la plus fidèle. Voilà encore une idée que Bossuet semblerait avoir empruntée à Pline le jeune, si l'on pouvait croire que l'homme de génie n'ait pas dédaigné d'imiter quelquefois l'homme d'esprit Bossuet dit : « que la seule simplicité d'un récit fidèle pourrait soutenir la gloire du prince de Condé. »
87. Parce qu'il vous était déféré, etc. Trajan avait exercé son premier consulat sous Domitien, l'an de Rome 843, il exerça le second l'an 85o, sous Nerva, qui l'avait adopté.
88. On en a vu même. Néron, par exemple. (Voyez Suét., Vie de Néron, c.XLIII .)
89. Qui furent nommés, etc. C. Marins, Jules César.
90. De ce prince. Domitien, qui fut consul dix-sept fois, dit Suétone, c.XIII.
91. Pour la troisième fois. Juste Lipse croit que le consul ici désigné est C. Silius Italicus. Les traditions des fastes sur cette époque sont obscures et incertaines.
92. Que le consul ne doit différer. De Sacy avait traduit d'après un texte qui portait seulement quum principem consuli dissimillimum esse deceat. Nous avons suivi la leçon de Gesner et de Schaefer.
93. A parler devant vous. J'ai suivi l'opinion de Juste Lipse et
d'Ernesti, qui préfèrent ici la leçon audi à la leçon communément
reçue, adi. — J'ai admis dans le texte de la phrase suivante une
transposition de mots proposée par Schaefer, et qui m'a paru nécessaire pour l'intelligence de l'idée. Tous les textes portent : senatorem te haberet tantum, an et consulem.
94. A des hommes éminents. Cornélius Fronto et Pomponius Collega, selon l'opinion la plus accréditée. Ils avaient été consuls pour la seconde fois sous Nerva. Voyez le chapitre suivant.
95. Pour réformer les dépenses, etc. Pline a déjà parlé, ép., II , I , de cette commission instituée par Nerva, pour rétablir les finances épuisées par Domitien.
96. Ces longues formules, etc. Les prières, les invocations, les paroles consacrées. La longue cérémonie des comices devait paraître dérisoire, lorsqu'on savait d'avance que c'était le prince qu'il fallait élire.
97. Rapprends donc. Le texte joint à la traduction de De Sacy porte ego. De Sacy a traduit d'après une autre leçon, quod ergo, je l'ai rétablie ; c'est d'ailleurs celle de l'édition de Schaefer.
98. Tous les princes, etc. Par exemple, Tibère et Néron.
99. Est moins à redouter. De Sacy a traduit d'après la leçon, ut felicius esset, proposée par Juste Lipse. Nous l'avons rétablie, comme plus claire et plus naturelle que l'a leçon commune, ut facilites esset.
100. Pour le salut du peuple. J'ai encore adopté le texte suivi par De Sacy, salute civium, qu'on a remplacé sans motif suffisant par salute principum.
101. Ont été conçus pour vous. De Sacy traduisait ont été conçus par votre ordre : il lisait sans doute pro imperio vestro. Cependant tous les textes portent imperio nostro. Gesner a remarqué que pro imperio nostro se rapporte assez mal à la formule qui suit, si bene.... rexeris. Il propose de lire pro imperatore nostro, et j'ai admis sa leçon. Les abréviations usitées dans les manuscrits rendent sa conjecture très naturelle. Le copiste aura écrit imp., qui aura été traduit par imperio, au lieu de l'être par imperatore.
102. Les vœux, etc. Les imprécations secrètes que l'on forme contre les mauvais princes. (D. S.)
103. Ils ne fussent pas écoutés. Il y a dans le texte : ne debeat, c'est-à-dire que la république n'ait pas à s'acquitter envers les dieux, que ses vœux ne soient pas écoutés.
104. C'est à lui. Dans le texte joint à la traduction de De Sacy, il y avait cujus intentio est. Intentio n'est pas dans les manuscrits, et n'a été ajouté que pour rendre la phrase plus latine : d'autres ont ajouté hoc (cujus hoc est) mais Ernesti remarque avec raison qu'on peut croire qu'au temps de Pline on disait cujus est, ut efficiat, pour cujus est, efficere. C'est ainsi que nous avons vu plus haut, c. 6o,parum est, ut in curiam venias, pour in curiam venire.
105. Créer un revenu, etc. J'ai suivi la leçon de Schaefer, c'est d'après cette leçon que De Sacy paraît avoir traduit, et non d'après celle qui a été mise en regard de sa traduction, in quem ea civitas amplissima reditus, etc.
106. Sur l'attention, etc. J'ai conservé indicium, qui peut s'entendre. La leçon des autres éditions, judicium, a moins de sens : judicium et suffragium offrent à peu près la même idée, et la répétition de principis est dès lors difficile à justifier.
107. N'est-il pas évident. J'ai ajouté, d'après Schaefer et les commentateurs, un mot qui me semble nécessaire à la phrase : et alioquin nihil magis prodesse. Les uns ont adopté liquet, les autres liquebit, dans la phrase précédente, au lieu de deprofuerint, quelques éditeurs ont lu praefuerint, c'est d'après cette dernière leçon que De Sacy avait traduit.
108. J'aime a joindre, etc. J'ai trouvé ut suffrage... inserantur ; mais je me suis assuré que les manuscrits portent ne suffragiis... inserantur. Réduit aux conjectures, j'ai adopté celle de Juste-Lipse : bene suffragiis.... inseruntur.
109. Et sur un terrain égal. Le texte de cette phrase est encore altéré, j'ai suivi la leçon de Gierig, qui m'a paru la plus claire.
110. Comme si leurs jonctions, etc. Je m'écarte si souvent du sens adopté par De Sacy, que je ne puis chaque fois discuter les changements que je crois utiles : il faudrait pour cela développer et multiplier les notes beaucoup plus que je ne me suis proposé de le faire. Le passage qui me donne l'occasion de faire cette remarque, est un de ceux où De Sacy s'est le plus écarté du texte et s'est le plus formellement mépris sur le sens.
111. Qui recommandaient les candidats, etc. Il y avait dans le texte : suffragatorum nomina honore mais, comme on l'a remarqué, ce ne sont point les noms des suffragateurs, c'est-à-dire des sénateurs qui recommandaient les candidats aux princes, mais les noms mêmes des candidats qui étaient accueillis avec faveur, honore quo solent. J'ai donc admis la transposition proposée par Schaefer, en sorte que suffragatorum se trouve lié à honore. Suffragatorum honor, la faveur, les applaudissements des suffragateurs.
112. Le désordre des toges, etc. De Sacy avait traduit fort inexactement : la joie éclatait jusque dans nos gestes et dans tous les mouvements que nous ne pouvions composer. Était-ce même le sens de la phrase ?
113.Même rougeur sur le front. C'est ainsi que Gesner a entendu nunquam frontem abstergeres: «Nunquam perfricares frontem, dit-il, pudorem poneres. Dixit de lacrymis, dixil de pudore : infert de utroque. » D'autres commentateurs lisent contraheres , ou alio sensu demitteres. De Sacy a traduit tout ce passage avec son inexactitude ordinaire.
114. D'en paraître digne, etc. De Sacy disait, d'en être digne, ce qui altérait le sens.
115. Vous avez présidé, etc. Dans l'affaire de Marius Priscus.
(Voyez les Lettres,II, II .)
116. On le voyait aller, etc. Dans l'édition de Schaefer, cette phrase termine le chapitre précédent. J'ai laissé la division établie dans le texte joint à la traduction de De Sacy : elle m'a paru plus naturelle.
117. L'heureux, l'agréable spectacle, etc. J'ai substitué à la leçon latine, pietati..... vicerit celle de Schaefer, erit pietati..... vicerit? qui du reste, avec un autre tour offre le même sens : aussi, en changeant le texte, n'ai-je pas changé la traduction.
118. De surmonter, etc. Au lieu de transferre, que j'ai trouvé dans le texte joint à la traduction de De Sacy, j'ai admis, avec Schaefer, transire .
119. Celui qui, etc. Domitien. ( Voyez Suét . , c. 4 et 19.)
120. Ou de leur alliance. Il y a seulement dans les manuscrits et dans les anciennes éditions, deorum liberos, nec dignitnte nuptiarum. Juste Lipse et tous les commentateurs ont senti que, pour le sens et la symétrie de la phrase, il fallait un membre qui correspondît à deorum liberos. Nous avons adopté generis praestantia, proposé par l'un d'eux.
121. De n'avoir pas su, etc. Le divorce était permis chez les Romains. (D. S.)
122. La femme. Plotine.
123. Si le grand pontife etc. C'était surtout aux pontifes qu'il importait de bien choisir leur épouse car ils ne pouvaient la répudier : « Matrimonium Flaminis, dit Aulugelle (x, 15 ), nisi morte dirimi non jus. » Trajan était alors grand pontife, et c'est lui que Pline désigne par les mots pontifici magno. « Si Trajan, aujourd'hui qu'il est grand pontife, avait à se choisir une femme, il choisirait la sienne. »
124. Votre sœur. Martiana.
125. Ne vous laissez jamais persuader, etc. De Sacy avait traduit : « Ne cessez point de croire que rien n'avilit tant le prince, que la faiblesse de haïr. » Peut-être avait-il suivi un autre texte car son idée n'est pas celle de Pline.
126. A un ami Suburranus. (D. S.)
127. Étaient esclaves de leurs affranchis. Claude était gouverné par Narcisse et Pallas.(Voyer Suét., Claude, XXIX , et Galba,XIV .)
128. Ou par quelque citoyen, etc. Schwrarz a été d'avis de sup primer principum après cuique. Schaefer a suivi son sentiment.
129. Vous balancez avec Nerva, etc. J'ai trouvé dans le texte joint à la traduction de De Sacy, quumaue ei adoptavi. J'ai suivi la leçon de Schaefer, qui est plus correcte et plus intelligible. —La plupart des éditions portent ensuite pulchrius fuisse genuisse talem. Mais Ernesti, Gesner etSchaefer s'accordent à voir une grave incorrection dans pulchrius fuisse ; ils proposent pulchriusne fuerit , que nous avons adopté.
130. Aient obtenu à l' un, etc. ( Voyez les chapitres 11 et 14 du Panégyrique.)
131 Un tyran avide , etc. Domitien exila ou fit mourir Helvidius, Rusticus, Senecion, Mauricus, et d'autres amis de Pline : (Voyez les Lettres, 1, 5, et autres.)
132. Peu connus. Notas est omis, quoique nécessaire. Juste Lipse propose de l'ajouter. (D S.)
133. Dans d'importantes et pénibles fonctions. Voyez Lettres, v,15 .
134. Célébrer ce jour, etc. Où fut tué Domitien, où Nerva fut élu, où naquit Trajan. Selon Suétone (Domit, 17), c'est le quatorze avant les calendes d'octobre, que Domitien fut tué. — Dans la phrase précédente, au lieu de quod eum potissimum mensem attribuisti, j'ai lu, avec Schaefer, quod eum potissimum mensem attribuisti, qui n'a pas besoin d'être changé.
135. En lui donnant vos honneurs et votre nom, etc. Ce fait est expliqué au commencement du Panégyrique. (D. S. )
136. Dans le tribunal, etc. Pline avait été tribun du peuple sous Domitien. (D. S.)—Dans la dépense de nos alliés , etc. (Voy. Let tres, III , 9.)
 |
 |
 |
 |
 |
|---|
Voir aussi "Etude sur Pline le Jeune" de T. Mommsen" (ICI)