Plaute
Stichus
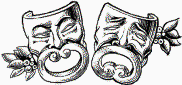 |
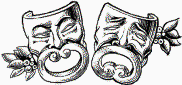 |
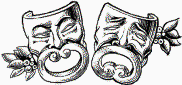 |
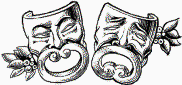 |
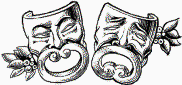 |
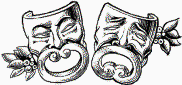 |
|---|
Traduction de J. NAUDET (membre de l'Institut, inscriptions et belles lettres)
PANCKOUCKE, éditeur
1835
AVANT-PROPOS
Stichus est plutôt l'ébauche, le commencement d'une comédie, qu'une comédie véritable. On doit regretter beaucoup que cette pièce n'ait point reçu le développement ni la perfection dont elle était susceptible ; car les sujets pareils sont rares sur la scène latine, et celui-ci pouvait être fécond en situations dramatiques, en peintures de mœurs.
Deux jeunes femmes vivent, depuis trois ans, privées de leurs époux, sans même recevoir de leurs nouvelles ; ils ont entrepris tous deux une expédition de commerce en pays étranger pour réparer leur fortune qu'ils avaient détruite par leurs profusions. Le père de ces jeunes femmes, indisposé contre ses gendres, et usant de son pouvoir sur elles et de la loi qui déclare le mariage annulé après trois ans d'absence et de silence, a formé le projet de dégager ses filles de leurs liens, et de les faire convoler en secondes noces. L'aînée est moins ferme, moins dévouée à son époux, plus passivement soumise à son père que sa sœur cadette. Celle-ci ranime par ses exhortations la foi chancelante de son aînée, et c'est de leur entretien que résulte une exposition claire, naturelle, propre à captiver l'attention du spectateur. L'état des personnages y est expliqué complètement sans qu'il en coûte rien à la vraisemblance du dialogue, et l'on y voit se dessiner un caractère sensible, énergique, noble, dans une position critique entre le malheur de désobéir à un père qu'on respecte et la crainte de trahir un époux qu'on aime. Ces combats, ou cette conciliation des devoirs conjugaux et de la piété filiale, peuvent produire de grands effets, si l'auteur sait ou veut préparer à son héroïne des épreuves assez fortes.
Mais ici notre attente est trompée, et cet exemple servirait mieux qu'aucun autre à nous convaincre que, chez les anciens, on ignorait ou on négligeait l'art de mettre en scène les femmes d'une vie honnête. Dira-t-on que l'austérité de la discipline romaine s'opposait à leur intervention dans des intrigues d'amour, sujet ordinaire de la moderne comédie ? que la gravité des citoyens aurait été blessée s'ils avaient vu leurs épouses, leurs filles traduites en public, eux qui estimaient que la femme la plus honorable était celle dont on parlait le moins ? Les édiles ne défendirent point la représentation de « Stichus » : ainsi donc, comme le prouvent d'ailleurs « l' Asinaire », « la Marmite », « Casine », « la Cassette », « les Ménechmes », « le Marchand », avec « l'Hécyre », « le Phormion », « l'Heautontimorumenos » de Térence, Rome permettait qu'on offrît en spectacle des femmes de citoyens, et même l'intérieur des foyers domestiques. Il est vrai que l'extrême dépendance et l'espèce de minorité dans lesquelles la loi et les coutumes retenaient perpétuellement les femmes, ne permettaient guère d'imaginer des fables comiques où elles prissent une part très active; elles en étaient encore exclues par l'opinion des anciens sur l'amour, dont ils ne comprenaient que les jouissances matérielles, dont ils méprisaient les sensibilités et les délicatesses comme une faiblesse honteuse. Mais ne pouvait-il point y avoir de sujets semblables à celui de « Stichus » où se montrât l'ardeur d'une chaste tendresse, ainsi que les qualités aimables dont les femmes peuvent s'embellir? Plaute ne les a point du tout ménagées quand il s'agit de leurs défauts, de leurs ridicules ; nous voyons par beaucoup de ses pièces que les Romains ne se fâchaient pas des traits de satire lancés contre elles. Ce n'était donc pas un respect jaloux pour la dignité des matrones, qui interdisait à la poésie comique les inventions qui auraient fait porter sur elles en grande partie l'intérêt de l'action ; c'était plutôt un dédain superbe, une prévention brutale du sexe le plus fort contre le plus faible : on aimait mieux rire des malices dont elles étaient l'objet que d'applaudir à leur éloge. Mais les Romains auraient-ils repoussé toute innovation tendant à substituer quelquefois aux tableaux lascifs de la galanterie des courtisanes et aux discours trop souvent obscènes de leurs amants et des marchands qui trafiquaient de leur beauté , des exemples touchants de ces devoirs que la dureté des lois et la pédanterie de la censure leur rendaient plus onéreux que sacrés, et qu'on les autorisait en quelque sorte à venir oublier dans ce même théâtre, où de cyniques voluptés allumaient leurs sens, où des vers impudiques souillaient leurs oreilles ? Faut-il accuser l'auteur de « Stichus », qui ne voulut pas exploiter une mine si abondante dans ce qu'elle avait de plus précieux ? Une disposition à peu près pareille glaça, sous la plume de Térence, le drame de « l' Hécyre ». Pourquoi deux hommes de génie ont-ils traité ainsi de tels sujets ? Grande question d'histoire littéraire, dont la solution touche à l'histoire des mœurs publiques.
Dans la seconde scène de « Stichus », le vieil Antiphon exhorte ses filles à renoncer à leurs époux, puisqu'ils n'ont point donné signe de vie depuis trois années. Mais la discussion se passe en moralités et en épigrammes contre le mariage et contre les femmes ; le père n'est point affermi dans sa résolution, il n'a point de dessein déterminé. Qu'il eût été facile d'imaginer des prétendants riches et amoureux ; de rendre les instances du vieillard plus impérieuses et le danger des deux sœurs plus imminent ! Si l'on imitait chez nous cette fable avec quelques changements à cause de la différence des lois civiles et des bienséances, en supposant de simples fiançailles, un engagement d'amour au lieu d'un mariage déjà contracté, combien les persécutions d'un père ambitieux ou cupide, les importunes assiduités d'un amant odieux, causeraient d'inquiétude, inspireraient de stratagèmes, amèneraient de situations tour à tour plaisantes et pathétiques ! Tel n'était pas le génie de la comédie latine, et surtout celui de Plaute. Plaute, travaillant pour des barbares, s'est fait barbare lui-même , et ressemble à l'homme qui, ayant trouvé un diamant, le jeta pour ramasser de gros fragments de verre. Au lieu de façonner et de polir une matière si heureuse, il remanie des matériaux communs, qu'il a tant de fois mis en œuvre. L'ancien parasite des deux époux, Gélasime, qui les avait aidés à se ruiner, languit de faim et de misère depuis leur départ. Il remplit un monologue de cent huit vers de ses plaintes grotesques et de ses quolibets lamentables. Les gens de goût pouvaient être choqués, les partisans des deux jeunes femmes devaient murmurer d'impatience; mais la foule égayée applaudissait. Si Plaute épargne les incidents propres à émouvoir la passion, il est prodigue de paroles bouffonnes. L'esclave Dinacion ne tarde pas à venir annoncer qu'Épignome, le mari de sa maîtresse Panégyris, est arrivé, en même temps que le mari de l'autre sœur, et qu'ils ont fait fortune tous deux, La nouvelle attendue, désirée si longtemps, semblait assez pressante : Dinacion s'amuse à vanter pompeusement l'importance de son message; il se préfère au héraut Talthybius ; il songe à se préparer pour la course des jeux Olympiques ; il délibère s'il ne lui convient pas d'attendre que sa maîtresse accoure au devant de lui, et qu'elle le supplie de lui faire part de ce bonheur : mais il réfléchit qu'elle ne peut venir le prier, puisqu'elle ignore ce qui se passe. Heureusement ce trait de lumière le décide, et il se résigne en quinze vers à faire la première démarche. L'inévitable parasite se trouve encore là en même temps, et il n'y aurait que pour lui à parler sans le caquet de Dinacion : Panégyris, en revanche, est trop silencieuse. A ce qu'il paraît, les Romains ne demandaient pas de grands éclats de sentiment, ni beaucoup d'éloquence aux amans non plus qu'aux époux dans ces occasions.
Épignome, par exemple, est homme de bon sens; ses discours le prouvent. Il vient d'être fort bien accueilli par le beau-père ; mais il n'est pas sa dupe : toutes ces politesses affectueuses, il sait fort bien que c'est à sa prospérité qu'il les doit. De là, plusieurs maximes très sages sur le culte qu'on rend à la fortune ; mais Épignome n'a pas encore vu sa femme. Je lui voudrais un peu moins de facilité à converser avec son esclave Stichus, qui lui demande une journée entière de liberté pour se réjouir au retour, un peu moins de complaisance malicieuse à écouter les compliments faméliques et les vaines sollicitations du parasite. Cette pièce pouvait être une école de vertus conjugales, d'expériences philosophiques sur la valeur des démonstrations d'amitié prodiguées aux riches et aux heureux. Il semble que Plaute en ait voulu faire le triomphe de la gastronomie. Le parasite, à sa première entrée, parle de repas ; Stichus obtient de son maître en arrivant la permission de foire un bon repas ; le parasite revient demander à Épignome un repas ; lorsque Pamphilippe, le second gendre, paraît, il s'entretient avec son beau-père du repas qu'ils feront chez Épignome ; le beau-père l'invite à un repas pour le lendemain, et Pamphilippe se propose de donner le jour suivant à tous les siens encore un repas. Ces réunions de famille sont fort agréables sans doute, et fort édifiantes dans la vie réelle; mais pour les effets du théâtre, un mari qui aurait voulu s'assurer par quelque épreuve de l'attachement de sa femme, des sentiments de ses proches et de ses amis, et qui aurait feint de revenir pauvre, un mari qui, par un obstacle imprévu, se serait trouvé près de sa femme sans pouvoir lui parler ou sans même oser la voir, aurait donné lieu à des scènes vives, tendres, divertissantes à la fois, et la reconnaissance ou le rapprochement des époux aurait produit un dénoûment plus agréable pour le spectateur, pour le spectateur moderne, s'entend, que l'orgie de Stichus; car nous retombons encore à la fin dans les repas.
Un nouveau spectacle commence : il n'est plus question des sœurs, ni de leur père, ni de leurs époux. Stichus étale aux regards ses plaisirs de table et ses ébats amoureux; il a invité son camarade Sagarinus à souper avec la courtisane Stéphanie, dont les deux amis partagent, de bon accord ensemble, l'amour et les faveurs. Après boire, il se met à danser ; Sagarinus l'imite, puis la belle qui a bu comme eux; ils donnent à boire au joueur de flûte qui réglait la déclamation notée, comme si chez nous, à l'Opéra, les acteurs faisaient boire l'orchestre; la comédie est ainsi tout à coup remplacée par une farce, par un intermède en forme de Bacchanales ; enfin la lassitude met un terme à la danse, et Stichus invite les spectateurs à s'en retourner souper chez eux, bon avis pour qui pouvait en profiter, et à l'applaudir, demande qui eût été mal accueillie autre part qu'à Rome. Cette pièce n'est pas certainement un des essais de la jeunesse de Plaute, c'est une production de sa maturité, ainsi que nous en donnerons plus tard la preuve. Elle en devient d'autant plus curieuse à étudier ; ces imperfections sont volontaires ; ces extravagances ont été calculées par un poète habile, ingénieux : ce fin observateur de l'esprit du public savait ce qu'il pouvait risquer sans péril, et quelles fautes le feraient réussir. Nos réflexions sur la « Cistellaria » trouvent leur confirmation dans la comédie de « Stichus ».
PERSONNAGES.
PANEGYRIS, épouse d'Épignome et sœur aînée de Pinacie,
PINACIE, épouse de Pamphilippe.
ANTIPHON, père de l'une et de l'autre.
GÉLASIME, parasite.
CROCOTIE, servante de Panégyris.
DINACION, jeune esclave de la même.
ÉPIGNOME, frère aîné de Pamphilippe et gendre d'Antiphon.
STICHUS, esclave d'Épignome.
PAMPHILIPPE, gendre d'Antiphon.
SAGARINUS, esclave de Pamphilippe et ami de Stichus.
STÉPHANIE, esclave de Pamphilippe, maîtresse de Stichus.
Le théâtre représente une place publique ; d'un côté est la maison d'Antiphon , de l'autre celle de Panégyris. La scène est coupée de manière que Je spectateur voit une partie de l'intérieur de cette dernière maison, la salle d'entrée, l'atrium, où sont les deux sœurs au commencement de la pièce.
attribué
A PRISCIEN LE GRAMMAIRIEN.
Un vieillard réprimande ses deux filles à cause de leur persévérance à défendre, à ne point délaisser leurs maris, deux frères que la pauvreté a forcés d'aller en pays étranger. De leur côté, elles tâchent de l'apaiser par des paroles convenables, pour qu'il leur soit permis de rester avec les maris qu'il leur a donnés. Ceux-ci reviennent d'outremer après avoir fait fortune; chacun reprend sa femme, et l'on permet à Stichus de se donner une fête.
![]()
Acte I
Scène 1
PANEGYRIS, PINACIE.
PANÉGYRIS.
Pénélope, je le crois, ma sœur, eut l'âme bien en peine, du veuvage qui la priva si longtemps de son mari. Nous pouvons juger de ses sentiments par nous-mêmes car depuis que nos maris sont absents de ce pays, l'intérêt que nous devons leur porter, fait que nous sommes tourmentées jour et nuit de perpétuelles inquiétudes.
PINACIE.
Il faut remplir notre devoir ; nous ne faisons que ce que nous prescrit la vertu. Mais viens, ma sœur ; j'ai beaucoup de choses à le dire au sujet de nos maris.
PANEGERIS
Sont-ce de bonnes nouvelles ?
PINACIE
Je l'espère, du moins, et je le désire. Mais il y a une chose, ma sœur, qui m'afflige cruellement; c'est de voir ton père, notre père, qui passe généralement pour le plus honnête homme de la ville, se conduire en malhonnête homme à présent, et faire à nos maris absents une injure si grande, si peu méritée, en rompant notre union avec eux. Ce procédé me rend la vie odieuse ; il me navre et me flétrit l'âme.
PANÉGYRIS.
Ne pleure pas, ma sœur ; et ne te fais pas toi-même le mal dont ton père te menace. J'ai l'espoir qu'il agira mieux. Je le connais ; ce qu'il en dit n'est que pour plaisanter ; et il ne voudrait pas pour les montagnes de Perse, montagnes d'or à ce qu'on rapporte , faire ce que tu appréhendes. Toutefois, quand même il le ferait, il ne nous appartient pas de nous fâcher; et d'ailleurs ce ne serait pas une injustice. Car voilà trois ans que nos maris ont quitté la maison.
PINACI E.
Oui, comme tu dis.
PANEGYRIS.
Et depuis lors, s'ils vivent, comment ils se portent, où ils sont, ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font, c'est ce dont ils ne prennent pas soin de nous informer, et ils ne reviennent point.
PINACIE.
Es-tu fâchée, ma sœur, parce qu'ils ne font pas leur devoir, de faire le tien ?
PANEGYRIS.
Oui, par Pollux.
PINACIE.
Ah! tais-toi, je t'en prie; garde, garde que j'entende sortir jamais une telle parole de ta bouche.
PANEGYRIS.
Eh, pourquoi ?
PINACIE.
Parce qu'à mon sens, par Pollux, tous les bons esprits se font une loi d'aimer leur devoir, de le remplir. Ainsi donc, ma sœur, c'est moi qui te conseille, quoique tu sois mon aînée, de ne point oublier ton devoir. Et encore qu'ils se conduisent mal, et qu'ils ne nous traitent pas comme ils devraient, cependant, par Pol lux, si nous ne voulons pas nous mettre tout à fait dans notre tort, il faut que le devoir nous soit toujours cher.
PANEGYRIS.
C'est mon avis ; je me tais.
PINACIE.
Mais tache au moins de t'en souvenir.
PANEGYRIS.
Je ne veux pas, ma sœur, qu'on me soupçonne d'oublier mon mari. Les égards qu'il m'a témoignés ne sont pas perdus pour lui. Je lui tiens compte, je lui sais gré, par Pollux, de ses bontés; je suis contente de cette union , et je n'ai pas de raison pour désirer un changement. Mais en définitive, cela dépend de la puissance paternelle. Nous sommes obligées d'obéir aux volontés de nos parents.
PINACIE.
Je le sais, et c'est une pensée qui remplit mon cœur d'amertume ; car il nous a déjà fait entrevoir ses intentions.
PANEGYRIS.
Cherchons donc ce qu'il nous convient de faire.
Scène 2
ANTIPHON, PANEGYRIS, PINACIE.
ANTIPHON, sortant de sa maison et parlant à ses esclaves.
Un esclave qui attend toujours qu'on lui rappelle son devoir, et ne sait pas le faire de son propre mouvement, est un mauvais esclave pour son maître. Vous vous souvenez bien, toutes les calendes, de venir demander la pitance: pourquoi ne pas vous souvenir de même de faire à la maison ce qui est nécessaire? Si tout n'est pas bien, rangé dans les appartements à mon retour, je vous admonesterai par mandement d'étrivières. Il semble que j'habite ici, non avec des hommes, mais avec des cochons. Tâchez, s'il vous plaît, que le logis soit propre, quand je reviendrai. Je serai à la maison tout à l'heure. Je vais chez ma fille aînée; si l'on me demande, vous viendrez m'y chercher ; ou je reviendrai moi-même dans un instant.
PINACIE, continuant à s'entretenir dans l'atrium avec sa sœur.
Quel parti prendre, ma sœur, si notre père s'obstine à nous contraindre ?
PANEGYRIS.
Souffrir ce qu'il lui plaira de faire; il le faut, puisque son pouvoir est le plus fort.
ANTIPHON, qui s'est avancé sur le proscenium représentant la voie publique.
Si elles veulent rester ici plutôt que de passer dans la maison d'un autre mari, qu'elles restent. Ai-je besoin, au bout de ma carrière, de me mettre en guerre avec mes filles ; quand elles ne me semblent avoir rien fait pour cela ? Non, je ne veux pas de disputes. Mais voici ce que je crois avoir de mieux à faire : c'est d'examiner avant tout de quelle manière j'aborderai la question avec elles; si je les attaquerai par des discours détournés, sans avoir l'air de leur faire des reproches et d'avoir rien entendu dire qui leur fût contraire ; ou bien, si je chercherai à les ébranler par la douceur, ou par les menaces. Je m'attends à des débats ; mes filles me sont bien connues.
PINACIE.
C'est en le touchant par nos prières, et non eu lui résistant, qu'il faut, je crois, nous défendre. Si nous demandons à notre père qu'il ait de l'indulgence, nous en obtiendrons, je l'espère. Nous ne pouvons pas lui résister sans un déshonneur, sans un crime énorme. Je ne le ferai point, je ne te conseillerai point de le faire. Mais essayons de le fléchir : je connais son cœur; il n'est pas inflexible.
ANTIPHON.
Voici mon plan ; je ferai semblant d'avoir à leur reprocher un tort; j'userai de détour pour jeter le trouble dans leur âme. Et puis, je leur montrerai ensuite mes vrais sentiments. Il y aura, j'en suis sûr, de longues discussions. Entrons ; mais la porte est ouverte.
PINACIE.
Certainement le son de la voix de mon père est venu à mes oreilles.
PANEGYRIS.
C'est lui, par Castor. Empressons-nous d'aller au devant de lui pour l'embrasser.
(Elles vont à sa rencontre au moment où il entre chez Panégyris.)
PINACIE.
Salut, mon père.
ANTIPHON, d'un ton un peu brusque.
Salut aussi à vous deux. Allons, allons, éloignez-vous.
PINACIE.
Que ce baiser .....
ANTIPHON.
J'ai assez de vos baisers.
PINACIE.
Pourquoi donc, je te prie, mon père ?
ANTIPHON.
Parce qu'ils aigrissent mon haleine.
PINACIE, lui montrant un fauteuil.
Assieds-toi ici, mon père.
ANTIPHON.
Je ne m'assieds pas là. Asseyez-vous-y; moi je m'assiérai sur ce banc.
PINACIE.
Attends, un coussin.
ANTIPHON.
Je te remercie de ton attention; je suis assez doucement comme cela.
PINACIE.
Permets, mon père.
ANTIPHON.
Quelle nécessité ?
PINACIE.
Oui, c'est nécessaire.
AMTIPHON.
Je te cède; maintenant, c'est assez.
PINACIE.
Des filles ne peuvent trop prendre soin de leur père. Qui doit nous être plus cher que toi? et ensuite, que nos époux, auxquels tu as voulu que nous fussions unies?
ANTIPHON.
Vous vous comportez comme doivent faire de bonnes femmes, en conservant pour vos maris absents les mêmes égards que s'ils étaient ici.
PINACIE
L'honnêteté, mon père, nous fait une loi d'honorer ceux qui nous ont prises pour leurs compagnes.
ANTIPHON.
Il n'y a pas ici d'étranger dont les oreilles soient à l'affût de nos discours ?
PANEGYRIS
Personne, que nous et toi.
ANTIPHON
Prêtez-moi attention. Je suis fort ignorant de ce qui concerne les femmes et leur caractère, et je viens comme disciple vous demander des leçons. Comment doivent se conduire les épouses qui se conduisent le mieux? dites-le-moi l'une et l'autre.
PANEGYRIS.
Quelle raison as-tu de venir nous interroger sur la conduite des femmes ?
ANTIPHON.
C'est que je cherche une épouse, par Pollux à présent que votre mère est morte.
PANÉGYRIS.
Tu en rencontreras facilement, mon père, qui ne la vaudront pas, et dont le caractère ne vaudra pas le sien; tu n'en trouveras pas une meilleure, le soleil n'en éclaire pas.
ANTIPHON, à Pinacie.
Mais je t'interroge aussi, comme ta sœur.
PINACIE.
Par Pollux, je sais ce que doit être une femme, si elle est selon le modèle que je me figure.
ANTIPHON.
Je désire savoir comment tu te figures ce modèle?
PINACIE.
Il faut, quand elle sort, qu'elle ferme la bouche à tous les médisants, et qu'elle ne leur donne aucune prise.
ANTIPHON, à Panégyris.
A ton tour, dis.
PANEGYRIS.
Que veux-tu que je te dise, mon père?
ANTIPHON.
A quoi connaît-on la femme douée d'un bon naturel?
PANEGYRIS.
C'est lorsqu'ayant le pouvoir de mal faire, elle s'abstient de faire mal.
ANTIPHON.
Pas mal répondu. ( A Pinacie) A toi maintenant. Laquelle vaut-il mieux épouser, une vierge, ou une veuve?
PINACIE.
Selon mes faibles lumières, entre beaucoup de maux, le moindre mal est ce qu'il y a de moins mauvais. Si l'on peut se passer de femme, qu'on s'en passe ; afin d'être toujours en mesure d'éviter aujourd'hui ce dont on serait fâché demain.
ANTIPHON, à Panégyris.
Quelle est la femme qui te paraît la plus sage?
PANEGYRIS.
Celle que la prospérité n'empêche pas de se connaître, et qui verra sans être découragée sa fortune déchoir.
ANTIPHON.
Par Pollux, je vous ai éprouvées adroitement, pour savoir votre façon de penser. Mais voici l'objet de ma visite, et pourquoi j'ai voulu vous entretenir : mes amis me conseillent de vous reprendre chez moi.
PANEGYRIS.
Mais nous que cela regarde, nous te conseillons le contraire. Car ou il ne fallait pas autrefois, si tes gendres te déplaisaient, nous donner à eux, ou il n'est pas juste à présent, mon père, de nous reprendre en leur absence.
ANTIPHON.
Moi, je souffrirai que de mon vivant vous ayez des mendiants pour maris ?
PINACIE.
Mon mendiant me plaît, comme un roi plaît à sa reine. J'ai le même cœur dans la pauvreté, que jadis au temps de notre opulence.
ANTIPHON.
Vous êtes donc bien attachées à des vagabonds, des mendiants ?
PANEGYRIS.
Ce n'est pas à la richesse, je pense, mon père, que tu m'avais mariée, mais à un époux.
ANTIPHON.
Quoi? vous les attendez, quand ils sont partis déjà depuis trois ans ! Vous devriez bien plutôt passer d'une maison misérable dans une des plus brillantes.
PANEGYRIS.
Il n'est pas raisonnable, mon père, de conduire à la chasse les chiens malgré eux. Quiconque prend une femme malgré elle, épouse une ennemie.
ANTIPHON.
Vous êtes donc toutes les deux résolues à ne point vous soumettre à la volonté paternelle ?
PINACIE.
Nous y sommes soumises car nous ne voulons pas quitter ceux à qui tu nous as données en mariage.
ANTIPHON.
Adieu , je vais rapporter à mes amis la disposition où vous êtes.
PANEGYRIS.
En l'apprenant, ils nous estimeront, je crois, davantage, s'ils sont estimables.
ANTIPHON.
Prenez donc soin de votre ménage du mieux qu'il vous sera possible.
PANEGYRIS.
A la bonne heure ; à présent, tu nous donnes de bons avis. Nous t'écouterons. ( Il soit) Maintenant, ma sœur, entrons.
PINACIE.
Non, je ferai d'abord un tour à la maison. S'il t'arrive des nouvelles de ton mari, fais-moi-le savoir.
PANEGERIS.
Je ne te le laisserai pas ignorer, et tu m'instruiras aussi de ce que tu sauras. ( Pinacie sort.) Holà, Crocotis! va chercher le parasite Gélasime ; amène-le avec toi. Je veux l'envoyer au port pour savoir s'il est arrivé hier ou aujourd'hui quelque vaisseau de l'Asie. J'ai bien un esclave qui s'y tient constamment tout le jour ; mais je veux cependant qu'on aille y voir de temps en temps. Hâte-toi, et reviens sans tarder.
(Panégyris s'en va dans les appartements intérieurs; Crocotis sort de la maison dans la rue ; Gélasime arrive d'un autre côté.)
Scène 3
GELASIME, CROCOTIS .
GELASIME, sans voir Crocotis.
Je soupçonne que j'ai pour mère la faim; car jamais, depuis ma naissance, je n'ai pu me rassasier. Et personne ne témoignera autant de reconnaissance à sa mère, que je n'en ai témoigné à la mienne, bien à mon corps défendant. Car elle me porta dix mois dans son sein ; et dans mon ventre, moi, je la porte depuis plus de dix ans. J'étais tout petit quand elle me portait, ce qui allégea d'autant sa peine, ce me semble; mais ce n'est pas une toute petite faim, moi, que je porte dans mon sein; par Hercule, c'est bien une faim énorme, dévorante. Les douleurs de mes entrailles renaissent tous les jours, sans que je puisse accoucher de ma mère. Je ne sais que devenir. J'ai ouï dire communément que la gestation de l'éléphant durait dix années entières ; la faim , assurément, est de la même race. Car il y a déjà bien des années, qu'elle me tient aux entrailles. Maintenant, s'il est quelqu'un qui veuille faire acquisition d'un plaisant, je suis à vendre avec tout mon costume. Je cherche partout de quoi remplir le vide que je souffre. Mon père me donna dans mon enfance le nom de Gélasime, parce que j'étais déjà plaisant dès l'âge le plus tendre. La pauvreté m'a fait mériter mon nom ; car c'est elle qui m'a contraint à prendre le métier de plaisant: la pauvreté, en effet, enseigne toutes sortes d'industries à celui dont elle s'empare. Mon père m'a dit que j'étais né dans un temps de disette; c'est pour cela, je pense, que je suis maintenant si affamé. Mais tel est en revanche le bon naturel dont notre race fut douée, je ne refuse jamais si l'on m'invite à manger. Il y avait jadis dans la conversation et dans l'usage, des façons de parler qui se sont perdues ; c'est grand dommage, par Hercule, car elles étaient excellentes, à mon sens, et tout aimables : «Viens souper ici; accepte ; il faut que tu promettes ; ne te fais pas prier ; es-tu libre ? je veux que tu acceptes ; je ne te laisserai pas que tu ne viennes. » En place de cette phrase on en a inventé une, par Hercule, qui ne signifie rien, qui ne vaut rien : « Je t'inviterais à souper, si moi-même je ne soupais en ville.» Maudite phrase ! je voudrais, par Hercule, qu'on lui cassât les reins, ou que le menteur crevât, s'il mange chez lui. Ces phrases me contraignent d'adopter le genre de vie des Barbares, et de faire le métier de crieur, pour annoncer ma vente et me mettre moi-même à l'encan.
CROCOTIS, à part.
Voici le parasite que j'allais chercher ; écoutons ce qu'il dit, avant que je lui parle.
GÉLASIME.
Mais il y a ici nombre de curieux impertinents, fort empressés de s'occuper des affaires d'autrui, parce qu'ils n'ont rien à eux, dont ils s'occupent. Apprennent-ils qu'on va faire une vente ; ils accourent, ils s'informent du motif; si c'est pour satisfaire à des créanciers? ou pour faire bombance, ou pour rendre la dot à une épouse dont on se sépare? Tous ces gens-là (quoiqu'ils méritent bien, selon moi, par Hercule, de se donner beaucoup de peine pour avoir du mal), je ne veux pas les retenir, et je proclame tout de suite la cause de ma vente pour leur apprêter de quoi se réjouir (car la curiosité marche toujours de compagnie avec la malveillance) ; voici donc pourquoi je procède moi-même à la criée : j'ai essuyé d'énormes, de déplorables pertes ; je suis ruiné misérablement dans mes serviteurs. Une multitude de franches lipées me sont mortes; de combien de soupers j'ai pleuré le trépas ! Combien de parties à boire et de vin parfumé, combien de dîners j'ai perdus coup sur coup, dans ces trois années! Aussi je dépéris de chagrin et de tristesse ; je suis presque mort de faim.
CROCOTIS, à part.
C'est bien le plus drôle de corps, quand la faim le talonne.
GÉLASIME.
Je suis résolu à faire une vente publique. Il faut absolument que je me défasse de tout ce que je possède. Arrivez, allons, c'est un butin pour qui se présentera. (Aux spectateurs) A vendre, des propos risibles; courage, enchérissez. Qui en veut pour un souper? qui, pour un dîner ? Hercule te soit en aide ! Tu dis un dîner? et toi, un souper? Hein ? tu fais oui? tu ne trouveras nulle part de meilleurs quolibets, je ne permets à aucun parasite d'en avoir de meilleurs. Veut-on encore des frictions à la grecque pour essuyer la sueur, ou d'autres pour adoucir, ou pour désenivrer ? Veut-on des mots subtils, de gentilles flatteries, de jolis mensonges parasitiques, une étrille rouillée, avec une fiole de cuir noircie, un parasite vide pour y serrer les restes? je suis obligé de vendre tout cela au plus vite, pour offrir la dîme à Hercule.
CROCOTIS, à part.
Par Castor, voilà une marchandise qui ne vaut pas grandiose ! la faim s'est attachée à lui jusqu'au fond des entrailles. Je vais lui parler.
GÉLASIME.
Qui est cette femme qui vient à ma rencontre? C'est une servante d'Épignome, Crocotis.
CROCOTIS.
Salut, Gélasime.
GÉLASIME.
Ce nom n'est pas le mien.
CROCOTIS.
Mais si, par Castor, c'est bien ton nom.
GÉLASIME.
Il le fut, précisément; mais je l'ai perdu par le fait. Je m'appelle à présent Ronge-miette, c'est mon nom véritable.
CROCOTIS.
Ah ! tu m'as fait bien rire aujourd'hui.
GÉLASIME.
Quand ? En quel lieu ?
CROCOTIS.
Ici, lorsque tu faisais ta vente.
GÉLASIME.
Oh ! oh ! friponne, tu m'écoutais ?
CROCOTIS.
Une vente bien digne de toi.
GÉLASIME.
Où vas-tu ?
CROCOTIS.
Chez toi.
GÉLASIME.
Pour quoi faire ?
CROCOTIS.
Panégyris m'a dit de te prier très instamment de venir avec moi la trouver à la maison.
GÉLASIME.
Oui-da, par Hercule, j'y cours à toutes jambes. Le festin du sacrifice est-il prêt ? combien a-t-elle immolé d'agneaux?
CROCOTIS.
Elle n'en a pas du tout immolé.
GÉLASIME
Comment? que veuille donc de moi?
CROCOTIS.
C'est, je crois, au sujet d'un emprunt de dix boisseaux de blé, qu'elle veut t'entretenir.
GÉLASIME.
Est-ce pour que je les lui emprunte?
CROCOTIS.
Non, par Hercule, c'est pour que tu nous les prêtes.
GÉLASIME.
Dis-lui que je n'ai rien de prêt à prêter, sinon le manteau que je porte, et une langue qui ne demande qu'à se vendre.
CROCOTIS.
Ah! Tu n 'as pas de langue pour dire : Je donnerai.
GÉLASIME.
J'ai laissé mon ancienne; en voici une qui ne sait dire que : Donne-moi.
CROCOTIS.
Que les dieux te confondent !
GÉLASIME.
Elle t'en souhaite autant.
CROCOTIS.
Eh bien, viens-tu, ou ne viens-tu pas?
GÉLASIME.
Retourne à la maison, dis que je vais venir, dépêche, va-t'en. (Seul) Je suis étonné; pourquoi me demande-t-elle aujourd'hui ? elle qui ne m'a jamais demandé depuis le départ de son mari. Je ne sais ce que c'est. Il faut que j'en coure la chance, et que je voie ce qu'elle veut, Mais voici Dinacion , son petit esclave. Voyez donc ; comme il s'est posé joliment ! il est à peindre. Le drôle, par Pollux, a souvent vidé de petites coupes de vin presque pur très habilement.
Acte II
Scène 1
DINACION, GÉLASIME .
DINACION.
Mercure, le fameux messager de Jupiter, ne porta jamais un plus joyeux message à son père, que celui que je vais porter à ma maîtresse. Mon cœur est tout plein d'allégresse et de plaisir. Il me plaît maintenant de ne m'exprimer qu'en un langage superbe. Certes, j'apporte avec moi tous les charmes de la plus charmante félicité. La joie coule à pleins bords dans mon sein, elle déborde. Anime donc tes pieds, que l'action fasse honneur aux discours. Dinacion, il est en ta puissance d'acquérir estime, louanges et gloire. Soulage ta maîtresse dans sa pauvreté ; couronne les services de tes ancêtres. Elle se tourmente dans l'impatience de revoir son époux Épignome ; comme une bonne épouse, elle l'aime passionnément. Maintenant dépêche, Dinacion; va comme il te plaît, cours selon ton envie, garde-toi d'avoir le moindre égard pour personne. Pousse du coude les gens hors du chemin. Ouvre-toi un libre passage; si un grand te fait obstacle, tout grand qu'il est, heurte, renverse. (Il se met à courir.)
GÉLASIME, à part.
Qu'a donc le folâtre Dinacion à courir de si bon cœur? Il porte une ligne avec un hameçon et un panier de pêcheur.
DINACION, s'arrêtant.
Mais enfin, c'est plutôt à ma maîtresse, je pense, à me prévenir humblement, à m'envoyer des ambassadeurs, des couronnes d'or, un char pour me transporter, car je ne puis pas aller à pied. Je vais donc retourner sur mes pas. Il est bien juste, à mon avis, qu'on vienne me supplier. Croit-on que ce soit une bagatelle, un rien, ce que je sais ? Tel est le bonheur que j'apporte du port, si grande est la joie que j'annonce, que ma maîtresse même, à moins de le savoir, n'oserait pas le demander aux dieux. Maintenant dois-je être si prévenant que d'aller l'avertir ? Je ne veux pas, ce n'est pas de mon devoir. Il me paraît plus convenable, en raison de mon message, d'attendre qu'elle me prie de lui en faire part. Un noble orgueil sied bien à la bonne fortune. (Il fait un mouvement pour retourner au port, puis il s'arrête.) Mais enfin j'y réfléchis; comment peut-elle savoir que je sais la nouvelle? Je ne puis me dispenser de revenir, de parler, de donner des explications, de délivrer ma maîtresse de son chagrin, de mettre le comble aux bons services de mes ancêtres, et de la combler d'aise au delà de ses espérances. J'effacerai les hauts faits de Talthybius, et je puis regarder en pitié tous les messagers. En même temps je me préparerai à la course pour les jeux Olympiques. Mais l'espace me manque ; la carrière est trop courte ; que je me trouve gêné ! (Il s'approche de la maison. ) Eh quoi ! je vois le logis fermé ; je vais heurter à la porte. Ouvrez, qu'on se hâte, que les portes me soient toutes grandes ouvertes, point de lenteur. Quelle négligence à faire leur devoir ! voyez combien de temps on me laisse attendre et frapper ! Est-ce que vous êtes occupés à dormir? ( S' apprêtant à heurter avec violence) J'éprouverai, qui a le plus de force, de la porte, ou de mes coudes et de mes pieds. Je voudrais que cette porte se fut enfuie de la maison, pour qu'elle subît un bon châtiment. Je me lasse à frapper; ( redoublant les coups sur la porte) c'est ton dernier moment.
GÉLASIME, à part.
Je vais lui parler. (Haut) Je te souhaite le bonjour,
DINACION.
Bonjour aussi à toi.
GÉLASIME.
Est-ce que tu es devenu pêcheur ?
DINACION.
Combien y a-t-il que tu n'as mangé ?
GÉLASIME.
D'où viens -tu? que portes -tu? qu'est-ce qui te presse?
DINACION.
Cela ne te regarde pas ; ne t'en mets pas en souci.
GÉLASIME, montrant le panier.
Qu'est-ce qu'il y a là dedans ?
DINACION.
Quelles couleuvres as-tu dans les yeux ?
GÉLASIME.
Pas tant de colère !
DINACION.
Si tu avais quelque discrétion, tu ne m'arrêterais pas.
GELASIME.
Puis-je savoir de toi la vérité ?
DINACION.
Oui ; tu n'auras pas à souper aujourd'hui.
Scène 2
PANEGYRIS, GÉLASIME, DINACION.
PANEGYRIS,
Qui donc, s'il vous plaît, vient briser cette porte ? Où est-il ? ( A Gélasime) Est-ce toi qui te conduis de la sorte? Est-ce toi qui viens chez moi en ennemi?
GÉLASIME, à Panégyris.
Bonjour, je me rends à tes ordres.
PANEGYRIS.
Est-ce pour que tu brises la porte ?
GÉLASIME.
Gronde tes gens; ils sont les coupables. Je venais voir ce que tu me voulais. Vraiment, j'avais: pitié de cette pauvre porte.
DINACION, à part ironiquement.
Aussi le secours ne s'est-il point fait attendre.
PANÉGYRIS.
Qui est-ce qui parle si près de nous ?
DINACION.
C'est Dinacion.
PANEGYRIS.
Où est-il ?
DINACION.
Tourne-toi de ce côté, Panégyris, et laisse un misérable parasite.
PANEGYRIS, voulant lui imposer silence.
Dinacion !
DINACION.
C'est le nom que je tiens de mes ancêtres.
PANEGYRIS.
Qu'y a-t-il ?
DINACION.
Qu'y a-t-il ? tu m'interroges !
PANEGYRIS.
Pourquoi ne t'interrogerais-je pas?
DINACION.
Qu'ai-je à faire à toi ?
PANEGYRIS.
Tu prends un ton bien insolent, mauvais sujet. Parle sur le champ, Dinacion.
DINACION.
Alors délivre-moi de ceux qui me retiennent.
PANEGYRIS.
Qui est-ce qui te retient?
DINACION.
Tu le demandes ? La fatigue s'est emparée de tous mes membres.
PANEGYRIS.
Ta langue, j'en suis sûre, n'est pas prise.
DINACION.
Je suis accouru du port, si vite, si vite, pour te montrer mon zèle.
PANEGYRIS. .
Quelle bonne nouvelle apportes-tu?
DINACION.
Je te fais part d'un bonheur cent fois plus grand que tu n'espères.
PANEGYRIS.
Je suis sauvée !
DINACION.
Et moi, je suis mort, la fatigue a tari la moelle de mes os.
GÉLASIME.
Et moi donc , à qui la faim a dévoré la moelle de l'estomac !
PANÉGYRIS.
Est-ce que tu as rencontré quelqu'un ?
DINACION.
Beaucoup de monde.
PANÉGYRIS.
Mais une personne ? .....
DINACIOIf.
Une foule. Et de tous ceux que j'ai vus, le plus mau vais garnement, le voici.
GELASIME.
Comment ! (A Panégyris) Il y a longtemps que je souffre ses injures. ( A Dinacion) Si tu m'irrites encore !
DINACION.
Par Pollux, tu mourras de faim.
GÉLASIME.
Je ne suis pas éloigné de croire que tu as dit la vérité.
DINACION.
Je veux un appareil de fête. ( Aux gens de la maison) Apportez ici des balais, avec le houssoir, pour que je détruise tout ce travail des araignées, que je déclare non recevables leurs tissus et que je jette à bas toutes leurs toiles.
GÉLASIME.
Les pauvrettes gèleront ensuite.
DINACION.
Quoi ? Penses tu qu'elles sont comme toi? qu'elles n'ont qu'un seul habit ? Prends ce balai.
GÉLASIME.
Je vais le prendre.
DINACION.
Je balaierai par ici, toi par là.
GÉLASIME.
Volontiers.
DINACION.
Qu'on m'apporte un seau d'eau.
GÉLASIME, aux spectateurs.
Il se passe bien de l'élection du peuple pour exercer l'édilité.
DINACION.
Allons, vite, fais de la peinture sur la terre, arrose le devant de la maison.
GÉLASIME.
J'obéirai.
DINACION.
Tu devrais avoir déjà fini. J'ôterai les toiles d'araignées de dessus la porte et la muraille.
GÉLASIME.
Par Pollux, il y a fort à faire!
PANEGYRIS, à part.
Je ne sais pas encore ce que ce peut être; à moins qu'il ne nous vienne des hôtes par hasard.
DINACION.
Garnissez les lits.
GÉLASIME, à part.
Les lits ! j'aime ce début.
DINACION.
Que d'autres fendent du bois, que d'autres vident les poissons que le pêcheur vient d'apporter, et descendent du croc un jambon et un ris de porc.
GÉLASIME, à part.
Ce garçon est plein de bon sens, par Hercule !
PANÉGYRI S.
Tu ne te montres pas, par Castor, assez soumis à ta maîtresse.
DINACION.
Eh, que dis-tu? J'oublie tout pour ne songer qu'à te satisfaire.
PANÉGYRIS.
Alors rends-moi compte de la commission pour laquelle je t'avais envoyé au port.
DINACION.
Je le veux bien. Lorsque tu m'as envoyé au port dès le point du jour, justement le soleil radieux s'élevait au dessus de la mer ; tandis que je m'informe aux douaniers s'il est venu quelque bâtiment de l'Asie, et qu'ils me répondent non, j'aperçois un vaisseau marchand, des plus grands que j'aie jamais vus, je pense ; vent en poupe, voiles déployées, il entre au port. Nous nous demandons les uns aux autres, à qui appartient ce vaisseau, ce qu'il porte ; en ce moment je vois Épignome, ton mari, avec son esclave Stichus.
PANÉGYRIS.
Hé! quoi? Épignome, dis-tu?
GÉLASIME.
Ton époux et ma vie !
DINACION.
Il arrive, te dis-je.
PANEGYRIS.
L'as-tu vu lui-même?
DINACION.
Oui, je l'ai vu, avec bien de la joie. Il apporte beaucoup d'or et d'argent.
P ANÉGYRIS.
Quel bonheur !
GÉLASIME.
Par Hercule, je prends le balai, et je balaierai de grand cœur.
DINACION.
De la laine, de la pourpre en quantité.
GÉLASIME, à part.
Voilà de quoi me garnir le ventre.
DINACION.
Des lits ornés d'ivoire et d'or.
GÉLASIME.
Je m'attablerai superbement.
DINACION.
Et puis, des tentures de Babylone, des tapis de pourpre. Enfin il rapporte beaucoup d'objets précieux.
GÉLASIME.
Par Hercule, qu'il a bien opéré !
DINACION.
Ensuite, pour continuer mon récit, il amène des joueuses de lyre, des joueuses de flûte , des harpistes d'une rare beauté.
GÉLASIME.
Bravo! après boire, je prendrai mes ébats; c'est alors que j'ai l'humeur très badine.
DINACION.
De plus, des parfums de toutes sortes.
GÉLASIME, à part.
Je ne vends plus mes bons mots. Je donne contre-ordre pour la vente ; il m'arrive un héritage. Crèvent les malveillants rechercheurs de ventes publiques ! Hercule, la dîme que je t'avais promise est bien augmentée, je t'en félicite.
DINACION.
Et puis il ramène encore des parasites.
GÉLASIME.
Aie! je meurs, infortuné!
DINACION.
Et des plus amusants.
GÉLASIME.
Par Hercule, je ramènerai la poussière que j'avais balayée.
PANEGYRIS.
As-tu vu Pamphilippe, le mari de ma sœur?
DINACION.
Non.
PANEGYRIS.
Vient-il ?
DINACION.
Oui, on disait qu'il était arrivé. Mais je me suis dépêché de courir ici en avant, pour t'annoncer cette nouvelle tant souhaitée.
GÉLASIME.
Je remets en vente les bons mots que je ne voulais plus vendre. Voilà que mon malheur apprête à rire aux malveillants. Hercule, assurément, pour ta part comme divinité, je ne t'aurais pas traité mal.
PANEGYRIS.
Entre, entre, Dinacion; dis à la maison qu'on m'apprête ce qu'il faut pour le sacrifice. ( A Gélasime) Porte-toi bien.
GÉLASIME.
Veux-tu que je t'aide ?
PANEGYRIS.
J'ai assez de serviteurs chez moi. (Elle sort.)
GÉLASIME, seul.
Pardieu, Gélasime, à ce qu'il me paraît, le sort t'a fait faux bond, s'il y en a un d'absent, et si l'arrivant n'arrive pas à ton secours. J'irai chez moi voir mes livres pour apprendre les meilleures plaisanteries ; car si je ne contrains les autres à me céder la place, je suis perdu sans ressource.
Acte III
Scène 1
ÉPIGNOME, STICHUS; suite de femmes esclaves et de rameurs portant les bagages.
ÉPIGNOME.
Puisque je reviens avec des affaires en bon état, sain et sauf dans mes foyers, je rends grâces à Neptune et aux tempêtes, et à Mercure aussi, qui m'a favorisé dans mon négoce, et qui a quadruplé mon bien par mes profits. Ceux que mon départ chagrina jadis, se réjouiront à présent de mon retour. J'ai déjà vu Antiphon, mon beau-père, qui n'a plus de ressentiment et avec qui je suis rentré en grâce. Considérez, je vous prie, le pouvoir de l'argent. Parce qu'il me voit bien dans mes affaires à mon retour, et rapportant de grandes richesses à la maison, à l'instant, sans médiateurs, là dans le vaisseau, sur le pont, nous nous sommes réconciliés de bonne amitié, et il soupe aujourd'hui chez moi avec mon frère. Car nous relâchâmes hier tous deux dans le même port ; mais mon vaisseau a mis à la voile aujourd'hui avant le sien. Allons, conduis à la maison ces femmes que j'ai amenées, Stichus.
STICHUS.
Mon maître, que je me taise, ou que je parle, je sais que tu dois savoir combien j'ai enduré avec toi de dures épreuves. A présent je voudrais avoir, après tant d'épreuves si dures, cette unique journée pour fêter les Eleuthéries en arrivant à la maison.
ÉPIGNOME.
Ta demande est juste et raisonnable, Stichus. Prends tes ébats pour aujourd'hui. Je ne te retiens pas, va où tu voudras. Je te donne pour boire une cruche de vin vieux.
STICHUS.
Vivat ! j'aurai aujourd'hui ma maîtresse.
ÉPIGNOME.
Dix, si tu veux, pourvu que ce soit toi qui payes. Où souperas-tu aujourd'hui, d'après cet arrangement?
STICHTJS.
J'ai pour maîtresse Stéphanie, ici près, une esclave de ton frère. Je lui ai donné rendez-vous pour souper à frais communs chez son camarade Sagarinus le Syrien. Elle est à la fois la bonne amie de tous deux : nous sommes en partage.
ÉPIGNOME.
Allons, emmène ces femmes à la maison. Je livre à ta disposition cette journée.
STICHUS.
Dis que c'est ma faute, si je ne la tourmente pas de la belle manière. ( Épignome entre chez lui. ) Je vais, par Hercule, en traversant le jardin, passer chez ma maîtresse et prendre possession pour cette nuit; en même temps je donnerai mon écot, et je dirai qu'on fasse le souper chez Sagarinus, ou j'irai moi-même à la provision. ( Aux spectateurs) Ne vous étonnez pas de ce que de pauvres esclaves s'amusent à boire, font l'amour, et s'invitent à souper ; cela nous est permis dans Athènes. Mais puisque j'y pense, plutôt que de m'exposer à quelque fâcherie, leur maison a encore une porte de derrière (la partie de derrière est la plus fréquentée de la maison); j'irai par là nous approvisionner, et par là aussi je rapporterai les provisions en traversant le jardin : il y a un passage de communication. ( Aux esclaves) Marchez, suivez-moi; je gaspille ma journée. (II sort.)
Scène 2
GÉLASIME, ÉPIGNOME .
GÉLASIME, seul.
J'ai consulté mes livres; je suis sûr, autant qu'on peut l'être, de posséder toujours mon roi par mes plaisanteries. Maintenant je viens voir s'il est arrivé du port, afin de le charmer tout d'abord à son arrivée par mes bons mots.
ÉPIGNOME, sortant de chez lui.
C'est Gélasime lui-même, le parasite, qui vient.
GELASIME, ne voyant pas Épignome.
Je suis sorti aujourd'hui sous d'excellents auspices; une belette emportait une souris à mes pieds. Son étrenne était pour moi un présage, il n'y a pas à en douter. Comme la belette aujourd'hui a trouvé sa vie, je ferai de même, je l'espère ; j'accepte l'augure. ( Apercevant Épignome) Eh mais c'est Épignome qui est là. Je vais lui parler. Épignome, que j'ai de plaisir à te revoir! la joie fait jaillir les larmes de mes yeux. T'es-tu toujours bien porté ?
EPIGNOME.
Ma santé s'est constamment soutenue.
GÉLASIME.
Chères et aimables paroles ! que les dieux comblent tes souhaits ! je t'offre le bonjour à pleine bouche. Tu souperas chez moi à l'occasion de ton heureuse arrivée.
ÉPIGNOME.
Je suis engagé ; mais je ne t'en ai pas moins d'obligation.
GÉLASIME.
Promets.
ÉPIGNOME.
Ce que je te dis est vrai.
GÉLASIME.
Ne me refuse pas, allons.
ÉPIGNOME.
Je te dis la vérité.
GÉLASIME.
Tu me feras plaisir, par Hercule.
ÉPIGNOME.
J'en suis persuadé. A la première occasion, j'accepterai.
GÉLASIME.
L'occasion est toute venue.
ÉPIGNOME.
Non, par Pollux, je ne peux pas.
GÉLASIME.
Pourquoi te faire prier? je veux que tu viennes. J'ai je ne sais quoi à te servir.
ÉPIGNOME.
Va, cherche un autre convive pour aujourd'hui.
GÉLASIME.
Non, promets-moi.
ÉPIGNOME.
Je ne me ferais pas prier, si je pouvais.
GÉLASIME.
Moi, par Hercule, il y a une chose que je te promets certainement ; c'est que j'aurai grand plaisir à recevoir, si tu me promets avec certitude.
ÉPIGNOME.
Adieu.
GÉLASIME.
Est-ce décidé?
ÉPIGNOME.
Décidé. Je souperai chez moi.
GÉLASIME.
Puisque tu ne veux pas prendre avec moi d'engagement, veux-tu que j'aille souper chez toi ?
ÉPIGNOME.
Je le voudrais bien, si je pouvais, Mais j'ai aujourd'hui à souper neuf personnes étrangères.
GÉLASIME.
Je ne demande pas une place sur un lit. Tu sais que je suis de ces braves convives qu'on met au petit bout sur un escabeau.
ÉPIGNOME.
Mais ce sont des orateurs du peuple d'Ambracie, qui viennent en ambassade au nom de leur république.
GÉLASIME.
Eh bien, les orateurs du peuple, les personnages honorables occuperont les places d'honneur. Moi chétif, je serai chétivement placé.
ÉPIGNOME.
Tu ne peux pas te trouver en compagnie avec des orateurs.
GÉLASIME.
Je suis orateur aussi, moi, par Hercule; mais cela ne me réussit guère.
ÉPIGNOME.
Je veux que nous mangions demain les restes. Porte- toi bien. (Il rentre chez lui.)
GÉLASIME, seul.
Je suis, perdu, par Hercule, non pas à demi, mais bien complètement. Il y a maintenant un Gélasime de moins au monde. C'est sûr, je ne veux plus désormais m'en fier aux belettes. Je ne connais point de bête en qui on se puisse moins assurer; elles changent dix fois en un jour de demeure : et j'avais pris sur elles mes auspices dans une affaire capitale ! J'y suis résolu, j'assemblerai mes amis pour leur demander suivant quelle loi il me faut à présent souffrir la faim. ................................ (Il sort. )
Acte IV
Scène 1
ANTIPHON, PAMPHILIPPE, ÉPIGNOME.
ANTIPHON , à Pamphilippe d'abord seul présent avec lui.
Que la bonté des dieux me protège, et me conserve mes deux filles, comme il m'est doux, Pamphilippe, de vous voir y toi et ton frère, revenir tous deux dans la patrie avec des affaires en bon état.
PAMPHILIPPE.
Je te demanderais caution, si je ne connaissais, Antiphon, ton amitié pour moi. Maintenant d'après les témoignages que tu m'en donnes, je veux te croire.
ANTIPHON.
Je t'inviterais à souper, si ton frère ne m'avait pas dit , lorsque je l'ai invité, que tu soupais aujourd'hui chez lui. Il aurait été convenable que je vous eusse reçus le jour de votre arrivée, plutôt que de m'engager avec lui ; mais je n'ai pas voulu le contrarier. Je n'ai pas envie toutefois de te faire une simple politesse en paroles ; vous viendrez demain chez moi tous les deux avec vos femmes.
PAMPHILIPPE.
Et après demain, chez moi. Car il m'avait déjà invité hier pour aujourd'hui. Mais ai-je bien fait ma paix avec toi, Antiphon ?
ANTIPHON.
Puisque vous avez prospéré autant que je pouvais le désirer, et comme doivent le faire mes amis, il y a paix et commerce entre nous. Car fais-y bien attention, selon qu'un homme a de la fortune, il a des amis constants; si sa fortune languit et chancelle, les amis commencent à chanceler. La fortune acquiert les amis.
ÉPIGNOME, sortant de chez lui et parlant à quelqu'un dans l'intérieur.
Je reviens à l'instant. ( Il s' avance sans voir son beau-père et son frère. ) C'est un grand bonheur, après une longue absence, lorsqu'on revient dans ses foyers, de ne trouver aucun objet chagrinant. Ma femme, pendant que je n'y étais pas, a si bien gouverné les affaires de la maison, qu'elle m'a rendu le cœur léger et libre de tout chagrin. Mais voici mon frère Pamphilippe; son beau-père l'accompagne.
PAMPHILIPPE.
Comment t'en va, Épignome ?
ÉPIGNOME,
Et toi ? depuis quand es-tu arrivé dans le port ?
PAMPHILIPPE.
Il y a très longtemps.
ÉPIGNOME, montrant Antiphon.
Et depuis, s'est-il adouci à ton égard?
ANTIPHON.
Plus que la mer qui portait vos vaisseaux.
ÉPIGNOME.
C'est-là un de tes procédés ordinaires. Débarquons-nous aujourd'hui les cargaisons, mon frère?
PAMPHILIPPE.
Pas si vite, je te prie. Embarquons-nous plutôt dans les plaisirs, c'est leur tour. Quand le souper sera-t-il prêt ? moi, je n'ai pas dîné.
ÉPIGNOME.
Entre à la maison, tu te baigneras.
PAMPHILIPPE.
Je vais entrer un moment chez moi pour saluer les dieux et ma femme.
ÉPIGNOME.
Elle est là chez nous qui s'empresse à aider sa sœur.
PAMPHILIPPE.
C'est très bien. Je vous retarderai d'autant moins. Dans un instant je serai chez toi.
ANTIPHON à Épignome.
Avant que tu t'en ailles, je veux lui conter devant toi un apologue.
ÉPIGNOME.
Oui da.
ANTIPHON.
Il y avait autrefois un vieillard, comme je suis, qui avait deux filles, comme celles que j'ai ; lesquelles étaient mariées à deux frères, comme les miennes le sont à vous.
PAMPHILIPPE, à part.
Je ne sais, ma foi, où doit aboutir l'apologue.
ANTIPHON, à Pamphilippe.
Le plus jeune possédait une joueuse de lyre et une joueuse de flûte, qu'il avait amenées de pays étranger, comme toi. Mais le vieillard était célibataire, comme je suis à présent.
PAMPHILIPPE.
Continue. Nous avons l'apologue en action.
ANTIPHON.
Alors, le vieillard dit au possesseur de la joueuse de flûte, comme je te dis maintenant ........
PAMPHILIPPE.
J'écoute de toutes mes oreilles, très attentivement.
ANTIPHON.
« Je t'ai donné ma fille pour te procurer des nuits agréables. Il me semble juste à présent que tu me donnes une compagne qui passe la nuit avec moi. »
PAMPHILIPPE.
Qui est-ce qui dit cela? est-ce le vieillard comme toi?
ANTIPHON.
Tout comme je te le dis. « Oui, répond le jeune homme, et même deux, si ce n'est pas assez d'une. Et si deux ne suffisent pas, j'en ajouterai deux autres. »
PAMPHILIPPE.
Qui a fait cette réponse, je te prie? le jeune homme comme moi ?
ANTIPHON.
Précisément, le jeune homme comme toi. Alors le vieillard comme moi : « Si tu veux, dit-il, eh bien, donne s'en quatre; pourvu, par Hercule, que tu y joignes de quoi les nourrir, pour qu'elles ne rognent pas trop ma portion. »
PAMPHILIPPE.
Parbleu, il était bien chiche le vieillard qui parlait ainsi; puisqu'il répondait à une promesse obligeante par une demande indiscrète.
ANTIPHON.
Parbleu, il était bien malhonnête le jeune homme, qui, aussitôt la demande faite, a répondu qu'il ne donnerait pas un grain de blé. D'autant que la prétention du vieillard était juste, par Hercule, ayant donné une dot pour sa fille, de vouloir en obtenir une pour la joueuse de flûte.
PAMPHILIPPE.
Par Hercule, le jeune homme était fin et bien avisé de ne pas vouloir donner au vieillard une maîtresse dotée.
ANTIPHON.
Le vieillard voulait gagner quelque chose sur l'article
des aliments. Mais faute de pouvoir ce qu'il voulait, il accepta aux conditions qu'il pouvait. « Soit fait, dit le jeune
homme. — Je te remercie, dit le vieillard. Est-ce affaire
conclue? J'en passerai, ajouta-t-il, par où tu voudras.»
Mais je vais entrer, et féliciter mes filles de votre arrivée ; ensuite, je me mettrai dans la baignoire, j'y dégourdirai le vieillard, et puis, après le bain, je vous
attendrai tranquillement couché à table. (il sort.)
PAMPHILIPPE.
L'admirable homme qu'Antiphon ! comme il a composé l'apologue, et avec quel art ! le coquin ! comme il veut faire le jeune homme ! On lui donnera une belle dans son lit pour réchauffer sa vieillesse. Car je ne sache pas, par Pollux, à quel autre usage elle pourrait lui servir. Mais qu'est devenu notre parasite Gélasime ? Se porte-t-il bien ?
ÉPIGNOME.
Je l'ai vu, par Pollux, il n'y a pas longtemps.
PAMPHILIPPE.
Comment va-t-il ?
ÉPIGNOME.
Comme un affamé.
PAMPHILIPPE.
Que ne l'as-tu invité à souper?
ÉPIGNOME.
Je ne voulais pas perdre mon bien tout en arrivant. Et voici justement le loup, tandis que nous en parlons. Il se présente avec les dents longues.
PAMPHILIPPE,
Amusons-nous à ses dépens.
ÉPIGNOME.
Tu me proposes ce que je m'étais déjà proposé.
Scène 2
GÉLASIME, PAMPHILIPPE, EPIGNOME.
GÉLASIME, aux spectateurs.
Comme je vous l'avais dit, depuis que je suis sorti d'ici, j'ai délibéré avec mes amis et mes parents; ils m'ont conseillé de mettre fin à mes jours aujourd'hui par la faim. Mais est-ce Pamphilippe que j'aperçois avec son frère Épignome ? Allons vers lui. O Pamphilippe tant souh aité, espérance de mes souhaits, ô ma vie, ô mon bonheur, salut ; que je suis aise de te revoir en bonne santé, revenu de tes voyages sain et sauf dans la patrie.
PAMPHILIPPE.
Salut, Gélasime.
GÉLASIME.
T'es-tu bien porté ?
PAMPHILIPPE.
La santé s'est constamment soutenue.
GÉLASIME.
Par Pollux , j'en suis bien aise. Je voudrais, ma foi, avoir mille boisseaux d'argent.
EPIGNOME.
Quel besoin en as-tu ?
GÉLASIME, brusquement.
Ce serait pour l'inviter à souper, lui , par Hercule, et non pas toi.
ÉPIGNOME.
Tu te fais tort en parlant ainsi.
GÉLASIME, d'un ton radouci, avec empressement.
Je vous inviterais tous les deux.
ÉPIGNOME.
Par Pollux, je t'inviterais avec plaisir, s'il restait de la place.
GÉLASIME.
Invite toujours; debout sur mes pieds, je me fourrerai bien vite quelque chose dans le gosier.
ÉPIGNOME.
Il y a plutôt une chose à faire.
GÉLASIME.
Quoi?
ÉPIGNOME.
Quand les convives seront partis, tu viendras.
GELASIME.
Malédiction sur tes jours !
EPIGNOME
Pour le bain, je veux dire, non pas pour souper.
GELASIME..
Que les dieux te confondent! Et toi, Pamphilippe, dis?
PAMPHILIPPE.
J'ai promis, par Hercule, d'aller souper en ville.
GELASIME.
Comment, en ville ?
PAMPHILIPPE.
Oui, en ville, assurément.
GELASIME.
Peste soit ! Fatigué comme tu es, comment t'avises-tu de souper en ville ?
PAMPHILIPPE.
Tu penses?
GELASIME.
Commande à souper chez toi, et fais dire que tu n'iras pas.
PAMPHILIPPE.
Je souperai chez moi tout seul ?
GELASIME.
Non pas seul ; invite-moi.
PAMPHILIPPE.
Mais ou serait fâché, après s'être mis en dépense pour me recevoir.
GELASIME.
Il est facile de t'excuser. Fais seulement ce que je te dis. Commande à souper chez toi.
ÉPIGNOME.
Ce n'est pas moi toujours, qui lui conseillerai de manquer de parole.
GÉLASIME, à Épignome.
Va-t'en donc. Mais tu crois que je ne devine pas ton dessein? ( A Pamphilippe) Prends-garde à toi, je t'avertis. Cet homme-là convoite ton héritage comme un loup affamé. Tu ne sais donc pas comme on égorge ici les gens, la nuit, dans les rues !
PAMPHILIPPE.
Je dirai à mes esclaves de venir me chercher en plus grand nombre pour me défendre.
ÉPIGNOME, à Gélasime, ironiquement.
Il n'ira pas, il n'ira pas, puisque tu lui conseilles tant de ne pas sortir.
GELASIME, à Pamphilippe.
Ordonne qu'on fasse le souper chez toi promptement pour moi, pour toi et ton épouse. Si tu m'écoutes, par Hercule, tu diras, j'en suis sûr, que je ne t'avais pas trompé.
ÉPIGNOME.
Si tu n'as pas d'autre gala aujourd'hui, tu seras mal régalé, Gélasime.
GÉLASIME, à Pamphilippe.
Est-ce que tu iras souper en ville ?
PAMPHILIPPE.
Je soupe chez mon frère ici près.
GÉLASIME.
Est-ce certain ?
PAMPHILIPPE.
Très certain,
GÉLASIME.
Par Pollux, je voudrais que tu attrapasses un coup de pierre.
PAMPHILIPPE.
Je n'ai pas peur ; je passerai par le jardin, et je n'irai pas dans la rue.
ÉPI GNOME.
Qu'en dis-tu, Gelasime?
GÉLASIME.
Toi qui reçois des orateurs, garde-les.
ÉPIGNOME.
Eh ! mais, par Pollux, cela te regarde.
GÉLASIME.
Puisque cela me regarde, tu n'as qu'à parler, je suis à ton service.
ÉPIGNOME.
Par Pollux, il me semble que je vois encore une place où l'on peut te mettre.
PAMPHILIPPE.
Je suis bien d'avis qu'il en profite.
GÉLASIME, à Pamphilippe.
O lumière de notre cité!
ÉPIGNOME.
Mais il faudrait te tenir à l'étroit.
GÉLASIME.
Entre deux coins de fer, si tu veux. Le peu de place nécessaire à un petit chien pour se coucher, c'est assez de place pour moi.
ÉPIGNOME.
J'obtiendrai cette grâce, viens.
GÉLASIME, montrant la maison d'Épignome.
Ici?
ÉPIGNOME.
Non, mais dans la prison. Car ici, il n'y a rien à gagner pour ton génie. ( A Pamphilippe) Allons, mon frère.
PAMPHILIPPE.
J'irai saluer les dieux, et dans un moment je passerai chez toi.
GÉLASIME, d'un air piteux.
Eh quoi ?
ÉPIGNOME.
Tu m'as entendu, va-t'en à la prison.
GÉLASIME.
Oui, en prison même, si tu l'ordonnes, j'irai.
ÉPIGNOME.
Dieux immortels ! on le ferait monter sur la croix, tout en haut, pour un souper ou un dîner.
GÉLASIME.
Telle est ma nature. Je suis prêt à combattre tout autre adversaire plutôt que la faim. (Il s'approche de Pamphilippe.)
PAMPHILIPPE.
Va-t'en, va-t'en. J'ai assez éprouvé combien tu portes bonheur. Quand tu étais notre parasite, à moi et à mon frère, notre fortune a fait naufrage. Maintenant je ne veux pas que Gélasime le risible devienne Gelasime le rieur à mes dépens. ( sort avec Pamphilippe sort avec Épignome.)
GÉLASIME.
Fuis, fuis de ma présence. (Seul.) Gélatine, considère quel parti tu dois prendre. Moi?—Toi. —Pour
moi ? — Pour toi. Tu vois combien il fait cher vivre; tu
vois comme ont péri les sentiments généreux, les affections bienveillantes parmi les hommes ; tu vois que
les plaisants , les parasites ne font plus rien , et que les
riches eux-mêmes s'en mêlent. Non, par Pollux, on ne
me verra pas vivant jusqu'à demain. Je vais aller chez
moi me charger le gosier d'un breuvage de corde ; je
ne veux pas qu'on puisse dire de moi, que je suis mort
de faim. ( il sort.)
Acte V
Scène 1
STICHUS, seul.
C'est un sot usage, à mon sens, c'est une bêtise qu'on fait toujours, quand on attend quelqu'un, d'aller voir s'il arrive ; ce qui ne hâte pas, par Hercule, sa venue d'un instant. C'est pourtant ce que je fais maintenant, moi qui regarde si Sagarinus arrive, quoiqu'il n'en vienne pas pour cela plus vite. Par Hercule, je me mettrai à table tout seul, s'il ne vient pas. Je vais toujours transporter de chez nous ici la cruche pleine de vin. Ensuite je me mettrai à table ; le jour est déjà comme un vieux qui se meurt. (Il sort.)
Scène 2
SAGARINUS, STICHUS.
SAGARINUS, seul.
Salut, ô Athènes, nourrice de la Grèce; patrie de mon maître, que j'ai de plaisir à te voir! Mais que fait ma bonne amie, ma camarade Stéphanie? comment se porte-t-elle ? Je suis curieux de le savoir. J'avais chargé Stichus de lui souhaiter le bonjour, et de lui dire que j'arriverais aujourd'hui, pour qu'elle fît le souper de bonne heure. Mais voici Stichus lui-même.
STICHUS, sortant de chez Épignome, sans voir Sagarinus.
Tu as été très aimable, mon maître, de faire ce cadeau à ton esclave Stichus. (Il tient une cruche de vin.) O dieux immortels, que de plaisirs je porte là! que de bons rires, que de saillies, que de baisers, de danses , de caresses, d'aimables empressements !
SAGARINUS, appelant.
Stichus !
STICHUS.
Voici.
SAGARINUS.
Que devient-on ?
STICHUS.
Vivat ! mon très-gracieux Sagarinus. ( Montrant la cruche pleine) J'apporte pour moi et pour toi un bon convive, c'est Bacchus. Par Pollux, le rendez-vous est donné pour souper ; on nous laisse la place libre chez vous. Car il y a chez nous un repas. Votre maître est de la partie avec sa femme, et de plus Antiphon. Mon maître y sera aussi. Voici le cadeau qu'on m'a fait.
SAGARINUS.
Est-ce qu'il t'est venu de l'or dans un rêve?
STICHUS.
Que t'importe ? Va vite te rafraîchir au bain.
SAGARINUS, d'un air suffisant, passant la main sous son menton.
Je suis très frais.
STICHUS.
Fort bien. Suis-moi donc, entrons.
SAGARINUS.
Parbleu, je te suis.
STICHUS.
Je veux que nous fassions lessive complète aujourd'hui. Laisse là les mœurs étrangères, montrons-nous habitants d'Athènes ; suis-moi.
SAGARINUS.
Je te suis, ce début me plaît pour ma rentrée à la maison. Bon augure et bonne étrenne s'offrent à moi tout d'abord. (Ils entrent chez Pamphilippe)
Scène 3
STÉPHANIE, seule, sortant de chez Épignome.
Que nul d'entre vous, spectateurs, ne s'étonne en me voyant sortir de là, quand j'habite ici (montrant la maison de Pamphilippe) ; je vous en expliquerai la raison. On m'a fait venir là de chez nous tout à l'heure, lorsqu'on a reçu la nouvelle que les maris des deux sœurs allaient arriver. Nous nous donnons du soin et du mouvement, nous garnissons les lits, nous faisons tous les apprêts. Cependant, au milieu de ces occupations, je n'ai pas négligé mes bons amis, Stichus et Sagari nus, mon camarade ; Stichus a fait les emplettes; pour le reste, j'ai commis à quelqu'un le soin de tenir leur souper préparé. Je m'en vais à présent, et je fêterai mes bons amis à leur retour.
( Elle entre dans la maison de son maître Pamphilippe. )
Scène 4
SAGARINUS, STICHUS.
SAGARINUS.
Allons, marchez, apportez le gala. Je te donne la direction du vin, Stichus. Il faut absolument que notre festin se fasse dans toutes les règles. Par les dieux favorables, nous serons joliment traités en rentrant aujourd'hui dans ces lieux. Je veux que tous ceux qui passeront par ici, soient invités à la fête.
STICHUS.
C'est dit ; pourvu, par Hercule, que chacun apporte son vin. Car de cette offrande magnifique (montrant la cruche) il ne sera fait distribution à personne qu'à nous. Servons-nous réciproquement nous-mêmes sans cérémonie. Le banquet est proportionné à nos petits moyens ; ce sont figues, noix, fèves, olives dans une écuelle, débris de gâteaux de lupin. C'est assez. Un esclave doit être modeste en sa dépense plutôt que fastueux. Chacun se règle selon son bien. Ceux qui ont une maison opulente boivent dans des vases en bateau, dans des tasses, dans des coupes d'or; mais nous, avec nos gobelets samiens, nous vivons cependant; et, selon nos facultés, nous, payons bien notre dette.
SAGARINUS.
De quel côté chacun se mettra-t-il auprès de notre bonne amie.
STICHUS.
Ma foi, prends le haut bout, toi. Et de plus, afin que tu en sois averti, je partage les offices entre, nous. Vois ce qu'il te plaît de prendre, et prends ton emploi.
SAGARINUS.
De quel emploi parles-tu?
STICHUS.
Lequel aimes-tu mieux avoir sous ton commandement, le dieu des fontaines, ou Bacchus? Très certainement Bacchus. Mais pendant que ta maîtresse et la mienne fait sa toilette et se pare, il serait bon de nous amuser entre nous ; je te nomme préfet de notre festin.
STICHUS.
La bonne idée qui me vient à l'esprit ! Mangeons sur des sièges, à la manière des cyniques, et non sur des lits.
SAGARINUS.
Non, non; là dessus en est plus mollement. Mais, notre préfet, pourquoi, en attendant, la coupe reste-t-elle oisive? Vois combien de cyathes nous boirons.
STICHUS.
Autant que tu as de doigts à la main ; comme dit la chanson:
Bois trois ou cinq, Ne bois pas quatre.
SAGARINUS, après avoir versé du vin dans la coupe.
A toi la coupe; verses-y du produit de la fontaine un dixième seulement, je te le conseille. ( Stichus boit et lui rend la coupe; Sagarinus la remplit, et s'apprête à boire.) A votre santé (Aux spectateurs), à notre santé, à la mienne, à la tienne, et puis encore à celle de notre chère Stéphanie.
STICHUS.
Bois donc, si tu veux boire.
SAGARINUS.
Je ne ferai pas attendre. (Il boit.)
STICHUS, regardant la table.
Par Pollux, le repas est complet, si notre amie venait nous rejoindre : elle manque, il ne manque plus qu'elle.
SAGARINUS.
Nous nous en sommes joliment acquittés. ( Remplissant encore une fois la coupe qu'il présente à Stichus) Je t'offre une rasade ; tu as la coupe avec du vin. ( Regardant sur la table) Je voudrais bien un peu de bonne chère.
STICHUS, brusquement.
Si tu n'es pas content de ce qu'il y a, cela ne me fait rien ; prends de l'eau.
SAGARINUS, reprenant la coupe, et après avoir versé.
Tu as raison ; je me moque des friandises. (Il présente la coupe au joueur de flûte, qui accompagnait la dé clamation , placé à un des côtés du proscenium.) Bois, musicien; allons, dépêche. ( Le musicien ne veut pas.) Il faut que tu boives, par Hercule, ne refuse pas. Pourquoi fais-tu la petite bouche ? Tu vois qu'il faut en passer par là ; bois donc. Allons, dépêche-toi. Prends, te dis-je. Ce n'est pas l'état qui le paiera. Cette réserve te sied mal. Ote tes flûtes de la bouche.
STICHUS, à Sagarinus.
Quand il aura bu, tu voudras bien observer mon ordre, ou ordonne toi-même. Il ne faut pas tout avaler comme pour le dernier coup. Nous n'aurons pas d'autre cruche, après, à déboucher. A ce train-là, par Pollux, on en ferait sauter une entière en un clin d'œil.
SAGARINUS, au joueur de flûte, qui lui rend la coupe après avoir bu.
Eh bien donc? quoique tu aies fait le difficile , tu ne t'en es pas mal trouvé. Allons, musicien, à présent que tu as bu, remets tes flûtes à tes lèvres; enfle promptement les joues, comme un serpent. A présent, Stichus, celui qui ne se conformera pas à l'ordre, sera puni par la perte d'une rasade.
STICHUS.
Tu proposes une loi équitable. A des propositions si justes il n'y a pas de refus. Allons, attention ; si tu manques ( montrant la cruche), je prendrai ici l'amende à l'instant.
SAGARINUS.
C'est très bien et très juste.
STICHUS.
Tiens, voilà pour commencer, regarde. (Il chante et danse en même temps.)
C'est charmant, Vraiment, D'aimer à deux de compagnie, De boire au même gobelet, De caresser le même objet ; O l'admirable sympathie! Nous n'avons qu'un cœur, qu'une foi.
Moi c'est toi, toi c'est moi : Deux amants d'une seule amie ! Que je l'embrasse, elle est à toi, Tu l'embrasses, elle est à moi, Et nous vivons rivaux sans jalousie.
SAGARINUS.
Holà ! c'est assez ; je ne veux pas que tu te crèves ; il faut jouer ensemble comme les petits chiens. Veux-tu que nous appelions notre amie? Elle dansera.
STICHUS.
C'est mon avis.
SAGARINUS, appelant.
Ma douce, mon aimable, ma gracieuse Stéphanie, sors, viens trouver tes amours. Tu es assez belle à mes yeux.
STICHUS, d'un air tendre et grivois tout ensemble.
Ah ! très belle en effet.
SAGARINUS.
Que la joie s'augmente dans nos cœurs joyeux par ta présence, par ta vue. A notre retour de la terre étrangère nous soupirons après toi, ma Stéphanette, miel de mon cœur, si notre tendresse t'est chère, si nous te plaisons tous deux.
Scène 5
STEPHANIE, SAGARINUS, STICHUS .
STEPHANIE.
Je vous obéirai, mes délices ; que l'aimable Vénus me soit en aide, comme il est vrai que je serais déjà sortie depuis longtemps avec vous, si je ne me parais pour vous plaire; tel est le génie féminin : une fille galante a beau être lavée, propre, parée, ajustée, elle n'a jamais assez d'ajustements. Il est bien plus facile de dégoûter les amants par une mise peu recherchée, que de les enchaîner toujours par des recherches de toilette.
SAGARINUS.
Que cela est joliment dit !
STICHUS.
C'est Vénus même qui parle par sa bouche. Sagarinus !
SAGARINUS, à Stichus qui fait des contorsions.
Qu'est-ce ?
STICHUS, d'un air amoureux.
J'ai mal partout.
SAGARINUS.
Partout ? tant pis.
STÉPHANIE, s'apprêtant à prendre place sur le lit à table.
De quel coté me pencherai-je !
SAGARINUS.
Du côté que tu voudras.
STÉPHANIE.
Je veux être à tous deux, car tous deux vous m'êtes chers.
STICHUS.
Aie , aie, mon pécule ! C'en est fait, la liberté me fuit.
STÉPHANIE.
Faites-moi place pour me coucher à table, je vous prie, si toutefois je vous plais. Je veux prendre part à ce bonheur avec l'un et l'autre.
STICHUS.
Je meurs.
SAGARINUS à Stichus.
Dis-moi?
STICHUS.
Que veux-tu que je te dise?
SAGARINUS.
Par la bonté des dieux, il faut cependant qu'elle danse, rien ne l'en dispensera. Allons, ma charmante, mon nectar , je danserai avec toi.
STICHUS.
Tu ne m'empêcheras pas ainsi, par Pollux, de sentir une démangeaison.
STÉPHANIE.
Puisqu'il faut que je danse, donnez à boire au joueur de flûte.
STICHUS.
Et à nous aussi.
SAGARINUS, versant du vin pour le musicien.
Tiens, joueur de flûte, cela d'abord; ensuite, quand tu auras vidé la coupe, sans tarder faits entendre, selon ton habitude, un air doux, agréable et lascif, qui nous chatouille jusqu'au bout des ongles. ( A Stichus) Verse de l'eau. ( Au musicien) Tiens, avale. ( Le musicien tend la main avec empressement) Tout à l'heure il refusait de boire; maintenant il accepte avec moins de peine. Tiens. ( A Stéphanie) Prunelle de mes yeux, pendant qu'il boit, donne-moi un baiser.
STICHUS.
Ce n'est que chez les misérables prostituées que l'amant et l'amante se tiennent debout en s'embrassant. (Il vent attirer à lui Stéphanie sur le banc.)
SAGARINUS, le prévenant et embrassant Stéphanie.
Bravo ! bravo ! voila comme on attrape les voleurs. ( Prenant la coupe des mains du joueur de flûte) Quoique tu aies eu de la peine à te décider, cela ne t'a pas fait mal cependant. Allons, enfle tes joues.
STICHUS, au joueur de flûte.
Maintenant quelque chose de tendre. Donne-nous pour notre vin vieux un air nouveau.
SAGARINUS, se mettant à danser.
Quel mignon voluptueux, quel danseur ionien pourrait en faire autant? Si tu l'emportes sur moi dans cette pirouette, j'accepte ton défi pour un e autre. Tiens, fais cela.
STICHUS , dansant à son tour.
Et toi, comme cela.
(Ils dansent et se regardent l'un l'autre alternativement.)
SAGARINUS.
Tra la la.
STICHUS.
Tata.
SAGARINUS,
La la
STICHUS.
Tac.
SAGARINUS.
Maintenant tous les deux ensemble. Je défie tous les baladins mignons ; nous triompherons d'eux, comme le champignon de la pluie. (Après avoir dansé.) Ren trons; c'est assez de danse pour le vin qu'on nous donne. Vous, spectateurs, applaudissez, et allez chez vous faire bombance.
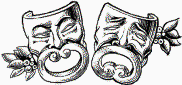 |
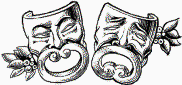 |
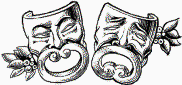 |
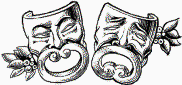 |
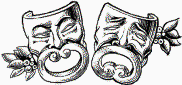 |
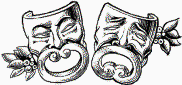 |
|---|