DE LA PROVIDENCE
par
Sénèque
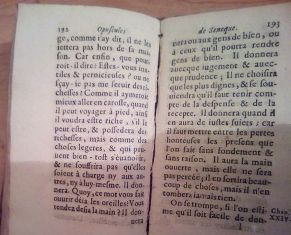
TRADUCTION de M. J. NAUDET
PUBLIÉE PAR C. L. F. PANCKOUCKE. 1833
SOMMAIRE.
\Cet ouvrage est adressé à Lucilius Junior, procurateur de Sicile,
le même que Sénèque a immortalisé en lui dédiant ses Lettres. Le
traité de la Providence paraît avoir été composé sous Néron : les
critiques supposent généralement qu'il formait l'un des livres d'un
ouvrage complet sur la morale, auquel Sénèque travailla dans les
dernières années de sa vie, et dont lui-même parle dans ses lettres cvi, cviii, cix. Lactance, dont les écrits sont si précieux
par eux-mêmes et par les documens qu'ils nous fournissent
sur l'antiquité littéraire, parle en maints endroits de ce grand
traité de morale, dont nous devons regretter la perte : car, s'il
nous était parvenu, nous posséderions en son entier le corps de la
doctrine de Sénèque, et nous aurions plus de moyens de concilier
les contradictions qui se trouvent assez souvent entre ses
différens écrits.
Le livre de la Providence n'est pas un traité général sur cette
grande question, ainsi que paraît l'indiquer son premier titre,
qui, probablement, n'est pas de la main de Sénèque. Sans embrasser
cet immense sujet dans toute son élévation, dans toute son
étendue, l'auteur se borne à justifier les dieux au sujet des maux
dont les gens de bien ne sont pas exempts. C'est ce que porte le
second et sans doute le véritable titre de ce traité : Quare bonis
viris mala accidant, quum sit Providentia? — A toto particulam
revelli placet, comme Sénèque l'exprime lui-même (ch. i).
Cette question de la providence appliquée aux destinées humaines
a exercé les philosophes anciens et modernes, et tous n'ont
présenté que des systèmes incomplets, incohérens, contradictoires.
Les uns ont nié l'existence d'un être supérieur, par conséquent ils
ont nié la providence : les autres en admettant une providence
générale, rejetaient une providence particulière, et laissaient agir les causes secondes : ceux-là ne voyaient partout que la fatalité,
les causes occultes et les effets du hasard. D'autres reconnaissaient
une providence générale, et, par suite, les peines attachées
en l'autre vie, à l'infraction des lois naturelles gravées dans tous
les coeurs. Tous ces systèmes, fondés sur le raisonnement, sont
plus ou moins faciles à détruire par la même arme : car tous manquent
de base et de sanction.
Seuls conséquens dans leur respectueux amour de la providence, me paraissent le chrétien et le stoïcien. Le premier montre
du doigt le ciel que la révélation a promise à la foi comme une
récompense achetée par l'homme vertueux au prix des tribulations
d'une vie d'épreuves. Il y a là base et sanction pour admettre et
justifier la providence; car la foi chez celui qui l'a n'est plus une
opinion,
c'est un fait matériel. Le stoïcien et Sénèque aiment
aussi à espérer que le sage se reposera des adversités de cette vie
dans le sein de la divinité ; mais chez eux cet espoir n'est qu'une
opinion sujette à controverse. Or, si cet appui leur manque, le
suicide est là : la mort volontaire est le remède que les dieux ont
mis toujours à la portée du sage, pour qu'il échappe à la souffrance,
à la misère, à la servitude. Afin d'apprécier cette sanction
des idées de Sénèque en faveur de la providence, il ne faut
pas le juger d'après les idées chrétiennes, mais d'après les moeurs
et la religion de son temps : grâce à la foi du suicide, on le trouvera
aussi bien d'accord avec lui-même dans tous ses raisonnemens,
que le chrétien avec la foi d'une vie future.
Lucilius avait demandé à Sénèque pourquoi, s'il existe une providence,
cette foule de maux dont les gens de bien sont assaillis?
Notre auteur observe que cette difficulté trouverait mieux sa place
dans un ouvrage où il prouverait que la providence préside à l'ensemble
de l'univers. Si Dieu permet que les hommes vertueux et
qui lui sont agréables, soient éprouvés par l'adversité, c'est pour
les rendre plus dignes de lui. I. — Les adversités ne sont pas des
maux, elles sont utiles, profitables et même nécessaires aux gens
vertueux. " Bel endroit où Sénèque incline la tête de Jupiter vers
la terre, et attache les regards du maître de l'univers sur Caton, etc. (1)'".
(1) Diderot
II.— Les calamités prétendues sont pour le bien de ceux qui les éprouvent; elles sont utiles à l'universalité du genre humain, que Dieu doit préférer à des individus. Paroles de Demetrius; exemples de Mucius, de Fabricius, de Rutilius, de Socrate, de Caton. Peut-on dire que Sylla fut heureux? III. — Les dieux ne laissent tomber la prospérité que sur les âmes abjectes et vulgaires. La vertu ne sert de rien à l'homme s'il ne rencontre les occasions d'en faire preuve. Dieu expose les gens de bien aux traverses, comme un capitaine met au premier rang du péril ses plus vaillans soldats. IV.— Ce qui prouve que les adversités sont plutôt un bien qu'un mal, c'est que Dieu les envoie de préférence aux gens de bien pour qu'ils en fassent leur profit. D'ailleurs tout ce qu'on souffre est la loi du destin. Le créateur de toutes choses a d'avance écrit, les destinées; il les a ordonnées une fois pour y obéir toujours. Le sage doit donc s'y soumettre. Singulier éloge de Phaéton. V. — Sénèque montre en terminant que Dieu préserve le sage de tous maux, en écartant de lui les vices, qui, selon lui, sont les seuls, maux réels. Exemple de Démocrite. Enfin Dieu prend lui-même la parole, et demande de quoi ont à se plaindre ceux qui ont embrassé la vertu. Souffrir patiemment est un avantage qui élève le sage au dessus de Dieu même, puisque Dieu n'a pas le pouvoir de rien souffrir. D'ailleurs, si le sage ne veut plus souffrir, la mort est à sa disposition. VI. Ce discours a été traduit par Chalvet, Du Ryer, La Grange, en partie par La Beaumelle, Vernier, Diderot, etc. — Un des livres de Lactance est intitulé de Providentia. Enfin nous avons un très long commentaire du traité de Sénèque en italien, par le P. A. Tomassi.
CH. DU.
![]()
I. Vous m'avez demandé, Lucilius, pourquoi les gens
de bien,
si le monde est gouverné par une Providence,
éprouvent tant de maux. La réponse trouverait mieux sa
place dans un ouvrage où je prouverais que la Providence
préside à l'univers, et que Dieu est présent parmi
nous; mais puisqu'il faut, pour vous satisfaire, traiter
séparément cette petite partie d'un si grand sujet, et
m'attacher à cette unique objection, sans entamer le fond
du procès ; je me charge d'une tâche peu difficile ; je vais
plaider la cause des dieux. Il est inutile de montrer en
ce moment que cette machine immense ne se maintiendrait
pas sans un gardien puissant; que les astres, dans
la constance de leurs révolutions diverses, ne suivent
pas un mouvement fortuit; que les choses produites par
le hasard sont sujettes à des perturbations fréquentes et
à de promptes collisions ; qu'au contraire, une loi éternelle
régit cette harmonieuse rapidité qui soutient tout
ce qu'embrasse l'immensité des terres et des mers, ainsi
que tous ces flambeaux qui brillent en leur place et à leur
tour; qu'un pareil ordre n'appartient pas à la matière vaguement agitée; qu'une réunion d'élémens sans plan et
sans dessein n'aurait ni cet équilibre ni cette disposition
savante, qui font que la terre demeure immobile au centre
de la sphère céleste, dont la fuite n'est jamais ralentie;
que la mer se répand dans les vallées pour humecter
l'intérieur des terres, sans jamais se sentir accrue par
tous les tributs des fleuves; et que des moindres semences
naissent les plus superbes végétaux. Les météores même,
où semble régner le plus de confusion et d'irrégularité,
je veux dire les pluies et les nuages, l'éruption de la
foudre, les feux lancés du sommet des volcans, les secousses
qui ébranlent la terre, en un mot tous les mouvemens
que la partie orageuse de la nature excite sur
notre globe, quoique nés subitement, ne sont pas l'effet
du hasard : ils ont leurs causes comme les phénomènes qui, se produisant hors de leur lieu naturel, sont des
prodiges; tels que les eaux chaudes au milieu de la mer,
les îles nouvelles qui s'élèvent à sa surface. De plus, quand
on voit les mers laisser leurs rivages à sec en se retirant,
et les couvrir ensuite de nouveau dans un court espace
de temps, peut-on croire que ce soit par la seule force
de l'aveugle matière qu'elles se resserrent et se refoulent
sur elles-mêmes, et qu'elles reprennent ensuite leur
place ; surtout, si l'on observe que le flux s'accroît et diminue
périodiquement à des jours et des heures fixes,
en obéissant aux différentes attractions de la lune, qui
règle à son gré les inondations de l'Océan?
Mais réservons ces considérations pour le temps convenable,
d'autant plus que vous accusez la Providence, et
ne la niez pas. Je veux vous réconcilier avec les dieux, qui
traitent toujours les bons avec bonté. La nature, en effet, ne veut pas que le bien nuise aux bons. Il y a entre Dieu et les gens de bien une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je, une amitié ! c'est plutôt une affinité,
une ressemblance. L'homme de bien ne diffère de Dieu
que par la durée; il est son disciple, son imitateur, son
véritable fils. Mais cet auguste père, inflexible sur la
pratique des vertus, élève rudement ses enfans ; c'est un
chef de famille sévère.
Lors donc que vous verrez des hommes vertueux et
agréables à la divinité, peiner, suer, gravir des sentiers
escarpés, tandis que les médians nagent au sein des délices
et de la volupté, songez qu'on aime la modestie dans
ses enfans, la licence dans ceux des esclaves; on assujettit
les premiers à une discipline austère, et l'on provoque
la pétulance des seconds. Ainsi Dieu n'élève pas
l'homme de bien dans la mollesse; il l'éprouve, il l'endurcit,
il le prépare pour lui-même.
II. Mais pourquoi les gens de bien souffrent-ils tant
d'adversités? Il n'y a pas de maux pour les gens de bien :
les contraires ne peuvent s'assembler. De même que tous ces fleuves, toutes ces pluies qu'épanchent les cieux,
toutes ces eaux qui viennent du sein de la terre dans la
mer, n'en peuvent point changer la saveur, ni même l'affaiblir;
ainsi le choc de l'adversité n'altère pas une âme
courageuse : elle reste inébranlable, elle imprime aux
évènemens sa couleur; car elle est plus puissante que
tout ce qui vient du dehors. Je ne veux pas dire qu'elle
y soit insensible; mais elle en triomphe; dans son calme
et sa tranquillité, elle résiste et reste supérieure à l'effort
de l'ennemi. Les calamités ne sont pour elle qu'un
exercice. Quel est l'homme au coeur élevé, généreux, qui
ne désire une honorable épreuve, qui ne soit prêt à sacrifier sa sûreté à son devoir? Pour peu qu'on ait d'énergie,
ne regardera-t-on pas l'inaction comme un supplice?
Nous voyons l'athlète qui veut entretenir ses forces,
choisir les adversaires les plus robustes, demander à
ceux avec qui il se prépare au combat, de déployer contre
lui toute leur vigueur; il endure les coups, les plus
rudes étreintes, et, s'il ne trouve personne qui l'égale,
il fait tête à plusieurs à la fois. Le courage se flétrit
quand il manque d'adversaire; sa grandeur, sa force, sa
puissance ne se montrent que dans l'épreuve de la douleur.
Ainsi se comporte l'homme de bien; il ne crainl pas
le malheur et la peine; il ne murmure pas contre le
destin ; quoi qu'il arrive, il s'en accommode, et le tourne
à son profit. Le mal n'est rien, la manière de le supporter
est tout. Voyez quelle différence il y a entre l'amour
d'un père et celui d'une mère pour leurs enfans. Le premier
ordonne qu'on les réveille de bon matin pour qu'ils
s'appliquent à l'étude, il ne les laisse pas oisifs même
les jours fériés, il fait couler leur sueur et quelquefois
leurs larmes. La mère, au contraire, les tient sous son
aile, leur épargne le poids du jour; elle veut qu'ils ne
pleurent jamais, qu'on ne les chagrine pas, qu'on écarte
d'eux la fatigue. Dieu a pour l'homme de bien les sentimens
d'un père, une mâle affection. «Qu'il lutte contre
les douleurs et contre les infortunes, dit-il, c'est ainsi
qu'il acquerra la véritable force. » Les animaux qu'on engraisse
s'énervent par l'inaction ; loin qu'ils supportent la
moindre fatigue, le mouvement seul, leur propre poids
les accablent. Un bonheur qui n'a jamais été troublé
succombe au premier coup. Mais, par l'habitude de se mesurer avec le malheur, l'homme s'endurcit à la souffrance,
et devient indomptable; est-il abattu, il combat
encore à genoux.
Vous êtes surpris que Dieu, qui aime les gens de bien,
qui veut les élever au plus haut degré de perfection, leur
donne ici-bas la fortune pour adversaire. Et moi, je ne suis
pas étonné qu'il prenne quelquefois envie aux dieux de
voir les grands hommes luttant contre l'adversité. C'est
quelquefois un plaisir pour nous de regarder un jeune
homme intrépide, qui attend, avec son épieu, une bête
féroce, et qui soutient la fureur d'un lion; le plaisir est
d'autant plus vif, que le combattant est d'un rang plus
illustre.
La divinité ne daigne point fixer ses yeux sur ces
vains amusemens de la frivolité humaine. Mais voici un
spectacle capable de distraire le souverain de l'univers
de ses soins éternels ; voici deux athlètes dignes d'avoir
Dieu pour spectateur : le grand homme aux prises avec
la fortune, surtout quand c'est lui qui l'a provoquée.
Non,
je ne vois dans le monde rien de plus beau à contempler
pour Jupiter, s'il veut abaisser vers nous ses regards,
que Caton, après le désastre de son parti, seul
debout au milieu des ruines de la république. « Que l'empire,
dit-il, tombe au pouvoir d'un seul homme; que la
terre soit occupée par ses légions, et la mer par ses vaisseaux;
que les Césariens veillent à nos portes; Caton sait
par où leur échapper : il suffit de mon seul bras pour
m'ouvrir le chemin qui mène à la liberté. Ce fer, innocent
même dans la guerre civile, et pur de sang romain,va remplir
enfin un office utile et glorieux. S'il n'a pu garantir la liberté de Rome, Caton lui devra la sienne. Exécute, ô
mon âme, un projet médité depuis longtemps; dérobe toi
aux misères de l'humanité. Déjà Petreius et Juba, en
se précipitant l'un contre l'autre, sont tombés sous leurs
coups mutuels : noble et courageux accord pour mourir,
mais qui serait encore au dessous du grand caractère
de Caton. Il aurait également à rougir de demander à
quelqu'un ou la mort ou la vie. »
Je n'en doute nullement, les dieux furent pénétrés de
la joie la plus vive, lorsque ce héros, intrépide libérateur
de lui-même, prenait soin de la sûreté des autres,
et disposait tout pour leur fuite; lorsqu'il se livrait à l'étude
cette même nuit qui devait être pour lui la dernière;
lorsqu'il plongeait le fer dans sa poitrine sacrée, lorsqu'il
arrachait ses propres entrailles, et que sa main faisait
sortir son âme vénérable, que le fer eût souillée. Voilà
sans doute pourquoi le coup mal dirigé ne fut pas mortel.
Ce n'était pas assez pour les dieux d'avoir eu Caton
en spectacle seulement une fois : sa vertu fut redemandée,
ramenée dans l'arène, afin qu'elle se montrât encore, et dans une épreuve plus difficile. En effet, il y a moins
de courage à faire un premier essai de la mort, qu'à s'y
reprendre. Oui,
les dieux devaient avoir plaisir à regarder
leur élève s'affranchir par une fin si belle et si mémorable.
La mort devient une apothéose,
quand elle est
un objet d'admiration pour ceux mêmes qu'elle épouvante.
III. La suite du discours me conduira tout-à-1'heure à
montrer combien il s'en faut que ce qu'on appelle des
maux en soient réellement; je me contente à présent d'affirmer
que ces prétendues calamités, quelque affreuses
qu'elles semblent, sont d'abord dans l'intérêt de ceux à qui elles arrivent, puis de l'universalité du genre humain,
dont les dieux tiennent compte plus que des individus
; qu'elles plaisent à qui les éprouve, ou qu'on les
mérite, si elles déplaisent; qu'elles entrent dans l'ordre
général des destinées, et qu'elles doivent échoir aux gens
de bien par la même loi qui les a faits tels qu'ils sont.
De là, vous conclurez qu'il ne faut pas plaindre le sort
de l'homme vertueux; qu'on peut le dire malheureux,
mais qu'il ne l'est jamais.
De ces assertions, celle qui paraît la plus difficile à
prouver est la première, savoir : que les maux qui nous
font frémir, sont dans l'intérêt de ceux qui les souffrent. Quoi, direz-vous, c'est un bien que d'être envoyé en
exil, d'être réduit à la mendicité, de porter ses enfans,
sa femme à la sépulture, d'avoir le corps mutilé, d'être
flétri par un jugement? Si vous ne concevez pas que, de
ces accidens, il puisse résulter un bien, soyez donc
étonné aussi de ce qu'on traite plusieurs maladies par le
fer et le feu, par la faim et la soif. Mais si vous songez
que, dans certains cas, on est obligé de dépouiller les
os, de les extraire, de retrancher des veines, d'amputer
quelques membres qui ne peuvent rester unis au corps
sans entraîner sa destruction totale; vous serez forcé de
reconnaître qu'il y a des maux utiles à ceux, qui les endurent,
aussi bien, assurément, que plusieurs objets des
voeux et des soins les plus empressés sont funestes à ceux
qu'ils charment, comme les jouissances de l'ivrognerie,
de la gourmandise, et de tous les vices qui conduisent à
la mort par le plaisir.
Parmi plusieurs maximes sublimes de notre cher Demetrius,
en voici une dont l'impression sur moi est toute
récente ; je crois l'entendre encore retentir à mon oreille : il n'y a rien, ce me semble, de plus malheureux que
l'homme qui n'a jamais eu de malheur. En effet il n'a
pas pu s'éprouver. Quand la fortune aurait secondé tous
ses voeux, les aurait même prévenus, toujours est-il que
les dieux ont eu mauvaise opinion de lui ; ils ne l'ont pas
jugé digne de vaincre quelquefois la fortune. Elle aussi,
évite le lâche, comme si elle disait : pourquoi m'atîaquer
à un pareil adversaire? à la première atteinte, il mettra
bas les armes; il n'y a pas besoin contre lui de toute ma
force; la plus légère menace le fera reculer; il ne peut
soutenir mes regards. Cherchons-en un autre avec qui je
puisse me mesurer. Je rougirais de combattre un ennemi
tout prêt à s'avouer vaincu.
Un gladiateur se croit déshonoré, si on le met en présence
d'un adversaire trop au dessous de lui ; il sait qu'on
n'a pas de gloire à vaincre celui qu'on vaincra sans péril.
La fortune fait de même; elle choisil les plus braves
pour entrer en lice avec eux, et passe dédaigneusement
devant les autres. Elle attaque les plus fiers et les plus
hardis, contre qui tout son effort soit nécessaire : elle
essaie le feu contre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
l'exil contre Rutilius, les tourmens contre Regulus,
le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n'est que par la mauvaise fortune que se produisent
les grands exemples : trouvez donc Mucius malheureux
lorsqu'il presse de son poing les feux de l'ennemi, et se
punit lui-même de son erreur? lorsqu'un roi, que son
glaive n'avait pu vaincre, fuit à la vue de son bras consumé?
eût-il été plus heureux, s'il eût échauffé sa main
dans le sein de sa maîtresse? Trouvez-vous Fabricius malheureux
d'employer tout le temps que lui laissent les
soins publics, à labourer sa terre? de faire la guerre autant contre l'or que contre Pyrrhus? de manger au coin
de son foyer ces herbes et ces racines qu'il a arrachées en
nettoyant son champ au retour du triomphe qui honore sa
vieillesse? Le croiriez-vous plus heureux, s'il chargeait son
estomac d'oiseaux étrangers, de poissons venus de pays
lointains? s'il réveillait la paresse de son appétit blasé par
les coquillages de la mer Adriatique et de la mer Tyrrhénienue
? s'il voyait servir sur sa table, parmi les fruits les
plus exquis, des bêtes fauves d'une grosseur énorme, dont
la prise aurait coûté bien du sang aux chasseurs? Trouvez-vous
Rutilius si malheureux d'avoir subi une condamnation
qui sera l'opprobre de ses juges dans tous les siècles?
de s'être plus facilement résigné à être privé de sa patrie
que de son exil ? d'avoir été le seul qui refusât la
clémence du dictateur Sylla, lorsqu'au lieu de rentrer
dans sa patrie, où on le rappelait, il se retira, que dis-je ? il s'enfuit dans une retraite plus lointaine? «Qu'ils
prennent leur parti, dit-il, ceux que ton bonheur a surpris
à Rome; qu'ils voient des flots de sang inonder la
place publique ; qu'ils voient au dessus du lac Servilius
(c'était la tuerie des proscriptions de Sylla) les têtes des
sénateurs; qu'ils voient des troupes d'assassins errant dans
la ville, et des milliers de citoyens romains égorgés dans
un même lieu, contre la foi donnée, ou plutôt au piège
de la foi donnée. Ce spectacle est fait pour ceux qui ne
peuvent pas vivre en exil. »
Syila est donc plus heureux, parce qu'à son arrivée
dans le Forum,
le glaive écarte la foule sur son passage;
parce qu'il permet d'exposer en public les têtes des consulaires;
parce qu'il fait payer par le questeur, et inscrire sur
les registres publics le prix de chaque meurtre, et qu'il
ose toutes ces horreurs après avoir publié la loi Cornelia? Venons à Regulus. Quel mal lui a fait la fortune en le
rendant un exemple de bonne foi, un exemple d'une
constance héroïque? Ses membres sont percés de clous;
de quelque côté qu'il tourne son corps fatigué, il pèse
sur une blessure ; une insomnie continuelle tient ses
paupières ouvertes. Plus grande est la torture, plus sublime
sera la gloire. Voulez-vous être sûr qu'il ne se repent
pas d'avoir mis ce prix à la vertu? ressuscitez-le,
envoyez-le dans le sénat : il y ouvrira le même avis.
Trouvez-vous donc plus heureux Mécène en proie aux
tourmens de l'amour, désolé par les froideurs d'une
femme capricieuse? Il cherche à rappeler le sommeil par
la douce harmonie d'un concert un peu éloigné. Il a beau
recourir au vin pour s'assoupir, au bruit des chutes
d'eau pour se distraire, à mille autres voluptés pour
tromper son chagrin, il demeurera éveillé sur la plume,
comme Regulus sur des pointes déchirantes. Mais Regulus
a une consolation ; c'est qu'il endure le supplice pour
la vertu ; il oublie ses tortures pour n'en considérer que
la cause. Au lieu que Mécène, flétri par la débauche, fatigué
par l'excès de son bonheur, est encore plus misérable
par la cause de ses souffrances que par ses souffrances
mêmes.
Le vice n'est pas encore assez maître du monde pour
qu'il soit douteux que, s'ils avaient la faculté de choisir
leur destinée, le plus grand nombre des hommes aimât
mieux ressembler à Regulus qu'à Mécène; ou si quelqu'un
osait préférer le sort de ce dernier, il préférerait
aussi, quoiqu'il ne le dît pas, le soit deTerentia.
Plaignez-vous Socrate pour avoir avalé la coupe que lui présenta le bourreau, comme s'il prenait un breuvage
d'immortalité? pour avoir disserté sur la mort jusqu'à
l'instant même de mourir? Le trouvez-vous à plaindre,
parce qu'il sentit son sang se figer, et que le froid,
qui s'insinuait dans ses veines, y éteignit peu à peu la vie?
Combien on doit plus envier son sort que celui de ces riches
voluptueux qui boivent dans des coupes de pierre
précieuse, et pour qui un jeune débauché, d'une virilité
équivoque ou supprimée, et instruit à tout souffrir,
délaie dans l'or la neige qui tombe de sa main. Ce qu'ils
ont bu, ils le rendront jusqu'à la dernière goutte avec
les angoisses du vomissement et avec le dégoût de la
bile qui reflue dans leur bouche; au lieu que Socrate
avala le poison avec joie et sans difficulté.
Pour Caton, tous les hommes reconnaissent, d'un accord
unanime, qu'il atteignit le comble de la félicité. C'était
pourtant lui que la nature avait choisi pour recevoir
le chocdes évènemeusles plus terribles. «Les inimitiés des
grands sont funestes, dit-elle; je veux donc qu'il soit en
butte à la haine de Pompée, de César et de Crassus. Il
est révoltant d'être supplanté par un rival sans mérite;
on lui préférera Vatinius. Il est affreux d'être engagé dans
les guerres civiles ; il combattra dans les trois parties du
monde pour la bonne cause, et ses revers égaleront son
intrépidité. Il est cruel d'attenter à sa propre vie; il y attentera.
Qu'aurai-je donc fait par là ? j'aurai montré à tous
que ces prétendus maux n'en sont pas, puisque Caton
m'en aura paru digne? »
IV. Les prospérités descendent sur le vulgaire, sur les
âmes communes. Mettre sous ses pieds les calamités et
les terreurs des mortels est le privilège des grands
hommes. Jouir d'un bonheur continuel, et couler ses jours sans recevoir aucune atteinte aux siens, c'est ne
pas connaître une moitié de la condition humaine. Vous
êtes magnanime; mais comment le saurai-je, si la fortune
ne vous a pas mis à portée de montrer votre vertu ?
Vous êtes descendu dans la carrière olympique, mais
vous étiez seul; vous avez remporté la couronne, mais
non pas la victoire. Je vous félicite, non de votre courage,
mais de l'honneur qu'on vous a décerné, comme si
vous aviez obtenu le consulat,ou la préture.
On peut en dire autant à l'homme de bien, lorsque
l'adversité ne lui a pas procuré une seule rencontre, où il
lui fût possible de déployer sa force d'âme. Vous êtes
malheureux de n'avoir jamais eu de malheur; vous avez
passé votre vie sans combat : on ne saura pas de quoi
vous étiez capable ; vous ne le saurez pas vous-même.
Pour se connaître, il faut des épreuves. On ne sait la
mesure de ses forces qu'en les essayant. Aussi a-t-on vu
des hommes s'offrir d'eux-mêmes à l'adversité trop tardive;
et leur vertu, qui se serait perdue dans l'obscurité,
s'est créé des occasions de briller. Oui, le grand homme
aime les traverses, comme le brave soldat, les périls.
Sous l'empire de C César, j'entendis Triumphus le mirmillon
se plaindre de la rareté des jeux : «Que de beaux
jours perdus ! » s'écriait-il.
Le courage est avide de périls,
il songe à son but, et
nullement aux maux qu'il souffrira, d'autant plus qu'ils
font une partie de sa gloire. Les guerriers montrent avec
orgueil leurs blessures ; ils regardent avec joie leur sang
couler; c'est une faveur des dieux. Quoique les soldats
qui reviennent de la bataille sans avoir reçu de coups aient aussi bien fait leur devoir, ce sont les blessés qui
attirent seuls tous les regards.
Je le répète, c'est pour l'intérêt de ceux qu'il veut élever
au comble de la gloire que Dieu leur apprête matière
à déployer leur force et leur vertu, ce qui ne peut se
faire que dans des conjonctures difficiles. Le pilote se signale
dans la tempête, et le soldat dans la mêlée. Comment
puis-je connaître votre courage dans la pauvreté, si
vous nagez dans l'opulence? votre constance contre l'ignominie,
le déshonneur, les haines populaires, si vous
vieillissez au milieu des applaudissemens, si rien n'ébranle
votre crédit, si la faveur générale s'empresse à
vous chercher? Comment juger de quelle âme vous supporteriez
la perte de vos enfans, si vous n'en avez aucun
à regretter? Je vous ai entendu donner des consolations
à d'autres; mais j'aurais voulu vous voir vous consoler
vous-même,vous interdire la douleur. Ne redoutez donc
pas ces aiguillons dont les dieux se servent pour réveiller
votre courage : l'adversité est une occasion pour la vertu.
Les vrais malheureux sont ceux qui s'engourdissent
dans l'excès du bonheur, comme ces navigateurs qu'un
calme plat enchaîne au milieu d'une mer immobile; le
moindre accident sera pour eux une chose extraordinaire.
Les chagrins paraissent plus amers à qui ne les
connut jamais, de même que le joug est plus dur au front
encore neuf et tendre. Le soldat novice pâlit à l'idée
d'une blessure ; un vétéran regarde avec intrépidité le
sang qu'il perd; il sait qu'il a plus d'une fois acheté la
victoire à ce prix. Ainsi Dieu fortifie, essaie, exerce ses élus, ses favoris.
Ceux, au contraire, qu'il semble traiter avec plus de
douceur et de ménagement, il les garde comme une
proie sans défense pour les maux à venir. En effet, ne
croyez pas qu'il y ait personne d'exempt; cet homme, si
longtemps heureux, aura son tour. Il semblait être.affranchi
; son jour était différé.
Vous me demandez pourquoi Dieu envoie aux gens
de bien des maladies et d'autres afflictions; et moi, je
vous demande pourquoi, dans les camps, ce sont toujours
les meilleurs soldats qu'on choisit pour les expéditions
les plus périlleuses? Faut-il dresser une embuscade à l'ennemi
pendant la nuit, reconnaître le pays, surprendre
un poste? ce sont des hommes d'élite qu'on en charge;
et aucun d'eux au départ ne se plaint d'une injuste rigueur
du général ; au contraire, ils se disent : «Le général
a confiance en nous. »
Ainsi, ceux à qui la Providence ordonne de souffrir des
maux insupportables pour les timides et pour les lâches
doivent dire : Dieu nous estime assez pour éprouver en
nous jusqu'où peut aller la constance humaine.
Fuyez les plaisirs, fuyez la mollesse d'un bonheur qui
énerve, s'il ne survient quelque accident pour vous avertir
de la fragilité des choses d'ici-bas. Celui que des pierres
transparentes garantissent du vent, dont les pieds sont
échauffés par des fomentations renouvelées incessamment,
dont la salle à manger est entretenue dans une
douce température par la chaleur qui circule sous le
plancher et autour des cloisons; un tel homme ne peut
être saisi par la moindre impression de l'air sans danger.
De tous les excès le plus à craindre, est l'excès du bonheur.
C'est une ivresse qui dérange le cerveau, qui entraîne l'esprit après des idées fantastiques, qui met entre
la vérité et l'erreur des brouillards épais. Ne vaudrait-il
pas mieux supporter des maux continuels, qui nous rappelassent
à la vertu, que de regorger d'énormes, d'excessives
prospérités? On meurt plus doucement l'estomac
vide; on crève par l'indigestion. Dieu suit le même procédé
avec les gens de bien que le maître avec ses disciples,
envers lesquels il est plus exigeant et plus sévère
en proportion des espérances qu'ils donnent. Croyez-vous
que les Lacédémoniens haïssent leurs enfans, parce
qu'ils éprouvent leur courage par des flagellations publiques?
Les pères eux-mêmes exhortent leurs fils à endurer
avec constance les coups de fouet; en les voyant déchirés,
demi-morts, ils les conjurent encore de tenir bon
et d'offrir leurs corps blessés à de nouvelles blessures.
Est-il donc surprenant que Dieu mette à de rudes
épreuves les âmes généreuses? L'apprentissagede la vertu
n'est jamais doux et facile. La fortune nous frappe et
nous déchire ; souffrons. Ce n'est point une persécution,
c'est une lutte. Nous serons d'autant plus forts, que nous
l'aurons plus de fois soutenue. Les membres les plus vigoureux
sont ceux qui travaillent et fatiguent davantage.
Il faut nous mettre à l'école de la fortune, pour qu'elle
nous endurcisse elle-même contre ses propres coups. Insensiblement
elle nous rendra capables de lui faire tête.
L'habitude des périls nous en inspirera le mépris. Ainsi
le nautonnier s'accoutume à supporter la mer; le laboureur
a la main calleuse; le soldat, pour lancer les traits,
se fait un bras robuste, et le coureur acquiert la souplesse
du jarret. La partie du corps la plus solide est celle qu'on exerce. A force de souffrir les maux, l'âme
finit par les braver. Vous en aurez la preuve, si vous
voyez tout ce qu'une vie rude et pénible donne à des
nations dénuées de tout et que fortifie leur indigence
même. Considérez ces peuples où finit la paix de notre
empire; je parle des Germains et de toutes ces tribus
vagabondes qu'on rencontre aux environs de lister.
Sous le poids d'un hiver perpétuel, d'un ciel sauvage,
ils ont pour séjour un sol avare et stérile; un abri
de chaume ou de feuillage sec les défend seul contre la
pluie ; ils courent sur des marais que la glace a durcis,
et font la chasse aux animaux des forêts pour se nourrir.
Sont-ils malheureux? non, il n'y a point de malheur
dans ce qui est devenu naturel par l'habitude, et l'on se
fait à la longue des plaisirs de ce qui fut d'abord une
nécessité. Ils n'ont de domicile et de demeure que celle
que leur assigne chaque jour le besoin du repos : la
nourriture la plus commune est le prix de leur sueur; ils
sont exposés à l'intempérie d'un affreux climat, sans vêtemens
pour s'en garantir. Eh bien! ce qui vous semble
une désolation, c'est la vie de tant de peuples.
Ne soyez donc pas surpris que les gens de bien, pour
être affermis, éprouvent des secousses violentes. Un arbre
ne se consolide et ne se fortifie que par les assauts
multipliés de l'Aquilon. Ce sont ces tourmentes mêmes
qui rendent sa fibre plus robuste, et sa racine plus vive
et plus puissante. Ceux qui naissent dans les vallons
abrités sont fragiles. Il est donc de l'avantage des gens de
bien, pour qu'ils soient sans peur, de vivre habituellement
parmi des objets d'effroi, et de souffrir avec une âme impassible
ces maux qui n'en sont pas, si ce n'est pour
l'homme qui ne sait point les supporter. V. Ajoutez que l'intérêt général exige que les gens de
bien soient, pour ainsi dire, toujours sous les armes et
en action. Le but de Dieu, comme celui du sage, est
de montrer que les objets des désirs et des craintes du
vulgaire ne sont ni de vrais biens ni de vrais maux. Or,
s'il n'est donné qu'aux hommes vertueux d'en jouir,
les uns seront réellement des biens, et les autres des
maux, s'ils ne sont infligés qu'aux méchans. La cécité
serait une chose abominable, s'il n'y avait que ceux qui
mériteraient d'avoir les yeux arrachés qui perdissent la
vue : qu'Appius et Metellus soient donc privés de la
lumière. Les richesses ne sont pas un bien; ainsi qu'Ellius,
le vendeur de prostituées, soit riche, afin que les
hommes qui rendent un culte à l'argent dans les temples,
le voient affluer aussi dans les lieux de débauche.
Dieu n'a pas de meilleur moyen de décrier les objets
de nos voeux, que de les retirer aux honnêtes gens,
pour les transporter aux infâmes.
«Mais, direz-vous, c'est une injustice que les bons
soient mutilés, percés de coups, chargés de chaînes;
tandis que les méchans conservent leurs membres intacts,
marchent en liberté, vivent dans les délices.» C'est donc
une injustice que les plus braves guerriers prennent les
armes, veillent la nuit dans les camps et défendent les
retranchemens, avec l'appareil sur leurs blessures; tandis
que des débauchés de profession, amusement de la
luxure, jouissent dans la ville d'une profonde sécurité?
C'est donc une injustice que les plus nobles vierges
soient réveillées pendant la nuit pour la célébration
des sacrifices; tandis que des femmes impudiques reposent
dans les bras du sommeil.
Les obligations laborieuses réclament les hommes les plus distingués. Le sénat se tient quelquefois assemblé
des journées entières; pendant ce temps-là, les plus vils
citoyens cherchent un amusement à leur paresse dans le
Champ-de-Mars, ou s'enivrent dans les cabarets, ou perdent
leur temps à babiller dans des cercles d'oisifs. La
même chose arrive dans la république du monde : les
gens de bien travaillent, se sacrifient, sont sacrifiés, et
cela sans contrainte; ils ne se font point traîner par
la fortune, ils la suivent d'un pas égal; ils seraient
même allés au devant d'elle, s'ils avaient connu ses
intentions.
Je me rappelle encore ces paroles énergiques du magnanime
Demetrius : « Dieux immortels, disait-il, je n'ai
qu'une plainte à faire de vous, c'est de ne m'avoir pas annoncé
votre volonté plus tôt ; j'aurais prévenu vos ordres :
je ne puis à présent qu'y obéir. Voulez-vous mes enfans?
c'est pour vous que je les ai élevés. Voulez-vous quelque
partie de mon corps? choisissez. Ce n'est pas un effort
bien généreux; dans un moment, il me faudra quitter ce
corps tout entier. Voulez-vous ma vie? je ne balance pas
à vous rendre ce que vous m'avez donné. Quoi que vous
demandiez, je vous l'abandonne sans regret. Oui; mais
j'aurais mieux aimé vous l'offrir, que de vous le laisser
prendre. Qu'était-il besoin de l'enlever? vous pouviez le
recevoir. Cependant, vous ne m'enlevez rien; on ne ravit
qu'à celui qui veut retenir. Moi, je ne souffre ni contrainte,
ni violence; Dieu ne m'opprime pas, je suis
d'accord avec lui, d'autant mieux que je n'ignore pas que
tous les évènemens sont réglés par une loi infaillible,
éternelle. » Les destins nous conduisent, et la durée de
notre carrière est fixée dès la première heure de notre
naissance. Les causes s'enchaînent, et un long ordre de choses détermine le sort des hommes comme celui des
états.
Il faut donc tout souffrir avec courage; ce ne sont pas
des accidens, comme nous le croyons, c'est notre destinée.
Les causes de nos plaisirs et de nos peines sont déterminées
longtemps d'avance, et quelle que soit la variété
d'évènemens qui distingue la vie de chacun, il y a
une ressemblance générale qui domine tout. Ce que nous
possédons doit périr, comme nous périrons nous-mêmes.
Pourquoi nous plaindre et nous indigner? C'est la loi de
notre existence. Que la nature use à son gré des corps
qu'elle a formés; nous, contens quoi qu'il arrive, exempts
de faiblesse, pensons que rien de ce qui est nous ne périt.
Quel est donc le devoir de l'homme vertueux? de
s'abandonner au destin. C'est une grande consolation que
d'être emporté avec l'univers. Quelle que soit la puissance
qui ordonne ainsi de notre vie et de notre mort, elle assujettit
à une pareille loi les dieux mêmes. Un torrent,
que rien ne peut arrêter, entraîne également et les dieux
et les hommes. Le créateur, l'arbitre de l'univers, qui a
tracé les arrêts du destin, y est lui-même soumis. Il a
ordonné une fois, il obéit toujours.
«Mais, dira-t-on, pourquoi, dans la distribution des
destinées, Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
gens de bien la pauvreté, les blessures, les catastrophes?
» L'ouvrier ne peut changer la matière; elle est
passive. Chaque être a ses conditions nécessaires, essentielles,
inévitables. Les âmes qui doivent languir dans le
sommeil, ou veiller dans un état qui en diffère peu,
se composent d'élémens sans aucune énergie. Mais pour
former un grand homme, il faut un destin plus fort; il
ne s'avancera pas par une route unie; il doit monter, descendre, être balotté par les vagues, naviguer dans la
bourrasque; il faut qu'il poursuive sa route ayant la fortune
contraire. Il trouvera bien des obstacles, bien des
écueils ; c'est à lui de les aplanir et de les vaincre avec
ses propres forces. L'or est éprouvé par le feu, et le courage
par les revers. Voyez à quelle hauteur la vertu doit
s'élever; vous comprendrez qu'elle ne peut pas choisir
un chemin sans péril.
Un chemin escarpé commence ma carrière. Mes coursiers rafraîchis, sortant de la barrière, Ne gravissent qu'à peine à la cime des airs. Là, tout dieu que je suis, du haut de l'univers Je ne puis sans effroi voir l'abîme du vide. Enfin de mon déclin la pente est si rapide, Que Téthys qui, le soir, me reçoit dans ses eaux, Tremble d'y voir rouler mon char et mes chevaux.
A ce discours, le généreux jeune homme répond : «Cette route n'a rien qui m'effraie; je monte; l'entreprise est assez belie, dussé-je y périr. » Son père continue à tâcher de l'intimider:
Je veux qu'en ton chemin nulle erreur ne t'égare; Oseras-tu braver plus d'un monstre barbare ? Les cornes du Taureau, la gueule du Lion, Et l'arc du Sagittaire?
«Tout ce que vous dites pour m'arrêter excite mon courage;
j'aimerai à me tenir sur ce char, où Phébus lui-même
tressaille de crainte. Qu'une âme basse et lâche
prenne les sentiers battus; la vertu s'élance sur les
hauteurs. »
VI. «Cependant pourquoi Dieu souffre-t-il qu'il arrive
mal aux gens de bien?» Non, il ne le souffre pas; il a éloigné d'eux tous les maux, c'est-à-dire les crimes, les
infamies, les mauvaises pensées, les desseins ambitieux,
la passion effrénée, l'avarice qui a soif du bien d'autrui :
Dieu prend les hommes vertueux sous sa défense et sous
sa protection. Exigera-t-on aussi qu'il garde leur bagage?
Ils le tiennent quitte de ce soin par leur mépris pour ce
qui ne touche pas à l'âme.
Démocrite se dépouilla de ses richesses, les regardant
comme un fardeau incommode pour le sage. Est-il surprenant que Dieu prépare aux
gens de bien le sort qu'ils recherchent
quelquefois eux-mêmes ? « Ils perdent leurs enfans. »
Et ne leur est-il jamais arrivé de les condamner eux-mêmes
à la mort? «On les envoie en exil.» Et ne quittent-ils pas
quelquefois leur patrie pour ne la plus revoir? « On leur ôte
la vie. » Et ne se l'arrachent-ils pas de leurs propres mains ?
«Pourquoi souffrent-ils certaines adversités?» C'est pour
apprendre aux autres à souffrir. Ils sont nés pour servir
d'exemple. Figurez-vous que Dieu leur dit : «Qu'avez-vous
à vous plaindre de moi, vous qui avez embrassé la vertu?
j'ai environné les autres de biens trompeurs; j'ai abusé
des esprits frivoles, comme par la longue illusion d'un
songe. Je leur ai prodigué l'or, l'argent, l'ivoire pour parure;
mais au dedans, ils n'ont pas le moindre bien. Ces
hommes, qui vous semblent fortunés, si vous considérez,
non pas l'apparence, mais le fond, sont vils, misérables,
hideux, décorés seulement à la surface, comme
les murs de leurs palais. Ce bonheur n'est point pur et
identifié avec eux; ce n'est qu'une application, et encore
très mince. Tant qu'ils peuvent rester debout et se montrer
comme il leur plaît, ils brillent, ils en imposent;
mais, au premier accident qui les déconcerte et les met à nu, on aperçoit la boue que cachait cet éclat emprunté.
Les biens que je vous ai donnés sont permanens et durables.
Plus vous les examinerez sous toutes les faces,
plus vous y découvrirez de grandeur et de perfection. Je
vous ai accordé de braver tout ce qu'on redoute, de mépriser
tout ce qu'on désire. Votre éclat n'est point au dehors
; tous vos biens ne regardent que l'intérieur. Ainsi
le monde ne daigne rien voir hors de lui, et jouit dans la
contemplation de sa propre harmonie. J'ai placé tous vos
avantages au dedans de vous. Votre bonheur consiste à
pouvoir vous passer du bonheur.Maisil arrive des afflictions,
d'affreux revers, de rudes épreuves. Je ne pouvais
vous y soustraire, j'ai armé votre âme. Souffrez donc
courageusement; c'est par là que vous pouvez être supérieurs
à Dieu même. Il est à l'abri des maux; vous les
surmontez. Méprisez la pauvreté; on ne vit jamais aussi
pauvre qu'on le fut en naissant. Méprisez la douleur,
elle finira, ou vous finirez. Méprisez la fortune, je ne
lui ai pas donné de trait qui atteignît l'âme. Méprisez la
mort, c'est le terme, ou le changement de l'existence.
J'ai pourvu surtout à ce qu'il fût impossible de vous retenir
malgré vous dans la vie; vous pouvez toujours en
sortir. Si vous êtes las de combattre, la fuite est permise.
Voilà pourquoi, de toutes les nécessités auxquelles je vous
ai soumis, il n'y en a pas que j'aie rendue plus facile que
la mort. Votre être est placé sur une pente, un mouvement
naturel l'entraîne. Regardez un peu, vous verrez
combien est courte et dégagée la voie qui mène à la liberté.
J'ai voulu qu'il n'y eût pas besoin de tant d'efforts
pour sortir du monde, que pour y entrer. La fortune
vous aurait tenus esclaves, si l'homme avait autant de
peine à mourir qu'à naître. Tous les temps, tous les lieux peuvent vous apprendre combien il est facile de rompre
avec la nature et de lui renvoyer son présent. Au pied
des autels, au milieu des sacrifices solennels pour la conservation
de la vie, apprenez ce qu'est la mort. Les taureaux
vigoureux succombent à une petite blessure; ces
animaux si grands et si robustes, un seul coup de la
main de l'homme suffit pour les abattre. Le fer le plus
mince peut trancher les liens des vertèbres, et dès que
l'articulation qui joint le cou à la tête a été coupée, ces
masses énormes tombent. La vie ne se cache pas dans une
retraite bien profonde; il n'est pas même besoin du fer
pour l'en tirer ; il n'est pas besoin de blessures qui pénètrent
dans les entrailles ; la mort est tout proche. Je n'ai
pas marqué d'endroits pour ces sortes de coups; partout
ils peuvent se porter. Ce qu'on appelle mourir, cet
instant où l'âme se sépare du corps, est trop court, trop
rapide pour être sensible. Soit qu'un noeud vous étrangle,
soit que l'eau vous suffoque, soit que, par une chute
violente, vous vous brisiez le crâne contre la terre, soit
que vous avaliez des charbons ardens pour fermer le
passage à la respiration refoulée sur elle-même, quel que
soit le moyen, l'effet est prompt. Ne rougissez-vous pas
de craindre si longtemps ce qui dure si peu? »
FIN DE L'OUVRAGE
![]()