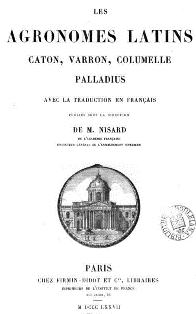
VARRON
De l'agriculture
NISARD 1877
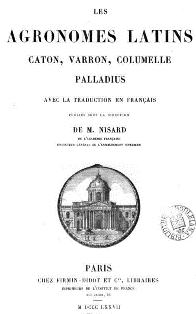
LIVRE I
I. Si j’avais du loisir, Fundania, je donnerais une meilleure forme à cet ouvrage. Tu l’auras tel que peut le faire un homme qui se dépêche: car si l’on peut dire que l’existence n’est qu’une bulle d’air, c’est encore plus vrai quand on est vieux. J’ai quatre-vingts ans; c’est l’annonce de plier bagage et de se tenir prêt à partir. Tu viens d’acheter un fonds de terre, dont tu voudrais, par une culture bien entendue, tirer le meilleur parti possible; et tu réclames à ce sujet mes soins et mes conseils. J’y ferai de mon mieux : je tâcherai même que mes instructions te profitent et pendant ma vie et après ma mort. Les paroles de la Sibylle ont bien pu être l’oracle non seulement de ses contemporains tant qu’elle a vécu, mais, après sa mort, de générations auxquelles elle ne pensait guère. Ses livres, après tant de siècles, sont encore solennellement consultés chaque fois qu’il y a parti à prendre par suite d’événements surnaturels. Ne pourrais-je pas, moi, de mon vivant, donner quelques avis utiles à ceux qui me touchent de si près? Je vais donc composer pour toi trois livres qui te serviront de guide, et auxquels tu pourras recourir au besoin pour tontes les indications relatives à la culture. Et puisque les dieux, dit-on, viennent en aide à qui s’adresse à eux, je commencerai par invoquer, non pas les Muses, à l’exemple d’Homère et d’Ennius, mais bien les douze grands dieux qui composent le conseil céleste. Je n’entends pas ces divinités citadines, six d’un sexe et six de l’autre, dont les statues dorées se dressent au Forum, mais bien les douze intelligences qui président aux travaux des laboureurs. Je commencerai donc par invoquer Jupiter et Tellus, dont la puissance embrasse le Ciel, la Terre, et tout ce que produit l’un et l’autre; parce que ce sont les générateurs de l’humanité, et que nous leur donnons les noms de père et de mère. J’invoquerai en second lieu le Soleil et la Lune dont nous observons le cours quand il s’agit d’ensemencer ou de récolter; en troisième lieu, Cérès et Bacchus, puisque les fruits qu’ils nous donnent sont indispensables à la vie. C’est par eux que la terre nous fournit aliments et boisson. En quatrième lieu, j’invoquerai le dieu Robigus et la déesse Flore, puisque l’un préserve de la rouille les blés et les arbres, et que l’autre les fait fleurir à temps : d’où les fêtes robigales en l’honneur de Robigus, et les jeux floraux en l’honneur de Flore. J’invoquerai encore Minerve et Vénus, dont l’une veille sur les plants d’oliviers, et l’autre préside au jardinage. C’est en leur honneur qu’on institua les fêtes appelées rustica uinalia. Enfin j’adresserai mes prières à la déesse Lympha et au dieu Bonus Eventus: car de même que sans l’eau toute végétation est chétive et misérable, de même sans le bon succès point de culture qui vienne à bien. Maintenant que j’ai invoqué toutes ces divinités, je vais te faire part d’entretiens que j’eus dernièrement sur l’agriculture, et qui contiennent tout l’enseignement pratique dont tu peux avoir besoin. En cas d’insuffisance, j’indiquerai les ouvrages tant grecs que latins auxquels tu pourrais avoir recours. Les auteurs grecs qui ont traité incidemment de diverses parties de l’agriculture sont au nombre de plus de cinquante. Voici ceux que tu pourras, dans l’occasion, consulter avec fruit : Hiéron de Sicile et Attalus Philométor; parmi les philosophes, Démocrite le physicien, Xénophon, disciple de Socrate, et les péripatéticiens Aristote et Théophraste; Architas le pythagoricien; ainsi qu’Amphilochus d’Athènes, Anaxipolis de Thase, Apollodorus de Lemnos, Aristophane de Mallus, Antigonus de Cyme, Agathocle de Chio, Apollonius de Pergame, Aristandre d’Athènes, Bacchius de Milet, Bion de Soles, Cheresté et Chéréas d’Athènes, Diodore de Prienne, Dion de Colophon, Déophane de Nicée, Epigène de Rhodes, Évagon de Thase; les deux Euphronius, celui d’Athènes et celui d’Amphipolis, Hégésias de Maronéa, deux Ménandre, l’un de Brienne et l’autre d’Héraclée; Nicésius de Maronéa, Pythion de Rhodes. Parmi les autres dont la patrie m’est inconnue, je citerai Androtion, Achrion, Aristomène, Athénagoras, Cratès, Dadis. Denys, Euphiton, Euphorion, Eubolus, Lysimaque, Mnaséas, Ménestrate, Plentiphane, Persis, et Théophile. Tous les auteurs que je viens de nommer ont écrit en prose; d’autres ont écrit en vers sur le même sujet: tels sont Hésiode d’Ascra et Ménécrate d’Éphèse. Le plus en réputation de tous est Magon de Carthage, qui a écrit en langue punique, et renfermé dans vingt-huit livres tout ce qui se trouvait avant lui épars çà et là dans différents ouvrages. Plus tard, Cassius Denys d’Utique en fit une traduction grecque en vingt livres, qu’il dédia au préteur Sextilius, et dans laquelle, nonobstant ce retranchement de huit livres sur l’œuvre de Magon, il sut fondre de nombreux emprunts faits aux auteurs grecs dénommés ci-dessus. Vint ensuite Diophane de Bithynie, qui fit de ces vingt livres un bon abrégé en six, offert par lui au roi Déjotarus. Je veux enchérir encore sur sa brièveté, et resserrer en trois livres la substance de son ouvrage. Le premier traitera de l’agriculture, le second du régime des troupeaux, et le troisième en général de l’engrais des animaux dans une métairie. J’élaguerai dès le premier tout ce qui, selon moi, n’a pas un rapport direct avec l’agriculture. Ainsi je commencerai par circonscrire la matière; puis je la traiterai suivant ses divisions naturelles. Mes observations seront puisées à trois sources: ma propre pratique, mes lectures, et ce que j’ai recueilli de vive voix de l’expérience d’autrui.
II. Je m’étais rendu au temple de Tellus le jour de la fête des semailles, sur l’invitation du gardien, que nous appelons avec nos ancêtres aeditimus, et dont nos puristes ont changé le nom en celui d’aedituus. J’y trouvai C. Fundanius mon beau-père, C. Agrius, chevalier romain, de la doctrine de Socrate, et le publicain P. Agrasius. Tous trois regardaient une carte d’Italie tracée sur la muraille. — Que faites-vous ici? leur dis-je. Est-ce la fête des semailles qui vous amène, pour employer vos vacances comme faisaient nos pères et nos ancêtres? Notre présence, dit Agrius, a, j’imagine, la même cause que la vôtre, l’invitation du gardien. Et si j’ai rencontré juste, attendez avec nous son retour. Il a dû comparaître devant l’édile, à qui appartient la surintendance de ce temple, et nous a fait prier de l’attendre ici. Eh bien, leur dis-je, faisons, en l’attendant, application du vieux proverbe: Le Romain triomphe assis. Très volontiers, dit Agrius; et comme il est de ceux qui pensent que le plus long d’un voyage c’est de franchir le seuil, il prit sans façon place sur un banc, et nous l’imitâmes. Quand nous fûmes assis, Agrasius, prenant la parole, nous dit : Vous autres qui avez parcouru tant de pays, en avez-vous vu de mieux cultivés que l’Italie? Pour moi, dit Agrius, je ne pense pas qu’il y en ait un seul où le sol soit comme chez nous, universellement en rapport. Par une division très naturelle, Ératosthène a fait de notre globe deux parties, dont l’une s’étend vers le midi, et l’autre vers le nord. Incontestablement la partie septentrionale est la plus saine des deux, et conséquemment la plus fertile, il faut donc reconnaître cette partie, et l’Italie notamment, comme plus propre à la culture que l’Asie. L’Italie d’abord est en Europe; en second lieu, on y trouve une température plus douce qu’en pénétrant dans l’intérieur de cette partie du monde, où règne un hiver permanent. Ce qui est tout simple, puisqu’elle a des régions situées entre le cercle polaire et l’axe même du ciel, où le soleil est invisible six mois de l’année. On dit même que des glaces éternelles couvrent la mer dans ces parages, et y rendent la navigation impossible. Eh bien! dit Fundanius, croyez-vous un tel sol capable de produire, ou ses productions susceptibles de culture? Pacuvius l’a dit: Sous un soleil ou sous une nuit sans fin, toute végétation périrait par le chaud ou par le froid. Même dans ce pays, où le jour et la nuit nous sont mesurés convenablement par alternative, je ne puis vivre pendant l’été à moins de couper, par un somme, la journée en deux parties. Comment donc faire là où l’année n’a qu’un jour et une nuit de six mois chacun, pour semer, cultiver et recueillir? En Italie au contraire, quelle est la production utile à la vie qui ne croisse et ne prospère? Quel froment comparable au froment de Campanie? quel blé, au blé d’Apulie? quel vin, au vin de Falerne? Quelle huile, à l’huile de Venafre? A cette multitude d’arbres qui couvre le sol de notre pays, ne dirait-on pas d’une vaste fruiterie? Est-elle plus peuplée de vignes, cette Phrygie g-ampeloessan (vinicole), comme l’appelle Homère? ou cette Argos que le même poète appelle g-polupuron (frugifère) est-elle plus abondante en blé? Dans quel pays du monde un arpent de terre produit-il dix et même quinze cullei de vin, comme certaines contrées de l’Italie? M. Caton n’a-t il pas écrit ces mots dans son livre des Origines: « On appelle gallo-romaines les terres comprises entre Riminum et le Picentin, et qui furent distribuées à l’armée des Gaules. Là on récolte quelquefois dix cullei par chaque arpent de terre. » D’ailleurs, ne voyons-nous pas à Faenza (Faventia) des vignobles rapporter, par arpent, trois cents amphores; ce qui leur a fait donner le nom de trécennaires ? Votre ami L. Martius, ajouta-t-il en me regardant, qui est préposé à la surveillance des arsenaux, m’a certainement dit que ses vignes de Faenza lui rendaient tout autant. Le cultivateur en Italie considère avant tout deux choses: D’abord, la récolte donnera-t-elle l’équivalent des avances et de la peine? Puis, l’air du pays est-il salubre? Quiconque néglige au préalable un de ces deux points est un fou. Qu’on lui cherche des tuteurs dans ses parents de l’une ou de l’autre branche. Nul homme sensé ne peut vouloir se mettre à découvert des frais de culture, si d’avance il voit qu’il n’a pas de récolte à attendre, ou qu’il risque de la perdre par l’insalubrité du pays. Mais voici, je pense, des hommes plus compétents que moi sur cette matière; car je vois venir C. Licinius Stolon et Cn. Tremellius Scrofa. Le premier compte parmi ses ancêtres les auteurs de nos lois sur la mesure des terres. Cette loi, qui défend à tout citoyen romain de posséder plus de cinq cents arpents, est d’un Licinius qui acquit le surnom de Stolon par les soins qu’il donnait à la culture; soins qu’il portait à ce degré de minutie qu’on n’aurait pu trouver le moindre rejeton (stolon) inutile dans toutes ses propriétés. Il fouillait autour des arbres pour arracher cette végétation parasite qu’on appelle stolon. C’est encore de cette même race que tire son origine, cet autre C. Licinius qui, étant tribun du peuple 365 ans après l’expulsion des rois, conduisit le premier le peuple romain du lieu des comices dans le Forum, et y fit accepter la loi qui assignait à chaque citoyen sept arpents de terre. L’autre est Cn. Tremellius Scrofa, votre collègue dans la commission des vingt distributeurs des terres de la Campanie. C’est un homme rempli de qualités, et qui passe pour le Romain le plus versé dans la science de l’agriculture. Et ce n’est pas sans cause, repartis-je; car ses terres doivent à ses soins un aspect que bien des gens préfèrent à celui des royales constructions de tant d’autres. J’entends ceux qui visitent une maison de campagne non pour y chercher, comme dans celles de Lucullus, des galeries de tableaux, mais des greniers bien garnis. D’ailleurs, ajoutai-je, ses fruiteries ont l’avantage d’être situées au bout de la voie Sacrée où les fruits se vendent au poids de l’or. Là-dessus les deux nouveaux venus nous rejoignent, et Stolon nous dit : Arrivons-nous trop tard? le diner est-il déjà mangé? Où est donc L. Fundilius, notre hôte? Rassurez-vous, reprit Agrius; on n’a pas encore ôté l’œuf qui, dans les jeux du Cirque, annonce la clôture des courses. Nous n’avons même pas vu encore celui qui est le signal des pompes du banquet. En attendant qu’il apparaisse, et que notre hôte soit de retour, parlez-nous de l’utilité de l’agriculture, ou de ses jouissances, ou des deux choses à la fois. Car c’est dans vos mains qu’est aujourd’hui le sceptre de cette science, comme autrefois dans celles de Stolon. Il y a, dit Scrofa, une distinction à faire. Bornons-nous l’agriculture à ce qui est relatif à l’ensemencement des terres? ou faut-il comprendre dans cette dénomination ce qui touche à la population animale des campagnes, les troupeaux, le gros bétail? Je vois que tous ceux qui ont écrit sur cette science en langue punique, en grec ou en latin, ont dépassé les limites de leur sujet. C’est en quoi je pense qu’il ne faut pas les imiter, reprit Stolon. Je suis de l’avis de ceux qui ont resserré le domaine de la science, en écartant tout ce qui n’a pas avec elle une relation immédiate. Ainsi le soin des troupeaux, que nombre d’auteurs ont rattaché à l’agriculture, me paraît appartenir plutôt au régime pastoral qu’au régime agricole. Aussi avons-nous des noms différents pour les préposés en chef à l’un et l’autre office. Nous appelons les uns uillici, les autres magistri pecorum (maîtres des troupeaux). Le uillicus est celui qui est spécialement chargé de la culture de la terre. Le nom lui vient de uilla (exploitation rurale), parce que c’est lui que regarde le soin de la rentrée des récoltes à la villa et de leur sortie pour la vente. C’est ainsi qu’aujourd’hui encore les paysans, au lieu de dire uia (route), disent uea, dérivé de uectura (transport); de même qu’ils disent, uella au lieu de uilla, dérivé de ueho (je transporte), comprenant par uella le lieu où l’on porte, et d’où l’on transporte. C’est par la même analogie que le métier de voiturer (uectura) se dit uellaturam facere. Assurément, dit Fundanius, l’agriculture est une chose, et le nourrissage une autre; mais ces choses se touchent. La flûte de droite et la flûte de gauche sont distinctes, mais connexes. L’une est là pour le chant, l’autre pour l’accompagnement. Ajoutez, repris-je, qu’à la vie pastorale appartient la première partie; à la vie agricole la seconde. C’était là du moins le sentiment du savant Dicéarque, qui, dans son tableau des mœurs primitives de la Grèce, nous apprend qu’en ces temps reculés les hommes menaient la vie des pasteurs; qu’ils ne savaient ni labourer la terre, ni planter, ni tailler les arbres; et qu’il faut rapporter à une période plus récente les premiers essais de la culture. Ainsi ce dernier art est subordonné au premier, comme la flûte de gauche l’est à la flûte de droite. Avec votre musique, dit Agrius, non seulement vous enlevez au maître les troupeaux qu’il possède, et à l’esclave le pécule que le maître lui abandonne, mais encore vous annulez la loi rurale qui défend de mener paître, sur un terrain de nouvelle plantation cette race d’animaux que l’astrologie a placée dans le ciel près du Taureau, je veux dire les chèvres. Prenez garde de citer exactement, interrompit Fundanius. La loi dit encore: Et autres espèces de bétail. Car il y a certainement des animaux qui sont le fléau de la culture, notamment les chèvres, dont vous venez de parler. Elles ont la dent venimeuse, et détruisent, en broutant, toutes les jeunes plantes, et surtout les vignes et les oliviers. Aussi est-il reçu parmi nous qu’à telle divinité on sacrifie un bouc, tandis que telle autre en repousse l’offrande; symbole d’aversion pour l’animal chez toutes deux. L’une veut sa mort; l’autre ne veut pas même le voir. C’est ainsi qu’on immole les boucs à Bacchus, père de la vigne, comme pour leur faire payer de leur tête les torts qu’ils lui font, tandis qu’au contraire nous ne voyons jamais immoler à Minerve aucun individu de cette race, précisément parce qu’on prétend que l’olivier devient stérile du moment que la dent d’un bouc y a touché, rien que la salive de l’animal étant un poison pour cette plante. C’est encore pour la même raison qu’il n’entre de chèvres pour victimes qu’une seule fois par an dans le temple d’Athènes. Et encore n’est-ce là qu’un sacrifice qu’on a jugé nécessaire pour empêcher cette race de nuire à l’olivier, qu’on dit avoir pris naissance dans cette ville. Il n’y a, repris-je, de bestiaux utiles à l’agriculture que ceux dont le travail contribue à rendre les champs fertiles; et ce sont ceux qu’on attelle à la charrue. S’il en est ainsi, dit Agrasius, comment une terre se passerait-elle de bestiaux, puisque l’engrais, cet élément si essentiel de toute culture, ce sont les bestiaux qui le produisent? Alors, dit Agrius, il faut admettre aussi qu’un troupeau d’esclaves fait partie de l’exploitation agricole, si l’on juge à propos d’en entretenir un pour le même motif. Vous errez en ce que vous dites: Ces troupeaux peuvent être utiles; donc il faut avoir des troupeaux. Ce n’est pas une conséquence. Avec ce raisonnement on arriverait à encombrer une métairie des professions les plus étrangères au travail des champs, de tisserands, d’ouvriers en draps, et autres. Eh bien, dit Scrofa, séparons de l’agriculture proprement dite le nourrissage des bestiaux. Quelle distinction faut-il faire encore? Irons-nous, repris-je alors, imiter les deux Saserna, et discuter, comme ils l’ont fait dans leurs livres, si l’art du potier n’a pas plus d’analogie que la science des mines avec l’agriculture? Sans contredit la matière vient du sol, mais n’est pas plus pour cela du ressort de l’agriculture que ne le sont les carrières et les sablonnières. Ce n’est pas que si tel fonds de culture peut admettre concurremment ce genre d’exploitation, je prétende qu’il faille l’exclure, et négliger le profit qu’on peut en tirer. Sans doute si, dans un fonds qui avoisine une grand-route, il se trouve un emplacement propice à la réception des voyageurs, on fera bien d’y construire une auberge. Mais ce genre d’entreprise, quels qu’en soient les bénéfices, ne saurait être considéré comme du domaine de l’agriculture. Car, dans les profits qu’on peut tirer directement ou indirectement de sa terre, il n’y a de vraiment agricole que ce qui est produit d’ensemencement. Stolon m’interrompit. Vous êtes jaloux de ce grand auteur, dit-il. Ce n’est que par esprit de critique que vous l’attaquez à l’endroit des poteries. Il a dit ailleurs d’excellentes choses qui rentrent certainement dans notre sujet, et dont vous ne parlez pas, afin de n’être pas obligé d’en faire l’éloge. Cette saillie fit sourire Scrofa, qui connaissait l’ouvrage et ne l’estimait guère; mais Agrasius, qui en jugeait différemment, croyant aussi le connaître, demanda à Stolon ce qu’il en pensait. Voici, dit Stolon, la recette que donne cet auteur pour détruire les punaises: « Faites infuser dans de l’eau un concombre sauvage. Partout où vous répandrez de cette eau, les punaises n’approcheront point. » Ou bien encore: « Frottez votre lit avec du fiel de bœuf délayé dans du vinaigre. » Eh bien, dit alors Fundanius s’adressant à Scrofa, voilà pourtant qui touche à l’agriculture. Oui, dit Scrofa, autant que son onguent épilatoire: « Prenez une grenouille jaune; faites-la bouillir dans l’eau jusqu’à réduction des deux tiers, et frottez-vous avec le résidu. » Moi, repris-je, je citerais plus volontiers le passage qui traite de l’incommodité dont est affligé Fundanius. Il souffre des pieds au point que la douleur lui fait rider le front. Vite la citation, s’écria Fundanius. J’aime mieux apprendre à guérir mes pieds qu’à planter des pieds de poirée. Quant à cela, dit Stolon en souriant, je me fais fort de vous communiquer la formule telle que l’auteur l’a déposée dans son livre, et que je l’ai entendue lire par Torquenna. Il faut d’abord que le malade, sitôt qu’il commence à sentir des douleurs aux pieds, pense à celui qui doit opérer sa guérison. Eh bien, reprit Fundanius, je pense à vous; guérissez mes pieds. Écoutez donc, continua Stolon: « Que la terre garde la maladie, et que la santé reste ici! » Il nous recommande de dire à jeun ces paroles trois fois neuf fois, de toucher la terre, et de cracher en même temps. Vous trouverez encore, repris-je, dans le livre des Saserna beaucoup d’autres secrets miraculeux également étrangers à l’agriculture, et qu’il faut laisser où ils sont. D’ailleurs, ajoutai-je, de semblables digressions se rencontrent dans beaucoup d’auteurs. Le traité d’agriculture de Caton lui-même en fourmille. On y trouve entre autres des procédés pour faire la galette, pour apprêter le libum, pour saler les jambons. Vous oubliez, dit Agrius, un article important: « Voulez-vous, dit Caton, boire beaucoup et manger encore davantage ? Avalez avant de vous mettre à table du chou cru, macéré dans du vinaigre, et prenez-en cinq feuilles encore après le repas. »
III. Nous venons, dit Agrius, d’écarter de l’agriculture tout ce qui lui est étranger: Il nous reste à parler de ce qui forme le domaine de la science. Qu’est-ce que l’agriculture? Est-ce un art? et si c’est un art, quel est son principe et sa fin? Stolon se tournant vers Scrofa, C’est à vous, notre supérieur à tous en rang, en âge et en lumières, à nous résoudre ces diverses questions. Scrofa, sans se faire prier, s’exprima ainsi: L’agriculture est un art, et un art aussi grand qu’il est nécessaire. Il nous apprend quel sol est propice à telle semence, quels travaux sa culture exige, et quelles qualités de terroir promettent des récoltes abondantes et continues.
IV. Les éléments de cet art sont les mêmes dont Ennius a dit qu’ils constituent le monde : l’eau, la terre, l’air, et le feu. Avant donc de confier vos semences à la terre, il importe d’étudier ces différents éléments, source première de toute production. C’est de cette connaissance que devront partir les agriculteurs pour conduire leurs travaux au double but d’être utile et de plaire: l’un solide, l’autre agréable. Mais au solide est due la préférence sur ce qui est de pur agrément. Il peut résulter toutefois de la même disposition, qu’une terre gagne à la fois en aspect et en produit; qu’elle soit de meilleure défaite et augmente de valeur réelle. De belles lignes d’oliviers, par exemple, ou d’autres arbres à fruit, auront cet avantage. A égalité de valeur entre deux objets, qui n’aime mieux payer plus cher celui qui flatte la vue? Sous le rapport d’utilité, préférez le fonds de terre le plus salubre; car, sans salubrité, point de récolte assurée. Dans un sol malsain, si fertile qu’il soit, le fruit du travail, à chaque instant, peut être détruit par des fléaux de tout genre. Là où l’on a sans cesse à compter avec le trépas, il s’agit, pour le cultivateur, non de recueillir, mais de vivre. Ainsi, dans toute contrée malsaine la culture n’est en quelque sorte qu’un jeu de hasard, auquel le propriétaire risque sa vie et sa fortune. La science toutefois peut atténuer le mal; car, sans avoir d’action directe sur l’insalubrité, dont les conditions résident dans le sol et l’atmosphère, et procèdent de la nature, nous y pouvons beaucoup cependant. On parvient par une attention intelligente à en atténuer les effets. Les influences malignes ou du sol ou des eaux, les miasmes fétides qui s’exhalent en certaines localités, l’exposition à un soleil trop ardent ou à des vents contraires, tous ces inconvénients se corrigent par des dépenses bien entendues. On voit de quelle importance est la position topographique des bâtiments d’exploitation, leur étendue, et l’exposition de leurs ouvertures, portes, portiques et fenêtres. N’a-t-on pas vu la science d’Hippocrate, dans un temps de peste, préserver de la contagion non seulement une maison, des champs, mais des villes entières? Mais où vais-je chercher le témoignage d’Hippocrate? N’avons-nous pas ici notre ami Varron, qui, lorsque l’armée et la flotte se trouvaient à Corcyre, et que toutes les maisons regorgeaient de malades et de morts, fit percer de nouvelles fenêtres pour donner passage au vent du nord, murer les anciennes qui laissaient pénétrer l’air infecté, pratiquer de nouvelles portes, et qui, par mille autres soins de ce genre, parvint à ramener ses compagnons sains et saufs dans leur patrie?
V. Nous avons déterminé les principes de l’agriculture et son but: Il nous reste à examiner les différentes parties dont sa science se compose. Quant à moi, dit Agrius, je suppose que le nombre doit en être infini, quand je vois cette multitude de livres que Théophraste a composés sous les titres d’histoire des plantes et des causes de la végétation en général. A mon avis, reprit Stolon, ces livres conviennent bien moins aux hommes qui cultivent la terre qu’à ceux qui fréquentent les écoles des philosophes. Ce qui ne veut pas dire que les uns et les autres ne puissent y rencontrer des enseignements utiles. Quoi qu’il en soit, veuillez nous expliquer vous-même les différentes parties de l’agriculture. Elle en comprend, dit Scrofa, quatre principales. Elles consistent à bien connaître: la première, le fonds à exploiter, la nature du sol et ses éléments constitutifs; la seconde, le personnel et le matériel nécessaires à son exploitation; la troisième, les façons que le terrain exige; la quatrième enfin, quelles époques de l’année conviennent à chacune d’elles. Chacune de ces quatre parties se subdivise elle-même au moins en deux autres. Les deux subdivisions de la première ont pour objet, l’une la terre elle-même, et l’autre les bâtiments et les étables. La seconde partie principale, qui embrasse tout l’effectif d’un fonds de culture, a également deux subdivisions, dont la première comprend les travailleurs, et la seconde les instruments aratoires. La troisième partie principale, qui a pour objet la direction des travaux, renferme d’une part les opérations préparatoires, et, de l’autre, le choix des lieux où l’on doit les exécuter. La quatrième partie, qui traite des différentes époques de l’année, comprend, dans sa première subdivision, tout ce qui a rapport à la révolution annuelle du soleil et au cours mensuel de la lune. Je commencerai par parler de ces quatre parties principales; puis je traiterai avec plus de détail les huit subdivisions.
VI. En considérant un fonds sous le rapport du sol, nous avons à examiner quatre points principaux, savoir la configuration du terrain, sa qualité, l’étendue de la propriété, et quelles chances de sécurité elle offre par elle-même. Un terrain doit sa configuration à la nature, qui l’a bien ou mal disposé, ou à la main de l’homme, qui l’a transformé pour la culture en bien ou en mal. Parlons d’abord de la configuration naturelle. Nous reconnaissons trois genres de terrains simples : celui des plaines, celui des collines, et celui des montagnes; des mixtes, qui se combinent de deux de ces genres ou des trois ensemble. On en trouve de fréquents exemples. Il y a pour chacun des trois genres simples des systèmes de culture différents. Sans contredit celui qui convient aux plaines ne peut s’appliquer, soit aux montagnes où la température est bien moins élevée, soit aux collines, où elle est plus froide que dans les premières localités, et plus chaude que dans les secondes. Cette différence entre les fonds de terrain simple est d’autant plus sensible qu’ils occupent respectivement plus de superficie. Plus le sol est découvert, plus la chaleur a d’intensité. C’est ce qui fait qu’en certains cantons l’atmosphère est si ardente et si lourde, et que dans les régions élevées, sur le Vésuve, par exemple, l’air est plus léger, et par conséquent plus sain. Ceux qui cultivent des terrains bas souffrent pendant l’été, au lieu que ceux qui cultivent des terrains élevés souffrent davantage pendant l’hiver. L’hiver est la saison propice pour ceux qui cultivent des plaines, parce qu’alors les prés sont en herbe, et les arbres en état d’être taillés. L’été au contraire est favorable à ceux qui cultivent les hauteurs, parce que durant cette saison les pâturages y abondent, tandis qu’ils sont brûlés dans les plaines. D’ailleurs l’air alors n’y est que frais; ce qui convient aux opérations forestières. Pour le sol des plaines, le plan incliné vaut mieux que l’absolu niveau; car le défaut de pente tend à former des marécages, les eaux ne trouvant pas d’écoulement, Aussi le terrain est-il d’autant plus défectueux qu’il est plus inégal; ce qui multiplie les bas fonds où l’eau séjourne. L’époque des semailles arrive plus tôt dans les plaines que sur les hauteurs, où l’on est obligé de gagner de vitesse, et d’attendre plus tard les récoltes. Certains arbres, comme l’érable et le sapin, n’atteignent toute leur hauteur, tout leur développement, que sur les montagnes, grâce à l’air vif qui y domine, D’autres, tels que les peupliers et les saules, ne prospèrent que dans les températures moyennes, comme la nôtre. Il en est qui ne réussissent que dans les terrains élevés, comme l’arbousier et le chêne. D’autres enfin n’aiment que les terrains bas, comme l’amandier et le figuier. Les productions des collines, suivant leur degré d’élévation, se rapprochent plus ou moins de celles des plaines et des montagnes. La culture varie suivant ces trois conditions du sol: on préfère les plaines pour le blé, les coteaux pour la vigne, et, pour les forêts, les montagnes. Toutes ces considérations doivent être respectivement pesées pour la culture de chaque ordre de terrain.
VII. En ce qui concerne la configuration naturelle, dit Stolon, je suis assez de l’avis de Caton, que le meilleur fonds de terre est celui qui se trouve placé au pied d’une montagne, et exposé au midi. Mais je soutiens, répond Scrofa, qu’en fait de culture, le produit est en raison de ce que l’aspect plaît plus à l’œil. C’est l’effet de la plantation en quinconce, et de l’observation des distances pour les pépinières, Aussi nos pères, avec leurs méthodes vicieuses, ne tiraient-ils, d’une égale superficie de terrain, que des blés et des vins inférieurs aux nôtres en quantité comme en qualité. C’est qu’avec la symétrie on ménage mieux l’espace, et que, par suite, chaque plant est moins exposé à se voir intercepter par son voisin l’influence du soleil, de la lune ou de l’air. Un exemple va rendre ceci plus sensible. La même quantité de noix, qui se tasse parfaitement dans un boisseau avec les coques entières, va difficilement entrer dans une mesure d’un boisseau et demi, quand vous l’aurez concassée. Vos plants, dûment alignés, en seront plus accessibles à l’action du soleil et de la lune, vous donneront plus de raisins ou d’olives, qui viendront mieux à maturité; double résultat entraînant ces deux conséquences, meilleure récolte d’huile et de vin, augmentation de profit. Nous voici arrivés à la seconde partie, qui traite des indications auxquelles on reconnaît qu’une terre est bonne ou mauvaise. C’est en effet de la qualité de la terre que dépend le choix des fruits qu’on peut y semer et recueillir, et le genre de culture qui lui est applicable. Le même sol ne convient point également à toutes sortes de productions. Celui-ci est spécialement propre à la vigne; celui-là au blé; et tel, à telle autre production, C’est ce qui fait sans doute qu’il y a dans l’île de Crète, près de Cortynia, un platane qui, même en hiver, ne se dépouille point de ses feuilles, Théophraste en mentionne un pareil dans l’île de Chypre. Il y a aussi devant la ville de Sybaris, que l’on appelle aujourd’hui Thurium, un chêne qui offre le même phénomène. Nous voyons enfin, dans les campagnes d’Éléphantine, des figuiers et des vignes qui ne s’effeuillent jamais. C’est encore par la même raison que beaucoup d’arbres portent des fruits deux fois par an, comme les vignes de Smyrne près de la mer, et les pommiers dans les champs de Consentinum. Autre preuve de cette observation. La culture donne en meilleure qualité les fruits que la nature sauvage produit en plus grande abondance. On peut citer encore les plantes qui ne peuvent vivre que dans un terrain aqueux, ou même au milieu de l’eau. Encore ne viennent-elles pas indistinctement dans toute espèce d’eau, puisque les unes réussissent mieux dans les lacs, comme les roseaux, dans le pays de Réate; les autres en eau courante, comme les aunes d’Épire; d’autres enfin dans la mer, comme les squilles et les palmiers, au dire de Théophraste. Quand j’étais à la tête de l’armée, j’ai vu dans l’intérieur de la Gaule Transalpine, près du Rhin, des contrées où il ne croît ni vignes, ni oliviers, ni pommiers; où l’on emploie une sorte de craie blanche pour fumer la terre; et où les habitants, au lieu de sel marin ou fossile, se servaient de charbons salés, qu’ils obtenaient de la combustion de certains bois. Stolon prit alors la parole, et dit : Caton, en examinant l’une après l’autre les différentes espèces de terres, les échelonne suivant leur qualité, et les divise en neuf classes. Dans la première, il met les terres à vignes, qui rapportent avec abondance un vin de bonne qualité; dans la seconde, les terres de jardin d’une irrigation facile; dans la troisième, les terrains propres aux saules; dans la quatrième, les terres qui conviennent aux plants d’oliviers. Dans la cinquième classe sont les prairies; dans la sixième, les terres à blé; dans la septième, les bois en coupe réglée; dans la huitième, les vergers ; dans la neuvième enfin, les terres où l’on récolte le gland. Je sais bien, dit Scrofa, que Caton a écrit cela; mais ce n’est pas l’avis de tout le monde. Il en est qui mettent les bonnes prairies en première ligne ; et je suis de ce nombre. Nos pères les appelaient parata, et non prata à cause de leur production spontanée. César Vopiscus, en plaidant un jour devant les censeurs, cita la campagne de Roséa comme la nourricière de l’Italie. L’échalas qu’on y oubliait la veille, disait-il, ne se retrouvait plus le lendemain; parce que l’herbe l’avait recouvert entièrement.
VIII. Les vignobles ont des adversaires qui prétendent que les frais de culture absorbent le produit. Les vignobles de quelle espèce dis-je? car il y en a plusieurs. L’espèce rampante, qui n’a pas besoin d’échalas, et qu’on rencontre en Espagne ; et l’espèce à haute tige, si commune en Italie, et dont les ceps sont isolés et maintenus en direction verticale par des échalas, ou assujettis ensemble par le haut à l’aide de traverses. C’est ce qu’on appelle marier la vigne. On emploie comme traverses, ou des perches, ou des roseaux, ou des cordes, ou la vigne elle-même. Le premier de ces moyens est en usage à Falerne; le second à Arpinum; le troisième à Brindes, et le quatrième dans la campagne de Milan. On procède à cette opération de deux manières, par lignes directes, ou par lignes croisées. C’est la plus ordinaire en Italie. Si le maître de la vigne tire de son propre fonds la matière qu’il emploie comme soutien, il n’a plus à redouter la dépense. Elle n’est même qu’insensible, au cas où il peut s’approvisionner dans le voisinage. Pour qu’il ait cette matière à sa disposition, il suffit, dans l’un des trois premiers cas, que sa propriété produise, soit du saule, soit des roseaux, soit du jonc ou quelque plante analogue. Dans le quatrième, il faut des arbustes propres à servir aux ceps de conducteurs. Dans la campagne de Milan on se sert à cet effet des érables; à Canusium, on emploie les figuiers, dont on entrelace les branches aux vignes. Quant aux échalas, il y en a quatre espèces. D’abord ceux qu’on tire du cœur de chêne ou de genévrier; ce sont les plus solides et ceux qui servent le mieux. Puis ceux qui proviennent de branches façonnées en pieux ou perches, qu’il faut choisir de bois compact, pour plus de durée, et qu’on retourne quand l’humidité de la terre les a pourris d’un bout, pour les enfouir par l’autre. Il s’en fabrique subsidiairement d’une troisième espèce avec des roseaux, quand on manque de matériaux pour les deux premières. On prend plusieurs tiges de roseaux, qu’on assujettit ensemble avec un lien d’écorce d’arbre et qu’on introduit dans des tubes de terre cuite, pour faire écouler l’humidité. La quatrième espèce pourrait être qualifiée d’échalas naturels. Ce sont les arbres qui en font l’office. Les rameaux de la vigne, qui s’élancent de l’un à l’autre, sont appelés par les uns traduces, et par les autres rumpi. Il faut que la vigne s’élève à hauteur d’homme, et que les échalas soient espacés de manière qu’un attelage de bœufs puisse labourer dans les intervalles. C’est un vignoble peu coûteux que celui qui, sans exiger de soutiens, rend la contenance d’un acratophore. On distingue deux sortes de vignes. Les grappes de l’une rampent sur le sol. Cette espèce est commune dans certains cantons d’Asie, et les renards y vendangent autant que les hommes. La présence des souris est encore une cause de déchet; à moins qu’on n’ait le soin de multiplier les souricières dans les vignobles, ainsi que cela se pratique dans l’île de Pandataire. Quant à l’autre espèce de vignes, on éloigne de la terre, en les élevant, les pousses qui promettent du raisin. On place à cet effet, au-dessous de ces pousses, à l’endroit où se forment les grappes, de petites branches en fourche de deux pieds de longueur environ. Par ce moyen, les sarments ainsi soutenus deviennent insensiblement, pour les vendanges à venir, des branches à fruit, que l’on attache en conséquence au cep avec une petite corde, ou cet autre lien que nos ancêtres appelaient cestus. Dans les pays qui produisent cette espèce de vignes, quand le dernier vendangeur a montré ses talons, le maître prend soin de faire rentrer chez lui toutes ces fourches, afin de les remettre en œuvre, sans nouveaux frais, l’année suivante. A Réate on n’y manque jamais. Du reste, le mode de culture appliqué à la vigne dépend surtout de la nature du sol. En effet, dans les terrains humides il importe d’élever davantage la vigne ; car le jus de la treille, lorsque la grappe se forme et grossit, ce n’est pas de l’eau qu’il demande, comme lorsqu’il est dans la coupe, mais du soleil; et c’est pour cela que les ceps tendent continuellement à grimper après les arbres.
IX. Il importe donc, comme je viens de le dire, de bien connaître la qualité de la terre, et à quel genre de production elle est propre ou impropre. Le mot terre a trois acceptions différentes, un sens général, un sens propre, et un sens mixte. Il est pris dans le sens général, lorsqu’on dit le globe de la terre, la terre d’Italie, ou de toute autre contrée; car alors on comprend dans cette dénomination la pierre, le sable, et les éléments divers dont la terre est composée. Le mot est pris dans le sens propre, lorsqu’on dit la terre d’une manière absolue, sans qualification ni épithète. Enfin il est pris dans le sens mixte, lorsqu’on parle de la terre comme propre à recevoir les semences et à les développer. C’est ainsi qu’on dit : une terre argileuse, une terre pierreuse, etc. Le mot terre, pris dans ce dernier sens, présente une idée non moins complexe que dans le sens général, et suppose un même composé de diverses substances. En effet, tout cet amalgame de corps étrangers que la terre, prise dans le sens général, renferme dans son sein, suivant les variétés de sa puissance génératrice, pierre, marbre, moellon, silex, sable, argile, rubrique, poussière, craie, gravier, charbon (résidu de la combustion des racines quand la terre est chauffée par le soleil jusqu’à l’incandescence), tout cet amalgame, dis-je, se retrouve dans ce qu’on appelle terre pris dans le sens propre, et la fait qualifier d’argileuse, de sablonneuse, etc., suivant l’élément qui domine. Ces différentes espèces de substances constituent donc autant d’espèces de terre, dont chacune comporte au moins trois degrés dans son essence. Un terrain pierreux, par exemple, ou l’est excessivement, ou l’est médiocrement, ou ne l’est presque point. Mêmes distinctions à faire dans chacune des autres espèces. De plus, chacun de ces degrés de relation est lui-même subdivisible en trois, puisqu’on y rencontre ou l’extrême sécheresse, ou l’extrême humidité ou l’habitude intermédiaire, toutes modifications qui n’ont pas une médiocre influence sur le revenu. Aussi le cultivateur expérimenté sèmera plutôt du froment que du blé commun dans un terrain humide, donnera, si son terrain est sec, la préférence à l’orge sur le blé, et confiera indifféremment l’un ou l’autre à un terrain mixte. Il est d’autres distinctions à faire, plus subtiles encore que les précédentes. Pour un terrain sablonneux, par exemple, il importe de savoir si le sable est blanc ou rouge; car le sable blanc ne convient pas aux pépinières, qui réussissent parfaitement dans le sable rouge. Il importe encore beaucoup de classer les terres selon qu’elles sont grasses ou maigres, ou entre les deux. Autant les grasses sont fertiles, autant les maigres le sont peu. Dans ces dernières point d’arbres touffus, point de vignes de rapport, point de paille fournie, point de grosses figues. Témoin les champs de Pupinia : on n’y voit qu’arbres chétifs, que prés arides, et envahis par la mousse. Dans les cantons, au contraire, où la terre est grasse, comme en Étrurie, partout de belles récoltes, et belles tous les ans; des arbres à feuillage épais, et de la mousse nulle part. Le parti qu’on tire d’une terre moyenne comme celle des environs de Tibur, est en raison de sa plus grande affinité avec les grasses qu’avec les maigres. Diophane de Bithynie, reprit alors Stolon, dit avec assez de raison qu’on peut juger de la qualité d’une terre par induction tirée de son apparence extérieure, ou de ce qu’elle produit naturellement. On examine, dans le premier cas, si sa couleur est claire ou foncée, si elle est légère, facile à remuer, friable ou compacte; dans le second cas, si sa végétation spontanée est abondante et promet maturité. Mais continue, parlez-nous maintenant de la troisième partie, qui a pour objet les différentes mesures établies dans chaque pays.
X. Scrofa reprit en ces termes : Chaque pays a sa mesure particulière. Dans l’Espagne ultérieure, on mesure les terres par iugum; en Campanie, par uersus; et, dans la campagne romaine, ainsi que dans tout le Latium, nous procédons par iugerum. On appelle iugum l’étendue que deux bœufs attelés ensemble peuvent labourer en un jour; uersus, une superficie de cent pieds carrés. Le iugerum contient deux actus quadratus; et un actus quadratus est de cent vingt pieds carrés. L’actus quadratus est appelé en latin acnua. La moindre des fractions d’un iugerum s’appelle scrupulum, et a dix pieds en longueur et autant en largeur. D’après ces bases, les arpenteurs comptent habituellement l’excédant du iugerum par onces, sextant, ou quelque autre partie aliquote de l’as, puisque le iugerum se compose de deux cent quatre-vingt-huit scrupules, ce qui forme précisément le même nombre d’unités qu’en contenait notre ancien as avant la guerre punique. Deux iugera réunis, du temps de Romulus, formaient un héritage. C’était, dit-on, la part que Romulus avait affectée à chaque citoyen, comme transmissible à ses héritiers. Dans la suite, cent héritages prirent le nom de centurie. La centurie est une surface carrée, dont chacun des côtés a deux mille quatre cents pieds de longueur. Quatre de ces centuries jointes ensemble, de manière qu’il y en ait deux de chaque côté, s’appellent saltus dans les partages publics des terres.
XI. Il est arrivé souvent que, faute de mesure exacte de la propriété, on a donné aux bâtiments plus ou moins d’étendue qu’il ne fallait : deux erreurs très préjudiciables à la bonne gestion du bien et à son revenu. En effet, lorsque les bâtiments sont plus grands que la terre ne comporte, les frais de construction et d’entretien sont relativement trop considérables aussi. Quand ils sont trop petits pour la grandeur du fonds, la récolte peut se perdre. Qui doute en effet qu’il ne faille donner plus de développement aux celliers quand on a des vignobles, aux greniers quand on a des terres à grain? Quand vous construirez une métairie, ayez soin de vous ménager une prise d’eau dans son enceinte, ou le plus possible à proximité. Le mieux est d’avoir chez soi la source; sinon, qu’elle ait du moins un cours constant. A défaut d’eau vive, établissez des citernes intérieures, et des abreuvoirs à ciel ouvert; les unes pour vos gens, les autres pour votre bétail.
XII. Pour vos constructions, choisissez de préférence le pied d’un coteau boisé, riche en pâturages, et l’exposition la plus saine. La meilleure de toutes est le levant d’équinoxe; car on y a de l’ombre en été et du soleil en hiver. Etes-vous forcé de bâtir au bord d’un fleuve? ouvrez vos jours de l’autre côté, sans quoi les habitations seraient froides pendant l’hiver et peu saines pendant l’été. Il faut éviter avec un soin égal le voisinage des lieux marécageux: d’abord, parce que les mêmes inconvénients s’y trouvent; et puis, parce que les marais venant à se dessécher engendrent une multitude d’insectes imperceptibles qui s’introduisent par la bouche et les narines avec l’air que l’on respire, et occasionnent ainsi des maladies graves. Mais, dit Fundanius, si j’héritais d’une terre dans cette condition, qu’aurais-je à faire pour me préserver de ses malignes influences? A cette question, dit Agrius, la réponse est facile. Vendre le plus cher, et, si l’on ne trouve acheteur, déguerpir le plus tôt possible. Scrofa continua en ces termes: il faut encore éviter que la façade ne se trouve dans la direction d’un vent pernicieux; et ne point bâtir dans le creux d’un vallon. Une assiette élevée est préférable, le moindre souffle suffisant pour dissiper les émanations inférieures, s’il y en a. Un bâtiment où le soleil donne tout le jour est dans la condition la plus saine. Il ne craint pas l’invasion des insectes: le vent les emporte, ou la sécheresse les tue. Les inondations, les débordements sont à craindre pour ceux qui habitent les lieux bas et les gorges profondes. Ajoutez que les voleurs peuvent plus facilement les y surprendre. Double danger, dont on se préserve en se plaçant sur les lieux élevés.
XIII. Dans la distribution des étables, réservez aux bœufs la partie qui est la plus chaude en hiver. Pour les liquides, tels que le vin et l’huile, ayez des celliers au niveau du sol. Les vases destinés à les contenir devront également être placés à ras de terre. Pour les denrées sèches, tels que les fèves, les lentilles, l’orge et le blé, on établira des espèces de planchers. Ménagez à vos domestiques un lieu de réunion où, lorsqu’ils souffrent de la fatigue, de la chaleur, ou du froid, ils puissent se reposer et se remettre. Logez le uillicus près de la porte d’entrée, afin qu’il ait l’œil sur ce qui entre et sort pendant la nuit, hommes et choses. Précaution indispensable, quand il n’y a pas de portier surtout. La cuisine encore devra être placée à proximité de sa surveillance. En temps d’hiver on y vaque à divers soins avant le jour : on y prépare, on y fait un premier repas. On devra ménager dans la basse-cour des remises spacieuses pour les charrettes et les autres ustensiles, afin qu’ils soient à couvert de la pluie. En les laissant en plein air, on s’expose à les voir enlever par les voleurs, ou endommager par les injures du temps. Dans les grandes exploitations il est bon d’avoir deux basses-cours, l’une intérieure, l’autre extérieure. Dans la basse-cour intérieure on devra ménager un bassin destiné à recevoir les eaux pluviales, qui en passant près des stylobates, et coulant sur un plan incliné, formeront un abreuvoir, où les bœufs, revenant des champs, pourront boire et se baigner pendant l’été, ainsi que les oies, et les porcs lorsqu’ils reviendront des pâturages. Il en faut un également dans la cour extérieure, pour faire tremper les lupins, et autres graines dont l’emploi exige un séjour sous l’eau. Cette cour, étant continuellement jonchée de litière et de paille que les bestiaux foulent sous leurs pieds, devient comme une fabrique d’engrais pour les champs. Chaque ferme doit avoir deux fosses à fumier, ou une fosse unique divisée en deux compartiments. L’un des côtés est destiné à recevoir le fumier nouveau que l’on apportera des étables; et c’est dans l’autre que l’on prendra l’ancien fumier, pour le porter dans les champs. Plus le fumier est récent, moins il est bon; et plus il est macéré, meilleur il est pour engraisser les terres. Il faudra surtout le garantir du soleil, en l’entourant de tous côtés de branches et de feuillages, afin d’empêcher que le soleil n’en retire le suc, qui est le principe de l’engrais. Aussi les agriculteurs expérimentés ne négligent-ils jamais de ménager l’écoulement des eaux, de façon à entretenir l’humidité dans ces réserves. Il en est même qui y font déposer la vidange des lieux d’aisance. Il faut, en outre, construire un vaste bâtiment, où l’on puisse mettre à couvert toute la récolte. Ce local, qu’on appelle nubilarium, doit être voisin de l’aire où l’on bat le blé. Il doit être d’une dimension proportionnée à l’étendue de la propriété, et ne s’ouvrir que d’un seul côté, qui est celui de l’aire. Le déplacement des gerbes de l’un à l’autre en devient plus facile et plus prompt en temps de pluie. Les fenêtres du nubilarium devront être percées de manière à laisser l’air y circuler aisément. Les constructions, dit Fundanius, influent sans contredit beaucoup sur le rapport, quand elles sont conçues suivant l’intelligente simplicité de nos ancêtres, plutôt que suivant les idées de luxe d’aujourd’hui. On travaillait alors en vue de l’utile; on ne songe maintenant qu’à satisfaire aux fantaisies les plus extravagantes. Alors le propriétaire avait de grands bâtiments de ferme, et se logeait en ville à l’étroit. C’est généralement le contraire aujourd’hui. A cette époque, une métairie était citée quand elle avait de vastes étables, un bon office, des celliers à vin et à huile proportionnés à la grandeur du fond, avec un plancher incliné venant aboutir à un réservoir; précaution d’autant plus nécessaire, que la fermentation du vin nouveau brisant souvent les tonneaux d’Espagne et même les futailles d’Italie, le vin se trouvait recueilli dans cette espèce de récipient. C’est ainsi que nos ancêtres avaient soin de pourvoir une métairie de tout ce qui répondait aux besoins de la culture. Aujourd’hui, au contraire, on ne vise qu’à rendre l’habitation du maître aussi vaste et aussi élégante que possible. On rivalise de luxe avec ces villas que les Métellus et les Lucullus ont élevées pour le malheur de la République. De nos jours, le point essentiel est d’exposer au vent frais de l’Orient les salles où l’on prend les repas pendant l’été, et au couchant celles où se tiennent les festins pendant l’hiver. Nul ne songe à donner une exposition convenable aux fenêtres des celliers à vin et à huile, ainsi que le faisaient nos ancêtres; ce qui est fort important, puisque le vin, renfermé dans les tonneaux, a besoin de fraîcheur, tandis que l’huile demande un air plus chaud. Ajoutons qu’une colline est, sauf empêchement, l’emplacement le plus convenable à l’établissement d’une ferme.
XIV. Je vais parler maintenant des clôtures qu’il faut établir pour la sûreté générale ou partielle de l’établissement. Il y en a quatre espèces : la clôture naturelle, la clôture champêtre, la clôture militaire, et enfin la clôture artificielle. Chacune de ces espèces peut se subdiviser en plusieurs autres. La première espèce, faite de haies vives, s’appelle clôture naturelle, parce qu’elle est formée d’épines et de broussailles, et qu’elle a racine en terre. C’est celle qui redoute le moins que les passants, par imprudence, n’y mettent le feu. La seconde espèce est faite de bois coupé. On emploie, à cet effet, des pieux que l’on entrelace de broussailles, ou que l’on perce de deux ou trois trous dans leur épaisseur, pour y faire passer transversalement autant de longues perches. On peut également construire cette clôture avec des troncs d’arbres horizontalement superposés, et assujettis l’un à l’autre. La troisième espèce, appelée clôture milliaire, consiste en un fossé avec remblais en terrasse. Le fossé, pour avoir les conditions voulues, doit être assez profond pour contenir toutes les eaux des pluies, ou recevoir celles provenant de la propriété. Le remblai ne forme bonne clôture qu’autant qu’il est pratiqué en deçà du fossé, ou qu’il s’élève assez haut pour ne pouvoir être aisément franchi. Cette clôture est principalement adaptée aux propriétés riveraines d’une grande route, ou de quelque cours d’eau. On peut voir dans les environs de Crustumium, non loin de la voie qui conduit aux salines, plus d’un exemple de l’emploi du fossé conjointement avec le remblai, comme précaution contre les débordements. On appelle murs les remblais sans fossés, qui sont en usage dans la campagne de Réate. La quatrième et dernière espèce, la clôture artificielle, est en maçonnerie, et de quatre sortes de matériaux: savoir, de pierres de taille, comme à Tusculum; de briques cuites, comme dans la Gaule; de briques crues, comme dans les champs sabins; enfin de blocs composés de terre et de cailloux jetés en moule, comme en Espagne et dans la plaine de Tarente.
XV. A défaut de clôtures, on marque encore les limites d’une propriété par des pieds d’arbres; ce qui évite les querelles de voisinage, et prévient les procès. Quelques-uns plantent des pins tout autour, comme l’a fait ma femme dans une terre qu’elle possède au pays des Sabins. D’autres se servent de cyprès, comme j’ai fait moi-même dans une propriété près du Vésuve; d’autres encore emploient les ormes, comme plus d’un propriétaire de Crustumium. Et en effet, il n’y a pas d’arbre préférable à celui-là dans tout pays de plaines comme celui dont nous venons de parler. Nul n’est plus profitable comme soutien des haies et des vignes, comme abri le plus recherché par le gros bétail et les troupeaux, et comme pourvoyeur de menu bois pour la haie, l’âtre et le four. Voilà bien, dit Scrofa, mes quatre points principaux d’observation pour les agriculteurs: configuration de la propriété, qualité du sol, dimension, et clôture.
XVI. Il nous reste à considérer ce qui est en dehors de la propriété; car la propriété est singulièrement intéressée aux conditions d’entourage. Ces conditions sont encore au nombre de quatre: Le pays est-il sûr? Offre-t-il débouchés et ressources? A-t-on à proximité les voies de communication, routes ou rivières navigables? Enfin y a-t-il avantage à espérer, ou préjudice à craindre du voisinage? D’abord, en ce qui concerne la sûreté, il est tel fonds d’une excellente nature que je ne conseillerais pas d’exploiter, à cause des déprédations auxquelles sa situation l’expose. Il en est plus d’un qui ont cet inconvénient, près de Célie en Sardaigne, et, en Espagne, sur les confins de la Lusitanie. En ce qui touche au second point, les terres les plus avantageuses sont celles qui offrent le plus de facilités pour la vente de ce qu’elles produisent, et l’acquisition de tout ce qu’exigent les besoins de l’exploitation. Il est des fonds de terre, en effet, où le blé et le vin manquent, et doivent être tirés d’ailleurs. En d’autres, au contraire, on est obligé à trafiquer d’un excédent de ces mêmes denrées. Ainsi, dans le voisinage des villes, on cultive avantageusement dans les jardins les violettes, les ruses, et autres fleurs qui sont recherchées sur leurs grands marchés; tandis que le même genre de culture ne conviendrait point à une ferme éloignée de tout pareil centre de débit. J’ajoute qu’avec la proximité d’une ville, d’un bourg, ou seulement d’une maison de campagne en terre opulente, où l’on trouve, d’une part, à acheter à bas prix ce qui manque, et, de l’autre, à placer son superflu, comme échalas, perches, roseaux, un fonds est placé dans une condition plus avantageuse non seulement que celui où l’on a de grandes distances à franchir, mais que souvent où l’on aurait tout sous la main. Aussi, beaucoup de propriétaires préfèrent-ils louer à l’année, de leurs voisins, les médecins, les foulons et les ouvriers dont ils pourraient avoir besoin, que d’entretenir ces professions en permanence dans leurs domaines. La mort d’un seul ouvrier, dans le premier cas, entraîne les plus graves préjudices. Les riches seuls, exploitant sur une grande échelle, peuvent se permettre cette complication de leur personnel domestique. Il se peut cependant que la nécessité en fasse une loi à d’autres que les riches. En cas d’éloignement de toute ville ou bourg, par exemple, il est bon d’avoir des forgerons, ou gens d’autres métiers, à demeure. On évite par là que les domestiques de la ferme ne suspendent leur travail, et ne perdent en allées et venues un temps qui serait mieux employé au profit de l’établissement. C’est en ce sens que Saserna défend dans son livre que personne ne sorte de la ferme, excepté le uillicus ou intendant, ou celui qu’il aura lui-même désigné. La défense serait encore mieux conçue en ces termes : Nul domestique sans l’ordre du métayer, ni le métayer lui-même sans l’ordre du maître. Saserna veut de plus qu’aucune absence n’excède un jour de durée, ou ne se répète plus fréquemment que le service ne l’exige. En troisième lieu, le voisinage de routes praticables pour les voitures, ou de fleuves navigables, augmente beaucoup la valeur d’une terre; car ce sont là, comme on sait, les deux grands moyens de communication. Enfin l’essence même des plantations limitrophes doit encore être prise en considération. Si c’est une chênaie, par exemple, qui vous avoisine, vous auriez tort de mettre des oliviers auprès; car ce bois leur est antipathique au point que vous verriez vos arbres, non seulement diminuer de produit, mais éviter le contact des chênes, en se rejetant en arrière. C’est ce que fait la vigne, lorsqu’elle se trouve placée auprès des plantes potagères. Par une propriété semblable à celle des chênes, la présence d’un gros noyer ou d’un certain nombre de plants du même arbre suffit pour frapper de stérilité tout l’entourage.
XVII. J’ai traité spéculativement des quatre conditions intrinsèques de la culture, et de quatre ordres de considérations extérieures qui s’y rattachent. Je vais parler maintenant de la pratique, où quelques-uns veulent faire la distinction de deux parties, à savoir les bras qui travaillent, et les instruments sans lesquels ils ne peuvent travailler; ce sont les instruments que d’autres veulent diviser en trois genres, savoir, le genre parlant, qui comprend les esclaves; le genre voix inarticulée, qui comprend les bœufs; le genre muet, qui comprend les véhicules. La culture s’exerce, ou par des esclaves, ou par des hommes libres, ou par un mélange des uns et des autres. Les hommes libres, qui cultivent eux-mêmes la terre, sont pour la plupart de pauvres gens, aidés de leur famille, ou des journaliers qui se chargent, moyennant salaire, de travaux, tels que les vendanges et la fenaison. Il y a encore une troisième classe de gens employés aux travaux de la terre. Ce sont ceux que nos ancêtres désignaient sous le nom d’oboerarii (travailleurs à forfait), qu’on rencontre en grand nombre en Asie, en Égypte et dans l’Illyrie. J’ai à dire des uns et des autres que, dans les terrains insalubres, il vaut mieux employer des gens à gages; et que, même dans les lieux sains, on fait bien de leur donner encore de préférence les gros ouvrages, tels que la rentrée des vendanges et des moissons. Voici ce que recommande Cassius, à propos de ces manœuvres. Choisissez des sujets propres à la fatigue, au-dessus de vingt-deux ans, et qui montrent des dispositions pour l’agriculture. On juge de leur aptitude par des travaux d’essai, ou en les questionnant sur ce qu’ils faisaient chez leur précédent maître. Prenez pour les diriger des esclaves qui ne soient ni insolents, ni timides; qui aient une teinture d’instruction, de bonnes manières, de la probité, et qui soient plus âgés que ceux qu’ils surveillent: ils en seront mieux écoutés. Cette position, par-dessus tout, exige l’intelligence des travaux rustiques : car l’esclave n’est pas là seulement pour donner des ordres: il doit mettre la main à l’œuvre; montrer par l’exemple ce qu’il faut faire, afin que ses subordonnés comprennent que ce sont ses talents et son expérience qui le placent au-dessus d’eux. Il ne faut pas permettre au chef d’employer les coups pour se faire obéir, quand il peut arriver au même but par de simples remontrances. Évitez également d’avoir plusieurs esclaves de la même nation; car c’est une source continuelle de querelles domestiques. Il est bon de stimuler, par des récompenses, le zèle des chefs; de leur former un pécule, de leur faire prendre des femmes parmi leurs compagnes de servitude. Les enfants qui naissent de ces unions attachent les pères au sol; et c’est par suite de ces mariages que les esclaves d’Épire sont si réputés et se vendent si cher. Quant aux chefs, on fera bien de flatter leur amour-propre, en leur donnant de temps à autre quelque marque de considération. Il est bon également quand un ouvrier se distingue, de le consulter sur la direction des ouvrages. Cette déférence le relève à ses propres yeux, en lui prouvant qu’on fait cas de lui, qu’on le compte pour quelque chose. Stimulez encore son zèle par de meilleurs traitements, une nourriture plus choisie, des vêtements moins grossiers, l’exemption de certains travaux; ou bien encore par la permission de faire paître à son profit quelques bestiaux sur la propriété du maître. C’est ainsi qu’on tempère l’effet d’un ordre un peu dur, d’une punition un peu sévère, et qu’on leur inspire le bon vouloir, et l’affection que le domestique, doit toujours avoir pour son maître.
XVIII. Pour limiter le personnel d’une exploitation rurale, Caton prend pour base l’étendue et le genre de culture. C’est sur celle des oliviers et des vignes qu’il raisonne. Mais les deux formules qu’il nous a données sont d’une application générale. La première suppose un plant d’oliviers de deux cent quarante iugera, et il porte à treize le nombre des esclaves; à savoir, un uillicus et sa femme, cinq ouvriers, trois bouviers, un ânier, un porcher, un berger. L’autre formule est basée sur un lot de cent iugera de vignes, pour lequel il faut avoir quinze esclaves; savoir, un uillicus et sa femme, dix ouvriers, un bouvier, un ânier, un porcher. En traitant du même sujet, Saserna nous dit dans son livre qu’un seul homme suffit pour labourer huit iugera de terre en quarante-cinq jours. Car, bien que quatre journées suffisent rigoureusement pour chaque iugerum, l’auteur alloue treize jours de plus pour maladies, mauvais temps, négligence du serviteur, ou excès d’indulgence chez le maître. Licinius prenant alors la parole : Ni l’un ni l’autre de ces auteurs, dit-il, ne s’est montré fort clair dans son système. Si Caton a voulu faire entendre (comme c’était sans doute son intention) que l’on doit augmenter ou diminuer le nombre des esclaves en raison de l’étendue de la propriété, il n’aurait dû comprendre, dans cette catégorie, ni le uillicus ni sa femme, Et, en effet, dans le cas même où une plantation d’oliviers aurait moins de deux cent quarante iugera, on ne peut toujours avoir moins d’un uillicus. Et dans le cas où l’étendue serait double ou triple de cette mesure, il ne faudrait pas prendre deux ou trois uillicus pour cela. C’est donc le nombre des ouvriers, ou simplement bouviers, qu’on augmente ou restreint, suivant l’étendue du fonds de terre. Encore faut-il que tout le terrain soit d’une même nature. S’il est assez inégal, âpre et montagneux pour ne pouvoir être labouré dans toutes ses parties. Il s’ensuit naturellement qu’un moindre nombre de bœufs, et par conséquent de bouviers, devient nécessaire. Je n’insiste pas sur un autre inconvénient du calcul de Caton. C’est qu’il a pris pour exemple une superficie de deux cent quarante iugera, qui n’est pas unité de mesure. Il eût dû compter par centurie, ou contenance de deux cents iugera. Or, comme pour arriver à ce chiffre il faut retrancher, des deux cent quarante iugera de Caton, quarante, c’est-à-dire le sixième de deux cent quarante, comment s’y prendra-t-on, voulant être conséquent, pour retrancher des treize esclaves la sixième partie? L’embarras ne serait pas moindre à prendre le sixième de onze, chiffre des esclaves, non compris le uillicus et sa femme. Veut-on admettre avec Caton que, pour cultiver cent iugera de vignes, il faut un personnel de quinze esclaves? Alors, pour une centurie de terre plantée moitié en vignes, moitié en oliviers, il faudrait avoir deux uillicus avec leurs femmes; ce qui serait absurde. Il nous faut donc chercher une autre base pour déterminer proportionnellement le nombre d’individus nécessaires. Et Saserna en indique une préférable à celle de Caton, quand il dit qu’il faut pour le labour de chaque iugerum quatre journées du travail d’un homme. Maintenant, pour convenir aux domaines de Saserna, qui étaient situés dans la Gaule, ce chiffre n’est pas nécessairement applicable, comme conséquence, aux terrains montagneux de Ligurie. En résumé, l’on arrive plus facilement à déterminer l’importance, tant du personnel que du matériel, nécessaire à l’exploitation, en portant son attention sur trois choses principales; savoir, la nature des propriétés environnantes; leur étendue; le nombre d’individus employés à leur culture; et enfin les modifications en plus ou en moins que ce nombre peut subir avec avantage. La nature nous a montré deux voies à suivre pour la culture de la terre; les expériences, et l’imitation. C’est en tâtonnant que les premiers agriculteurs ont établi les principes : leurs enfants n’ont guère fait qu’imiter. Nous devons, nous, procéder par les deux voies : imiter d’une part nos prédécesseurs, et, sur quelques points, essayer d’innover; tout en prenant toujours, non le hasard, mais le raisonnement pour guide. Si, par exemple, nous nous décidons à donner, au second labour de nos vignes, plus ou moins de profondeur que ne font les autres; que ce ne soit jamais par simple caprice. C’est en vue d’un résultat positif qu’ont agi ceux qui les premiers sarclèrent deux fois ou trois fois la terre, ceux qui tentèrent la greffe des figuiers en été, ce qu’on avait coutume de ne faire qu’au printemps.
XIX. En ce qui concerne les instruments dits à voix inarticulée, Saserna prétend que deux attelages de bœufs suffisent pour deux iugera de terre; tandis que Caton exige trois attelages pour un plant d’oliviers de deux cent quarante iugera. De sorte que, si nous en croyons Saserna, il ne faut qu’un attelage pour cent iugera; et si nous nous en rapportons à Caton, un attelage ne suffit que pour quatre-vingts. Quant à moi, je pense que ni le calcul de Caton, ni celui de Saserna, ne s’appliquent universellement à toutes espèces de terre; mais que l’un ou l’autre peut se trouver juste pour quelques fonds de terre en particulier. Les terrains sont plus ou moins difficiles à labourer. Il en est que les bœufs ne parviennent à ouvrir qu’avec des efforts inouïs, et tels que souvent la charrue se brise, laissant son soc dans le sillon. D’où il suit que tant que la nature du sol à cultiver ne nous est pas parfaitement connue, le plus sûr est de prendre pour règle la coutume du propriétaire qui nous a précédés, ou celle des propriétaires voisins; et de ne se permettre d’abord que de rares expériences. Caton dit plus loin que, dans un plan d’oliviers de deux cent quarante iugera, il faut trois ânes pour porter le fumier, et un quatrième pour tourner la meule. Il ajoute que dans une vigne de cent iugera on a besoin d’un attelage de bœufs, d’un attelage d’ânes, et enfin d’un âne qui tourne la meule. En parlant de ces instruments à voix inarticulée, Caton n’aurait-il pas dû ajouter, touchant le bétail, qu’il faut en restreindre le nombre au strict nécessaire, afin de simplifier le service des instruments qui se soignent eux-mêmes; c’est-à-dire les esclaves. En fait d’espèces, les brebis sont toujours préférables aux cochons; non pas seulement pour ceux qui ont des prés, mais pour ceux même qui n’en ont pas; car, en élevant des moutons, on ne songe pas seulement à tirer parti de son fourrage, on veut encore se procurer un engrais.
XX. Touchant les quadrupèdes, il faut s’assurer en premier lieu des qualités requises pour les bœufs de labour. Ceux qu’on achète avant qu’ils n’aient travaillé ne doivent pas avoir moins de trois ans, ni plus de quatre. Il les faut robustes et bien appareillés, sans quoi le plus fort, au travail, épuiserait le plus faible; qu’ils soient larges de front, avec les cornes écartées et noires autant que possible, le poitrail large et les cuisses charnues. Si les animaux ont déjà servi, n’employez pas en pays rudes et montagneux ceux qui n’auraient labouré qu’en pays de plaines, et réciproquement. Si ce sont de jeunes bœufs n’ayant point encore senti le joug, il faudra leur engager le cou dans des fourches, et ne les laisser manger qu’en cette posture. Quelques jours de cette pratique les rendront maniables et faciles à dompter. Ensuite on les accoutumera insensiblement au joug, en attelant toujours un jeune bœuf avec un bœuf déjà rompu au service, dont l’exemple l’habitue d’abord à la soumission. On commencera par les faire marcher sur un sol uni, sans leur faire encore tirer de charrue; puis on les attellera à une charrue légère, qu’ils ne tireront d’abord que dans du sable, ou dans une terre qui cède aisément. Quant aux bœufs destinés aux charrois, on commencera également par les faire tirer d’abord des voitures sans charge, en les conduisant de préférence au milieu des villes ou des bourgs. Ils se familiarisent ainsi avec les bruits et le mouvement des lieux habités; ce qui est un grand pas de fait pour leur éducation. Lorsqu’on aura commencé par mettre un bœuf à la droite, il ne faut point l’y remettre toujours: c’est lui ménager une espèce de repos dans le travail, que de le changer de côté de temps à autre. Dans les contrées où la terre est peu compacte, comme dans les champs de Campanie, on remplace les bœufs par des vaches ou des ânes, qu’il sera d’autant plus facile d’accoutumer à tirer une charrue légère. Pour tourner la meule, et pour faire les transports nécessaires dans la propriété même, les uns se servent d’ânons, les autres de vaches; d’autres encore emploient des mulets, selon que le fourrage est plus ou moins abondant. Il est, par exemple, plus aisé de nourrir un ânon qu’une vache; mais la vache est d’un plus grand rapport. Dans le choix de ses animaux de trait, le cultivateur aura toujours égard à la nature du sol. S’il est montueux et difficile à labourer, il faut des bêtes plus robustes, et dont on puisse tirer autant de travail et plus de profit.
XXI. Il est bon d’avoir des chiens, en petit nombre, et de bonne garde. On les dresse à veiller la nuit et à dormir le jour, renfermés et à la chaîne; quand ils sont lâchés, leur activité en redouble. Voilà tout ce que nous avons à dire des quadrupèdes que l’on ne soumet point au joug, ainsi que des troupeaux. Un propriétaire de prés, qui n’a pas de bestiaux à lui lorsqu’il a vendu ses fourrages, doit se procurer des troupeaux étrangers, pour les faire paître et parquer dans ses prairies.
XXII. Quant aux instruments dits muets, comme paniers, futailles, etc., voici les principales recommandations que nous avons à faire. En premier lieu, ne rien acheter de ce qu’on peut recueillir ou confectionner sur les lieux; ce qui comprend toute espèce d’ustensile qui se fabrique en osier, ou dont on a sous la main la matière première ; tels que paniers, corbeilles, traîneaux, maillets, râteaux. Il en est de même de tout ce qu’on fait de chanvre, lin, jonc, genêt, feuilles de palmier; comme les câbles, les cordes, et les nattes. Quant aux divers ustensiles qu’on ne peut point tirer de son fonds, il faut, en les achetant, regarder moins à l’apparence qu’à l’utilité; car on paye moins cher, et le revenu s’en trouve mieux. Proximité, qualité et bon marché; voilà les conditions essentielles pour les acquisitions de ce genre. Le choix et le nombre des différents instruments est subordonné à l’importance de l’exploitation, et se multiplie en raison de son étendue. C’est ce qui fait sans doute, dit Stolon, que Caton raisonne sur une superficie donnée, quand il dit que celui qui cultive un plant d’oliviers de deux cent quarante iugera doit avoir, au nombre de cinq, chaque espèce de vases nécessaires à la confection de l’huile, dont il donne ainsi l’énumération: chaudières, pots, vases à trois anses, etc., le tout en cuivre. En fait d’ustensiles en bois et fer, il veut qu’on ait trois grandes charrettes, six charrues avec leurs socs, quatre civières à fumier, etc. Passant ensuite aux différents instruments de fer seulement, huit fourches, autant de sarcloirs, quatre bêches, etc. Quant au mobilier d’exploitation d’un vignoble, Caton l’a déterminé comme il suit, en calculant sur une superficie de cent iugera : trois pressoirs complets, des futailles garnies de leur couvercle, en nombre suffisant pour contenir huit cents cullei; vingt vaisseaux à transporter le raisin pendant les vendanges; vingt autres réservés pour le blé, etc. Si Caton, contrairement à d’autres auteurs, exige un si grand nombre de cullei, c’est, je crois, pour qu’on ne soit pas forcé de faire argent, chaque année, du produit de ses vignes; car le vin se vend plus cher quand il est vieux, et la même qualité se place avec plus ou moins d’avantage, suivant le cours du moment. Caton entre ensuite dans de grands détails touchant les quantités et espèces d’instruments de fer, tels que serpes, bêches, râteaux. Il descend même jusqu’aux subdivisions de quelques espèces. Ainsi, sous le nom générique de faux, il distingue différentes sous-espèces, dont voici les quantités pour chacune: six serpes à tailler la vigne; cinq à couper les liens des ceps; pareil nombre de serpes à faire du bois; trois à émondage, et dix propres à couper les ronces. Scrofa prenant alors la parole, nous dit: Tout propriétaire devra faire un inventaire détaillé de tout ce mobilier rustique, et en emporter une copie à la ville. Le uillicus, de son côté, aura soin que tous ces ustensiles soient disposés avec ordre, chacun à la place qui lui a été assignée. Il devra surtout avoir autant que possible sous ses yeux tous les objets qu’il ne pourra garder sous clef, notamment ceux d’un usage moins habituel; comme les paniers et les vases, dont on n’a besoin qu’au temps des vendanges. Car plus les objets sont en vue, moins ils sont exposés aux déprédations des voleurs.
XXIII. Agrarius prit alors la parole et dit : Vous nous avez parlé jusqu’à présent du fonds de terre en général, et des divers instruments nécessaires à sa culture: de sorte que, des quatre parties de l’agriculture, vous avez épuisé les deux premières. J’attends maintenant la troisième partie. Comme je n’entends par revenu, dit Scrofa, que ce que la terre produit quand elle a été ensemencée, nous n’avons réellement que deux points à examiner; savoir, la qualité de la semence et celle du sol. Telle terre conviendra particulièrement au foin, telle autre au blé; celle-ci à l’olive, celle-là au raisin. Il en est de même de tout ce qui appartient à la dénomination générique de fourrage, comme le basilic, les céréales coupées en vert, la vesce, le sainfoin, le cytise, le lupin. C’est une erreur de croire qu’une terre grasse puisse recevoir indifféremment toute semence, et qu’en une terre maigre on ne puisse rien semer. On fera bien au contraire de choisir une terre maigre pour tout ce qui ne demande pas beaucoup de suc, comme le cytise et les légumes; à l’exception toutefois des pois chiches, qu’il faut cependant considérer comme légume, si l’on comprend sous ce nom tout ce qui se récolte par extraction de la tige, par opposition à ce qui se cueille seulement; car légume vient de legere, cueillir. Dans les terres grasses on pourra semer tout ce qui demande plus de nourriture; comme les racines potagères, le froment, le seigle, le lin. Certaines plantes sont cultivées, non pas tant pour le produit immédiat qu’on en retire, que pour l’amélioration d’une récolte à venir; parce que leurs fanes coupées et laissées sur la terre y servent d’engrais. C’est par cette raison que dans une terre trop maigre on emploie, en guise de fumier, des tiges de lupin non encore monté en graine, ou bien même celles des fèves, avant que la cosse n’ait atteint le degré de formation où elle est bonne à cueillir. Mettons à part les plantes dont le produit est de pur agrément, et qui peuplent nos jardins et nos parterres, aussi bien que celles qui, sans contribuer à l’alimentation, sont cependant indispensables à l’économie rurale; tels que les saules et les roseaux, et autres végétations qui exigent un sol humide. Certaines plantes se plairont dans un terrain sec; d’autres préféreront des lieux ombragés, comme l’asperge sauvage et l’asperge domestique; d’autres enfin ne devront être semées que dans des lieux exposés au soleil, dont la chaleur est indispensable à leur croissance; telles sont, par exemple, les violettes et les autres plantes des jardins. Mais l’osier, dont on fait des paniers, des claies et des vans, demande un autre sol et une autre culture. Les bois en coupe réglée, et ceux qu’on laisse croître pour les chasses, veulent aussi des terroirs et des régimes différents. Il faudra également réserver des endroits convenables au chanvre, au lin, au jonc, au sparte, d’où l’on tire les matériaux employés à botteler la paille des bœufs, à faire des ficelles, des cordes et des câbles. D’autres terrains reçoivent indifféremment diverses espèces de plantes. C’est ainsi que nous voyons souvent introduire des plantes de jardinet autres dans les vergers de formation nouvelle, dont les arbres, récemment alignés, n’ont pas encore eu le temps d’étendre leurs racines; pratique dont on s’abstient soigneusement quand les arbres ont pris du développement, de crainte de leur nuire. Ceci, reprit Stolon, se concilie assez bien avec ce qu’a écrit Caton, à propos des semailles, qu’une terre grasse, bien fumée, où l’on ne voit aucun arbre, est ce qu’il faut au froment; et qu’un sol ombragé convient aux raves, au raifort, au millet et au panais.
XXIV. Les espèces d’olives qui prospèrent en terre grasse et chaude sont, l’olive à confire, le radius maior de Salente, l’orchis, la posea, la sergiane, la colminienne et l’albicère (blanc de cire). Entre toutes ces variétés, cultivez de préférence celle qui flatte le plus le goût local. L’exposition au vent d’ouest, et en plein soleil, est la plus favorable à cet arbre. Le sol est-il quelque peu froid et maigre? plantez-y l’olive licinienne. Dans un terrain de qualités contraires, cette espèce ne rend jamais l’hostus complet, malgré un luxe de fruits qui l’épuise; et l’arbre est bientôt rongé d’une mousse rougeâtre. L’hostus est ce qui s’exprime, d’huile à chaque factus; et l’on appelle factus un tour de pressoir. La contenance d’un factus est, suivant les uns, de cent soixante modius d’huile; d’autres le font descendre à cent vingt seulement, et réduisent en proportion le nombre et la contenance des mesures fractionnaires. Caton conseille plus loin de former un rideau d’ormes et de peupliers autour de son domaine: on en tire des feuilles pour la nourriture des bœufs et brebis, et du bois pour son usage. Mais nous pensons, quant à nous, que cette prescription n’est rien moins que générale; et que là où elle est utilement appliquée, ce n’est pas en vue seulement du feuillage, qu’on se procure par ce moyen. On peut d’ailleurs, sans inconvénient, border d’arbres sa propriété du côté du nord; car, ainsi placés, ils n’interceptent pas les rayons du soleil. Si le terrain est humide, ajouta Stolon, toujours d’après la même autorité, choisissez de préférence les peupliers et les roseaux. A cet effet, on retournera la terre avec une houe, puis on mettra les boutures de roseaux à trois pieds l’un de l’autre, en les entremêlant d’asperges sauvages, qui en produiront de bonnes à manger; car roseaux et asperges exigent à peu près même culture. On entourera ces plantations d’osier franc, dont on pourra se servir plus tard pour lier les vignes.
XXV. Ce que doit observer, quant au choix du terrain, celui qui plante de la vigne, le voici : L’exposition la plus chaude et conséquemment la plus vineuse doit être réservée au petit aminéen, au raisin double dit fortuné, et au petit raisin gris. Où le terrain est gras et le ciel nébuleux, il faut mettre le gros aminéen, le murgantin, l’apicius et le lucanien. Les autres espèces, et surtout les raisins noirs, se plaisent indifféremment partout.
XXVI. Les vignerons apportent un soin particulier à placer l’échalas de telle sorte que la vigne en soit abritée du côté du septentrion. Lorsqu’on se sert de cyprès vif en guise d’échalas, on plante alternativement une rangée de ceps et une rangée de cyprès, en empêchant toutefois ces derniers de dépasser la hauteur d’un échalas ordinaire. Il ne faut pas non plus que la vigne soit trop rapprochée des choux et autres légumes; ce voisinage lui est antipathique. Je crains bien, dit Agrius, se tournant vers Fundanius, que le gardien du temple ne revienne avant que nous soyons arrivés à la quatrième partie, c’est-à-dire aux vendanges, que j’attends avec impatience. Rassurez-vous, dit Scrofa, il va lui-même apprêter les paniers et les urnes.
XXVII. Nous avons deux divisions du temps: l’année, ou la révolution complète du soleil et le mois qui suit celle de la lune, je parlerai d’abord du cours annuel du soleil. Cet espace de temps, considéré par rapport aux fruits de la terre, est divisé en quatre parties, chacune à peu près de trois mois; ou, plus exactement encore, en huit, dont chacune est d’un mois et demi environ. La première division est celle des saisons: le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Le printemps est l’époque de certaines semailles, et celle du premier labour donné à la terre, afin d’en extirper toutes les mauvaises herbes avant qu’elles aient jeté leur graine. Le sol, soulevé en glèbe par le labour, devient alors plus accessible à l’action du soleil et des pluies, et plus maniable pour les façons ultérieures. Il faut à la terre deux labours au moins; et trois valent encore mieux. On fera la moisson en été; et c’est en automne, et par un temps bien sec, qu’il faudra faire la vendange et procéder aux coupes des bois. On abat l’arbre à ras de terre; mais il ne faut déterrer la souche qu’après les premières pluies, afin d’empêcher la pousse de nouveaux rejetons. C’est en hiver qu’on fera la taille des arbres, en choisissant toutefois le moment où il n’y a sur leur écorce ni frimas, ni pluie, ni glaçons.
XXVIII. Le printemps commence lorsque le soleil est dans le Verseau; l’été, lorsqu’il entre dans le Taureau; l’automne, lorsqu’il passe dans le Lion; et l’hiver, lorsqu’il atteint le Scorpion. Mais comme le premier jour de chaque saison est le 23 de l’entrée successive du soleil dans chaque signe, il s’ensuit que le printemps est de 91 jours; l’été, de 94; l’automne de 91; et l’hiver, de 89. Ce calcul étant mis en rapport avec les divisions de notre année civile, le premier jour du printemps correspondra au 8e des Ides de février; le premier de l’été, avec le 8e des Ides de mai; le premier de l’automne, avec le 4e des Ides d’août; et le premier de l’hiver, avec le 5e des Ides de novembre. Il est plus exact encore de partager l’année entière en huit périodes distinctes. La première, de 45 jours, commence lorsque le soleil se couche au point d’où s’élève le vent Favonius, et dure jusqu’à l’équinoxe du printemps. La seconde, de 46 jours, dure de l’équinoxe du printemps jusqu’à l’ascension des Pléiades. La troisième, de 48 jours, du lever des Pléiades au solstice; la quatrième, de 24 jours, du solstice à l’arrivée de la Canicule. La cinquième, de 68 jours, de l’arrivée de la Canicule à l’équinoxe d’automne. La sixième, de 45 jours, de l’équinoxe d’automne à la disparition des Pléiades. La septième, de 44 jours, de la disparition des Pléiades au solstice d’hiver; et la huitième enfin, de 45 jours, commençant au solstice d’hiver, et durant jusqu’au temps où le soleil se couche au point d’où s’élève le vent Favonius.
XXIX. La première période est le temps d’établir des pépinières de toute espèce, de tailler la vigne et de la déchausser, de couper les racines qui sortent de terre, d’échardonner les prés, de planter des saussaies, de sarcler les terres qui sont déjà labourées et ensemencées, et qu’on appelle segetes, pour les distinguer des arua, qui sont des terres labourées, mais non encore ensemencées. Quant aux terres appelées novales, on comprend sous ce nom toutes celles qui ne sont ensemencées et renouvelées, pour ainsi dire, que tous les deux ans. Remarquons encore que, donner le premier labour, s’exprime par le mot proscindere (fendre), tandis qu’on désigne le second par le mot offringere (briser), parce que cette dernière façon a pour but de briser la glèbe que la première n’aura fait que soulever. On emploie le mot lirare (sillonner) pour désigner l’acte par lequel on donne le troisième labour, au terrain déjà ensemencé. Cette opération se fait au moyen de deux planches attachées au soc, et disposées de telle sorte que, tout en recouvrant les semences jetées sur les arrêtes, on creuse en même temps des sillons qui donnent un écoulement facile aux eaux pluviales. Ceux qui n’ont cultivé qu’une propriété de médiocre étendue, comme on en trouve beaucoup en Apulie, font d’ordinaire passer la herse sur leurs terres, afin de mieux atteindre les mottes qui pourraient être restées sur les arêtes. La trace profonde que laisse en terre le soc de la charrue s’appelle sulcus (sillon), et la saillie qui se forme entre deux sillons s’appelle porca (arête), de porricere (mettre à distance, élever), parce que la semence se trouve pour ainsi dire exhaussée au-dessus du sol. C’est encore dans le même sens qu’on se sert du mot porricere pour signifier l’action d’offrir aux dieux les entrailles des victimes.
XXX. Dans la seconde période, comprise entre l’équinoxe de printemps et le lever des Pléiades, on vaquera aux travaux que voici : sarcler les terres labourées, ou leur donner le premier labour; couper les saules et enclore les prés; mettre la dernière main à ce qui resterait imparfait des travaux de la période précédente; planter les arbres avant la germination et la floraison; car tout arbre qui ne garde ses feuilles qu’une partie de l’année n’est plus propre à être planté, lorsqu’il en a pris de nouvelles. Il y a encore le travail de plantation et de taille des oliviers.
XXXI. Durant la troisième période, comprise entre le lever des Pléiades et le solstice, on devra bêcher ou labourer les jeunes vignes, et les herser; c’est-à-dire briser les mottes sans en laisser une seule. On désigne cette dernière opération par le mot occare, dérivé lui-même d’occidere (détruire); comme pour faire entendre qu’on anéantit les mottes de terre. C’est encore le moment d’épamprer les vignes, soin qu’il ne faut confier qu’à des mains intelligentes; car cette opération, exclusivement propre à la vigne, est d’une plus grande importance encore que celle de la taille des arbres à fruits. Épamprer c’est ne laisser sur un sarment que les deux ou même les trois premiers brins que vous aurez reconnus comme les plus forts, et retrancher tous les autres, de crainte que le cep ne soit pas en état de fournir à tous une nourriture suffisante. C’est dans cette vue qu’on commence par couper les pieds de vigne au moment où ils sortent de terre, afin qu’à la seconde pousse on ait un sarment plus vigoureux, et qui donne des bourgeons mieux nourris. Quand le cep sort de terre mince et effilé comme un jonc, cette faiblesse le rend impuissant à pousser des rameaux productifs; on l’appelle alors flagellum. Mais le cep vigoureux, et qui promet des grappes, s’appelle palma. Flagellum vient de flatus (souffle), en changeant une lettre; mot qui signifie objet de peu de consistance. Le palma (cep à porter fruit) tire son nom probablement du mot parilema, dérivé de parire (produire), dont, par une suppression de lettre assez commune dans notre langue, on aura fait palma. Il y a aussi les pousses appelées capreoli (vrilles de la vigne), espèce de filament en forme de spirale, ou de boucles de cheveux. Cette végétation de la vigne s’enroule comme autant de serpents autour de ce qui croît près d’elle ; d’où le nom de capreoli, dont la racine est capere, prendre. Toute espèce de fourrage, basilic des champs (ocimum), dragée, vesce, etc., se coupe à la même époque. Le foin proprement dit se fauche en denier. Ocimum vient du grec g-ohkeohs (hâtif). Son homonyme des jardins a la même propriété. Ce nom vient peut-être aussi de ce que cette plante lèche le ventre aux bœufs, à qui on en donne, comme purgation, par ce motif. C’est une espèce de fève que l’on récolte en vert, avant que la cosse ne soit formée. Le farrago (dragée) est un mélange d’orge, de vesce et autres plantes légumineuses, qui se sème à la fois, et se coupe également en vert pour nourrir les bestiaux. Le nom de farrago lui vient, ou de l’instrument de fer avec lequel on le coupe, ou de ce que, primitivement, c’était les terres, ayant produit du blé (farraciœ segetes); qu’on choisissait pour cette culture. Ce mélange se donne, au printemps, aux chevaux et bêtes de somme. Il commence par les purger, et ensuite il les engraisse. Vicia (la vesce) tire son nom de vincere (lier), parce que cette plante a, comme la vigne, des vrilles (capreoli) avec lesquelles elle s’accroche aux tiges des lupins ou autres plantes voisines, qu’elle enveloppe de ses étreintes. Si vos prairies sont arrosables, il faudra procéder à leur irrigation aussitôt que vous en aurez enlevé le foin. Ne manquez pas, surtout en temps de sécheresse, d’arroser chaque soir les arbres fruitiers, dont le nom poma vient probablement de leur besoin continuel de boire (potare, potus.)
XXXII. La plupart des cultivateurs font la moisson pendant la quatrième période, du solstice d’été à la canicule; parce qu’ils prétendent que le blé, pour acquérir la consistance de la maturité, doit rester quinze jours dans sa balle, quinze jours en fleur, et quinze jours en graine. C’est aussi le moment d’achever ce qui reste de labours à faire, et qui sont alors d’autant plus profitables que la terre est plus échauffée. Un premier labour étant donné à la terre, faites y repasser la charrue, afin d’écraser les mottes que le premier n’aura fait que soulever. C’est encore l’époque des semailles pour la vesce, les lentilles, les pois chiches, la cicerole, et autres plantes comprises sous le nom générique, soit de legumina, soit de legaria (qu’on leur donne dans quelques contrées de la Gaule). Ces deux mots ont une origine commune, legere (cueillir), parce qu’en récoltant on cueille au lieu de couper. Reste-t-il encore des mottes dans vos vignes, après le second labour? passez-y la herse deux fois, si le plant est vieux; trois fois, s’il est nouveau.
XXXIII. Pendant la cinquième période, c’est-à-dire depuis la canicule jusqu’à l’équinoxe d’automne, il faut couper la paille, la botteler, achever les labours, émonder les arbres, et faire la seconde coupe des prairies arrosables.
XXXIV. Dès le commencement de la sixième période, c’est-à-dire, à partir de l’équinoxe d’automne, il faut (suivant nos auteurs) procéder aux semailles, y consacrer les quatre-vingt onze jours qui suivent, et ne semer, une fois venu le solstice d’hiver, que dans le cas de nécessité absolue. L’observation est importante; car ce qu’on sème avant lève en sept jours, et tout ce qui se sème après se montre à peine au bout de quarante. Il ne faut cependant pas, d’après les mêmes auteurs, semer avant l’équinoxe, parce que la semence est exposée à pourrir, si le temps devient contraire. L’époque du coucher des Pléiades doit être choisie pour semer la fève; mais c’est entre l’équinoxe d’automne et le coucher des Pléiades qu’il faut cueillir le raisin et faire les vendanges. Immédiatement après, on commence à tailler la vigne, à provigner, et à planter les arbres à fruit. Dans les contrées où le froid se fait sentir de bonne heure, il vaut mieux ajourner ces travaux au printemps de l’autre année. Dès le commencement de la sixième période, c’est-à-dire, à partir de l’équinoxe d’automne, il faut (suivant nos auteurs) procéder aux semailles, y consacrer les quatre-vingt onze jours qui suivent, et ne semer, une fois venu le solstice d’hiver, que dans le cas de nécessité absolue. L’observation est importante; car ce qu’on sème avant lève en sept jours, et tout ce qui se sème après se montre à peine au bout de quarante. Il ne faut cependant pas, d’après les mêmes auteurs, semer avant l’équinoxe, parce que la semence est exposée à pourrir, si le temps devient contraire. L’époque du coucher des Pléiades doit être choisie pour semer la fève; mais c’est entre l’équinoxe d’automne et le coucher des Pléiades qu’il faut cueillir le raisin et faire les vendanges. Immédiatement après, on commence à tailler la vigne, à provigner, et à planter les arbres à fruit. Dans les contrées où le froid se fait sentir de bonne heure, il vaut mieux ajourner ces travaux au printemps de l’autre année.
XXXV. Pendant la septième période, c’est-à dire depuis le coucher des Pléiades jusqu’au solstice d’hiver, il faut (toujours d’après les mêmes autorités) planter les lis et le safran. Pour faire un plant de rosiers, on choisit des pieds qui aient déjà pris racine; on en fend la tige, dans sa longueur, en brins d’une palme environ, qu’on couvre de terre, et qu’on transplante après, lorsqu’ils ont pris racine à leur tour. Quant aux violettes, leur culture a le grave inconvénient d’exiger des planches surélevées. A cet effet, on ramasse la terre à l’entour. Or, cette terre est entraînée et balayée par les arrosements ou les pluies, et le sol de la propriété s’appauvrit d’autant. Quand le soleil s’est couché au point de l’horizon d’où s’élève Favonius, c’est le temps, jusqu’au lever de l’Arcture, de transplanter le serpolet venu de graine. Cette herbe doit son nom à ses habitudes rampantes (quod serpit). On peut encore creuser de nouveaux fossés, nettoyer les anciens, tailler la vigne et les arbres auxquels elle est mariée; mais il faut suspendre tout travail durant les quinze jours qui précèdent et les quinze Jours qui suivent le solstice d’hiver. Certains arbres cependant, les ormes, par exemple, peuvent encore être plantés dans cet intervalle.
XXXVI. Dans la huitième période, c’est-à-dire depuis le solstice d’hiver jusqu’au lever du Favonius, il faut faire écouler du sol les eaux qui y séjournent, et le sarcler, si la saison a été sèche et que la terre soit friable. Il faut encore tailler les vignes et les arbres fruitiers; et quand on ne peut plus travailler aux champs, expédier, au logis, tout ce qui peut se faire sous un toit pendant les veillées d’hiver. Toutes ces règles doivent être consignées par écrit, et la copie doit en être placée en vue dans la ferme, afin que tous, et notamment le uillicus, puissent bien s’en pénétrer.
XXXVII. Les jours lunaires doivent encore être l’objet d’une attention toute spéciale. Ils se partagent en deux séries: l’une, où la lune nouvelle va toujours croissant jusqu’à ce qu’elle soit pleine; et l’autre, où elle décroît successivement jusqu’au jour intermédiaire de l’ancienne et nouvelle lune. Il y a des travaux qu’il vaut mieux faire pendant la croissance de la lune que sur son déclin, et réciproquement. La moisson des blés par exemple, et les coupes de bois, sont dans cette dernière catégorie. Pour moi, dit Agrasius, je tiens de mon père, et j’ai pour principe de ne jamais faire tondre mes brebis quand la lune décroît. Je ne me ferais pas même couper les cheveux, de peur de devenir chauve. Qu’est-ce, demanda Agrius, que les quartiers de la lune, et quelle est leur influence relative sur l’agriculture? Comment, dit Tremellius, n’avez-vous donc jamais entendu parler à la campagne du troisième jour avant que la lune ne croisse, et du huitième avant qu’elle ne décline? Et ne savez-vous pas qu’en fait des travaux qui ne se font qu’en croissance il en est qu’il vaut mieux entreprendre avant qu’après ce huitième jour? et qu’en fait de travaux à faire en décroissance, le moment qu’il faut choisir est celui où l’astre jette le moins de lumière? C’est là tout ce que je puis vous dire touchant les quartiers de la lune, et leur influence sur les travaux rustiques. On pourrait, dit Stolon, diviser encore l’année en six parties, en faisant acception à la fois du cours de la lune et de celui du soleil. En effet, tous les biens de la terre passent successivement par cinq phases, dont la dernière est leur entrée dans le modius ou la futaille, en état de maturité. Ils en sortent ensuite pour les besoins de la vie. C’est la sixième et dernière de leurs phases, dont voici l’énumération : savoir première phase, préparation; deuxième phase, ensemencement ou plantation; troisième, nutrition; quatrième, récolte; cinquième, emmagasinement; sixième, consommation. Les soins de préparation varient suivant l’espèce de culture : creuser des fosses, biner, aligner, voilà pour les vignobles ou le verger; labourer, bêcher, voilà pour les céréales et plantes potagères. Certains arbres veulent que le terrain soit remué plus ou moins profondément avec le hoyau, suivant le plus ou le moins d’extension de leurs racines. Celles du cyprès, par exemple, en ont fort peu; tandis que les racines d’un platane sont susceptibles d’un développement extraordinaire. C’est au point qu’au dire de Théophraste, on voyait à Athènes, dans le Lycée, un platane encore jeune, dont les racines n’avaient pas en longueur moins de trente-trois coudées. Telle culture exige un double labour à la charrue, avant que la semence ne soit confiée à la terre. Quant aux prairies, il ne leur faut aucun travail préparatoire, si ce n’est d’en former l’entrée aux bestiaux dès que le poirier est en fleur, et de les arroser en temps opportun, quand on a des moyens d’irrigation.
XXXVIII. Examinons maintenant comment il faut engraisser les champs, et quelle espèce de fumier est préférable. Cette distinction n’est rien moins qu’indifférente. Suivant Cassius, il n’y a pas de meilleur engrais que la fiente des volatiles en général, les oiseaux aquatiques exceptés. Mais celle des pigeons a la supériorité, à cause de cette chaleur qui lui est propre, et qui excite puissamment la fermentation dans la terre. Il faut l’éparpiller dans les champs comme de la graine, et non l’y mettre en tas comme le fumier des bestiaux. Quant à moi, je pense que la fiente provenant des volières de grives et de merles mérite la préférence, parce qu’elle forme non seulement un bon engrais pour les terres, mais encore une nourriture pour les bœufs et les cochons, qu’elle rend plus gras. Aussi les prix de baux de ces volières sont-ils moins élevés quand le propriétaire s’en réserve les ordures. Cassius place comme fumier après la fiente des pigeons, les excréments humains; et, en troisième ligne, ceux des chèvres, brebis et ânes. Le fumier de cheval est moins bon pour la culture des céréales, tandis qu’il convient parfaitement aux prairies; comme en général tout fumier provenant de la litière des bêtes de somme; car l’orge dont on les nourrit active singulièrement la pousse de l’herbe. Pour ménager les bras, la fosse à fumier doit être à proximité de la ferme. Voulez-vous empêcher que les serpents n’y pullulent? enfoncez au milieu un morceau de bois de chêne.
XXXIX. Pour la seconde phase (ensemencement ou plantation), tout dépend de saisir le moment propice. Autant que l’exposition des lieux, il importe d’observer la saison favorable à la semence ou plant qu’on va confier à la terre. Ne voyons-nous pas en effet telle plante fleurir au printemps, et telle autre en été? ce ne sont pas les mêmes non plus qui fleurissent en automne et en hiver. On les sème, greffe et récolte plus tôt ou plus tard, suivant leur nature. En général, le printemps, pour greffer, est préférable à l’automne; ce qui n’empêche pas d’attendre le solstice pour le figuier, et même les jours d’hiver pour le cerisier. Les végétaux se propagent de quatre manières différentes: savoir, par la voie de nature d’abord; en second lieu, par moyens artificiels, tels que transplantation d’une racine toute formée d’un terrain dans un autre; enfouissement par un bout d’un rameau détaché d’une plante, et qui devient plante lui-même; enfin, insertion sur un arbre d’une branche empruntée à un autre arbre. Examinons maintenant les conditions de lieux et de temps qu’exige chacune de ces opérations.
XL. La semence, principe de toute végétation, est ou visible ou invisible. Elle est invisible lorsqu’elle est répandue dans l’air, comme le prétend le physicien Anaxagore; et apportée sur les champs par la pluie qui tombe, suivant l’opinion de Théophraste. Les semences visibles méritent la plus grande attention du cultivateur. Il en est de tellement menues que l’œil ne peut les saisir; celles de cyprès, par exemple. Car les noix rondes comme des balles, à écorce mince, que produit cet arbre, ne sont pas sa semence; elles n’en sont que l’enveloppe. La nature nous a donné les germes; c’est à l’expérience à faire le reste. Il est une végétation spontanée qui naît sans que personne s’en mêle; et une production artificielle procédant de la première, et qu’il faut la main de l’homme pour féconder. Quand on emploie la semence naturelle, il faut prendre garde qu’elle soit passée ou mélangée, et surtout ne pas prendre par ressemblance une graine pour une autre. L’action du temps sur certaines semences va jusqu’à en changer la nature. Ainsi la graine de chou produit des raves, et celle des raves des choux, si l’on a laissé vieillir l’une et l’autre. Quant au second mode de propager les plantes au moyen de racines toutes formées, ayez soin que la transplantation ne s’opère ni trop tôt ni trop tard. Les époques favorables, selon Théophraste, sont le printemps, l’automne, et le lever de la Canicule. Mais il y a des distinctions à faire, suivant la qualité du sol et l’espèce de la plante. Ainsi lorsque le sol est aride, maigre, argileux, et dépourvu conséquemment d’humidité naturelle, il faut choisir le printemps. Ce sera l’automne, si la terre est bonne et grasse, au contraire; car elle serait trop humide au printemps. Quelques-uns fixent à trente jours la période d’exécution de ces travaux. Le troisième mode, où l’on procède par bouture, c’est-à-dire en détachant d’un arbre des branches qu’on met provisoirement en terre, exige une attention toute particulière à bien choisir le moment de la transplantation; ce qui doit avoir lieu avant que les boutures aient poussé fleurs ou bourgeons. Avant tout, il aura fallu les séparer délicatement de l’arbre, et non les en arracher; car plus on leur a laissé de pied, plus elles ont de consistance, et plus vite elles prennent racine. Il faut aussi se dépêcher de les mettre en terre avant que la sève ne se dessèche. Pour se procurer des boutures d’oliviers, il suffit de couper une jeune branche de grosseur égale aux deux extrémités, et d’un pied environ de longueur; c’est ce que les uns appellent clavola, et les autres talea. Quant au quatrième mode de propagation, qui consiste à prendre une branche sur un arbre pour l’insérer dans un autre, l’arbre sur lequel on prend la greffe, celui sur lequel on ente, le moment où l’on fait cette opération, et le procédé qu’on emploie, sont autant d’objets de sérieuse considération. On ne saurait greffer le poirier sur le chêne par exemple; ni sur le pommier non plus. C’est ce qu’observe religieusement quiconque a foi dans les augures : car autant de greffes différentes sur un arbre, nous disent-ils, autant de coups de foudre qui doivent le frapper. Si l’on greffe sur un poirier sauvage un autre poirier, si bonne d’ailleurs qu’en soit l’espèce, on obtient un fruit moins savoureux qu’en opérant sur un poirier cultivé. Règle générale: quand on greffe un arbre sur un autre de même essence, pommier sur pommier, par exemple, il faut que l’arbre dont on emprunte la greffe soit d’une espèce meilleure que celui sur lequel on l’applique. On a dernièrement imaginé une nouvelle manière de greffer, qui exige deux arbres voisins. Au moyen d’une ouverture pratiquée dans l’arbre qu’on désire greffer, on introduit une petite branche attirée de l’arbre dont on veut avoir le fruit. Cette branche doit être entaillée des deux côtés, au point de contact, avec une serpette; de sorte qu’à l’endroit où elle ressort son écorce s’adapte parfaitement à l’écorce de la branche qu’elle traverse. On aura soin encore que l’extrémité de la branche entée se dresse vers le ciel. L’année suivante, lorsque la greffe a bien pris, on opère sa séparation de l’arbre auquel elle a d’abord appartenu.
XLI. A quelle époque faut-il greffer chaque espèce? c’est la première considération. Nous devons remarquer à ce sujet que nombre d’essences d’arbres qui étaient greffées jadis au printemps, le sont aujourd’hui pendant le solstice d’été : tels sont les figuiers, dont le bois a peu de densité, et conséquemment besoin de chaleur. Aussi cette culture ne peut-elle réussir dans les pays froids; l’humidité est encore nuisible à leurs greffes récentes. Ce bois pourrit vite quand il est jeune; on pense donc avec raison que le meilleur moment pour le greffer est l’époque de la canicule. Quant aux plantes moins délicates de leur nature, on attache au-dessus de leurs greffes un vase rempli d’eau, dont on laisse tomber le contenu goutte à goutte, afin que le rameau inséré ne se dessèche point avant son incorporation à l’arbre. Il faut conserver intacte l’écorce des greffes, et se garder, lorsqu’on les apprête, de mettre la moelle à nu. Il est bon même qu’elles soient enduites d’argile, et assujetties avec une lanière d’écorce, pour les garantir au dehors de la pluie ou de la chaleur. Par une précaution du même genre, on fait l’incision de la vigne trois jours avant de la greffer, afin de débarrasser le cep de son humidité surabondante; ou bien si on a commencé par greffer, on place l’incision un peu au-dessus de la greffe, pour ménager un écoulement à l’humidité en cas de besoin. Les figuiers, grenadiers, et en général tous les arbres d’une nature moins aqueuse, se greffent sans exiger ces précautions. Quelques boutures, par exception celles de figuier, sont de ce nombre, et ne se transplantent que lorsqu’elles sont en bourgeons. Des modes de propagation, la greffe est celui qu’on applique de préférence aux plantes qui sont, comme les figuiers, trop tardives pour venir de semence. La semence naturelle de cet arbre est cette graine qu’on trouve dans la figue quand on la mange, et qui est si menue qu’à peine elle pourrait produire quelques chétifs rejetons. En général, toute semence sèche et compacte est lente à pousser. Plus sa substance est relâchée, plus son développement est chétif. C’est le même rapport qui existe, dans le règne animal, du mâle à la femelle. Ainsi le figuier, le grenadier, et la vigne, dont la nature est analogue à la mollesse féminine, croissent-ils plus rapidement que le palmier, le cyprès, et l’olivier, qui sont d’une consistance plutôt sèche qu’humide. Aussi, pour avoir des figuiers, vaut-il mieux recourir aux boutures que d’attendre à voir lever la graine; à moins toutefois qu’on ne puisse faire autrement, et qu’il y ait nécessité de recevoir son plant d’outre-mer, ou d’en expédier à cette destination. Dans ce cas, on attache en colliers, au moyen de petites cordes, des figues bonnes à manger; et quand elles sont bien sèches, on peut les empaqueter et les envoyer où l’on veut. On n’a plus qu’à les mettre en terre pour obtenir une pépinière de figuiers. C’est ainsi que les figues de Chio, de Chalcis, de Lydie, d’Afrique, et d’autres contrées d’outre-mer, ont émigré en Italie. La même observation s’applique à l’olivier, dont la semence est un noyau. Le germe étant bien plus lent à se développer par le moyen de ce noyau mis en terre que par l’usage du talea dont nous avons parlé, c’est le talea qu’on emploie pour former les pépinières.
XLII. Pour le sainfoin il faut une terre qui n’ait ni trop de sécheresse ni trop d’humidité, et soit d’une nature intermédiaire. Les auteurs prétendent qu’un sol dans cette condition n’exige comme semence qu’un modius et demi de sainfoin par iugerum. On sème cette plante comme le blé et le foin c’est-à-dire en jetant la graine sur la terre.
XLIII. On sème la graine de cytise, comme celle du chou, dans une terre bien labourée. Lorsqu’ensuite le cytise est venu, on le transplante, en mettant entre chaque plant un pied et demi de distance; ou bien on prend d’un cytise vigoureux de petites boutures que l’on met en terre, en les espaçant de même que les tiges qui viennent de graine.
XLIV. La semence d’un iugerum est, en fèves, de quatre modii; en blé, de cinq; en orge, de dix; en froment, de dix. Cette proportion cependant varie selon la qualité du sol; en plus, si la terre est grasse; en moins, si elle est maigre. Pour cette appréciation on fera bien d’observer les habitudes locales, et, avec d’autant plus de raison, que la même quantité de semence rend en certains endroits dix pour un, et quinze en d’autres; comme en Étrurie par exemple, et en quelques cantons d’Italie. A Sybaris, dit-on, le rendement ordinaire est du centuple. Il en est de même à Garada en Syrie, et à Bysacium en Afrique. Il importe encore beaucoup de distinguer pour l’ensemencement, entre les terres neuves, celles qu’on appelle restibiles et qui rapportent tous les ans, et les jachères, où la production n’est qu’alternative. A Olynthe, dit alors Agrius, on moissonne tous les ans; mais on dit que de trois ans en trois ans la récolte est plus abondante. Après chaque récolte, dit Licinius, il faudrait toujours laisser un an de repos à la terre, ou au moins, de deux années l’une, ne lui confier que des semences assez légères pour ne point l’épuiser. Parlez-nous maintenant, dit Agrius, de la troisième phase, des productions de la terre, c’est-à-dire de la nutrition. Toute plante, reprit Licinius, reçoit de la terre sa nourriture et son accroissement. Devenue adulte, elle conçoit; et, après avoir porté le temps nécessaire, elle enfante des fruits ou des épis: en sorte qu’elle reproduit un germe en tout semblable à celui dont elle est née. Si vous arrachez une fleur de poirier ou de tout autre arbre, si vous en cueillez le fruit encore vert, il ne pousse plus rien de toute l’année à l’endroit de cette mutilation; car les plantes ne peuvent avoir deux portées en un an. Elles produisent comme les femmes accouchent, à leur époque.
XLV. L’orge lève habituellement le septième jour; le blé le suit de près. Les légumes sortent presque tous de terre au bout de quatre ou cinq jours; à l’exception cependant de la fève, qui pousse un peu plus tard. La germination pour le millet, le sésame, et les graines analogues, est à peu près de la même durée, à moins de retard provenant de la température ou de la condition du sol. Les plantes élevées en pépinières sont d’une délicatesse extrême. Si le pays est froid, il faut dans la saison d’hiver les couvrir de feuilles ou de paille. Il faut encore, quand le froid est suivi de pluie, prendre garde que l’eau ne séjourne auprès; car la gelée est un poison pour leurs tendres racines aussi bien que pour leurs jeunes pousses, qui même en sont arrêtées davantage dans leur développement. Les plantes en automne et en hiver profitent plus dans la partie qui est sous terre, et qui conserve toujours un certain degré de chaleur vivifiante, que dans la partie qui est au-dessus, et que le froid de l’air frappe de tous côtés. C’est ce qu’on voit dans toute végétation de nature que la main de l’homme n’a pas encore touchée. La croissance dans les racines est bien plus rapide que dans la partie supérieure de la tige, sans toutefois dépasser le point où s’arrête l’influence des rayons du soleil. L’extension que prennent les racines est subordonnée à deux causes différentes, à leur essence d’abord, ensuite à la nature du sol, où elles s’ouvrent plus aisément passage les unes que les autres.
XLVI. Nous voyons parfois des effets surprenants de ces mêmes causes. Ainsi les feuilles de certaines plantes indiquent, par leur seule position, l’époque de l’année où l’on se trouve. On est sûr par exemple que le solstice d’été est passé, sitôt que les feuilles de l’olivier, du peuplier blanc et du saule se sont retournées. Un phénomène non moins singulier est celui qu’offre la fleur appelée tournesol, que nous voyons se tourner le matin vers le soleil levant, et le suivre dans sa course jusqu’à son coucher, le calice toujours ouvert de son côté.
XLVII. Les plantes élevées et greffées dans des pépinières, comme le figuier et l’olivier, étant, ainsi que nous l’avons dit, d’une délicatesse extrême, il faudra avoir soin de leur former un abri de deux planches, attachées de gauche et de droite. On devra également arracher toutes les herbes autour de leur pied, et s’y prendre pour cela de bonne heure, car si on laisse fortifier cette végétation parasite, elle résiste et se rompt, plutôt que de céder à la main. Quant à l’herbe des prairies, qui croît pour la fenaison seulement, il ne faut pas l’arracher quand elle se forme, mais il faut craindre de marcher dessus, et en éloigner les troupeaux et toute espèce de bétail. Les hommes eux-mêmes doivent s’interdire d’y passer. L’herbe disparaît sous les pas, et la trace devient sentier.
XLVIII. On appelle épi dans le blé le point culminant de la tige. Lorsque l’épi d’orge ou de froment est entier, il se compose de trois parties adhérant l’une à l’autre, savoir le grain, la balle et les barbes, sans compter la gaine qui enveloppe le grain au commencement de sa formation. On appelle grain le corps solide qui se trouve dans l’intérieur de l’épi; balle, la pellicule qui renferme le grain; et barbes, ces sortes d’aiguilles longues et fines dont la balle est comme défendue. La balle est donc l’étui du grain, et les barbes en forment la palissade. Les barbes et le grain sont choses assez connues; mais peu de gens savent ce que c’est que la balle. Aucun auteur, à ma connaissance, n’en a parlé, excepté Ennius dans sa traduction des livres d’Evhémérus. L’étymologie du mot gluma (balle) paraît être glubere (écorcer, peler), parce qu’en effet il faut dépouiller le grain de cette pellicule qui le couvre. On donne par la même raison le nom de gluma à la peau qui couvre la pulpe de nos figues. Arista (barbe) vient du mot arescere, sécher, parce que c’est la partie de l’épi qui se sèche la première. Granum (grain) vient de gerere, porter; car c’est pour le grain que l’épi doit porter, et non pour la balle ou les barbes, que l’on sème le blé; de même qu’on plante la vigne afin qu’elle porte non pas des pampres, mais des grappes. Spica, l’épi que les paysans par tradition appellent encore speca, paraît être dérivé de spes (espérance), parce qu’on sème avec l’espoir de recueillir. On appelle muticus (écorné) l’épi qui n’a point de barbes, parce qu’elles font aux épis l’office de cornes. Lorsque l’épi commence à se former, il est renfermé dans une petite enveloppe verte qui le dérobe entièrement; c’est ce qu’on appelle vagina, gaine, nom qu’on donne également au fourreau qui contient l’épée. L’extrémité supérieure de l’épi mûr, et qui est d’un volume moindre que le grain, est ce qu’on appelle frit; l’extrémité inférieure an point de sa jonction avec la tige, et qui est également moindre que le grain, s’appelle urruncum.
XLIX. Stolon avait fini de parler; et personne ne le questionnant, il pensa qu’on ne désirait pas en savoir davantage sur la nutrition des plantes. Alors il annonça l’intention de passer aux récoltes. Dans les prairies basses, dit-il, l’herbe doit être fauchée au moment où elle commence à se sécher. On la retourne avec la fourche jusqu’à complète dessiccation. Il faut alors la botteler avant de la transporter à la ferme; puis on passe le râteau sur le pré pour ramasser l’herbe qui sera restée à terre, que l’on ajoute aux meules de foin. La fenaison terminée, viennent les regains; opération qui consiste à passer une seconde fois la faux avec plus de soin, afin d’atteindre les herbes qui ont échappé à la première coupe, et qui forment de petites touffes à la superficie du pré; c’est, je crois, du mot sectio (coupe) qu’est venu celui de sicilire, faire le regain.
L. Messis, moisson, dont meto est la racine, se dit proprement de tout ce qu’on moissonne, et notamment du blé. On moissonne les grains de trois manières. La première, usitée dans l’Ombrie, consiste à couper le tuyau à ras de terre, et à lier sur place au fur et à mesure. Quand on a formé un certain nombre de javelles, on les reprend une à une pour séparer l’épi de sa tige. On réunit tous les épis dans un panier qu’on porte à l’aire. La paille qu’on a laissée se met ensuite en tas. Pour la seconde manière, en usage dans le Picénum, on se sert d’un instrument de bois recourbé, à l’extrémité duquel est adaptée une petite scie de fer. Cet instrument réunit en faisceau les épis qu’il hache sur pied, laissant la paille debout, pour être sciée plus tard. La troisième manière, qui se pratique aux environs de Rome, et dans beaucoup d’autres contrées, est celle-ci. On coupe la paille par le milieu, en tenant la tige par le bout de la main gauche; et c’est là, je pense, l’origine du mot messis (moisson), qui viendrait alors de medium (milieu). On coupe ensuite le chaume ou la partie qui se trouvait au-dessous de la main, et qui tient encore à la terre par sa racine. Quant à la paille adhérant à l’épi, on la met dans des paniers, et on la porte à l’aire. Là on la sépare pour la serrer dans un lieu découvert, palam; ce qui peut bien être l’étymologie de palea (paille) quelques-uns dérivent son autre nom stramentum du verbe stare (être debout), et de stamen son substantif. D’autres le font venir de stratus (étendu), parce qu’on étend la paille quand elle sert de litière aux troupeaux. La moisson se fait dès que le blé est mûr. Dans les conditions ordinaires, un homme peut, dit-on, expédier son arpent en un jour, ramasser les épis dans une corbeille, et les porter à l’aire.
LI. L’aire doit être en plein champ et placée sur une éminence, afin que le vent y souffle de tous côtés. Donnez-lui une dimension proportionnée à l’importance de la récolte; que sa surface soit circulaire de préférence, et légèrement exhaussée au centre, pour ménager aux eaux un prompt écoulement en cas de pluie; car du centre à la circonférence rien de plus court que le rayon. Formez-en le sol de terre bien battue, de glaise s’il est possible : autrement la chaleur y opère des gerçures où l’eau séjourne, ou qui servent de retraite aux rats et aux fourmis. On prévient ces inconvénients en enduisant l’aire de marc d’huile. Rien n’empêche mieux l’herbe de pousser, et c’est la mort aux fourmis et aux taupes. Quelques-uns, pour plus de solidité, ont des aires pavées ou même carrelées. D’autres, comme les Bagiennis, poussent l’attention jusqu’à les couvrir, pour les mettre à l’abri des orages, très fréquents dans cette contrée vers l’époque de la moisson. En pays chaud, quand l’aire est sans toit, il faut ménager dans le voisinage des espèces d’abris, où les ouvriers puissent se mettre à l’ombre pendant l’ardeur du jour.
LII. La plus belle partie de la récolte et la plus forte en épis doit être mise à part pour les semences. C’est dans l’aire qu’on sépare le grain de l’épi; ce qui s’opère au moyen d’un traîneau qu’on fait tirer par des bêtes de somme. Le traîneau est formé d’une planche garnie en dessous de fer ou de pierres pointues, laquelle supporte le conducteur ou quelque poids équivalent. Cette machine, qui se promène sur les épis, en détache le grain qu’ils contiennent. Le traîneau consiste quelquefois en une réunion de soliveaux garnis de dents et de roulettes. C’est alors ce qu’on appelle le chariot à la carthaginoise. Cette forme comporte de même un conducteur assis, et un attelage de bêtes de somme. Elle est usitée dans l’Espagne citérieure, et autres lieux. Quelques-uns se contentent de faire fouler les épis par leurs bêtes, qu’ils poussent à coups de gaule, et dont le trépignement remplit le même office. Quand le blé est bien battu, on le vanne avec un instrument appelé uallum ou uallabrum, en ayant soin de choisir pour cette opération un moment où le vent n’ait qu’assez de force pour emporter les parties légères qu’on appelle acus, en sorte que le froment reste par l’effet de son poids, et arrive à la corbeille épuré.
LIII. La moisson faite, on vend le droit de glaner, ou bien l’on arrache le chaume pour le porter à la métairie. S’il reste trop peu d’épis, et que la main-d’œuvre soit chère, il vaut mieux y faire paître les troupeaux. Car la considération dominante est que le bénéfice ne soit pas absorbé par les frais.
LIV. Lorsque le raisin est mûr, on procède aux vendanges. Il faut examiner d’abord par quelle espèce de raisin, et dans quelle partie du vignoble, la récolte doit commencer. Car le raisin précoce, ainsi que la miscella (mélange), qu’on appelle vulgairement raisin noir, mûrissent longtemps avant les autres espèces. Il faut donc les cueillir les premiers. On doit aussi débuter par le côté du vignoble le plus exposé au soleil. On fait ensuite un triage du raisin à manger en grappe, et de celui dont on fait du vin. Le premier choix va droit au pressoir, et de là au tonneau. Le raisin de table est mis à part dans des paniers, puis renfermé dans des vases de terre, qu’on dépose au fond d’une futaille où le marc est resté. On le garde aussi dans des amphores enduites de poix, que l’on descend au fond d’un réservoir d’eau; ou bien on le fait sécher dans l’aire, avant qu’il n’entre au garde-manger. Quand le raisin est foulé, remettez sous le pressoir les pédicules et les peaux; on en exprime ainsi ce qui peut y rester de vin doux, et l’on augmente d’autant la cuve. Lorsque le marc ne rend plus, on coupe tout ce qui déborde le pressoir, pour le presser de nouveau. Le résultat de ce dernier tour du pressoir s’appelle circumcisitum (vin de rognure); mais on le met à part, parce qu’il sent le fer. Quand le marc a été bien pressuré, on le jette dans des tonneaux qu’on remplit d’eau. On obtient par là une boisson du nom de lota (piquette), contraction de lota acina (levure de marc), et qui se donne aux ouvriers en guise de vin pendant l'hiver.
LV. Nous arrivons maintenant à la récolte des olives. Tant que le fruit se trouve à portée, ou qu’on peut y atteindre avec le secours d’une échelle, il vaut mieux le cueillir que le gauler; l’olive froissée se dessèche, et rend moins d’huile. Il vaut mieux encore la cueillir à la main nue qu’avec le doigtier, dont la dureté meurtrit la baie et même écorce les branches de l’arbre, qui en sont plus exposées à l’action du froid. Quand le fruit se trouve hors de portée, on doit se servir plutôt de roseaux que de perches pour l’abattre; car de deux inconvénients, il faut choisir le moindre. Il faut surtout avoir soin de ne point gauler à rebours, afin que le fruit en tombant n’entraîne pas avec lui le bourgeon; sans quoi l’arbre serait frappé de stérilité l’année suivante. On dit communément que les oliviers ne donnent de récolte, de pleine récolte au moins, que de deux années l’une. L’habitude de gauler n’en est pas certainement la moindre cause. Comme le fruit de la vigne, l’olive quand elle est rentrée sert à deux fins : ou on la mange en nature, ou on la convertit en un liquide onctueux que le corps humain s’applique concurremment en dedans et en dessus; car il nous suit au bain et au gymnase. L’olive à faire de l’huile est jour par jour mise en tas sur des planches, où on la laisse quelque temps macérer. Ensuite chaque tas, par ordre de formation, se transporte au trapèze. C’est ainsi qu’on appelle un appareil composé de deux meules, d’une pierre dure et rocailleuse. L’olive qu’on laisse en tas trop longtemps fermente, et donne de l’huile rance. Aussi, dans le cas où l’on ne pourrait l’employer dans le temps voulu, il est bon de remuer les tas pour faire prendre l’air au fruit. On tire de l’olive deux produits différents, savoir, l’huile que tout le monde connaît, et le marc, dont l’utilité est trop ignorée; car on le voit généralement couler sans profit des pressoirs dans les champs, où il laisse de larges places noires, et parfois stériles, quand la terre a été profondément imbibée. Or cette substance a, pour qui sait en faire usage, une sorte d’application utile, principalement en matière d’agriculture. Répandue au pied d’un arbre, d’un olivier notamment, partout où on l’emploie, elle détruit toute végétation nuisible.
LVI. Agrius s’adressant alors à Stolon. Me voilà, dit-il, assis depuis longtemps dans la ferme, les clefs à la main, et attendant toujours que vous y fassiez entrer la récolte. Eh bien, dit Stolon, me voilà; je suis sur le seuil, ouvrez la porte. En ce qui concerne le foin, il vaut mieux le rentrer directement que le laisser en meules à découvert : les bestiaux du moins l’aiment mieux ainsi, comme on peut s’en assurer en leur donnant le choix de l’un et de l’autre.
LVII. Pour le blé, il faut le serrer dans de hauts greniers, où les vents soufflent du nord et de l’est, et où l’humidité ne puisse pénétrer d’aucun côté. Que les murailles et le sol en soient revêtus d’un mastic composé de marbre pilé, ou du moins de glaise mêlée à de la paille de froment et du marc d’huile. Cet enduit préserve les greniers des rats ou des vers, et contribue en même temps à donner au grain de la consistance et de la fermeté. Quelques personnes humectent leur grain de marc d’huile, dans la proportion d’un quadrantal par mille modii environ; d’autres répandent ou plutôt égrugent au-dessus de la craie de Chalcis ou de Carie, de l’absinthe, et autres substances analogues. Certains cultivateurs ont des greniers souterrains ou caveaux appelées sirus, comme on en voit en Cappadoce et en Thrace; ailleurs on se sert de puits, comme dans l’Espagne citérieure, et aux environs d’Osca et de Carthage. Le sol au fond de ces puits est couvert de paille; aucune humidité n’y pénètre, car on ne les ouvre jamais; ni même un souffle d’air, si ce n’est lorsqu’il y a nécessité de recourir à la réserve. L’air en étant exclu, il n’est pas à craindre que le charançon s’y mette. Le blé dans les puits se conserve cinquante ans, et le millet pourrait même s’y garder plus d’un siècle. D’autres enfin construisent dans leurs champs mêmes des greniers qui sont comme suspendus. On en voit de ce modèle dans l’Espagne citérieure, et dans certaines contrées de l’Apulie. Ces greniers sont éventés non seulement des côtés par les courants qui viennent des fenêtres, mais encore par l’air qui frappe dessous en leur plancher.
LVIII. Les fèves et autres légumes se conservent très longtemps, sans se gâter, dans des vaisseaux à huile que l’on recouvre de cendre. Caton dit aussi que le petit et le gros aminéen, ainsi que le raisin dit apicius, se gardent très bien dans des pots de terre; mais qu’on les conserve également ou dans du vin cuit jusqu’à la diminution des deux tiers, ou tout simplement dans du vin doux. Il ajoute que le lucarina (raisin ferme) et l’aminéen scantien sont de toutes les espèces de raisins ceux qui se conservent le mieux suspendus.
LIX. Quant aux autres fruits, comme les poires, coings, les scantiennes, les quiriniennes, les pommes rondes, les pommes appelées autrefois mustea (douces comme le moût), et qu’on appelle aujourd’hui melimela (douces comme le miel), tous se conservent très bien sur la paille en lieu sec et frais. Aussi quand on fait construire un fruitier, il faut avoir soin d’en ouvrir les fenêtres au nord, et de laisser un libre accès aux vents qui soufflent de ce côté. Il importe toutefois de les garnir de volets; car le vent continu finit par ôter aux fruits leur suc, et les rendre insipides. Pour plus de fraîcheur encore, on recouvre en stuc les voûtes, les murailles et même les planchers de ces fruiteries. On voit même certaines personnes y faire dresser des lits pour prendre leurs repas. Et en effet quand on est assez riche pour forcer l’art à faire d’une salle à manger une galerie de peintures, pourquoi se refuserait-on la jouissance toute naturelle de contempler en dînant une variété de beaux fruits, rangés dans une agréable symétrie? N’imitons pas toutefois ceux qui, donnant un dîner à la campagne, étalent somptueusement dans leur fruiterie la dépouille de tous les marchés de Rome. Quant à la manière de conserver les pommes, les uns les posent sur des planches ou tablettes de marbre; d’autres préfèrent les mettre sur de la paille ou des cardes de laine. On conserve les grenades en les mettant avec la branche dans des futailles remplies de sable. Les poires anciennes, ainsi que celles qui mûrissent au temps des semailles, se conservent mieux confites dans du vin cuit jusqu’à la diminution des deux tiers. Quant aux cormes et aux poires, on les coupe ordinairement par morceaux qu’on fait dessécher au soleil. On pourra même conserver les cormes sans les couper, pourvu qu’on les place dans quelque lieu sec et frais. Les raves sont coupées par morceaux, et conservées dans la graine de moutarde. Les noix se gardent mieux dans du sable. Il en est de même des grenades qu’on cueille à leur point de maturité. Pour les grenades qui ne sont pas encore mûres et qui tiennent à la branche, il faudra les mettre dans un pot sans fond qu’on enfoncera dans la terre, après avoir enduit la branche de poix, pour la soustraire à l’influence de l’air extérieur : quand vous le retirez ensuite, le fruit se présente non seulement intact, mais d’une grosseur qu’il n’eût jamais acquise sur l’arbre.
LX. A l’égard des olives de table, Caton nous dit que l’on conserve très bien les orchites et les posea tant sèches que vertes dans de la saumure, ou dans de l’huile de lentisque, si elles sont meurtries. Il ajoute que si l’on veut que l’orchite conserve son beau noir, il faut la mettre dans du sel, dont on la laisse s’imprégner pendant cinq jours; puis on jette le sel, et on expose le fruit pendant deux jours au soleil. On peut aussi confire la même espèce sans sel, en la faisant infuser dans du vin doux cuit jusqu’à réduction de moitié.
LXI. Les agriculteurs expérimentés ont bien raison de conserver le marc d’huile en tonneaux avec autant de soin que l’huile et le vin : voici comme il faut s’y prendre. On le fait bouillir aussitôt qu’il sort du pressoir, et on le verse dans des vaisseaux, après l’avoir laissé refroidir. Il y a encore d’autres manières d’apprêter le marc d’huile; on le mélange avec du moût par exemple.
LXII. Comme on ne met les fruits en serre qu’en vue de les en tirer plus tard, il nous reste encore à faire quelques observations sur ce qui constitue la sixième et dernière phase des productions de la terre. On retire les fruits de l’endroit où on les a serrés, soit pour les consommer, soit pour les vendre, ou bien encore pour les mieux garder. Quant à l’époque à laquelle il faudra les retirer, elle dépend de la nature même des fruits qu’on veut livrer à la consommation, ou préserver de tout accident.
LXIII. Il faut tirer le blé du grenier sitôt que le charançon commence à le ronger. On l’exposera alors au soleil, en plaçant à proximité des bassins pleins d’eau, où ces insectes ne tarderont pas à venir se noyer. Ceux qui ont leur blé sous terre, dans des caveaux appelés g-seiroi, ne devront y entrer qu’après les avoir laissés ouverts pendant quelque temps. Car si l’on voulait s’y introduire immédiatement après leur ouverture, on courrait risque de suffoquer, comme il en est des exemples. Le blé que vous aurez conservé en épis pour le faire servir â votre consommation doit être retiré pendant l’hiver; on le fait moudre et ensuite on le torréfie.
LXIV. Le marc d’huile est un résidu de substance aqueuse, mêlé aux matières que l’huile dépose au fond des vaisseaux de terre où on la renferme. Voici comme on s’y prend d’ordinaire pour le conserver: on dégage le marc en soufflant dessus du liquide qui surnage au bout de quinze jours de dépôt : on le transvase ensuite. Et la même opération se répète jusqu’à douze fois pendant six mois consécutifs, de quinze jours en quinze jours, de façon que la dernière ait lieu dans le déclin de la lune. On fait ensuite bouillir le marc dans des chaudières à un feu doux jusqu’à réduction de moitié, puis on le met en réserve pour s’en servir au besoin.
LXV. Quand le moût est mis en tonneau pour faire du vin, on doit s’abstenir de tirer tant que dure l’ébullition, même lorsqu’elle est assez avancée pour que le vin puisse être regardé comme fait. Si l’on veut boire du vin vieux, il ne faudra le tirer qu’au bout d’une année; car le vin n’est réputé vieux qu’après un an d’existence. Si le cru tourne à l’aigre, il faut consommer de suite, ou vendre le raisin en grappe. Il y a des vins dont la qualité augmente par la durée; tels sont ceux de Falerne par exemple.
LXVI. Les olives blanches, quand on les emploie avant qu’elles ne soient parfaitement confites, ont un goût amer qui rebute le palais. Il en est de même des noires, à moins qu’on ne les trempe dans le sel avant de s’en servir. Cette précaution les rend très mangeables.
LXVII. Moins on conserve les noix, les dattes et les figues, et plus elles sont savoureuses; si la garde se prolonge, les figues perdent leur goût, les dattes moisissent et les noix se dessèchent.
LXVIII. Quant aux fruits qu’on suspend pour les faire sécher, raisins, pommes et cormes, les yeux seuls indiquent le moment de les livrer à la consommation. En effet, on voit aisément, par le degré d’altération de leur couleur et le point de leur dessiccation, quand il faut les manger, pour ne pas attendre qu’ils ne soient plus bons qu’à jeter. Les cormes rentrées tout à fait mûres doivent être mangées promptement; vertes, elles sont plus de garde; car il leur faut le temps d’acquérir la maturité qu’on ne leur a pas laissé prendre sur l’arbre.
LXIX. C’est pendant l’hiver qu’on tire du grenier le blé destiné à la consommation domestique, qu’on doit torréfier pour le rendre propre à la panification. Le blé de semence y reste jusqu’au moment où la terre est préparée pour le recevoir: il en est de même en général de toute espèce de graine. Il ne faut leur faire voir le jour qu’au moment de les employer. Pour ce qu’on destine au marché, il faut attendre le moment de vendre avec avantage. Telle production ne peut se conserver sans s’altérer; il faut se presser de s’en défaire. Cette autre est plus de garde, attendez que son prix s’élève, Qui sait attendre, non seulement retire l’intérêt de sa marchandise, mais en obtient quelquefois un prix double. Stolon parlait encore, lorsqu’un affranchi du gardien entre tout en pleurs, en nous suppliant d’excuser si l’on nous a fait si longtemps attendre; et en même temps il nous invite aux funérailles de son maître pour le lendemain. Nous nous levons tous en nous écriant : Quoi ! à ses funérailles? Quelles funérailles? Alors l’esclave nous raconte, toujours pleurant, que son maître vient d’être frappé d’un coup de couteau, et que le meurtrier s’est perdu dans la foule. Seulement, par une exclamation qu’il avait faite, on jugeait que le crime était l’effet d’une méprise. L’esclave ajoutait que, tout occupé de reconduire son maître au logis, d’envoyer chercher promptement un médecin, il n’avait pas eu le temps de nous avertir plus tôt, et que nous serions sans doute disposés à trouver sa conduite naturelle. Son empressement, il est vrai, n’avait pas empêché son patron de rendre l’âme peu de temps après; mais il croyait néanmoins n’avoir fait en cela que son devoir. Nous ne le trouvâmes que trop excusé, et nous descendîmes tous du temple pour retourner chez nous, plus émus de l’accident, par rapport à l’humanité, que surpris de ce que Rome en était le théâtre.

LIVRE II
Préface
DE L’ÉDUCATION DES BESTIAUX.
Nos grands aïeux avaient bien raison de mettre l’homme des champs au-dessus de l’homme des villes. En effet, autant les habitudes d’une maison de plaisance semblent oiseuses à nos campagnards, s’ils les comparent à la laborieuse agitation d’une ferme, autant cette première existence paraissait-elle active à nos ancêtres auprès de la paresse des citadins. Aussi avaient-ils partagé leur temps de façon à ne donner aux affaires de la ville que deux jours sur neuf, consacrant les sept autres exclusivement aux occupations rurales. Tant qu’ils sont restés fidèles à cette coutume, ils y ont gagné sous deux rapports: d’abord leurs champs rapportaient davantage, et eux-mêmes se portaient mieux. En second lieu, ils pouvaient se passer de ces gymnases de toute espèce dont le raffinement des Grecs a rempli leurs maisons de villes, et qu’il nous faut avoir, nous, maintenant dans nos demeures, depuis le premier jusqu’au dernier. Comme de nos jours il n’est guère de chefs de famille qui, laissant là faux et charrue, n’ait émigré dans l’enceinte de Rome, et ne consacre à applaudir au cirque et au théâtre les mains jadis occupées aux champs et aux vignobles, il en résulte qu’aujourd’hui nous payons pour qu’on nous apporte d’Afrique et de Sardaigne le blé qui nous nourrit, et que nous allons par mer faire vendange à Cos et à Chio. Les fondateurs de cette ville, qui n’étaient eux que des pâtres, avaient voulu que leurs descendants fussent des cultivateurs; et, au mépris de leurs lois, l’ambition de leurs descendants a converti les champs en prairie, sans même faire de différence entre paître des troupeaux et labourer la terre. Autre chose cependant est le laboureur et le pâtre. Pour se nourrir aussi des champs, le bœuf de labour n’en diffère pas moins du bœuf de pâturage. Le bœuf en troupeau ne produit pas; il consomme. Le bœuf sous le joug, au contraire, contribue à la production du blé dans les guérets et du fourrage dans les jachères. Je le répète, la science du cultivateur diffère essentiellement de celle du pâtre. Le but du cultivateur est de tourner à son profit tout ce qu’il fait produire à la terre; celui du pâtre, de retirer tout le parti possible de son troupeau. Mais comme il y a un rapport intime entre ces deux choses, puisque d’un côté le profit peut être plus grand à faire consommer le fourrage sur place qu’à le vendre; et que de l’autre l’engrais, l’élément de fécondation le plus indispensable à la terre, est essentiellement une provenance du bétail. Il s’ensuit que tout possesseur de biens fonds doit embrasser les deux sciences, être à la fois agriculteur et éleveur de troupeaux, et porter ses soins même sur toute espèce animale qui peut se trouver dans une ferme et ses dépendances. Car les volières, les garennes, les viviers, sont toutes industries dont le profit n’est rien moins que méprisable. J’ai traité de l’agriculture dans un premier livre dédié à ma femme Fundania, qui fait elle-même valoir une terre. Celui-ci, mon cher Niger Turanius, je l’écris pour vous, amateur passionné de tout ce qui touche au régime pastoral; vous, que ce goût conduit si souvent aux foires de Macra, et qui trouvez dans ce genre de spéculation de quoi satisfaire à de très coûteuses exigences. La tâche ne sera pas difficile pour moi, possesseur autrefois de bétail sur une grande échelle; car j’ai eu de nombreux troupeaux de l’espèce ovine en Apulie, et à Réate, des haras considérables. Je ne traiterai toutefois que sommairement la matière, me bornant à recueillir ici des entretiens que j’ai eus avec quelques amis, grands propriétaires de bestiaux en Epire, à l’époque de la guerre des pirates, lorsque je commandais les flottes de la Grèce, entre la Sicile et l’île de Délos.
I. Ménas venait de se retirer; et Cossinius se tournant vers moi : « Nous ne vous laisserons pas partir, me dit-il, que vous n’ayez achevé de nous expliquer ces trois parties dont vous aviez déjà commencé à nous entretenir, lorsque vous avez été interrompu. »« Qu’est-ce que ces trois parties? dit Murrius ; ne serait-ce point celles dont vous me parliez hier, et qui concernent l’éducation des bestiaux? » - «Précisément, reprit Cossinius. Nous étions allés voir Pétus qui était indisposé; et là, Varron avait commencé une dissertation sur l’origine de cette science, sur la haute considération qu’elle mérite, et sur toutes les conditions de sa pratique. Il a été interrompu par l’arrivée du médecin. » -« Je ne veux me charger, repris-je alors, que des deux premières parties composant l’historique de la science. Je vous dirai ce que je sais; quelle est son origine, et combien d’estime lui est due. Quant à la troisième, qui est la partie pratique, c’est à Scrofa de s’en tirer... (lui qui s’y entend bien mieux que moi). On peut bien parler grec à des gens qui sont Grecs à moitié. Scrofa, en effet, n’en a-t-il pas remontré à C. Lucilius Hirpus, votre gendre, si célèbre par les beaux troupeaux qu’il possède au pays des Brutiens? » -« Très volontiers, dit Scrofa; mais à la condition qu’en retour, vous autres Épirotes et pâtres par excellence, vous nous ferez part de tout ce que vous savez sur ce sujet, pour me récompenser de ma complaisance; car on a toujours quelque chose à apprendre. » Je m’étais donc ainsi renfermé, de mon choix, dans la partie purement théorique de la science : ce n’est pas que je ne fusse aussi propriétaire de troupeaux en Italie; mais n’est pas joueur de cithare quiconque a l’instrument en main, et je pris la parole ainsi: L’homme et les animaux doivent avoir été de tout temps dans l’ordre de la nature. Soit que l’on admette un principe générateur, avec Thalès de Milet et Zénon de Cittium; soit qu’avec Pythagore de Samos et Aristote de Stagire, on en veuille nier l’existence, il faut convenir avec Dicéarque que la vie humaine, en remontant jusqu’à sa condition le plus anciennement connue, a successivement passé par bien des transformations, avant d’arriver à sa forme actuelle; et que, dans cette condition primitive, l’homme se nourrissait des productions spontanées de la terre, vierge de tout ensemencement. A l’état de nature a succédé la vie pastorale; seconde période, où l’homme, au lieu de se repaître exclusivement de glands, d’arbouses, de mûres et autres fruits sauvages, enlevés aux forêts et aux buissons, choisit parmi les animaux, hôtes des bois comme lui, les espèces dont il peut s’approprier la substance, les emprisonne, et les apprivoise. On suppose avec assez de raison qu’il s’empara d’abord des brebis, comme étant la conquête la plus facile et la plus profitable. Ces animaux en effet, d’un naturel si doux, convenaient parfaitement à la condition primitive de l’homme, à qui ils fournissaient du lait et du fromage pour sa nourriture, des peaux et de la laine pour couvrir son corps. Apres la vie pastorale vint la vie agricole, troisième période de l’humanité, qui garda longtemps plus d’un trait des deux précédentes. De nos jours encore on retrouve plusieurs espèces de bétail à l’état sauvage dans certaines contrées. Les brebis par exemple en Phrygie, où on les voit errer par troupeaux, et les chèvres dans l’île de Samothrace. Ces dernières, dont l’espèce s’appelle en latin rota, abondent en Italie, sur les monts Fiscellum et Tetrica. Quant aux porcs, tout le monde sait qu’il y en a de sauvages, â moins qu’on ne veuille regarder le sanglier comme un autre animal. Les bœufs se trouvent également à l’état le plus sauvage en Dardanie, en Médie, et en Thrace. Les ânes sauvages (onagres) ne sont pas rares dans la Phrygie et la Lycaonie; il y a des chevaux sauvages dans quelques contrées de l’Espagne citérieure. Voilà pour l’origine de la science, je passe à l’estime qui lui est due. Les plus illustres personnages de l’antiquité étaient tous des pâtres; les langues grecque et latine en portent toutes deux témoignage. Voyez les anciens poètes qui appellent leur héros tantôt g-polyarnos (riche en agneaux), tantôt g-polymehlos (riche en brebis), tantôt enfin g-polysoutehs (riche en troupeaux de bœufs.) Ces mêmes poètes nous parlent de brebis dont la toison était d’or, par allusion sans doute à leur extrême cherté. Telle était la brebis d’Atrée à Argos, dont ce prince se plaint d’avoir été dépouillé par Thyeste; et le bélier qu’Eétès possédait en Colchide, but de l’expédition de ces fils de rois connus sous le nom d’Argonautes. Enfin telles étaient, en Libye, celles qu’enfermait le jardin des Hespérides, d’où Hercule ravit les pommes d’or (mala); c’est-à-dire, suivant la tradition, des troupeaux de chèvres et de brebis, qu’il transporta d’Afrique en Grèce. Et en effet les Grecs, pour rappeler par le son le cri de ces animaux, leur ont donné le nom de g-mehla, onomatopée que les Latins ont rendue plus expressive en changeant une seule lettre, bela. Car on entend plutôt bee que me quand une brebis crie. De ce mot on a fait ensuite le verbe belare, en retranchant une lettre, comme dans beaucoup d’autres dérivés. Si le bétail n’eût pas été en honneur chez les anciens, les astronomes ne lui auraient certes pas emprunté plusieurs noms de signes, dans la description qu’ils ont faite du ciel. Loin d’avoir la moindre hésitation à placer ces noms au zodiaque, plus d’un auteur, en énumérant les douze signes, commence par ceux qui portent des noms d’animaux, et donne ainsi le pas au Bélier et au Taureau sur Apollon et sur Hercule, qui, tout dieux qu’ils sont, ne viennent qu’en troisième lieu, sous le nom de Gémeaux. Et, peu contents de n’avoir en noms de bétail qu’un sixième du nombre des signes, ils y ont introduit le Capricorne pour compléter le quart. Les noms de chèvre, de bouc et de chien, que portent différentes constellations, sont également empruntés au bétail. Des terres, qui plus est, et des mers ne tirent-elles pas leurs noms de la même source, témoin la mer Égée, qui doit le sien à l’espèce chèvre (g-aigeios), le mont Taurus en Syrie, le mont Canterius dans le pays des Sabins, le Bosphore de Thrace et le Bosphore cimmérien. Il y a des villes dont les noms n’ont pas d’autre origine par exemple, la ville grecque qu’on nomme g-hippion g-Argos. Enfin l’Italie ne doit-elle pas elle-même son nom aux veaux (uituli), comme le prétend Pison? Qui oserait nier que le peuple romain n’ait eu des pâtres pour ancêtres? Qui ne sait que Faustulus, père nourricier de Romulus et Remus, et l’instructeur de leur jeunesse, était un simple pâtre? N’étaient-ils pas des pâtres eux-mêmes ces fondateurs de notre ville, comme le prouve leur choix pour la fonder, du jour même des Parilia? Ne dit-on pas encore aujourd’hui, suivant l’ancienne coutume, tant de bœufs, tant de brebis, pour exprimer la valeur de certaines choses? Notre plus ancienne monnaie n’a-t-elle pas une figure de bétail pour effigie? Et n’était-ce pas avec une charrue attelée d’un bœuf et d’une vache qu’autrefois on traçait l’enceinte d’une ville, et qu’on marquait l’emplacement de ses portes? Enfin les suouitaurilia, c’est-à-dire les victimes solennelles que l’on promène autour du peuple romain pour le purifier, qu’est-ce autre chose qu’un verrat, un bélier, et un taureau? Combien n’avons-nous pas de noms propres empruntés soit au gros, soit au petit bétail? au petit bétail, comme ceux de Porcius, d’Ovinius, de Caprilius; au gros bétail, comme ceux de Taurius, d’Equitius. Enfin les Annius n’ont-ils pas reçu le surnom de Capra, les Statilius celui de Taurus, et les Pomponius celui de Vitulus? Et combien on en citerait d’autres! Reste à dire en quoi consiste la science même du nourrissage; c’est ce dont notre ami Scrofa, à qui la palme est décernée par le siècle en fait d’économie rurale, va s’acquitter beaucoup mieux que moi. Tout le monde alors tourna les yeux vers Scrofa, qui commença en ces termes: Cette science consiste à se procurer du bétail et à le nourrir, afin de tirer le plus d’argent possible de la chose même d’où vient le mot argent. Car pecunia (argent monnayé) est dérivé de pecus le bétail étant regardé comme la base de toute richesse. Cette science se divise en neuf parties, ou, si l’on veut, en trois, qui se subdivisent chacune en trois autres. La première de ces trois parties comprend le petit bétail, dont on compte trois espèces, savoir: les brebis, les chèvres, et les porcs; la seconde comprend le gros bétail, qui se forme également de trois espèces, savoir, les bœufs, les ânes et les chevaux; la troisième et dernière partie, qui n’est qu’accessoire et non d’un produit immédiat, mais qui cependant est inhérente à la matière, comprend les mulets, les chiens et les bergers. Chacune de ces neuf parties en renferme neuf autres relatives, savoir, quatre à l’acquisition du bétail, quatre à son entretien, et une dernière qui se rapporte à ces deux objets à la fois; ce qui ne fait pas moins de quatre-vingt une parties, toutes indispensables, et d’une importance majeure. D’abord, pour se procurer du bon bétail, il importe avant tout de savoir à quel âge on doit prendre chaque espèce. Les bœufs, par exemple, se payent moins cher en deçà d’un an et passé dix, parce que le bœuf ne commence à servir qu’à sa seconde ou à sa troisième année, et ne sert plus après sa dixième. En général, la première et les dernières années des bestiaux sont toujours stériles. La seconde des quatre parties qui se rattachent à l’acquisition a pour objet la forme extérieure du bétail, considération qui influe beaucoup sur la qualité. Pour l’acheteur, un bœuf aux cornes noirâtres vaut mieux qu’un bœuf aux cornes blanches; une chèvre de grande taille, qu’une petite chèvre. Quant au porc, il doit être long de corps et court de tête. La troisième partie consiste à s’assurer de la race. Celle des ânes d’Arcadie est célèbre dans la Grèce comme en Italie celle des ânes de Réate. C’est au point que j’ai vu un âne se vendre soixante mille sesterces, et deux paires de chevaux, à Rome, aller jusqu’à quatre cent mille. La quatrième partie se rapporte aux formes de droit qui régissent l’acquisition du bétail, et aux précautions légales dont cette propriété s’entoure. Pour qu’elle passe sûrement d’une main à une autre, il faut bien faire intervenir quelques formalités. Ce n’est pas tout, en fait de transaction, qu’on soit convenu d’un prix et qu’on le paye. L’état sanitaire, bon, mauvais ou douteux, amène autant de stipulations différentes dans un marché de bétail. Viennent après l’achat quatre ordres de considérations d’une autre nature. Il s’agit de nourrir son bétail, de le faire multiplier, d’élever les petits, de le conserver sain. Touchant la nourriture, qui est le premier de ces quatre ordres, il y a trois choses à observer relativement aux espèces : les conditions de lieux de parcours, l’époque de l’année où le bétail y doit être conduit, et ce qu’il faut qu’il y trouve à paître. Ainsi des localités montueuses et du feuillage à brouter, voilà ce qui convient aux chèvres, plutôt que de gras pâturages. C’est le contraire pour les cavales. Il y a encore, suivant les localités, pacage d’été et pacage d’hiver. Ainsi les troupeaux de brebis de l’Apulie vont passer la campagne d’été dans le Samnium, après que la déclaration en a été faite aux fermiers de la république, qui l’enregistrent; car il ne faut pas encourir les peines portées par la loi des censeurs. Ainsi, pendant la même saison, les mulets quittent les plaines de Roséa pour les hautes montagnes de Gurgur. Il faut en dernier lieu faire acception des aliments particulièrement propres à chaque espèce de bétail, ce qui ne se borne pas à donner du foin aux chevaux et aux bœufs, et du gland aux porcs, à qui le foin ne saurait convenir. Il faut encore savoir à propos ajouter de l’orge et des fèves à la provende, et faire manger aux bœufs du lupin; du cytise et du sainfoin aux bêtes laitières. Un mois avant la saillie, on augmente la ration des béliers et des taureaux, pour leur donner des forces, tandis qu’on diminue celle des vaches et des brebis; car on prétend, avec raison, que les femelles conçoivent mieux quand elles sont maigres. La génération est l’objet de la seconde partie; et j’appelle génération la période intermédiaire entre la conception et l’instant où la bête met bas; car c’est le commencement et le but de la génération. Il faut s’occuper avant tout de l’accouplement et de l’époque où la femelle admet le mâle. Pour la race portant soie, c’est depuis le lever de Favonius jusqu’à l’équinoxe du printemps; pour la race ovine, du coucher de l’Arcture à celui de l’Aigle. Il faut en outre observer préalablement un temps de séparation nécessaire entre les mâles et les femelles, lequel est ordinairement de deux mois pour toute espèce de troupeaux. La gestation a aussi des soins particuliers, la délivrance arrivant plus tôt ou plus tard, suivant les espèces. La jument par exemple porte un an, la vache dix mois, la truie quatre, la brebis cinq, et la chèvre autant. Un phénomène de génération qui passe toute croyance, et qui est cependant de toute vérité, se voit sur les côtes de Lusitanie en Espagne, près de la ville d’Olysippe, sur le mont Tagro. Là, les cavales conçoivent du vent, comme il arrive assez souvent chez nous aux poules dont les œufs sont appelés g-hypehnemos (conçus du vent); mais les poulains conçus de cette manière ne vivent pas plus de trois ans. Quant aux petits qui viennent à terme, ou après, il faut les nettoyer et les faire lever avec précaution, de crainte qu’ils ne soient (pendant la nuit) écrasés sous la mère. Les agneaux qui naissent après terme, et qui ont conséquemment séjourné plus que le temps normal dans les flancs de la mère, s’appellent chordi, mot dérivé de g-chorion (arrière-faix). La troisième partie, la formation des élèves consiste à examiner combien durera, à quelles heures, et en quel lieu se fera l’allaitement des petits; et si la mère manque de lait, à leur donner une nourrice. Les élèves qu’on fait de cette façon sont appelés subrumi, ce qui veut dire, sous la mamelle. Rumis était, à ce que je crois, l’ancien mot usité pour exprimer la mamelle. On sèvre ordinairement les agneaux au bout de quatre mois, les boucs au bout de trois, et les porcs au bout de deux mois. Comme à cet âge ces derniers sont assez purs pour pouvoir être offerts en sacrifice, on les appelait autrefois sacres (sacrés); c’est à eux que Plaute fait allusion, lorsqu’il dit : Combien coûtent les porcs sacrés? On appelle dans le même sens opimi les bœufs d’engrais que l’on destine aux sacrifices publics. La quatrième partie concerne le régime sanitaire, matière aussi importante que complexe; car une bête malade peut vicier tout un troupeau, et d’un mal individuel faire un désastre général. Il faut distinguer deux sortes de maladies : celles qui, de même que les maladies des hommes, réclament la présence du médecin; et celles qui, pour leur guérison, ne demandent que les soins du pâtre. Cette partie en renferme trois autres: savoir, les causes des maladies, les symptômes qui les annoncent, et le traitement qu’il faut appliquer à chacune. En général, les maladies du bétail ont pour cause l’excès du chaud ou du froid; quelquefois l’excès de travail ou son contraire, le manque d’exercice, ou bien encore l’inobservation d’un temps de repos, quand on les fait boire ou manger immédiatement après le travail. La présence d’une maladie se manifeste par des symptômes. Ceux de la fièvre occasionnée par l’excès de chaleur ou de froid sont : la bouche béante, la respiration entrecoupée, et le corps brûlant. Voici le traitement qu’il faut suivre dans ce cas: On baigne l’animal, on le frotte avec de l’huile et du vin tiède; on le met à la diète, on le couvre bien pour que le froid ne puisse l’atteindre, et on ne lui donne à boire que de l’eau qu’on a fait tiédir. Si ce traitement ne fait point d’effet, pratiquez une saignée; des veines de la tête surtout. Les autres maladies ont également des causes et des signes particuliers. Le pasteur en chef doit en avoir par écrit le détail circonstancié. Reste la question du nombre; neuvième subdivision, commune, ainsi que nous l’avons dit, aux deux premières. Lorsqu’on veut élever des bestiaux, il importe avant tout d’en fixer les quantités, d’examiner combien de troupeaux le fonds comporte, et de combien de têtes chacun doit se composer, afin de n’avoir en terrains ni déficit ni superflu; car il y a perte dans les deux cas. Il faudra de plus, pour chaque troupeau, avoir des notes exactes du nombre des brebis en état de porter, de celui des béliers, de leurs petits mâles et femelles, et enfin des bêtes de rebut, dont il faut se défaire. Quand une mère a trop de nourrissons, certains pâtres lui en retirent. Imitez-les. Ce qui reste profite mieux. Prenez-y garde, dit Atticus. Il y a dans vos catégories quelque chose qui cloche, qui cadre mal avec vos définitions de gros et petit bétail. Essayez, par exemple, d’appliquer vos neuf divisions aux chapitres des pasteurs et des mulets: vos principes sur l’accouplement et la gestation y feraient une belle figure! Passe pour les chiens, à qui ces notions sont du moins applicables. Je vous concède même les pasteurs, parce qu’on leur permet dans les fermes, et même dans leurs stations d’été, d’avoir des femmes avec eux. L’on gagne à cela de les attacher davantage à leurs troupeaux, et d’obtenir des naissances un accroissement de son domestique; ce qui fait fructifier l’exploitation. Cette multiplication de neuf par neuf, repris-je, peut bien n’être pas tout à fait rigoureuse. C’est une façon de parler, comme on dit les mille vaisseaux de l’expédition de Troie, le tribunal des centumvirs (des cent juges) à Rome. Il n’y a qu’à retrancher, en ce qui concerne les mulets, les deux parties relatives à la conception et à la gestation. Du mulet? s’écria Vaccius. Est-ce qu’on n’a pas vu à Rome des mules porter et mettre bas? Je m’empressai de chanter sur le même ton, en citant un passage de Magon et un de Dionysius, où il est dit que la gestation est d’un an chez les juments et les mules. Or, si c’est un prodige en Italie, ajoutai-je, comment ailleurs la chose est-elle trouvée toute naturelle? N’est-il pas vrai que les hirondelles et les cigognes, qui produisent en Italie, ne pondent point en d’autres contrées? Ignorez-vous encore que le palmier-datte, qui donne des fruits en Syrie et en Judée, ne rapporte pas en Italie? Allons, dit alors Scrofa, si vous tenez absolument à avoir nos quatre-vingt une divisions complètes, abstraction faite de la faculté reproductive des mulets, nous avons de quoi remplir la double lacune. Il est en effet deux espèces de produits qu’on tire par surcroît des troupeaux, et qui constituent deux nouveaux sujets de considérations supplémentaires. L’un de ces produits provient de la tonte qu’on fait aux brebis et aux chèvres, en coupant ou arrachant leur toison. L’autre, plus généralement pratiqué, consiste dans le lait et le fromage. Les Grecs ont honoré cette matière d’un nom particulier, g-tyropoiia (fabrication des fromages) et leurs auteurs en ont beaucoup parlé.
II. Voilà ma tâche accomplie; j’ai posé les questions et leurs limites : à votre tour, célèbres Épirotes. Développez devant nous chaque division de la matière, et voyons un peu quelle est la portée des pasteurs de Pergame et de Malède. Alors Atticus, dont le nom de famille était encore T. Pomponius, et qui s’appelle Cédilius Atticus aujourd’hui, prit la parole et dit : Je vois bien que c’est à moi de parler le premier, puisque vous semblez me désigner des yeux. Je traiterai donc des troupeaux que j’appelle, d’après vous, primitifs. Vous venez de nous dire en effet que, parmi ces animaux sauvages, les brebis furent les premières dont l’homme se soit emparé, qu’il ait apprivoisées. Il faut avant tout n’acheter que de bonnes brebis: elles sont réputées telles, quant à l’âge, lorsqu’elles ne sont ni trop vieilles, ni trop jeunes. Les unes ne sont pas actuellement, les autres ne sont plus de rapport. Préférez cependant l’âge où le produit est en expectative, à celui qui n’a d’avenir que la mort. Voici les conditions quant aux formes extérieures des brebis: grande taille, laine abondante et soyeuse, et touffue par tout le corps, mais principalement vers la tête et autour du cou; le dessous du ventre bien fourni. Nos ancêtres nommaient apicœ les brebis au ventre dégarni, et les mettaient au rebut. Ayez soin qu’elles soient basses sur jambe, et à queue longue, si elles sont de race italienne; à queue courte, si elles sont originaires de Syrie. Le premier point à constater, c’est la qualité de la race; il y a deux moyens d’en juger. En premier lieu, le bélier a-t-il le front bien garni, les cornes torses tendant à se réunir vers le museau, l’œil roux, les oreilles fournies, beaucoup d’ampleur de poitrine, d’épaules et de croupe, une longue et large queue? En second lieu, les agneaux issus de lui sont-ils de belle venue? Il faut voir encore si le bélier a la langue noire ou mouchetée, car les agneaux qu’il produira seront respectivement de laine noire ou mouchetée. Quant à l’achat, les formes en sont réglées par la loi, dont les dispositions sont plus ou moins modifiées par la coutume des lieux. Quelques-uns, en fixant un prix par tête, stipulent que deux agneaux choisis (venus après terme), ou deux brebis éventées, ne seront comptés que pour un. On se sert d’ailleurs pour cette espèce de transaction d’une forme traditionnelle, que voici : L’acheteur dit au vendeur: Me les vendez-vous pour tant? et, après réponse affirmative et engagement de l’acheteur d’en payer le prix, ce dernier ajoute, suivant la teneur de la formule : Me garantissez-vous loyalement que ces brebis sont saines, selon les conditions requises pour cette espèce de bétail, qu’il n’en est aucune de borgne, sourde, ni de pelée sous le ventre, ou qui provienne de troupeau malade; et que j’en serai bien dûment propriétaire? Ces formalités accomplies, le troupeau n’est encore considéré comme ayant changé de maître, qu’après le recensement; mais elles suffisent, d’après la législation, de contrats pour qu’acheteur ou vendeur puissent être judiciairement contraints, le premier à livrer même avant d’avoir reçu le prix; le second, à payer ledit prix. Je vais traiter maintenant des quatre autres parties : de l’alimentation, de la propagation, de l’éducation des jeunes, et de l’état sanitaire. Le premier soin est de bien pourvoir à la nourriture des brebis, autant au-dedans qu’au-dehors. Les étables devront être bien situées, à l’abri du vent, et tournées au levant plutôt qu’au midi. Le sol en devra être uni, et de plan incliné, afin d’être facilement balayé et tenu propre; car, dans l’humidité, la laine des brebis s’altère, la corne de leurs pieds se pourrit, et inévitablement les bêtes deviennent galeuses. Le feuillage de leur litière doit être renouvelé au bout de quelques jours, pour leur procurer un coucher plus doux et plus propre : elles n’en mangent que mieux. Il faut encore séparer du reste par des cloisons les brebis malades, ou prêtes de mettre bas : cette précaution n’est guère praticable qu’aux troupeaux qui séjournent dans les fermes. Mais dans les bois et loin des habitations on aura soin de se prémunir de claies, filets, et autres ustensiles propres à construire des parcs d’isolement. Le pacage des troupeaux exige des excursions tellement lointaines, qu’il y a quelquefois plusieurs milles entre les stations d’été et celles d’hiver. Qui le sait mieux que moi? dis-je; car j’ai des troupeaux qui paissent l’hiver en Apulie, et l’été sur la montagne de Réate. Le sentier, calles publicae, chemin réservé aux troupeaux, qui relie ces deux stations ensemble, pourrait être assimilé à un joug, aux extrémités duquel sont assujettis deux paniers qu’on veut porter ensemble. Quand on fait paître les brebis sans changer de contrée, il y a, suivant les saisons, des distinctions à faire dans les heures de la journée. L’été, c’est au point du jour qu’on mène le troupeau au pâturage. L’herbe, alors humide de rosée, est bien plus savoureuse qu’à l’heure de midi, où la chaleur l’a desséchée. Quand le soleil a paru, c’est le moment de le conduire à l’abreuvoir: il retourne, après, plus gaillard à la pâture. Vers midi on le met à l’ombre sous des rochers ou des arbres touffus, en attendant que la grande ardeur soit passée. Puis aux approches de la soirée, quand l’air est rafraîchi, on le fait paître de nouveau jusqu’au coucher du soleil. On aura soin qu’il ait toujours les rayons à dos, car les moutons ont la tête d’une sensibilité extrême. Le soleil couché, après un intervalle de repos, on fait encore boire ses bêtes, et paître de nouveau jusqu’à nuit fermée, parce qu’alors l’herbe aura repris la saveur du matin. Cette pratique doit s’observer scrupuleusement depuis le lever des Pléiades jusqu’à l’équinoxe de l’automne. Dans un champ récemment moissonné, la présence d’un troupeau est doublement avantageuse. Il s’engraisse des épis tombés; et, par le fumier qu’il y dépose, mêlé à la paille broyée sous ses pieds, la terre se trouve tout amendée pour une récolte à venir. Le régime de pacage pour l’hiver et le printemps offre les différences que voici. On mène au pâturage les brebis à l’heure où les frimas de la nuit ont disparu, et on les y laisse tout le jour, ne les faisant boire qu’une fois vers l’heure de midi. C’est à peu près là tout ce qu’on peut dire touchant l’alimentation des brebis. Je passe à la propagation de l’espèce. Il faut, deux mois à l’avance, séparer le bélier étalon du reste du troupeau, et le nourrir plus largement que de coutume. Le soir, au retour du pâturage, mettez devant lui une ration d’orge: il en aura plus de force, et supportera mieux les fatigues de son rôle. Le véritable moment de la monte est depuis le coucher de l’Arcture jusqu’à celui de l’Aigle tout agneau conçu plus tard est chétif et grêle. La brebis porte cent cinquante jours, et conséquemment mettra bas à la fin de l’automne, époque où la température est assez douce, et où l’herbe, renouvelée par les premières pluies, commence à sortir de la terre. Pendant tout le temps de la monte les brebis ne doivent boire qu’à la même source; un changement d’eau ne manquerait pas d’altérer leur laine et de nuire à leur fruit. Sitôt que toutes les brebis sont pleines, de nouveau on les sépare des béliers, dont l’importunité ne leur est plus que nuisible. Ne souffrez jamais qu’elles subissent le mâle avant l’âge de deux ans: plus tôt, elles ne donnent que des agneaux imparfaits, et elles-mêmes s’épuisent. L’âge de trois ans va encore mieux pour produire. Pour empêcher les approches du bélier, on enferme aux brebis les parties sexuelles dans de petits paniers de joncs, ou de toute autre matière; mais le meilleur préservatif, c’est de faire paître séparément mâles et femelles. J’arrive maintenant à l’éducation. Quand les brebis sont prêtes à mettre bas, on les fait entrer dans des étables réservées à cet effet. Là on tient les nouveau-nés près du feu deux ou trois jours, au bout desquels ils sont en état de reconnaître leur mère, et de manger seuls. Les mères brebis sont en état d’aller paître avec le reste du troupeau : on retient les petits à l’étable, pour les faire téter le soir, au retour. Puis on les met de nouveau à part, de crainte qu’ils ne soient foulés aux pieds pendant la nuit. Le matin, avant de conduire les mères au pâturage, on fait encore téter les agneaux, afin qu’ils soient allaités pour toute la journée. Au bout de dix jours environ, on les attache, avec des écorces d’arbres ou quelques autres liens légers, à des pieux plantés à quelque distance les uns des autres, de crainte qu’en courant çà et là tout le jour, ils ne fassent injure à leurs faibles membres. S’ils ne cherchent pas le pis d’eux-mêmes, il faut les en approcher, en leur frottant les lèvres de beurre ou de saindoux, et en leur faisant ensuite flairer le lait quelque temps. Après on mettra devant eux de la vesce moulue, ou de l’herbe tendre, le matin avant le pâturage, et le soir au retour. On continuera ce régime jusqu’au quatrième mois inclusivement: quelques-uns s’abstiennent de tirer leurs brebis pendant ce temps, mais il vaut mieux ne point discontinuer de les traire: les laines n’en sont que plus belles et les bêtes que plus fécondes. Lorsqu’on sèvre les agneaux, il y a des soins à prendre pour les empêcher de dépérir par envie de téter. Il faut les affriander par un choix de nourriture, et veiller à ce qu’ils ne souffrent jamais du froid ou du chaud. Quand ce besoin a cessé de se faire sentir, alors laissez-les se mêler avec le reste du troupeau. On ne châtre les agneaux qu’à l’âge de cinq mois, en choisissant, pour cette opération, une température moyenne. En fait de bélier, il faut choisir de préférence, pour élever, ceux dont les mères font habituellement deux agneaux d’une seule portée. Les recommandations sont pour la plupart applicables à l’espèce qu’on appelle pellita, à cause des peaux dont on l’enveloppe; précaution que l’on prend pour les brebis d’Attique et de Tarente, afin de mieux conserver la finesse de leur laine, et faire qu’elle se tonde, lave et teigne mieux. Les étables et mangeoires exigent également plus de soin, de propreté que celles des brebis à grosse laine. Le sol en doit être pavé, afin que l’urine n’y séjourne point. Les brebis ne refusent aucune nourriture; paille, feuilles de figuiers, feuilles de vigne. On peut aussi leur donner du son, mais par mesure réglée, pour qu’elles n’en aient ni trop ni trop peu; car l’un ou l’autre excès en fait un aliment contraire. Le cytise et la cyzeine sont ce qui leur convient le mieux. Cette nourriture les engraisse, et leur donne du lait en abondance. Quant à l’état sanitaire, il y aurait beaucoup à dire; mais, je le répète, celui qui a charge de troupeau devra avoir par écrit, dans un livre, tout ce qui concerne ce sujet, et porter avec lui sa pharmacie. Reste à déterminer le nombre de têtes d’un troupeau : c’est tantôt plus, tantôt moins, Il n’y a pas là-dessus de règle positive. En Épire, on confie d’ordinaire cent brebis à grosse laine à un seul berger ; et l’on a deux bergers pour le même nombre de chèvres.
III. Cossinius prenant alors la parole: Allons, mon cher Faustulus, dit-il, assez bêlé comme cela. C’est à mon tour; permettez-moi de vous parler des chèvres avec le Mélanthius d’Homère, et prenez en même temps une leçon de brièveté. Pour former un troupeau de chèvres, il faut les choisir avant tout d’âge à produire, et à produire le plus longtemps possible. Il les faut donc plutôt jeunes que vieilles. Quant aux conditions extérieures, prenez des bêtes grandes et fortes, qui aient la taille affilée et la toison épaisse, à moins que ce ne soit de l’espèce à poil ras; car l’une et l’autre existe. Elles devront en outre avoir sous le museau deux excroissances de chair: c’est un signe de fécondité. Plus la chèvre a les mamelles grosses, plus elle a de lait, et plus son lait a de consistance. Les indices de qualité supérieure chez le bouc sont le poil blanc, la tête et le cou ramassés, et l’épiglotte allongée. On forme un meilleur troupeau par achat en bloc d’animaux habitués à être ensemble, qu’en allant les recruter de côté et d’autre. Je m’en réfère, quant à la race, à ce qu’Atticus vient de dire touchant celle des brebis avec cette différence toutefois que la première espèce est dans ses habitudes aussi calme que l’autre est remuante. Voici ce que dit Caton, dans ses Origines, de sa singulière agilité : « Sur les monts de Soracte et Fiscella on voit des chèvres sauvages sauter de rocher en rocher, franchissant un intervalle de soixante pieds et plus. » Nos brebis et nos chèvres domestiques ont une origine sauvage. C’est de ces dernières que l’île de Caprée, sur les côtes d’Italie, tire son nom. Comme les chèvres qui donnent deux petits à la fois sont sans contredit d’une meilleure race que les autres, les mâles qui en proviennent doivent être destinés de préférence à la propagation de l’espèce. Quelques personnes tiennent à se procurer des chèvres de l’île de Média, qui passe pour fournir les plus beaux sujets de l’espèce. En ce qui concerne les achats, on devrait, selon moi, s’écarter un peu de la formule ordinaire; car affirmer que des chèvres sont saines, c’est ce que nulle personne d’esprit sain ne peut faire entendre, puisque cet animal n’est jamais sans fièvre, il y a donc quelques mots à retrancher aux termes généraux du contrat, et c’est le sens de la rédaction que Manilius nous en donne dans ses livres : « Me répondez-vous que ces chèvres sont aujourd’hui en bon état, qu’elles boivent, et qu’elles sont bien et dûment ma propriété? » De subtils physiologistes prétendent, et c’est un fait consigné dans les écrits d’Archélaüs, que les chèvres ne respirent pas, comme le reste des animaux, par les narines, et que chez elles cette fonction se fait par l’oreille. Quant à l’entretien, ce qui forme la première partie du second ordre de considérations, voici ce que j’ai à en dire : L’exposition convenable pour les étables à chèvres est le levant d’hiver; car ces animaux sont très sensibles au froid. Comme pour le bétail en général, le sol de ces étables sera pavé de pierres ou de briques, afin qu’elles soient plus exemptes d’humidité et plus facilement tenues propres. On choisira la même exposition pour les parcs où les chèvres stationnent la nuit dans les lointains pâturages, et le sol en devra être couvert d’une litière de feuillage. Du reste, ce qu’on vient de dire sur le régime alimentaire de la race ovine est également applicable aux chèvres, si ce n’est qu’elles aiment mieux gravir des hauteurs boisées que paître de plain pied dans les prairies. Elles broutent avec une prédilection marquée les pousses d’arbrisseaux sauvages, et s’attaquent volontiers aux plans cultivés : d’où est venu le nom de capra (chèvre), dérivé de carpere (cueillir). Aussi, dans les baux de location, stipule-t-on d’ordinaire l’interdiction de faire paître les chèvres, dont la dent est fatale aux plantations. Et les astronomes n’admettent cet animal dans le ciel qu’en dehors du cercle aux douze signes (les deux Chevreaux et la Chèvre ne sont pas loin du Taureau). En ce qui concerne la propagation, les boucs destinés à la monte sont, comme les béliers, séparés quelque temps du troupeau, et on les présente aux chèvres à la fin de l’automne; les femelles couvertes à cette époque mettent bas au bout de quatre mois, c’est-à-dire dans la saison du printemps. Touchant l’éducation des jeunes boucs, nous nous bornerons à faire remarquer qu’à l’âge de trois mois ils peuvent déjà faire partie du troupeau. Que pourrais-je dire de la santé de ce bétail, qui, en quelque sorte, n’est jamais sain? Toutefois celui qui a la charge du troupeau devrait avoir par écrit, dans son livre, des recettes pour certaines de leurs maladies, ainsi que pour guérir les blessures qu’elles se font en se battant, ou en paissant dans les buissons épineux. Reste à déterminer la force d’un troupeau. Elle doit être moindre pour les chèvres que pour les brebis. L’instinct des unes est de se disperser capricieusement et d’errer à l’aventure; celui des autres est de se réunir et de se masser en quelque sorte sur un même point. Aussi, dans la Gaule, préfère-t-on diviser les troupeaux de chèvres. Les grands troupeaux sont trop sujets à la contagion, et exercent de trop grands ravages; cinquante têtes sont censées suffire pour en former un. Et l’accident arrivé dernièrement à Galérius vient à l’appui de cette opinion : ce chevalier romain possède environ mille jugera de terre dans les environs de Rome. Il entend dire un jour à un berger qui amenait dix chèvres à la ville, qu’elles lui rapportaient chacune un denier par jour. Galérius aussitôt de se former un troupeau de mille chèvres, espérant ainsi retirer chaque jour mille deniers de son fonds. Mais il lui fallut en rabattre; car une maladie vint peu après enlever tout son troupeau. Cependant du côté de Sallence et de Casinum on a des troupeaux de cent têtes. La même divergence d’opinion se rencontre touchant le nombre des femelles que l’on peut faire couvrir par un même mâle. Quelques personnes, et je suis de ce nombre, comptent dix chèvres pour un bouc; d’autres, comme Ménus, en comptent quinze; d’autres, vingt, comme Murrius.
IV. Maintenant qu’un de nos porchers italiens entre en scène, et nous expose la théorie de son état : mais qui peut en parler plus pertinemment que l’homme qui a Scrofa (truie) pour surnom? Afin que vous le sachiez, dit alors Trémellius, vous et tous ceux qui m’écoutent, ce surnom n’est pas originaire dans ma famille, et je ne suis rien moins qu’un descendant d’Eumée. Le premier de nous qui l’ait porté est mon grand-père. Il était questeur de Licinius Nerva, préteur de Macédoine, et se trouvait commander l’armée en l’absence de ce dernier. Les ennemis, croyant l’occasion favorable pour un coup de main, entreprirent de forcer son camp. Mon grand-père, en exhortant les siens à courir aux armes et à faire une sortie contre les assaillants, se vanta de les repousser comme la truie chasse ses petits d’auprès d’elle. Il tint parole : l’ennemi fut battu et dispersé; si bien que le préteur en recueillit le titre d’Imperator, et mon grand-père eut le surnom de Scrofa. Mais ni mon bisaïeul, ni aucun des Trémellius, ne l’ont porté antérieurement; et je ne suis pas moins que le septième préteur de ma famille. Ce n’est pas que je refuse de vous dire ce que je sais du bétail portant soies. Je me suis toujours beaucoup occupé d’agriculture, et conséquemment je ne puis être étranger à ce sujet, non plus que vous autres grands nourrisseurs de bestiaux. Quel cultivateur en effet n’a pas de porcs chez lui? et qui de nous n’a pas entendu dire à son père : « Bien insouciant ou bien peu économe, est celui qui tire de la boucherie et non de son fonds le lard de son garde-manger ! Pour avoir un troupeau de porcs dans une bonne condition, il faut que chaque bête qui le compose soit d’âge et de forme convenables. Par formes convenables on entend ampleur de membres, tête et pieds compris, et robe unicolore plutôt que bigarrée. Le verrat, avec ces mêmes qualités, doit avoir la tête particulièrement grosse. Les présomptions touchant la qualité de la race se forment sur l’aspect des animaux, leur progéniture et leur origine. Sur l’aspect, sont-ils verrat ou truie, la beauté relative de l’espèce; sur la progéniture, font-ils beaucoup de petits? sur l’origine; leur pays natal est-il réputé pour en produire de gros plutôt que de petits? Pour l’achat on se sert de la formule suivante : « Me répondez-vous que ces truies sont saines, que la propriété m’en est bien et dûment acquise, franche de toute répétition; et qu’enfin elles ne proviennent point de troupeau malade? » Quelques personnes y ajoutent : « Et qu’elles ne sont pas atteintes de la fièvre ni de la diarrhée? » En fait de pâturages, ce sont les endroits marécageux qui conviennent à cette espèce de bétail, qui se plaît dans l’eau et même dans la fange. On dit que les loups, lorsqu’ils ont trouvé un porc, traînent cette proie jusqu’à ce qu’ils trouvent de l’eau, leurs dents ne pouvant supporter l’extrême chaleur de sa chair. Les porcs se repaissent surtout de glands, mais aussi de fèves, d’orge, et de toute autre espèce de grain. Cette nourriture non seulement les engraisse, mais donne à leur chair un goût très agréable. En été, on les mène paître le matin, et à midi on les fait stationner quelque part, où il y ait de l’ombrage et surtout de l’eau. Dans l’après-midi on les fait paître de nouveau lorsque la chaleur est tombée. Dans l’hiver le pâturage ne leur convient que lorsque la gelée blanche a disparu, et que la glace est fondue entièrement. On enferme deux mois à l’avance les verrats qu’on destine à la monte. L’époque la plus favorable pour l’accouplement est depuis Favonius jusqu’à l’équinoxe du printemps; car comme les truies portent quatre mois, elles mettront bas au moment où la terre abonde en pâturages. Il faut qu’elles aient un an avant d’être couvertes; et mieux serait d’attendre vingt mois, afin qu’elles aient deux ans à l’époque de mettre bas. La période de leur fécondité dure, dit-on, sept ans après la première portée. Pour les disposer à être saillies, on les mène dans des endroits humides et marécageux, où elles puissent se vautrer dans la fange, ce qui produit sur elles l’effet d’un bain pour l’homme. Quand toutes les truies sont pleines, on les sépare encore des verrats. Ces derniers commencent à saillir à huit mois, et cette faculté leur dure un an dans sa plénitude et va ensuite déclinant jusqu’à ce qu’ils ne soient plus bons qu’à envoyer au boucher, par qui leur chair est distribuée au peuple. Les Grecs appellent le porc g-hys; ils l’appelaient autrefois g-thys, dérivé du verbe g-thyein, immoler, comme pour faire entendre que ces animaux ont été les premières victimes immolées aux autels des dieux. La coutume en a subsisté dans les mystères de Cérès, dans les solennités qui accompagnent la conclusion d’un traité de paix; et la tradition nous en fait retrouver des vestiges dans les cérémonies de mariage des anciens rois et des hauts personnages d’Étrurie, dont le sacrifice d’un porc pour les nouveaux mariés, chacun de leur côté, était la cérémonie préalable. Le même usage existait chez les habitants du Latium, et dans les colonies grecques d’Italie. Le nom de porcus chez nous et celui de g-choiros chez les Grecs est même encore employé par les femmes, les nourrices principalement, pour désigner les parties sexuelles d’une fille nubile. C’est une expression figurée de l’aptitude aux rites de l’hymen. On a dit que le porc était prédestiné par la nature à paraître sur nos tables, et qu’elle avait animé sa substance, comme l’homme la sale, dans ce seul but de conservation. La charcuterie des Gaules a toujours été renommée pour l’excellence et la quantité de ses produits. L’exportation considérable de jambons, de saucissons et autres confections de ce genre, qui se fait annuellement de ce pays à Rome, témoigne de leur supériorité comme goût. Voici en quels termes parle Caton de leur quantité : « On voit en Italie des fosses à conserver le lard, qui contiennent jusqu’à trois et quatre mille pièces de lard gaulois. Le porc arrive quelquefois à un tel degré d’embonpoint qu’il ne peut plus marcher ni même se tenir sur ses pattes, et qu’il faut le transporter en charrette. » Attilius, Espagnol aussi instruit que digne de foi, parle d’un porc tué en Lusitanie dans l’Espagne citérieure, dont le sénateur L. Volumnius reçut deux côtes avec une très petite partie de filet, le tout pesant vingt-trois livres. Le groin de l’animal, depuis le cou jusqu’au boutoir, avait, disait-il, un pied et trois doigts de longueur. Voici, dis-je, un fait qui n’est pas moins curieux, et dont j’ai été témoin oculaire. En Arcadie une truie avait tellement engraissé, qu’elle ne pouvait plus se lever; si bien qu’une souris avait fait un trou dans sa chair et s’y était mise en gésine. La même chose, dit-on, est arrivée chez les Vénètes. La première portée d’une truie donne la mesure de sa fécondité ultérieure, car les suivantes n’en diffèrent pas beaucoup. En ce qui concerne l’alimentation des pourceaux, autrement dite porculation, on laisse les petits pendant deux mois avec leur mère, et on ne les en sépare que lorsqu’ils sont en état de manger seuls. Les pourceaux nés en hiver sont toujours chétifs la cause en est d’abord dans la rigueur de la saison; puis dans le peu de lait que peut leur fournir à cette époque la mère, dont ils mordillent quelquefois les tettes au point de la blesser avec leurs dents. Il faut donner à chaque truie une cahute à part, où elle puisse élever ses petits séparément autrement ceux-ci s’attacheraient à des truies étrangères, et il en résulterait un mélange qui finirait par détériorer la race. L’année se trouve naturellement divisée en deux pour les truies. Elles mettent bas deux fois l’an, ont quatre mois de gestation à chaque portée, nourrissent pendant les deux autres. Les cahutes où elles sont enfermées doivent avoir trois pieds en hauteur, et un peu plus en largeur; le degré d’élévation au-dessus du sol y doit être calculé de manière à empêcher de la part de la truie les mouvements qui la feraient avorter; mais il doit être suffisant pour que le porcher puisse aisément voir dans l’intérieur quand il y a risque pour les petits d’être écrasés par la mère. Pour la facilité du nettoiement, on y ménagera une porte dans le seuil, qui sera élevée d’un pied et une palme de hauteur; ce qui empêche les pourceaux de sortir avec leur mère. Le porcher, chaque fois qu’il nettoiera les cahutes, devra y répandre du sable, ou toute autre matière propre à dessécher l’humidité. Il faut donner aux truies qui ont mis bas une nourriture plus abondante, afin qu’elles puissent fournir du lait suffisamment à leurs petits. On y mettra chaque jour environ deux livres d’orge détrempée, et la ration est doublée c’est-à-dire répétée soir et matin, quand on n’a pas autre chose à leur donner. On appelle les petits lactentes (cochons de lait) tant qu’ils tètent; et quelquefois delici (de lacte) après le sevrage. Dix jours après leur naissance, ils sont regardés comme purs; et nos ancêtres les appelaient alors sevrés, c’est-à-dire propres à servir de victimes. Et nous trouvons ici le commentaire d’un passage des Ménechmes de Plaute. L’un des personnages de la pièce, dont la scène est à Epidamne, croyant qu’un autre est fou, et a besoin d’un sacrifice expiatoire, demande: « Combien coûtent ici les porcs sacrés? » Ceux qui ont des vignes donnent à leurs porcs le marc et les épluchures de raisin. Dès que les pourceaux ne sont plus lactentes (cochons de lait), ils deviennent nefrendes, c’est-à-dire qui ne peuvent encore frendere (casser la fève). Porcus est un vieux mot grec tombé en désuétude, qu’on a remplacé dans ce pays par celui de g-choiron. Il faut faire boire deux fois par jour les truies pendant leur nourriture : elles en ont plus de lait. La truie doit faire autant de petits qu’elle a de mamelles. Si elle en fait moins, on la regarde comme n’étant point de bon rapport; si elle en fait davantage, on crie au prodige. Nous avons en ce genre la vieille tradition de la truie d’Énée, qui mit bas à Lavinium trente pourceaux blancs. Et le miracle se trouva confirmé, quand trente ans plus tard Albe fut fondée par les habitants de Lavinium. On voit encore dans cette dernière ville des monuments publics de cette truie et de ses pourceaux. Leur effigie y est coulée en bronze, et les prêtres nous montrent le corps de la mère conservé dans la saumure. Dans les premiers jours les truies peuvent nourrir jusqu’à huit pourceaux. Passé ce moment, les éleveurs entendus ne manquent pas d’en soustraire la moitié, à mesure qu’ils grandissent; car la mère ne peut avoir assez de lait pour que toute la portée réussisse. Pendant les dix premiers jours, les truies ne devront point quitter leurs cahutes, si ce n’est pour aller boire aux abreuvoirs. Au bout de ce temps on peut les mener paître, mais seulement dans le voisinage, afin qu’elles puissent revenir souvent allaiter leurs petits. Ceux-ci, quand ils ont pris une certaine croissance, suivent volontiers la mère au pâturage: alors on les enferme à part ou on les fait paître séparément, pour les accoutumer à supporter facilement cette privation: Ils y sont faits au bout de dix jours. Le porcher devra ainsi habituer les porcs à obéir au son du cornet. Pour y parvenir il aura soin de faire retentir une fois cet instrument avant d’ouvrir la porte, et de leur faire trouver en sortant de l’orge répandue en traînées. On en perd moins de cette manière qu’en leur présentant le grain en tas, et tous peuvent en approcher plus aisément; on les habitue ainsi à se réunir au son du cornet, et l’on n’a plus à craindre qu’ils ne s’égarent lorsqu’ils sont dispersés dans les bois. Un an est le bon âge pour châtrer les verrats; au moins faut-il qu’ils n’aient pas moins de six mois. Ils quittent le nom de verrat après cette opération, pour prendre celui de maïales. Touchant le régime sanitaire, je me borne à une observation. Si le lait de la mère vient à manquer aux petits, donnez-leur jusqu’à l’âge de trois mois du froment rôti (cru, il relâche trop le ventre). Reste encore la question du chiffre. Généralement on compte dix verrats par cent truies; d’autres en veulent moins de dix. On n’est pas fixé non plus sur la force du troupeau: je regarde, moi, cent têtes comme un nombre convenable. Quelques-uns le font plus grand, et vont à cent cinquante. Il en est qui doublent le premier nombre; d’autres vont même encore plus loin. En général, plus un troupeau est restreint, moins il est coûteux, et moins le porcher a besoin d’aides. Or la question pour chacun est celle des plus grands profits, et non du plus ou moins grand nombre de têtes; c’est donc par les circonstances qu’il faut se déterminer. Ainsi parla Scrofa.
V. En ce moment survient le sénateur Q. Luciénus, l’homme du monde le plus aimable et le plus enjoué, et notre ami commun à tous. Salut, chers Co-Epirotes, dit-il en entrant; salut aussi à Varron, g-poimena g-laohn (pasteur des peuples). Quant à Scrofa, je lui ai déjà donné le bonjour ce matin: on lui rend des saluts, non sans le gronder d’arriver si tard au rendez-vous. Patience, dit-il, mauvais sujet que vous êtes, voici mon dos et un fouet; vous, Murrius, venez çà, et voyez-moi payer rançon à la déesse Palès, afin d’en pouvoir témoigner, au cas où ces gens-là voudraient me faire payer deux fois. Atticus se tournant alors vers Murrius, veuillez, lui dit-il, mettre Luciénus au fait, tant de ce qui a été dit que de ce qui reste à dire, afin qu’il puisse prendre rôle dans l’entretien. En attendant nous allons passer au second acte, c’est-à-dire mettre en scène le gros bétail. Ceci est mon rôle, dit Vaccius, puisqu’il est question de bœufs et de vaches. Je vous ferai part de mes notions sur cette matière: ceux qui y sont étrangers pourront s’instruire; les autres me relèveront, si je me trompe. Vaccius, lui dis-je, prenez-y garde. C’est un sujet capital que le bœuf en fait de bétail; en Italie surtout, pays qui lui doit le nom qu’il porte. Car en Grèce autrefois, si l’on en croit Timée, un taureau s’appelait italos; de là le nom d’Italie, contrée où bœufs et veaux (uituli) abondent, et sont d’une beauté extraordinaire. Selon d’autres, l’Italie doit son nom au fameux taureau Italus, qu’Hercule poursuivit depuis la Sicile jusqu’en ce pays. Le bœuf est le ministre de Cérès, et l’associé de l’homme dans les travaux rustiques. Les anciens le regardaient comme inviolable, et ils punissaient de mort quiconque tuait un de ces animaux : témoin les lois de l’Attique et du Péloponnèse. C’est encore au taureau que Buzugès d’Athènes et Onogure d’Argos doivent leur célébrité. Je sais, dit Vacelus, que le taureau a quelque chose de majestueux; que son nom (g-bous), en composition, est significatif de grandeur; exemples: g-bousykos (grosse figue), g-boupais (enfant d’une belle venue), g-boulios (grande famine), g-boohpis (qui a de grands yeux;) et que de plus on appelle bumamma (pis de vache) le raisin à gros grains. Je sais encore que c’est sous la forme d’un taureau que Jupiter, amoureux d’Europe, enleva de son pays cette belle Phénicienne, et traversa la mer avec elle. Je n’ignore pas non plus que c’est un taureau qui empêcha les enfants de Neptune et de Ménalippe d’être écrasés dans une étable par un troupeau de bœufs. Je sais enfin que les abeilles qui nous donnent le miel le plus doux naissent du cadavre d’un bœuf en putréfaction; ce qui fait que les Grecs les appellent g-bougonas (nées d’un bœuf), expression que Plautius a latinisée, lorsqu’il disait au préteur Illyrius, accusé d’avoir écrit contre le sénat: « Soyez tranquille, je vous rendrai aussi innocent que celui qui a écrit la Bugonia (naissance des abeilles). » Il y a quatre âges pour la race bovine. Au premier âge, l’animal s’appelle veau; au deuxième, juvencus (bouvillon); au troisième, taureau jeune; au quatrième, taureau fait. La femelle prend successivement, suivant l’âge, les dénominations de génisse, de jeune vache, et de vache. Taura est le nom qu’on donne à une vache stérile. Une vache pleine se nomme horda; d’où le mot hordicalia, fêtes où l’on immole des vaches pleines. Quand on veut acheter un troupeau de gros bétail, il faut d’abord s’assurer que les bêtes ont atteint l’âge de génération, et sont encore en état de produire. On les choisira saines et bien prises dans leurs membres, de grande taille et de forme allongée, noires par les cornes, larges du front, avec les yeux grands et noirs, les oreilles velues, les joues raplaties, l’épine dorsale plutôt concave que convexe, les naseaux ouverts, les lèvres noirâtres, le cou long et musculeux, le fanon pendant, le coffre développé, les côtes bien attachées, les épaules larges, le fessier charnu, une queue qui balaye leurs sabots et se termine en bouquet de poils légèrement frisés, les jambes courtes et droites, légèrement renflées au genou, et tournées en dehors, les pieds étroits, et qui ne s’entrechoquent point dans la marche; les ongles lisses, serrés et bien égaux; le poil uni et doux au toucher. En fait de couleur, le noir a le premier rang; le poil rouge foncé, le second; le rouge pâle, le troisième; le blanc ne vient que le quatrième: ce pelage leur indique donc le dernier, et le noir, le premier degré dans l’échelle de force des animaux. Des deux intermédiaires, le second vaut mieux que le troisième; et tous sont préférables en pelage pie (tacheté de noir et de blanc). Il ne faut prendre les mâles que de bonne race; ce dont on juge par leurs formes extérieures, et par celles des veaux issus d’eux, qui doivent leur ressembler en tout. Leur provenance est aussi un point essentiel. La race gauloise est généralement la meilleure que nous ayons en Italie, et la plus propre au travail; le bœuf ligurien est paresseux. Ceux d’Épire sont les meilleurs de toute la Grèce, et l’emportent même sur ceux d’Italie; quelques personnes cependant accordent a ces derniers, comme victimes à offrir dans les sacrifices et les prières publiques, une préférence méritée, par leurs formes colossales et leur pelage éclatant. C’est ce qui fait que les bœufs de poil blanc sont moins communs en Italie que dans la Thrace, notamment vers le golfe Mélas, où l’on n’en rencontre guère d’une autre couleur. Voici les termes de marché usités pour ce genre de bétail, lorsqu’il a déjà subi le joug: « Me répondez-vous que ces bœufs sont sains, et qu’en les prenant je suis à l’abri de toute répétition ultérieure? » S’ils ne sont pas domptés, on stipule comme il suit: « Me répondez-vous que ces bouvillons sont sains, qu’ils proviennent d’un troupeau sain, et qu’en les prenant je suis à l’abri de toute répétition ultérieure? » Les formules sont moins concises, si l’on suit les prescriptions de Manilius. L’on retranche la clause de santé, quand les animaux sont achetés pour la boucherie ou pour les autels. Les forêts où les bœufs trouvent abondamment de jeunes pousses et du feuillage à leur portée sont les lieux de pâturage qui leur conviennent le mieux. Aussi on les tient l’hiver au bord de la mer, et l’été sur les hauteurs boisées. Quant à la propagation de l’espèce, voici les règles que j’observe. Un mois avant l’accouplement, j’empêche mes vaches de se gorger de nourriture, parce que, maigres, elles conçoivent plus facilement. Mes taureaux, au contraire, sont engraissés deux mois à l’avance, avec force paille et foin, et fourrage vert; et pendant tout ce temps je m’attache à les séparer des femelles, comme Atticus. Je prends pour soixante-dix vaches deux taureaux, l’un d’un an, l’autre de deux; j’attends pour leur livrer la femelle, le lever de l’astre que les Grecs appellent Api et les Romains Fides, et je réunis ensuite mes taureaux au reste du troupeau. On tient comme indicatif de sexe, pour le fruit conçu, le côté par ou le taureau se retire après l’acte consommé, prenant la droite de la vache, si c’est un mâle; et la gauche, si c’est une femelle. A vous, lecteurs d’Aristote, ajouta-t-il en se tournant vers moi, d’expliquer cette circonstance. Ne faites pas saillir une vache avant deux ans, afin qu’elle en ait trois lorsqu’elle vêle pour la première fois. Mieux serait encore qu’elle en eût quatre. Les vaches sont fécondes dix ans, et quelquefois plus. L’époque de conception la plus favorable pour elles est la période de quarante jours que suit le lever du Dauphin, un peu après. Car une vache qui aura conçu à cette époque vêlera dans la saison la plus tempérée de l’année, le temps de sa gestation étant de dix mois. J’ai trouvé dans un livre à ce sujet, une assertion bien singulière : c’est qu’un taureau châtré est encore prolifique quand on le mène saillir immédiatement après l’opération. On choisira pour faire paître les vaches des lieux bas, abondants en herbe, et assez spacieux pour qu’elles ne se gênent, ne se heurtent, ni ne se battent. Quelques-uns, pour éviter la piqûre des taons, et de certains insectes qui les attaquent sous la queue et les rendent furieuses, les tiennent enfermées pendant l’ardeur du jour, et mollement couchées sur une litière de feuilles ou de verdure. En été on doit les mener boire deux fois par jour, et une seule fois en hiver. Lorsqu’elles sont prêtes à vêler, il faudra mettre du fourrage frais près des étables, pour les affriander quand elles sortent; car en cet état elles sont sujettes à être dégoûtées. Les lieux où elles se retirent doivent être préservés du froid, qui les maigrit autant que la faim. Durant l’allaitement il faut séparer à l’étable les petits de leurs mères, de crainte qu’ils ne soient écrasés pendant la nuit. On ne les laissera approcher d’elles qu’une fois le matin, et une fois au retour des pâturages. A mesure que les veaux grandissent, il faut soulager les mères, en leur mettant du fourrage vert dans la crèche. Le sol, dans les étables à vaches comme dans toutes autres, doit être construit en pierre ou matériaux équivalents, afin de conserver saine la corne de leurs pieds. A partir de l’équinoxe d’automne, les veaux paissent avec leurs mères. Il ne faut pas les châtrer avant l’âge de deux ans. Si l’opération a lieu plus tôt, ils ont peine à s’en remettre plus tard; ils deviennent indociles, et impropres au travail. Chaque année, suivant la pratique adoptée pour toute espèce de bétail, on fait un triage des bêtes de rebut, que l’on retranche du troupeau; car elles y tiennent inutilement la place qu’occuperaient des sujets productifs. Lorsqu’une vache a perdu son veau, remplacez-le par une autre dont la mère n’a pas assez de lait pour le nourrir. Aux veaux de six mois on donne du son de froment, de la farine d’orge, de l’herbe bien tendre, et on les fait boire matin et soir. Les précautions sanitaires sont multipliées. J’ai extrait des livres de Magon toutes les prescriptions qui s’y rapportent, et je les fais lire souvent à mon bouvier. J’ai déjà dit que le rapport du nombre des taureaux à celui des vaches est de deux pour soixante, et qu’il faut un mâle d’un an et un de deux. Certaines personnes cependant veulent que la proportion soit plus ou moins forte. Notre Atticus, par exemple, n’a que deux taureaux pour soixante-dix vaches. La force du troupeau varie également. Moi, je suis de l’avis de ceux qui regardent cent têtes comme un nombre suffisant. Atticus et Luciénus, ont des troupeaux de cent vingt têtes chacun. Ainsi parla Vaccius.
VI. Murrius, qui était revenu avec Luciénus, pendant que Vaccius parlait, dit alors: Moi, je me propose de traiter les ânes; car je suis de Réate, c’est-à-dire d’un pays d’où viennent les meilleurs et les plus grands. J’y ai fait des sujets que j’ai vendus même à des Arcadiens. Celui qui veut former un beau troupeau d’ânes doit avant tout prendre les mâles et les femelles à l’âge où l’on peut en tirer lignée le plus longtemps possible. Il les choisira robustes, de belle forme, de bonne taille et de bonne race, c’est-à-dire originaires d’un pays réputé pour cette production. C’est ce qui fait que l’Arcadie est le marché aux ânes pour le Péloponnèse, et Réate pour l’Italie; car de ce que les murènes ont si bon goût sur les côtes de Sicile, et les esturgeons sur celles de Rhodes, il ne s’ensuit pas qu’on trouve ces poissons de même qualité dans toutes les mers. Il y a deux espèces d’ânes : les ânes sauvages qu’on appelle onagres, et qui abondent en Phrygie et Lycaonie, et les ânes privés, comme ils sont tous en Italie. L’âne sauvage est propre à la propagation de espèce, car sa progéniture s’apprivoise facilement; tandis que celle d’un âne privé n’est jamais sauvage. Les petits ressemblent toujours â leurs père et mère. Il faut donc bien choisir ceux-ci sous le rapport des formes extérieures. Les conditions de vente et de livraison sont à peu près les mêmes que pour tout autre bétail, et contiennent également des clauses de garantie sanitaire, et contre toute répétition ultérieure. La farine et le son d’orge conviennent parfaitement aux ânes pour nourriture. Les ânesses doivent être couvertes avant le solstice, pour mettre bas au solstice de l’année suivante; car elles portent une année entière. On fera bien de ne point les faire travailler pendant la durée de la gestation, car la fatigue nuit à leur fruit. Quant au mâle, il faut continuer à l’employer, car pour lui ce sont les intermittences de travail qui sont nuisibles. Pour nourrir les petits, on suit les mêmes règles que pour les poulains. La première année, on les laisse avec leur mère. A partir de la seconde, on ne les en sépare pas, sauf la nuit, ayant toutefois soin de les attacher avec un licou un peu lâche, ou quelque lien analogue. La troisième année, on commence à les dresser pour l’espèce de travail à laquelle on les destine. Touchant la quantité, on n’a pas ordinairement d’ânes en grande réunion, si ce n’est pour le transport des marchandises. Leur occupation la plus ordinaire est de tramer la meule, de porter aux champs, de labourer, même dans les terres légères, comme celles de Campanie. On ne les voit guère en nombre que dans les convois organisés pour amener à dos d’âne de Brindes ou d’Apulie à la côte, les huiles, les vins, les blés, et autres denrées.
VII. A mon tour, dit alors Luciénus, d’ouvrir la barrière, et de lancer mes chevaux. Et je ne prends pas seulement pour texte les coursiers mâles dont, comme Atticus, je ne veux comme étalon qu’un pour dix juments; je vais aussi parler des cavales, que le vaillant Q. Modius Équiculus n’estimait pas moins pour la guerre. Veut-on former des troupeaux de chevaux et de cavales, tels qu’on en voit dans le Péloponnèse et dans l’Apulie? Avant tout il faut s’assurer de l’âge des individus, qui, dit-on, ne doit pas être au-dessous de trois ans ni au- dessus de dix. C’est aux dents qu’on reconnaît l’âge du cheval, ainsi que de tout animal qui a le pied fendu, et même celui des bêtes à cornes. A deux ans et demi le cheval commence à perdre les quatre dents du milieu, deux d’en haut, et deux d’en bas. En entrant dans sa quatrième année, il lui tombe encore, à chaque mâchoire, les deux voisines de celles, qu’il a déjà perdues; et les grosses dents appelées molaires commencent alors à pousser. Quand il atteint sa cinquième année, il en perd encore deux autres de même manière. Il en repousse en place, qui, creuses d’abord, commencent à se remplir dans la sixième année; de sorte qu’à sept ans le cheval a son râtelier complet. A partir de cette époque, il n’y a plus de signe certain de son âge; seulement lorsque la bête a les dents saillantes hors de la bouche, les sourcils blancs, et que ses salières se creusent au-dessous des sourcils, on suppose qu’elle a seize ans. Il faut aux cavales une taille moyenne, c’est-à-dire ni grande ni petite; la croupe et les flancs larges. L’étalon, au contraire, doit être choisi de haute taille, d’une belle structure, et toutes ses proportions doivent être en harmonie. Un poulain promet de devenir beau cheval, s’il a la tête petite, les membres bien attachés, les yeux noirs, les naseaux ouverts, les oreilles bien plantées, le cou large et souple, la crinière fournie, brune, frisée, d’un crin soyeux, et qui retombe du côté droit; le poitrail plein et développé, les épaules fortes, le ventre effacé, les reins serrés par le bas, le dos large, l’épine double, et le moins possible en saillie la queue ample et légèrement frisée, les jambes droites, égales et plutôt longues; les genoux arrondis, étroits et surtout point cagneux; la corne dure, et le corps parsemé de petites veines qui s’aperçoivent au travers de la peau; circonstance qui rend son traitement beaucoup plus facile en cas de maladie. L’origine du cheval est un point de la dernière importance, car il y a des races sans nombre. Les plus estimées prennent le nom des contrées dont elles sont originaires; ainsi on dit en Grèce la race thessalienne ou de Thessalie, et chez nous les races apulienne, roséanienne, d’Apulie, de Roséa. Un bon augure dans un jeune cheval, c’est lorsqu’en paissant avec les autres, il se montre empressé à disputer la supériorité à la course ou dans toute autre circonstance; ou bien encore lorsqu’en traversant un fleuve il devance tous les autres à la tête du troupeau, sans regarder derrière lui. L’achat des chevaux se fait à peu près de la même manière que celui des bœufs et des ânes; et la propriété en change de mains, à peu près dans les formes qu’on trouve consignées dans le livre de Manilius. Il n’y a pas de meilleure nourriture pour les chevaux que l’herbe dans les prés, le foin sec à l’écurie. Lorsqu’une cavale a pouliné, il faut ajouter de l’orge à sa provende, et la faire boire deux fois par jour. Quant à la propagation, l’époque de la monte est de l’équinoxe du printemps au solstice, afin que les juments puissent mettre bas en temps propice pour le poulain, qui vient au monde le dixième jour du douzième mois après l’accouplement. Les chevaux qui proviennent d’une conception postérieure à l’époque marquée sont en général défectueux, et plus ou moins impropres à l’usage qu’on se propose d’en faire. Ainsi, dès que le printemps sera venu, le peroriga devra présenter l’étalon à la jument deux fois par jour. Ou appelle peroriga celui qui est chargé de faire accomplir aux chevaux l’acte générateur. Sa présence est nécessaire pour tenir les cavales à l’attache, afin qu’elles soient saillies plus promptement, et que l’étalon ne perde point sa semence par excès d’ardeur. Quand les juments se défendent de l’approche du mâle, c’est un avertissement qu’elles ont été suffisamment saillies. Si l’étalon montre quelque répugnance pour la jument, on frotte les parties naturelles de cette dernière, au moment de ses pertes annuelles, avec de la moelle d’oignon marin pilée dans l’eau jusqu’à ce qu’elle ait acquis la densité du miel; puis on les fera flairer à l’étalon. Je citerai à ce propos un fait incroyable, mais qui n’en est pas moins réel. Un étalon se refusait obstinément à saillir sa mère. Le peroriga s’avisa de lui couvrir la tête, le ramena en cet état auprès d’elle, et l’accouplement eut lieu. Mais on n’eut pas plutôt enlevé le bandeau qui cachait les yeux de l’animal, qu’il se jeta sur le peroriga, et le déchira à belles dents. Quand les cavales sont pleines, il faut les ménager au travail, et ne pas les exposer au froid, ce qui leur serait fatal pendant la gestation. Par ce motif, il faut préserver de toute humidité le sol de leurs écuries, et tenir closes portes et fenêtres. On adaptera aussi de longues barres aux mangeoires pour séparer les cavales, et les empêcher de se battre entre elles. Pendant tout le temps de leur portée, il ne faut pas qu’elles soient poussées de nourriture, ni qu’elles souffrent de la faim. Il y a des personnes qui ne font saillir les cavales que de deux années l’une: les mères, disent-ils, s’en conservent plus longtemps, et les poulains en sont plus forts. Suivant eux, il en est des cavales comme des terres qu’on ne laisse pas reposer: cette production continue les épuise. Les poulains de dix jours vont paître avec leur mère. Évitez qu’ils stationnent dans l’étable, dont le fumier brûle leurs sabots délicats. A cinq mois, on leur donne, chaque fois qu’ils rentrent à l’écurie, de la farine d’orge avec du son, ou toute autre production végétale de leur goût. A l’âge d’un an, on leur donne de l’orge en nature et du son, jusqu’à ce qu’ils ne tètent plus; ce n’est qu’après deux ans révolus qu’on les sèvre. De temps à autre il faut les flatter de la main pendant qu’ils sont avec la mère, afin que plus tard ils ne s’effarouchent pas d’être touchés. Par le même motif, on suspend des mords dans leurs écuries, pour qu’ils s’accoutument, dès le jeune âge à en supporter la vue et à en entendre le cliquetis. Lorsque les poulains auront pris l’habitude d’approcher quand on leur tend la main, il faudra de temps à autre leur mettre sur le dos un enfant, qui d’abord s’y couche à plat ventre, et ensuite s’y tient assis. Pour ce manège, il faut que le cheval ait trois ans. C’est l’âge où sa croissance est faite et où il commence à avoir des muscles. Il en est qui prétendent qu’un cheval peut être dressé à un an et demi; mais le plus sûr est d’attendre qu’il ait trois ans: à partir de ce moment, on lui donne du fourrage composé de céréales de toute espèce coupées en vert; ce qui est pour l’animal une purgation très salutaire. Il faut pendant dix jours le mettre à ce régime pour toute nourriture. Le onzième jour on lui donnera de l’orge, dont on augmentera graduellement la mesure jusqu’au quatorzième. La ration de ce jour servira de base pour les dix suivants. Il faut lui faire prendre ensuite un exercice modéré, le frotter d’huile quand il sera en sueur, et, si le temps est froid, allumer du feu dans l’écurie. Parmi les jeunes chevaux, les uns sont plus propres pour la guerre et les autres pour les transports, ceux-ci pour la monte et ceux-là pour la course, ou à la voiture. Il s’ensuit qu’il faut varier entre eux les soins de l’éducation. L’homme de guerre choisit et dresse les chevaux suivant des conditions tout autres que l’écuyer ou le conducteur des chars du cirque. On comprendra également que le cheval qu’on destine au transport à dos doit être dressé d’autre façon que le cheval de selle ou de trait. On veut sur le champ de bataille un coursier plein de feu. Pour faire route, on préfère un cheval paisible. C’est afin de répondre à cette diversité de vues que l’on a imaginé de châtrer les chevaux. Privé de ses testicules, et conséquemment de liqueur séminale, l’animal devient plus maniable. On appelle canterii les chevaux châtrés, de même que maïales les porcs, et capi les coqs rendus, par cette opération, impropres à la propagation de l’espèce. Quant à la médecine des chevaux, la multitude des maladies et la diversité des symptômes en rendent la science très compliquée; et il est indispensable que le chef d’un haras en ait les différentes prescriptions couchées par écrit. C’est ce qui nous explique pourquoi les Grecs appellent g-hippiatroi (médecins des chevaux) ceux qui traitent les maladies du bétail en général.
VIII. Pendant ce discours, un affranchi de Ménate vint nous avertir, de la part de son maître, que les liba étaient achevés, et que tout était prêt pour le sacrifice: ceux qui voudraient y prendre part n’avaient donc qu’à venir. Quant à moi, m’écriai-je, je ne vous laisse point partir que vous ne m’ayez donné le troisième acte dans lequel figurent les mulets, les chiens et les pâtres. En ce qui touche les mulets, dit Murrius, il y a peu à dire. Les mulets et les bardeaux sont des bâtards engendrés de deux espèces différentes, et entés pour ainsi dire sur une souche hétérogène, puisque le mulet provient d’une cavale et d’un âne, et que le bardeau est le produit d’un cheval et d’une ânesse. Tous deux sont de bon usage, mais nuls pour la propagation. On fait nourrir un ânon nouveau-né par une jument; il en devient plus fort, car le lait de jument est meilleur que celui d’ânesse, et, dit-on, que tout autre lait. Plus tard on lui donne pour nourriture de la paille. La nourrice, non plus, ne doit pas être négligée; car il faut qu’elle allaite concurremment son propre poulain. L’âne, élevé de cette manière jusqu’à l’âge de trois ans, peut être employé à saillir les cavales, et ne les dédaignera point, habitué qu’il est de vivre toujours au milieu d’elles. L’employer plus jeune serait le faire vieillir plus tôt; et il ne donnerait que de faibles produits. Au défaut d’ânes élevés par des cavales, on choisit, pour étalon, le plus grand et le plus fort qu’on peut trouver. Il faut surtout qu’il soit de bonne race, de celle d’Arcadie, par exemple, si l’on s’en rapporte aux anciens, ou, suivant notre propre expérience, de celle de Réate, où l’on vient les chercher de trois cents et même de quatre cents milles de distance. On achète les ânes absolument comme les chevaux. Ce sont les mêmes stipulations et les mêmes garanties. On les nourrit principalement d’orge et de foin, dont on augmente la mesure quelque temps avant la monte, pour leur donner plus de vigueur. Quant à l’époque où le peroriga devra donner les ânes aux juments, elle est absolument la même pour les étalons des deux espèces. Le mulet ou la mule, produit de l’accouplement, devra être élevé avec soin. Les mulets nés en pays humides et marécageux ont la corne du pied molle; mais quand on a soin de leur faire passer l’été sur les montagnes, comme c’est la coutume dans le Réate, elle acquiert un degré de dureté sans pareille. L’âge et la forme sont à considérer, pour qui veut former un troupeau de mulets. L’âge, afin qu’ils soient de force à porter une charge; la forme, afin que l’œil trouve plaisir à les contempler. Un couple de mulets attelés peut tirer toute espèce de voiture. Homme de Réate, continua Murrius en s’adressant à moi, je pourrais donner mon opinion comme autorité sur cette matière; mais vous avez eu vous-même des troupeaux de cavales dans vos domaines, et vous vous êtes fait un revenu des mulets que vous en avez tiré. Le bardeau (hinnus) est le produit d’un cheval et d’une ânesse il est moins grand et plus roux que le mulet, ressemble au cheval par les oreilles, et à l’âne par la crinière et la queue. Il est, comme le cheval, un an dans le ventre de sa mère; et c’est aussi aux dents qu’on reconnait son âge.
IX. Maintenant, dit Atticus, Il ne nous reste plus à parler que des chiens, race intéressante, pour nous autres surtout qui élevons des animaux à laine. Le chien est le gardien du bétail en général; mais il est le défenseur naturel des brebis et des chèvres. Le loup est là sans cesse qui les guette, et nous lui opposons les chiens. Quant aux animaux portant soie, verrats, porcs châtrés et truies, ils tiennent du sanglier, dont la dent est si meurtrière à nos chiens dans les chasses, et ont tous de quoi se défendre. Que dirai-je? Un loup ayant un jour paru au milieu d’un troupeau de mulets au pâturage, ceux-ci aussitôt, par un mouvement instinctif, formèrent un cercle autour de lui, et le tuèrent à coup de pieds. Quant aux taureaux, ils se serrent croupe contre croupe, présentant au loup les cornes de tous côtés. Pour en revenir à mon sujet, il y a deux espèces de chiens: d’abord les chiens de chasse qui sont dressés pour la bête fauve et le gibier, et les chiens de garde qui sont de la dépendance du berger. Je me borne à traiter de ces derniers, en suivant les neuf divisions méthodiques que vous avez indiquées pour le régime général des bestiaux. Il faut d’abord choisir des chiens d’âge convenable. Trop jeunes ou trop vieux, loin de défendre les brebis, ils ne peuvent se défendre eux-mêmes, et deviennent la proie des animaux féroces. Quant à l’extérieur, prenez-les de belle forme, de grande taille, avec les yeux noirs ou roux, les narines de même couleur, les lèvres rouges en tirant sur le noir, ni trop retroussées, ni trop pendantes. On examinera encore s’ils ont les mâchoires allongées et garnies de quatre dents, deux en bas, et deux en haut; celles d’en bas saillantes en dehors de la gueule; celles d’en haut droites, perpendiculaires, moins apparentes, mais également aiguës, et recouvertes en parties par les lèvres. Il est essentiel encore que les chiens aient la tête forte, les oreilles longues et souples, le cou gros et bien attaché, les jointures des ergots écartées les unes des autres, les cuisses droites, et tournées plus en dedans qu’en dehors; les pattes larges et le pas bruyant, les doigts écartés, les ongles durs et recourbés, la plante du pied molle, et pour ainsi dire dilatable comme du levain, et non pas dure comme de la corne; le corps effilé au point de jonction des cuisses, l’épine du dos ni saillante ni convexe, la queue épaisse, la voix sonore, la gueule bien fendue, et le poil blanc de préférence, afin qu’on puisse facilement les distinguer des bêtes fauves dans l’obscurité de la nuit. On veut aux chiennes de grosses tettes de dimension égale. La race des chiens est encore une chose à considérer. Il y a celle de Laconie, celle d’Épire, celle de Salente, ainsi désignées des pays d’où elles tirent leur origine. Voulez-vous acheter des chiens, ne vous adressez ni aux bouchers ni aux chasseurs de profession. Les chiens de boucher ne sont point dressés à suivre le bétail; et les chiens de chasse laissent là les brebis pour courir après le premier lièvre ou cerf qui vient à passer. Les meilleurs chiens sont ceux qu’on achète à des bergers, et qui sont déjà dressés à suivre les troupeaux, ou ceux dont l’éducation n’est point encore faite. Le chien prend facilement toute habitude qu’on veut lui donner, et s’attache plus au berger qu’au troupeau. P. Aufidius Pontianus d’Amiternum avait acheté des troupeaux de brebis au fond de l’Ombrie. Les chiens étalent compris dans le marché, et les bergers devaient accompagner les troupeaux jusqu’à la foire d’Héraclée et aux bois de Métaponte. En conséquence, arrivés au lieu convenu, mes gens retournèrent chez eux sans les chiens. Mais, peu de jours après, ceux-ci, regrettant sans doute leurs anciens maîtres, vinrent d’eux-mêmes les rejoindre en Ombrie, à plusieurs journées de distance et, sans s’être nourris autrement que de ce qu’ils trouvèrent dans les champs. Notez bien qu’aucun de ces bergers sans doute n’avait fait usage de la recette recommandée par le livre de Saserna. Pour se faire suivre d’un chien, on n’a qu’à lui donner une grenouille cuite dans l’eau. Il importe d’avoir ses chiens tous de même race; car cette espèce d’amitié fait qu’ils se soutiennent. Quant à l’achat, qui est le quatrième dans l’ordre des considérations, même forme de transmission de la propriété; et mêmes stipulations de garantie, en cas de répétition ou de maladie de l’animal, pour les chiens que pour tout autre bétail, sauf les exceptions qui peuvent être utiles. Quelques-uns fixent le prix à tant par tête; d’autres introduisent la condition que les petits suivront leur mère; d’autres enfin stipulent que deux petits ne comptent que pour un adulte, de même que deux agneaux pour une brebis. En général on comprend dans le marché tous les chiens qui ont coutume d’être ensemble. La nourriture du chien a plus de rapport avec la nourriture de l’homme qu’avec celle de la brebis, puisqu’on lui donne des os et des restes de table, et non des herbes ou des feuilles. Il faut avoir grand soin de lui donner à manger; autrement la faim lui fait déserter le troupeau et chercher sa vie ailleurs. Parfois aussi, poussé par le besoin, il pourrait démentir l’ancien proverbe, et commenter la fable d’Actéon, en tournant ses dents contre son maître. On fera bien de leur donner du pain d’orge détrempé dans du lait; une fois habitués à cette nourriture, ils ne s’éloignent pas facilement. Quand il meurt une brebis, gardez-vous de leur en laisser manger la chair, de peur qu’ils n’y prennent goût, et ne veuillent plus s’en passer ensuite. On donne du bouillon fait avec des os, ou les os eux-mêmes, après les avoir cassés. Ils se fortifient les dents à ronger; et l’avidité avec laquelle ils cherchent la moelle leur élargit la gueule, en donnant du jeu à leurs mâchoires. Habituez-les de bonne heure à prendre leur repas de jour dans les lieux mêmes où paît le troupeau, et celui du soir dans l’étable. Quant à la propagation de l’espèce, on fait couvrir les chiennes aux premiers jours du printemps. C’est l’époque où elles sont en chaleur (catuliunt). Une chienne, fécondée alors, met bas vers le solstice; car cette espèce porte ordinairement trois mois. Il faut dans l’intervalle la nourrir de pain d’orge de préférence à celui de froment, parce qu’il est plus nourrissant et donne plus de lait. Quant aux petits, Il faut tout d’abord choisir dans une portée ceux qu’on veut élever, et jeter les autres. Plus on en ôte à la mère, plus ceux qui restent deviennent forts, le lait étant moins partagé. On leur fait un lit de paille, ou de quelque substance analogue; car, mollement couchés, ils profitent mieux. Les petits chiens commencent à voir clair au bout de vingt jours. On les laisse avec leur mère pendant les deux premiers mois, et peu à peu ils s’en déshabituent d’eux-mêmes. On dresse les chiens en en réunissant plusieurs qu’on excite à se battre ensemble : cet exercice les dégourdit. Mais il ne faut pas le pousser au point de les fatiguer et de les affaiblir. Pour les accoutumer à l’attache, on commence par un lien léger, en les battant chaque fois qu’ils font mine de le ronger, jusqu’à ce qu’ils en perdent l’habitude. Quand il pleut, on garnit leur loge d’herbes et de feuillage, afin de les tenir propres et de les préserver du froid. Quelques-uns croient, en les châtrant, leur ôter l’envie de s’éloigner du troupeau. D’autres s’abstiennent de cette opération, qui, selon eux, les énerve. Il en est encore qui leur frottent les oreilles et l’entre-deux des ergots avec des amandes pilées dans de l’eau, pour les garantir des mouches, des tiques et des puces, dont la piqûre engendre des ulcères dans ces parties. On empêche les chiens d’être blessés par les bêtes féroces, au moyen d’une espèce de collier qu’on appelle mellum; c’est une large zone de cuir bien épais, qui leur entoure le cou. On a soin de la hérisser de clous à tête, de la garnir, en dessous, d’un autre cuir plus douillet, qui recouvre la tête de ces clous, et empêche le fer d’entamer la peau du chien. Du moment qu’une bête féroce, loup ou autre, a senti les clous qui garnissent le collier, tous les chiens du troupeau, avec ou sans collier, sont à l’abri de ses attaques. Le nombre des chiens doit être en raison de la force du troupeau. D’ordinaire on en compte un par berger; mais cette proportion peut varier dans certains cas. Si, par exemple, les bêtes féroces abondent dans le pays, il faut multiplier les chiens. C’est une nécessité quand l’on conduit un troupeau à quelque lointaine station d’hiver on d’été, et qu’on a des forêts à traverser; à un troupeau sédentaire un couple de chiens suffit. Il est bon que ce soit mâle et femelle : ils en sont plus attachés, et, par émulation, plus hardis. D’ailleurs, si l’un des deux est malade, le troupeau ne chôme pas. Ici Atticus regarda autour de lui, comme pour dire: Ai-je oublié quelque chose? Voilà un silence, m’écriai-je, qui appelle en scène un autre interlocuteur.
X. En effet, l’acte ne sera fini que lorsqu’on nous aura instruit de tout ce qui concerne le personnel des pâtres; proportions numériques et conditions individuelles. Cossinius dit alors : Pour le gros bétail il faut des hommes faits; pour le menu, des enfants suffisent. Mais il faut plus de force physique chez les pâtres nomades, qui passent leur vie par voie et par chemin, que chez ceux qui paissent leurs troupeaux dans les environs d’une ferme et rentrent chaque soir au logis. Aussi ne voit-on remplir cet office au milieu des bois que par des hommes dans la vigueur de l’âge, et bien armés; tandis que pour le pacage sédentaire, il ne faut qu’un petit garçon, de même qu’une petite fille, pour tout surveillant. Dans les pâturages éloignés les bergers doivent pendant le jour réunir et faire paître en commun leurs troupeaux, et pendant la nuit rester séparément chacun auprès du sien. Ils seront tous placés sous les ordres d’un seul intendant, de plus d’âge et d’expérience que ses subalternes; car on obéit assez volontiers à plus vieux et plus instruit que soi. Il ne faut pas cependant qu’il soit vieux au point de moins supporter les fatigues de sa condition; car les vieillards non plus que les enfants ne sont propres à franchir des sentiers difficiles, et à gravir des montagnes à pied; fatigues auxquelles sont journellement exposés ceux qui mènent paître au loin le gros bétail, notamment les troupeaux de chèvres, qui se plaisent sur les rochers ou dans les forêts montagneuses. Il faut donc se procurer des pâtres robustes, alertes et agiles, pourvus de membres bien dispos, et capables non seulement de suivre les troupeaux, mais encore de les défendre contre les bêtes féroces et les brigands; des hommes en état de soulever les fardeaux pour charger les bêtes de somme, de courir si le cas l’exige, et de lancer des traits. Tout peuple n’est pas apte indifféremment aux fonctions de pâtres; un Basculien, un Turdulien ne saurait s’en tirer. Les Gaulois y sont éminemment propres, surtout s’il s’agit du service des bêtes de somme. En ce qui concerne l’acquisition, il y a six manières d’obtenir la propriété d’un pâtre: 1° par droit d’hérédité; 2° par voie de mancipation, c’est-à-dire en les recevant d’une personne qui est en condition légale d’en transmettre la possession; 3° par cession, opérée, où, et à qui de droit; 4° par investiture d’usucapion; 5° par adjudication. Le pécule du pâtre passe ordinairement à l’acheteur par droit d’accession, à moins qu’on ne s’en réserve la propriété par les termes de la vente : il y a aussi la garantie habituelle liée à sa santé et au fait qu’il n’a commis ni vol ni causé de tort à son maître qui est responsable, et sauf si l’acquisition se fait par mancipation, l’accord est lié à l’obligation d’une double indemnité ou du prix seul, selon l’accord convenu. Les pâtres doivent prendre leurs repas séparément pendant la journée, chacun avec son troupeau, mais ils se retrouvent en commun lors du souper sous la supervision de l’intendant. C’est le travail de l’intendant de veiller à ce que chaque chose soit pourvue pour le troupeau ou les pâtres, principalement la nourriture pour les pâtres et les soins pour le troupeau : le maître peut fournir pour cela des bêtes de charge ou des chevaux qui peuvent porter sur leur dos. En ce qui concerne la nourriture des bergers, elle est facile, du moins pour ceux qui restent tout le temps à la ferme car ils ont une servante comme épouse, Vénus Pastoralis n’en demande pas plus. Certains disent que fournir des femmes est un expédient pour ceux qui font pâturer les troupeaux dans le saltus, les forêts et n’ont pas de maison mais trouvent leur abri de leur pluie sous des remises improvisées ; que de telles femmes suivant les troupeaux et faisant le repas des pâtres donnent meilleure satisfaction et tiennent les pâtres plus attachés à leur devoir. Mais elles doivent être aussi fortes que les hommes et tout aussi capables de travailler, comme elles le sont dans de nombreux endroits ; on en voit en Illyrie, où les femmes nourrissent les troupeaux, transporter du bois pour le feu, faire les repas ou veiller sur les outils de la maison dans leurs remises. En ce qui concerne l’éducation de leurs enfants, il suffira de dire que ces femmes sont à la fois mères et nourrices. A ce moment, Cossinius me regarda et dit : Je t’ai entendu dire, quand tu étais en Liburnie, que tu avais vu de fortes femmes avec des enfants amenant le bois de chauffe et en même temps portant un enfant en nourrice, voire même deux, faisant ainsi honte aux femmes de notre classe, qui se couchent pour une piqûre de moustique ou quand elles sont enceintes. « C’est exact, répondis-je, et le contraste est encore plus frappant en Illyrie, où il arrive souvent qu’une femme enceinte, près de l’accouchement, quitte un moment son travail et revienne avec un nouveau-né que l’on croirait qu’elle a trouvé plutôt qu’enfanté. » En outre, la coutume de ce pays permet aux filles de 20 ans, appelés vierges, d’aller et venir sans protection et de se donner à qui bon leur semble en ayant des enfants avant le mariage. En ce qui concerne la santé de l’homme et de l’animal sans la présence d’un docteur, résuma Cossinius, l’intendant du troupeau doit avoir des règles écrites, de fait l’intendant doit avoir une certaine éducation, autrement il ne gardera jamais son troupeau correctement. Quant au nombre de bergers, certains comptent juste, d’autres large. J’ai un berger pour 80 moutons de longue laine : Atticus en a un pour cent. On peut réduire ce nombre d’hommes pour les troupeaux importants (mille têtes et plus) plutôt que les petits troupeaux comme celui d’Atticus et le mien, car j’ai sept cents moutons et Atticus, en a, je crois, huit cents, bien que nous ayons tous deux un bélier pour dix femelles. Deux hommes sont nécessaires pour s’occuper d’un troupeau de cinquante juments: et chacun d’eux doit avoir une jument de monte dans ces lieux où la coutume est de les emmener en pâturage, aussi souvent qu’en Apulie et en Lucanie.
XI. Maintenant que nous avons tenu parole, partons, dit Cossinius. « Pas avant d’avoir ajouté quelque chose comme promis m’écriai-je, au sujet des profits supplémentaires que l’on peut tirer du bétail; c’est-à-dire le lait, le fromage et la tonte de la laine. » Cossinius résuma : « Le lait de brebis, et après lui, le lait de chèvre, est le plus nourrissant de toutes les boisons. » Comme purgatif, le lait de jument est le meilleur, et après lui, dans l’ordre, celui de l’ânesse, de la vache et de la chèvre, mais la qualité dépend de la nourriture fournie au bétail, de sa condition et de sa traite. Pour la nourriture du bétail, le lait provenant de l’orge est nourrissant comme d’autres sortes de nourritures sèches et dures. Pour ses qualités purgatives, le lait est bon quand il provient de pâturages verts, tout spécialement d’herbes contenant des plantes, qui, par elles-mêmes, ont un effet purgatif sur le corps humain. Pour la condition du bétail, le lait d’un troupeau est meilleur quand le troupeau est en bonne santé et encore jeune. Pour la traite, le lait est meilleur quand il n’est ni pris pendant trop longtemps, ni en provenance d’une vache ayant mis bas récemment. Le fromage fait avec le lait de vaches est très agréable au goût mais difficile à digérer : vient ensuite, celui fait avec le lait de brebis, tandis que le moins agréable au goût mais le plus digeste est celui fait avec du lait de chèvres. Il y a aussi une distinction entre les fromages quand il est doux et nouveau ou sec et vieux, car il est plus nourrissant doux et l’opposé est vrai quand il est sec. La coutume est de faire du fromage à l’élévation des Pléiades, au printemps jusqu’à son élévation en été, cependant la règle n’est pas drastique à cause des différences de lieux et de la qualité du fourrage. La pratique consiste à ajouter une quantité de ferment, de la taille d’une olive, à deux conges de lait pour le faire cailler. Le ferment pris dans les estomacs de lièvre est meilleur que celui pris dans l’agneau, mais certains utilisent comme ferment le jus d’un figuier mélangé à du vinaigre, et parfois assaisonné d’autres légumes. Dans certains endroits de la Grèce, cela s’appelle g-opon, ailleurs g-dakryon. « Je veux bien croire, dis-je, que le figuier planté à côté du temple de la déesse Rumina le fut par des bergers dans le but que tu indiques, car là, il est de coutume de faire des libations de lait plutôt que de vin ou de sacrifier des cochons de lait. L’homme utilisait le mot rumis ou ruma quand nous disons aujourd’hui mamma, ce qui veut dire mamelle: de là l’appellation pour les agneaux de lait de subrumi tout comme nous appelons les cochons de lait lactantes du mot lac, puisqu’ils sucent la mamelle d’où provient le lait. Cossinius résuma : « Si vous saupoudrez votre fromage avec du sel, mieux vaut utiliser du sel minéral que du sel marin. En ce qui concerne la tonte des moutons, la première chose dont il faut s’assurer avant de commencer est que les moutons n’ont ni croûtes ni plaies, auquel cas il vaut mieux différer la tonte après leur guérison. L’époque de la tonte est l’espace de temps compris entre l’équinoxe du printemps et le solstice, c’est-à-dire lorsque les brebis commencent à transpirer. C’est ce qui fait qu’on nomme la laine nouvellement coupée sucida (laine avec le suint). Immédiatement après la tonte on frotte les brebis d’un mélange de vin et d’huile. Quelques-uns ajoutent de la cire blanche et du saindoux. Si on les couvre de peaux, il faut, avant de les envelopper, enduire l’intérieur de la même substance. Quand on blesse une brebis en la tondant, on applique à la plaie un emplâtre de poix fondue. Ici on tond les brebis à grosse laine au temps où se fait la moisson de l’orge, ailleurs, c’est avant la fenaison. A l’exemple des habitants de l’Espagne citérieure, quelques personnes tondent leurs brebis deux fois par an, de six mois en six mois. Elles se donnent double tâche dans l’espoir d’obtenir plus de laine; de même qu’on fauche deux fois les prairies, pour en tirer plus de foin. Les gens soigneux étendent sous les brebis de petites nattes, pour qu’aucun flocon ne se perde. Il faut pour la tonte un temps serein, et le moment le plus favorable est de la quatrième heure à la dixième; car la grande chaleur, qui met en sueur les brebis, donne à la laine plus de poids, de moelleux, et d’éclat. La laine fraîchement coupée s’appelle vellus ou velumen (ce qui s’arrache); d’où l’on voit clairement que la coutume d’arracher la laine a précédé celle de la tondre. Ceux qui procèdent encore suivant l’ancienne méthode font jeuner les brebis trois jours à l’avance, parce que l’animal étant affaibli, la laine cède plus facilement à la main. On dit que les premiers barbiers sont venus de Cilicie vers la 454e année de la fondation de Rome (c’est ce qui résulte du nom de l’inscription d’Ardée); et qu’ils ont été introduits en Italie par P. Licinius Ména. La prolixité de la chevelure et de la barbe, dans les statues antiques, témoigne encore d’un temps où l’on ne coupait ni l’une ni l’autre. Si la brebis, reprit Cossinius, nous fournit la laine dont nous nous habillons, le poil de la chèvre s’emploie diversement pour la marine, la construction des machines de guerre, et les procédés de l’industrie. Certains peuples se couvrent le corps de la peau même des brebis, comme les Gétules et les Sardes. Cet usage paraît même avoir existé chez les Grecs d’autrefois, comme on le voit par la dénomination de g-diphtherias, donnée dans leurs tragédies à certains vieillards, et sur notre théâtre, aux personnages d’habitudes rustiques; pour témoins, le jeune homme dans l’Hypobolimée de Cécilius, et le père dans l’Heautontimorumenos de Térence. La tonte des chèvres est en usage en Phrygie, où l’espèce à longs poils est commune. C’est de cette contrée que nous viennent les tissus de poil que nous appelons cilices, ainsi nommés parce que c’est en Cilicie qu’a commencé l’habitude de tondre les chèvres. Ainsi parla Cossinius, sans trouver de contradicteurs. En ce moment vint à nous un affranchi de Vitulus, sortant des jardins de ville de son patron. Mon maître, nous dit-il, m’envoie vous prier de moins entamer son jour de fête, et de venir le trouver le plus tôt possible. Nous acceptâmes l’invitation, mon cher Niger, Turranius, Scrofa et moi, nous allâmes rejoindre Vitulus dans ses jardins. Le reste de la société s’en retourna les uns chez eux, les autres chez Ménas.

LIVRE III
I. L’existence humaine a deux modes, Q. Pinnus, manifestement aussi distincts de théâtre que d’origine, la vie des champs et celle des cités. La vie champêtre est de beaucoup la plus ancienne. Longtemps avant qu’il y eût des villes, les campagnes avaient des habitants. Pour la Grèce, suivant la tradition, la plus ancienne des cités est Thèbes, fondée en Béotie par le roi Ogygès. Pour la campagne romaine, c’est Rome, création du roi Romulus, (car c’est maintenant qu’on peut dire, avec plus de vérité qu’on ne pouvait faire à l’époque où écrivait Ennius: qu’il y a environ sept cents ans, plus ou moins, que la célèbre ville de Rome a été bâtie sous les auspices les plus augustes). Or, en admettant que l’existence de Thèbes soit antérieure au cataclysme d’Ogygès, on ne saurait cependant faire remonter à plus de deux mille ans la fondation de cette ville. Maintenant rapprochez cette date de celle où l’on a commencé à cultiver les champs, où les hommes n’avaient d’autres demeures que des cabanes et des chaumières, ne sachant ce que c’était que portes ni que murailles : il s’établit une antériorité presque immémoriale de l’habitation agricole sur l’habitation urbaine. Et il n’y a pas là de quoi surprendre: la nature nous a donné les campagnes, c’est l’art qui a construit les villes. Or l’invention des arts en Grèce ne remonte, dit-on, qu’à mille ans, tandis que de tous temps la terre a été susceptible de culture. Mais la vie agricole n’est pas seulement la plus ancienne, elle est encore la plus recommandable. Ce n’était pas sans raison que nos ancêtres constamment reportaient la population de la ville dans la campagne. Rome, en faisant de ses citoyens des paysans, assurait sa subsistance pendant la paix, et son intégrité en cas de guerre. Il y avait une signification dans tous ces noms de mère et de Cérès donnés indistinctement à la Terre; dans cette croyance de la sainteté, de l’utilité de la profession de cultivateur, qui faisait honorer ceux qui l’exerçaient comme les seuls restes de l’antique race de Saturne. C’est dans le même esprit qu’on a nommé Initia (initiation) les cérémonies particulières du culte de Cérès. Une autre preuve de l’antériorité de la vie champêtre sur la vie des cités, c’est le nom même de la ville de Thèbes, nom qu’elle a reçu de la nature de son sol, et non de son fondateur. Car, dans l’ancienne langue de la Grèce, comme encore aujourd’hui chez les Eoliens, peuple originaire de la Béotie, un monticule s’appelait Teba sans aspiration; et le mot est encore usité parmi les Pélasges, venus de la Grèce dans la campagne sabine. Il en existe même un monument dans le pays; car on voit sur la voie Salaria, non loin de Réate, une butte milliaire qui s’appelle Tebae. L’exiguïté des possessions dans l’origine ne comportait pas de distinction entre l’agriculture et l’éducation des bestiaux. Issus de bergers, les hommes de ce temps semaient et faisaient paître leurs troupeaux dans le même champ; mais plus tard, quand quelques-uns se furent agrandis, les troupeaux furent mis à part, et l’on vit surgir les dénominations spéciales de pâtre et de cultivateur. L’occupation du premier est elle-même divisible en deux parties, que l’on n’a point jusqu’ici distinguées suffisamment. Autre en effet est le régime des animaux nourris dans l’intérieur d’une ferme, et de ceux qu’on mène paître au dehors : celui-ci constitue une profession bien connue et très considérée, désignée particulièrement par le mot de pecuaria. Elle enrichit ceux qui la professent, qu’elle oblige à acheter ou à louer un parcours étendu: l’autre est la basse-cour, occupation moins relevée, dont on a fait une sorte d’annexe de l’agriculture, et que nulle personne n’a, que je sache, traitée spécialement dans toute son étendue. Moi, j’ai toujours cru que l’économie rurale, embrassant indistinctement tout ce qui donne produit, devait se diviser en trois parties : la culture, l’éducation des bestiaux, et l’entretien de la basse-cour. J’ai donc songé à traiter la matière en trois livres, dont deux sont déjà écrits; j’ai adressé le premier, qui est sur l’agriculture, à ma femme Fundania, et l’autre, de l’éducation des bestiaux, à Turranius Niger. Reste donc le troisième, concernant les produits de la basse-cour; et c’est à vous, mon voisin et bon ami, que je veux l’offrir. Votre villa, si remarquable par l’élégance de sa construction tant extérieure qu’intérieure, et par la richesse de ses mosaïques, ne vous paraîtrait pas digne de vous, si les murs, au-dedans, n’étaient garnis de livres, l’ornement auquel vous tenez le plus. Mon désir est de contribuer, autant qu’il est en moi, à ce que, dans cette belle propriété, le produit réponde à la main-d’œuvre. Je vous envoie donc ce livre, résumé d’un entretien sur ce qui constitue la perfection en fait de maison de campagne; et je commence ainsi.
II. C’était durant les comices pour l’édilité, et par la plus grande chaleur du jour. Axius, mon camarade de tribu, et moi, nous venions de sortir, mais nous voulions rester à portée d’accompagner notre candidat quand il retournerait chez lui. Axius me dit: Si nous allions nous mettre à l’ombre dans la villa publique pendant qu’on fera le relevé des suffrages, au lieu de nous entasser dans la moitié de tente que notre candidat peut nous offrir? En fait de mauvais conseil, lui répondis-je, si le proverbe dit vrai, tant pis pour qui le demande. Quand il est bon, tant mieux pour qui le donne et pour qui le reçoit. Nous entrons donc dans la villa publique, et nous y trouvons l’augure Appius Claudius, se levant sur un banc, prêt à répondre au consul s’il le consultait. Il avait à sa gauche Cornélius Mérula (merle), de famille consulaire, et Fircellius Pavo (paon), de Réate; et à sa droite Minutius Pica (pie), et M. Pétronius Passer (moineau). Nous allâmes à lui; et Axius lui dit en souriant: Ne voulez-vous pas nous admettre dans votre volière, parmi les oiseaux que voici? Certes, répondit-il; vous surtout, qui dernièrement m’avez fait manger des oiseaux de passage, dont l’eau me vient encore à la bouche. Nous dînions, je m’en souviens, dans votre villa de Réate, près du lac Velin ; et j’étais appelé de ce côté pour un différend survenu entre les habitants d’Interamne et ceux de Réate. Au reste, ajouta-t-il, ne convenez-vous pas que cette villa où nous sommes, telle que l’ont construite nos ancêtres, est à la fois plus simple et de meilleur goût que votre élégante maison de Réate. Est- ce qu’on trouve ici de ces incrustations en or ou en citronnier? y voit-on briller l’azur et le vermillon? y marche-t-on sur la marqueterie et les mosaïques? toutes magnificences étalées avec profusion dans la vôtre. Cependant celle-ci est commune à tout le peuple romain, et la vôtre ne sert qu’à vous; celle-ci est une retraite pour les citoyens au sortir des comices, et pour le premier venu; c’est pour des juments et des ânes que la vôtre est faite. Ajoutez que cet établissement est d’une grande utilité pour l’administration de la République; c’est ici que les consuls passent les cohortes en revue, que se fait la visite des armes, et que les censeurs convoquent le peuple pour le dénombrement. Mais, reprit Axius, laquelle regardez-vous donc comme plus utile ou de votre villa de l’extrémité du champ de Mars, qui réunit à elle seule plus de magnificence que celle de Réate ensemble, avec son splendide étalage de peinture et de statues; ou de la mienne, où ne se voit trace de la main de Lysippe ou d’Antiphile, mais où le semeur et le pâtre laissent fréquemment les leurs en revanche? Et comment se fait-il d’ailleurs, puisque l’idée de villa implique l’exploitation rurale sur une grande échelle, comment se fait-il, dis-je, que dans la vôtre il n’y ait pas un pouce de terre, pas un bœuf, pas une jument? Qu’a de commun enfin votre villa avec celles que possédaient votre aïeul et bisaïeul? On n’y voit ni foin séchant sur les planchers, ni vendanges dans les celliers, ni grains dans les greniers. Car enfin, pour être située hors de la ville, une maison n’en est pas plus villa que ne le sont toutes les habitations qu’on a construites au-delà de la porte Plumentane ou dans le faubourg Émilien. Comme je confesse mon ignorance en cette matière, dit en souriant Appius, je vous prie de vouloir bien m’apprendre ce que c’est qu’une villa; car je suis sur le point d’en acheter une de M. Séjus à Ostie, et je ne voudrais pas faire une école. Si effectivement une maison n’est villa qu’à la condition de contenir un âne comme celui que vous m’avez montré chez vous, et qui vous a coûté quarante mille sesterces, je crains bien, au lieu d’une villa que je veux acheter, de m’en tenir à une simple habitation située sur la côte d’Ostie. C’est cependant L. Mérula que voici qui m’avait mis en goût de cette acquisition. Il y avait passé quelques jours chez Séjus, et jamais villa, m’a-t-il dit, ne lui avait tant plu. Cependant il n’y avait aperçu, je ne dis pas des tableaux, des statues de bronze ou de marbre, mais non pas même un trapèze, un pressoir, un vaisseau à huile. Axius se tournant alors vers Mérula: Qu’est-ce qu’une villa, lui dit-il, où l’on ne trouve ni la décoration d’une maison de ville, ni l’attirail des travaux de la campagne? Mais, répondit Mérula, est-ce que votre villa de Velinum, où jamais architecte ni peintre n’a mis le pied, mérite moins ce nom que votre villa de Roséa, où tous les arts se sont donné rendez-vous, et dont vous avez la jouissance en commun avec votre âne? Ici Axius exprima par un signe de tête que la première, bien que simplement rustique, était aussi bien villa pour lui que celle qui présentait le double caractère d’habitation de ville et de campagne; et il lui demanda quelle induction il prétendait en tirer. Quelle induction? dit Mérula. Si le mérite de votre fonds de Roséa consiste dans les nourritures que vous y faites; si le nom de villa lui est dû en raison des troupeaux qui errent dans ses pâturages et s’abritent dans ses étables; on doit également appeler villa tout établissement où des animaux qu’on nourrit rapportent des bénéfices considérables. Qu’importe en effet que ces bénéfices proviennent des brebis ou des volatiles? Trouveriez-vous plus doux le produit de vos bêtes à cornes, dont la substance engendre les abeilles, que celui des abeilles elles-mêmes, qu’on voit à l’ouvrage dans les ruches de la villa de Séjus? Et rendrez-vous les porcs élevés dans votre métairie plus chers que Séjus ne vend ses sangliers aux bouchers de la ville? Mais qui m’empêche, dit Axius, d’avoir des abeilles dans ma villa? Est-ce que le miel de Sicile ne se fait que chez Séjus, et ne peut-on obtenir à Réate que du miel corse? serait-ce que le gland que Séjus achète a la vertu d’engraisser les sangliers, tandis que mon gland, qui ne me coûte rien, les ferait maigrir? Mais, reprit Appius, Mérula n’a point dit que vous ne puissiez faire chez vous les mêmes élèves que Séjus; seulement j’ai vu de mes propres yeux que vous ne le faites pas. Car il y a deux espèces de nourriture : l’une que j’appellerai champêtre, et qui comprend le bétail; l’autre, sédentaire, et qui embrasse pigeons, poules, mouches à miel, et en général tout ce qu’on veut élever dans l’enceinte d’une villa. Magon de Carthage, Cassius Dionysius, et quelques autres, ont traité cette matière spécialement en différents endroits de leurs ouvrages, dont Séjus paraît être imbu. Aussi tire-t-il plus de profit de sa seule villa par les nourritures qu’il y fait, que d’autres n’en savent recueillir de la culture d’un fonds tout entier. En effet, dit Mérula, j’ai vu chez lui des bandes immenses d’oies, de poules, de pigeons, de grues, de paons, ainsi qu’une multitude de loirs, poissons, sangliers, et autres gibiers de chasse. L’affranchi qui tient ses livres, et que Varron a vu, m’a assuré, quand il me faisait les honneurs en l’absence de Séjus, que son maître tirait de sa villa plus de cinquante mille sesterces par an. Comme Axius paraissait tout étonné, je lui demandai s’il connaissait le fonds de ma tante maternelle, sur la voie Salaria, dans le pays sabin, à vingt-quatre milles de Rome. Assurément, dit-il, puisque c’est là que je m’arrête à midi, lorsque, pendant l’été, je me rends de Rome à Réate; et que je passe la nuit, lorsque j’en reviens pendant l’hiver. Eh bien! repris-je, il y a dans cette villa une volière, dont il est sorti à ma connaissance, dans une seule année, jusqu’à cinq mille grives, qui ont été vendues trois deniers pièce; de sorte que ce seul produit a donné cette année-là soixante mille sesterces, le double du revenu de votre métairie de Réate, bien qu’elle n’ait pas moins de deux cents jugera. Quoi! soixante milles sesterces, s’écria Axius; soixante mille! vous plaisantez, sans doute. Non, je dis soixante mille. Soit. Mais vous conviendrez que pour arriver à ce chiffre il faut la coïncidence d’un festin public ou d’un triomphe extraordinaire, tel que celui de Métellus Scipion; ou bien encore de ces repas de corps, dont le grand nombre a fait, à certaines époques, renchérir les vivres de nos marchés. Mais, année commune, vous serez longtemps à réaliser un bénéfice aussi considérable. Soyez persuadé au contraire qu’une volière ne vous fait jamais faux bond, et que, par le temps qui court, on n’a pas à rabattre des espérances qu’on y a fondées. Car où est l’année où vous ne voyiez un festin de triomphe ou de ces repas de corps qui affluent au point de faire renchérir les vivres? Vous pourriez dire, ajouta Mérula, que, dans ce temps de profusion, ces publiques bombances sont quotidiennes à Rome. L. Albutius, homme fort savant, comme vous le savez tous, et dont nous avons des satires dans le goût de celles de Lucilius, ne disait-il pas que son fonds du pays albain rapportait bien moins que sa villa? que le revenu de l’un était au-dessous de dix mille sesterces, et celui de l’autre au-dessus de vingt? Le même auteur prétendait qu’avec une villa près de la mer, dans une localité de son choix, il se serait fait par an plus de cent mille sesterces. Dernièrement encore, M. Caton n’a-t-il pas vendu pour quarante mille sesterces de poissons provenant des viviers de Lucullus, dont il venait d’accepter la tutelle? Mon cher Mérula, dit Axius, veuillez m’accepter pour élève dans l’art de faire des élèves dans une villa. Je ne dis pas non, reprit Mérula; mais il faut me payer d’avance par un dîner. Vous l’aurez dès aujourd’hui; et à l’avenir, je vous ferai tâter souvent des élèves que vous m’aurez appris à faire. J’ai peur, dit Appius, que vous ne me fassiez manger quelque oie ou paon mort dans votre basse-cour. Qu’importe, reprit Axius, que les oiseaux ou poissons que l’on vous sert soient morts de leur belle mort ou d’autre manière? vous ne pouvez les manger vivants. Mais je vous en prie, Mérula, initiez-moi à cette science de la basse-cour; veuillez nous en exposer les principes et les ressources. Mérula accepta la tâche de bon cœur.
III. Un propriétaire doit avant tout connaître les espèces animales qu’on nourrit dans une villa ou dans ses dépendances, en vue de profit ou d’agrément. Il y a pour cela trois régimes différents à étudier: celui de volière, celui de la garenne, celui du vivier. J’entends par volière le lieu où l’on renferme toutes espèces d’oiseaux; par garenne, non pas ce que le mot signifiait pour nos ancêtres à la troisième génération, c’est-à-dire un parc exclusivement peuplé de lièvres, mais un enclos attenant à la villa, où l’on peut nourrir du gibier de toutes sortes. J’entends enfin par vivier toute réserve de poisson d’eau douce ou salée, dépendant d’une villa. Chacun de ces trois régimes est au moins double. Ainsi la théorie de la volière comprend en deux parties les espèces volatiles auxquelles la terre suffit, telles que les paons, les tourterelles, les grives; et celles à qui il faut la terre et l’eau, comme les oies, les sarcelles, les canards. La théorie de la garenne distingue également entre les sangliers, chevreuils et lièvres, d’un côté, et les abeilles, escargots et loirs, de l’autre. Enfin la théorie du vivier se divise aussi en deux classes, celle des poissons de mer, et celle des poissons d’eau douce. L’attention doit donc se porter sur six parties différentes. On commencera par s’entourer de gens de trois professions, des oiseleurs, chasseurs et pêcheurs; ou du moins on aura respectivement recours à leur entremise pour se procurer des mères pleines, dont les esclaves, sous la surveillance du maître, soignent la progéniture, l’élèvent, l’engraissent jusqu’à ce qu’elle soit bonne à envoyer au marché. Certaines espèces, comme les loirs, les escargots et les poules, s’obtiennent sans qu’il soit besoin pour cela de faire intervenir oiseleurs, chasseurs ou pêcheurs; et ce genre de spéculation a commencé sans doute par s’exercer sur celles qui sont les hôtes ordinaires de toute villa. Les poulets, dans l’origine, ne se sont pas multipliés seulement par les soins des augures, et pour le besoin des auspices; plus d’un chef de famille aussi, dans nos campagnes, donna des soins à leur propagation. On s’avisa, dans la suite, de former dans le voisinage de la villa des enclos entourés de murailles, tant pour s’y livrer à la chasse que pour y établir des ruches pour les abeilles, qui d’abord n’avaient d’autre abri que l’entablement d’un toit. Plus tard on creusa des viviers remplis d’eau douce, et dans lesquels ou emprisonna les poissons pêchés seulement dans les rivières. On voit que chacune des trois parties de l’industrie de la basse-cour a passé par deux degrés, marqués, le premier, du caractère de la frugalité antique, le second, de la tendance aux raffinements des siècles postérieurs. Dans la première période, en effet, nos ancêtres n’avaient dans leurs villas que deux places réservées à la volaille (aviaria), et consistant, l’une, en une cour basse, où ils nourrissaient les poules, dont les œufs et les poulets étalent tout le produit. L’autre est une tourelle servant de colombier, et située dans la partie supérieure du bâtiment. On a changé ce nom d’aviaria, et nous avons aujourd’hui des ornithones (volières), création de la sensualité moderne, dont la construction occupe plus de place que toute une villa d’autrefois. On en peut dire autant des garennes. Celle de votre père, Axius, n’a jamais eu pour hôtes que des lièvres. On ne voyait point alors de ces immenses emplacements où l’on enferme de murs plusieurs jugera de terre, pour entretenir une multitude de sangliers et de chevreuils. Alors se tournant vers moi : Lorsque M. Pison, dit-il, vous vendit son fonds de Tusculanum, combien y avait-il de sangliers dans le parc? Alors, je vous le demande, connaissait-on d’autres viviers que des viviers d’eau douce, et d’autres poissons que des chiens de mer et des mulets? Aujourd’hui il n’y a pas un Rhinton qui ne dise que, pour ne nourrir que cette sorte de poissons, autant vaudrait un étang rempli de grenouilles. Philippe se trouvant un jour à Casinum, Ummidius, son hôte, lui servit un beau loup marin pêché dans votre rivière, Varron. A peine Philippe en eut-il goûté, qu’il le cracha en s’écriant: Je veux mourir, si je n’ai pas cru que c’était du poisson. Vous voyez, dis-je, comme le luxe de notre siècle a étendu les garennes et prolongé les viviers jusqu’à la mer, en y faisant entrer en masse les poissons marins. N’est-ce point de ces derniers que Sergius et Licinius ont tiré l’un son nom d’Orata, et l’autre celui de Muréna? Qui ne connaît les fameux viviers des Philippes, des Hortensius et des Lucullus? Eh bien, reprit Mérula, dites-moi maintenant, Axius, de quelle époque je dois prendre mon sujet.
IV. Pour moi, répondit Axius, j’ai toujours aimé, comme dit le proverbe, à me tenir au camp derrière les principia (quartier général). Commencez donc par le siècle présent; j’aime mieux cela que de vous voir remonter au temps passé; car, après tout, les paons rapportent plus que les poules. Je ne vous cacherai même pas mon désir de vous entendre parler en premier lieu des volières (ornithones) : les grives ont donné bien du prix à ce nom, et les soixante mille sesterces que ces oiseaux rapportent à Fircellina m’ont communiqué une étrange démangeaison d’en posséder aussi. Eh bien donc, reprit Mérula, il y a deux espèces de volières : l’une d’agrément, comme celle de notre ami Varron à Casinum, et qui a trouvé beaucoup d’admirateurs; l’autre de rapport, et dont on fait commerce. On consacre à Rome des enclos fermés de murs à ce genre de spéculation; on les loue même à la campagne, notamment dans le pays sabin, naturellement très fréquenté pour les grives. Lucullus a imaginé de se donner une volière à deux fins. Il a fait construire à cet effet, dans l’intérieur de la sienne à Tusculum, une espèce de salle à manger, où il pouvait prendre le plaisir de la bonne chère, et jouir doublement du spectacle de ses grives, ici rôties et étalées sur un plat, là voltigeant prisonnières autour des fenêtres: combinaison assez mal entendue, car les ébats de ces oiseaux ne réjouissent pas tant la vue que leur odeur désagréable n’offense l’odorat.
V. Or, comme je pense, Axius, que vous tenez principalement aux volières, dont on tire profit, je parlerai, non pas de celles où l’on mange des grives, mais de celles où on les engraisse, pour les manger. On élève à cet effet un péristyle ou un bâtiment en forme de dôme, fermé par le haut d’un toit ou de filets, et qui puisse contenir quelques milliers de grives et de merles. Quelques-uns y ajoutent d’autres espèces qui se vendent également cher, lorsque les oiseaux sont engraissés; des cailles par exemple, et des miliana (oiseaux qui se nourrissent de millet). On y fait arriver l’eau par le moyen d’un conduit; ou, ce qui vaut encore mieux, on l’y fait serpenter dans de petits canaux assez étroits pour être d’un nettoiement facile. Trop de largeur fait qu’ils se salissent trop vite, et occasionne une déperdition d’eau. Il faut que l’écoulement en soit ménagé de façon qu’elle ne séjourne ni ne dépose, ce qui est pernicieux pour les oiseaux. La porte de la volière doit être basse, étroite, et avoir la forme de ce qu’on appelle cochlea dans les amphithéâtres destinés aux combats de taureaux. Les fenêtres y seront rares, et disposées de manière à ne laisser apercevoir au dehors ni arbres ni oiseaux; car cette vue et les regrets qu’elle réveille font maigrir les oiseaux prisonniers. N’y laissez pénétrer de jour que ce qu’il en faut aux grives pour reconnaître où est le perchoir, le manger et l’eau. On enduira portes et fenêtres d’une couche bien lisse de mastic, pour empêcher les rats et autres ennemis de s’introduire dans la volière. L’intérieur des murs garni tout autour de bâtons à percher, et l’on y appuiera d’un bout des perches enfoncées de l’autre en terre, et croisées de distance en distance par d’antres perches transversales, à l’instar des cancelli du théâtre. On aura soin de mettre à portée de l’eau à boire, et des boulettes faites de pâte pétrie avec des figues. Quand on voudra faire une levée de grives, il faudra, vingt jours à l’avance, augmenter la nourriture, et n’y plus employer que de la farine supérieure. (Dans cette espèce de cage devront également se trouver des planches sur lesquelles les oiseaux puissent se poser par voie de supplément ou de diversion aux perches.) Attenante à la volière doit s’en trouver une autre plus petite, dans laquelle on dépose les oiseaux trouvés morts dans la grande; car il faut que l’intendant puisse toujours rendre compte à son maître du nombre exact confié à ses soins. Les oiseaux qu’on juge en état d’être retirés devront être chassés de la grande volière dans la petite, pourvue à cet effet d’une plus large porte, et qui a plus de jour que la première, avec laquelle elle communique. Quand on a le nombre de grives que l’on veut dans cet endroit appelé seclusorium, on les y tue hors de la vue des autres, que ce spectacle pourrait attrister et faire périr elles-mêmes, plus tôt qu’il ne faut pour celui qui spécule sur leur mort. Les grives ne ressemblent pas aux autres oiseaux de passage qui ne déposent leurs œufs que dans les champs, comme les cigognes ou que sous les toits, comme les hirondelles; elles pondent partout. Malgré le nom masculin (turdus) de cet oiseau, il y a des grives femelles, de même qu’il y a des merles mâles, bien que le nom qu’on leur donne (merula) soit du genre féminin. Il y a des oiseaux de passage, comme les hirondelles et les grues, et des oiseaux domestiques, tels que les pigeons et les poules. Les grives appartiennent à la première classe. Elles traversent chaque année la mer, pour venir en Italie vers l’équinoxe d’automne et s’en retourner vers l’équinoxe de printemps. A une autre époque arrivent dans nos contrées une quantité prodigieuse de tourterelles et de cailles, dont on peut observer le passage dans les îles voisines de Ponti, de Palmaria et de Pandataria; car ces oiseaux y font une pause de quelques jours à leur arrivée en Italie, et une autre quand ils repassent la mer au retour. — Eh bien! dit Appius à Axius, vous n’avez qu’à jeter là cinq mille sesterces; et vienne un triomphe ou un festin public, vous voilà en possession des soixante mille où vous voulez arriver. Puis se tournant vers moi : A vous appartient, me dit-il, de nous parler de l’autre espèce de volière, vous qui en avez une auprès de Casinum pour votre plaisir seulement, et qui, non content d’avoir dans cette construction surpassé la volière de M. Lœnius Strabo, notre hôte à Brundusium, le premier qui se soit avisé de renfermer des oiseaux dans un cabinet en péristyle et couvert d’un filet, avez encore laissé loin derrière vous la splendide volière de Lucullus à Tusculum. — Vous savez, lui répondis-je, que j’ai dans ma villa de Casinum un ruisseau profond et limpide, qui la traverse entre deux quais en pierre. Sa largeur est de cinquante-sept pieds; et il faut passer sur des ponts pour communiquer d’une partie de ma propriété à l’autre. Mon cabinet de travail est situé à l’endroit où le ruisseau prend sa source; et de ce point, jusqu’à une île formée par sa jonction à un autre cours d’eau, il y a une distance de huit cent cinquante pieds. Le long de ses bords règne, sur une largeur de dix pieds, une promenade à ciel découvert; entre cette promenade et la campagne se trouve l’emplacement de ma volière, fermée de gauche et de droite par des murs pleins et élevés. Les lignes extérieures de l’édifice lui donnent quelque ressemblance avec des tablettes à écrire, surmontées d’un chapiteau. Dans la partie rectangulaire, sa largeur est de quarante-huit pieds, et sa longueur de soixante-douze, non compris le chapiteau demi-circulaire, qui est d’un rayon de vingt-sept pieds. Entre la volière et la promenade qui figure la marge inférieure des tablettes, s’ouvre un passage voûté aboutissant à une esplanade. De chaque côté un portique régulier soutenu par des colonnes en pierre, dont les intervalles sont occupés par des arbustes nains. Un filet de chanvre s’étend du haut du mur extérieur jusqu’à l’architrave; et un semblable filet joint l’architrave au stylobate. L’intérieur est rempli d’oiseaux de toutes espèces, qui reçoivent la nourriture au travers des filets. Un petit ruisseau leur porte ses eaux. En deçà du stylobate, règnent à gauche et à droite, le long des portiques, deux viviers assez étroits, et qui, séparés par un petit sentier, s’étendent jusqu’à l’extrémité de l’esplanade. Ce sentier conduit à un tholus, espèce de salon en rotonde, entouré de deux rangs de colonnes isolées. Il en existe un semblable dans la maison de Catulus, si ce n’est que des murs pleins remplacent la colonnade. Au-delà est un bocage de haute futaie enfermé de murailles, et dont l’épais couvert ne laisse pénétrer le jour que par en bas; l’espace est de cinq pieds entre les colonnes extérieures, qui sont de pierre, et les colonnes intérieures, qui sont de sapin, et très minces de fût. L’entrecolonnement intérieur est rempli, au lieu de murs, par un filet de cordes à boyaux; espèce de clôture à jour, qui laisse la vue du bocage, sans que les oiseaux puissent s’échapper. Un autre filet remplit également l’entre-deux des colonnes intérieures. L’espace intermédiaire des deux colonnades est garni de perchoirs formés par des bâtons enfoncés dans chaque colonne, et régulièrement étagés comme les gradins d’un théâtre. Cette partie de la volière est principalement réservée aux oiseaux à voix harmonieuse, comme merles et rossignols. Un petit tuyau leur fournit de l’eau, et on leur donne à manger par les mailles du filet. Au pied du stylobate règne une assise en pierre d’un pied neuf pouces d’élévation à partir de la base du socle. Le socle lui-même a deux pieds de hauteur au-dessus du niveau d’un bassin, et cinq pieds de largeur; ce qui donne aux convives la facilité de circuler entre les colonnes et les lits. Le bassin est entouré d’une espèce de trottoir large d’un pied; une petite île en occupe le centre. On a creusé le socle dans tout son pourtour, pour y faire des niches à canards. Au milieu de l’île s’élève une petite colonne, dans laquelle est scellé un axe, qui au lieu de table porte une roue avec ses raies; mais ces raies soutiennent, en guise de jantes, une table creusée en tambour, large de deux pieds et demi, et profonde d’une palme. Cette table n’est servie que par un jeune esclave, qui, par un simple mouvement de rotation, fait passer successivement, à portée de chaque convive, les coupes et les plats. Les lits sont dressés sur le socle, du sein duquel sortent les canards pour nager dans le bassin, lequel communique par un petit ruisseau avec les deux viviers; de sorte qu’on voit les petits poissons passant librement de l’un à l’autre. J’oubliais de vous dire que, de la table qui se trouve à l’extrémité des raies de la roue, coule, à la volonté de chaque convive, de l’eau chaude ou de l’eau froide, selon le robinet qu’il veut ouvrir. On voit, dans la coupole qui couvre ce salon, l’étoile Lucifer pendant le jour, et l’étoile Hespérus pendant la nuit; elles en suivent le bord, et marquent les heures. Dans le haut de cette coupole est peinte autour d’un tourillon la rose des huit vents, comme dans l’horloge que fit l’artiste de Cyrrhus pour la ville d’Athènes; et une aiguille, supportée par le tourillon, se meut de façon à indiquer quel vent souffle au dehors. Pendant que je parlais, une grande rumeur s’élève du champ de Mars. Il n’y avait pas de quoi surprendre de vieux athlètes des comices, dans ce paroxysme de fièvre électorale; notre curiosité s’en émut cependant. Sur ce point arrive Pantuléjus Parra, qui nous dit que, pendant qu’on faisait le relevé des suffrages, un individu avait été surpris jetant furtivement de nouveaux bulletins dans l’une des bourses, et que les adversaires du candidat ainsi favorisé avaient traîné le délinquant devant le consul. Pavo se lève aussitôt : le bruit courait que l’auteur de la fraude était le gardien du candidat pour lequel il avait voté.
VI. Axius prit alors la parole, et dit : Voilà Fircellius parti; on peut maintenant parler des paons tout à son aise. Lui présent, un mot de travers eût pu, à raison de la parenté, vous attirer une prise de bec avec lui. Mérula reprit donc en ces termes: J’ai vu introduire l’habitude de former des troupeaux de paons qui se vendent si cher. On dit que M. Aufidius Lurco tire des siens plus de soixante mille sesterces par an. Si l’on en veut faire un revenu, il faut avoir un peu moins de mâles que de femelles; c’est le contraire si l’on n’a en vue que l’agrément, car le mâle l’emporte au coup d’œil. On prétend qu’on rencontre des troupes de paons sauvages à Samos dans le bois sacré de Junon, et dans ceux que Pison possède dans l’île de Planasia. Pour former un troupeau, prenez des sujets de bon âge et de belles formes; car en fait d’oiseaux, c’est à celui-là que la nature a donné la palme de la beauté. Les femelles ne sont pas propres à la multiplication avant deux ans ni après cet âge. On nourrit les paons de grain, d’orge surtout. Lurco donne à six paons un modius d’orge par mois. Il augmente à mesure au temps de la ponte, et même un peu avant qu’ils ne commencent à accoupler. Son intendant doit lui rendre par chaque paonne trois petits, qui, devenus grands, se vendent cinq deniers la pièce; prix que l’on ne tire guère du plus beau mouton. Il achète en outre des œufs de paons, qu’il fait couver à des poules. Quand les petits sont éclos, il les fait passer dans une espèce de voûte servant de loge aux autres. Il faut que ces loges soient assez spacieuses pour que chaque oiseau y trouve son gîte à part, et que l’intérieur en soit crépi avec soin, de sorte que ni serpent ni bête malfaisante ne puisse s’y introduire par aucune ouverture ni crevasse. On ménagera devant l’entrée un espace où les paons puissent aller prendre leur nourriture, les jours où le soleil donne. L’un et l’autre emplacement a besoin d’être toujours proprement tenu. Le gardien les visitera souvent la pelle à la main, pour enlever la fiente, qu’il doit conserver avec soin; car elle est d’une grande utilité pour la culture des champs, et peut en outre servir de litière aux jeunes paons. Q. Hortensius fit le premier, dit-on, servir cette espèce de volatiles dans le festin d’installation de son augurat; prodigalité qui eut l’approbation des voluptueux, plutôt que des gens honnêtes et d’habitudes rigides L’exemple néanmoins fut contagieux, et le prix de ces oiseaux a depuis monté à tel point, qu’un œuf de paon se vend maintenant cinq deniers, et l’oiseau lui-même facilement cinquante. Un troupeau de cent paons rapporte sans peine quarante mille sesterces, et même soixante mille, si, comme fait Albutius, on exige trois petits par chaque mère.
VII. A ce moment un appariteur vint, de la part du consul, avertir Appius que les augures étaient mandés : celui-ci quitta aussitôt la villa publique. A peine fut-il parti, qu’une volée de pigeons vint s’y abattre. Si par hasard, dit alors Mérula à Axius, vous aviez monté un colombier (g-peristerotropheios), vous vous imagineriez que ces pigeons sont à vous, tout sauvages qu’ils sont; car un colombier a d’ordinaire des hôtes de deux espèces. Les pigeons sauvages d’abord, que d’autres appellent saxatiles, et qui habitent les tours et le faîte (columen) des métairies. Aussi est-ce du mot columen, que leur est venu le nom de columboe. En effet, leur timidité naturelle leur fait toujours rechercher les points les plus élevés des bâtiments. Cette espèce hante donc principalement les tours; c’est là qu’ils dirigent leur vol au retour des champs, et c’est de là qu’ils revolent aux champs. La seconde espèce est plus sociable, et vient volontiers chercher sa nourriture sur le seuil des maisons. Son plumage est presque toujours blanc, tandis que celui de la première est bigarré, mais sans aucun mélange de blanc. De l’union de ces deux espèces on en forme une troisième, de couleur mélangée. C’est principalement sur celle-là qu’on spécule. Elle vit en commun dans un local appelé par les uns g-peristereon, (colombier), et, par les autres g-peristerotropheios (lieu où l’on nourrit des colombes), et qui en contient quelquefois jusqu’à cinq mille. Un colombier doit être construit en voûte et se terminer en forme de dôme, avec une porte étroite et des fenêtres à la carthaginoise ou plus larges même, garnies de treillis au-dedans et au dehors, de manière à laisser entrer le jour, tout en fermant le passage aux serpents et autres animaux dangereux. Les parois intérieures sont enduites de stuc, et la même application est faite autour des fenêtres en dehors, afin que ni rat ni lézard ne puisse s’y introduire; car rien n’est timide comme la colombe. On disposera pour chaque couple de pigeons des boulins de forme circulaire, distribués avec ordre et serrés les uns contre les autres, pour qu’il en tienne davantage, et de façon à remplir tout l’espace compris entre le sol et la voûte. Chaque boulin aura une ouverture qui permette au pigeon d’entrer et de sortir librement, et l’intérieur en sera de trois palmes en tous sens. A chaque rang de boulins seront adaptées des tablettes de deux palmes de largeur, qui serviront de vestibule aux pigeons, et sur lesquelles ils pourront se reposer avant d’entrer. L’on ne conduira au colombier que de l’eau limpide et pure, afin que les pigeons puissent à la fois y boire et se baigner; car leur propreté est proverbiale: aussi le gardien doit-il balayer le colombier plusieurs fois par mois; la fiente, qui le salirait en s’y amassant, est d’ailleurs d’une grande utilité pour la culture de la terre, au point que quelques auteurs la regardent comme le meilleur de tous les engrais. Le gardien doit aussi donner ses soins aux pigeons malades, retirer les morts du colombier, ainsi que les petits qui sont bons à être vendus. Les femelles couveuses seront placées dans un lieu particulier, où elles se trouveront séparées des autres par un filet, en conservant cependant la faculté de sortir. Il y a deux raisons pour en agir ainsi. Au cas où les mères viendraient à languir, et à se rebuter d’une réclusion trop prolongée, elles peuvent se refaire par une excursion en plein air. D’un autre côté, l’attachement à leur couvée garantit leur retour, à moins que le corbeau ou l’épervier ne soient là pour l’intercepter. Pour détruire ces ennemis, les gardiens enfoncent en terre deux baguettes couvertes de glu, et recourbées l’une sur l’autre. L’épervier fond sur le pigeon attaché comme appât entre ces baguettes, et se trouve pris au piège, en s’empêtrant dans la glu. Une conséquence bien connue de l’instinct qui ramène toujours le pigeon au colombier, c’est l’habitude qu’ont prise certaines personnes d’en apporter dans leur sein au théâtre, pour leur y donner la volée; ce qu’elles ne feraient pas, si elles n’avaient la certitude de voir les pigeons revenir au logis. On place la nourriture dans des mangeoires adossées aux murs du colombier, et qui se remplissent à l’extérieur au moyen de tuyaux. Les pigeons aiment le millet, le blé, l’orge, les pois, les haricots, et l’ers. On fera bien d’attirer autant que possible dans le colombier les pigeons sauvages, qui séjournent sur les tours et les combles des métairies voisines. Quand on achète des pigeons, il faut les prendre de bon âge, ni trop jeunes ni trop vieux, et qu’il y ait autant de mâles que de femelles. Rien qui pullule comme les pigeons; en quarante jours la mère conçoit, pond, couve et élève ses petits; et c’est à recommencer tout le long de l’année, sans autre intermittence que la période de solstice d’hiver à l’équinoxe du printemps. Elles ne font que deux petits à la fois, qui, à peine arrivés à leur croissance et à leur force, fécondent la mère dont ils sont sortis. Les personnes qui engraissent les petits pour les vendre plus cher les renferment à part, ils ont déjà leurs plumes; puis les gorgent avec du pain blanc mâché, qu’elles leur donnent deux fois par jour en hiver, et trois fois en été; le matin, à midi, et le soir; la ration de midi est retranchée l’hiver. On laisse dans le nid ceux qui commencent seulement à s’emplumer, après leur avoir cassé les pattes, et on donne à manger aux mères en conséquence. Les élèves qu’on fait par ce procédé engraissent plus promptement et sont toujours plus blancs que les autres. Une paire de pigeons d’une belle couleur, d’une bonne race, et qui n’a point de défaut, se vend ordinairement à Rome deux cents nummi, et quelquefois mille, si elle est d’une beauté remarquable. Le chevalier romain L. Axius avait même refusé cette somme pour une seule paire de pigeons, qu’il ne voulait pas donner à moins de quatre cents deniers. Si je pouvais me procurer, s’écria alors notre Axius, un colombier comme je le désire, j’irais vite acheter des boulins de terre cuite, et je les enverrais à ma villa. Comment, dit Pica, est-ce que nombre de personnes n’ont pas des boulins sur le toit même de leur maison? Avec cet appareil, dont la valeur va jusqu’à cent mille sesterces, peut-on dire qu’ils n’ont pas de colombiers? Je vous conseille moi, de vous en donner un à Rome en employant le même moyen et d’attendre que vous ayez appris à en tirer un as et demi par jour, avant de vous lancer dans des constructions plus dispendieuses à la campagne.
VIII. Continuez, dit alors Axius à Mérula; et Mérula reprit en ces termes : De même que pour les pigeons, on doit pour les tourterelles disposer un local proportionné à la quantité qu’on en veut avoir. Il y faut, comme dans les colombiers, eau pure, porte, fenêtres, et des murs bien crépis; mais au lieu de boulins on attachera aux murailles des bâtons ou juchoirs régulièrement étagés, et couverts de petites nattes de chanvre. Il faut que le rang d’en bas soit élevé de trois pieds au moins au-dessus du sol; qu’il y ait un intervalle de neuf pouces entre tous les autres, et que le plus élevé soit à un demi-pied de distance de la voûte. Les bâtons à jucher doivent avoir même longueur à partir de la muraille. Les tourterelles n’en doivent sortir ni jour ni nuit. On leur donne pour nourriture du froment sec, dans la proportion d’un demi modius pour cent vingt tourterelles. La place doit être balayée tous les jours, pour que la fiente qui s’y amasse n’incommode point les oiseaux. Elle a d’ailleurs son emploi en agriculture. L’époque de la moisson convient plus que toute autre pour engraisser les tourterelles. En aucun temps de l’année les mères ne sont en si bon état, ne font autant de petits, propres à engraisser à leur tour. C’est donc ce moment que la spéculation doit surtout saisir.
IX. Je voudrais bien, dit alors Axius, savoir comment on engraisse les poules et les pigeons ramiers. Si Mérula voulait bien encore nous l’apprendre, nous compléterions alors ce qui reste à dire des autres animaux. Mérula reprit en ces termes: il y a trois espèces de poules; les poules de basse-cour, les poules sauvages, et les poules d’Afrique. Les poules de basse-cour se voient par toute la campagne et dans les fermes. Les personnes qui se proposent d’établir un poulailler (g-ornithoboskeios), et qui veulent, comme les habitants de Délos, en tirer tout le parti possible, ont cinq choses principales à considérer: 1° L’achat. De quel nombre de poules faut-il former son poulailler, et dans quelles conditions individuelles ? 2° La multiplication de l’espèce; quels soins exigent l’accouplement et la ponte? 3° Les œufs; comment on fait couver et éclore? 4° Les poussins; de quelle façon ; et par qui doit-on les faire élever? 5° Et cette question n’est qu’un appendice des quatre autres: comment s’engraisse cette volaille? Poule est le nom générique de la femelle; coq, celui du mâle; on appelle chapons ceux que la castration a privés d’une partie de leur masculinité. On châtre les coqs, pour en faire des chapons, en leur brûlant avec un fer rouge les ergots à l’extrémité des pattes, jusqu’à ce que la peau s’en détache; puis on enduit la plaie avec de la terre à potier. Celui qui se propose de former un poulailler-modèle doit le peupler des trois espèces, mais surtout de la poule ordinaire. Dans l’achat de cette dernière espèce il faut rechercher les plus fécondes. On les reconnaît au plumage roux, aux ailes noires, aux ergots de grandeurs inégales, à la grosse tête, à la crête large et élevée. Choisissez des coqs lascifs. Les indices de cette qualité sont des formes membrues, la crête d’un rouge éclatant, le bec court, fort et aigu, l’œil fauve ou noir, le jabot d’un rouge tirant sur le blanc, le cou bigarré ou nuancé d’or, les cuisses velues, les pattes courtes, les ergots allongés, la queue développée, et bien fournie. Remarquez encore si vos coqs se redressent avec fierté; s’ils chantent fréquemment; s’ils se montrent acharnés au combat; si, loin de craindre pour eux-mêmes, ils sont disposés à protéger leurs poules. Il y a cependant une exception à faire pour les coqs de Médie, de Tanagra et de Chalcis, qui, tout beaux et tout belliqueux qu’ils sont, n’ont qu’une médiocre aptitude à la propagation. Pour deux cents poules, il faut un lieu clos, dans lequel on dispose deux cabanes l’une à côté de l’autre, toutes deux au soleil levant. Chacune aura dix pieds de longueur, cinq pieds de largeur, et à peu près autant en hauteur. Les fenêtres auront trois pieds de large sur quatre de haut, et seront tissues à claires voies, de façon à laisser entrer beaucoup de jour, sans livrer passage à aucune bête nuisible. On ménagera de plus entre ces cabanes un passage pour le gardien du poulailler. Dans chaque cabane se trouveront des perches en nombre suffisant pour servir de juchoir à toutes les poules. Vis-à-vis de chaque perche on creusera dans le mur des trous qui serviront de nids; on ménagera en outre une espèce de cour fermée, où les poules puissent rester pendant le jour et s’ébattre dans la poussière, et où se trouvera aussi une grande cellule servant d’habitation au gardien. Tout le tour du poulailler sera garni de nids, creusés ou attachés fortement aux murs; car le moindre dérangement pendant l’incubation peut nuire aux œufs. Quand les poules commencent à pondre, il faut étendre dans leurs nids de la paille, qu’on enlève lorsqu’elles commencent à couver, pour en remettre de nouvelle; car la vieille paille engendre des puces, et d’autres vermines qui tourmentent et inquiètent les poules; ce qui fait que les œufs sont couvés inégalement ou même se gâtent. On prétend qu’il ne faut pas donner à une poule plus de vingt-cinq œufs à couver, lors même qu’elle est assez féconde pour en pondre davantage. L’époque la plus favorable à l’incubation est depuis l’équinoxe du printemps jusqu’à celui d’automne. On ne fera donc point couver les œufs pondus avant ou après cette époque, non plus que ceux qui proviennent de poules pondant pour la première fois. En général on choisira pour couver de vieilles poules plutôt que des jeunes, et, de préférence, celles qui n’ont ni le bec ni les ongles pointus; les autres sont plus propres à pondre qu’à couver. L’âge le plus convenable est celui d’un an ou deux. Si l’on fait couver à une poule, des œufs de paon, il faut laisser passer dix jours avant d’ajouter des œufs de poule afin que tous puissent éclore en même temps; car on a des poulets au bout de vingt jours, tandis qu’il en faut trente pour obtenir des paonneaux. On tient les poules qui couvent renfermées nuit et jour; ce n’est que le soir et le matin qu’on les laisse sortir un instant, pour leur donner leur nourriture. Le gardien doit de temps à autre visiter les nids et retourner les œufs, pour que la chaleur puisse les pénétrer de toutes parts. Pour s’assurer si un œuf est plein ou vide, on le plonge dans l’eau. S’il est vide, il surnage; s’il est plein, il va à fond. Ceux qui secouent les œufs dans ce but ont tort; car ils risquent de brouiller le germe, qui est le principe de vie. On dit encore qu’un signe certain qu’un œuf est vide est sa transparence lorsqu’on l’interpose à la lumière. Pour conserver les œufs, on les frotte avec du sel égrugé ou bien on les trempe dans la saumure pendant trois ou quatre heures; puis on les met, après les avoir bien essuyés, dans du son ou de la paille. Les œufs ne doivent être couvés qu’en nombre impair. Le gardien du poulailler peut, dès le quatrième jour de l’incubation, connaître les œufs qui ont été fécondés ou non: il suffit de les tenir devant le jour. Il jette alors ceux qui ne montrent aucun changement, pour en mettre d’autres à leur place. Il faut tirer de chaque nid les poulets à mesure qu’ils naissent, et les donner à élever à une mère qui n’en aura pas beaucoup. S’il reste moins d’œufs que de poussins éclos, il faudra retirer les premiers pour les donner à d’autres poules qui n’en ont pas encore d’éclos, en observant toutefois de ne jamais laisser à une poule plus de trente poussins à conduire. Dans les 15 premiers jours on donne aux poulets tous les jours de la farine d’orge bien détrempée dans l’eau et mêlée avec de la graine de cresson. De cette manière on n’aura pas à craindre que l’orge ne se gonfle dans l’estomac des poulets. On placera cette nourriture sur de la poussière, et non sur la terre sèche et dure, qui blesserait leur bec délicat. Ne leur donnez point d’eau dans les premiers jours. Quand la queue commence à leur pousser, il faut enlever souvent de la tête et du cou la vermine qui les ferait dépérir. On brûlera autour du poulailler de la corne de cerf, pour en écarter les serpents, dont l’odeur seule suffit pour faire périr les poulets. Il faut les conduire souvent au soleil et sur des tas de fumier, où ils puissent s’ébattre à leur aise, ils en sont meilleurs. On fera bien même d’y mener tout le poulailler en été, et tant que la température est douce et que le soleil donne. On aura la précaution d’étendre au-dessus du clos un filet, qui les empêche de s’envoler, et les préserve en même temps des oiseaux de proie. Épargnez-leur l’excès du chaud aussi bien que l’excès du froid: l’un est aussi nuisible que l’autre. Quand les poulets commenceront à avoir des plumes, il faut les habituer à ne suivre qu’une poule ou deux, afin que les autres ne soient occupées qu’à pondre. L’incubation ne doit commencer qu’après le renouvellement de la lune. Les œufs qu’on fait couver plus tôt ne réussissent presque jamais. Il ne leur faut que vingt jours environ pour éclore. J’ai parlé trop longuement peut-être des poules ordinaires: pour compensation je ne dirai qu’un mot des autres espèces. Les poules sauvages sont fort rares à Rome, et l’on n’en voit guère d’apprivoisées, si ce n’est en cage; elles ressemblent d’aspect, non de plumage, aux poules d’Afrique, plutôt qu’à celles de ferme, quand on n’a rien fait pour les déguiser. On les dépose souvent en parade dans les pompes publiques, avec des perroquets, des merles blancs, et comme objets rares et curieux. Elles ne pondent et couvent volontiers que dans les bois, et ne produisent guère à l’état domestique. Ce sont elles qui ont fait appeler Gallinaria l’île que l’on voit dans la mer de Toscane, près de l’Italie, vis-à-vis d’Intemelium, d’Albium Ingaunum, et des montagnes de Ligurie. Suivant d’autres, ce nom vient des poules ordinaires, transportées là originairement par des matelots, et dont la race s’y est perpétuée à l’état sauvage. Les poules d’Afrique sont grandes, bigarrées, et ont le dos en saillie. Les Grecs les appellent méléagrides. Ce sont les dernières que l’art culinaire a imaginé d’offrir aux palais blasés de notre époque : leur rareté les fait payer très cher. Les poules ordinaires sont celles qu’on engraisse le plus souvent. On les enferme à cet effet dans un lieu chauffé doucement, où elles aient peu d’espace et de jour. Le mouvement et la lumière nuisent à leur embonpoint. On les choisit à la taille, en exceptant toutefois celles qu’on appelle à tort mélices, puisque leur véritable nom est Melicae; de même que nos ancêtres disaient Thélis au lieu de Thétis, le nom domestique donné originairement aux poules qu’on faisait venir de Médie à cause de leur grandeur, est resté désormais à cette race, qui s’est perpétuée dans notre pays, et a conservé avec son type une grande ressemblance. Pour les engraisser, on leur arrache les plumes des ailes et de la queue, et on leur donne en abondance des boulettes faites avec de la farine d’orge, à laquelle on peut ajouter aussi de la farine d’ivraie ou de la graine de lin pétrie dans de l’eau tiède. On leur donne à manger deux fois par jour; mais il faut s’assurer avant le second repas si le premier est digéré. Après, quand elles ont mangé, on leur purge la tête de vermine, et on les renferme de nouveau; ce régime se continue pendant vingt-cinq jours, et au bout de ce temps les poules sont engraissées. Quelques-uns, dans le même but, leur donnent du pain de froment émietté dans de l’eau, et y mêlent du vin généreux et qui ait du bouquet. On prétend par ce moyen rendre les poules grasses et tendres en vingt jours. Si l’on s’aperçoit que l’excès de nourriture les rebute, il faut en diminuer la quantité de jour en jour jusqu’au dixième, suivant la progression que l’on a observée en l’augmentant, de sorte que la ration soit égale le vingtième jour et le premier. Les pigeons ramiers s’engraissent de la même manière que les poules.
X. Passez à présent, dit Axius, à ces hôtes de villa, que vous autres Philhellènes appelez amphibies (g-amphibia), espèces auxquelles la terre ne suffit pas, et dont l’entretien exige encore de ces bassins pleins d’eau (g-chehnoboskeion), ainsi nommés quand vous y élevez spécialement des oies. Scipion Métellus et M. Séius ont quantité d’élèves de cette dernière espèce. Mérula reprit : Quand Séius a formé ses troupeaux d’oies, il a porté ses soins sur les cinq points principaux dont j’ai parlé en traitant des poules: attention à bien choisir, multiplication de l’espèce, ponte, naissance des petits, et engraissement. L’esclave qui les achetait avait ordre de n’en prendre que de grande taille et de plumage blanc; car leur progéniture est presque toujours à leur ressemblance. C’est qu’il y a une autre espèce qu’on appelle oies sauvages, au plumage bigarré, qui n’aime point à se joindre aux oies domestiques et s’apprivoise difficilement. L’époque la plus favorable à l’accouplement est celle du solstice d’hiver. Les oies pourront alors pondre et couver depuis les calendes de mars jusqu’au solstice. Ces oiseaux s’accouplent ordinairement dans l’eau ; et, l’acte consommé, ils plongent dans la rivière ou le bassin. Ils ne font pas plus de trois pontes par an. On disposera pour chaque oie une cabane de deux pieds et demi de tour, où la femelle puisse déposer ses œufs; et on y étendra de la paille pour litière. On marque les œufs de manière à les reconnaître, car une oie ne fait éclore que les siens. On lui en donne ordinairement neuf ou onze à couver; jamais plus de quinze, ni moins de sept. Elle couve trente jours si la température est froide, et vingt-cinq quand le temps est doux. Lorsque les oisons sont éclos, on les laisse les cinq premiers jours avec leur mère. Il faut ensuite, si le temps est beau, les conduire tous les jours à la prairie, au marais ou aux bassins. On leur dispose des cellules au-dessous ou au-dessus du sol, lesquelles n’en doivent pas contenir plus de vingt. Il faut en exclure soigneusement toute humidité, et tapisser le sol de paille ou de quelque chose d’analogue. On doit également veiller avec soin à ce qu’aucun animal nuisible, tel que la belette, ne puisse y pénétrer. On fera paître les oies dans des lieux humides où l’on sème exprès des herbes à graines, celle notamment qu’on appelle seris, qui reverdit par le seul contact de l’eau, quelque desséchée qu’elle puisse être. Il ne faut pas leur laisser paître cette herbe à la tige; on l’arrache pour la leur offrir. Sans cette précaution, il est à craindre qu’ils ne détruisent le plant sous leurs pieds ou qu’ils ne crèvent à force d’en manger. En effet, ces oiseaux sont tellement gloutons, que si l’on ne modère pas leur avidité, ils font des efforts à se tordre le cou pour déraciner quelque plante. Cette partie, ainsi que la tête, est chez eux le côté faible. A défaut de cette herbe, on leur donnera de l’orge ou toute autre espèce de grains. On peut aussi, suivant la saison, les nourrir de toute espèce de fourrage, avec les mêmes précautions que j’ai indiquées pour la seris. Lorsqu’ils couvent, on met devant eux de l’orge broyée dans de l’eau. Quant à leurs petits, on les nourrira les deux premiers jours avec de la pâte ou de l’orge en nature ; puis, les trois jours suivants, on leur donnera dans un vase du cresson sortant de l’eau, et haché très fin. Lorsqu’ils sont en âge d’être renfermés dans les cabanes dont j’ai parlé plus haut, leur nourriture sera de la pâte de farine d’orge, du fourrage ou toute espèce d’herbe tendre hachée menu. Les oisons qu’on veut engraisser doivent avoir de quatre à six mois. Il faut alors les enfermer à part, et les nourrir avec de la pâte de fleur de farine détrempée, dont on leur donnera tant qu’ils voudront trois fois par jour. Après chaque repas on les fera boire copieusement; en suivant ce régime pendant deux mois, ils seront engraissés suffisamment. A chaque repas il faut nettoyer les lieux où ils prennent leur nourriture; car ils se plaisent dans la propreté, mais ils ne quittent jamais une place sans l’avoir salie.
XI. Veut-on élever des troupeaux de canards, former ce qu’on appelle un g-nehssotropheion (lieu où l’on nourrit des canards), il faut avant tout choisir, si l’on peut, un terrain de marécage; et celui qui leur convient le mieux. A défaut de cela, ayez un emplacement où se trouve un lac naturel, un étang ou un bassin fait de main d’homme, avec des degrés par lesquels les canards puissent descendre. Le clos qui leur sert d’habitation doit être entouré d’un mur de quinze pieds de hauteur, comme celui que vous avez vu dans la ferme de Séius, et n’avoir qu’une seule porte. Le long du mur règnera une suite de petites loges couvertes de toits, construites uniformément et d’une largeur convenable. Chacune aura un vestibule pavé de briques dans toute son étendue. Le clos lui-même sera traversé dans toute sa longueur d’un canal toujours plein. C’est là qu’on dépose ce qu’ils mangent, c’est là qu’ils trouvent de quoi boire. Les canards se nourrissent ainsi. Les murs seront recouverts d’un enduit bien poli, pour empêcher les chats et autres animaux nuisibles de s’y introduire. On étendra en outre sur le clos un filet à larges mailles, dans le double but d’empêcher l’aigle de fondre sur les canards, et les canards de s’envoler au dehors. Leur nourriture se compose de blé, orge, marc du raisin, et quelquefois aussi d’écrevisses et petits animaux aquatiques de cette espèce. Il faut une large prise d’eau pour que les bassins soient alimentés constamment et renouvelés sans cesse. Quelques espèces sont encore élevées comme les canards: ce sont les sarcelles et les phalerides. Il en est de même des perdrix, qui, au rapport d’Archélaüs, conçoivent, rien que d’entendre le mâle. On n’élève pas ces dernières espèces comme les autres, en raison de leur fécondité et de la délicatesse de leur chair; mais on les engraisse, si l’on veut, par les mêmes moyens. Voilà, je crois, le premier acte de la basse-cour terminé. Je n’ai plus rien à dire.
XII. Cependant Appius était de retour; et après les questions réciproques sur ce qui s’était dit et fait de part et d’autre, Nous en sommes donc, dit-il, au second acte, c’est-à-dire à ces parcs annexés de nos villas, qu’on appelle encore leporaria, d’après leur ancienne destination spéciale. Aujourd’hui il ne s’agit plus d’un arpent ou deux, où l’on réunit quelques lièvres, mais de vastes espaces, de forêts entières, où l’on renferme par bandes les cerfs et les chevreuils. On dit que Q. Fulvius Lupinus a dans les environs de Tarquinia un enclos de quarante arpents, où, indépendamment des animaux dont nous venons de parler, on trouve des moutons sauvages. Des parcs plus spacieux encore se rencontrent sur le territoire de Statonia, et en beaucoup d’autres endroits. T. Pompéius a dans la Gaule transalpine un parc consacré à la chasse, qui n’a pas moins de quarante mille pas carrés. Dans ces enclos sont en outre des enceintes particulières réservées aux escargots et aux abeilles, et des tonneaux où on élève des loirs. Rien de plus facile que la garde, l’entretien et la multiplication de ces animaux, les abeilles exceptées. Tout le monde sait en effet qu’un parc doit être environné de murailles bien crépies, pour empêcher les chats, les fouines, etc., d’y pénétrer, et assez élevées pour que les loups ne puissent les franchir. On sait qu’il faut également qu’un parc abonde en gîtes où les lièvres puissent se rendre invisibles pendant le jour, et se tapir dans les broussailles et sous les herbes; et que les arbres y doivent former une voûte assez épaisse pour empêcher l’aigle de s’y abattre. Personne enfin n’ignore qu’il suffit de quelques lièvres et hases pour que ce gibier pullule aussitôt. Deux couples vont peupler tout un parc. La race est prolifique au point que si vous ouvrez une mère qui vient à peine de mettre bas, vous allez la trouver déjà pleine. Archélaüs nous apprend que pour connaître l’âge d’une hase on n’a qu’à examiner combien d’orifices elle a au ventre; car le nombre en diffère dans ces animaux selon leur âge. On a un procédé nouveau pour engraisser les lièvres: c’est de les prendre dans le parc, et de les placer dans des cages étroites et fermées. On compte trois espèces de lièvres. La première est notre lièvre d’Italie, qui a les pattes courtes par-devant et très longues par derrière, le poil fauve sur le dos, blanc sous le ventre, de longues oreilles. On dit que, pleines, les hases sont en état de concevoir de nouveau. Les lièvres deviennent très grands en Gaule transalpine et en Macédoine; Ils restent de taille moyenne en Espagne et en Italie. La seconde espèce, que l’on rencontre dans la partie de la Gaule voisine des Alpes, ne diffère de la première que par le pelage, qui est tout blanc. On en apporte rarement à Rome. La troisième espèce, qu’on appelle aussi cuniculi (lapins), est originaire d’Espagne, et ressemble beaucoup aux nôtres; sauf pour leur taille, qui est plus petite. L. Ælius a cru que lepus (lièvre) venait de levipes (au pied léger), à cause de la vitesse de cet animal. J’imagine, moi, que lepus vient d’un ancien mot grec; car les Éoliens de Béotie appelaient un lièvre g-leporis. Les lapins (cuniculi) doivent leur nom aux terriers (cuniculi) qu’ils font sous terre pour se cacher. Les trois espèces doivent, autant que l’on peut, être réunies dans les parcs. Quant aux deux premières, continua Appius en s’adressant à moi, je ne doute pas que vous ne les ayez dans le vôtre; mais vous, qui êtes resté si longtemps en Espagne, peut-être vous êtes-vous aussi procuré des lapins.
XIII. S’adressant ensuite à Axius: vous n’êtes pas sans savoir, lui dit-il, que le sanglier est aussi gibier de parc, et qu’on engraisse sans trop de peine l’animal qui y entre sauvage aussi bien que celui qui y est né dans la domesticité. Vous avez vu vous-même, dans cette propriété que Varron a achetée de M. Pupius Pison, aux environs de Tusculum, les sangliers et les chevreuils se rassembler au son du cor, à heure fixe, pour prendre leur nourriture; tandis que d’un tertre réservé aux exercices gymnastiques, on jetait aux uns du gland et aux autres de la vesce ou quelque autre semblable pâture. Quant à cette scène, répondit Axius, j’en ai vu la représentation chez Q. Hortensius, et sur une bien plus grande échelle. Il a sur le territoire de Laurente un bois de plus de cinquante arpents, entouré de murailles qu’il appelle non pas son leporarium, mais son g-thehriotropheion. Au milieu du bois est une espèce d’élévation, où l’on avait disposé trois lits, et où l’on nous servit à souper. Quintus fit venir Orphée, qui arrive en robe longue la cithare à la main, et qui, sur l’ordre qu’il en reçoit, se met à sonner d’une trompette. Au premier son de l’instrument nous nous voyons entourés d’une multitude de cerfs, de sangliers et autres bêtes fauves; si bien que le spectacle ne nous parut pas au-dessous des chasses sans bêtes féroces, dont les édiles nous donnent quelquefois le plaisir au grand cirque.
XIV. Apostrophant alors Mérula: Appius, dit-il, vous a bien facilité votre rôle. Ce qui concerne la chasse, et c’était le second acte, vient d’être expédié en un tour de main. Quant aux escargots et aux loirs, je vous en tiens quitte; et ce n’était pas une affaire. La chose est pourtant moins simple que vous ne semblez le croire, mon cher Axius; reprit Appius. Encore faut-il aux escargots un lieu qui leur convienne ; et pour cela il le faut en plein air, et entouré d’eau de toutes parts; sinon vous risquez de courir après les petits, et même après les gros que vous aurez mis là pour y multiplier. L’eau vous tient lieu de fugitivarius si le soleil n’y donne pas trop, et si la rosée y abonde: c’est ce qu’on peut trouver de mieux à défaut de rosée naturelle, inconvénient propre aux lieux trop exposés; ou le lieu, même couvert, est dépourvu de ces rochers ou tertres dont l’eau baigne le pied, alors il faut produire artificiellement la rosée; et voici par quel procédé. Au moyen d’un tuyau qui se termine par un certain nombre de petits mamelons, on lance avec force de l’eau, qui, retombant sur une pierre, rejaillit en gouttes de tous côtés. L’escargot vit de peu, et l’on est dispensé de pourvoir à sa nourriture; il la trouve lui-même en rampant sur la terre ou sur les parois des rochers, à moins que quelque ruisseau interposé ne lui fasse obstacle. On en voit étalés dans les marchés, vivre assez longtemps de leur propre substance. Il suffit de leur jeter de temps à autre quelques feuilles de laurier avec un peu de son. Les cuisiniers, en les préparant, ne savent pas toujours s’ils sont morts ou en vie. Il y a plusieurs espèces d’escargots : l’espèce petite et blanchâtre qui vient de Réate, la grosse que nous tirons de l’Illyrie, et la moyenne qui nous est apportée d’Afrique. Ce n’est pas que cette différence de grosseur tienne précisément aux pays: l’Afrique, par exemple, nous envoie des escargots que nous nommons solitanœ, et qui sont si gros que leur coquille peut contenir jusqu’à quatre-vingts quadrantes de liquide. Et les provenances de deux autres pays offrent aussi respectivement des dimensions exceptionnelles. Ces animaux pondent une prodigieuse quantité d’œufs très petits, et dont la coque, très tendre dans l’origine, s’endurcit avec le temps. Ils les déposent dans des monceaux de terre en forme d’îlots, dans lesquels ils ouvrent un large passage à l’air. Pour les engraisser, on les enferme dans un pot de terre percé de plusieurs trous, que l’on frotte à l’intérieur de farine délayée dans du vin cuit, jusqu’à réduction des deux tiers. Les trous sont là pour laisser pénétrer l’air. On voit que cette espèce a la vie dure.
XV. L’enceinte où l’on élève des loirs ne ressemble en rien à celle qui est réservée aux escargots, puisque au lieu d’eau ce sont des murailles qui l’environnent. Ces murailles doivent être de pierre lisse ou bien crépies en dedans, pour que les loirs ne puissent trouver jour à s’échapper. On plantera dans cette enceinte de jeunes chênes qui portent du gland; et quand il ne s’en trouve point sur les arbres, il faudra en jeter aux loirs, ainsi que des châtaignes, pour leur servir de nourriture. Il y sera pratiqué des trous assez larges pour qu’ils puissent y faire leurs petits. Ne leur prodiguez pas l’eau. Les loirs boivent peu, et ils aiment être à sec. On les engraisse dans des vaisseaux tels qu’on en voit dans beaucoup de fermes, et qui ne ressemblent point aux vaisseaux ordinaires. Les potiers qui les fabriquent ont soin d’y pratiquer sur les côtés des rainures et un enfoncement servant à passer à ces animaux la nourriture qui leur convient, et qui consiste en glands, noix ou châtaignes; on pose par-dessus un couvercle, et privés de jour, ces loirs engraissent promptement.
XVI. Il ne nous reste plus à traiter que le troisième acte de la basse-cour, c’est-à-dire les viviers. Comment, le troisième? s’écria Axius; parce que, dans votre jeunesse, vous vous êtes habitué, par motif d’économie, à vous passer de vin au miel, est-ce une raison pour que nous soyons privés de miel aussi, nous autres? Le fait est vrai, dit Appius. Mes parents m’avaient laissé sans fortune, avec la charge de deux frères et de sœurs. J’ai marié sans dot l’une de mes sœurs à Lucullus, qui m’a depuis institué son héritier. Ce n’est qu’alors que j’ai moi-même commencé à boire du vin au miel; mais, à ma table, il y en a toujours eu pour mes convives. A cela près, il appartient à moi, bien plus qu’à vous, de connaître à fond les habitudes de cette race ailée, à qui la nature a si singulièrement départi le don d’industrie. J’ai plus que vous étudié son merveilleux instinct; et je vais le prouver. Écoutez-moi. Je laisse à Mérula le soin d’exposer, avec cette méthode dont il vient de nous donner des preuves, les pratiques observées par tous les meliturges (gens qui font du miel). Les abeilles sont engendrées par d’autres abeilles ou naissent spontanément du corps d’un bœuf en putréfaction. C’est ce qui a fait dire à Archélaüs, dans une de ses épigrammes, « que les mouches à miel sont la génération allée d’un bœuf mort. » Le même auteur dit encore que les guêpes sont engendrées par des chevaux, et les abeilles par des veaux. Les abeilles ne vivent point solitaires comme les aigles. A l’exemple de l’homme, elles aiment à se réunir. Les geais en font autant, mais non dans le même but. Les abeilles s’associent pour travailler, pour édifier; chez les geais, rien de semblable. On ne voit point chez eux ces combinaisons d’intelligence, cette adresse d’exécution qui se remarquent dans les constructions des abeilles, et dans leur prévoyance à remplir leurs magasins. Il y a pour les abeilles trois ordres d’occupation: la subsistance, l’édification, et le grand œuvre. Autres soins demandent la préparation du repas et celle de la cire, celle de la cire et celle du miel, la confection du miel et celle de l’alvéole. Chaque cellule d’un rayon a six angles, ce qui fait autant de côtés que l’abeille a de pattes. Remarquons qu’il est démontré par les géomètres qu’un hexagone inscrit dans un cercle y occupe plus de surface qu’un polygone de moins de côtés. Les abeilles vont pâturer au dehors; mais c’est dans l’intérieur de la niche que s’élabore ce doux produit si agréable aux dieux et aux hommes. Le miel trouve place sur les autels aussi bien que sur nos tables, tant au début d’un repas qu’au second service. Les abeilles ont des institutions comme les nôtres, une royauté, un gouvernement, une société organisée. La propreté est de leur essence. Jamais on ne les voit se poser dans le voisinage d’immondices ou d’exhalaisons fétides. Ce n’est pas qu’elles recherchent les parfums : on les voit punir, au contraire, de leur aiguillon quiconque s’approche parfumé de leurs cellules. Elles n’ont point l’indifférente avidité des mouches; aussi ne vont-elles jamais s’abattre, comme celles-ci, sur la viande, le sang ou la graisse. Les aliments d’une saveur douce peuvent seuls les attirer. Incapables de nuire, elles ne goûtent rien de ce qu’elles effleurent en butinant. Timides par nature, elles n’en résistent pas moins à outrance si l’on essaie de les troubler dans leur travail. Elles ont pourtant le sentiment de leur extrême faiblesse. On les appelle favorites des Muses, parce que s’il arrive qu’un essaim se disperse, on n’a qu’à frapper sur des cymbales ou les mains l’une contre l’autre, pour les réunir. Et de même que les hommes ont assigné à ces déesses l’Olympe et l’Hélicon pour leur séjour, de même la nature a abandonné à ces insectes les montagnes incultes et fleuries. Elles suivent leur roi partout, le soutiennent quand il est fatigué, et le portent sur leur dos quand il ne peut plus voler, tant elles attachent de prix à sa conservation. Elles aiment le travail et détestent les paresseux; aussi les voit-on constamment faire la guerre aux bourdons, et les expulser de leur société; car ils dévorent le miel sans aider à le faire. Souvent même on voit un gros de bourdons fuir devant quelques abeilles qui les poursuivent en murmurant de courroux. Elles bouchent, avec une matière que les Grecs appellent g-erithakeh, tous les trous au travers desquels l’air pourrait pénétrer dans leurs rayons. Les abeilles observent la discipline d’une armée, dorment à tour de rôle, répartissent entre elles la besogne, et envoient au loin des espèces de colonies. Elles obéissent à la voix de leur chef, comme les soldats au son de la trompette, et, comme eux, elles ont leurs signes de guerre et de paix. Mais j’ai peur que toute cette physiologie des abeilles ne fatigue notre cher Axius, qui aimerait mieux entendre parler de ce qu’elles rapportent. Je passe donc la lampe à Mérula : à son tour d’entrer en lice. Je ne sais, dit Mérula, si mes notions sur ce point pourront vous satisfaire; mais j’aurai pour autorité un homme que vous connaissez tous, et qui tire tous les ans cinq mille livres de miel de ruches qu’il a louées. J’ai encore notre ami Varron qui m’a dit avoir eu sous ses ordres en Espagne deux frères véiens, tous deux du canton de Falisque, lesquels sont devenus fort riches, bien que leur père ne leur eût laissé qu’une petite ferme d’un arpent au plus; et voici comment. Tout alentour du bâtiment, ils ont placé des ruches, transformé une partie de leur champ en jardin, et planté le reste en thym, cytise et mélisse, cette plante que les uns appellent g-melephyllon (feuille à miel), les autres g-melissophyllon (feuille aux abeilles), et d’autres encore g-melinon. Grâce à ces dispositions, ils ne retiraient jamais moins de dix mille sesterces par an de leur miel. Remarquez cependant qu’ils attendaient pour le vendre un moment favorable, et n’étaient jamais pressés de s’en défaire coûte que coûte. Eh bien ! s’écria Axius, enseignez-moi où je dois placer des ruches, et quels soins il faut leur donner pour en tirer d’aussi beaux produits. Mérula répondit : Quant aux ruches (g-melittohnes), que les uns appellent g-melittotropheia, les autres mellaria, elles doivent être placées près de la métairie, dans un lieu sans écho; car l’opinion générale est que cet effet du son effarouche les abeilles. Il leur faut un lieu assez élevé, qui ne soit ni brûlé pendant l’été, ni privé de soleil pendant l’hiver; pâture abondante dans le voisinage, et de l’eau pure. Si la nature n’y a pourvu, le propriétaire aura soin de faire venir à proximité des ruches les plantes que les abeilles recherchent le plus, comme la rose, le serpolet, la mélisse, le pavot, les fèves, les lentilles, les pois, la dragée, le sauchet, le sainfoin, et surtout le cytise, qui convient tant aux abeilles malades. Cette plante a encore l’avantage de fleurir depuis l’équinoxe du printemps jusqu’à celui d’automne. Autant le cytise leur est précieux sous le rapport sanitaire, autant le thym l’est pour la préparation du miel. Si le miel de Sicile a la palme, il la doit à l’abondance et à l’excellente qualité du thym que produit cette île. Aussi quelques personnes vont-elles jusqu’à arroser les pépinières plantées à l’usage des abeilles, de thym broyé et détrempé dans de l’eau tiède. Quant à l’emplacement des ruches, il faut le choisir le plus rapproché possible de la villa. Quelques-uns, pour plus de sûreté, les mettent sous le portique même. Les ruches sont de forme circulaire. On en fait d’osier quand on en a, de bois, d’écorce, de troncs d’arbres creusés ou de poterie; d’autres les font carrées avec de la férule, et leur donnent environ trois pieds de long sur un pied de large. Il faut toutefois en restreindre les dimensions, si l’on n’a pas assez d’abeilles pour les remplir; car trop d’espace vide les décourage. On a donné aux ruches le nom d’alvus (ventre), du mot alimonium (nourriture); c’est pourquoi on les fait étroites par le milieu, et renflées par le bas pour figurer un ventre. Les ruches d’osier doivent être enduites en dedans et en dehors avec de la bouse de vache, pour faire disparaître leurs aspérités, qui rebuteraient les abeilles. On les assujettit par rangs le long des murs, de façon qu’il n’y ait pas d’adhérence entre elles, et qu’elles soient à l’abri de toute secousse. La même distance qui sépare le premier rang du second doit régner entre le second et le troisième. Au lieu d’en ajouter un quatrième, on fera mieux, dit-on, de s’en tenir aux deux premiers. On pratique au milieu de chaque ruche de petits trous de droite et de gauche, pour que les abeilles puissent entrer et sortir; et on y pose un couvercle qu’on peut lever à volonté, lorsqu’on veut en retirer le miel. Les ruches en écorces sont les meilleures. Celles en terre cuite sont les moins bonnes, parce qu’elles sont plus accessibles au froid en hiver et à la chaleur en été. Le mellarius, c’est-à-dire celui qui est chargé du soin des ruches, doit les visiter trois fois par mois, au printemps et en été, y pratiquer de légères fumigations, les purger d’immondices, et en chasser les vermisseaux. Il veillera soigneusement à ce qu’il n’y ait pas plusieurs rois dans une même ruche; car cette pluralité cause des séditions, et le travail languit. Selon quelques auteurs, les chefs sont de trois couleurs, noire, rouge et mélangée; Ménécrate n’en admet que deux, le noir et le mélangé. Comme le mélangé est sous tous les rapports préférable au noir, il faut que le mellarius tue celui-ci toutes les fois qu’il se rencontre avec l’autre dans une même ruche. Cette royauté double, source de factions, est la perte d’une ruche; car il en résulte l’expulsion ou l’émigration d’une partie des abeilles, lorsqu’un prétendant triomphe ou se voit chassé. Parmi les abeilles, on regarde comme les meilleures celles qui sont petites, rondes et bigarrées. Le bourdon (fur) qu’on appelle aussi fucus est noir, et large de ventre. Il y a une autre espèce d’abeille qui ressemble à la guêpe; elle ne s’associe point aux travaux des abeilles ordinaires, et leur nuit au contraire par ses morsures; aussi celles-ci l’expulsent-elles toujours de leur communauté. Il faut distinguer les abeilles sauvages des abeilles privées. Les premières séjournent dans les bois et les lieux incultes, les autres dans les champs cultivés. Les abeilles sauvages sont velues et petites, mais plus laborieuses que les abeilles privées. En achetant de ces insectes, on doit s’assurer s’ils ne sont point malades. C’est un signe de bonne santé lorsque les essaims sont denses, les mouches luisantes, et qu’il y a dans leur travail précision et netteté. C’est un signe de maladie lorsque les abeilles sont velues, hérissées, poudreuses, à moins toutefois qu’elles ne soient alors pressées de travail, ce qui peut leur donner cette apparence négligée et malingre. Quand on juge à propos de transférer les ruches, il faut mettre une grande circonspection dans le choix du lieu et du moment. Pour le moment, le printemps est préférable à l’hiver car dans la saison froide les abeilles ont peine à s’habituer aux changements de demeure, et sont disposées à déserter. C’est ce qui arrive certainement, si d’un lieu qui leur convient vous les transportez dans un autre moins propice à leur pâture. Le changement de ruche sans changement de place exige encore certaines précautions. On frotte par exemple les nouvelles ruches de mélisse, ce qui est pour les abeilles un grand appât, et dans chacune on place près de l’ouverture quelques rayons de miel; cette provision toute faite leur donne le change sur leur translation. La nourriture qu’elles trouvent au commencement du printemps, dans les fleurs d’amandier et de cornouiller, les rend presque toujours malades: on les guérit avec de l’urine. On appelle propolis la matière dont se servent les abeilles, surtout en été, pour boucher l’ouverture de leur ruche. C’est la même substance que les médecins emploient pour les emplâtres. Aussi se vend-elle dans la rue Sacrée plus cher que le miel même. On appelle érithace celle qui colle les rayons ensemble, et qui est essentiellement distincte du miel et du propolis; on lui suppose une vertu attractive. Quand on veut, par exemple, qu’un essaim se fixe sur une branche d’arbre ou ailleurs, on n’a qu’à frotter la place avec de l’érithace mêlée de mélisse. Les rayons sont un composé de cire, à plusieurs compartiments, dont chacun a autant de côtés que la nature a donné de pattes à l’abeille, c’est-à-dire six. Ce n’est pas indistinctement de toutes plantes que les abeilles recueillent de quoi composer ces quatre différentes substances, propolis, érithace, rayon et miel. Telle ne fournit, comme la grenade et l’asperge, que la nourriture; ou, comme l’olivier, que la cire; ou, comme le figuier, que du miel, lequel est assez médiocre. Telle autre, comme les fèves, la mélisse, la courge et le chou, contiennent deux éléments, nourriture et cire; ou, comme le pommier et le poirier sauvages, miel et nourriture; ou, comme le pavot, cire et miel. D’autres enfin réunissent les trois principes élémentaires, de la cire, du miel et de la nourriture, comme l’amandier et le chou sauvage. Il y a aussi un grand nombre de fleurs sur lesquelles elles recueillent tantôt une seule, tantôt plusieurs de ces substances. On doit établir une distinction entre les plantes dont elles font un miel liquide, comme la bruyère, et celles dont elles font un miel épais, comme le romarin. Le miel du figuier est insipide; le miel du cytise vaut mieux; mais le meilleur de tous provient du thym. Comme elles ne se désaltèrent que dans l’eau la plus pure, il faut qu’elles trouvent dans le voisinage de leurs ruches un petit courant ou un réservoir, où l’eau n’ait pas plus de deux ou trois doigts de profondeur. On y jettera de petits cailloux ou des briques, formant au-dessus de l’eau des points où les abeilles puissent se poser pour boire. On doit veiller avec soin à ce que l’eau soit toujours très claire, ce qui influe singulièrement sur la qualité du miel. Comme l’essaim ne peut sortir par tous les temps pour butiner, il faut qu’il trouve dans ce cas la nourriture tout à portée, de peur que, réduites à ne vivre que de leur miel, les abeilles ne mettent à sec la ruche. A cet effet on fait bouillir dans six congii d’eau dix livres de figues; et de la pâte qui en résulte on pétrit des espèces de gâteaux qu’on place auprès des ruches. Certaines personnes y mettent aussi de petits vases remplis d’eau emmiellée, sur chacun desquels surnage un morceau de laine de la plus grande propreté: par ce moyen les abeilles peuvent en quelque sorte sucer l’eau, et ne risquent ni d’en trop boire ni de se noyer. Il doit y avoir un vase pour chaque ruche, et on les remplit à mesure qu’ils se vident. D’autres broient dans un mortier des raisins secs et des figues, et versent du vin réduit aux deux tiers par la cuisson. Du résidu ils font ensuite de petits pâtés qu’ils jettent non loin des ruches, de façon que les abeilles les trouvent sur leur passage dans leurs excursions au dehors. Quand une émigration se prépare (ce qui arrive quand un grand nombre de naissances étant venues à bien, les anciennes de la ruche veulent envoyer la génération nouvelle en colonie, ainsi que les Sabins par l’accroissement de leur population furent souvent obligés de le faire), cette résolution s’annonce par deux signes précurseurs. D’abord, quelques jours avant, on voit surtout le soir, près de l’ouverture de la ruche, des groupes d’abeilles accrochées les unes aux autres par pelotons, et formant comme autant de grappes; ou bien encore, sur le point de s’envoler, et quand a déjà commencé le mouvement de retraite, elles font entendre une rumeur extraordinaire, comme d’une armée qui lève le camp. Les plus promptes voltigent autour de la ruche, attendant que les autres, qui ne se sont pas encore rassemblées, les rejoignent. Quand le mellarius aperçoit ce symptôme, il n’a qu’à jeter sur les abeilles de la poussière, et à frapper en même temps sur quelque instrument de cuivre, pour répandre l’effroi parmi elles. Il pourra ensuite les conduire où bon lui semblera, en ayant soin de placer aux lieux de leur destination nouvelle une branche d’arbre ou tout autre objet frotté d’érithace, de mélisse, et enfin de tout ce qui attire les abeilles. Quand il a réussi à les arrêter, il y place une ruche frottée intérieurement des mêmes substances, et, entourant les abeilles d’une légère fumigation, il les oblige à y entrer. Une fois qu’elle y a pris pied, la nouvelle colonie y fixe si bien son domicile, qu’en vain l’on rapprocherait d’elle la ruche qu’elle vient de quitter, c’est la nouvelle qu’elle préfère. Voilà tout ce que je crois avoir à dire de l’éducation des abeilles. Passons au but principal de leur entretien, qui est le profit qu’on en retire. On enlève les rayons lorsque les ruches sont pleines. Les abeilles font elles-mêmes connaître ce moment. On a lieu de présumer qu’il est venu lorsqu’on entend un bourdonnement dans les ruches, et qu’on voit les abeilles se trémousser en entrant et en sortant; ou bien encore lorsqu’en ôtant le couvercle, on voit les cellules couvertes comme d’une pellicule de miel, signe qu’elles sont entièrement remplies. Il y en a qui prétendent qu’en enlevant le miel on doit en laisser dans la ruche la dixième partie, et que si l’on enlève tout, les abeilles désertent. Quelques-uns même en laissent davantage. Il en est des abeilles comme des terres: on augmente le rapport d’un champ en le laissant se reposer de temps à autre; on augmente celui des abeilles, et en même temps on les attache davantage à leur ruche, en y laissant la totalité ou du moins la plus grande partie du miel. On enlève les rayons pour la première fois au lever des Pléiades; pour la seconde fois, à la fin de l’été, avant que l’Arcture soit entièrement levée; et pour la troisième, après le coucher des Pléiades. A cette dernière époque on ne doit jamais ôter plus du tiers du miel, quand même la ruche serait pleine; les deux autres tiers y resteront comme provision d’hiver. Quand la ruche n’est que médiocrement fournie, la levée du miel ne doit se faire ni d’un seul coup, ni en présence des abeilles, afin de ne pas les décourager. Si dans les rayons qu’on enlève, il se trouve une portion qui soit vide de miel ou tant soit peu endommagée, il faudra la retrancher avec le couteau. Il faut veiller avec soin à ce que parmi les abeilles les plus fortes n’oppriment pas les plus faibles, ce qui amènerait une diminution notable dans le rapport des ruches. On choisit en conséquence les moins vigoureuses, pour les soumettre à un autre roi. Lorsqu’on s’aperçoit qu’elles se battent souvent entre elles, il faut les asperger avec de l’eau mêlée de miel: aussitôt tout cesse, et les combattants se pressent les uns contre les autres pour sucer le liquide. L’effet de ce moyen est encore plus sensible quand, au lieu d’eau, c’est du vin mêlé de miel que vous répandez sur les abeilles. Attirées alors par l’odeur du vin, elles se recherchent avec plus d’empressement, et s’enivrent en le suçant. Quand les abeilles se montrent paresseuses à sortir, et restent dans les ruches en trop grand nombre, il faut avoir recours aux fumigations, et placer dans leur voisinage quelques herbes odoriférantes, surtout de la mélisse et du thym. Les plus grands soins sont indispensables pour les empêcher de périr de l’excès du froid ou de la chaleur. Lorsqu’en butinant elles viennent à être surprises par une averse ou par un froid subit, ce qui est rare toutefois, et qu’abattues par les grosses gouttes d’eau, elles sont jetées à terre privées de force et de mouvement, il faut les ramasser, et les mettre, dans un vase qu’on placera dans un lieu couvert où règne une chaleur douce, et les y tenir jusqu’à ce que le temps soit bien assuré. On répand alors sur elles de la cendre de bois de figuier, chaude plutôt que tiède; puis on secoue légèrement le vase, sans toucher les abeilles, et on l’expose au soleil. Lorsqu’elles sentent la chaleur, elles se remettent et reprennent vie, comme des mouches qui ont été submergées. Il faut leur appliquer ce traitement non loin des ruches, pour qu’elles puissent y retourner dès qu’elles seront revenues à elles, et reprendre leur ouvrage avec une force nouvelle.
XVII. Nous voyons alors revenir Pavo. Si vous voulez lever l’ancre, dit-il, on procède en ce moment au scrutin; et le praeco (crieur) a déjà commencé à proclamer l’édile nommé par chaque tribu. Aussitôt Appius se lève pour aller féliciter son candidat sur le lieu même, et s’en retourner ensuite dans ses jardins. Mérula s’adressant alors à Axius: A un autre jour, dit-il, le troisième acte de la basse-cour. Tous se levèrent, et je restai seul avec Axius. Nous nous regardâmes un instant en silence, comme pour nous dire : Notre candidat à nous viendra bien lui-même nous trouver. Enfin Axius me dit: Le départ de Mérula ne me fait pas autrement faute; car le reste du sujet ne m’est rien moins qu’étranger. On distingue deux espèces de viviers, les viviers d’eau douce, et ceux d’eau salée. Les premiers, formant chez les gens du peuple et dans les fermes ordinaires une industrie assez lucrative, ne sont alimentés que par l’eau qu’y fournissent les nymphes. Les viviers d’eau salée, au contraire, sont créés par les nobles pour le faste plus que pour l’utilité. C’est Neptune qui y apporte de l’eau et des poissons. Ils contribuent à vider la bourse du maître plutôt qu’à la remplir. On les construit à grands frais, et c’est à grands frais qu’on les peuple et qu’on les entretient. Hirtius retirait douze mille sesterces des bâtiments dépendant de ses viviers; mais le seul entretien de ses poissons engloutissait tout le profit. Et rien n’est moins surprenant. Je me rappelle qu’un jour il prêta à César six mille murènes, à condition qu’elles lui fussent rendues au poids: c’est la quantité prodigieuse de ces poissons qui fit monter sa villa au prix de quatre millions de sesterces. On a bien raison d’appeler nos viviers d’intérieur et de petites gens des viviers doux, et ceux des nobles, des viviers amers. Parmi nous autres, en effet, on se contente d’un seul vivier d’eau douce: et quel amateur de viviers maritimes n’en veut avoir plusieurs communiquant de l’un à l’autre, à l’imitation de Pausias et des peintres de son école, qui ont de grandes boîtes divisées en autant de cases qu’ils emploient de nuances de cire? Nos nobles ont des viviers à compartiments, servant à parquer en quelque sorte les poissons par espèce; et jamais cuisinier ne fera sommation à ceux-ci de comparaître sur table: ils sont sacrés, Varron, plus sacrés que ceux que vous vîtes en Lydie, pendant un sacrifice que vous faisiez près de la mer, s’attrouper sur le rivage au son de la flûte d’un Grec, et venir presque sur l’autel sans que personne n'osât y toucher. C’est dans ce même pays que vous avez vu des filles danser en rond. Notre ami Hortensius, au temps où il possédait encore à Bauli ces viviers qui lui avaient coûté si cher, envoyait (je le sais pour l’avoir vu de mes yeux dans les visites fréquentes que je lui ai faites à sa villa), envoyait acheter à Puteoli (Pouzzoles) le poisson qu’on servait sur sa table. Et c’était peu qu’il s’interdît de manger du sien; il fallait qu’il lui donnât à manger lui-même, montrant autant et plus de sollicitude pour l’appétit de ses surmulets que je n’en puis avoir pour celui de mes ânes de Roséa. Et ce n’était pas certes à aussi peu de frais qu’il leur fournissait eau et pâture. Car à quoi se réduit l’entretien de mes ânes, qui sont d’un si beau produit? Un petit palefrenier, quelque peu d’orge et l’eau de mes sources, voilà tout ce qu’il faut; tandis qu’Hortensius avait à son service une armée de pêcheurs continuellement occupée à lui fournir des masses de petits poissons, pour les repas des gros. Et quand la mer était grosse, et que tous les filets du monde n’auraient pas amené un seul poisson, il fallait, pour remplacer cette nourriture vivante, épuiser le marché à la marée des salaisons qui sont la nourriture du peuple. Hortensius vous aurait laissé prendre tous les mulets de voiture de son écurie, plutôt qu’un seul mulet barbu de ses viviers. Et quels soins il donnait à ses poissons quand ils étaient malades ! il n’en avait pas plus pour ses esclaves. Il eût plutôt laissé un de ces derniers boire de l’eau froide en maladie, qu’un de ses chers poissons. Il faisait peu de cas des viviers de M. Lucullus, l’homme, disait-il, le plus indifférent au bien-être de ses poissons : chez ce dernier, les pauvres bêtes n’avaient point de bassins d’été; leur eau n’était pas renouvelée; on les y laissait croupir. Parlez-moi de L. Lucullus, qui avait fait ouvrir une montagne près de Naples, dans le seul but d’introduire dans ses viviers l’eau de la mer, que chaque marée y apportait et remportait. Pour les poissons c’était un autre Neptune. Il avait ménagé à ses chers nourrissons un plus frais séjour pour l’été, imitant en cela la sollicitude des pasteurs apuliens, qui, au temps des grandes chaleurs, conduisent leurs troupeaux sur les montagnes du pays sabin. Sa passion pour ses viviers de Baies était portée à ce point, qu’il avait donné carte blanche à son architecte pour la construction d’un canal souterrain, communiquant de ses viviers avec la mer, afin que la marée, au moyen d’une écluse, pût deux fois par jour, depuis le premier quartier jusqu’à la nouvelle lune, y entrer et en ressortir après les avoir rafraîchis. Pendant que nous parlions ainsi, un bruit de pas se fait entendre à notre droite, et nous voyons entrer notre candidat avec les insignes de sa nouvelle dignité. Nous allons au-devant de lui; et après l’avoir félicité, nous l’escortons au Capitole. Puis nous nous séparons, pour rentrer chacun chez nous. Voilà, mon cher Pinnius, le résumé succinct des conversations que nous avons eues sur l’entretien de la basse-cour.
FIN DE L'OUVRAGE
