Études sur le théâtre latin
par
Maurice Meyer
Docteur-ès-Lettres
PROFESSEUR SUPPLÉANT DE POÉSIE LATINE
AU COLLÈGE DE FRANGE.
1847
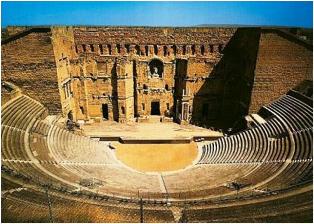
Chapitre 1 Les Atellanes : De la satire primitive et de la satyre. Les Atellanes à Rome jusqu'au temps de J. César. Leur caractère. Personnages invariables ou masques de caractère. Les Atellanes sous César et sous les Empereurs. De la langue Osque dans les Atellanes. Des auteursd'Atellanes.
Je publie mes premières études et quelques-unes de
mes leçons faites l'année dernière au Collège de
France, sur le Théâtre latin. J'ai essayé de conserver à
celles-ci quelque chose de l'improvisation de la chaire;
j'y ai laissé subsister volontairement, à côté des preuves philologiques
ou littéraires destinées au lecteur sérieux,
les ornements du discours destinés primitivement
à l'agrément de l'auditeur. Je pense que de
notre temps, pour être, non pas goûté, mais seulement
lu, la science seule n'a ni assez de charmes, ni
assez d'amis. D'autre part la vivacité du langage,
les parures du style, le besoin de varier l'ordre et le mouvement des sujets sans quelque échantillon d'études
sérieuses, quoique incomplètes ne peuvent captiver
un instant que les frivoles ou les indifférents
et, si je ne devais toucher que,ceux-ci, je les donnerais
tous, sans exception, pour l'honneur d'être feuilleté par un esprit solide et de bonne foi.
Le public des lecteurs est diversement composé.
A côté des poètes et au-dessous des érudits, il y a des
hommes qui ont trop de science pour être rangés
parmi les premiers et trop peu pour compter parmi
les seconds. C'est pour ceux-là que j'ai écrit ce
premier ouvrage pour eux que j'ai été sobre dans
beaucoup de citations philologiques et réservé dans
l'emploi des ornements. Heureux si, après cette première
épreuve, il m'est donné un jour d'aspirer
plus haut et de n'écrire plus que pour les savants !
Paris, le 4 mars 1847.
LES ATELLANES.
ou
Le Théâtre primitif.
Les productions dramatiques des Romains qui sont le mieux connues parmi nous, sont généralement celles où l'art grec a servi de modèle ou d'inspiration, et qui ne portent pas l'empreinte unique du caractère Romain. C'est à l'éclat que ces oeuvres d'emprunt ont jeté sur les lettres romaines qu'est due la quantité des copies qui en sont restées c'est par le grand nombre et la bonne conservation de ces copies parvenues jusqu'à nous, que nous avons acquis la connaissance familière de toute cette littérature d'imitation. Mais cette popularité de certains ouvrages a ajouté encore à l'obscurité où est à peu près restée une partie intéressante du génie dramatique de cette grande nation. On connaît à peine le théâtre entièrement indigène où accourait cette foule du bas-peuple qui, comme Marius, était demeurée étrangère et résista longtemps à toute civilisation qui n'était pas Romaine. C'est là cependant que se montraient dans toute leur beauté sauvage, avec leur sève forte et sans mélange, les véritables productions de l'esprit du sol. Dans ce coin obscur de la société d'alors, que Plaute a laissé entrevoir, sur ce modeste théâtre, se révélait avec toute sa pétulante énergie le vrai caractère Romain; refoulé ou amoindri sur d'autres scènes. Là les laboureurs, les artisans, tous les gens du peuple venaient applaudir des improvisations dont leur vie domestique était souvent le sujet, des plaisanteries plus effrontées que fines, qu'ils trouvaient sans fiel, des noms ou des personnages comiques dont la tradition était un héritage de leurs ancêtres. De ce répertoire populaire, dont nous ne possédons que de faibles restes, les pièces les plus anciennes et qui paraissent les plus originales sont les Atellanes. Nous voulons tenter d'en réunir tous les éléments les plus caractéristiques, afin de reconnaître en partie ce qu'a pu fournir, dans l'art dramatique, Rome dégagée de toute préoccupation étrangère, et uniquement livrée à ses propres inspirations; afin de restituer, s'il se peut, quelques chose de son génie individuel. Pour expliquer l'introduction des Atellanes à Rome, il faut remonter jusqu'à la satire nous allons l'esseyer.
De la Satire primitive et de la Satyre.
La coutume des chants destinés à la raillerie est chez les Romains presque aussi ancienne que Rome même. Dès l'origine, les habitants. des champs avaient l'habitude de se divertir, dans leurs fêtes rustiques, par des attaques mutuelles et des plaisanteries aiguisées en vers barbares (1). Les jeunes gens, le jour des noces de quelque parent ou de quelque ami, chantaient souvent des couplets moqueurs qu'inspiraient la joie et la circonstance (2). A Rome, la raillerie et la satire en vers se donnaient carrière encore dans d'autres occasions, car nous apprenons que l'on ne put longtemps tolérer leurs mordantes licences, par le passage de la Loi des Douze Tables, qui défend de telles chansons satiriques sous les peines les plus infamantes (3).
(1) Virgil., Georg. II; 385. Horat. Epist. II, I, 145.
(2) Festus voc. Fescennini, Catull., Carm. LX1, 12 et 126. Servius ad Aeneid., lib. vn, 695. Cf. Claudian., xi-xiv, pag. 96, édit. Bipont. Senec, Medea, 113. -Martial, Epigr., VII, 8, 7. Ménage, Diction.; mot Charivari.
(3) Cicer. Tuscul., iv, 2. -Cf. Horat., Sat. II, I, 80-83. (Plus tard
cette loi fut appliquée à la scène; Cicer. de Republ., ap. August. Civit.
Dei, II, 9, 12, 13).
,Festus voc. occentassint.
L'époque
de la publication d'une défense aussi sévère
( 302 de R. ) nous prouve que les excès de la Satire
n'en suivirent pas immédiatement la naissance. Horace en quelques vers nous fait connaître
ses vicissitudes principales. D'abord simple
badinage essayé aux solennités que les villageois
consacraient à la Terre, ou mêlé aux fleurs et au
vin qu'ils consacraient au dieu Genius, elle devient
bientôt hardie et éclate en vers fescennins. Cette
liberté de la raillerie que l'allégresse des fêtes
semble permettre se fait accepter facilement; elle
se joue avec grâce dans des dialogues versifiés elle
lance la médisance et la honte en riant; sa nouveauté
la rend aimable, et ses traits piquent longtemps
sans blesser. Mais ses libertés finirent par dégénérer
en excès: ses jeux devinrent dangereux,
ses badinages se tournèrent en rage, et ses atteintes
en cruelles menaces. Les victimes s'émurent; et
ceux qui craignaient de le devenir réclamèrent avec
elles. Une loi mit fin au mal, les vers méchants furent
défendus, et les poètes obligés de dire le bien
et de plaire (l).
Dans ces disputes alternatives, dans la réciprocité
de ces innocentes injures, on peut reconnaître
déjà le germe d'une sorte de comédie. Ce qui peut
prêter encore à le faire entrevoir, c'est la figure que
prenaient ces acteurs de village. Les uns se peignaient
le visage avec le suc de certaines plantes
colorantes (2); les autres se couvraient de masques d'écorce pour se donner des traits effrayants.
(1) Horat., Epist. Il. I, 139-155. Cf. Epist. ad Pison., 210 seqq.
(2) Tibull., Eleg. II I, vers 55.
Virgile, en épurant plus tard, en embellissant de son génie les dialogues du même genre, nous donne à la fois une idée de ces scènes primitives et comme un avant-goût de celles du théâtre; et c'est ainsi qu'il a pu dire Nec erubuit sylvas habitare Thalia. (1)
(1) Virgil., Eclog. vi, vers 2.
Telle fut la satire primitive à Rome. Avant d'en suivre certaines vicissitudes, il est indispensable de marquer sa place distincte à un genre qui, malgré quelque analogie de forme et de nom avec la satire, s'en sépara cependant quelque temps par un caractère spécial. Ils'agit de la Satyre, divertissement différent dont l'origine, dit Denys d'Halicarnasse, appartenait à la Grèce, et dont la courte histoire peut être retracée ici. Un passage de Fabius.Pictor, le.plus ancien des historiens latins, pourra nous en donner une idée assez exacte.C'est le récit, copié par Denys d'Halicarnasse des jeux célébrés à Rome en 258 d'après un voeu de Posthumius qui venait de vaincre les Latins au lac Regille. Après une longue description des tableaux divers et du cortège de la fête, l'écrivain fait apparaître, à la suite des athlètes, les choeurs des danseurs divisés en trois classes. Ils sont suivis du Choeur des Satyres qui dansent la atawis grecque (1).
(1) Danse satyrique.
Les uns représentent des Silènes et
portent des tuniques velues et des manteaux entrelacés
de toutes sortes de fleurs; les autres, vêtus en
Satyres et couvert de peaux de boucs, la tête hérissée,
ridiculisent par une grotesque imitation les danses
graves et toute la pompe qu'ils ont sous les yeux.
Enfin la hardiesse des propos et des vers malins se
joignait à celle de la pantomime et venait compléter
ce spectacle dont la date n'est pas sans importance.
C'est un an après l'institution régulière des
Saturnales que fut célébrée cette fête triomphale.
En tête ou à la suite de ce cortège figuraient le
plus ordinairement des personnages ridicules ou effrayants,
destinés à plaire la populace. C'étaient le
monstre Manducus (1) et deux masques de femmes,
nommées Citeria et Petreia.
(1) Plaut. Rudens, act. n, se. 6, vers 51. Festus, voc. Manducus.
La première insultait joyeusement les assistants ou les passants, l'autre était ordinairement ivre. (1)
(1) Festus, voc. Petreia et Citeria, Peut-être les Manies à la face
enfarinée y figuraient aussi
Souvent même, dans ces solennités guerrières, les chants de la louange s'entremêlaient à ceux de la raillerie. C'est ainsi que, en 344, le consul Valerius était accueilli par de malignes saillies en vers dialogués, sorties des rangs ou retentissait en même temps l'éloge du tribun Maenius. D'autres fois on choisissait le moment ou l'anniversaire des funérailles pour y faire figurer ces choeurs de Satyres ou pour en imiter les danses, comme Virgile nous l'apprend au sujet du berger Daphnis (1).
(1) Cette danse des Satyres et des autres personnages mythologiques est devenue familière, sous Auguste, chez les bergers et ailleurs. Voir Horace, Epist. II, 2, 124
Jusqu'ici c'est au milieu des coutumes militaires,
des institutions religieuses de la patrie que se confondent
les improvisations de la Satyre. Comme délassement
intellectuel, comme composition littéraire,
nous n'en retrouverons que des traces équivoques.
A part un ou deux vers dont les indicatîons sont fort douteuses, on ne connaît point alors
d'écrits, particulièrement Satyriques. Mais dans la
suite le goût du théâtre qui, avec celui de l'imitation
grecque, s'était promptement développé depuis
les heureux essais de Livius Andronicus paraît avoir
gagné jusqu'aux Satyres. Peut-être sont-ce des Satyres
dialoguées que composait
Sylla, l'ami de Roscius, le protecteur, le
bienfaiteur des mimes et des bouffons. Sans
doute aussi, au siècle d'Auguste, les Pisons s'essaient
ou veulent s'essayer à composer des pièces
satyriques où doivent revivre les Satyres et même
les Faunes antiques avec leurs saillies moqueuses et
leur caractère rieur, et Horace leur apprend avec
délicatesse l'art de rester originaux et d'éviter la
ressemblance du drame satyrique des Grecs. Il
se peut que, séduits par la popularité des Atellanes
ou des pièces grecques, Sylla et les Pisons aient
voulu, à leur tour, créer ou réhabiliter ce genre sur
la scène satyrique. Car il n'est pas douteux que la
Satyre a eu à Rome un théâtre qui portait son nom.
Vitruve en décrivant les trois espèces de scènes
destinées au théâtre Romain, donne la troisième
place à celle qu'on nommait satyrique, dont il dépeint
en détail la décoration agreste et Donat dans ses Prolémogènes sur Térence, fait figurer la
satyre romaine sur un théâtre pareil. Quel que
soit le degré de vraisemblance de nos conjectures,
il faut supposer néanmoins que, jusqu'à la
tentative de Sylla et même dans la suite, ce théâtre
admit aussi indistinctement soit les Atellanes et toutes
les pièces appelées planipedia, soit, comme le
prétend Munk, toutes celles dont le sujet était
champêtre.
Il est facile maintenant de reconnaître clairement
la différence des deux genres dont nous nous
occupons, Bien qu'au premier abord ils paraissent
se confondre, ils se détachent cependant l'un de
l'autre par des points distincts. Les danses satyriques
en l'honneur de Posthumius ou du berger
Daphnis n'ont pas leurs analogues dans les jeux
des champs décrits par Horace ,et Virgile. Chez les
antiques campagnards qu'ils nous montrent, la
danse n'est qu'un divertissement accessoire au
chant. Le plus souvent même elle est négligée et
les auteurs n'en font pas mention tandis qu'elle
est l'élément ordinaire du jeu des Satyres. Ici le déguisement est habituel et, certains costumes mythologiques
sont même un ornement, sinon indispensable, du moins en rapport lvec le personnage,
comme nous l'apprend le passage de Fabius Pictor.
Là le vêtement n'est pas même nommé à part les
masques d'écorce et les figures peintes dont parlent
Virgile et Tibule, tout autre déguisement ne fait
pas partie des réjouissances solennelles. Dans la Satire,
c'est la fête de la Terre, de quelque divinité
des champs, ou du Dieu Genius, c'est la célébration
d'un mariage qui appellent les divertissements,
les vers. fescennins et saturnins: dans la Satyre, c'est
une victoire ou une mort qui les provoque. Dans
la première les insultes sont réciproques entre les
villageois; les vers joyeux se croisent ordinairement
et n'attaquent que ceux mêmes qui les chantent.
La seconde s'adresse tantôt à un général, à quelque
éminent personnage, sans ,qu'il y ait réciprocité de
leur part, et tantôt ses jéux honorent la tombe de
quelque citoyen opulent ou le souvenir d'un mort
fameux
Cependant, excepté quelques improvisations satyriques
mêlées encore aux cérémonies du triomphe
et de la mort, la Satire sembla s'être confondue,
ailleurs et plus tard, avec la Satyre romaine. Ainsi,
au VI°siècle, on croirait les reconnaître toutes
deux dans les habitudes d'un certain Cécilius. Ce
sénateur étrange avait reçu de Caton le surnom de
Fescennin, parce qu'il avait coutume de descendre de cheval pour danser en pleine rue est débiter des
plaisanteries aux passants. " Il chante, disait-il, où
bon lui semble parfois il récite en gesticulant des
vers grecs, dit des bouffonneries, prend des tons divers
et exécute certaines danses (1)." Ce mélange
paraît encore dans ces prières de la moisson, que les
villageois du temps de Virgile, entonnaient en l'honneur
de Cérès et qu'ils entremêlaient de danses désordonnées
(2), et dans ces insultes dont les effrontés
vendangeurs harcelaient alors les passants (3).
(1) Macrob., Satur. Il, 10. Cf. Plaut., Persa, act.V, se. 2, vers 43.
(2) Virg., Georg. 1, 350.
(3) Horat., sat. I, VII. 28.
C'est là ce qui explique la confusion qui existe à
ce sujet, même chez les auteurs les plus voisins de
cette époque. L'association des deux genres a rendu
incertaine la véritable étymologie du mot Satire.
Donat dit formellement que la Satyre latine tire son
origine de la Satyre grecque ainsi nommée des Satyres pétulants et bavards qui la représentaient, et
il rejette comme vicieuse toute autre étymologie.
La Satyre romaine, ajoute-t-il, quoique jouée sur
une scène grossière et à peu près toute champêtre, s'occupait des vices sans nommer personne.
Évidemment Donat ne reconnaît plus qu'une seule
Satyre et qu'un seul nom. Au contraire, Porphyrion,
un des commentateurs d'Horace, en cherchant
à expliquer le nom originaire de la Satire, ne mentionne plus que celle qu'il commente. Enfin
Diomède, au Ve siècle, se perd dans les étymologie
qu'il cherche à ce mot. Il en essaie quatre différentes,
dont la première fait venir le mot Satyra du
chant railleur des Satyres, et son choix ne sait déjà
plus se fixer à aucune.
Les Atellanes à Rome jusqu'au temps de J. César. Leur Caractère.
Le passe-temps de la Satire et les spectacles du
Cirque suffisaient depuis longtemps à la satisfaction
des esprits Romains, lorsqu'en 391, sous le consulat
de Paeticus et de Stolon, se déclara tout-à-coup
une peste dont les ravages défiaient les ressources
de l'art et de la prière. Au milieu du découragement
général on songea, pour apaiser plus sûrement
les dieux, à tenter la célébration de solennités extraordinaires,
rehaussées pour la première fois par
la nouveauté des jeux scéniques. De l'Etrurie qui, en
138, avait déjà fourni des gladiateurs et des cavaliers
au cirque romain furent appelés des pantomimes dont les jeux offraient d'abord une grande
simplieité. Car ils n'étaient ni relevés par des vers
récités, ni même accompagnés d'une pantomime,
destinée à en reproduire la pensée. Ils consistaient
seulement en quelques danses exécutées avec grâce
aux sons de la flûte. La jeunesse romaine se mit
aussitôt à les imiter, en mêlant à ces divertissements
les badinages réciproques de l'ancienne Satire et
des gestes analogues aux paroles. Au bout de quelque
temps ces informes essais, encouragés par la vogue,
devinrent une institution, ces.acteurs novices
furent remplacés par des comédiens réguliers qu'on
nomma Histrions, et aux mutuelles plaisanteries
improvisées jusque là en vers grossiers, succédèrent
des Satires en vers cadencés, où la flûte gouvernait
la déclamation et les mouvements.
Longtemps les Romains se contentèrent de ce
genre de plaisirs. Cependant, plus ces jeux devenaient
un art, plus allait être inévitable un retour
nouveau vers l'ancienne Satire, où la vivacité joyeuse
et caustique, l'esprit libre et prompt étaient tout
le talcnt. Ainsi lorsque Livius Andronicus, en 514
eut apporté une perfection nouvelle aux compositions
scéniques de son temps, en leur donnant pour
la première fois la régularité du théâtre grec, la
gaîté et les saillies en vers libres, bannis de la marche
uniforme du drame, finirent par se faire jour
ailleurs. Elles furent renouvelées avec la satire d'autrefois
que la jeunesse rapporta, en se réservant à elle seule le droit de la représenter. Dans la suite,
cette satire fut modifiée, ces badinages prirent le
le nom d'Exodia et furent ordinairement intercalés
dans les fables Atellanes, sorte de pièces satiriques
empruntées aux Osques.
Ici s'arrêtent les seuls renseignements fournis par
Tite-Live sur les Atellanes et sur les modifications
principales qu'éprouva la Satire. Essayons de développer
avec exactitude ce qu'il n'a fait que montrer.
C'est du pays des Osques, peuple de la vieille
Campanie, que les Atellanes furent apportées à
Rome. Elles avaient emprunté leur nom d'Atella
ville de ce pays, où elles avaient pris naissance.
Il est remarquable que les Osques avaient chez les
anciens une réputation de plaisants obscènes et grossiers,
d'audacieux,bouffons qui a une frappante
connexité avec les habitudes de la Satire primitive.
Outre d'autres rapports que nous signalerons, cette
conformité n'a pas dû peu contribuer à joindre la Satire et
l'Atellane.Mais elles se réunirent primitivement
sans se confondre la forme diverse des deux genres
en empêchait de suite le complet mélange. La
Satire primitive était sans règle, l'oeuvre enjouée du
hasard; l'Atellane, dont on ne mentionne jamais
l'origine Osque sans la nommer fable Atellane, parait avoir eu un ensemble quelconque, une sorte de
canevas burlesque, et convenait bien pour servir de
cadre à la Satire. Tite-Live d'ailleurs est formel ici: Juventus more antiquo ridicula intexta versibus jactitarecoepit,
quae inde Exodia postea appellata consertaque
fabellis potissimum Atellanis sunt. Le mot potissimum même serait une preuve de plus de la séparation
de ces deux espèces il apprend que le ridicule
de la Satire avait pu s'intercaler encore dans
d'autres pièces que les Atellanes. On ne saurait
donc admettre l'opinion de M. Schlegel qui ne fait
des Atellanes et des Satires qu'une seule et même
chose à leur début. Le savant critique a négligé
le passage de Tite-Live que nous mentionnons, et
a été évidemment trompé par l'intime rapport de
ces deux sortes de Satires qui les amena, mais plus
tard, à n'en être plus qu'une seule.
La jeunesse romaine se réserva la représentation
des Atellanes mêlées d'exodia, et ne permit pas, dit
Tite-Live, qu'elles fussent souillées par les histrions.
Deux faits nous paraissent ressortir de ce passage.
Le premier, c'est le peu de popularité qu'avait alors
obtenu l'introduction de l'art grec sur la scène de
Rome, puisque la jeunesse, celle qui partout impose
la mode et la suit, ramena le genre, antique,
où l'art avait moins de part, où éclataient sans frein
la gaîté et le naturel vraiment romains. Le second c'est le caractère indigène des Atellanes qui, restées
comme le patrimoine de la jeunesse Romaine, n'étaient
point touchées par ces histrions de l'art grec
que Livius avait formés. Cette opinion se confirme
par ce que nous, savons des privilèges accordés aux
acteurs d'Atellanes. Les droits de citoyens romains
leur étaient conservés à l'exclusion des histrions, qui
étaient soumis à tous les genres d'humiliations.
Ceux-ci, privés de toutes pérogatives, pouvaient être
transportés d'une tribu dans une autre, fustigés à
volonté par ordre des magistrats, écartés en même
temps de toutes les fonctions publiques et militaires,
et.relégués souvent dans les tribus les moins honorées. Ceux-là n'étaient pas renvoyés d'une tribu
à une autre, et se voyaient admis, comme tous les
citoyens, au service des légions. De plus, lorsqu'une
déclamation vicieuse ou quelque autre défaut
scénique leur attirait l'improbation des spectateurs,
ils pouvaient .garder leur masque et cacher
ainsi la rougeur de la honte, tandis que les histrions,
obligés de l'ôter quand ils étaient sifflés, perdaient
jusqu'avec faible abri contre la confusion.
Ce qui entraîna encore la réunion de la Satire et
de l'Atellane, c'est la conformité de leur caractère
champêtre. Une grande partie des titres des pièces
Atellanes qui nous restent l'attesteraient au besoin, si nous n'en trouvions un témoignage assez précis
dans ce passage de Varron, " in Atellanis licet.animadvertere
rusticos dicere adduxisse pro scorto
pelliculam". (1)
(1) Varro, de Ling. latin., VII, 84. Cf. Festus, voc. Scortum.
Nous n'osons pas ici nous égarer,
comme Schober dans des conjectures, que
rien n'appuie, sur les plaisanteries champêtres
des anciens Osques, imitées et perfectionnées par
les habitants d'Atella. Nous ne.nous demanderons
pas si, pour ceux-ci, l'intérêt de ces pièces consistait
dans le rapprochement de la vie des champs avec
celle de la ville. Nous croyons qu'il est plus prudent
de n'établir des inductions que d'après les textes
dont nous pouvons disposer. Valère Maxime dit
Atellani ludi ab Oscis acciti sunt quod genus delectationis
Italica severitale temperatum. Ce passage,
en indiquant une transformation des jeux Osques
dès leur introduction à Rome, fait penser aussi que
sur leur sol natal ils avaient été d'une pétulance plus
désordonnée. Peut-être, comme quelques uns l'ont
cru, Valère Maxime veut-il seulement dire que ces
plaisanteries, au lieu de dégénérer en passant à de
vils histrions, gagnèrent quelque considération par
le rang des acteurs qu'elles trouvèrent à Rome. Mais n'est-il pas préférable de s'attacher au sens littëral
du passage et de croire que cet excès de grossière
vivacité, jüstifié d'ailleurs par le caractère
Osque, se modéra réellement sous.la main de ces
jeunes Romains de condition libre à qui échurent
les Atellanes? Nous n'en voudrions pour preuve que
l'éloge accordé par Donat à l'antique élégance de
l'Atellane que cette faveur, qu'elles perdirent
plus tard d'être jetées au milieu d'une pièce comme
un gracieux délassement, et peut-être que ces
maximes de sagesse ou cette grâce que Sénèque et
Marc-Aurèlè étaient heureux de rencontrer dans les
pièces de ce genre: Quoiqu'il en soit, .ce qui reste
certain pour nous c'est que l'Atellarie avait été en
Campanie plus grossière que ce qu'elle était à Rome.
Mais le burlesque; une fois devenu populaire;
sait difficilement s'arrêter; il recule sans cesse ses
limites, et les Atellanes étaient destinées à se modifier
encore; On dirait que cette sévérité Italique,
qui, selon le mot de Valère Maxime, en avait
adouci d'abord l'âpreté, se perdit promptement
avant que les Atellanes ne fussent devenues des
pièces écrites car nous n'en trouvons pas de
traces dans les courts fragments qui nous sont parvenus. Au contraire, on y reconnait facilement que le ridicule se montra de nouveau dans toute sa
grossièreté, et que la moquerie impitoyable et vulgaire
des champs redevint l'élément dominant.
D'ailleurs, le caractère commun de rusticité qui
avait associé la Satire et l'Atellane finit dans la
suite par les confondre entièrement. Nous trouvons
plus tard le mot d'Exodium employé indistinctement
pour celui d'Atellana et des acteurs particuliers
désignés communément par le nom générique
d'exodiarius, jouant les Atellanes à la place de
ces jeunes gens qui en avaient institué l'usage. Ce
retour plus marqué vers l'ancienne licence rustique
des Osques donna, à ce qu'il paraît, une excessive
hardiesse aux pièces Atellanes, et l'on se demande
avec surprise comment, sous la République, on
n'infligea jamais à leur audace le châtiment qui,
par exemple, avait réprimé la tentative de Naevius.
Dans la suite, leur effronterie s'accrut encore, et
l'on n'est plus étonné de voir Diomède, au cinquième
siècle de notre ère, comparer les Atellanes au drame
satyrique des Grecs. A part le costume et les acteurs,
c'étaient le même genre de plaisanteries, la
même scène agreste; depuis longtemps c'étaient une licence et des. obscénités pareilles, et l'on y retrouvait
les mêmes mètres et les mêmes vers.
La place qu'occupaient les Atellanes dans la distribution
des pièces prêtait encore plus à cette ressemblance.
Le drame satyrique chez les Grecs se
jouait après la tragédie, et en faisait reparaître quelques
personnages pour les ridiculiser. Les Atellanes
aussi se montraient après les tragédies graeco-romaines,
afin de distraire par la gaîté des scènes et
des propos le spectateur encore ému de la catastrophe
tragique. Un point encore a une apparence
de conformité. Le drame satyrique faisait emploi
de caractères nobles ou mythologiques placé
après la tragédie, il se servait de ses personnages
pour provoquer le rire à la place des larmes par
une fin joyeuse au lieu d'une péripétie fatale. On
trouve dans la série des Atellanes quelques titres
qui sembleraient rappeler le même emploi de,caractères
nobles et le même but, tels que l'Agamemnon
suppositus, le Marsyas de Pomponius, l'Andromache,
les Phoenissoe de Novius. Mais, sur les cent
six titres de pièces que nous possédons, nous n'avons
que ceux-là qui offrent ici quelque semblant d'analogie, et l'on est porté à croire que c'était
moins là une imitation du drame satyrique que
la copie des tragico-comédies appelées fables Rhynthoniennes.
Là se bornent les rapports des deux genres. Le
fond est complètement différent. Les Atellanes n'avaient
pas coutume de reproduire les personnages
de la pièce qui les avait précédées. Création du sol,
elles avaient leurs caractères à part leurs saillies
particulières, leurs paysans d'une condition inférieure
à ceux du drame satyrique, et, excepté les
titres cités plus haut, leurs sujets étaient toujours
pris dans les rangs obscurs. Le plus grand nombre
des pièces et des fragments comparés indiquent des
Comédies de caractère. Le développement grotesque
des habitudes d'une classe commune de la société
romaine, paraît leur avoir suffi le plus souvent.
Tantôt c'est une profession décriée qu'elles
mettent en scène, comme l'Hetaera de Naevius,
le Leno, le Prostibulum, la Munda, les Aleones de
Pomponius tantôt ce sont les métiers des gens du
peuple, comme le Gardien du temple, les Aruspices,
les Boulangers, les Pêcheurs, les Peintres, les Vendangeurs, les Foulons et les Crieurs publics. Dans
d'autres pièces, c'étaient les coutumes de diverses
contrées qu'on livrait au ridicule ainsi les Campaniens,les Syriens, les Gaulois transalpins et peut-être
les Soldats de Pometia; dans d'autres, des vices
généraux qui sont de toutes les classes, comme l'Avare,
le Méchant, le Solliciteur,l.'Héritier avide ou
des caricatures prises aux champs, telles que le
Rustictis la Porcaria, la Sarcularia, le Verres aegrotus.
Les Atellanes étaient donc surtout des pièces de
caractère, dont les modèles étaient empruntés à la
vie vulgaire. Ce n'est pas qu'on ne trouve çà et là
quelque comédie d'intrigue dans leur répertoire.
Les intrigues des Atellanes avaient même un caractère
particulier elles étaient passées en proverbe,
car Varron dit quelque part « Putas eos
non citius tricas Atellanas quam id extricaturos, »
et Arnobe « Jamdudum me fateor haesitare, circumihiscere,
tricas, quemadmodum dicitur, conduplicare
Atellanas » Ces passages indiquent-ils que le noeud des Atellanes était facile à délier, ou
plutôt qu'il était embarrassé et.sans vraisemblance?
On peut choisir ici entre deux conjectures d'après
la seconde citation, il semblerait que c'était ordinairement
une intrigue confuse et embrouillée, et
la première signifierait que cette intrigue était difficile
à dénouer. D'après la phrase de Varron, on
pourrait aussi bien admettre le sens contraire. Pour
nous, nous pensons que ces pièces mêlées d'improvisation,
où l'art avait une part accessoire, devaient
contenir une intrigue pénible, sans clarté,
et d'autant moins naturelle que ce genre ne leur
était point habituel. Nous adoptons donc la première
version, et nous trouvons dans Quintilien un
passage qui semblerait la fortifier, lorsqu'il recommande
à l'orateur d'éviter ces obscurités qui sont
l'attrait captieux des Atellanes, " illa obscura quae
Atellanae more captent."
Quoi qu'il en soit, le
peu de comédies d'intrigues dont nous croyons posséder
les titres, ne peuvent se comparer à la nomenclature
des autres. On peut tout au plus; à en juger
par les fragments, citer le Praco posterior, et les pièces
à travestissement des Kalendae Martiae des Pannuceati,
du Maccus Virgo, et des Macci Gemini). Ces rares exceptions qui, avec quelques autres,
s'expliquent par les hasards. de l'improvisation et la
liberté même des Atellanes ne doivent pas nous
égarer sur leur nature essentielle. Les Atellanes
sont et restent des Comédies de caractère. C'est ce
que prouvent encore les Masques de caractère qu'elles ont montrés les premières à Rome, et popularisés
jusqu'à nous.
Personnages invariables ou Masques de Caractère.
Diomède a dit " Latinis Atellana a graeca satyrica differt quod in satyrica fere Satyrorum personae inducuntur; in Atellana Oscae personae, ut Maccus." Le Maccus, personnage Osque, comme le dit Diomède, est le premier des masques de caractère de ce théâtre. Il est resté un type comique dont la forme a peu varié. Il représentait ordinaiement un paysan d'Apulie ou de Calabre, maladroit, gourmand, sujet à mille accidents et rompu au métier de dupe. C'est un masque commode qui convenait à toutes les tribulations risibles, et les aùteurs d'Atellanes l'ont fait voir sous plusieurs côtés. Dans les fragments qui nous restent, ils ont fait Maccus tour-à-tour soldat hôtelier, exilé, frère jumeau, médiateur et même jeune fille, sans compter les pièces où il figure en son propre nom, dégagé de tout, accessoire d'emprunt.
 ---Maccus
---Maccus  ---- Pappus
---- Pappus  ---- Bucco
---- Bucco
Ici, dans sa
gaucherie, il se heurte ou se brise les doigts au
seuil de la porte, là, fier soldat, il bataille contre
un camarade pour la conquête d'un souper, ou
prétend manger à lui seul la part de deux personnes. Ailleurs, il se laisse tromper au point de
prendre un homme pour une jeune fille, ou
vient compter à son maître l'argent du fromage de
Sardaigne qu'il a vendu. Presque partout il paie pour autrui; c'est lui qui est puni pour les fautes d'un autre coupable, lui qu'on frappe quand les
autres volent.
Ce sont là les seules scènes que nous laissent entrevoir de trop rares fragments. Ajoutons-y les indications
que fournissent la sculpture et le dessin.
On, croit aujourd'hui que le Maccus paraissait
avec une tête énorme, une grosse bosse ou deux,
et qu'il n'est autre que le Polichinelle Napolitain qui
s'est perpétué jusqu'à nous. Une figurine antique
de bronze nous montre ce long nez en forme de
bec de poulet ou pulcino d'où le personnage moderne
a reçu son nom de pulcinella. Ficoroni nous
en donne dans deux passages une complète description. Il dépeint deux figures: l'une est sans bras,
n'a qu'un petit manteau, et qu'une espèce de
sandales pour chaussures bossue devant, et derrière,
la tête rasée ou plutôt chauve, le nez long
et crochu, l'oreille tendue. L'autre a un ample
manteau, les pieds nus, la tête rasée; un nez recourbé couvre sa bouche et son menton. Ficoroni
conclut que toutes les deux sont les mêmes que
Pulcinella. Assurément c'est bien là le portrait de
Polichinelle, mais on a de bien faibles preuves
pour croire que Polichinelle et Maccus sont la même
chose. Maccus a pris son nom à la Grèce et l'a
laissé en Italie, le niais s'y appelle encore Matto
et Mattaccio. Ce petit manteau de Pulcinella était, nous dit Donat, le costume des esclaves comiques,
et la tête chauve était chez les acteurs mimiques,
le signe de la bêtise, la marque des dupes. Polichinelle a bien dans la farce moderne
le même rôle stupide que le Maccus sur la scène
antique on reconnaît un planipes dans les deux
descriptions que nous avons citées, et ce sont bien
deux masques de la vieille comédie romaine. Mais
d'autres types comiques que nous verrons se distinguaient
aussi par leur stupidité et leurs gaucheries
et d'ailleurs où trouver sûrement dans tout
cela le nom de Maccus?
Le Bucco est aussi un masque de caractère à part
dans les Atellanes. Son nom vient du gonflement
de ses joues, ses grosses lèvres annoncent la sottise.
Il paraît avoir partagé avec le Maccus le sceptre de
la stupidité. Il était particulièrement bavard,
impertinent, vaniteux et sans doute parasite. Il nous reste plusieurs pièces où il a le premier
rôle. Pomponius a écrit le Bucco auctoratus et le
Bucco adoptatus, et Novius nous a. laissé un Bucculo.
Les fragments que nous avons recueillis sont trop
courts pour permettre ici la moindre conjecture.
La seule qui soit vraisemblable sur le nom même
de Bucco, c'est que l'Italie en a gardé le nom de
Buffone, l'homme aux joues enflées, et que notre
mot bouffon paraît n'avoir pas d'autre origine.
Le Bucco et Policliinelle se montrent réunis sur
une même planche de Ficoroni. On voit deux
femmes de profil qui élèvent et montrent chacune
un masque qu'elles tiennent à la main. L'un des
deux masques. est une tête frappante du Polichinelle
moderne l'autre est celle du Bucco. Ficoroni représente
autre part encore un homme assis dont
les joues gonflées et l'énormité de la bouche annoncent
le Bucco. Ce même masque y reparaît fréquemment
ailleurs.
Un troisième personnage de caractère c'est le
Pappus. Celui-ci représentait un vieillard ridicule,
raillé par tout le monde, joué par sa femme,
dupé par des jeunes gens, confondu devant la justice,
trompé dans son ambition, et peut-être passionné pour le vin s'il faut en croire le titre de Hirnea Pappi que porte une Atellane. Pomponius à
écrit plusieurs pièces qui ont le Pappus pour titre,:
telles que le Pappus agricola, la Sponsa Pappi et le
Pappus Praeteritus. Nous avons aussi un Pappus
Praeteritus composé par Novius. Ici, les fragments
moins incomplets des pièces où le Pappus avait, un
rôle, nous permettent de le juger dans des situations
diverses. Soit que, dans le Pappus agricola; il
prête à rire par les perfidies conjugales dont il est
le jouet et par les tempêtes impuissantes de sa
colère soit que, dans les deux Pappus praeteritus,
il invite à des festins intéressés tous ceux
dont il brigue les suffrages, et se voie tristement
repoussé des emplois malgré la vivacité de ses espérances,
malgré les courses forcées que le choix du
peuple a imposées à sa vieillesse soit que, dans
les Pictores, il trébuche de piège en piège et ne
reçoive qu'affronts pour son avarice et que démentis
pour ses mensonges partout le Pappus a pour insigne le ridicule; partout on le reconnaît à
sa vieillesse humiliée ou aux mécomptes de sa cupidité.
Si, dans les Atellanes tous les rôles de
candidats et d'avares n'appartiennent qu'au Pappus,
on peut lui rapporter encore le titre de la pièce du
Marcus et les deux seuls vers qui nous restent de
l'Atellane intitulée Phiilosophia. Peut-être est-ce lui
qui, dans son désespoir d'avoir été dépouillé de
son trésor, va demander au rusé Dossennus de lui
prédire quel est l'auteur du vol peut-être est ce
lui aussi qui, sous la robe blanche du candidat,
vient, dans le Petitor, recevoir des souhaits ironiques
pour le bon succès de sa brigue. Mais, au
milieu de beaucoup d'autres suppositions que nous
omettons, ce ne sont là que des probabilités qu'il
faut se garder d'adopter comme des preuves.
Nous ne pouvons encore qu'essayer des conjéctures
sur certains autres masques de caractère dont les profils se dessinent à peine dans nos fragments.
Ainsi la pièce des l'annuceati, dont nous avons déjà
parlé, pourrait bien avoir eu pour principaux rôles
deux Arlequins, car le mot de Pannuceati, qui vient
de pannus; a la même origine que celui de Panniculus, regardé ordinairement comme l'Arlequin moderne.
On pourrait de la sorte trouver l'Arlequin
dans les Atellanes, sans l'aller chercher dans les
mimes, où l'a classé un peu vaguement le scholiaste
de Martial. Ce qui surtout donnerait du crédit
à cette opinion, c'est l'habitude laissée à Arlequin
seul de ne jamais découvrir son visage nous ne
connaissons pas ses traits; ils sont cachés sous l'immobilité
d'un masque qui est resté en quelque sorte
la figure propre de l'Arlequin moderne et nous
noüs rappelons que ce fut là un des priviléges exclusifs
des acteurs d'Atellanes. Au reste, l'antiquité
dti Panniculus ou Pannuceatus n'est pas douteuse:
Son costume se retrouve fort ressemblant sur un
vase peint découvert à Pompeia; et sa personne
dans Ficoroni où l'on voit une figure, la tête
légèrement inclinée sur une épaule et coiffée du petit chapeau d'Arlequin son allure leste et dégagée,
son maintien léger, et une espèce de batte qu'il
agite dans la main, complètent la ressemblance.
Le Dossennus ou Dorsennus paraît avoir eu aussi
une sorte de caractère à part. Bien que nous n'ayons
qu'une seule pièce qui porte son nom pour titre,
il en est fait mention dans plusieurs fragments et
l'on peut réunir quelques traits principaux de sa
figure. Peut-être son nom lui est-il venu d'une
bosse qui surmontait son dos. Son caractère était
celui d'un savant homme, qui tire l'horoscope aux
ignorants et fait profession de découvrir les plus
mystérieux secrets. Il faisait, à ce qu'il paraît, payer
sa science en bonne monnaie ou en aliments
ou quelquefois converti en maître d'école, il l'enseignait
un peu rudement à ses disciples. C'est
tout ce que nous en savons.
Cette superstition vulgaire, qui faisait recourir les
villageois aux divinations de l'horoscope, et qui est
une marque singulière de l'esprit rustique, devait
être pour l'Atellane un sujet fertile en plaisanteries. On distingue en effet parmi ses acteurs des personnages
effrayants, des espèces de spectres, dont
la voracité fabuleuse où l'horrible pâleur était une
source de terreur comique. Une pièce de Pomponius,
intitulée Pytho Gorgonius, et une note de Scaliger
(1) méritent ici quelque attention. Sélon Scaliger, le Pytho Gorgonius n'était autre que le Manducus,
fantôme aux larges mâchoires (2), aux dents
grinçantes (3), faisant aussi, nous l'avons vu, partie
des cérémonies satyriques des triomphateurs.
C'est lui que Varron place dans les Atellanes (4), et
dont Juvénal effrayait les spectateurs en bas-âge (5).
(1) Scalig. in Varron.. de Ling. Latin.
(2) Festus, voc. Manducus.
(3) Plaut., Rudens,II, vi, 51.
(4) Varro. de Ling. Lat.Cf. Festus voc. Manducus.
(5) Festus, voc. Mania.
Il en faut dire autant de la pièce de Novius, intitulée Maria medica, où probablement la Mania, sorte de spectre aussi, invoqué ordinairement par les nourrices contre l'indocilité des petits-enfants, pilait des médicaments dans un mortier pour guérir sans doute quelque malade. Tels sont à peu près tous les personnages de caractère, tous les masques .particuliers qui ont peu être recueillis des débris du théâtre des Atellanes. On voit qu'ils étaient assez divers pour varier les scènes et l'intérêt, et déjà assez nombreux pour épargner le retour fréquent des mêmes épisodes. On a pensé avec assez de raison que la plupart des autres.personnages perpétués jusqu'à nous par les comédies dites dell'arte des Italiens que le Giangurgolo, par exemple, Pantalon, Brighelle et autres, remontaient par leur origine jusqu'aux Atellanes et aux mimes. Mais, malgré d'ingénieuses tentatives il reste impossible de rattacher précisément chaque rejeton à sa véritable souche. Seülement; en voyant de nos jours les acteurs de la farce italienne improviser une partie de leurs rôles, il est permis de croire que, pareillement dans l'Atellane même quand elle fut écrite, une place était laissée encore à l'essor et aux plaisanteries hasardées de l'improvisation. Les situations et les titres que nous venons de parcourir nous ont appris la plus grande partie des sujets des Atellanes. Il est à remarquer que, parmi eux, il en est qui semblent s'attaquer à des choses morales. La P/ulosophia par exemple, dont nous avons parlé déjà, où le savant Dossennus se pique de ne pas communiquer sa sagesse gratuitement, était sans doute une satire burlesque des travers bourgeois de la philosophie. D'autres titres encore, mais très rares, annoncent que l'Atellane, comme la flamme qui ne discerne pas ce qu'elle brûle, touchait quelquefois à des points généraux à des principes, à des institutions, et pénétrait jusqu'au foyer sacré de la famille. Le Lar familiaris, le Patruus, les Nuptiae et sans doute les Synephebi, paraissent avoir été de malins tableaux d'intérieur, qui ridiculisaient autre chose que la vie du village et les moeurs des artisans, 'de même que les Malevoli étaient une critique d'une des faiblesses les plus communes du genre humain. Le Fatum, si vénéré par l'opinion était bafoué dans les Atellanes (1) le Praefectus morum et le Vitae et mortis judïclutn embrassaient les plus graves sujets.
(1) Cicer., de Diviri.,II, 10.
Cette dernière pièce, qu'on est étonné de voir au nombre des Atellanes,.est encore remarquable parce qu'elle porte le même titre qu'une satire où Ennius, nous dit Quintilien (1), mettait aux prises la vie et la mort. Ici l'Atellane n'était probablement qu'une imitation dramatique de la satire d'autrefois, et se retrouvait ainsi dans sa véritable condition primitive. Trois autres Atellanes d'ailleurs la Satira, l'Exodium, le Funus (2), attestent que l'Atellane n'avait pas oublié son origine et que par une pente toute naturelle, les jeux satiriques ou exodia, passant du second rang qu'ils occupaient jadis au premier, devenaient souvent l'Atellane même.
(1) Inst. orat., ix, 2.
(2) Peut-être cette pièce n'est-elle point de Novius. Merula (Ann. Ennil, p. 418) l'attribue à Naevius
Les Atellanes sous César et sous les Empereurs.
L'Atellane, qui avait des théâtres au dehors aussi bien qu'à Rome (1), prenait aussi parfois un caractère personnel et signalait des noms propres.
(1) Cicer. ad Famil., VII, 1. Juven., Sat. III175.
Cette liberté qui n'était que la conséquence de
toutes celles dont elle usait, paraît avoir été pour
elle un motif de défaveur sous César. Ennemi comme
il l'était de toute insinuation indirecte et de
toute critique personnelle, César dictateur, dont le
goût était une autorité et la volonté une loi César qui, sur la scène, préférait les maximes générales
de Syrus, aux courageux reproches de Laberius,
fut sans doute la cause du décri où, en 708,
était tombée la farce de l'Atellane. Cicéron,.qui est
dans ses Lettres l'interprète expressif des opinions
du moment, nous apprend que les Mimes furent
ajoutés aux pièces sérieuses à la place de l'Atellane
(1), et les termes qu'il ajoute marquent assez
le mépris qu'on faisait alors des hardiesses de celle-ci.
Ce n'est pas que César eût supprimé complètement
les jeux Osques, car Suétone mentionne
qu'il appela des comédiens de tous les pays, et
donna des représentations dans toutes les langues
(2)
(1) Cicer. ad. Fam. IX, 16.
(2) J. Caesar, cap. 39.
Mais c'était là, dans un but politique sans
doute, une condescendance d'un moment il voulait,
après les guerres civiles, convier à Rome même,
au spectacle de ses fêtes, toutes les nations qui
composaient l'empire; tandis que le passage de Cicéron
ne prouve pas moins que l'Atellane était ordinairement
en défaveur. Auguste qui, pour se rendre
populaire, voulait relever tout ce que César
avait abaissé, et qui encourageait sans distinction
tous les théâtres de son habile bienfaisance,
favorisa sans doute le retour des Atellanes à leur vogue. première, car elles atteignirent alors à une
puissance qu'elles n'avaient pas connue jusque-là.
Les Atellanes, soit qu'elles voulussent se venger de
leur longue oppression, soit qu'elles tendissent à
accroître leur importance, portèrent, sous les successeurs
d'Auguste, l'audace à ses dernières limites,
et leur caractère changea comme les moeurs publiques.
Leur satire devint politique, cruelle, implacable
et ne craignit pas de remonter jusqu'à.l'empereur.
Elle désignait, avec une crudité d'expressions
qu'on couvrait d'applaudissements, les crimes
et les voluptés infâmes de Tibère. Elle irritait
Caligula par les équivoques transparentes de son ironie.
Un acteur d'Atellanes était brûlé en plein amphithéâtre,
par ordre de l'empereur, pour un vers
méchant. Ce châtiment inouï qui est déja bien
loin de la tolérance républicaine des dédains de
César et des ménagements d'Auguste, ne peut s'expliquer
en partie que par l'âcreté croissante de la
raillerie des Atellanes. Il ne trouva de compensation
que dans un moment de clémence de Néron. Celui-ci
se contenta de chasser de Rome l'histrion Datus
qui, dans une Atellane, avait rappelé par des gestes
satiriques deux crimes de l'empereur, et fait une terrible allusion au sénat. Les Atellanes apprirent à Galba son impopularité, dès son arrivée à
Rome, par un chant si applaudi et si connu que la
foule transportée l'acheva d'une voix unanime,
Enfin Domitien fut aussi cruel dans sa vengeance
que Caligula car il fit mourir le fils d'Helvidius pour
avoir eu l'audace de faire allusion, dans un
exode, au divorce impérial.
Deux de ces témoignages dénotent dans la représentation
des Atellanes quelques usages que nous
n'avions pas tus précédemment. Datus l'histrion
chante dans l'Atellane des vers grecs et c'est un
refrain déjà connu qu'entonne un acteur d'Atellanes
pour exprimer le dégoût produit par l'arrivé
de Galba. Ces changements, auxquels les fragments
de l'Atellane sous la république n'offrent rien de
pareil, peuvent s'expliquer assez facilement. L'imitation
des Grecs qui avait jeté tant d'éclat sur le
règne d'Auguste avait plus que jamais familiarisé
avec leur langue tous les genres de littérature,est ;il
n'est pas surprenant que les Atellanes aient en cela
obéi quelquefois, comme ici,.au goût général qui les
soutenait de plus en plus. Cet autre refrain connu :Venit, io, simus a villa; qui fut le chant de réception de Galba, est une preuve de plus de la vogue
dont ces pièces jouissaient alors. Leurs allusions,
aussi hardies que l'empereur était odieux, étaient
l'expression véritable du sentiment populaire.
Malgré les efforts de Tibère malgré leur exil
momentané (1), elles avaient résisté à la destruction
et retrouvé par la persécution une verve plus
libre encore.
(1) Tacit. Ann., iv, 14.
Doit-on s'étonner que restées, comme
le théâtre en général, le refuge et l'organe de la
haine du peuple; elles aient emprunté, pour l'exprimer, les.refrains mêmes que le peuple répétait?
Cet emploi passager de vers grecs ou de chansons
familières laissa néanmoins intact le cachet primitif
et original de ce genre de littérature. Alors et plus
tard les Atellanes demeuraient les dépositaires de la
vieille langue nationale et indigène. Elles avaient
conservé cette fleur native du sol latin qui ailleurs,
s'était fanée sous des ornements d'emprunt et dont
Lucrèce et Catulle, à peu près seuls dans la poésie,
avaient sauvé la fraîcheur et gardé le vrai parfum.
Dans la décadence des lettres latines et même
du succès théâtral des Atellanes c'est là l'attrait
nouveau, l'ascendant que celles-ci gagneront, non
plus sur la foule, mais sur quelques hommes d'étude
qui fatigués du faux goût de l'époque, de l'épuisement
de la langue, voudront se retremper à sa source. Dans Pétrone déjà, Trimalcion témoigne
de ce retour vers le vieux langage latin lorsque,
devant ses convives, il se vante d'avoir acheté des
histrions qui ne représenteront que des Atellanes et
un choeur qui chantera en latin. Ainsi, aux premiers siècles du christianisme, les baladins d'Atellanes
peuvent être réduits à figurer à la table d'un
empereur Antonin peut, en plein théâtre, apprendre
son déshonneur de la bouche d'un bouffon.Tertullien, dépeindre avec une sainte horreur
les impudicités de la scène des Atellanes (1) et Arnobe, à son tour, nous montrer ces acteurs
chauves et imbéciles, ces bruyants applaudissement,
ces propos, ces gestes obscènes il peut demander
avec un accent douloureux si ces comédies,
ces mimes, ces Atellanes, si tous ces vils plaisirs
sauraient être jamais les voluptés des dieux
rien dans cet emportement éloquent du chrétien
dans cette décadence de l'art des Atellanes ne doit
nous étonner.
(1) Tertull. de Spectacul.,17.
Outre la juste indignation du culte
nouveau, outre plusieurs causes indépendantes des
Atellanes, la nature même de ces pièces contenait
le germe de leur abaissement. Leur pétulance indécente, leur liberté si peu inquiétée à l'origine leur audace cmellement, mais rarement châtiée
dans la suite, devaient les entraîner hors de
toutes les bornes. Il n'est pas donné à la licence de
s'arrêter elle passe nécessairement de l'usage à
l'excès et se perd par l'abus. Mais le privilège qui
distingué alors les Atellanes, c'est de rester encore une curiosité littéraire pour quelques rares esprits, studieux des origines latines; c'est, par exemple, d'être avec tous les grands écrivains de la Rome
antique, l'étude que sans cesse Fronton recommande
à Marc-Aurële celle que Marc- Aurèle entoure
de toutes ses préférences. Tantôt le noble
élève écrit à son précepteur qu'il passe les nuits à
l'étude et le jour au théâtre, et qu'il a fait les extraits de soixante volumes au nombre desquels sont
les Atellànes tantôt c'est le maître qui vante à
son disciple les pensées riantes et fines qu'il pourra y puiser. Ailleurs enfin il surprend encore
le goût marqué de l'empereur pour cette sorte de
poètes comiques et l'on conclut que ce mérite
de langage, que ces succès de cabinet, sont la véritable
et dernière originalité des Atellanes.
De la langue Osque dans les Atellanes.
Ici se présente une grave question qu'on a diversement
posée et péniblement résolue. Les Atellanes
furent-elles écrites en langue latine ou en langue
osque? Strabon en affirmant que, de son temps,
les Atellanes se servaient de la langue osque, a
créé la difficulté et fait naître les objections. On a
demandé comment ce dialecte usité seulement
dans les Atellanes, pouvait être intelligible à. tous
les Romains, surtout au moment du plus haut perfectionnement
des lettres latines lorsque Strabon
écrivait.
Si l'on suppose un instant que l'Osque offrait de
grandes affinités avec le Latin, cette hypothèse s'évanouit
devant tout ce que les grammairiens et divers passages nous ont appris de cette langue.
Un consul romain, nous dit Tite-Live, avait des
espions particuliers parlant la langue osque, et
nous savons par un vers de Titinius que ceux qui
parlaient l'osque pouvaient ignorer le latin. Ennius
prétendait qu'il avait le coeur triple parce qu'il
savait les trois langues grecque, osque, latine, et Macrobe sépare les termes osques et puniques de
ceux de la langue ordinaire. D'ailleurs, dans
tous les fragments d'Atellanes que nous possédons,
on ne suprend pas la moindre trace de l'osque,
et, pour appuyer les mots de ce dialecte,
toujours les citations et les grammairiens désignent
les poètes latins Ennius, Pacuvius,. jamais les Atellanes.
Que Varron nous dise que Pappus le vieillard
est nommé Casais, parce que les Osques disaient
Casriar pour Senex que Festus assure que
les Osques appellent le dieu Mars Mamrrs (1) nous
n'en rencontrons pas moins toujours, au lieu de
Mamers et de Casnar, les mots vulgairement usités
de Pappus et de Mars, dans les fragments qui sont
restés (2).
(1) Festus, voc. Mars. D'après Varron L. L. iv, Mames était le nom de Mars chez les Sabins.
(2) Il n'est pas fait une seule fois mention des Atellanes dans les Rtudimenta linguae Oscae (|in-4°, Hanov. 1839) de Grotefend. Il a cependant traité la question du langage à fond et discuté longuement sur les deux principaux monuments qui nous sont parvenus de cet idiome curieux.
Ces arguments frappent d'abord par leur gravité
et semblent compliquer le problème. Les uns, pour
le résoudre, ont supposé que le mot osque, employé
par Strabon signifiait ici obscéne, acception qu'il
a en effet souvent; d'autres que Strabon prenait
le nom originaire de ces jeux pour celui de la langue, qu'on y parlait. Enfin Schober a aggravé
la difficulté en substituant, de sa pleine autorité
des campagnards de la Sabine à des paysans Osques,
uniquement parce que Varron a dit que la
langue des Sabins avait ses racines dans le dialecte
osque. Il n'est pas impossible cependant, en
s'attachant à la vraisemblance, de conserver le sens
littéral du passage et de rendre plausible l'assertion
de Strabon. Lorsqu'il dit que le dialecte d'Atella
subsiste encore de son temps à. Rome, son
témoignage se confirme à peu près par ceux de
quelques autres car Suétone dit expressément que
les théâtres de toutes les langues furent protégés
par Auguste et Horace dans son dédain pour
les sauvages beautés du vieux Latium, se plaint
que son siècle garde encore les restes de l'antique
poésie des champs. Strabon ne dit pas que toute
la pièce fut écrite en langue osque, et d'ailleurs
tous nos fragments seraient contraires à cette version
mais il faut même supposer que plus de débris
écrits des Atellahes ne nous révéleraient pas
plus de traces de langage osque. Car tout fait croire
que ce dialecte n'était en usage que dans les improvisations
de ce théâtre, sans doute, aussi ancien qu'elles l'Osque sera resté leur partage unique,
comme un souvenir de l'origine campanienne
de l'Atellane. Peut-rêtre cet idiome était-il mêlé
au. latin dans certaines parties improvisées, de la
pièce mais le Maccus principalement s'il faut en
croire M. Leclerc, paraît avoir parlé l'Osque,
probablement parce que, complètement originaire
d'Atella le trait distinctif de son rôle était d'en reproduire
plus spécialement l'improvisation et le langage. Ces conjectures, en respectant le texte de
Strabon, serviraient à tout concilier. Elles expliqueraient
en même temps l'existence de nos fragments
entièrement latins, l'assertion de Varron et
de Festus, et le silence des grammairiens sur les
Atellanes, toutes les fois qu'ils parlent des monuments
écrits de la langue des Osques.
.La dernière objection au sujet de la difficulté
pour les spectateurs de comprendre ce dialecte peut
être facilement renversée. D'abord les passages cités
plus haut d'Ennius et deTite-Live indiquent
qu'aux premiers siècles de Rome, l'usage de l'osque
était quelque peu répandu.; ensuite, qui empêche
d'admettre que le Maccus, par exemple, ait
parlé dans un langage presque inintelligible? Si, comme le pense, M. Leclerc, les autres acteurs, lui
répondaient en latin, cette réponse comprise d'un
interlocuteur devait aider à éclaircir l'obscure volubilité de l'autre. La sagacité du spectateur eût
cherché ainsi à deviner l'énigme, et son intérêt
était captivé. Mais on peut pousser la supposition
plus loin et croire que le Maccus, avec tous ses avantages avec des intonations fausses et. bizarres, plaisait et amusait même sans être compris dans son
bavardage. Le Polichinelle de nos jours, dont
le bredouillement nasillard est la voix enrouée ne
sont d'aucune langue, est-il moins goûté de la foule
pour n'être pas entendu ou plutôt son jargon guttural
et insignifiant n'est-il pas encore un attrait de
plus aux yeux des enfants et des gens du peuple.
Dans le théâtre de Ghérardi, dans les intermèdes des pièces de Molière, l'italien, le latin, sont
mêlés au français et n'étaient guère plus compris
des spectateurs qu'ils: piquaient cependant par leur étrangeté même.
Des Auteurs d'Atellanes.
Aucun écrivain ne cite en général d'auteurs d'Atellanes
avant Pomponius et Novius. La chronique d'Eusèbe nous apprend que Pomponins vivait en 663
de Rome et y avait un nom célèbre alors. On
peut conclure de l'absence de toute mention pareille
avant cette date, que jusque là les Atellanes avaient
été entièrement improvisées. Ce mélange primitif
du libre désordre de la satire et du thème dramatique
emprunté aux Osques, qui avait pris le nom
d'Atellanes, avait pu suffire longtemps à l'expression
triviale des moeurs de la Campanie, au sel
grossier des plaisanteries rustiques. Mais lorsqu'un
plus long séjour au sein de Rome policée eut familiarisé
ce théâtre inculte avec le goût de la civilisation
et avec les habitudes de la comédie graeco-latine
de Plante lorsque, pour renouveler une partie
de leur vogue qui s'épuisait, les Atellanes eurent
besoin de recourir à d'autres sujets connus et
aimés du bas-peuple; alors vint sans doute Pornponius
qui essaya d'en ranimer l'intérêt en mêlant aux.
personnages rustiques primitifs des professions de
la ville des épisodes de la vie des classes inférieures
de Rome, et captiva la populace par des tableaux
pris au milieu d'elle-même. Cette innovation qui
introduisait une série de sujets nouveaux qui modifiait
profondément les usages de ce théâtre et n'avait
pour elle, comme Atella,. ni l'autorité des
moeurs natales, ni celle de la tradition mais le talent ou le génie d'un seul écrivain, ne pouvait se
transmettre que par des oeuvres écrites à des acteurs
qui, certainement alors déjà, étaient une troupe
d'histrions.
Pomponius écrivit donc ses pièces, en réservant
toutefois les masques de caractère et une partie de
l'improvisation antique. Il y sema des maximes
nombreuses, et pour laisser aux Atellanes nouvelles
l'originalité des anciennes autant que pour être goûté
du bas-peuple qui venait l'écouter, il garda la rudesse du langage et sut maintenir la vétusté du latin
primitif, au milieu des raffinements grecs qui le
transformaient de toutes parts. Velleius Paterculus,
dans une phrase concise résume toutes ces qualités
et recommande le talent d'invention de Pomponius. Outre le mérite d'avoir traité des sujets
nouveaux, il se peut que,Pomponius ait eu celui
de créer d'heureuses expressions, car Macrobe nous
apprend qu'Afranius et Cornificius lui en dérobaient
quelquefois et que Virgile en déguisait l'emprunt
par une application nouvelle (1).
(1) Voir Macrob., Sat. VI, 4, au sujet du mot deductum.
Les pieds de trois
syllabes, le tribraque surtout, furent introduits
peut-être par lui dans les vers de l'Atellane les tétramètres catalectiques y furent employés plus souvent
encore. Les débris qui nous restent en
fournissent de nombreux exemples. Nous avons
soixante-quatre titres de pièces que composa Pomponius. Comparé aux autres qui nous restent, ce
nombre qui leur est supérieur, décèle dans Pomponius
une prodigieuse fécondité d'esprit. On peut
remarquer de plus qu'il était de Bologne, le berceau
du Docteur actuel de la farce italienne, et que plusieurs de ses créations dramatiques ont pu être inspirées
par les jeux scéniques de sa patrie.
Nous n'avons pas autant de détails sur Novius,
autre écrivain d'Atellanes. Les conjectures de la
plupart des commentateurs le font contemporain de
.Pomponius,et deux passages de Macrobe, oû Novius
est nommé avant Pomponius pourraient faire
croire que celui-ci a suivi l'autre, s'ils n'étaient formellement
contredits par la précision du témoignage
de Velleius. Il est possible de faire accorder entr'elles
les assertions des deux écrivains en admettant
que Novius, quoique du même temps que Pomponius,
n'écrivit qu'après lui des Atellanes. Macrobe
cite Novius comme un écrivain fort estimé, et nous découvrons dans la correspondance de Fronton
et de Marc-Aurèle que celui-ci avait conçu un
goût tout particulier pour les petites Atellanes (atellaniolae) de Novius. Les titres des pièces de
Novius parvenues jusqu'à nous sont au nombre de
quarante et un. Dans les vers qui nous restent de lui
nous retrouvons l'emploi du même mètre que nous
avons d'après nos fragments, signalé dans Pomponius.
Enfin le passage cité de Macrobe prouverait
que cet écrivain s'était élevé à une renommée
peut-être aussi haute que son contemporain. C'est
là, avec une mention humiliante de Tertullien,
tout ce que nous savons de Novius.
Après Novius, l'éclat des Atellanes se perdit ;
il resta longtemps éclipsé par celui des Mimes et des
Pantomimes; il ne reparut dans la suite qu'avec
Caïus Memmius, le dernier écrivain d'Atellanes connu.
Nous sommes sans renseignements sur l'existence
de ce Memmius on Mummius; mais il résulte
certainement, des succès que l'Atellane reconquit
sous les empereurs, la présomption que c'est sous
les premiers d'entre eux, sous Auguste peut-être,
quevécut Memmius. Nous n'avons que le titre d'une
seule de ses pièces et trois fragments sans importance.
Son autorité est rarement invoquée par les grammairiens Nonius même l'a regardée
comme douteuse.
Tels sont l'origine, le caractère, les personnages
et les auteurs de la scène des Atellanes. Ses vicissitudes,
dont le manque de pièces entières nous dérobe
la plus grande partie, ont été montrées dans
leurs phases principales, et quelquefois rétablies
par la conjecture. Comme tous les jeux destinés
aux plaisirs des classes inférieures, elle subit le sort
ou les caprices de l'esprit populaire. Grossière d'abord
comme les premiers siècles de Rome, puis
variant ses tableaux et ses personnages au moment
où Rome modifiait sa littérature et sa constitution,
où Sylla, renonçant à la dictature, s'essayait à des
compositions du genre de l'Atellane, elle est à peine
nommée au milieu des troubles civils qui vont ensanglanter la république. Le peuple a des intérêts
trop chers, trop puissants à défendre, pour songer
aux divertissements du théâtre; César est un maître
trop habile et trop ombrageux pour protéger la liberté
du drame plébéien. Ranimée sous les premiers
empereurs, effroi des oppresseurs, divertissement
et vengeance des opprimés, l'Atellane plus tard, perdue par ses propres excès; effacée par la
vogue des mimes sous les Antonins, n'est plus
qu'une curiosité de cabinet pour quelques uns, un
sujet de blàme et d'imprécations dans la bouche
des premiers Chrétiens. Il n'en pouvait guères
être autrement. Les vertus des nouveaux
empereur, en désarmant la satire politique; étaient
aux Atellanes leur attrait le plus populaire. Le goût
et la langue des Grecs, répandus partout, rendaient
plus indifférent aux créations du vieux génie latin.
Les règnes, courts et sanglants de quelques princes
laissaient.à peine aux haines personnelles le temps
de se former les uns, par l'empire de la force brutale
sans le mélange des goûts littéraires des premiers
Césars; les autres, par leur origine étrangère
ou barbare, étaient un obstacle à l'essor de l'esprit
indigène. Le christianisme enfin, venant régénérer
le monde et substituer la pureté et la vraie grandeur
à toutes les corruptions du monde païen, devait,
comme il l'a fait, flétrir et rabaisser encore
cette littérature qui avait à peu près suivi la décadence
du paganisme. Après tant de causes, ce sont
les mépris de la chaire chrétienne, les tendances épurées de tous les esprits, qui ont fait oublier ces
oeuvres, curieuses jusque dans leur dépérissement,
où le bon sens populaire tenait encore plus de place
que l'art, et ont ainsi contribuéà les empêcher d'arriver
intactes jusqu'à nous. Il faut éternellement regretter,
comme une lacune pour les lettres, cette
mutilation et cette perte des monuments d'une partie
intéressante et presque ignorée du monde ancien.
LES PARASITES.
La flatterie n'a pas encore trouvé son historien. Il
y aurait cependant un livre curieux à écrire, non
pas à la façon de La Bruyère ou de Lucien, sur les
travers et la perversité des flatteurs mais une simple
histoire de chacun d'eux, avec leur origine, leurs
oeuvres, leurs vicissitudes et leur fin. Je n'y voudrais
pas le moindre commentaire aucune tirade sur la
morale rien de blessant pour l'écrivain mais un
tableau fidèle et surtout minutieux où chaque fait
serait soigneusement mis en lumière, chaque parole
rapportée. J'estime que ce serait là un livre instructif
et dont chacun tirerait parfaitement son profit
personnel, sans que la moralité se lise au bout du
récit. Quel tableau si l'on y songe, et quel traité
de philosophie que celui où Pindare figurerait à côté
de Dangeau, et Cherile, le flatteur d'Alexandre, au près de Tristan l'Hermite! Tout le soin de l'auteur
consisterait, dans une oeuvre pareille, à ne raconter
que ce qui touche à la flatterie et à ne pas confondre
avec elle ce qui naît d'une admiration sincère
ou d'un dévouaient senti; à bien distinguer par
exemple, dans Bossuet, l'auteur des Oraisons funèbres
de l'historien des Variations, et à démêler dans
la vie de Voltaire ce qui fut du courtisan et ce qui
vint de l'indépendance. J'imagine que rien ne nous
apprendrait mieux le secret de bien des grandeurs
et la disgrâce de bien des vertus. On pourrait se consoler
là, en voyant tomber les masques, d'être resté
obscur, mais fier; on ne s'en obstinerait que mieux,
je .pense, dans son goût de l'oubli et de l'indépendance,
et, tout en reconnaissant, à chaque page, la
vérité du nil mirari , d'Horace on finirait par
s'admirer soi-même un peu plus complaisamment.
Je sais bien qu'un tel livre pourrait mener à une
fin contraire et allécher à la flatterie par le récit du succès des
flatteurs. Mais je voudrais que l'art de
l'écrivain s'appliquât à mettre à nu, sans cesser
d'être impartial les ressorts les plus secrets du
courtisan et fît en quelque sorte l'ariatomie de ses
moindres actions, de manière à. nous attacher
plutôt à tous ses mouvements qu'à. ses fins. J'ai
d'ailleurs encore assez bonne opinion des hommes
pour croire que, dans un tableau ainsi fait, c'est
le fond plutôt que le relief qui les frapperait, et.que
la plupart verraient dans l'équitable sagacité du narrateur moins une apologie qu'une profonde satire.
Or, rien chez nous ne démonétise le vice
comme la satire, et, dans une histoire pareille,
l'exactitude aurait chance de tourner au profit de
la morale. Pour cela une dernière condition serait
indispensable; c'est que les flatteurs de tous les genres
y eussent leur place. Flatteurs de cour, flatteurs
d'église; de bas et de haut étage, courtisans de la
bourgeoisie et de la milice; flagorneurs de la maison
et de la rue, tout devra entrer dans cette galerie,
depuis ce complaisant des Caractères de Thèophraste,
qui affecte d'apercevoir le moindre duvet attaché au
vêtement de son patron, pour le prendre et le souffler
à terre, jusqu'à ce prédicateur qui ayant dit devant
Louis XIV " sire nous mourons tous," s'empressa
d'ajouter " ou du moins presque tous " en voyant le
roi froncer le sourcil.
La comédie ancienne prêterait bien des épisodes
à un tel livre. Elle a un flatteur presque obligé dans
la plupart de ses pièces. C'est le Parasite. C'est un des
masques de caractère les plus vieux et les plus
originaux de l'antique théâtre. Il mérite d'être étudié
dans tous ses traits et ses transformations diverses.
A quelques égards; cette étude sera presqu'une
restimtion, car le Parasite, tel qu'il fut autrefois, a
disparu du théâtre moderne.
Les origines de la flatterie sont nobles. On flatta d'abord
par conviction. L'amitié la plus désintéressée faisait un courtisan. Patrocle, que, dans son ingénieux paradoxe sur les Parasites, Lucien appelle
le flatteur d'Achille, Patrocle eut le dévoûment sans
la bassesse il sanctifia la flatterie. Les Parasites,
ceux qui courtisaient à table, ont une origine encore
plus haute. Polémon, le Périégète sans doute,
nous dit que les Parasites étaient jadis des hommes
attachés à la plupart des temples pour y prendre
solennellement leur part des sacrifices offerts aux
Dieux. Ils se nourrissaient des viandes sacrées.
Quelquefois leurs fonctions duraient un an, comme
pour ceux qu'une inscription, citée par Athénée, appelait
au temple de Délos (1). Ils devaient avoir parmi
eux un père et un fils bâtards, d'après les termes
d'un décret d'Alcibiade inscrit au temple d'Hercule
(2).
(1) Criton, dans sa comédie du Curieux, appelle les habitants de Délos Parasites du dieu de leur pays. Délos passait pour la terre promise, le plus heureux séjour des Parasites, parce qu'elle réunissait trois avantages précieux pour ces gourmets, un marché bien fourni, des habitants nombreux venus de tous pays, et les Déliens Parasites eux-mêmes du dieu Apollon, c'est-à-dire sans doute habitués à la bonne chère et aux festins gratuits. Le rapport entre les deux sortes de Parasites est déjà évident ici.
(2) Tout ce livre VI est rempli des plus curieux détails sur l'origine et les diverses attributions des Parasites primitifs.
Je ne sais s'il faut voir dans cette singulière
prescription un hommage rendu à Hercule, né,
comme on le sait, d'un dieu et d'une mortelle, car
les Athéniens appelaient aussi bâtards les enfants
issus d'une mère étrangère ou d'un père étranger,
quoique légitimement mariés. Mais je reconnaîtrais
là plutôt une marque de la bassesse prochaine des parasites, un mélange de noblesse et d'abjection,
d'où la noblesse se retirera peu à peu pour ne laisser
plus tard que l'abjection. Quand Plutarque nous
dit que Solon; auteur d'une loi sur les parasites, établit
une amende contre ceux d'entre eux qui refuseraient
de se rendre au temple, j'ai peine à me
figurer que tous vissent encore dans ces fonctions
ce qu'elles avaient de digne et d'honorable et je
prévois qu'elles dégénéreront. Je sais bien qu'on
nous cite des parasites de noble origine, choisis pour
Délos que, par un décret gravé dans le temple des
Dioscures, ils recevaient un tiers des sacrifices les
plus riches et que la loi royale pourvoyait à leur élection. Mais ces coutumes, conformes à la sainteté
de l'institution, ne contredisent pas ce qui a été dit:
Le blé sacré leur était aussi confié. Ils en gardaient
une portion pour eux, donnant le meilleur
à'l'autel. Ce blé était enfermé dans le Parasition,
espèce de demeure qui leur, était destinée et qui portait
leur nom. Comme on voit, là encore je retrouve
le prêtre et le mendiant dans le même homme
car, d'après un passage d'Aristote dont parle
Athénée, il est dit qu'ils recevaient de toutes mains et
avaient même leur part du poisson des pêcheurs. Le mélange du temporel et du sacré tourne toujours
tôt ou tard au détriment de celui-ci. Les parasites
ne devaient pas tarder à déchoir dans l'opinon
publique.
La première pièce écrite par Aristophane portait
un nom cher aux Parasites C'était les Détaliens ou
Convives. Un choeur de Parasites y paraissait probablement,
comme on le vit encore dans d'autres
comédies. C'est alors seulement, au moment
de la réâction contre les désordres de la société, que
le nom de parasite figure sur la scène comique.
Ararus, fils d'Aristophane, s'en servit, dit-on, le
premier. Mais le personnage est antérieur, comme
nous venons de le voir, et cela devait être. Entre
le convive du dieu et le convive du bout de la table
la distance était grande. Pour que le poète satirique
se permît de les appeler l'un et l'autre d'un nom
commun, il fallait que l'homme sacré prît le temps
de déchoir peu à peu et, à force de retourner à la
table du riche, tombât décidément du premier rang
dans l'avilissement du dernier. Ainsi Epicharme
avait dépeint dans ses comédies le commensal mendiant
du festin des grands avant qu'on eût déterminé
son nom caractéristique. Dans son Plutus,
par exemple, dit Athénée, nous en avons un, qui va
dîner même là où il. n'est pas invité et qui pousse.la complaisance pour lè maître jusqu'à se fâcher pour
lui contre ceux qui osent le contredire.
On le voit les moeurs de la Grèce primitive
avaient bien dégénéré. Homère avait désigné à
peu près quels étaient les convives qui pouvaient
se passer d'invitation c'étaient les parents les plus
proches, comme Ménélas à la table d'Agamemnon,
ou les amis les plus considérables. Le proverbe
grec disait « les bons vont au repas des bons,
sans y être conviés. » Au cinquième siècle avant
J.. C. le premier venu se glissait sans honte au milieu
d'une foule d'invités et, moyenant quelqu'argent,
gagnait l'esclave Nonzecaclceiécer, chargé de désigner les convives à l'amphitryon ou de les distribuer
dans leurs places respectives. Le théâtre avait
saisi, au milieu de sa gaieté d'emprunt et de ses cajoleries
originales, la figure du parasite, et en avait consacré
le type. Les parasites des dieux que la comédie
n'aurait pas osé toucher d'abord, une fois changés en
flatteurs de l'opulence, devinrent pour la scène une mine féconde, excellente, et gagnèrent une popularité dont les Latins se souvinrent
Diodore de Sinope,.dans son Epiclere,a eu soin de
nous expliquer comment s'était opérée la transition
du sacré au profane. "Notre ville honorant Hercule
avec éclat institua des sacrifices dans tous les dêmes.
En donnant à ce Dieu des Parasites à cet effet, elle
ne les à jamais tirés au sort, ni pris au hasard. Elle
a choisi au contraire avec soin douze citoyens parmi
les plus puissants, hommes riches et d'une vie
pure. Plus tard quelques citoyens considérables
à l'imitation de ce qui s'était fait pour Hercule
choisirent des parasites pour les nourrir, invitèrent
non pas les plus aimables, mais les plus flatteurs et
s'entourèrent des plus plats courtisans".
Le nombre des parasites de la ville ne tarda pas
à grossir et à se faire un nom. On citait les plus fameux
chacun d'eux avait sa manie et sa réputation
particulières: Chéréphon; par exemple, un des plus
célèbres; mérite d'être noté. Plein de ruse et d'audace,
il errait toujours aux environs des cuisines, s'informant des noms des convives et entrant tout
le premier dans la salle à manger par la porte entrebaillée.
Alexis, dans sa comédie des Mourants ensemble,
nous dit que franchir les mers coûtait peu à
Chéréphon pour jouir d'une bonne table. Il allait
sans hésiter d'Athènes à Corinthe pour goûter d'un
fin repas, comme cet Archéphon, qui invité par
Ptolémée à venir souper avec lui, se rendit par mer
de l'Attique en Egypte, s'il en faut croire Machon .le
comique. Chéréphon se.permettait tout alors.
Il tournait en tout sens sur le plat du milieu les
viandes avant qu'elles ne fussent servies, afin d'en reconnaître
la qualité, et en cachait souvent une partie
sous sa main pour l'emporter et en faire mystérieusement
un deuxième repas chez lui. Menandre
,a parlé de Chéréphon dans beaucoup de ses pièces.
Le poète Timoclès lui attribue un caractère peu
ordinaire aux gens de son espèce; c'est qu'il n'était
pas pauvre et ne se montrait pas toujours fort accommodant, malgré cette maxime de Diphile,
dans son Parasite, qu'il ne faut pas qu'un parasite
soit trop morose. C'était là une particularité pour
un homme qui ne mendiait que des dîners gratuits.
Car il y avait une sorte de parasites qui se contentaient
de rechercher la table d'autrui, mais en y
apportant leur part ou en la payant au patron. On les appelait parasites Autosites. La comédie n'a pas
manqué de les reproduire.
Notre homme n'etait pas si généreux. Même les
jours de fête de quelque déesse, il ne pouvait les
passer tout entiers chez lui à l'honorer. Il s'empressait
de s'inviter ailleurs. C'est ainsi qu'il avait
su, un jour, s'introduire aux noces d'Ophella. Un
panier et une couronne à la main, comme il faisait
nuit,.il vint en disant qu'il apportait des oiseaux de
la part de la mariée. Il dut un souper à cette arrivée
inattendue. Rien n'était inaccessible à cette
gent curieuse et conteuse. Le gynécée même leur
était ouvert. Mais Chéréphon ne se borna pas
à pratiquer son art. Il écrivit un traité sur les repas.
Callimaque a conservé quelques mots du début.
Enfin il manquait à sa renommée une dernière consécration,
celle d'apparaître en personne sur le théâtre.
Nicostrate la lui a donnée en faisant de Chéréphon
un personnage de sa comédie de l'Usurier. Qu'on ne s'étonne point de la vogue de cette
classe d'hommes à cette époque. La cuisine a eu
chez les anciens une importance que la comédie ne pouvait manquer de reconnaître maintes fois.
Des écrits sans nombre s'en sont occupés. Mnesithée
a fait un traité des Comestibles, Chrysippe de
Tyane un livre sur la Boulangerie, Euthydème
d'Athènes sur les Poissons, nourriture plus chère
aux Grecs que la viande, et qui valut aux gourmets
romains Sergius et Licinius les surnoms héréditaires
de Orata (dorade), et de Murcna (lamproie). (1)
(1) Macrob. Saturn. II, cap. 11 et 12. L'esturgeon était fort recherché des délicats de Rome. Macrob. II. cap. 9. avait déjà cité un Fabius, surnommé Gurges pour avoir mangé son bien. Uu autre célèbre gourmand porta aussi le surnom de Gurges. C'était ce Gallonius dont Lucilius, dans ses Satires, a si vivement persécuté les rapines, la gourmandise et les fourberies. (Liv. iv, fragm. I, et XXVIII, fragm. 5, Corpet.)
Héraclide (sans doute de Tarente) a écrit sur la cuisine, et Archestrate de Syracuse, gourmand célèbre, a composé un poème épique sur la bonne chère, dont Athénée, à qui j'emprunte çà et là tous ces noms, nous a rapporté les premiers vers. Notre Berchoux, du moins, en rimant sur la gastronomie, n'avait point visé au poème épique (1).
(1) L'importance de la bonne chère était sans égale alors. Parmi ces aïeux de Brillat-Savarin,je ne veux plus citer que Lyncée de Samos, condisciple et rival de Menandre, et ses deux amis Diagoras et Hippblochus. Afin d'étudier les meilleurs morceaux de chaque pays, ils avaient pris le parti de voyager et de se communiquer leurs impressions gastronomiques. Athénée nous a conservé quelques fragments de cette correspondance.
Le cuisinier était devenu un personnage. Malheur
à qui l'insultait:.Jamais, dit Menandre, injure
faite à un cuisinier n'est restée impunie, tant ce métier est révéré parmi nous. Aussi les cuisiniers
étaient représentés libres à l'origine dans toutes
les comédies, et Posidippe est le seul comique qu'on
ait cité en Grèce avant l'époque macédonnienne
pour avoir mis en scène un cuisinier esclave.
Le règne de la cuisine rendait inévitable celui des
parasites. Dans un siècle dont le poète comique a dit
que le flatteur y tenait la première place, le calomniateur
la seconde, et le méchant la troisième,
le parasite devait remplir tour-à-tour et souvent
tout ensemble chacun de ces rôles, et le cuisinier
était destiné à lui octroyer sa récompense.
La misère d'ailleurs aiguisait ordinairement la verve et l'appétit du premier, et l'épicurisme régnant augmentait
chaque jour la popularité de l'autre. Sous
le couvert d'Aristippe et d'Épiçure, les plaisirs de
la table se tournaient en débauches, et, comme
Tite-Live l'a dit plus tard des Romains, le métier
des cuisiniers devenait un art. C'est presque un lieu commun de dire que les Romains
furent aussi friands de bonne chère que les
Grecs. Qui ne sait tout ce que l'antiquité nous a
appris à ce sujet ? qui n'a lu Pétrone, Macrobe,
Martial,. Apicius? qui ne sait que déjà le viel Ennius,
ami du vin avait écrit le poème des Phagetica ? Les causes de ces excès furent d!abord différentes
chez les deux peuples. Les habitudes de
la vie matérielle, encouragées chez les Romains
par le goût des batailles et du sang des hippodromes,
les poussèrent à l'origine, plus encore que
la philosophie d'Épicure à tous les excès du sensualisme.
A Rome, les travaux agricoles, les agitations
de la guerre furent pendant plusieurs siècles la
seule cause. La philosophie ne vint que bien tard,
longtemps après qu'un ordre du sénat eût condamné
être brûlés des livres philosophiques attribués à
Numa, et trouvés, dans les champs du greffier Petillius.
N'oublions pas qu'un de ceux qui contribuèrent
le plus à la faire goûter aux Romains fut le
consul Lucullus, aussi célèbre, par les richesses de
sa table que de sa bibliothèque. Les Grecs avaient
institué une loi qui limitait le nombre des convives et nommé des surveillants chargés de la faire
exécuter. Le sévère Ménandre la rappelle dans son
théâtre et nous apprend que la joie des noces mêmes
avait ses règles et sa .police. Chez les Romains, le tribun Orchius, dès le sixième siècle, avait
de même déterminé la quantité permise des convives, et la loi Fannia, spirituellement appelée Centussis dans les satires de Lucilius essaya bientôt
après de mettre des bornes au luxe des appétits et
.des festins (1).
(1) Macrob, Saturn. II, 13 . Caton, quand il se plaignit qu'on transgressait cette loi, devait échouer là comme il échoua pour la loi Oppia. Il arrive un temps où les moeurs publiques sont plus fortes que toutes les lois.
Rien ne prouverait mieux au besoin, les penchants
gloutons de la Rome primitive que les premiers
essais de son théâtre. Dans la farce latine,
c'est la vie sensuelle qui domine, comme à l'origine de presque toutes les civilisations. Seulement
ici la gourmandise a le premier rang et le garde au
milieu même des raffinements d'esprit qui suivirent
et des progrès du goût que hâtèrent les lettres
grecques. Dans les premiers triomphes des chefs
Romains ou dans les pompes religieuses en tête
du cortége, se montraient déjà ces figures caractéristiques de monstres aux larges mâchoires, telles
que le Manducus ou le Pytho Gorgionus qui
avec les Manies à la face enfarinée, étaient encore
la terreur des petits enfants au temps de Juvénal.
La farce, fescennine, les Atellanes, les empruntèrent
et donnèrent, sur leur théâtre, une popularité
inattendue à ces masques voraces. Les Atellanes ne
s'en tinrent pas là elles ajoutèrent à ces figures des traits empruntés aux jeux de la Campanie, aux
vieilles traditions de la farce Osque, et créèrent
ainsi des copies différentes et. curieuses. Je remarque
parmi ces personnages divers et caractéristiques
le Bucco, l'homme qui tire son nom de sa
grosse bouche, de ses lèvres enflées, et dont la
sculpture antique nous a transmis deux modèles. Le Bucco dont le nom s'est traduit sans
doute en Italie par Buffone, ce qui a donné lieu
chez nous à la dénomination de bouffon, malgré
l'étymologie contraire fournie par Saumaise et Menage,
le Bucco était un parasite, bavard comme ils
le sont tous.
Il y a encore dans la farce, latine un autre personnage
dont certaines habitudes offrent aussi
quelque analogie avec celles du parasite primitif;
car il vivait, comme lui de nourriture donnée.
C'était un tireur d'horoscopes du nom de Dossennus ou de Dorsennus, peut-être parce qu'il avait le
le dos bossu ou voûté, comme Munk paraît le
croire. Il y a sur lui des fragments curieux de
Novius et de Pomponius qui nous le montrent tour-à-
tour comme un savant divinateur pour les ignorants et comme un: sévère maître d'école. Le trésor public nourrissait donc quelquefois ces
savants singuliers. Ici, c'est le peuple qui était le
patron et Dossennus le parasite. C'était moins, il
faut le croire par, ce passage et par un autre tiré
de la pièce intitulée Philosophia de Pomponius c'était moins un commensal qu'un
mendiant d'une espèce particulière, un mendiant
.savant. On trouve de même dans Aristophane une
comédie qui porte pour titre le nom d'une de ces
familles de divinateurs, assez fréquentes en Asie-
Mineure et en Grèce. Dans sa pièce des Telmises (tireurs d'horoscopes de la Carie) dont nous
n'avons que quelques fragments, je reconnais aussi
ce goût de la table, commun sans doute aux gens
de cette espèce et dont le Dossennus offre un
échantillon singulier dans la farce latine. On a confondu souvent ce Dossennus avec un autre
Dossennus qu'Horace a cité particulièrementau
sujet des parasites.
Je ne saurais partager à ce sujet l'opinion qui
fait de ce Dossennus le personnage des Atellanes
de Novius ou de Pomponius. Évidemment il s'agit
ici d'un auteur. Les expressions d'Horace et la
place qu'il leur donne ne me paraissent pas laisser
le moindre doute ce sujet. C'est après avoir cité
les comédies de Plaute et apprécié leur caractère
qu'il mentionne celles d'un autre écrivain comique,
de Dossennus, qui, dans ses pièces,, s'occupait
surtout des parasites. Cette figure poétique du
passage d'Horace, qui a trompé quelques commentateurs,
et par laquelle l'auteur ou sa comédie est
représentée comme parcourant la scène, le brodequin
au pied, cette figure est familière au satirique
latin. Il l'empruntait sans doute à cette coutume
qui, à Rome, permettait aux auteurs d'être en
même temps acteurs dans leurs propres pièces. Là c'est la pièce, ce n'est pas l'acteur qui foule
en se promenant les parfums et les fleurs de la
scène.
Le Dossennus des Atellanes, personnage nommé
dans plusieurs farces latines et que Novius a pris
pour titre d'une de ses pièces, n'est donc pas
le même que Dossennus l'auteur, cité par Horace,
et qui a pu être aussi, comme Plaute, acteur dans
ses propres ouvrages.
Sénèque cite un vers inscrit sur la tombe
d'un Dossennus dont il vante la sage philosophie.
Peut-être ce vers qui est placé à la suite de cette
phrase se rapporte-
t-il à Dossennus, l'auteur comique. Cependant
il est plus sage de garder quelque réserve sur ce
point, dans l'absence de preuves plus satisfaisantes.
C'est là tout ce qui nous reste des passages qui peuvent avoir .trait à cet écrivain qu'Horace a pris
la peine de placer à côté de Plaute, ce qui semblerait
annoncer un grand mérite malgré le dédain
avec lequel Plaute et Dossennus sont traités dans
son épître. C'est une lacune regrettable dans le répertoire
comique des Latins qui s'est trop appauvri.
de tout ce qui touchait à la vie intérieure, au foyer
romain, avant que les Grecs ne fussent venus s'y
asseoir.
Malgré cette perte, les parasites de la vieille comédie
nous sont parvenus en assez grand nombre,
encore. Si nous n'avons plus, pour mieux les connaître
en les comparant, ceux du comique Dossennus,
il nous resté encore ceux que Plaute et Térence
ont laissés. Ils sont originaux pour nous et fort,
curieux à étudier.
Plaute reçut le personnage du parasite de la tradition
grecque et latine et l'emprunta en même temps
aux habitudes de la société Romaine. L'existence
du parasite était nécessairement liée à celle du patriciat.
Du jour où il y eut un patron et un client,
du jour où le Congiarium et la Sportule établirent
entre eux des rapports nécessaires à tous deux;
de ce jour a du naître le parasite Romain. La richesses
n'existe qu'à côté de la pauvreté, la pauvreté engendre la flatterie. Un homme qui est pauvre et flatteur est.bien près d'être un parasite. Caton raconte dans le Traité de la Vieillesse de Cicéron que les
réunions de table furent fondées pendant sa questurc;
lorsqu'on introduisit à Rome le culte de la
Mère des dieux. Mais ce qu'il en estimé le plus, ce
sont les longues conversations. Ce goût n'était
pas celui de tous les Romains dans leurs repas.
Dans l'origine, les hommes y prenaient part en se
couchant à leur place respective..Mais les
femmes y restaient assises. Cette sévérité de
moeurs, comme le dit fort bien Val. Maxime, se
conserva dans les repas des dieux du Capitole et disparut
bientôt de la vie privée, lorsque furent introduites
à Rome, avec le luxe Asiatique, ces tables à
un pied et ces séductions du superflu qui firent oublier
si vite la simplicité du nécessaire. A
ces festins on amenait quelquefois des convives
qui n'avaient pas été invités par le maître du lieu
mais engagés par quelque commensal. Ces nouveaux
venus s'appelaient des ombres. Rarement
les parasites venaient à ce titre. Les ombres avaient ordinairement la 4° place à chaque
table, tandis que le plus souvent les parasites
se mettaient en dehors, sur un petit banc placé
tout au bout. " Je ne demande pas une place sur un
lit, dit Gelasime dans le Stichus " tu sais que je suis
de ces braves convives qu'on met au petit bout sur
un escabeau imi subsellii virum". C'était la
manière des cyniques. D'autres fois, ils occupaient
le dernier lit de la dernière table comme un
de ces flatteurs dépeints par Horace, imi derisor
lecti. Heureux si on ne trompait pas leur appétit
en ne plaçant devant eux, comme fera plus tard
un empereur, que le simulacre menteur des mets
servis à la première table; plus heureux encore le
maître si le parasite, armé de ces mains crochues
que Plaute appelait furtificae, n'emportait pas les
serviettes comme la Babonette des Plaideurs, ou
plutôt comme l'Hermogène de Martial!
Plaute a écrit un Flatteur comme Ménandre,
comme Eupolis comme tant d'autres. Il nous en reste à peine quelques vers. D'autres titres, tels
que le Parasitas Piger, le Saturio et des fragments
des Baccharia et de la Bis Compressa complètent pour
nous tout ce qu'il a donné sur les parasites.
Ce qu'il faut remarquer dans Plaute, c'est que déjà
là nous ne voyons plus le parasite manger sur la scène.
Je doute que dans ses pièces qui nous manquent
aussi bien que dans les autres, Plaute l'ait montré à
table. Le théâtre latin ne nous a jamais donné que
le récit de ses fredaines culinaires nous avons la
théorie de sa gloutonnerie, nous ne la voyons pas
en action. Dans le Stichaus, par exemple, où il est
tant parlé de repas, quel est celui qui nous offre
le spectacle d'une orgie? Sera-ce le parasite Gelasime
? non, ce sera l'esclave Stichus. Le parasite sera
tout simplement éconduit et ne nous montrera
rien. Lorsque Charançon, dans la pièce de ce nom,
revient apporter une nouvelle heureuse à Phédrome
et feint de défaillir pour se faire amplement nourrir,
c'est au logis de son jeune maître qu'il va se régaler et il ne reparaît qu'après le repas. Serait-ce
que le théâtre avait pour règle de cacher à tous les
regards ces menus détails de la vie du parasite, ordinairement
né libre, et était plutôt indiscret sur ce
point pour les esclaves, tel que Stichus ou faut-il
penser que, la gloutonnerie n'étant plus qu'un accessoire
de convention dans les habitudes des parasites
de la .comédie Romaine, on en mettait à dessein la
représentation dans l'ombre, pour mieux faire ressortir leurs talents de messagers d'amour et d'habiles
compères? La première hypothèse me paraît plus
vraisemblable pour le théâtre de Plaute. La seconde
sera plus vraie quand le jour de Térence sera venu.
Il n'en était pas tout-à-fait de même pour la
scène des Grecs. La plupart des passages de comédies
cités par Athénée, les fragments des Detaliens
ou Convives d'Aristophane, font penser que le public
était admis à voir ces repas, étalés sans doute
devant lui comme une sorte de souvenir parodié des
festins d'Homère. J'imagine que la comédie nouvelle
fit autrement. Dans la comédie ancienne et aussi
peut-être dans la moyenne, c'était la voracité du
parasite qui se donnait carrière. Dans la nouvelle, la
morale a plus de part. C'est l'intrigant, l'adulateur,
le fourbe qu'on démasque. Voyez le Flatteur de Ménandre. Un festin s'y donne en plein théâtre,
mais c'est un repas de fête en l'honneur de Vénus.
Un cuisinier y exhorte à la prière et demande aux
dieux la santé et le bonheur. Les sentences morales
s'y mêlent. Un parasite y flatte un soldat avec
une complaisance qui applaudit à toutes ses fanfaronnades.
Nous avons la mise en scène de l'adulation,
Térence qui, dans son Eunuque, avoue avoir
imité le Colax de Ménandre, ne l'aurait certainement
pas choisi si le comique grec n'en avait fait qu'un
gastronome. Le Gnathon du comique latin n'est resté populaire au marché que parcequ'il a été riche
et prodigue autrefois. Mais ses talents sont au-dessus
de la gloutonnerie. C'est dans l'adulation qu'il
met surtout sa coquetterie. Il a toute une théorie
sur le métier de Flatteur. C'est un homme consommé
dans ce qu'il appelle son art.
Plaute n'a pas été si loin il s'est mieux souvenu
des origines du personnage. En le mettant en reregard
de son maître ou plutôt de son roi, comme
on l'appelait, Plaute n'a fait du parasite qu'un auxiliaire
plus intelligent et plus haut placé que l'esclave.
S'il faut trouver quelque expédient plus habile,
plus rare, s'il faut voyager surtout, le parasite
est là, il se dévoue aux intérêts, aux amours de son
patron, pourvu que celui-ci serve les intérêts de son
estomac. Le serviteur est souvent vindicatif et railleur,
malgré son esclavage; le parasite, quoique libre,
n'est ordinairement que plaisant et rampant.
Le premier est forcément attaché aux caprices de
son maître, le second à plusieurs patrons et abandonne
ceux qui l'oublient. Autant il se montre obséquieux
et inventif pour qui le nourrit, autant il est
sans pitié pour qui le néglige. Si l'on pouvait douter
encore de la vanité de l'aristocratie Romaine, le
parasite en serait la meilleure preuve. Ces proconsuls
qui apportaient des richesses considérables des
provinces qu'ils avaient gouvernées, ces puissants
possesseurs de terres et d'esclaves avaient besoin
que leur orgueil fût chatouillé chaque jour du bruit de leur mérite, de la nomenclature fastueuse de
leurs métairies. Un homme devait se faire l'écho de leur vanité, et il recevait en friandises
le prix d'une admiration qu'il renouvelait sans
cesse et qu'il éprouvait rarement.
Plaute a montré tour à-tour ce personnage comme
un accessoire de peu de valeur, comme un intermédiaire
utile ou comme un des plus nécessaires acteurs
de sa comédie. Dans l'Asinaire, le parasite de
Diabole, rival de l'amant de Philénie, n'a pas même
un nom à part. Plaute ne l'a pas jugé assez important
pour le nommer. Il figure là comme le satellite
obligé d'un amant riche. C'est lui qui rédige
ce traité curieux qui, moyennant 20 mines, fera
de Philénie la possession la propriété régulière de
l'heureux Diabole. Les différentes clauses de ce contrat
témoignent de la finesse dépravée de ces complaisants
subalternes autant que de la corruption
des moeurs romaines. Les précautions prises et stipulées
pour empêcher l'infidélité, sont tout ensemble
la preuve des progrès effrayants qu'elle avait
faits, et de ce goût de la propriété et ,du droit qui
chez les Romains, transformait certaines personnes
en choses et les moindres engagements.en contrats.
Lorsque le parasite voit sa proie échapper à son maître,
il devient dénonciateur. Il chercher exciter la jalousie et fournit un texte aux récriminations conjugales.
Il veut venger les mécomptes de son jeune patron
sur le dos du vieux Déménète, le père de l'amant
préféré, et il y réussit; mais son intervention
se borne là. Il est pour Plaute la cause fort secondaire
de deux scènes excellentes et il disparaît ensuite.
Dans les Ménechmes, Labrosse, le parasite, vient
aussi dénoncer un Ménechme à.sa femme et disparaît
promptement. Mais là, il est la dupe de ses bons
offices, car à peine a-t-il fini sa tâche et réclamé son
salaire habituel qu'il est honteusement renvoyé
sans obtenir mieux que des refus.
Les militaires fanfarons faisaient, eux aussi, du
parasite leur suivant obligé. Le Miles Gloriosus de
Plaute, comme le Cléomaque des Bacchis comme
le Thrason de l'Eunuque, ne marche pas sans être
accompagné de son flatteur. Au retour des guerres
puniques, ces soldats accoutumés aux fatigues et à
la bonne chère, ignorants et enrichis, étaient une
proie facile pour le parasite en quête de franches
lippées. Chacun d'eux y trouvait son compte celui-ci à bien vivre et à leur tenir tête à table, ceux là
à se voir des approbateurs toujours prêts à écouter
leurs mensonges et des agents pour les servir.
La tradition d'ailleurs venait encore ajouter à la vérité
du portrait. Nous savons par le prologue de l'Eunuque de Térence que le Colax de Ménandre n'était
autre chose que le courtisan d'un de ces militaires
fanfarons qui seront de tous les temps, comme la fausse gloire est la, suite nécessaire la caricature de
la véritable. D'autres pièces grecques nous donnent
les mêmes personnages, comme le Soldat d'Antiphane, par exemple, comme le faux Hercule de Ménandre qui portait, nous dit Plutarque uue massue non d'un bois solide et pesant,
mais d'un bois creux et léger, symbole de sa
fausse bravoure; ou comme le Sycionien à qui
Plaute a emprunté pour le soldat du Truculentus son nom expressif de Stratoplaane et où se trouve ce
vers qui est tout un portrait.
Au-dehors aspect dur, mais coeur lâche au-dedans.
Les soldats fanfarons ou Capitans matamores ont
donné lieu à de plaisantes scènes jusque sur le théâtre
moderne. Addison dans le Spectateur les appelle
pédants militaires. " Le pédant militaire, dit-il,
parle toujours dans un camp, il emporte les villes
d'assaut, établit des logements et livre dix batailles
d'un bout de l'année à l'autre; tous ses discours
sentent la poudre." Montesquieu dans ses Lettres Persanes ne les a pas négligés. " Ils font voler
les armées comme des grues et tomber tes murailles
comme des cartons; ils ont des ponts sur toutes les rivières, des routes secrètes dans toutes les
montagnes, des magasins immenses dans les sabes
brûlants" mais le Parasite a disparu et le capitan n'a plus d'auditeur.
Plaute va plus loin encore. Le Prostitueur, ce pourvoyeur
honteux mais nécessaire de la société roimaine,
a aussi son parasite. Labrax dans le Rudens échoue sur la rive, accompagné de son hôte Charmidés.
Ce sont les conseils flatteurs de celui-ci qui
l'ont perdu, dit-il, et l'ont poussé au naufrage.
Mais ici la dépravation est égale des deux côtés. Le
commensal n'épargne plus son hôte dès qu'il le voit
dans l'infortune. Labrax a beau appeler, dans sa
détresse, Charmidès à son secours et invoquer son
ancienne hospitalité ! "Je ne suis plus ton hôte,
répond l'autre, foin de ton hospitalité !" Leçon
cruelle pour ces vils trafiquants qui ne cherchent que des complices dans leurs Parasites et qui
méritaient de trouver des ingrats ! Charmidès, de
son côté, ne paraît pas trop embarrassé de son isolement.
Ses talents le sauveront sans doute. Je remarque même
que, contrairement aux gens de son espèce, il avait, dit-il, de l'argent sur lui
avant son naufrage, ce qui est presqu'une exception
parmi les parasites de Plaute.
Je retrouve ailleurs ces hôtes perfides en meilleure
compagnie que celle d'un prostitueur, Ils se vengeaient
souvent par un mordant sarcasme de la
bassesse de leur condition. Charmidès, avec son insouciance
maligne et caustique, me rappelle le parasite
Bithys à qui un jour le roi Lysimaque, son
maître, jeta un scorpion de bois sur l'habit. Lysimaque était fort avare, on le sait; il était, homme à
faire comme Héliogabale, à tromper la faim de ses
parasites en leur faisant servir des mets de bois ou
de cire. Bithys, tout effrayé, saute de sa place. Puis
s'étant.aperçu que çe n'était qu'un faux scorpion
"moi aussi, dit-il, prince, je vais vous effrayer. Donnez-moi un talent !". Mais ces courtisans moqueurs
ne se vengeaient pas toujours par une saillie. Une
fois sur le chemin de la perfidie, ils poussaient
quelquefois jusqu'au crime. On peut permettre à
Charmidès de trahir, de livrer son hôte Labrax. L'esprit
fait accepter la fourberie et l'on rit d'ailleurs
volontiers de voir un traître en tromper un autre.
Mais la trahison devient plus grave quand elle frappe un grand nom et produit une catastrophe. Comment
qualifier, par exemple, ce flatteur de Crassus
qui, selon Nicolas de Damas, osa livrer son maître aux Parthes ? De nos jours aussi, madame Dubarry
n'a-t-elle pas été dénoncée à ses bourreaux
par le nain Zamore qu'elle avait comblé de bienfaits
comme pour prouver une fois de plus que la gratitude
est pareille à une fleur délicate qui ne germe et
ne s'épanouit que dans les terres choisies et cultivées
?
Les parasites comiques que nous venons d'examiner sont
ce qu'en langage scénique on appellerait
aujourd'hui des utilités. Ce sont des accessoires de
tradition, de masques épisodiques, qui jettent quelque
gaîté sur l'ensemble de la pièce.Ainsi, pour résumer,
le parasite de Diabole est tout à la fois rédacteur
et délateur, et réussit. Celui de Ménechme est délateur
aussi, mais il est éconduit. Les parasites de militaires
sont des flatteurs rampants et secondaires et
enfin Charmidès représente le parasite goguenard.
Nous avons deux pièces de Plaute où ces utilités
sont un peu moins accessoires. Ce sont les comédies
où le Parasite ne représente qu'un gourmand.
Les programmes qu'ils nous donnent sont curieux
par leur sel et leurs détails et relèvent par
là le rôle. Ces deux pièces sont les Captifs et le Stichus j'y ajouterais le parasite de la Bis Compressa, si nous en avions plus qu'un seul fragment, où ce personnage fait une ingénieuse comparaison entre
une horloge et son estomac. Ces.deux comédies sont
comme le procès-verbal de la décadence des parasites
primitifs, de ceux qui n'ont plus au service de leur
roi qu'un ventre toujours affamé. A cette époque
où la vie rustique était de mode, les riches ne se logeaient
à la ville que pour le temps nécessaire à
l'expédition des affaires privées et publiques. Aussi,
en été, lorsque les tribunaux et le sénat sont en vacances,
quand les patrons sont aux champs, les parasites
étaient sans besogne. Le maître est-il de retour,
ils n'étaient pas toujours plus heureux, car
ils trouvaient difficilement des hôtes; et Ergasile,
le parasite des Captifs, pleure d'autant plus son
maître absent que c'était le plus libéral des maîtres
et qu'il ressemblait bien peu aux patrons avares et
égoïstes d'alors. Jadis les parasites étaient chargés
de faire eux-mêmes les emplettes au marché jadis
ils pourvoyaient à tous les besoins, à tous les goûts
de leurs jeunes maîtres; un quolibet se payait d'un
ou de plusieurs dîners. On s'était bien refroidi pour
eux depuis lors. Ils étaient déchus de leur ancienne
splendeur, et pour trouver des tables somptueuses,
des patrons généreux, ils étaient obligés de se mettre
publiquement en vente, eux, leurs services, leurs
bons mots, comme le fait si spirituellement Gelasime
dans la pièce.de Strichus. "Il y avait jadis, s'écrie-t-il dans sa douleur, il y avait dans
la conversation et dans l'usage des façons,de parler qui se sont
perdues c'est bien dommage, par Ilercule, car elles étaient excellentes,
à mon sens, et tout aimables. Viens souper ici, accepte,
il faut que tu promettes ne te fais pas prier est-tu libre?
je veux que tu acceptes je ne te laisserai pas que tu ne viennes. En place de cette phrase on en a inventé une, par Hercule,
qui ne signifie, qui ne vaut rien. Je t'inviterais à souper,
si moi-même je ne soupais en ville» maudite phrase! je voudrais,
par Hercule qu'on lui cassât les reins ou que le menteur crevât,
s'il mange chez lui."
On le voit, la transformation du parasite en agent
d'affaires, en serviteur utile, est devenue nécessaire.
Les maîtres ne donnent plus pour être seulement
ffattés, mais pour être servis. L'importance du parasite
n'est plus qu'à ce prix. Deux comédies
de Plaute, le Persan et Charançon; une comédie de
Térence, le Phormion le placent sous ce jour plus
avantageux. C'est du nom du parasite que ces pièces
tirent le leur. Ce qu'il faut remarquer dans le Persan c'est que le parasite, homme libre, est au service de
qui? de l'esclave Toxile. Témoignage curieux du
degré de liberté des esclaves à cette époque et de la
confusion des rangs qui en devait être la suite Ainsi,
la misère du parasite Saturion le met à la merci
du plus vil. Il ne faut pas trop s'en plaindre si ce
privilège, ce semblant de liberté doit tourner plus
tard à l'amélioration de Toxile, si l'esclave doit s'ennoblir
par là et mériter un jour, comme le Métrophane
de Lucilius; la sympathie dé son maître et
une épitaphe honorable
Saturion et Charançon sont tous deux l'âme de
l'intrigue qui noue les deux comédies. L'un dispose
despotiquement de sa fille pour la faire servir à un
mensonge humiliant et intéressé; l'autre, par son
active fourberie, procure au maître qui le nourrit
argent et prospérité. Tous deux oublient ici plus
souvent leur appétit pour faire montre de ruses et
de ressources. Plaute, dans ses neuf comédies complètes
qui ont un parasite pour personnage, n'a
donc confié le premier rôle que deux fois à ces
acteurs subalternes. On ne saurait trop remarquer
avec quelle variété de ton et d'esprit il leur
fait à chacun tenir un langage dont le fond est à peu
près toujours le même quel sel il a répandu dans
toutes leurs saillies, et comme il a su, malgré la
monotonie d'une situation commune et accessoire,
leur donner presque toujours du relief et de l'attrait!
Les noms mêmes qu'ils portent sont déjà piquants! ils peignent l'homme. Ergasilce est un parasite affairé.
Gelasime est bouffon. Peniculus ou Labrosse et
déstiné à manger les derniers restes du festin, à
nettoyer les tables. Charmidès aime la joie. Artotrogus
dévore tout Saturion est insatiable. Charançon
porte le nom de cet insecte qui ronge les
blés (1), et, dans les fragments, Gastrion annonce
qu'il n'a que du ventre et Phagon qu'il mange sans
cesse.
(1) On trouve dans Athénée, vi, 65, p. 60, l'origine de ce nom de Charançon. Anaxilas disait: "Les flatteurs sont les Charançons des riches. Chacun
s'insinuant dans l'esprit inoffensif d'un maître, s'y accroupit et le ronge
jusqu'à ce qu'il l'ait absolument vidé comme un sac de blé. Après celui-là,
il va en ronger un autre."
Térence, dans le Phormion,a fait, de son parasite un acteur intéressé au succès de ses fourberies, comme Charançon et le Persan. Seulement Phormion au lieu d'être poussé par le personnage principal, est l'auteur premier des méfaits de son maître.. C'est lui dont les conseils ont mené tout d'abord Antiphon à une faute. Dans le Persan de Plaute, Saturion, malgré toute son importance, ne faisait que se prêter aux manèges de son patron. Il le secondait, mais ne le dirigeait pas. Dans Charunçon, ce n'est que sur l'ordre de Phedrome, son maître, que le parasite se rend en Carie et le sert par son adresse. Plaute, en faisant porter une partie de l'intérêt sur ce rôle, n'a jamais oublié qu'il était subalterne. Il est resté naturel et vrai en l'agrandissant. Térence a fait davantage. Son parasite a oublié son inférioirité primitive. Il vit en grand seigneur c'est lui qui va au bain, qui est parfumé, brillant; tranquille, tandis que son patron se ruine et s'inquiète (1).
(1) Plaute avait tracé tout autrement le caractère du parasite. " Un parasite, dit Saturion dans le Persan, v. 121, perd toute sa valeur s'il a de l'argent chez lui. Il lui prend aussitôt envie d'ordonner un festin, de faire bombance à ses frais, de manger son bien. Un bon parasite doit être de l'espèce des cyniques."
On dirait que les rôles sont intervertis
et que le maître est devenu le valet de son flatteur.
Le parasite conduit là toutes choses; il a en
astuce des principes dont il fait étalage mais son
rôle est d'autant moins vraisemblable qu'il est plus
important. Térence, le commensal des grands, Térence
qui faisait admirer la beauté de sa voix et de
sa personne aux soupers de Lélius et de Furius, me
semble avoir voulu trop relever ce personnage.
Dans Plaute, nous avons vu que les parasites
avaient perdu de leur vogue; les maîtres étaient
moins généreux pour eux, leurs bons mots n'avaient
plus de crédit et leur misère trouvait moins de soulagement.
Térence a fait tout autrement pour son
Gnathon dans la comédie de l'Eunuque. Gnathon
ne se plaint pas de la dureté des temps au contraire
tout lui réussit; il est heureux. Il est la
providence des marchés et des fournisseurs, contrairement
à ce, que disaient les pauvres parasites de Plaute. Bien plus, pour relever sa condition et
n'en pas faire un parasite ordinaire, Térence lui fait
dire qu'il a été riche autrefois et qu'il ne s'est constitué
parasite qu'après avoir mangé son bien. Cela
pouvait être, cela s'était vu déjà. Ménandre d'ailleur,
que Térence imite ici, avait sans doute donné
cette qualité à son parasite. Théopompe, dans ses Histoires, parle même d'un certain Nicostrate d'Argos
qui s'était fait flatteur et rampant, quoique riche, et Horace nous apprendra plus tard l'histoire
curieuse de ce Moenius qui, après avoir bravement
dissipé son patrimoine, s'était établi parasite
et bouffon. Mais là comme ailleurs, Térence,
le successeur de Plaute, a interverti la tradition, et
l'invraisemblance se montre dans le mensonge que
fait le parasite en annonçant qu'il a créé un art
nouveau d'être affamé, une secte nouvelle de flagorneurs.
En faisant ce récit mensonger à un camarade
malheureux, le parasite excrce encore son métirer
hors de la table du riche et cela me paraît peu
naturel, surtout devant un ami ruiné. Il va plus
loin encore, et c'est là que l'esprit surtout fait du
tort à la vérité. Il parle d'ouvrir une école, une
.classe d'.tudiants parasites. Mais Térenee ne devait-il
pas se demander où cette école recruterait des
élèves? il faut avoir l'appétit satisfait et l'esprit tranquille pour étudier, et il était à craindre qu'il n'y
eût plus de parasites le jour où il aurait fallu systématiquement
apprendre l'art de l'être.
Parmi les fragments fort incomplets des autres comiques,
qui nous sont parvenus, le parasite est
nommé plusieurs fois. Nous trouvons dans la pièce
intitulée Gemina, de Titinius, une mention de parasites
éconduits, sans doute parcequ'ils entraînaient
le personnage de la pièce à de trop nombreux et de
trop dangereux repas.
Ces conseils avaient-ils porté fruit et contribué à
préserver le principal personnage du contact des
parasites? L'attrait naturel qu'offraient leurs flagorneries,
l'utilité de leurs services me font douter du
succès des conseils qui cherchaient à les écarter.
Titinius, dans une antre de ses pièces, le Quintus, nous donne encore une idée de l'art trompeur, des
mystifications du Parasite :
Quod ea parasitus habeat, ut qui illum sciat
Delicere et noctem facere possit de die.
Noctem facere de die signifie sans doute ici, comme
le croit Neukirch, tromper,jouer; il peut être l'équivalent
de cette expression triviale de notre langue
faire voir des étoiles en plein jour. Si c'est là la véritable
traduction et si cette locution n'est pas prise
au propre, elle serait une preuve de plus du talent
singulier des parasites.
Il nous reste d'Afranius un fragment plus important
sur cette classe secondaire, mais intéressante
de la société romaine. Voici le passage il est tiré
de sa pièce intitulée Vopiscus, le Jumeau survivant : Equidem te nunquam mihi
Parasitum, verum amicum, aequalem atque hospitem
Quotidianum, et lautum convivam domi (1)
(1) On trouve un passage dans Plaute, où la différence de conviva et de parasitus est assez bien marquée. Il s'agit de Periplectomène; cet homme bien élevé ce représentant des moeurs nouvelles ce citadin poli qui se vante d'avoir tous les talents de la bonne société, et qui sait être tout à la fois gai convive, parasite de premier ordre, et excellent pourvoyeur de festins; Miles gloriosus, 606. On dirait qu'avec le Struthias de Ménandre il a pu servir de modèle au Gnathon de Térence.
Ce passage est incomplets Bothe supposè qu'il a
dû être précédé de cette phrase, Qualem me voluisti? Neukirch, au lieu de rendre la phrase qui précède
interrogative, sous-entend simplement cognovi. Quoiqu'il en soit, .la difficulté, pour nous n'est pas
là, elle porte sur un autre point. Il s'agit de savoir
si verum ici signifie véritable, ou si c'est la conjonction
mais du français. Dans ce dernier cas, la phrase
ferait croire qu'on distinguait les parasites des véritables
amis, des convives brillants, des hôtes de
chaque jour. Dans le premier cas, au contraire, ce langage
serait bien honorable pour eux, si toutefois
ce n'est pas un parasite, ou un flatteur, ce qui
est la même chose, qui le tenait à un de ses confrères.
Il'prouverait qu'un parasite pouvait être regardé
comme un véritable ami, comme un convive
aimable, comme un égal (1).
(1) C'est ainsi que dans le Stichus, v. 461,Gelasime invite, à ce titre, Epignome, son patron
Cette seconde interprétation
me paraît la plus vraisemblable, d'après
l'ensemble de toute la phrase. Mais, dans tous les
cas, je ne saurais traduire ici parasitum que par le
mot de parasite et non par celui de commensal. Je ne
connais pas d'exemple dans la comédie latine où
parasite ait été pris en bonne part.
Je ne sais s'il faut compter parmi les fragments
de Naevius ou parmi ceux de Plaute les vers cités dans la Casine tirée, dit Plaute,d'un Colax ou Parasite. L'un et l'autre ont écrit une pièce de ce nom mais je remarque un usage emprunté aux Grecs et que Plaute n'a reproduit pour aucun de ses autres parasites celui d'appoter soi-même sa nourriture. Les viandes, les mets sacrés offerts aux dieux étaient donnés en partage et je nz serai pas surpris que quelques acteurs ou mimes soient devenus le parasite du dieu. Apollon n'avaiy-il pas ses parasites parmi des mimes? Un curieux témoignage de Festus qui ferait remonter bien haut les représentations des mimes,
nous apprend que ces pièces avaient un parasite
qui, quoique relégué parmi les acteurs de seconde
classe, était en même temps parasite d'Apollon.
D'autres renseignements viennent confirmer celui-ci. Nous avons l'épitaphe curieuse d'un certain
Latinus, acteur recommandable par ses vertus autant
que par ses talents. Il aurait pu, dit Martial, avoir pour spectateur ce sévère Caton
qui ne voulut point un jour assister, aux hardiesses
de la scène des fêtes. Florales. Latinus était
en même, temps parasite d'Apollon. Sous.Marc-Aurèle, Acilius réunissait les mêmes fonctions avec
celles d'Arcimime et de premier acteur tragique et
comique de son temps. Enfin.Faustine, mère
de Commode, avait élevé dans son palais l'affranchi
Agilius, placé sur le théâtre par.l'empereur lui-même
et, devenu en même temps parasite d'Apollon.
Plus tard,on en fit un décurion .
Dans l'épitaphe d'Acilius, que Gruter nous a
transmise; se trouve mentionnée la communauté dés mimes, et là encore se reconnaît facilemen la
trace ou l'imitation de ces collèges sacrés chargés
de garder le temple et nourris des offrandes du Dieu.
Dans le Persan de Plaute, quand le Parasite voit venir Toxile, il fait une évidente allusion à cette double
fonction en le saluant par ces mots:: O mon Jupiter
en ce monde c'est un membre, de ton collège
de goinfrerie qui te salue!
Le parasite rappelle ici spirituellement l'institution
des épulons préposés aux Lectisternia, aux repas
sacrés, et se range sans façon dans cette confrérie
gourmande. Il y aurait pu compter aussi ces parasites
en troupe qui se morfondaient et se promenaient
alors au forum et ces autres flatteurs
affamés qu'Epignome,.dans le Stichus, ramenait
avec lui de ses lointains voyages. C'est comme
un prélude à l'usage qui va s'introduire de choisir
les.parasites des dieux parmi lesparasites du théâtre.
Cette association de l'emploi profane avec la charge sacrée révèle une fois de plus le rapport .qui,
de tout temps mêla les choses de la scène à celles
du temple et devait plus tard; même en France, interresser
si vivement les pieuses confréries aux
origines de notre théâtre. Déjà, en Grèce; nous avons
vu que l'institution divine avait précédé le personnage comique. A Rome c'est le contraire. Ce n'est
que fort longtemps après; 542 sans doute, époque
de la fondation des jeux Apollinaires, que se fit le
rapprochement et j'en placerais volontiers l'origine
vers l'année 574, lorsqu'un théâtre fut construit auprès
du temple consacré à Apollon.
Le parasite était un acteur de second ordre, Festus
nous l'a dit. Ses habitudes
et son extérieur se reconnaissaient à des marques
particulières. Son masque, était noir le nez légèrement
courbé, le sourcil froncé. Son habit était
de couleur noire ou grise, excepté dans le Sycionien de Menandre.
Le parasite y endosse le vêtement blanc parce qu'il
s'y marie. Cela était moins rare, sans doute, dans le théâtre latin.. Chez les Grecs, ils se permettaient tout. Il: y avait, là, des parasites qui vivaient avec des vieilles femmes qui les nourrissaient. Est-il étonnant qu'iks aient fini quelques fois par se marier ?
Ils étaient ordinairement armés d'une fiole de
cuir, contenant de l'huile ou des parfums et d'une étrille,
ustensiles nécessaires à la
toilette de bains des patrons qu'ils servaient ou qu'ils cherchaent avant l'heure du diner. Cet héritage
des parasites Grecs s'était augmenté souvent entre les mains de certains parasite de la comédie romaine. Outre l'Ampula et le Strigilis, Saturion
dans le Persan compte parmi son baggage indispensable
une tasse; des sandales et un manteau, Seaphium, Soccos, Pallium. La tasse était pour
boire, les sandales pour marcher, le manteau
pour se couvrir. C'était l'attirail d'un cynique, l'ameublement des parasites pauvres. Ceux de Térence ne
se seraient pas contentés de si peu.
Ils avaient, nous dit Pollux, l'oreille. déchirée
probablement comrne une.marque des coups qu'ils
recevaient et très souvent un oeil crevé, parce que c'était sur eux qu'on se jetait à la fin des repas,
dans l'ivresse de la bonne chère. Ils recevaient
les insultes, les coupes, les plats à la tête; et la première
réponse que fait à Gnathon son pauvre ami
qui ne sait pas le métier de parasite, c'est qu'il ne
peut ni être bouffon, ni supporter les horions
Il ne descendait pas, comme Saturion dans le Persan de la race ingénieusement nommée les Duricranes.
Èrgasile, dans les Captifs, dit qu'un parasite
doit se sentir capable de recevoir des soufflets et
de se laisser casser les verres et les pots sur la tête.
Charançon est spirituellement traité comme un
membre de la famille des Coclès parce qu'il n'a
qu'un oeil et, dans les Menechmes Péniculus
jure sur le seul ceil qui lui reste de demeurer silencieux. Térence eût-il consenti à montrer ses
parasites ainsi défigurés? J'en doute. Telles sont les indications que la comédie ancienne
nous a laissées sur ce personnage original et oublié.
I1 semble que dans la suite le type s'en effaça quelque
peu du théâtre pour se multiplier dans la société
romaine, car, au temps d'Auguste, c'est à là table
des grands qu'on rencontre surtout les parasites,
et leur art devient une sorte d'agrément mondain,
un moyen de se produire et de se pousser, qui, quoique
toujours humble, a beaucoup perdu de sa vile
origine. Auguste lui-même en indique parfaitement
le caractère dans cette lettre qu'il écrivit à Mécène
pour engager Horace à quitter sa table de parasite
pour le palais impérial. Ainsi la place du poète à la
table du favori était celle d'un parasite, et nous savons
par quelle indépendance Horace sut l'honorer
tandis que son rôle dans la maison de l'empereur
eût été, du moins Auguste le dit, plus digne et
plus dignement nommé. Car, dans une lettre qui
suivit, l'empereur, pour l'attirer davantage sans
doute, l'appelle convictor, commensal du prince.
Nous voilà déjà bien loin de ces mendiants grotesques
qui, pour un dîner, descendaient jusqu'a épousseter
et balayer les toiles d'araignée, comme dans le
Stichus, et de ces riches qui se faisaient eux-mêmes parasites, ou qui allaient en personne
au marché. Horace, qui a refusé pour lui-même
cette dépendance dorée qui contrariait
mouvements, ne se fait pas scrupule d'enseigner à
ses amis l'art de la subir avec une dignité habile.
Demander avec précaution, se rendre toujours nécessaire
et jamais importun, régler ses gouts sur
celui du maître, ne parler qu'avec une discrète mesure de sa propre famille pour la servir plus sûrement, voila entre autres, ce qu'il leur recommande en termes plein de finesse et d'expériance. On pourrait retrouver là l'histoire et les devoirs du parasite dans le monde et à la cour. Ce n'est pas que tout cet art se soit raffiné alors et qu'on n'y reconnaisse pas les vestiges de son passé. Le chanteur Tigellius avait encore ses parasites comme l'esclave Toxile dans Plaute, et Fannius, l'un d'eux, avait une bouche aussi mordante qu'insatiable. Il y en avait toujours quelques uns qui vendaient leurs suffrages en échange d'un bon souper ou de quelques nippes usées. Les ombres ou personnages amenés par des invités n'effrayaient pas la
générosité des. amphitryons, et
on rencontrait encore des citoyens pauvres mais honnêtes qui,comme Vulteius Ména le crieur public, le marchand de guenilles attablé un instant chez l'orateur Philippe,
préfériaent leur misèrere à: ce
honteux métier.
II y avait donc.alors des restes de l'ancienne souche des parasites et en même temps une race plus nombreuse et à peu près nouvelle qui semblait descendre quelque peu d'Ennius, d'Andronicus, de Térence (il nous y avait préparé par ses parasites), de ces poètes commensaux qui avaien racheté leur vassalité par la rançon du talent mais qui eurent sous Auguste des rejetons sans nombre, souvent moins dignes, désignés quelquefois par le nom de Scurae, Grassatores, ou par l'épithete moins humiliant de convivae et d'umbrae.
Je reviens au théatre. Deux caractères y distinguent les anciens parasites. Ils sont gourmands pour la forme et agents d'affaires au fond. Communs, goguenarrs, triviaux, naturels dans Plaute, parfumés et florrissants ; hommes du monde dans Térence ; ils forment deux sortes de classe, celle des parasites pauvres et celle des parasites riches. Les premiers annoncent tout à la fois le règne et la décadence des petites familles plébéiennes, les autres sont les précursseurs, les représentants, trop prématurés,
de l'aristocratie impériale. Il: y a trop d'élégance dans leur corruption. Dans le théâtre latin de l'ère nouvelle, il ne nous
reste plus qu'une seule pièce où ce personnage
figure avec quelques-uns de ses attributs anciens,
augmentés de ceux qu'il devait à son temps. Le
Querolus, comédie du 4e siècle nous offre un parasite
plein d'intérêt pour nous, parce qu'il marque
nettement la transformation que nous cherchons.
Au 4e siècle, malgré la consécration publique du
christianisme, le paganisme luttait encore. On ne
déracine pas d'un coup, par un simple édit, les
vieilles moeurs, les vieilles habitudes d'un peuple,
et il y a pendant, longtemps plus de force dans
la rebellion des idées vaincues qu'il n'y a d'ascendant.
et de séduction dans les idées naissantes. Dans
les moeurs, les transitions sont nécessairement lentes et, quelle que soit la sympathie acquiseau choses
nouvelles, on ne passe point sans effort
de l'admiration à la pratique. Cela est vrai
surtout des choses de l'imagination. Les jeux publics,
les jeux de la scène avaient pour le peuple un
attrait qui se conciliait mal avec les prescriptions du
culte nouveau. La vogue extraordinaire des mimes
et des pantomimes était un des témoignages les plus
frappants de la résistance du goût païen. Les empereurs
l'avaient si bien compris que, tout en abolissant
le culte ancien, ils permettaient le maintien
des plaisirs publics et des solennités du polythéisme.
L'attrait du cirque et du théâtre, la popularité de
tous ces spectacles sensuels, faisaient une concurende sérieuse aux cérémoniels mystiques et aux sacrifices
des victimes destinées à la foi naissante.
Pour que celle-ci finît par l'emporter, il lui fallait
le temps, il fallait cette guerre de tous les jours
faite par l'art chrétien aux arts du paganisme ces
processions solennelles, cette magie des peintures
sacrées, cette enivrante séduction de la musique;
employée par l'Eglise à captiver et élever toutes les
âmes, à les détourner peu à peu des entraînements
dangereux de l'idolâtrie et les ravir à la matière.
C'est, dans une situation pareille des esprits, la seule
lutte possible. Ne rien décréter, ne rien emporter
d'assaut attendre et, rivaliser par l'exemple, souvent
par les mêmes moyens, mais dans un autre but,
et, par l'emploi des mêmes personnages produire
des effets nouveaux; c'est là le seul gage du succès
pour les idées naissantes.
Voyez, par exemple, le parasite Mandrogerus;
c'est son nom dans la pièce qui nous occupe;
trompe la confiance du vieil Euclion qui meurt et la
crédulité de son fils auprès de. qui il se fait passer
pour magicien. Il vide la maison de Querolus, et
croyant y avoir fait une capture inutile, il la restitue
trop tôt, car, à son insu, c'est un trésor qu'il a
rendu à son maître. Toutes les ruses des parasites
que nous avons étudiées précédemment se retrouvent ici le voyage en pays étrangers, la captation
tentée sur un vieillard, sur son fils, le mensonge
mis au service de la cupidité. L'influence chrétienne
n'est pas étrangère à cette espèce de code
pénal de la flatterie, témoignage singulier de l'abjection
profondeoù les parasites étaient tombés.
On leur infligeait donc les plus durs traitements, les maux les plus humiliants puisqu'une loi seule
en pouvait réprimer les excès. Ils n'étaient plus exposés
seulement à avoir les vêtements déchirés, on
leur brisait les os. Les petits os se payaient d'un petit
écu (solidus), les grands d'une livre d'argent (argenti
libra). La mort d'un Parasite, cet outrage à
l'humanité beaucoup trop fréquent alors, entraînait
enfin les plus cruelles peines pour l'auteur du crime.
La vie d'Heliogabale nous apprend, à ce sujet, tout
ce qu'on osait contre eux. Il les faisait attacher à une
roue tournante pour jouir de leurs tortures
ou les étouffait sans pitié sous ces monceaux de roses
et de lis qu'Horace aimait à trouver au milieu
des plus gais festins. Longtemps avant cette
époque Hiérax d'Antioche, le joueur de flûte
puis le flatteur de Ptolémée Évergète et ensuite de
Philométor, avait de même été mis à mort sans motif. Il était temps que le christianisme intervînt
et, enseignant tout à la fois la charité qui nous
fait descendre jusqu'aux plus humbles et l'égalité
qui les fait monter jusqu'à nous, marquât dans
la loi le châtiment à côté du délit, sans distinction
de rang.
Règle souveraine qui supprimant
cet odieux monopole des souffrances et de la mort
exercé par une moitié de l'humanité contre l'autre,
donnera peu à peu le premier rang au plus digne,
et fera, en définitive du mépris la seule et la plus
poignante punition du vil !
Nous devinons à peu près maintenant ce que sera
le Parasite de nos temps modernes, quelque chose de
rampant et de méprisable, un type démonétisé qui
s'efface de plus en plus devant la morale nouvelle
et qui n'a chance de reparaître quelque peu qu'avec
les siècles de corruption. Ce n'est plus alors qu'un
mendiant d'esprit, un frelon qui s'attache à la richesse,
mais il n'intervient plus dans les intérêts de
famille, et on ne le chargera plus de rien d'important.
Il n'a plus de devoir à remplir, il n'a que des
besoins, et c'est parce qu'on ne compte dans la société que par les devoirs que le Parasite ne marquera
plus. On lui jettera quelque aumône encore,
mais il aura perdu son caractère, sa place nécessaire.
Au xvii° siècle, par exemple, au temps du faste et
de la poésie, les parasites sont tous poètes comme
au temps d'Horace et de Martial. Le grand siècle offre,
sous ce rapport, des analogies avec la belle époque
romaine. Là aussi, il y a une aristocratie qui domine
et des inférieurs qui sont obligés de se faire pardonner,
par toutes sortes d'obséquiosités, leur rang
subalterne. Dans cette société régulièrement partgée,
où des barrières presque insurmortables séparaient
toutes les classes, que de vers flatteurs, que de
dédicaces pour obtenir, je ne dis pas le droit de manger
à une table splendide, mais de ne pas mourir
de faim! Fr. Colletet qui allait mendier son pain de
cuisine en cuisine, Cassandre, Tristan l'Hermite, vivaient
d'aumônes et des reliefs du dîner de leurs
protecteurs. Cette condition misérable était souvent
la suite des désordres ou de la paresse des poètes
parasites. Je me trompe cependant, le malheur ne
fut pas toujours invariablement leur partage. Fr.
Colletet, par exemple, vit un jour la bonne fortune
venir frapper à sa porte, c'est Tallemant des Réaux
qui nous le dit
« Cependant comme nul n'est prophète en son pays, il est arrivé
que ce Jean-François Colletet ayant été pris par ceux du Luxembourg, il y à 5 ou 6 ans, comme il allait à Cologne offrir
son service au cardinal Mazarin le gouverneur du pays, et autres
grands seigneurs germaniques, le prirent pour un si galant
homme un si grand poète et un si grand orateur qu'après l'avoir régalé deux ans durant, bien loin de lui faire payer rançon,
ils le reconduisirent tous jusqu'à la première place du roi de
France. » Quelle bonne aubaine pour un poète et surtout
pour un poète à jeun.
On connaît l'épitaphe que Tristan écrivit pour
lui-même et qui aurait pu servir à toute cette famille
de poetae minores, ordinairementvêtus de simple
bureau et que la faim avait avilis; la voici :
"Je fis le chien couchant auprès d'un grand seigneur,
Je me vis toujours pauvre et tâchai de paraître,
Je vécus dans la peine espérant le bonheur,
Et mourus sur un coffre en attendant mon maître."
Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce même
Tristan l'auteur de Marianne, écrivit une comédie
en cinq actes, intitulée le Parasite, et dédiée à
M. le duc de Chaulne, un de ces grands seigneurs
du temps, dont la protection s'achetait au prix de
tant de vers et de souplesse. Tristan a voulu imiter
la vieille comédie latine et il a échoué complètement.
C'est presque tout-à-fait l'ancienne tradition
un mari et un fils enlevés depuis 20 ans par
des corsaires, un capitan matamore, copié du Pyrgopolynice et du Thrason romains et enfin Fripesaulce
le Parasite. Malheureusement l'imitation ne
suffit pas pour réussir, surtout quand elle est faite
sans discernement, comme ici. Le style même est
sans force et sans éclat, et il n'était pas donné à
Tristan de faire goûter un langage tel que celui-ci,
par exemple, qu'il prête à son parasite :
"Oh ! je crois que ma faim n'eut jamais de pareille!
Je sens dans mes boyaux plus de deux millions
De chiens, de chats, de rats, de loups et de lions
Qui présentent leurs dents, qui leurs griffent étendent,
Et, grondants à toute heure, à manger me demandent, etc."
En cherchant avec quelque soin on peut retrouver
encore, parmi les Parasites du temps, ces marques
extérieures de leur condition que j'ai signalées
dans les parasites de Plaute. Montmaur, par exemple,
le célèbre professeur de grec, s'attira par ses
goûts de Parasite éhonté, des épigrammes et des
inimitiés sans nombre. On imprima contre lui une
longue diatribe en deux volumes, intitulée Histoire
de Pierre de Montmaur qui contient de curieux détails sur sa vie et ses habitudes gourmandes.
J'en extrais ce seul passage pour montrer que les Parasites
de l'antiquité n'étaient pas seuls exposés à perdre un oeil . M. Bayle cite les vers suivants
d'un écrit intitulé Éloge historique du sieur Gomor,
(Montmaur).
Aussi ce messer cicofante,
Pour montrer que c'est son attente,
Fit l'autre jour un joli tour,
Cassant d'une bûche flottée
La lourde caboche évantée
Du gros janitor de Boncour.
Mais ce grand chercheur de lippée
N'eut pas plutôt fait cette équipée,
Qu'il se vit absous du péché
Car il reçut telle mornifle
Sur son gros museau qui renifle,
Que son oeil en resta poché.
Au XVIII° siècle Collin d'Harleville introduit un
Parasite plus brillant dans sa petite pièce de M. de
Crac. C'est un homme qui a quelque fortune et, qui aime par économie, à manger chez ses voisinset à les payer en grosses flatteries. Nous avons vu, quelques parasites pareils chez les Grecs. Verdac, c'est le nom de celui-ci, n'est placé là que comme
une variété de l'espèce des menteurs que Collin d'Harleville
voulait ridiculiser. Mais de même que Térence,
Collin d'Harleville se serait bien gardé de dépeindre
un vrai Parasite avec son accoutrement grossier,
son langage sans pudeur, son oeil crevé et son ventre
proéminent. Le talent gracieux et facile de l'auteur, le temps où il écrivait; n'admettaient guères
ee genre de vérité dramatique. Ce mensonge aimable,
à la mode alors, je le retrouve plus tard encore
dans une pâle traduction en vers de l'Eunuque, honnêtement déguisé sous ce titre Le Flatteur Parasite, comédie en trois actes par Massot-Delaunay
(1819), avec cette préface la pièce de Térence
que j'intitule le Parasite, pour ne pas effaroucher
les oreilles délicates, se rapproche sinon des
moeurs, du moins des caractères du siècle, etc.
La cuisine est restée.en définitive le seul domaine
de ces êtres déchus. Supprimez l'appétit, il n'y a
plus de Parasites, ou plutôt de gastronomes, et de
pique-assiettes, car c'est là leur dernière dénomination.
Elle suffit pour les délinir. Le ventre a fini
par remplacer chez eux l'esprit. C'est une dernière
et définitive transformation de leur décadence. Ils
sont revenus au point d'où ils étaient partis, à l'appétit,
sans autre attribut qui le relève et lui vaille
quelque indulgence, ou quelque bénéfice. Notre société
a fait deux classes fort distinctes de ce qui
n'en était qu'une seule jadis. Elle a maintenant ses
courtisans et ses gourmands. Ceux-ci, qui ne sont
pas autre chose que les anciens parasites, ont formulé
ainsi, sur la scène, leur dernier programme.
C'est par là que je veux achever leur portrait :
Dans ce siècle économique
Comment engraisser, hélas! On y vit de politique,
Et moi je n'en use pas.
Dîner! voilà mon histoire,
La table est mon seul amour,
Manger, chanter, rire et boire, Voilà mon ordre du jour.
J'ai dans mainte circonstance,
Toujours ennemi de l'eau,
Voté contre l'abstinence
Et contre le vin nouveau.
Mais, lorsque dans mes finances,
L'ordre est un peu rétabli,
Je vais tenir mes séances
Chez Balaine ou chez Véry.
Je me place, dès que j'entre,
N'importe dans quel endroit,
A la gauche comme au centre,
Aussi bien qu'au côté droit.
Sur la carte avec méthode
Je vais régler mes budgets,
Et je n'ai pas d'autre code
Que le Cuisinier français (1).
(1) Le Castronome sans argent, par MM. Scribe et Dupin, représenté au théâtre de Madame le 10 mars 1821. M. Pique-Assiette, comédie-vaudeville en 1 acte, par MM. Dartois et Gabriel, représentée le 18 mai 1824 aux Variétés, est la dernière pièce française qui se soit spécialement occupée de ce personnage.

LES FEMMES.
On a dit que la tragédie apprend à fuir la vie et
la comédie à l'arranger. Il y a du vrai dans cette spirituelle
définition. L'antique tragédie, qui n'a pour
éléments que des caractères d'exception et l'inévitable
action de la destinée, qui se noue par des
malheurs et se dénoue par une catastrophe, la tragédie
fait détester la vie réelle en découvre les maux.
La comédie qui vit d'observation, qui cherche ses
sujets dans la vie commune plutôt que dans les situations
extraordinaires, qui place le beau dans le
vrai et non dans le surhumain, qui enfin met tout à
la merci de la finesse et se termine d'ordinaire par
le triomphe du plus habile, la comédie nous enseigne
la prudence dans la vie elle en montre les détours,
mais aussi l'issue facile. C'est là ce qui la
distingue de la tragédie et ce qui la fait plus généralement
goûter: Savoir arranger sa vie n'est-ce pas là toute la
vie? J'imagine que Plaute sut mieux ordonner la
sienne après avoir perdu sa fortune et tourné la
meule chez un maître, qu'il mit plus d'observation
et de finesse dans les trois comédies qu'il composa
alors et dans les suivantes, et qu'il y donna de plus
utiles leçons de prudence. Il venait de retremper
son talent à la meilleure école, à celle où l'on apprend
le mieux le secret de la vie et des homme,
il venait de connaître le malheur après avoir goûté
de la prospérité. La fortune qui nous échoit à la suite
d'une vie obscure nous cause une sorte d'enivrement
et nous fait le plus ordinairement illusion sur
la réalité. On oublie ou on ignore les maux de la vie
sociale et l'on est disposé à excuser ceux que l'on
connaît. Ce qui corrige nos illusions, ce sont les revers
après la fortune. Aucun éblouissement ne trompe
plus nos yeux; nous avons un intérêt pressant d'étudier les caractères qui nous entourent, de pénétrer
les causes du mal, d'en éviter des atteintes nouvelles
et pourvu que nous soyions d'une humeur ferme et naturellement gaie, comme semble l'avoir
été Plaute, nous jugeons, non pas avec aigreur, mais avec justesse.
Ainsi, je ne suis pas indifférent à cet épisode de
la vie de Plaute, qui nous le montre aux gages
d'un meunier après s'être enrichi au théâtre. Quoi qu'il
fut toujours rapproché du peuple par sa condition
ou par ses goûts, il y a cependant telle vérité d'observation des Captifs ou du Fanfaron qui lui
aurait échappé, je pense, s'il n'avait éprouvé personnellement,
dans l'obscurité d'un sort subalterne,
combien l'esclavage s'ennoblit par la fidélité, et combien
l'orgueil se ridiculise par la jactance. Il y a
de même dans le Misanthrope plus d'un trait que
Molière aurait négligé, si des chagrins d'intérieur
n'étaient venus apporter un aliment de plus à son
génie et ajouter à la vérité du portrait.
Pour Térence, à part bien d'autres raisons qui
viennent de son caractère, je dois avoir moins de
confiance en lui après ce que je viens de dire. Térence,
si ses biographes ont dit vrai, eut à Rome la
vie la.plus douce et la plus fortunée. Les revers
avaient précédé. Ce rôle de commensal des grands,
ces applaudissements qu'il recherchait et donnait au
milieu de leurs festins joyeux, cette figure gracieuse
dont Suétone nous parle, toutes ces délices d'enfant
gâté en échange desquelles il permettait à ses hôtes de
retoucher ses pièces, me semblent avoir dû laisser peu
de place à la vérité et à l'observation. On voit mieux
d'en bas que d'en haut et, dans la vie aristocratique
il y a, avec les éblouissements qu'elle devait causer
à l'affranchi Térence, une élégance menteuse dont ses oeuvres se sont fardées aux dépens du vrai.
L'excès du bonheur a gâté ce talent un peu triste
qui avait déjà tant de dispositions à oublier le naturel. Quand il accouple deux pièces de Ménandre
pour en tirer une seule, quand il se traîne dans l'ornière de l'imitation, non-seulement des Grecs,
mais des latins ses contemporains, il faut lui savoir
gré d'un peu de vraisemblance à défaut de vérité.
Je préfère donc Plaute pour sa verve libre souvent
jusqu'à l'incorrection pour son bon sens
rempli de bonne humeur, qui brave à tout instant
la gêne et le clair-obscur: Cet oubli de la mesure
qui est pour nous une des parties les plus intéressantes
de son talent, parce qu'elle, nous révèle le
fond véritable de cette société trop discrète sur sa
vie intérieure, ce mensonge si transparent d'une étiquette
grecque pour dissimuler, ou plutôt pour
mieux faire ressortir des caractères tout Romains,
tout en lui m'attache et m'instruit. Cette ville de
Rome si remplie de turpitudes bourgeoises, ces maisons
de débauche plus animées, plus curieuses que
le foyer domestique, mais qui ne sauraient remplacer
la famille qui, dans l'antiquité, n'était pas mêlée
à la société, ces valets insolents qui se vengent
de la servitude par l'effronterie, je les étudie à l'aise,
je les vois sans fard dans le panorama du grand comique.
Plaute est pour moi le chroniqueur préféré
de la bourgeoisie Romaine. Seulement, il raconte et
montre tout à la fois. Il est plein de gaîté, mais il
est sérieux au fond. Il a de l'espriti souvent trop
d'esprit peut-être, mais son esprit ne sacrifie pas la
vérité. Ce ne sont pas les grandes scènes du Forum,
ce n'est pas le spectacle du patriotisme Romain
que je vais chercher là, ce sont les commérages et les vices de cette rue des Toscans que Lucilius
dénoncera aussi, c'est le ménage de la plèbe
Romaine, c'est comme les coulisses du forum dont je
deviens le témoin. Il est pour la bourgeoisie de
Rome ce que sera Tallemant des Réaux, pour les
ruelles du 17° siècle; seulement c'est Tallemant,
moins la calomnie et avec un grain de poésie de
plus.
Cette poésie, mêlée d'alliage, a eu, je le sais, ses
détracteurs. Horace en fut. Mais je crois à peine nécessaire ici de défendre Plaute contre Horace. Le
gros sel de l'un ne devait guères complaire au goût
raffiné de l'autre. Horace est un critique nourri de
l'art grec. En apolitique, il a gardé quelque chose de
la vieille indépendance Romaine en littérature, il
a oublié son origine. Voyez plutôt ce Livius Andronicus
qu'il étudiait dans son enfance à l'école du
sévère Orbilius Atta, Pacuvius, Afranius et tant
d'autres noms consacrés par le temps et le génie, il
s'étonne qu'on les admire, il cherche à affaiblir leur
gloire. Le vers saturnin, dont l'origine remonte
aux premiers essais de la littérature Romaine à
Naevius, par exemple, ce vers lui paraît une chose
horrible horridus ille numerus Saturnius. C'est là
d'ailleurs le défaut des siècles de perfection sociale.
Lorsque les moeurs ont acquis toute leur politesse,
quand la langue a atteint son moment le plus parfait,
il semble que la prospérité littéraire présente
fasse oublier les tâtonnements naïfs; la veine originale du passé et que les jeunes poètes, les heureux
du jour doivent ridiculiser leurs aïeux. Sous Louis XIV,
je retrouve le même dédain pour la vieille langue
française. Chapelain, surpris par Ménage au moment
où il lisait le vieux roman de Lancer, a bien
de la peine à se défendre d'avoir fait une lecture si
peu goûtée alors. Boileau qui a blâmé Lafontaine
d'avoir employé dans sa fable du Bûcheron
une autre langue que celle de son siècle (1), n'a-t-il
pas dénié aussi à Molière le prix de son art parce
que l'incomparable comique a mêlé un peu d'alliage
à ses meilleures comédie,
Et sans honte à Térence allié Tabarin,
comme si les oeuvres secondaires de Molière étaient
sans prix, comme si le rire poli avait seul le monopole
du génie, à l'exclusion de la gaîté bourgeoise?
(1) D'Alembert croit cette assertion fausse.
Ce serait un curieux sujet d'étude de comparer les
femmes de Molière à celles de Plaute d'un côté, la
subordination, la retenue, dans la famille antique
d'atitre part, l'émancipation, la coquetterie, dans le
gynécée moderne. Pour mieux juger de la femme
telle que l'avaient faite le monde et le théâtre romains,
il ne serait pas inutile de la mettre quelque-fois en regard de celle que Molière nous a fait connaître.
La lumière jaillit du choc des contraires et
l'on se prend à aimer mieux ce qu'on avait dédaigné
quand on le compare à ce qu'on aime encore,
et réciproquement. Je sais que le rôle, ou, si l'on
veut le règne de nos femmes n'a plus guères de
rapport avec la sujétion des femmes païennes et que
le parallèle ne paraît guères possible entre deux sociétés
si complètement différentes sur ce point.
Mais je n'essaierai les rapprochements que lorsqu'ils
me paraîtront s'offrir d'eux-mêmes et l'étude que
j'entreprends ne sera pas un parallèle prolongé.
Il y a dans Plaute des indications suffisantes pour
suivre la femme depuis sa sortie de la maison paternelle
jusqu'à sa décrépitude, depuis ses cheveux
blonds jusqu'à ses cheveux blancs. Il est vrai que ce
n'est ni là ni dans les livres qu'on peut étudier dans
tous ses détails la vie des filles des conditions libres,
telle que la règle Romaine l'avait façonnée. Le théâtre
était discret surce point il nous en a donné de rares
copies. La famille était comme Auguste, qui n'aimait
pas de voir prodiguer son nom dans les vers
des poètes, de peur de le démonétiser. Elle se défendait
contre la curiosité d'un public épris de scandales,
par le prestige de sa vieille austérité et, il faut
bien le dire, par sa monotonie même. Quel attrait
pouvaient offrir aux foulons, aux petits marchands,
aux mangeurs de pois chiches; toute la plèbe
bruyante et inattentive de la cavea, ces moeurs d'intérieur, étrangères aux affaires publiques, et ordidinairement
contraires à ces menus désordres du
dehors qui composent ou recré en la vie des peuples
sensuels? La mère vouée aux soins du ménage, la
fille occupée à filer, à aller aux écoles le fils livré
souvent par sa mère elle-même, à un libertinage
qui alors n'avait rien de repréhensible, voilà ce
qu'était la famille Romaine. La matrone et sa fille
n'en pouvaient guères varier la froide régularité. Le
père et son fils l'auraient pu, s'ils n'avaient toujours
vécu au dehors, au milieu des affaires et des plaisirs,
et si on ne les eût rencontrés moins souvent
chez eux qu'au Champ-de-Mars, par exemple, ou
au cirque, dans les temples ou dans les boutiques.
Chez les femmes de naissance libre, l'éducation
avait un caractère moins grossier que chez les hommes.
A l'origine de Rome, au moment où la renommée
prêtait à Hermodore d'Ephèse la rédaction
des Douze Tables lorsque les Romains commençaient
à goûter les institutions de la Grèce et â connaître
les inspirations de sa muse, les femmes vivaient
tout à la fois sous l'empire de la sévérité
locale, et, sans doute, des traditions Helléniques.
Au temps d'Homère, les femmes ont je ne sais quelle majesté jusque dans les moindres soins de
leur ménage. Elles partagent le meilleur de l'autorité
conjugale. Elles ont l'ascendant de la beauté, et
c'est là ce qui les distingue de la femme chrétienne;
elles sont aimées ou admirées pour leurs vertus.
Hélène, toute coupable qu'elle est, se fait pardonner
les malheurs de Troie à force de grâce les
vieillards d'Homère la trouvent si semblable aux
déesses qu'ils n'osent la blâmer. Pénélope est un
modèle de résignation et de constance conjugales.
Lorsqu'elle fait cesser, par sa présence, les désordres
de ses prétendants et qu'elle change leur licence
en respect, elle est en face d'eux comme le symbole
du bien en regard de l'immoralité. Son prestige
s'explique, mais il sera de courte durée. A cette époque
encore, les femmes assises près de leurs époux,
prenaient part à tous les banquets. Elles reposaient
sur le même lit que les jeunes gens et les vieillards,
que Nestor et Phénix.Tout était pur alors l'innocence
couvrait, justifiait tout. Ce sont des jeunes
filles qui, par l'ordre de Pénélope, baignent Ulysse
à son retour dans Ithaque et il est à peine besoin
de citer Iphigénie, Polyxène, Antigone, Alceste, Hécube
pour rappeler les vertus ou la beauté de la fille
et de l'épouse grecques, que l'épopée et la tradition
avaient transmises à la tragédie. Mais le mal était,
là comme ailleurs, l'inévitable voisin du bien. La critique devait suivre l'apologie. A côté
d'Homère, Hésiode médira des femmes; il se souviendra de Clytemnestre plutot que d'Andromaque
Se fier aux femmes,s'écrieca-t-il, c'est se fier à des fourbes
et plus tard Euripide, le peintre d'Iphigénie, écrira
Médée et se rendra célèbre par la haine que ce sexe
lui inspire.
La constitution républicaine qui succéda à la
royauté changera complètement leur sort. Ces occupations
d'intérieur, qui primitivement n'étaient
qu'une partie de leurs attributions,devinrent la seule,
après l'invasion Dorienne. La femme,grecque fut
reléguée dans sa maison, sans relations avec le dehors
et réduite à subir les événements qu'elle aidait à préparer naguère. Cet état d'infériorité, qui était
dû en partie aux agitations politiques des diverses
républiques entr'elles permettait aux époux de
porter toute leur attention aux luttes de l'Agora.
La comédie ne pouvait manquer de saisir et de
ridiculiser ce besoin de leur émancipation première
qui devait dominer les femmes, à l'aspect de tant
de débats dont elles ne prenaient plus leur part.
Thucydide a beau dire, pour les ramener à leur
infériorité, que le plus bel apanage des femmes est
de se cacher et de ne point faire parler d'elles ; Aristophane, au lieu d'une sentence, essayera de le leur
apprendre par des exemples. La Lysistrata et les Harangueuses seront tout
ensemble un tableau de moeurs
et une leçon. Des femmes qui conspirent pour la politique
ou qui veulent inaugurer la communauté des
biens et l'égalité des deux sexes, sans y réussir, un
poète populaire qui se moque d'elles et leur fait avouer
maintes fois combien elles sont peu aimées de leurs
maris tout cela parlait bien haut contre leur sexe.
C'était un avertissement ingénieux et efficace de rester
désormais dans leurs maisons, d'exercer une active
surveillance sur les esclaves, de songer à la fabrication
de la toile et des vêtements, à la cuisson
du pain, d'économiser avec soin le superflu préceptes
sages, que Xénophon, lui aussi, avait écrits pour
elles, et qu'elles trouvaient sans doute humiliants
puisqu'elles s'y rangeaient si peu.
Le secret de leur déchéance se trouve ailleurs
aussi. Le discours de Démosthènes contr eNééra est
un tableau de moeurs bien plus instructif encore que
les leçons d'Aristophane et de Xénophon. La popularité
croissante des courtisanes, leur esprit, leurs relations
avec les hommes les plus influents de la république,
leur commerce plus aimable et moins onéreux
que celui des femmes mariées, leur séduisante
dépravation poussée à ses dernières limites, nuisirent
de plus en plus à l'ascendant des épouses. Faut-il s'ètonner
si celles-ci ne s'asseyaient plus à table, avec
des étrangers, à côté de leurs époux, comme aux temps homériques (1), et si Ménandre et Philémon
les ont tant décriées dans la plupart de leurs pièces ?
(1) Voici dans la préface de Cornel. Nepos, De vita, excellent, imperat. un curieux passage qui marque la différence entre la Romaine de son temps et la femme grecque: "Avons-nous honte de conduire nos femmes dans les repas auxquels nous assistons? Nos mères de famille ne tiennent-elles pas les premiers rangs chez elles et dans le monde? Il n'en est pas de même en Grèce. La femme n'est admise qu'à la table de ses proches, elle ne séjourne qu'au fond de sa maison, appelé gynécée personne n'y pénètre que ses plus proches parents."
Au nombre des règles que Xénophon a prescrites
à l'épouse dans ses Economiques, se trouve celle de
nourrir et d'élever ses enfants. Il n'y a pas de chapitre
spécial pour la jeune fille. Aristophane, de
même, dans la dispute du Juste et de L'Injuste de
ses Nuées, n'a parlé que de l'éducation des hommes.
Les Grecs ne donnaient toute leur attention
qu'à ceux-ci. Les Romains ont été aussi discrets
ou aussi négligents à cet égard. Nous avons à peine,
je l'ai déjà dit, quelques instructions sur la vie des
jeunes fillés libres de Rome. Dans les honnêtes
familles, elles avaient été élevées, dès le principe,
sous l'oeil de leurs mères, suivant avec elles la direction paternelle, et accoutumées à de sévères devoirs. A l'origine de Rome, sous l'empire de la
morale et de la règle on choisissait quelquefois
une parente d'un âge mûr et de principes exemplaires
pour lui confier tous les rejetons d'une
même famille. Devant elle, on n'eût rien osé dire
qui offensât la décence ou inquiétât la pudeur. Ce
n'étaient. pas seulement les études et les travaux
de l'enfance, mais ses délassements et ses jeux
qu'elle tempérait par je ne sais quelle sainte et modeste retenue. Bien que Varron dise encore plus
tard, dans ses Ménippées " la jeune fille est exclue
du banquet, parce que nos ancêtres n'ont pas voulu
que les oreilles de la vierge nubile fussent, abreuvées
du langage de Vénus, " cette discipline s'était
bien affaiblie déjà au VI° siècle de Rome. L'invasion
du luxe et des moeurs de la Grèce et de l'Asie, le
grand nombre des femmes maîtresses de leurs dots
et, par suite, plus libres dans le mariage, la contagion
du célibat et les ravages portés par les célibataires
au sein de la société, avaient ébranlé la vieille austérité.
Plaute, dans tout son théâtre, n'a osé montrer
qu'une seule fille libre, mettant toutes les autres
dans la situation exceptionnelle d'enfants exposés
dès leur bas-âge perdus pour leurs familles
laissés à la merci du vice des malheurs, de la misère, et n'ayant gardé quelquefois que la noblesse
du coeur au lieu de la dignité du rang, tant
il craignait tout ensemble de n'être pas vrai et de
profaner cette mystérieuse discrétion où se réfugiaient
l'orgueil et la chasteté des femmes bien
nées. La fille de Saturion du Persan représente
seule, dans ses comédies, la jeune Romaine de condition
libre. Mais, là encore, le grand comique a
été habile et circonspect. C'est à un des derniers
degrés de la société libre qu'il l'a choisie et il s'est
bien gardé de la montrer amoureuse. Saturion,
son père, est un parasite; et la vertu de la fille
vient plutôt de sa condition propre que des exemples
qu'on lui donne. Est-ce à dire que cette droiture,
mise en regard des fourberies de Saturion,
soit un charme ici? Plaute a mieux aimé la rendre
austère qu'attrayante; et il avait pour cela de bonnes
raisons. Il fallait défendre tout son théâtre,
son époque il fallait prouver que la vertu ne gagnait
rien à être tirée de son sanctuaire, car elle
touchait au pédantisme, et par conséquent à1l'ennui.
Il fallait faire ressortir, par le contrasté, ces
portraits de femmes graveleux, mais piquantes, que
l'auteur avait si complaisamment prodiguées ailleurs
et justifier, du même coup, les préférences
de son auditoire.
Cette fille de Saturion le dirai-je? n'est pas
sans ressemblance avec quelques femmes de la société
moderne. Avec,sa. morale sèche et trop expéfimentée avec son goût des sentences bien tournées elle me rappelle l'Hôtel de Rambouillet. Je
ne sais s'il faut accepter cette maison fameuse
comme le chef-lieu de la décence et de la puleur
au XVII° siècle, ainsi que le voulais M. Roederer
mais il est vrai de reconnaître que les D'Arigennes
que Madame de Sévigné tranchaient assez
fortement; par leur vie, avec le reste de ce monde
où la galanterie couvrait et fomentait des désordres.
Parmi lès femmes célibataires et honnêtes; je
ne sache pas de plus digne représentant de ces
Jansénistes de l'amour; comme les appelait Ninon
que la laide et sentimentale Scudéry, dont Boileau
disait qu'elle avait encore plus de probité et d'honneur
que d'esprit. Il ne faut pas trop s'en étonner. Le pédantismë, dans une âme bien douée,
était un préservatif alors que commerce des personnages et des faits illustrés n'est pas toujours
stérile. Quand on parle de Brute et de Clélie; on
tient à. se montrer; comme eùx, meilleur que les
autres et les grands noms peuvent inspirer les
grandes choses. La fille de Saturion, dans le Persan, est un peu de cette école là: Mademoiselle Scudéry,
au milieu des vices du XVII° siècle traite les sentiments
avec ce ton prétentieux qu'elle devait à l'hôtel
de Rambouillet et à sa condition de vieille fille-
auteur. A Rome, au sein des débordements qui se montraient déjà, Plaute entreprend de mettre en
scène aussi une personne spirituelle, sermonnant
son père avec la science d'une fille bien apprise et
traitant ses propres devoirs en précieuse Romaine
qui a étudié sa loi des Dottze Tables. Quand on lui
demande ce qu'elle pense des remparts qui défendent
la place, elle répond: « Si les habitants sont
vertueux, je.la crois assez bien défendue: pourvu
qu'on ait exilé la Mauvaise Foi, le Péculat, l'Envie,
etc. ». Mademoiselle de Scudéry n'eût pas mieux
dit. Seulement au nombre des vertus elle eût
ajouté la Bienséance et fait couler le fleuve, du
Tendre autour des remparts.
Ce fleuve-là nous mène droit aux jeunes premiéres
de Térence.. Bien que postérieures de vingt ans
aux jeunes filles de Plaute elles sont d'une ingénuité
et d'une gràce où l'imagination du peintre
est pour quelque chose pour trop peut-être.
Quelle discrète et aimable création, par exemple,
que l'Antiphile de l'Heautontimorumenos Le travail
à l'aiguille, une parure simple, point de bijoux,
des cheveux flottants négligemment sur un
cou modeste voilà Antiphile. La physionomie
est heureuse, et.la touche de Térence se reconnaît
à la délicatesse du trait. On aimerait à
croire que ce devait être là, ou à peu près, la jeune Romaine d'alors, élévée près de sa mère, dans la
sévérité de la règle primitive. Il y a je ne sais quel
parfum pudique qui s'exhale de ces retraites dérobées
à l'agitation du dehors, où s'enfermaient les
femmes grecques et romaines; comme en un sanctuaire
inaccessible à la passion; pareilles à ces femmes
de l'Orient moderne qui cachent leur beauté
sous les bandeaux et le cachemire, comme en une
châsse sacrée, pour ne point exciter les regards profanes
et pour conserver la paix du coeur.
Il me semble que la jeune Virginie devait avoir
vécu de cette vie austère et pure lorsqu'elle commença
à suivre les écoles publiques, et que le regard
audacieux de Clodius la rencontra dans tout
l'éclat de cette beauté que donne au visage d'une
honnête femme le charme de la jeunesse augmenté
de la pudeur surprise
Gratior et pulchro veniens in corpore virtus.
L'offense alors venait du mépris qu'un patricien fesait
d'une plébéienne l'orgueil du rang se confondait
avec la chasteté du sexe dans ce sentiment
d'effroi pudique que Tite-Live prête à Virginie. La
résistance était toute la vertu alors. Plus tard, sous
l'influence du Christianisme naissant, ce sentiment
mélangé de la femme dépouillera son orgueil pour
s'élever plus haut et s'ennoblir par la résignation.
Sa force, au lieu d'être toute virile et extérieure,
deviendra plus sublime en se contenant. Puisée à des sources moins terrestres, elle imposera l'admiration
en fesant taire le désir, ou elle subira les
affrontes sans trouble et la souffrance au lieu
d'être l'épreuve de la vertu, en sera comme la consécration
et le baptême; Après la mort volontaire
viendra le martyre, après Virginie, Jeanne-d'Arc.
Rien de pareil dans l'Antiphile de Térence. J'y
reconnais, malgré moi, je ne sais quelle ressemblance
éloignée avec l'Agnès de l'École des Femmes. Agnès, comme Antiphile; vit dans l'innocence et
dans la pratique des devoirs d'intérieur; elle ne
néglige pas l'aiguille, cet instrument de la vie honnête,
de l'industrie et quelquefois aussi de la fourberie
des femmes. Losrqu'Arnolphe lui demande
Qu'avez-vous;fait, ces neuf ou dix jours-ci?
Agnés répond
Six chemises, je pense, et six coiffes aussi.
Est-ce une raison pour que la pupille ne trompe pas
son tuteur? Agnès ne le croit pas, et joue Arnolphe
au bénéfice du jeune Horace. La vertueuse Antiphile
n'a pas plus de scrupule; malgré la précaution
prise par Térence de la cacher trop souvent au
spectateur; Antiphilé n'hésite pas à s'associer à la
ruse d'une courtisane pour épouser plus sûrement
celui qu'elle aime. Cette pureté relative, dont Térence
aime à orner ses héroînes, eette candeur, restée sans tache malgré l'absence de 1'amant et le
manque d'une famille, en dépit des funestes conseils
de la misère et de l'isolement; cette Virginie
de second ordre, qui, cette fois, s'est fiancée toute
seule à un autre lcilius, me semblent. une sorte
d'exception ici. Les temps et les moeurs n'étaient
plus les mêmes. La corruption, depuis Plaute,
n'avait fait que s'accroître et l'éducation, au moment
où écrivait Térence, se gâtait par le goût
même des jeux usités au théâtre. Térence a ici un
contradicteur remarquable. Voici une réfutation
que j'emprunte à un discours de ce même Scipion
Emilien, qui fut son ami. C'est un récit curieux
des moeurs d'alors:
« On apprend dit-il aujourd'hui des arts déshonnêtese On va avec des hommes de mauvaises moeurs, se mêler aux jeux des histrions, au son de la sambuque et du psaltérion. On apprend à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang des choses indécentes pour les enfants de condition libre les jeunes
gens et les jeunes filles de noble naissance vont dis-je, dans les écoles de danse, au milieu d'hommes de mauvaises moeurs!
Quelqu'un m'ayant rapporté cela, je ne pouvais me mettre dans L'esprit que les hommes nobles enseignassent de pareilles choses à leurs enfants, mais ayant été conduit dans une de ces
écoles de danse, j'y ai vu en vérité plus de cinq cents jeunes gens ou jeunes filles de condition libre. Parmi eux, j'ai vu, ce qui m'a vivement affligé pour la république, un enfant âgé
d'environ douze ans portant eneore la bulle, fils d'un candidat, qui exécutait avec des crotales une danse qu'un jeune esdave impudique ne pourrait honnêtement exécuter (1.).
Cette délicatesse que Térence donne ailleurs encore
à ses jeunes premières est donc un progrès qui
va au-delà des moeurs de son siècle. Ce n'est plus
l'instinct brutal et mobile que Plaute décrit avec
une vérité si audacieuse, ni cette sensibilité primitive
de quelques-unes de ses héroïnes; ce n'est plus
la chair seule qui glorifié ses sensations sous le nom
de sentiment. C'est mieux déjà que l'amour d'Anacréon,
de Properce et d'Horace, où le dévouement
n'avait rien à voir. Je sens battre dans ces coeurs
trop policés, non plus un sang impétueux et révolté,
le sang de l'Italie païenne, mais j'y touche à une
fibre plus délicate et à je ne sais quelles tendres
émotions qui semblent de l'amour moderne. On
raconte qu'un Scipion ( il faut toujours citer cette
famille là quand on parle de Térence), après une
de ses conquêtes, trouvant parmi ses prisonniers
une captive d'une beauté admirable se sentit la
force de la respecter et la rendit aussi pure qu'il
l'avait reçue à un prince Celtibérien; son fiancé.
Il y a quelque chose de ce respect chevaleresque
dans la plupart des amours de Térence. On dirait
que par l'élégance il a trouvé la politesse, et que sa
réserve naturelle lui a fait deviner la pudeur et la
discrétion de l'amour.
Il s'oublie quelquefois cependant et, quoiqu'il
fasse, il est ramené involontairement à la vérité
Romaine, au culte de la beauté sans apprêts. Ecoutons
Cheréa dans l'Eunuque. Ce qu'il exalte dans celle qu'il aime, c'est le naturel du teint, la fermeté
des chairs, la forte sève.
Son coeur bat comme celui de Chérubin, et il
ajoute " Ce n'est pas une fille comme les nôtres, à qui
a les mères abaissent les épaules, serrent la poitrine
pour leur faire fine taille. Quelqu'une a-t-elle un peu d'embonpoint? la mère dit que c'est un athlète,et lui retranche la nourriture. Malgré la bonté de
son tempérament, on en fait un fuseau." En vérité, se mettre à jeuner pour chasser l'embonpoint
voilà un raffinement de coquetterie que
l'industrie de nos femmes n'a pas surpassé. C'est
pour nous toute une révélation. Ainsi, ce besoin de
plaire qui autrefois ne se séparait pas de l'estime,
s'en était détaché à ce moment. Le goût des grâces
extérieures avait envahi le gynécée, et la jeune fille
subissait là aussi non-seulement l'exemple, mais
la direction maternelle! Du besoin de plaire à plaire il n'y a pas loin.
Pourvu qu'on eût une dot, fût-elle de dix talents, ou même de deux, on trouvait un
mari. Le désordre même à ce prix n'était plus un
obstacle. " Ne vois-tu pas, dit Saturion quelles
sont les moeurs d'aujourd'hui, avec quelle réputation
tant de filles trouvent ici à se marier? pourvu que la
dot y soit, le vice n'est plus vice". La fortune
était donc devenue la seule condition nécessaire
pour faire porter devant la nouvelle mariée, comme
dit 0lympion, le flambeau du mariage. Les
orphelines étaient plus heureuses elles recevaient
au lieu d'apporter, et n'avaient pas toujours à craindre
de rester filles. Car, j'imagine que la loi qui ordonnait
à leurs plus proches parents de les épouser,
au dire de Géta dans le Phormion, était aussi une loi
Romaine. Il y avait quelques exceptions pourtant.
On pouvait éviter le mariage en leur donnant une
dot de cinq mines, mais pour cela il fallait que
l'orpheline fût notoirement décriée.
Les flambeaux n'étaient pas seuls destinés aux
honneurs de la noce les choeurs, les flûtes fiburaient
aussi. Quelquefois la joueuse de flûte se fesait attendre et retardait le moment solennel.
D'autres fois s'était la lenteur de la jeune épouse
qu'on accusait, " C'est 1a lenteur même, assurrément,
qui a donné naissance aux femmes, s'écrie Pleuside, dans le Fanfaron, car, de toutes les lenteurs
imaginables, il n'y en a pas d'égale aux leurs" Le
mari d'une coquette à sa toilette dirait-il autrement
aujourd'hui? Le moyen, en effet, d'être lestement
préparée, quand on ayait près de soi une mère occupée à serrer la taille
et autour de soi des esclaves, vingt costumes, vingt coiffures de modes nouvelles à essayer, à endosser; la tunique transparente,
par exemple, ou la tunique épaisse, le linon à
franges, l'intérieure, la chamarrée, la fleur de
souci, la safranée, le par-dessus ou bien, le sens dessus-dessous, le bandeau, la royale ou l'étrangère,
la vert-de-mer, la plumettée. la jauner cire, la
jaune-miel, et mille autres frivolités? Heureux encore l'époux impatient s'il n'avait pas d'autre sujet de plainte, et si durant les apprêts de la
fête, il ne voyait point un chien noir étranger dans la maison, ou un serpent tomber dans la cour, oü
une poule chanter au plus beau moment, présages
funestes de l'infidélité et de l'autorité prochaines de
la jeune mariée.
Il ne faut pas trop s'étonner que ce soit surtout
à Térence que nous empruntions les principales
scènes de la vie des filles libres et de leur mariage.
C'est au mariage que Térence pousse avant tout
ses personnages, mais au mariage où l'affection soit
subordonnée finalement à la convenante. Le théâtre
latin, en général, glorifie le mariage d'inclination. Mais chez Térence, la sympathie, quand
il y en a, s'augmente de la distinction. Toutes ses
jeunes premières se marient ou sont admises dans la
famille, à l'exception d'une seule qui est une courtisane
éhontée, la Bacchis de l'Heautontimorumenos. Quand il fait prédominer la force des sympathies,
il va jusqu'à conclure des mariages sans aucune
dot, témoin celui de Callidie avec le fils de Demée
dans les Adelphes, malgré cette loi de l'opinion qui
ne sanctionnait pas les mariages non dotés.
Térence a fait plus encore pour la bienséance. Sous le couvert des Grecs, il a imaginé de mettre
au théâtre des femmes nées libres, mais d'une
liberté que la scène pouvait montrer sans inconvénient. Ce sont des étrangères ou des orphelines
pauvres, comme Antiphile, vivant dans l'obscurité,
avec une mère, une amie ou une étrangère comme
elles, de cette vie équivoque qui n'est point le vice,
puisqu'elles gardent une entière fidélité à celui
qu'elles aim ent, et qui n'est pas la vertu, puisqu'elles
ont,un amant et souvent un mari clandestin.
Je ne veux point examiner si ces créations mixtes
ne devaient pas compromettre davantage cette
sévérité du foyer domestique que Térence tenait à
ménager. Je constate seulement que, à défaut de
Plaute, c'est là surtout qu'on devait trouver quelques
détails sur la fille libre de la Comédie latine.
Plaute me paraît avoir mieux servi la cause des
honnêtes femmes en reléguant indistinctement
parmi les courtisanes ou les captives, ce qui est ordinairement la même chose, toutes les âmes
ingénues qui s'étaient laissé surprendre par l'amour. Il n'y a pas de scènes plus piquantes,
plus vives ou plus touchantes que toutes celles
qu'il a écrites sur cette partie trop importante du
monde romain. On pourrait ici faire des catégories
sans fin et tracer l'histoire de la courtisane esclave,
de l'affranchie, de la cliente, de l'indigène, de
l'étrangère, etc. Il n'y a, à le bien prendre, que
deux classes à noter. Ce sont les courtisanes viles,
et les courtisanes honnêtes.
Les courtisanes viles ont une poétique, j'aime
mieux dire une règle de vie curieuse il n'est pas besoin de reconnaître que l'intérêt en fait le fond, Les
vieilles, qui ont gaspillé leurs jeunes années dans le
désordre, n'ont plus que le souci de l'argent et de
la bonne chère. Rarement la coquetterie leur est
restée. Je doute qu'il y en eût beaucoup de semblables
à ces Phrynés surannées dont se moquait
Scapha dans la Mosteltaria qui se parfument de
toutes sortes de parfums et qui tâchent de se remettre
à neuf; vieillotes édentées qui dissimulent
avec du fard les défauts de leur personne. Chez
elles, quand la sueur vient à se mêler avec les
parfums, l'odeur qu'elles ont ressemble à ces mélanges
de plusieurs sauces que font quelquefois les
cuisiniers. Elles aimaient mieux le fard joyeux qui vient d'un bon vin et se faisaient gloire de
mériter les noms de Multibiba et de Merobiba,
comme Tibère plus tard celui de Biberius Mero. Ce
qu'elles n'épargnaient pas à leurs jeunes écolières,
ce sont les conseils sur l'art de tirer de l'argent d'un
coeur épris et sur les suites désastreuses d'un amour
véritable, quand celles-ci en étaient atteintes.
Quant aux belles paroles des amants ruinés, aux
promesses séduisantes, c'étaient pour elles peines
perdues. Elles n'avaient foi qu'à ce qu'elles tenaient " Nos mains ont des yeux, répondait la vieille
Cléerète à un amoureux appauvri, elles ne croient
que ce qu'elles voient."
Elles étaient tantôt les maîtresses, tantôt les
sèrvantes de leurs jeunes compagnes. A ce dernier
titre, elles devaient faire patte de velours à tout
venant, sourire avec agrément et cacher le piège
sous mille agaceries. Maîtresses, elles n'avaient
pas tant de ménagements à garder. Elles étalent
à tout moment et tout haut leurs ignobles doctrines.
Ce ne sont que comparaisons piquantes
jetées sans honte au nez des amants. Tantôt l'amoureux
est un poisson qui n'est délicieux que
quand il est frais, parce qu'alors on le met à toutes
sauces une fois vieux et quand on en à tout
tiré, il ne vaut plus rien; ou c'est une brebis, qu'il
faut envoyer paître une fois qu'elle est tondue. Tantôt c'est une ville ennemie où il ne faut laisser
que les murs. Philosophie destructive qui sème
bien des ruines autour d'elle! Enfin ce sont elles qui
traitent aussi les grandes affaires et se font donner
ces singuliers contrats, signés et paraphés, par lesquels
leurs pupilles, moyennant une somme ronde,
sont la propriété. mensuelle. ou annuelle du plus
offrant. Nous en avons un complet avec toutes ses
clauses dans l'Asinaire. C'est un monument de
dépravation et de cupidité qui a son prix. J'ignore
si les voluptueux de nos jours s'abaissent à faire
des contrats pareils. Mais, en tous cas, ils ne les
signent pas.
Les jeunes courtisanes, tombées entre les mains
de ces mégères, ou de ces traficants non moins
rapaces dont le nom de prostitueurs est assez tristement
significatif, trouvaient autour d'elles, on le
voit tous les encouragements de la débauche.
Leur beauté, leur jeunesse étaient un appât de
plus pour prendre, comme elles disaient, ces poissons
si bons à garder, qui tombaient dans leurs
rets. Cette beauté était pour,elles d'un prix inestimable.
Bacchis l'explique fort bien à Antiphile
dans l'Heautontimorumenos, et Scapha à Philematie
dans la Mostellaria. C'est la fragilité même de ce
mérite, fort lucratif pour elles, qui les forçait à se montrer cupides et intéressées. Car, une fois la
beauté partie, les amants partaient avec elle.
" Sur mon honneur, dit la Bacchis de Térence, je vous félicite,
ma chère Antiphile, et vous estime heureuse d'avoir su:
tenir une conduite qui répondît à votre beauté; je ne suis plus
,étonnée, de par tous les dieux! que chacun vous recherche.
J'ai pu juger de votre caractère par vos paroles. Quand je songe
à la vie que vous menez, vous et toutes les femmes qui comme
vous évitent le monde, je ne trouve pas étonnant que vous soyez
si vertueuses, tandis que nous le sommes si peu. Vous avez tout
profit à vous bien conduire; nos amants à. nous ne nous le permettent
pas; car ils ne s'éprennent de nous que pour notre beauté.
Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs coeurs à d'autres. Si
nous ne nous sommes préalablement ménagé quelques ressources,
nous vivons alors dans l'abandon. Vous, au contraire, si
vous avez une fois consenti à unir votre destinée à celle d'un
homme dont les goûts sont tout-à-fait conformes aux vôtres, cet
homme s'attache exclusivement à vous. Grâce à ce lien, vous
êtes comme enchainés l'un à l'autre, et jamais aucun orage ne
peut troubler votre affection. (1)"
(1) Térent. Heautont. 381 sqq.
Le contraste entre la corruption et l'ingénuité
est plus franc dans Plaute
"SCAPHA. Grâce à ta jolie figure tout ce que tu mets te va
bien.
PHILÉMATIE. Flatteuse, tais-toi.
SCAPHA Ma foi tu es bien sotte. Est-ce que tu écouterais
plus volontiers des mensonges malveillants que des vérités à ta
louange ? Quant à moi, par Pollux, j'aime beaucoup mieux m'entendre
louer faussement que d'être justement critiquée et de voir
qu'on se moque de ma figure.
PHILEMATIE. J'aime la vérité, je veux qu'on me la dise; le
mensonge m'est odieux.
SCAPHA. Par l'amitié que tu me portes, pâr.l'amour que
Philolachès a pour toi, tu es charmante. Vraiment, par Pollux,
je m'étonne qu'une fille si avisée, si instruite, si bien apprise et
qui n'est pas sotte, se conduise sottement.
PHILEMATIE. Eh bien! montre-moi, je te prie, en quoi j'ai
tort.
SCAPHA. Oui, assurément, tu as tort de ne penser qu'à lui,
de lui être si dévouée de n'en pas écouter d'autres. C'est bon
pour une femme honnête et non pour une courtisane, de se
rendre esclave d'un seul amour.
PHILEMATIE. Ne me donne pas de mauvais conseils, Scapha.
SCAPHA. On voit arriver plus souvent ce qu'on n'attendait
pas que ce qu'on attendait. Enfin, si mes paroles ne peuvent
pas te persuader de cette vérité, jngé de mes paroles par les faits
tü vois un exemple quelle je suis, quelle je fus jadis. Je n'étais
pas.moins aimée que toi aujourd'hui je me donnai tout entière
à un seul amant, et lui par Pollux, dès qu'il vit la couleur de
mes cheveux altérée par l'âge il me délaissa, il m'abandonna.
Sois sûre qu'un mêmes sort t'attend." (1)
(1) Plaut. Mostell. 174 sqq.
Si encore elles avaient pu se faire un pécule dans leurs bonnes fortunes! Mais "une courtisane est pareille à la mer tout ce qu'on lui donne, elle le dévore sans qu'il.y ait accroissement pour elle. Du moins la. mer conserve ce qu'elle renferme subsiste toujours. Mais donnez tout ce que vous voudrez à une courtisane, il n'en reste rien, ni pour celui qui donne, ni pour celle qui a reçu. " (1)
(1) Plaut., Trinum, 531 sqq.
La coquetterie et la vanité, Phronesie l'avoue, les rendaient prodigues.
Le libertinage et l'économie ne vont guères de pair,
et Plaute, dans le prologue du Trinumus avait
personnifié l'ndigence comme fille de la débauche.
On citait les courtisanes qui avaient su s'enrichir:
c'était l'exception.
Ennius nous a laissé de la courtisane et de sa
mobilité perfide un charmant croquis dont le
théâtre de Plaute est le meilleur commentaire.
Cette coquette qu'il compare à
"une balle inconstante
Qui circule et voltige et trompe notre attente" sera plus sévèrement traitée par Lucilius
" Plus méchante mille fois dit-il, que ce lion dont nous parlions tout-à-l'heure, plus elle est carressante
et plus l'enragée vous mord" (1).
(1) Lucil. fragm. Corpet. xxx. 12.
Peut-être veut-il signaler ici. plutôt une de ces Laïs à deux oboles, parfumées de lavande, cagneuses dont les courtisanes elles-mêmes faisaient litière. Car là aussi se glissait la vanité des rangs, et Molière n'eût pas manqué de se demander, en les entendant, où la dignité allait se nicher" il rentre, dit l'une d'elles, car une courtisane; qui se tient toute seule dans la rue, a bien l'air d'une prostituée. La modeste Adelphasie du Carthaginois ne veut pas se rencontrer à l'autel avec " ces bonnes amies des gardes-moulins, restes de galants enfarinés" (1).
(1) Plaut., Poenul.,v. 261 sqq. Il faut sans doute ranger aussi dans cette classe cette Créléa citée par Lucilius (Varron Ling. Int., vi, 69), qui était venue d'elle-même trouver un ami. Juvenal, Sat. vi. Cette satire est l'historique le plus complet de toutes ces turpitudes.
A coup sûr, la Lesbie
de Catulle ou cette Flora, qui institua le peuple
Romain son héritier, n'avaient rien à démêler avec
cette méchante engeance, bien qu'elles fussent
comprises pour la plupart, les unes et les autres,
parmi les femmes du second ordre, in classe secunda,
comme l'a dit Horace. Les poursuites amoureuses dont les courtisanes
étaient l'objet ne se cachaient pas dans l'ombre
comme pour les filles de condition libre. On n'avait
aucun scrupule de leur faire des signes en
les rencontrant, de les appeler tout haut en pleine
rue. On ne s'en tenait pas là tantôt leurs portes
étaient assiégées par vingt carillons ou charbonnées
d'inscriptions galantes avec le bout de cette même
torche qui, la nuit, servait à éclairer les soupirants;
tantôt c'étaient leurs fenêtres qui retentissaient sous
les doigts de ces amis impatients. La Tarentilla de Naevius, la coquette d'Ennius, les courtisanes de l'Asinaire et de la Mostellaria, nous ont appris comment toutes ces avances étaient accueillies. Nous
savons même, par un passage du Fanfaron, qu'il
ne fallait pas toujours prendre au sérieux les appels
que les courtisanes faisaient à leur tour en pleine
voie publique.
Une fois trouvé et accepté, l'amant quittait rarement
celle qu'il avait choisie. Il la suivait même
aux écoles, comme Phedria, par exemple, aimait à
le faire pour Pamphile du Phormion, la conduisant
et la reconduisant sans cesse. On y allait, entr'autres,
apprendre à jouer de la lyre. Mais quand
la moisson ne donnait pas et que les galants manpuaient, elles faisaient courir au port, attendre les
vaisseaux étrangers, s'informer du maître et de son
nom et saisir les dupes au débarquement.
Ces femmes, si hardies à la chasse des amoureux
sont pour la plupart molles et hautaines, sans
force pour le travail. Cette industrie infâme a les
mêmes caractères sous toutes les latitudes. «Je ne
suis pas accoutumée à porter des fardeaux, à mener
paître les troupeaux, comme une paysanne » s'écrie
la belle Pasicompsa du Mercator. Ces mains,
qu'elles passaient des heures à laver ce teint
entretenu par l'oisiveté, cette peau qu'elles polissaient
et repolissaient des journées entières,
auraient pu se gâter sans doute à ce métier. Leur
coquetterie ne s'accommodait guères que du repos. Elles avaient d'ordinaire pour les aider dans les
soins de leur toilette deux servantes, et souvent
deux hommes pour leur apporter de l'eau sans
compter toute cette suite d'esclaves et d'affranchis
que quelques-unes traînaient après elles, portant les bijoux et tous les oripeaux de leurs maîtresses.
Il y a sur ce point un endroit curieux dans l'Heautontimorumenos. C'est lorsque Bacchis est près de
venir au second acte. Le nombre d'esclaves et
d'objets dont elle se fait suivre est si embarrassante
qu'elle ne paraît qu'après une fort longue scène,
quoiqu'on l'ait entrevue au début. Elles se rendaient
souvent dans les temples pour assister aux fêtes.
Avant d'approcher des autels, elles se purifiaient
par des ablutions, comme ces deux jeunes soeurs,
du Carthaginois, au jour où l'on célébrait la fête de
Vénus, la solennité des Aphrodises. Cette valetaille,
dont elles faisaient volontiers étalage, s'augmentait
encore des esclaves étrangers que leur
donnaient plus particulièrement les soldats fanfarons
au retour de leurs campagnes. C'est ainsi,
entr'autres, que Phronesie du Truculentus reçoit de
son militaire le don de deux esclaves Syriennes,
princesses dont il a dit-il, changé le pays en désert.
Phedria, dans l'Eunuque, est plus généreux encore.
Il accorde un eunuque à sa Thaïs, qui l'a demandé
parce que les grandes dames seules en ont un à leur service
et une de ces négresses d'Ethiopie déjà
fort recherchées au temps de Ménandre.
En échange de tant de faveurs, elles se montraientt aimables et caressantes. Elles donnaient à
ceux de leurs amants qui étaient forcés de voyager des cachets dont elles avaient un double, portant
un portrait un signe convenu, c'était comme
une lettre de créance sur leur tendresse. Elles leur
écrivaient de ces aimables missives d'amour sur la
cire de deux tablettes nouées d'un fil oû les mots
les plus gracieux ne leur coûtaient pas à dire;espèces de circulaires dont le style faisait partie de
'leur trompeuse industrie, et dont nous trouvions
un modèle très finement tourné dans le Pseudolus.
Plaute a mis là, sous le poinçon de Phénicie, ses
plus jolis néologismes, ses minauderies les plus
coquettes. Il ne fâut pas s'étonner de tous ces
manèges qui égalent toutes les ruses, toutes les
perfidies que nous connaissons déjà. Comment résister
à ce goût de la fraude qui était comme la condition
propre de leur existence? Comment l'oiseleur
n'eût-il pas mis en jeu son appeau et ses miroirs,
quand l'oiseau courait de lui-même à la glu
et s'offrait si facilement au lacet? Au fond pourtant, on ne sait qui il faut plaindre le plus, de ces
femmes obligées à tous les mensonges pour captiver
toujours., ou de ces dupes qui, dans leur aveuglement,
consentaient à partager leur possession
avec d'autres plutôt que de la laisser échapper.
Plaute, du milieu de tant de désordres instructifs
pour nous, avait su tirer des leçons plus
instructives encore. Du plus profond de ces âmes
corrompues et perdues pour ce monde sortaient
quelquefois des accents touchants et vrais, de
vagues aspirations, on le dirait, vers un monde
meilleur. La constance, l'attachement, le dégoût
du libertinage étaient souvent la suite inattendue
d'une dégradation involontaire. Nous voulons parler
des courtisanes honnêtes. La liste, on le prévoit,
n'en saurait être longue.
Parmi ces femmes sans nom, sans origine, qui
faisaient leur patrie du lieu où elles étaient le plus
à.l'aise, ubi bene ibi patria comme elles disaient,
il s'en trouvait que le hasard ou le malheur avait
éloignées de leur famille, victimes de la cupidité d'un
trafiquant, abandonnées dès leur bas âge ou forcées
de transiger avec la misère. Quelques-unes, comme
Gymnasie dans la Cistellaria, froidement débauchées,
avares sans égoïsme, dépravées seulement
par l'habitude, se montraient obligeantes et respectueuses.
Leur naïveté dans la turpitude les rendait
excusables. D'autres avaient un instinct singulier du bien et arrivaient à la dignité par la reconnaissance.
Telle est Philématie dans la Mostellaria. La
blancheur de son teint, sa beauté semblent refléter
son âme.
« Selon la réputation qu'on a, dit-elle, l'argent vient en conséquence.
Que j'aie bonne renommée, je serai assez riche. En
vain on met grand soin à se parer, si l'on se conduit mal. La
mauvaise conduite est pire que la fange pour gâter l'éclat des
parures. »
Elle n'aime que Philolachès, elle ne vivra que
pour lui seul. Ne l'a-t-il pas d'ailleurs affranchie?
Quand la vieille Scapha lui reproche son oubli des
autres amants, elle répond " Ils m'estimeront davantage
en voyant que je suis reconnaissante." Voyez la pure physionomie de Silénie dans la
Cistellaria de Philénie dans l'Asinaire
SILÉNIE. Le coeur me fait mal.
GYMNASIE. Tu m'étonnes. Comment le coeur peut-il te faire
mal? explique-le-moi, je te prie; les hommes prétendent que les
femmes n'en ont pas.
SILÉNIE. Si j'en ai un, c'est lui qui souffre; s'il n'existe pas,
ma souffrance est là toujours.
GYMNASIE. Elle aime, la pauvre enfant
SILÉNIE. Quoi l'amour est-il si amer, lorsqu'il entre dans
l'âme ?
GYMNASIE. Sans doute, par Castor! dans l'amour le miel et
le fiel abondent à la fois. Il fait goûter bien des douceurs, mais
il est prodigue aussi d'amertume il en abreuve.
SILENIE. Je reconnais à ces traits le inal qui me tourmente.
GYMNASIE. Du courage! ton mal s'apaisera.
SILÉNIE. Je l'espèrerais si je voyais venir le médecin qui seul
peut me traiter. Il viendra! que ce mot est lent quand on aime!
pourquoi pas, il vient? Folle que j'étais c'est ma faute si
j'éprouve des peines si cuisantes. Fallait-il m'attacher à lui seul
pour lui consacrer toute ma vie ?
GYMNASIE, Quelle idée avais-tu, ma chère Silénie.? Bon pour une
matrone de n'aimer qu'un seul homme et de passer ses jours avec lui, une fois qu'elle est mariée, Mais une courtisane,
c'est tout comme une ville florissante elle ne prospère qu'autant
que beaucoup d'hommes la fréquentent
SILÉNIE. Prêtez-moi attention, s'il vous plaît, je vous expliquerai pourquoi je vous ai priée de venir me voir. Ma mère,
voyant ma répugnance pour la profession de courtisane, et voulant
récompenser par sa complaisance mon empressement à lui
plaire en tout, me permit, si je venais à concevoir une passion,
de vivre avec celui que j'aimerais.
LA MÈRE. Par Castor quelle sottise Mais as-tu formé une
liaison ?
SILENIE. Avec Alcésimarque, avec lui seul. Aucun autre
homme n'a porté atteinte à ma pudeur.
C'est ici un dégoût insurmontable du vice que le
dénoûment justifiera en rendant à sa famille libre
cette fille touchante dont les moindres paroles annonçaient
un sang généreux; là, c'est la tendresse désintéressée,
une instinctive sympathie pour un seul;
c'est aussi l'ennui de cette vie de subordination et
d'efforts, qui ne permettait guères de suivre ses meilleures
inclinations. Vivre avec l'être préféré, lui
rendre en dévoûment ce qu'elles ont reçu en libéralités, ou mourir s'il meurt, voilà la passion dernière
de ces créatures à part. Plaute en les
représentant, a voulu respecter toutes les classes
sans en intervertir l'ordre; il a, je l'ai dit, mis la
noblesse dans le coeur et non dans le rang, se réservant,
à la fin de justifier l'un par l'autre. Mais
c'est ici, ce devait être l'exception.
Térence en a fait à peu près la règle de son
théâtre. Ses courtisanes sont honnêtes, elles ont
réfléchi sur elles-mêmes, ce qui est assez rare,
dit-on elles se sont trouvées trop libres, ce qui
marque une grande sagesse, et elles ont changé de
vie, ce qui est une invraisemblance et un anachronisme.
Je choisis, pour exemple, la courtisane Bacchis
de l'Hecyre. Il faut ramener la paix dans un jeune
ménage dont l'époux a aimé Bacchis. C'est elle qui
s'en chargera, bien qu'elle n'ait qu'à se louer de son
amant. L'invraisemblance commence déjà. MaisTérence
tient surtout à faire mieux que les autres c'est
là l'écueil. Quand Bacchis est invitée à se rendre
dans la famille du jeune époux, elle dit"Toute autre de mon état n'en ferait, ma foi, rien. Elle n'irait
pas se montrer à une jeune épouse. Mais je ne veux pas
que les parents de Pamphile, qui doivent l'estimer, le jugent
sans raison plus léger qu'il n'est."
Après ce trait de dévoûment, les parents. enchantés lui offrent leur amitié. Mais voici le secret de toute cette conduite, ou plutôt de tout le théâtre de
Térence, car il semble que ce soit lui qui se révèle
ici par la bouche de Bacchis " Je ne serai pas fâchée qu'on dise que je suis la
seule qui ait fait ce que mes pareilles évitent avec
grand soin."
Je me borne là. Nous n'assistons plus aux tentdres
épanchements d'une âme aimante, ce n'est plus
ici le cri du devoir désintéressé. C'est une femme
d'expérience qui calcule ses démarches, quoiqu'elles
soient honnêtes, qui fait le bien précisément
parce que ses pareilles ne le font pas. Elle tient
avant tout à faire parler d'elle par quelque chose
d'extraordinaire. Cette conduite, loin de me complaire,
m'étonne je vois une courtisane devenue la
providence d'un jeune couple et. je ne me laisse
guères séduire à cette vertu impossible.
Quand on parcourt tout le théâtre de Térence, il
est facile de reconnaître tout d'abord qu'il veut moraliser
la scène et que, par suite, il est l'ennemie des
courtisanes, telles qu'on les voyait à Rome, telles
que les avaient représentées ses prédécesseurs. Sa
pudeur s'effraye de voir réunies sous le même toit
une fille de joie et une maîtresse de maison, une mère de famille.Dans les Adelphes, Demée s'écrie
Pro divum fidem !
Meretrix et mater familias una in domo !
et la Bacchis de l'Hecyre ne manque pas de reconnaître
en entrant chez Philumène que la présence
d'une courtisane est un épouvantail pour une
jeune épouse. Ces sentiments si choisis, cette décence
inattendue au théâtre, je les retrouve encore
à un plus haut degré dans une scène de réprimandes,
où l'irascible Chrêmes tonne contre son fils. Ce
mari si peu respectueux pour sa Sostrate, sa mater
familias et qui lui disait tout à l'heure, entre autres
injures, "parlez, parlez, je n'en ferai pas moins
ce que je veux", ce moraliste si oublieux, dès qu'il
veut gourmander son fils, s'écrie
" Vous ne cherchez pas ce qui vous manque le moyen de
plaire à votre père et de conserver ce qu'il a gagné à la sueur de
son front. Amener devant mes yeux par toutes sortes de subterfuges une...
j'aurais honte de prononcer le mot en présence
de votre mére"
Cette pudeur excessive quelqu'invraisemblable
qu'elle soit, porterait son excuse avec elle si Térence l'avait gardée dans tout son répertoire. Mais
n'est-elle pas un contre-sens, quand je vois ailleurs,
dans l'Eunuque par exemple, la courtisane Thaïs,
celle qui se partage définitivementet sans rougir entre
deux amants qu'elle aime inégalement, entrer dans
une famille libre et se faire admettre dans la clientèle
et sous la protection du père de son Phedria (1)?
(1) Chez Plaute les courtisanes n'avaient pas besoin d'être douées de ces qualités de bon ton, de ces mérites de la bonne société pour être les clientes des maisons libres.
Et ce dégoût du vice n'est-il pas un dégoût de convention
qui ne saurait me convertir au bien, quand je
vois la courtisane de l'Hecyre devenue, comme je
l'ai dit, l'amie d'une honnête maison ?
Balzac disait avec raison que les plus libres
courtisanes des comédies de Térence sont souvent
plus modestes que les plus honnêtes matrones des
comédies de Plaute; et je ne m'étonne pas que ce
soit celui-là qu'ait choisi pour modèle, au 10° siècle, la nonne Hrotswitha, quand elle voulut mettre en
scène la courtisane corrigée. Seulement, avec les embellissements
du comique latin, Hrotswitha avait un
correctif de plus. Le Christianisme était venu. En
ramenant, par le mépris, ces femmes de plaisir au
sentiment de leur turpitude, en montrant le ciel et
le pardon à leur repentir, il devait leur inculquer la
vraie dignité. Elles se purifiaient par les pleurs et
par la prière, deux choses que le paganisme n'a
pas connues. Madeleine n'avait-elle pas baisé en
pleurant les pieds du Christ et ressaisi, par le
remords, l'estime d'elle-même ? La courtisane sainte
Afre n'avait-elle pas, au 4° siècle, reçu chez elle un
pieux évêque et ne s'était-elle pas convertie à la
vertu par la seule séduction, par l'action bienfaisante
de sa présence? Souvent même la mort était
choisie comme la seule expiation légitime. Dans sa
comédie de Paphnuce, Hrotswitha nous montre la
fille de joie Thaïs ramenée au bien par un homme
de Dieu. Son corps, cette enveloppe souillée, se dissout
et meurt. Son âme, libre et plus forte, s'envole
aux cieux pour y recouvrer toute sa candeur native.
C'était là l'unique moyen de traduire la courtisane
à la barre d'un couvent.
Mais Térence avait-il besoin de devancer ainsi
son temps en fardant le personnage? L'antiquité
toute entière n'a-t-elle pas été aux pieds des courtisanes? Qui a reçu plus de fêtes, plus d'encens que
ces Aspasie, ces Néera, que cette Précia, maîtresse dé Lucullus, si vantée par Plutarque ? Où brillaient
l'esprit, la fortune, les fils et avec eux, il faut bien
le redire, les pères des grandes familles de Rome et
d'Athènes? n'était-ce pas chez elles sans cesse et
pour elles? On allait là, comme on allait, au
XVII°siècle, chez Ninon, dans sa maison du Marais,
faire montre de bel esprit et de galanterie, parler
des choses de la ville et rencontrer les hommes du
bel-air. Pour beaucoup d'entr'elles, malgré leur
avidité, la vie n'avait qu'un jour, qu'un moment,
le moment présent; elles vivaient de frivolités et
d'insouciance, laissant à leurs mères le soin trop
lourd de tout prévoir; elles aimaient à oublier, ou
plutôt elles ignoraient ces préoccupations du lendemain
qui ailleurs assombrissent déjà la veille, et
elles changeaient d'amants, pour perpétuer leurs
plaisirs. Mais elles n'allaient pas, même dans leur
honnêteté, pourvoir, comme Bacchis au bonheur
de ceux qu'elles quittaient. C'eût été trop de prévoyance
et de désintéressement pour elles.
Dans un temps où la loi Oppia venait d'être
abrogée, après vingt ans de règne, non pas autant
par l'éloquence de deux tribuns ou par cette
bonne fortune du hasard qui gagne souvent les plus
mauvaises causes, que par l'ascendant des moeurs
régnantes qui sont, après tout la plus forte loi;
lorsque les mystères des Bacchanales portaient un
tel ravage au sein des moeurs publiques, que le
Sénat était obligé d'en arrêter les débordements; sous l'empire des chars, des litières, du luxe des
.festins et des toilettes, que les lois Scatinia, par
exemple, et Orchia purent à peine maîtriser un
moment; n'y avait-il pas pour ces femmes trop
populaires, partout dans l'air vicieux qu'elles respiraient,
dans la mode qu'elles suivaient et imposaient,
dans cette atmosphère brûlante de toutes
les ardeurs, où elles vivaient n'y avait-il pas les
éléments d'un bonheur tout Épicurien? Pour quelques-unes que l'ennui ou.,la honte venait atteindre
au milieu de ce sensualisme triomphant, combien
d'autres qui ne connaissaient rien au delà, et
qui couraient avec ivresse sur l'abîme en croyant
fouler des fleurs.
Il est temps de revenir à la morale et de laisser
l'histoire des passions pour celle de la raison. J'arrive
au mariage proprement dit, sans intervention
de courtisane.
Une fois mariée, la jeune fille libre, la jeune première changeait de condition. Elle passait sous le
toit conjugal à deux titres différents. Elle se mettait
sous la tutelle de son mari, lui abandonnait ses
revenus, et alors elle devenait mater familias ou
gardait sa fortune, ses biens et prenait le nom uxor. Alcmène de l'Amphitryon semble être
le type le pius choisi de la mater familias. Je sais
que cette tragi-comédie, toute exceptionnelle dans
le répertoire de Plaute, a sans doute une origine
plus particulièrement Grecque. Le Tarentin Rhinthon,
qui a donné son nom à cette sorte de drames
satyriques que les Grecs appelèrent Hilarotragédies
et les Romains fables Rhiynthonnies, avait écrit un Amphitryon qui a pu être le modèle de Plaute.
Avant cela même, le comique Archippus d'Athènes
avait donné une pièce du même nom et
l'on pourrait retrouver un Amphitryon jusque dans
le bagage de Sophocle. Mais l'érudition n'a
que faire ici, et Plaute, malgré son savoir, eût été
fort surpris sans doute d'apprendre le nombre des
aïeux de sa fable. Il ne tient pas trop longtemps
ses auditeurs hors de Rome car à peine Sosie a-t-il ouvert la pièce qu'aussitôt l'auditoire se reconnaît
et se retrouve. "Que deviendrais-je s'écriet-
il dès le début, si les triumvirs me mettaient en
prison". L'illusion n'est plus permise Alcmène
est bien Romaine.
Il me semble la voir revêtue du costume des honnêtes femmes décrit par Palestrion dans le Fanfaron, la robe traînante, la longue chevelure, les
bandelettes. N'est-ce pas Cornélie la mère des
Gracques, que j'entends dire à Sempronius, son
mari
" Il est une dot que je me flatte d'avoir apportée, non pas
celle qu'on entend ordinairement par ce mot, mais la chasteté,
la modestie, la sage tempérance, la crainte des Dieux, l'amour
de mes parents, une humeur concilianteà l'égard de ma famille,
la soumission à mon époux, une âme généreuse et bienveillante,
selon les mérites de chacun." (1)
Non, c'est Alcmène qui parle.
(1) Plaut, Amphit,, V. 685 sqq.
Cette déclaration
corrige tout ce que pourrait avoir de compromettant
pour elle cet adultère innocent, le seul que
Plaute ait osé montrer; de même que le déguisement
de Jupiter autorise la bouffonnerie sans danger pour
la morale de la famille. Le roi des Dieux ressemble
si parfaitement à Amphitryon qu'Alcmène est entièrement
justifiée. La tragédie et la comédie, dont
nous avons tracé le programme au commencement,
se mêlent ici dans une mesure appréciable. Jupiter
et son fils sont des personnages de tragédie; ils sont
hors des proportions humaines, et leurs actions sont
comme eux. Alcmène et Sosie sont des personnages
de comédie ils vivent de la vie générale leurs caractères
et leurs actions suivent la règle commune.
Plaute, en associant dans une intrigue comique ces deux sortes d'acteurs si différents d'abord, a fait une
tragi-comédie; il n'a qu'effleuré le tragique sans vouloir
le toucher franchement.
Serait-ce qu'il pensait, comme Figaro, que de
toutes les choses sérieuses le mariage est la plus
bouffonne, ou voulait-il avertir, en riant, les bienheureux
époux que la foi conjugale, comme tout
le reste, est soumise à une volonté supérieure, et
que là comme ailleurs, ils ne pourraient échapper
à leur destinée? Assurément, à part l'influence du
modèle grec, il semble qu'il y ait eu de tout cela
dans la détermination du comique latin. Ridiculiser
et avertir tout à la fois les maris sans entacher
la vertu, proverbiale encore, de leurs femmes, c'était là une veine nouvelle pour la comédie. Lucrèce,
cette tragédie de l'histoire, si populaire à Rome,
qu'était-ce autre chose qu'Alcmène ? L'une et l'autre,
esclaves volontaires du devoir honorent leur foyer
domestique par l'ascendant modeste de ces vertus
patriarcales qui à Rome surtout, étaient la seule
force de ce sexe subalterne. Elles aiment leurs maris
comme leur chasteté, mais ce qu'elles aiment
aussi dans cette autre moitié d'elles-mêmes qui
les domine et leur impose, ce qu'elles encouragent,
ce qu'elles exaltent en eux, c'est le devoir, c'est
plus que le devoir, c'est la gloire, c'est le renom
qui vient du courage. "Ah! qu'il s'éloigne de moi,
pouvu qu'il rentre avec honneur dans ses foyers.
Je ne me plaindrai pas, si l'on proclame mon époux vainqueur de l'ennemi. La valeur est un don
céleste. Liberté, puissance, richesse, existence, famille,
patrie, parents, tout est défendu par la valeur.
La valeur renferme en elle tout ce qu'on estime
c'est avoir tous les biens qu'avoir la valeur!"
Ces maximes, ce compliment flatteur adressé en
passant at la bravoure des spectateurs Romains, on
dirait qu'ils sont de Lucrèce, louant l'intrépidité
de son époux occupé au siège d'Ardée. C'est Alcmène
qui parle, au moment où son faux mari la
quitte pour aller battre les Téléboëns.
L'analogie ne se borne pas la. L'une et l'autre
ont admis un étranger dans l'asile inviolable où
elles se renferment. Mais Lucrèce seule en a reçu
le plus sanglant outrage, et l'on sait quelle catastrophe
instructive a suivi et quelle révolution. Plus
tard, Attius écrira une tragédie nationale pour consacrer
la délivrance de Rome après le suicide de
Lucrèce. Mais je doute que dans son Brutus il célèbre
autre chose que la liberté publique, malgré
un vers qui semble appartenir au récit de l'attentat
commis sur la femme de Collatin. Faire reposer
l'intérêt de sa pièce sur le crime de Sextus,
montrér un patricien coupable, c'eût été trop s'exposer
dans un pays ou Naevius avait, si chèrement,
expié quelques allusions contre l'aristocratie contemporaine.
La censure était terrible alors; elle avait des chaînes pour les récalcitrans au lieu
d'éloigner la pièce seule des honneurs du pulpitum, c'était l'auteur qu'on exilait loin de la métropole.
La censure de nos jours, fille de la censure Romaine,
vaut déjà mieux que sa mère.
Plaute, qui avait poussé la circonspection jusqu'à
se moquer, dans deux vers que je blâme, du châtiment
de Naevius, avait sons les yeux des célibataires
entêtés, audacieux, une jeunesse passionnée
et des gynécées peut-être troublés. Sa maligne sagacité,
malgré l'apparente sérénité du dehors, entrevoyait
sans doute plus d'un Sextus dans l'aristocratie
qui l'entourait, et plus d'un divorce dans
l'avenir de ces ménages bourgeois qui venaient l'écouter.
J'imagine qu'il ne pouvait rappeler l'épisode
ou le souvenir de Lucrèce qu'en le déguisant.
Au lieu d'un fils de roi, c'est un dieu qui méditera
l'attentat au lieu d'une péripétie sanglante qui
pouvait tourner contre l'auditoire ou contre l'auteur,
il inventera un dénoûment honnêtement railleur
qui ne compromettra que les Dieux et enfin
à la place d'un adultère volontaire qui pouvait offenser
le vérité et les femmes, ce sera une fraude
instructive qui ne fera réfléchir que les maris. La
leçon comme toutes les leçons de théâtre, ne
corrigea sans doute personne; mais elle eut ce que
Plaute poursuivait surtout le succès.
Dirai-je toutes les beautés de sentiment que,
dans cette comédie, Plaute a données à la matrone? Lorsque Jupiter quitte Alcmène, en lui demandant
si elle n'a plus rien à désirer, elle ajoute avec ce
ton ferme qui vient d'une fidélité sans tache, avec ce
charme de tendresse où le devoir et l'amour s'exaltent
et se rehaussent l'un par l'autre
" Qu'absent tu aimes toujours celle qui est toute à toi, quoiqu'absent." Le vers latin est bien plus expressif
"Ut, quum absim, me ames me tuam absentem tamen"
La Didon de Virgile eût-elle parlé un langage
plus tendre, et la Bérénice de Racine, lorsqu'elle
dit à Titus
Moi, dont vous connaissez le trouble et le tourment,
Quand vous ne me quittez que pour quelque moment,
Moi, qui mourrais le jour qu'on voudrait m'interdir
De vous...
a-t-elle trouvé un accent d'amour aussi abandonne
et aussi contenu tout ensemble? Ici Alcmène
leur est supérieure parce qu'elle est tout à lâ fois
amante et épouse, et parce que sa passion n'a rien
que de noble dans son expansion. Ce qui fait que
la passion émeut et entraîne, c'est lorsqu'elle vient d'une âme vivement éprise et se trahit par des
mouvements naturels et grands. Mais qu'est-ce que
l'émotion sans l'estime, et que faut-il préférer de.
l'impression produite par un fougueux désordre des
sens et du coeur ou du ravissement causé par l'équilibre inattendu de la passion avec le devoir? Le
pathétique que la saine droiture peut désavouer et
dont il faut cacher la source parce qu'elle est impure, n'a ni la force ni l'effet de l'émotion plus
haute qui naît du spectacle d'une ardente vertu.
J'aime la passion qui peut éclater devant tous, qui
peut avouer son origine, j'aime Alcmène répondant
aux injures de son époux
« La honte que tu me reproches est indigne de ma race. Moi
infidèle on peut me calomnier, on ne peut me convaincre. J'en
atteste le pouvoir suprême de Jupiter et la chaste Junon,que je
révère autant que je le dois, le corps d'aucun mortel, excepté
toi, n'a touché le mien et ma pudeur n'a souffert aucune atteinte
La hardiesse sied bien à qui n'a point failli. »
Cette fierté passionnée me touche plus que le délire
de Phèdre. Il me semble que la laideur morale
n'est qu'un élément imparfait du beau dans les arts,
et ne doit jamais produire cet entraînement salutaire
qui vient de l'accord habile de la vertu et de l'amour.
Ces sentiments qui appartiennent à la tragédie,
Plante a dû les traiter accessoirement et en affaiblir
l'effet par le gai contraste du faux mari qui rit tout
bas de la tendresse d'Alcmène. Il savait bien que Rome avait encore des Alcmènes sans doute, mais
il n'oubliait pas que leur vertu avait perdu sa grâce
à force de s'imposer et de se faire valoir et que
rien, ne plaît moins à des oreilles blasées que
l'éternel panégyrique de la morale. Il fallait l'intervention
d'un dieu, le récit piquant d'une surprise
galante et d'un amour en belle humeur
pour rendre aimables aux spectateurs de la
cavea ces détails sur la chasteté de l'épouse
devenus monotones pour le plus grand nombre des
maris. C'est le contraste qui sauve la donnée. Au
sein de la corruption environnante, la pureté eût
trop risqué à être montrée toute seule à des Romains.
Plaute a voulu et su être amusant sans
cesser d'être vrai.
Quand il essaie de quitter le merveilleux et le
tragi-comique pour nous découvrir un coin analogue
de la vie bourgeoise et contemporaine, il
échappe encore à la monotonie par le même secret.
Panégyris et Pinacie, par exemple, dans le Stichus,
sont deux épouses différemment édifiées sur les devoirs
du mariage. L'une et l'autre sont loin de leurs
maris, qui les ont quittées pour aller réparer, en
pays étrangers, les brèches survenues à leur fortune.
Panégyris, l'aînée, prête une oreille fort
complaisante aux propositions d'un nouveau mariage
apportées par son père lui-rnême. Elle pousse
beaucoup plus loin le respect filial ou plutôt l'oubli du mari, que Pinacle, sa soeur cadette. Celle-ci résiste avec un courage tout romain. Elle s'enferme
dans son devoir comme dans une forteresse où il
faut bravement succomber plutôt que d'en sortir.
Héroïsme touchant et qui, sous la plume de
Térence, eût prêté certainement à toute une élégie
sur la foi conjugale, à d'élégantes sentences sur la
tendresse C'est Hector, disait-elle, en l'embrassant toujours,
Voilà ses yeux, sa bouche et déjà son audace !
C'est lui-même, c'est toi, cher époux, que j'embrasse.
Plaute aime trop la popularité il sait trop ses
Romains pour tomber dans un tel écart il risquerait
de voir son public partir dès les premières
scènes, comme il fit plus tard à la représentation
de l'Hecyre de Térence pour aller admirer un
acrobate ou un ours.
Aussi, que de précautions pour se faire pardonner
cette exquise création de Pinacie! Que d'enveloppes chatoyantes et multipliées autour de cette lueur
sereine et un peu austère, pour ne pas blesser les
yeux grossiers de la populace Auprès de Pinacie,
on médit des femmes, du mariage; les farces d'un
parasite et les orgies d'un esclave se donnent libre
carrière pour faire accepter, pour sauver cette
charmante, leçon de dignité conjugale, et la morale,
à peine esquissée, passe à la faveur de la plus
licencieuse gaîté. N'est-ce pas à peu près ainsi que Shakspeare faisait contraster les grossiers dialogues
des domestiques de Capulet, ou les concept de
Mercutio avec les adorables entretiens de Roméo
et de Juliette pour se faire mieux écouter de tous
et ne pas encourir les sifflets de John Bull?
Il serait intéressant de remarquer combien ces
figures presque poétiques ont changé dans Molière
et d'étudier ce qu'y est devenue cette morale du
mariage. La théorie du devoir, si bien exprimée
par Pinacie, se retrouve là désormais bien moins
dans la pratique que dans les reproches des maris.
Chrysale résume assez bien, je crois, l'opinion de
Molière sur les devoirs des femmes mariées. Ce n'est
pas que toutes les épouses, dans Molière, se montrent
frivoles et se piquent d'infidélité. Martine, la
femme de Sganarelle, veut être battue, par son
mari, et Elmire cache bien le sien sous la table
pour le faire assister aux séductions de Tartufe.
Mais ce sont des vertus d'intérieur où l'expérience
du vice a trop de part j'y reconnais l'alliage
d'un société blasée. Elmire ne dirait pas
Une femme se rit de sottises pareilles,
Et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles, si elle ne savait d'avance combien les époux ont de
raisons pour douter des protestations. d'innocence
de leurs femmes. Martine, qui se laisse étriller
humblement devant les gens par le sien, a-t-elle
sur ses devoirs des principes bien édifiants?' Il est
permis d'en douter quand on l'entend dire que c'est
trop peu de tromper Sganarelle et qu'il lui faut un
châtiment moins doux. " Je sais bien qu'une femme
a toujours dans les mains de quoi se venger d'un
mari mais c'est une punition trop délicate pour
mon pendard. Je veux une vengeance qui se fasse
un peu mieux sentir." Nous voilà bien loin des
maximes de Plaute. C'est de la petite vertu à la
place de la grande.
Les temps étaient bien changés! Le Christianisme
avait depuis longtemps relevé la femme de
sa condition subalterne; il l'avait instituée l'égale
de son mari pour commander côté de lui au sein
de la famille pour briller auprès.de lui, plus que
lui, au sein de la société renouvelée. C'est pour la
femme qu'avait été créée la politesse que Rome ne
connaissait pas; c'est pour elle que, depuis la chevalerie,
cette politesse.s'était convertie en galanterie.
Ce partage à deux du même sceptre, cette
égalité à l'intérieur et au dehors, ces privilèges
égaux quoique divers, en donnant à l'épouse des
droits analogues, lui fournissaient nécessairement
l'occasion des mêmes torts. Cette différence des
deux sociétés, je ne la trouve nulle part mieux caractérisée que dans cette sortie de Madame Georges
Dandin
Pour moi, dit Angélique, je vous déclare que mon dessein
n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive
dans un mari. Comment! parce qu'un homme s'avise de nous
épouser, il faut d'abord que toutes choses soient finies pour
nous ct que nous rompions tout commerce avec les vivants.
C'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les
maris et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous
les divertissements et qu'on ne vive que pour eux ! Je me moque
de cela, et ne veux pas mourir si jeune !
Qu'on ne s'y trompe pas cette déclaration des
droits de la femme a ses précédents jusque dans
Rome. Angélique n'est point autre chose que
l'épouse dotée des Romains. Ici nous sommes en
face de l'uxor. C'est celle-là que la comédie latine
persécute sans cesse, c'est, avec elle, l'esclave qui
fait partie de sa dot que Plaute se plaît à bafouer
au profit du mariage d'inclination. (1)
(1) La comédie latine est remplie de plaintes et de railleries contre la femme dotée et contre la femme en général.
Malheureusement, ces hardies attaques contre l'émancipation
de la femme libre, cette guerre du théâtre
que Caton continuait de son côté à la tribune, ne
purent rien contre la puissance du fait. Plaute dit
dans le Rudens " J'ai vu souvent débiter au théâtre
de belles maximes, et le public applaudissait les
leçons qu'on lui donnait. Mais ensuite, quand on
s'en retournait chacun chez soi, personne ne s'était
approprié les vertus que les acteurs avaient enseignées." Cette vérité, outre qu'elle est la .plus naturelle
justification de tout le répertoire de Plaute,
expliquait en même temps l'inutilité de ses efforts
contre les déportements de l'uxor. Cette autorité
despotique du chef de la famille qui disposait si
facilement de la vie de ses enfants, qui ne laissait
à la femme qu'une servitude libre, selon le mot
expressif de Servius et s'étendait sur la tête de ses filles jusqu'au-delà de leur mariage, avait
trouvé enfin son contrepoids dans les exigences de
la femme dotée. La permission laissée par la loi à la
femme de s'unir sans aliéner ses biens fut le plus
rude coup porté à l'omnipotence d'un seul. La
brèche qui suivit s'agrandit chaque jour; le théâtre
et les livres ne se font pas faute de la signaler depuis
Naevius jusqu'à Martial l'émancipation de la
femme finira par y passer tout entière.
Le discours et l'échec de Caton au sujet de la loi
d'Oppius suffiraient, au besoin, pour nous donner
la mesure de l'altération des moeurs de la matrone
d'alors. Des femmes qui allaient sans honte assiéger
les portes du sénat, prier chacun des sénateurs
d'intercéder pour elles cela ne s'était jamais vu
avant le 6e siècle de Rome, et je ne suis pas fâché
de la leçon (si toutefois l'histoire est vraie), que
le jeune Papirius donna un jour à cette gent loquace,
impertinente et curieuse, en racontant à sa
mère qne les délibérations du sénat avaient eu pour
objet de savoir s'il valait mieux, pour la chose
publique, donner deux femmes à chaque mari, ou
deux maris à chaque femme. On se figure l'émoi
qui suivit. La nouvelle qui circule accroît le trouble
et la frayeur. Toutes les rues qui avoisinent la voie
sacrée sont encombrées le lendemain de matrones, de dames illustres en pleurs. Les sénateurs qui arrivent
au temple pour délibérer ont un siège à soutenir
contre les supplications qui leur pleuvent de
toutes parts. " Plutôt deux maris pour une femme
que deux femmes pour un mari" Voilà la clameur
générale. Les sénateurs restent stupéfaits; ils s'interrogent,
ils remontent à la cause de tout ce bruit.
Papirius avait tout fait. Pour faire cesser les instances
de sa mère, qui voulait obstinément savoir
de quoi il s'était agi au sénat, il avait inventé ce
contre plutôt que de révéler l'objet véritable de la
séance.
Aulu-Gelle nous a encore laissé un chapitre curieux,
où, préoccupé d'un parallèle littéraire entre
la comédie latine et la comédie grecque il oublie
la peinture de moeurs qui s'y montre, parce que de
son temps cette peinture n'avait plus de prix. Elle
en a pour nous. C'est la comparaison du Plocium de
Cecilius avec celui de Ménandre. Voici les scènes
du comique latin
? Un vieillard se plaint de sa femme fort laide,
mais très riche, qui vient de le contraindre à vendre
une esclave jeune et jolie, habile au service, qu'elle
soupçonnait d'être la maîtresse de son mari.
UN VIEILLARD. On est malheureux quand on ne peut cacher
son chagrin.
Le MARI. Comment le pourrais-je avec une femme de ce caractère
et de cette tournure? Quand je me tairais, mon malheur
en serait-il moins évident? Hormis la dot, elle a tout ce qu'un mari ne souhaite nullement. Puissé-je au moins servir de leçon
au sage Je suis esclave; quoique libre, je suis prisonnier sans
qu'on ait pris la ville. Cette femme m'enlève tout ce qui me
plaît. Direz-vous que c'est pour mon bonheur! tandis que je
soupire après sa mort, je suis moi-même un mort au milieu des
vivants. Elle prétend que j'entretiens un commerce secret avec
mon esclave, que je la trahis aussi, plaintes, prières, instances,
menaces, elle a tout employé pour me forcer à la vendre. Je parierais
que maintenant elle va dire à ses amies et à ses parentes:
« qui de vous dans sa jeunesse a obtenu de son mari ce que
moi, vieille femme, je.viens d'obtenir du mien? Je l'ai contraint
à chasser sa maîtresse. » Là-dessus, les laugaes ne manqueront
pas de s'exercer. Malheureux que de propos vont courir sur
moi
LE VIEILLARD. Dites-moi, je vous prie, votre femme vous
ferait-elle enrager ?
LE MARI. Et ouvez-vous me le demander?
LE VIEILLARD. Mais encore ?
LE MARI. Ne m'en parlez pas, cela me fait mal; aussitôt que
je rentre chez moi, à peine suis-je assis qu'elle vient m'embrasser
et m'infecter de son haleine fétide.
LE VIEILLARD. Elle sait bien ce qu'elle fait. Elle veut vous
obliger à rendre tout le vin que vous avez bu hors de chez vous. (1)
(1) Aul.-Gell. II. 23. Collect. latine-française. Panckouckc, p. 169. Une allusion à cette dernière pensée se retrouve dans la bouche du célibataire des Adelphes de Térence, 32 " Une femme, pour peu que vous tardiez, s'imagine que vous êtes à boire, à courtiser, à courir les plaisirs, que tout le bon temps est pour vous, tandis qu'elle a toute la peine."
Après cela, doit-on s'étonner si les femmes les plus sévères de Plaute médisent de leur sexe, si celles de Térence sont obligées de faire des réserves pour expliquer leur propre mérite Le censeur Métellus n'avait-il pas dit, à peu près comme Euripide " Romains, si nous pouvions nous conserver sans épouses, nous nous passerions de cet ennui. Mais puisque la nature a voulu qu'il soit également impossible d'être heureux avec les femmes et d'exister sans elles, il faut sacrifier le bonheur de notre vie à la conservation de l'État." Voilà la guerre franchement déclarée. C'est dans un autre intérêt, l'intérêt de la patrie, qu'on supporte ce sexe importun, ces matrones dont la plupart abritaient, comme dit Horace leur arrogance derrière des gardes, une litière, des coiffeurs, des monceaux de parures, et qui s'entouraient jnême de femmes parasites. (1)
(1) Dans Amphitryon, 370, Jupiter se hâte de retourner au camp, " de peur, dit-il, qu'on me reproche d'avoir préféré ma femme au bien public."
Nous pouvons nous expliquer désormais comment sur le moindre prétexte on répudiait ces femmes si péniblement tolérées. Qu'on était loin déjà de l'innocence de ce Ruga, qui avait quitté la sienne parce qu'elle était stérile Il fallut bien moins plus tard pour provoquer un divorce. Sortir sans voile, aller au théâtre sans permission c'était pour bien des femmes une cause de séparation. A Rome, la défiance contre les matrones était si grande, ou, si l'on veut, les lois de la pudeur si sévères, u'elles ne pouvaient quitter le logis sans être accompagnées. Se montrer seules c'était pour elles encourir l'infamie. Les .embrassements mêmes des époux étaient perfides. Pline dit qu'on voulait savoir par là si elles ne.sentaient pas le vin. Aussi que de bons .tours on. cherchait à jouer à ces maîtres exigeants Myrrhine dans la Casina, a beau dire " Une honnête femme ne doit point avoir de pécule que de l'aveu de son mari. Quand une femme a du bien acquis de son chef, il lui est venu par des larcins ou par des galanteries." Les opprimées se donnaient néanmoins.le plaisir des représailles, comme ces femmes de l'Astraba, qui s'entendaient pour faire payer à leurs maris les vivres plus cher qu'au marché (1).
(1) Plaut., fragm., Astraba, 7.
Le temps n'est pas loin oit les épouses
prendront elles-mêmes l'initiative du divorce et quitteront les premières la place sans même donner
de motif.
J'entends d'ici Dorippe, la matrone du Mercator,
la femme qui a apporté une dot; quelles doléances
elle se permet quand elle voit une autre femme
chez son époux Lysimaque! Ecoutez les reproches
d'Artémone, la femme du vieux Déménéte de l'Asinaire,
qui court sur les brisées de son fils et se
laisse surprendre par sa digne moitié en conversation
délicate avec une courtisane. C'est toujours
une épouse richement dotée qui se plaint et il est
curieux d'étudier les scènes où elle se donne carrière.
Ce n'est plus un ton humble et embarrassé;
sa voix est forte et menaçante elle fait plier sous
elle, comme un roseau ce barbon émancipé
tout-à-l 'heure si superbe
"Debout, amoureux à la maison voyez ce coucou à tête
grise; que sa femme est obligée de tirer d'un tel repaire!" C'est qu'elle se sent forte de son devoir devant son
Déménéte, tout humilié de sa faute. Sans aucun
doute, Artémone, épouse d'un sénateur, est une de
celles qui ont demandé plus d'une fois en cachette à
leur fils de quelle loi on s'était occupé au Sénat, ce
qu'on disait de nouveau au forum, chez le barbier du coin, au Vélabre ou dans la rue Toscane. Je
soupçonne même que cette scène, cette leçon faite
à son Déménéte n'est pas la première. Est-ce à
dire que sa tendresse conjugale en sera moins vive
ou moins importune? Ces libertés prises au-dehors
me semblent au contraire, devoir river mieux la
chaîne, et réchauffer le coeur de la matrone. C'est
une tempête qui attise le feu au lieu de l'éteindre.
Le temps approche où Varron, témoin de toutes
ces bourrasques, s'écriera en définitive " défaut
d'épouse doit être corrigé ou supporté. Qui corrige
sa femme l'améliore, qui la supporte s'améliore lui-même."
C'est la pensée de Socrate sous les foudres
de sa femme Xantippe. Mais alors ce genre de résignation
qu'il propose était d'une pratique facile
pour les époux. Ils avaient, pour se consoler, une
Aspasie ou une Laïs. L'intimité des courtisanes
fameuses était une sorte de mode, et non un scandale.
A Rome, tout au plus si cela jetait quelquefois
un peu de trouble au sein des ménages. Déménéte
est de la même école ou peu s'en faut. L'aimable
Philénie le distrait des orages ou de la monotonie
du mariage. Mais il craint sa chaste moitié tout en
la bravant. C'est là ce qui le rend surtout comique.
On dirait Chrysale parlant de Philaminte
"Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton;
Je ne sais où me mettre et c'est un vrai dragon.
Et cependant avec toute sa diablerie
Il faut que je l'appelle et mon coeur et ma mie. Je remarque néanmoins une disparité entre les
deux théâtres. Déménéte, aussitôt qu'il a entendu
gronder la voix de sa femme, s'écrie: Je suis mort!
et, comme tous les barbons de Plaute, il tremble
pour sa peau, et se fait aussi humble qu'il peut.
Les maris coupables de Molière ne s'effraient pas
pour si peu ils le prennent de plus haut. Madame
Jourdain, qui est la copie d'Artémone, lorsqu'elle
vient elle aussi troubler la fête et gâter
les joies du festin, ne rencontre pas un mari aussi
souple, et la lutte s'engage d'égal à égal avec une
bien autre vivacité que dans le comique latin.
" Impertinente, lui riposte M. Jourdain, vous faites bien d'éviter
ma colère !" et l'on sait aussi de quel bois Sganarelle frottail les
oreilles de sa chère Martine pour toute réponse à
ses légitimes reproches. On ne saurait trop le
répéter, la vertu n'était plus invariablement du côté
de la femme. Avec des droits égaux, livrée nécessairement
aux mêmes écarts, l'épouse perdait le
privilége de sa supériorité en pareil cas. Son inégalité,
qui autrefois faisait sa force n'était plus
qu'une fiction. Les femmes de Molière couraient
aux mêmes plaisirs que leurs dignes maîtres; elles
payaient une infidélité par une autre; et le goût
des représailles les dominait si fort, j'imagine,
que leur vengeance précédait bien souvent l'outrage (1).
(1) Les femmes osent moins dans Aristophane. Lui aussi, il a dépeint les femmes grecques avec des goûts d'émancipation qui vont même jusqu'à la politique. Mais quelle différence quand elles sont vis-à-vis de leurs maris! Elle sont un air contrit et humble, et les craignent tout autrement que dans Plaute, Térence et Molière.
La filiation de madame Jourdain pourrait,
au besoin, se reconnaître facilement. Elle a dû
s'appeler Agnès ou Isabelle avant son mariage; sa
révolte dans l'âge mûr me fait supposer qu'elle a
dû être bien humble dans sa jeunesse.
Cette émancipation des deux sexes avait encore
un autre caractère, à cette époque, qui mérite
d'être noté. Le théàtre latin pourrait, tout bien considéré,
passer pour plus moral que le nôtre, quand
on en étudie de près les passions et les désordres.
Voyez ces jeunes Romains au bel air et aux grandes
équipées voyez leurs vieux pères tout rajeunis
par l'amour, à quelles portes vont-ils frapper?
A celles des courtisanes et des esclaves. Térence
nous montre bien des relations entre le fils
de famille et la fille de condition libre, mais leurs
sentiments sont estimables et purs. Le mariage les
doit couronner; la débauche n'a rien à y voir.
Hors de là, le désordre avait ses limites jamais il
n'allait publiquement troubler la foi conjugale,
par l'adultère, ou le coeur d'une fille notoirement
libre, par le libertinage. Chez les Romains de la
république, sur le théâtre, le respect de la naissance
et du rang était plus fort que toutes les passions. Dans nos société smodernes, rien de pareil
le gynécée n'est plus à l'abri de l'invasion des infidèles
le mal a grandi et le vice s'est raffiné. La
morale de Molière, sur ce point, n'est plus.celle de
Plaute. Celui-ci laissait à peine soupçonner ce que
l'autre a dépeint. L'un se serait bien gardé d'étaler
sur la scène, si ce n'est sous le couvert d'une allégorie
parfaitement inoffensive, ces licences graves
dont l'autre a fait le ressort principal de son théâtre.
Il est à peine besoin de mentionner à part les
matrones et les jeunes femmes de Térence. Nous
savons son procédé. Ses épouses sont exactement
aussi douces que ses jeunes filles sont des modèles
de pureté. On se croirait en plein règne d'Évandre
et de Numa Pompilius, mais de Numa arrangé par
M.de Florian. C'est l'Arcadie transportée dans l'atrium;
c'est l'histoire de la bourgeoisie Romaine,
mise en idylles. Philuméne, par exemple dans l'Hecyre, est d'une pudeur qui me persuaderait difficilement.
Pourquoi se marier, quand on a tant de remords
d'une faute involontairement commise avant
le mariage?ou pourquoi fuir le toit conjugal, quand
on.a eu, malgré sa faute, le courage de tromper
un mari? C'est me gâter le caractère de la fille de
naissance libre. C'est me la faire tout à la fois trop timide et trop hardie trop touchante et trop perverse.
C'est toujours un peu Virginie avant le mariage,
et Agnès le jour des noces.
L'auteur craint si fort de compromettre ce caractère
double cette délicatesse imaginaire de
ses femmes en général, qu'il les laisse la plupart
dans la coulisse pour ne point se commettre avec
elles à l'éclat du grand jour. Voyez ses belles-mères,
ses matrones, ses Sostrate! Le procédé ne change
guères. L'uniformité n'effraie pas Térence " Je t'en prie, dit Sostraste à son mari dans l'Heautontimorumenos, ne va pas croire que j'aie rien osé faire contre tes ordres. Si j'ai commis une faute, mon Chrêmes, c'est par ignorance" Soumission exemplaire qui va même au-delà de
celle d'Alcmène! C'est à peine si, dans les dernières
scènes de son Phormion, il a pu toucher le côté acariàtre
du caractère de la matrone. Nausistrate n'ose
qu'en tremblant, et presqu'à l'insu de son mari, se
plaindre de lui. C'est encore une ébauche timide du
vrai modèle.On croirait entendre Térence lui-même
nous confiant à demi-voix à l'oreille, avec force réticences,
quelque grosse indiscrétion contre les dames
romaines. Le caractère du conteur se, trahit dans les
demi-mots de la confidence.
Ainsi les matrones de la scène latine sont accommodantes,
comme chez Térence ou acariâtres,
comme dans Plaute. Elles ne vont jamais au-delà
de l'ennui. Au dehors, le maître même humilié, c'est toujours le mari; la vie civile n'en connaît pas
d'autre. Au dedans, il est quelque fois traité d'égal;
il cède souvent, jamais il n'est complètement subalterne.
Au dix-septième siècle, tout cela a changé:
l'indépendance des femmes n'a fait que grandir;
elle étend ses ravages autour d'elles. Molière n'avait
montré qu'un coin de la vérité; la comédie de la
société est plus piquante encore que celle de la
scène et le théâtre vaut mieux que le monde. Voici,
à ce sujet, un curieux témoignage de Labruyère:
Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre son mari au
point qu'il n'en est fait, dans le monde, aucune mention. Vit-il
encore? ne vit-il plus? On en doute. Il ne sert dans sa famille
qu'à montrer l'exemple d'un silence timide et d'une parfaite soumission.
Il ne lui est dû ni douaire ni convention. Mais à cela
près, et qu'il n'accouche pas, il est la femme et elle le mari. Ils
passent les mois entiers dans une même maison sans le moindre
danger de se rencontrer; il est vrai seulemeut qu'ils sont
voisins. Monsieur paie le rôtisseur et le cuisinier, et c'est toujours
chez Madame qu'on soupe. Il n'ont souvent rien de commun,
pas même le nom. Ils vivent à la romaine ou à la grecque.
Chacun a le sien et ce n'est qu'avec le temps et après
qu'on est initié au jargon d'une ville qu'on sait enfin que M. B.
est publiquement, depuis.vingt ans, le mari de madameL. (1)
(1) Labruyère, Des Femmes.
Nous voilà bien loin de la société romaine. Nous entrons à pleines voiles dans celle du 18° siècle et nous pouvons déjà entrevoir la femme libre du nôtre.

LES ESCLAVES.
Je ne me propose pas de refaire ou de compléter les ouvrages nombreux et remarquables qui ont été écrits sur l'esclavage ancien. Une telle matière, outre qu'elle serait au dessus de mes forces, n'aurait ici ni sa place véritable, ni le mérite de la nouveauté et romprait certainement l'ensemble des études que je viens de réunir. D'ailleurs, après les livres remarquables de M. de Saint-Paul en France, et de M. Blair en Angleterre, les deux traités modernes qui me paraissent les plus neufs et les plus complets sur cette question, il eût été téméraire de vouloir les imiter sans les copier, il serait difficile de faire mieux ou davantage j'ai dû nécessairement tenter de faire autrement. Le cadre que je me suis tracé comprenait, non pas la philosophie de la.servitude ancienne, mais sa mise en scène.
Au lieu d'étudier l'esclavage dans sa vie générale dans son origine, dans ses conséquences, j'ai voulu, j'ai dû examiner l'esclave au sein de la famille, dans ses rapports de chaque jour avec ses maîtres, dans ses heures de joie et de malheur, l'esclave en déshabillé, si je puis dire, l'homme enfin plutôt que le principe. La comédie romaine, où j'en dois chercher les situations et les exemples divers, m'indiquait tout naturellement ce chemin de traverse dans cette large voie de la servitude antique, et je me suis hâté de le choisir comme plus commode pour moi, et plus convenable pour mon sujet. Moschus dans une de ses idylles intitulée l'Amour fugitif, a parodié avec grâce ces annonces par lesquelles on offrait une récompense à qui trouverait un esclave en fuite. Vénus, travestie en crieur public, y dit " Si quelqu'un aperçoit par les carrefours l'Amour errant, c'est mon esclave fugitif le dénonciateur recevra une récompense. Le prix sera un baiser de Cypris; mais si tu le ramènes, ô étranger tu n'auras pas seulement le baiser, tu recevras quelque chose de plus. L'enfant est en tout point remarquable tu le distinguerais entre vingt autres. Sa peau n'est.pas blanche; elle ressemble au feu; ses yeux sont terribles et ardents; avec des pensers méchants, il a le parler doux. Tu verras un très petit arc avec une flèche. Il a aussi sur le dos un petit carquois d'or fort petit, etc,"
Nous avons là tout le signalement de l'Amour retracé avec une délicatesse qu'Apulée a cherché imiter, dans ses Métamorphoses, en racontant la fuite de Psyché. Mais ce qui manque aux deux copies, c'est l'aspect craintif et fatigué, c'est le trouble du fugitif, c'est la marque honteuse de ses fers, les stigmates des verges qui ont sillonné son dos et que Moschus remplace mal ici par le carquois d'or. Tout cela est bien brillant pour un esclave ou plutôt ce n'est plus un esclave. L'idylle a ôté sa vérité au sujet en l'embellissant, et l'on pourrait dire, comme des pastorales de Florian, qu'il y manque le loup. En effet, l'esclave n'était pas autre chose qu'une machine à étrivières, une statue de coups.de fouets, verberea statua, comme dit Plaute, qu'un être dégradé par les supplices ou les vils travaux et qui n'offrait guère de ressemblance avec les riantes images de tout à l'heure. Ce même Apulée qui nous raconte avec agrément cette charmante allégorie où Mercure s'en va partout, au nom de Vénus, criant comme un héraut " si quelqu'un peut arrêter dans sa fuite ou découvrir dans sa cachette une esclave de Vénus, esclave fugitive, fille d'un roi, nommée Psyché", Apulée nous a donné le revers du tableau. Nous lui devons le récit de la réalité à côté de la fiction. Il décrit ailleurs un moulin avec des couleurs d'une effrayante vivacité. " Ceux qui l'habitent ce sont des hommes, des ombres d'hommes plutôt, dont toute la peau porte la pâleur livide qui vient des coups; leur dos sillonné par les plaies est, non pas couvert, mais à peine voilé d'une méchante guenille déchirée partout tous sont vêtus de tuniques qui laissent voir leurs corps à travers leurs lambeaux, ils sont marqués au front, la tête à demi-rasée, l'anneau au pied." Voilà le véritable esclave romain quand il est au moulin c'est-à-dire au supplice. Mais ce n'est là qu'un côté de cette face curieuse, c'est le plus sombre, et il devait déplaire à la muse comique. Les comédies de Plaute et de Térence citent souvent sans y insister, cette série de châtiments qu'on infligeait à l'esclave, mais jamais elles ne nous ont donné le spectacle dont Apulée a si fortement frappé notre imagination. C'eût été tomber dans la tragédie d'abord et, de plus, c'était risquer de donner trop d'importance à ce qui semblait une habitude sociale et non une cruauté.
Dans toutes les comédies qui nous restent, on ne met même jamais en scène l'esclave au moment où il.fuit, à moins qu'il n'en soit question dans ce prologue de l'Heaulontimorumenos où Térence accuse Luscius Lanuvinus d'avoir montré au théâtre un esclave qui court à toutes jambes. Il est plus probable que, là, comme ailleurs, il n'est parlé que d'un serviteur pressé d'apporter quelque nouvelle importante. J'observe même que, dans le Poenulus de Plaute l'esclave Syncérastus citant tous tes gens méprisables qui se rencontrent dans l'obscur repaire du prostitueur Leloup, son maître, compte parmi eux un esclave fugitif sans ajouter d'autres détails, et je conclus que le répertoire comique des Romains n'a pas fait de la fuite un des mille épisodes de leur vie scénique, et a eu soin de ne pas choisir ses principaux personnages dans cette classe infime. C'est de l'esclave sur place, attaché toujours au logis, quelquefois aux intérêts de son maître, que la comédie latine s'est uniquement occupée. C'est lui qui, dans la vie romaine, était l'auxiliaire le plus habituel, le plus actif, le plus goguenard ou le plus fripon des passions de ceux qu'il servait. C'est un personnage pour nous il doit aider à nous expliquer les vices de la jeunesse romaine, parce que le plus souvent il les entretient et en vit. Pour les Romains, c'est une utilité indispensable. Placé, comme le parasite, entre les pères hargneux .et les fils dissipés, auxiliaire des uns et des autres, associé le plus souvent aux faiblesses des mères pour leurs enfants, il jette un intérêt piquant, une lumière vive ou réjouissante sur l'intérieur discret des familles libres. C'est assez dire que le plus ordinairement il s'agira de l'esclave de la ville, et rarement du campagnard.
Celui-ci est relégué au fond des terres machine animée, instrument vocale, plus propre au labour que le boeuf, le cheval et le chien, appelés par Varron machines demi-muettes, instrumentum semi- mutum, et que la charrue et le hoyau, machines absolument muettes, instrumentum mutum (l), il attendra dans une obscurité misérable et laborieuse, que la vieillesse arrive avec l'impuissance et les maladies et que le père de famille, comme le recommande Caton, le vende avec les vieux boeufs, les animaux chétifs, les vieux chars et les vieilles ferrures.
(1) Varro. de Re Rustica. I. 17. 1.Montrons tout de suite dans quelle abjection étaient les esclaves attachés plus spécialement à l'agriculture. Varron dit ensuite, I. 17. 2. Toutes les terres sont cultivées par des hommes libres, ou par des esclaves, ou par un mélange des deux classes. Je dis de toutes les terres en général qu'il est plus avantageux de cultiver les cantons malsains au moyen d'ouvriers payés qu'avec des esclaves. Varron ici ne les regardait pas même comme propres à ce travail, à cause de leur difficulté à s'acclimater et à se reproduire dans des terres où ils n'étaient pas nés. Ils sont pour lui une chose en citant les esclaves, les animaux et les objets de labourage. Caton de Re. Rust. v. 6., ne se montre quelque peu indulgent que pour les bouviers. Il ajoute, LIX, qu'il suflit de donner aux ouvriers des champs une tunique tous les trois ans, une saie et une chaussure tous les deux ans, et ne manque pas de recommander que, en remettant les vêtements neufs, on leur retire les vieux pour en faire des couvertures.
Pour celui-ci les jours sont à peu près tous les mêmes, monotones, affligés, rarement égayés par quelques orgies grossières par une fête rustique ou un voyage à la ville. Pour l'autre, au contraire, les heures de joie sont plus nombreuses, la vie est plus variée, il porte avec je ne sais quel stoïcisme insouciant le fardeau de son sort, et il se fait goûter à force d'esprit de courage et de bonne humeur. C'est donc lui surtout l'esclave citadin né le plus habituellement dans la maison de ses maîtres, Verna, que la comédie latine a mis en scène. C'est là que nous l'allons chercher. Dans l'Amphitryon, Sosie le peureux, Sosie soumis et désobéissant tout à la fois, rompu aux malheurs de l'esclavage et en murmurant. cependant tout bas Sosie a-t-il un caractère d'esclave bien net et savamment tracé? Il commence par se plaindre de sa condition d'esclave, non pas tant cependant pour elle que pour récriminer contre les maîtres et les riches. Rotrou, dans son imitation des Deux Sosiesn'oublie pas de faire comme son modèle. Dans un sujet grec, le Sosie de Plaute parle de triumvirs et de licteurs. Celui de Rotrou une lanterne à la main s'écrie
A quelle complaisance un serf est-il réduit Qu'il faille marcher seul à telle heure de nuit ? Si du guet par hasard la rencontre importune Se trouve sur mes pas, quelle est mon infortune! Ces gens, pour mon malheur, trop pleins de courtoisie, Me voudront recevoir contre ma fantaisie, Et, croyant me traiter bien honorablement, De la Maison du Roi feront mon logement. La vérité est du côté du modèle. C'est de l'aristocratie, c'est de la nécessité de servir sous elle que s'irrite Plaute, lui qui tourna la meule sous un maître aussi. C'est le guet et la Bastille qui font peur au valet du xvii° siècle mais ici la crainte est moins fondée les valets d'alors étaient trop subalternes et trop humbles pour qu'on eût jamais à sévir de la sorte contre eux ils étaient au-dessous de la bourgeoisie méprisée aussi, qui subissait quelquefois la peine des lettres de cachet et de la prison. Ceux pour qui on réservait plus particulièrement ces marques de la défaveur c'étaient surtout les courtisans ceux qui tombaient de la protection de la veille dans la disgrâce du lendemain. Molière l'a compris ainsi, et, en donnant à son Sosie ce rôle d'ambassadeur exploité par son maître et ramené néanmoins vers lui par cette séduction qu'exercent les grands sur ceux qui les entourent et les servent, il a mieux peint les flatteurs de son temps, les véritables valets de la société d'alors.
Dans Plaute, Sosie est un esclave de la plus basse espèce. Il est né serf. " Hic qui verna est, queritur", dit Mercure, l'esclave improvisé. Sous le coup des menaces de celui-ci, le pauvre valet du véritable Amphitryon ne tarde pas à parler de ses propres faiblesses d'esclave. Plaute, comme il l'osera souvent encore ailleurs, lui fait dire, sur ses défauts et sur sa condition, des vérités qu'un juge ou un maître seul devait dévoiler, comme, par exemple qu'il a l'habitude de mentir, de tromper, et qu'il est lâche, car il a fui pendant le combat que son maître livrait aux Téléboëns. L'auteur se plaît à se mettre en rapport avec son auditoire par ces confidences qui violent la convention de la fable scénique. C'est un moyen comique qu'il emploie de préférence, parce qu'il y peut montrer son esprit en prévenant celui des spectateurs. Il n'attend pas que ceux-ci aient vu finir la pièce pour décider que Sosie est un menteur ou un poltron; Plaute le leur dit tout de suite pour les faire sourire et quelquefois pour gagner leurs bonnes grâces. Dans l'Amphitryon surtout, où figurent des personnages de tragédie l'auteur a plus qu'ailleurs intérêt à se familiariser avec les plébéiens de la cavea pour leur faire voir que sous la pourpre de Jupiter et la gravité d'Alcmène, il n'a pas cessé de rire, et que, sous couleur de tragédie, il tient à les amuser toujours sauf à les moraliser, s'il peut, Cette intention, Mercure est chargé de la déclarer dès le prologue: les personnages de la pièce seraient vraiment plus dignes de la tragédie, dit-il, s'il n'avait eu soin d'y mêler un esclave pour la convertir en une tragi-comédie. Nous savons donc la véritable destination de l'esclave, du vrai Sosie, dans cette pièce. C'est pour l'auteur le représentant de la comédie, c'est par lui qu'il veut maintenir sa fable à un degré plaisant et inférieur. La condition subalterne de Sosie ressort mieux encore par le contraste que lui a opposé Plaute dans le personnage de Mercure, improvisé valet de noble maison. Pendant tout le cours de la tragi-comédie, la grande livrée bafoue la petite, et, quoique le rôle de Cléanthis, imaginé par Molière y manque, ces personnages épisodiques et nécessaires sont du comique le plus vrai et le plus réjouissant. Malgré le peu de soin que montre ordinairement Plaute à soutenir ses personnages. et à mettre une suite entière dans leurs caractères, il est curieux de remarquer ici combien Mercure représente avec vérité le valet d'un seigneur. Voyez dans sa première scène avec Sosie cette hauteur de ton, cet orgueil insultant pour la mesquine livrée de son rival. Il fait le bon prince en voulant bien épargner une première fois les coups au valet peureux et titnide mais il pourrait bien lui en administrer, s'il voulait. Que ne peut-il pas d'ailleurs? Sosie a bientôt cédé devant cette toute puissance et fini par douter s'il est Sosie et s'il appartient à Amphitryon. Mais à peine Mercure est-il avec Jupiter auprès d'Alcmene, cette arrogance se convertit en flagornerie. Le valet hautain de tout-à-l'heure devient fort humble devant son seigneur et maître, il veut le servir en adroit parasite. Hélas! ses avances sont fort mal accueillies: Jupiter le repousse avec colère; il veut le battre l'assommer, et Alcmène obtient difficilement grâce pour lui. Cela rappelle involontairement la fable du Loup et du Chien, et je ne sais si Sosie n'est pas plus heureux de servir un simple mortel, malgré tous les ennuis de sa condition, que d'être exposé aux caprices et aux insultes d'un dieu en bonne fortune.
Il est à peine besoin de dire que dans cette pièce, semée de quiproquos, le vrai Sosie reçoit des coups à la place de l'autre, et que, plus les malheurs s'accumulent sur sa tête, plus il est comique et prête à rire. Dans cette donnée mythologique, qui n'a, sur plusieurs points, qu'une vraisemblance de convention, l'étude des moeurs réelles de l'esclave trouve .àà peine quelques détails à recueillir. Nous y apprenons que l'esclave passait quelquefois la nuit suspendu au gibet, au haut duquèl il subissait le supplice des verges. Sosie en parle avec gaîté à propos de cette longue nuit qui se prolonge sans fin sur les amours du faux Amphitryon, et nous n'y devons pas trop insister. Ses méfaits .n'étaient pourtant pas bien graves, s'il faut l'en croire, ou plutôt. s'il faut demander à toute l'antiquité pour quelles causes futiles on punissait du gibet le moindre serviteur. Sosie buvait souvent en cachette de son maître, et vidait quelquefois de grands flacons de vin pur.; il l'avoue à Mercure à peu près comme, dans les Fourberies de Scapin, le rusé valet confesse à Octave qu'il a troué ses tonneaux de vin d'Espagne. Partout ailleurs, Sosie est le modèle des esclaves soumis et honnêtes. S'il a contracté les légers défauts de sa condition, il a gardé en revanche les qualités, du serviteur primitif. Aux emportements, aux menaces de son maître, il répond avec une sorte de philosophie résignée " Tu es mon maitre fais de moi ce qu'il te plaira." Il y a dans toute cette réponse quelque chose d'amer pour nous. C'est l'homme qui se reconnaît la propriété; la chose d'un autre homme, c'est l'aveu calme et touchant d'une impuissante infériorité contre laquelle l'esclave ne songe pas même à résister tant il y est inféodé dès son enfance. Je me trompe cependant sa liberté n'a pas abdiqué toute entière.
L'homme, à certains moments, se relève sous la chaîne du serf; le sentiment du juste, du vrai, crie encore plus haut que ses maux. Sosie ajoute " Mais tu auras beau faire, tu ne m'empêcheras pas de dire la vérité telle qu'elle est." Et ailleurs " Amphitryon, c'est une grande misère pour un malheureux et bon serviteur qui dit la vérité à son maître, d'avoir tort parce qu'il est le plus faible."Voilà le vrai, voilà la seule force qui reste à l'esclave dans son abaissement, c'est là sa grandeur et sa plus digne réhabilitation. Il se venge de l'oppression par la soumission ou par la vérité. Peut-être se consolera-t-il un jour en se faisant aimer de celui qu'il aura dignement servi, où en méritant une inscription honorable sur sa tombe, comme le Métrophane de Lucilius. Le pauvre Sosie, dans sa modestie est loin de rêver une si heureuse fin. Jamais, dit-il, son image n'honorera les funérailles de ses descendants. Il mourra dans cette mansarde qui est sa seule demeure et les Esquilies sans doute. auront sa tombe sans aucune inscription.
Voilà par quels traits sérieux ou profonds Plaute a marqué à certains endroits le caractère comique de l'esclave Sosie, sans cependant lui donner un relief complet, sans achever définitivement le portrait. Selon sa coutume, il n'a pas voulu y arrêter longtemps l'attention de la plèbe qui venait l'écouter, et il n'a pas insisté davantage. Imitons-le et passons.
Dans l'Asinaire le tableau est plus franchement tracé. C'est de la bonne et sincère fourberie d'esclave, c'est la représentation du plus grand nombre d'entre eux. C'est l'histoire de deux valets fripons qui s'entendent avec un père et son fils pour voler la maîtresse de la maison au profit des fredaines paternelles et filiales. Une fois maîtres de la somme convoitée, ils se jouent de leurs deux complices, et ne la leur livrent qu'en échange de quelques concessions humiliantes. Cette donnée qui est si fréquente dans toute la comédie grecque et latine est un témoignage de l'influence des esclaves au sein des familles. Si, dans l'antiquité, la vie conjugale n'avait pas été faite de deux parts entièrement distinctes, l'une toute extérieure pour les hommes, l'autre toute claustrale pour les femmes, la première mêlée, désordonnée, livrée à tous les hasards du dehors, à la renommée ou au vice, la seconde soustraite aux moindres vicissitudes et vouée à l'ordre si enfin l'égalité moderne avait régné entre les époux, le rôle d'un intermédiaire eût perdu de son importance, et l'esclave serait retombé au rang subalterne où nous voyons le valet. de nos jours. Ce qui lui donnait de la valeur alors, ce sont les adoucissements dont le coupable du dehors avait besoin pour se rallier à l'innocente du dedans c'est une puissance qui se sert d'un ambassadeur intelligent pour entretenir ses bonnes relations avec une puissance alliée, c'est l'indulgence qu'un fils cherche, par cette entremisse, à reconquérir auprès de son père, c'est aussi nous le voyons ici les ressources que les vicieux de l'Agora ou du forum veulent se ménager dans le Gynécée pour fournir à leurs débauches et à leurs caprices.
Dans l'Asinaire les deux esclaves savent bien ce qu'ils valent et ils cherchent, comme tous les esclaves, à tirer profit de leur importance. Liban, qui ouvre la pièce avec son vieux maître Déménète le traite avec une arrogance peu ordinaire. Tout en le forçant à des aveux humiliants, il trouve moyen de se railler du mariage avec une femme dotée et des peines conjugales subies par son vieux maître. Ce n'est pas tout, il se moque même des tortures qu'on inflige ordinairement à l'esclavage, prenant philosophiquement le temps comme il vient et souriant un peu follement de ce qui fait trembler les autres:
LIBAN Est-ce que tu me conduis en certain endroit où la pierre bat la pierre?
DÉMÉNÈTE Qu'est-ce que cet endroit-là? En quelle partie du monde le trouve-t-on ?
LIBAN Dans les îles Batonnières et Ferri-Crépantes, où les boeufs écorchés se ruent sur le dos des hommes vivants.
DEMENETE Quel est ce lieu? où se trouve-t-il? je ne devine pas.
LIBAN: Oui, ce lieu où gémissent les vauriens qui voudraient manger la polente.
DEMENETE Ah! je comprends à la fin quel est cet endroit, Liban.
Liban désigne par les Iles Batonnières et Ferri-Crëpantes les ergastules oit les esclaves subissaient les peines de la bastonnade, des verges et des fers. Plaute a un singulier talent pour toutes ces dénominations bouffonnes dont il a donné d'autres échantillons dans le Fanfaron le Persan, le Charançon et ailleurs. Cette espèce de gaîté rendue ingénieuse par la misère, ce néologisme moqueur est un trait de moeurs qu'on retrouve partout au milieu des classes méprisées. On aime à y avoir raison des plus cruels tourments, on les trouve moins durs en les supportant plus longtemps ou on oppose aux tortures et à l'abjection une force qui se produit par des facéties de toutes sortes, par un ricanement qui a souvent sa profondeur, et comme on a bravé les lois sociales par toutes sortes de méfaits qu'elle n'admet pas ou par des crimes qu'elle châtie, on s'insurge de même contre sa langue par la création d'un langage à part qui a son esprit et quelquefois sa poésie. On pourrait trouver à chaque page, à chaque scène de Plaute, la preuve de cette ironie contre les maux d'un esclavage sans remède, par exemple dans ces qualifications, ces apostrophes que les deux valets s'adressent, telles que gymnase des houssines, pilier des prisons, conservateur des chaînes, délice des êtrivières et tant d'autres analogues.
Aux yeux de quelques-uns, de Térence, par exemple, ces folles échappées pouvaient paraître du cynisme; aux yeux des autres ce n'est que la bonne humeur, de la misère qui se soulage. Cette comédie montre il faut le dire, une singulière union entre maîtres et valets. Tout-à-l'heure le vieux Déménète chargeait Liban de le voler lui-même, ou sa femme, ou Saurea l'esclave dotal de sa femme pour trouver vingt mines à la fin de la journée. Cette fois c'est Léonidas, le camarade de Liban, qui veut faire partager à celui-ci et à son jeune maître Argyrippe le fruit d'une heureuse capture en retour de celles dont ils ont profité en société avec lui " Puisqu'ils partagent avec moi les bonnes lippées et les parties fines, il est juste que je partage avec eux la proie que j'ai trouvée."
Un des secrets de l'insolence des esclaves est là. Un inférieur est bien fort contre ses maîtres quand il peut s'armer contre eux de si malins souvenirs, quand entre le supérieur trop sévère et le subalterne trop hardi peut s'élever, comme un épouvantail contre celui-là et comme un rempart pour celui-ci,. le reproche ou la mémoire d'une complicité de débauches. Cicéron écrivant à son frère Quintus n'oubliera pas plus tard les précautions que commande l'emploi familier des esclaves. Il ne lui permet d'user de l'un d'eux dans sa vie privée, dans ses affaires particulières, qu'à la condition expresse qu'il aura fait preuve d'une fidélité exemplaire. Il lui prescrit de n'en user jamais dans ses affaires publiques .et de s'en préserver rigoureusement. II ajoute"Un esclave fidèle pourrait s'acquitter avec succès de bien des emplois que cependant il ne faut pas lui confier, pour s'épargner les observations et le blâme." Déménète et Argyrippe, dans le désordre de leurs moeurs n'avaient pas été aussi prévoyants. Ces familiarités de l'esclave ne se bornent pas au partage des mêmes plaisirs. De temps à autre, ces éclairs de dignité, d'indépendance ce sentiment fier de l'homme qui se redresse sous sa chaîne, se font jour au milieu des plus joyeuses scènes. Au second acte, par exemple, quand le marchand hésite à livrer ses vingt mines à l'esclave, lorsque la dispute s'échauffe et prend une tournure originale produite par le faux emportement de l'esclave Léonidas et par la sérieuse colère du bonhomme de marchand, il y a des vérités noter, il y a la triste réalité qui sort du fond de ces jeux plaisants. Quand
le marchand s'est écrié" Comment, un esclave outrager un homme libre!" Léonidas répond " Tu feras outrage aux autres et on ne te pourra rien dire Je suis homme comme toi."
Ce serait une matière à déclamations dans la tragégie, dans Sénèque, par exemple. C'est dans Plaute un regard furtif sur l'abîme qui sépare le serf de l'homme libre; mais l'oeil se détourne vite sur de plus riants objets. Plaute n'oublie jamais qu'il faut être comique surtout. Philémon avait invoqué aussi, à sa manière, cette égalité de l'esclave avec l'homme libre, dans un fragment précieux d'une comédie perdue pour nous. Il disait avec un accent plus profond': "Tout esclave qu'il est, son corps est le même. La nature n'a jamais fait personne esclave; c'est la fortune qui en a subjugué, ahaissé quelques-uns".(1)
(1) Philémon. Fragm,
Ces vers marquent une plus juste appréciation de l'esclavage et il est peu probable que l'auteur les eût mis dans la bouche d'un valet. En reconnaissant l'égalité de la naissance l'auteur y est frappé en même temps de la différence des fortunes. Sa. pensée respire un sentiment de la fatalité qui se confirme par d'autres fragments de ses comédies. Il est difficile quand on envisage la constitution les vicissitudes de la servitude mantique et cette rupture presque originelle de l'équilibre entre deux classes de la société, de n'y pas reconnaître quelque chose de fatal de ne pas chercher avec avidité le moment historique où l'on reviendra à l'essai où l'on rêvera le retour de ce juste équilibre, jusqu'à ce qu'enfin il soit définitivement rétabli par les moeurs et la loi nouvelles.
C'est ainsi qu'après Cicéron, qui commence déjà à s'étonner de l'émotion que lui cause la mort de son lecteur Sosithée, quoiqu'il ne soit qu'un esclave, Horace profitera de la fête des Saturnales et de la liberté de Décembre, comme il dit, pour rappeler aux maîtres, par la bouche d'un esclave aussi, que la servitude s'est déplacée, qu'elle n'est plus dans l'ergastule, mais dans l'atrium, que, par suite l'égalité commence entre le maître et le subalterne et que la supériorité n'appartiendra plus qu'à la vertu (1).
(1) Horac., Sat. II. 7. Cette satire est remarquable par les vérités qu'elle contient. L'esclavage, on le voit, est encore une fatalité, une nécessité sociale, mais le sentiment de l'égalité perce déjà et en fera peu à peu justice
Horace glisse ces vérités à la faveur de la franchise d'exception que le calendrier romain permettait un seul jour aux esclaves; comme Plaute, il indique plutôt qu'il ne développe d'importantes vérités, pour ramener à la fin sur elles le voile complaisant des institutions de son temps. Les esprits ne sont pas assez mûrs encore pour dire ou faire davantage Horace lui-même, qui, à la fin de sa satire, reprend si bien le ton de maîtres, et de maître arrogant, n'entrevoit encore que confusément le droit dans toute sa vérité, l'avenir avec l'égalité complète mais il faut déjà lui savoir gré de ces bienfaisantes lueurs. Il n'a voulu choisir, comme dans la Satire troisième du même livre, qu'un heureux cadre pour expliquer ou excuser ses travers aux yeux de ses détracteurs, et il s'est à peine douté de l'importance du tableau.
Dans Pétrone, Trimalcion est déjà plus humain. Là, comme dans le passage de Philémon, le sentiment de l'égalité éclate, mais avec un degré de plus. Trimalcion ne se résigne pas, comme le poète grec, à cette séparation que la fatalité a mise entre les hommes ;il invoque la nature en dépit du destin et affranchit tous ses esclaves par son testament. "Mes amis, s'écrie-t-il, les esclaves sont des hommes comme nous. Nous avons tous bu le même lait, et quoique la mauvaise fortune les ait réduits dans le malheureux état où ils sont, ils demeurent nos égaux aux yeux de la nature."
Pourquoi ces généreuses pensées n'apparaissent-elles que par hasard au milieu de ces institutions tyranniques pourquoi, dans Juvénal, par exemple, voit-on encore une dame romaine, à qui on reprochait sa dureté pour un esclave s'écrier " Insensé l'esclave est-il un homme?
C'est que l'aristocratie, plus fière plus riche, plus débauchée que jamais, n'avait jamais tant pratiqué cette règle romaine qui lui interdisait les travaux manuels, l'industrie active et qu'elle avait tout intérêt encore à ne pas regarder comme des hommes ces instruments complaisants qui, de tous les coins du monde, venaient contribuer au bien-être, à la fortune de leurs despotiques bienfaiteurs, de leurs maîtres. Plaute devait donc se borner, lui plus que tout autre, à ces indications furtives et développer ce qu'il comprenait beaucoup mieux, l'esprit de ruse, l'audace et les insolences de l'esclave. Ces réponses hardies, adressées par le valet à ses patrons, justifient assez bien, ce me semble, tout ce que peut avoir d'étrange la scène où Liban force son jeune maître à le porter sur son dos. On se croirait presqu'à ce moment des Saturnales choisi par Horace dans la satire citée. Un subalterne qui ose rappeler à un homme libre qu'il est homme comme lui, un serviteur, complice des plaisirs de son jeune maître, nous l'avons montré, et tenant en sa merci ses ressources et presque ses amours, bien quelque droit de faire acheter un peu cher ses complaisances, et de se mettre, dans un moment de belle humeur, à la place de celui qu'il sert. Cette représentation fort comique d'un patron qui se promène sur la scène, monté, tenu en bride par son valet, qu'est-ce autre chose, après tout, qu'une image matérielle de la réalité? Argyrippe, si naïvement humble avec sa Philénie, si familier si faible avec son serviteur, c'est le cheval qui subit la selle, et prête une bouche molle et complaisante au mors. Liban ou Léonidas, hardis avec Déménète, impérieusement dévoués à Argyrippe, les amenant l'un et l'autre tout suppliants à leurs genoux, voilà les véritables cavaliers, ceux qui imposent le frein et qui sont maîtres des mouvements.
Un autre motif encore peut justifier cette hardiesse, destinée surtout à exciter le rire du petit peuple et à rabaisser les maîtres. Léonidas et Liban sont moins méprisables que ne le feraient croire leurs plaisanteries. Ils sont insolents, mais ils aiment ceux qu'ils servent. Déménète, en signalant l'astuce de Liban, rend cette justice à son dévoûment
" Il n'y a pas d'esclave plus astucieux, plus malin, plus dangereux. Mais si l'on veut qu'une commission soit bien faite, on n'a qu'à l'en charger, il mourrait plutôt à la peine que de ne pas ,tenir ce qu'il a promis."
Liban quand il se prépare à combiner le grand complot qui doit sauver le jeune couple amoureux, se montre plein d'ardeur à le servir, et se stimule par ces paroles encourageantes
"Allons, point de lenteur, secoue la paresse et appelle à ton secours ton ancien génie d'intrigue. Tu as ton maître à sauver. Ne va pas faire comme le commun des esclaves qui n'ont d'esprit et de finesse que pour tromper les leurs." Léonidas, dans son vif désir de bien faire, n'exprime pas d'autres sentiments lorsqu'il a trouvé, dans l'arrivée du marchand, la bonne aubaine qu'il épiait.
Voilà comment le dévoûment rendait des deux côtés, entre maîtres et valets, la familiarité acceptable. Voilà par quels correctifs pourraient s'expliquer, s'il en était besoin, les libertés de l'Asinaire. A côté de ces détails, on en rencontre d'autres qui nous apprennent quelques habitudes de la servitude. Les esclaves pouvaient distribuer leurs économies ou pécule; Liban le dit plaisamment en voyant venir son. camarade. Ces ressources, lentement amassées sur leur industrie de tous les jours, sur leur nourriture, n'étaient, entre leurs mains, qu'une sorte d'usufruit, ou plutôt une possession fictive, dont le patron était, au fond, le maître véritable.C'etait,comme les libertés dont nous avons parlé plus haut, une apparence de propriété ou de droit, qu'on laissait entre leurs mains, un hochet pour leur vanité, qu'on leur retirait à la première occasion. Ce pécule leur servait souvent à acheter des suppléants, liberté encouragée par les chefs de maison, parce qu'elle laissait à l'esclave, maître d'un pécule, plus de loisir pour l'augmenter. Nous en avons un exemple ici. Léonidas, à la fin du second acte, parle avec éloge de Stichus, son suppléant. Nous en avons d'autres ailleurs. Verrès, lorsqu'il se vit obligé de restituer à la mère du jeune Malléolus, son pupille, une partie des sommes qu'il lui avait retenues, lui rendit, avec elles, les esclaves, leur pécule et leurs suppléants, Vicari. Horace, dans cette satire citée déjà, où il permet un si libre langage à l'esclave, ne manque pas de rappeler cette humiliante comparaison qui est aussi une leçon d'égalité " Si l'esclave qui obéit à un autre esclave est, comme le veulent vos usages, son remplaçant ou son compagnon, que suis-je, moi, à votre égard? Vous me commandez, il est vrai; mais vous obéissez honteusement à d'autres maîtres, et vous vous laissez conduire comme le bois mobile que dirigent des ressorts étrangers." (1)
(1) Horac. Sat. Il. 7. 79
La comédie de l'Alulaire met trop en évidence l'avarice du maître pour laisser beaucoup de place aux caractères des esclaves. La scène qui s'ouvre par des reproches qu'Euclion adresse à la vieille esclave Staphyla, témoigne de la misérable condition, de l'abjection où étaient laissés même les plus vieux serviteurs. Staphyla est battue par son maître, et les malédictions suivent les mauvais traitements. Il faut, lui dit Euclion, qu'une misérable de ton espèce ait ce qu'elle mérite, un sort misérable. Il est vrai que, comme Harpagon, le maître ici n'est si terrible que parce qu'il tremble pour son trésor, et que sa dureté vient en grande partie de sa terreur d'avare; cependant; nous savons par trop d'exemples que les rigueurs envers les plus anciens valets n'avaient pas toujours besoin de ce motif pour s'exercer. D'ailleurs, à la fin de cette scène Staphyla parle de se suicider par strangulation ;c'est assez dire à quels tourments elle est en butte (1).
(1) Saint Chrysostôme, Homél. xi, dit d'une maîtresse " Les passants entendent les emportements de cette femme et les hurlements de ses esclaves, elle les fait déshabiller, les attache au pied de son sofa, et leur donne .elle-même des coups de fouet."
Dans cette pièce, le véritable rôle des inférieurs, c'était de faire ressortir, par leur conduite ou par leurs récits, la mesquine parcimonie du chef.
Plaute n'y a pas manqué. Cuisiniers, prétendants, amoureux, serviteurs, chacun souffre ou se plaint d'Euelion. Ce qui tranche sur ce fond rapace et médisant, c'est la conduite de l'esclave de Lyconide, l'amant de la fille de l'avare. Strobile, c'est son nom, est ici le représentant, l'expression de la servitude honnête. Il arrête son jeune maître quand il va faire une faute il se néglige pour le mieux servir il dort moins pour mieux veiller sur lui; il devine ses moindres pensées; un ordre est à peine donné que déjà il est rempli. Au lieu d'exciter son amour pour en profiter davantage, il le retient sur la limite de l'excès, et le calme avec prudence, avec désintéressement. Cet attachement à un jeune maître amoureux n'est pas nouveau pour nous. Nous l'avons déjà vu dans les deux pièces précédentes. Les amants ont du bon ils sont généreux ils partagent volontiers avec ceux qui les servent au lieu d'arrog,ance, ils montrent de l'aménité; souvent même une bonhomie qui intervertit les rôles, et fait, nous l'avons observé, un maître du subalterne. Et puis avec eux les profits sont plus grands car, en amour, on compte peu. Voilà quelle a été de tout temps la règle de ceux qui aiment, et la cause de la sympathie, de la fidélité, qu'ils ont trouvée dans leurs valets. Celui de Lyconide poussé sa tendresse fort loin, car il dérobe, en faveur de son maître, la fameuse marmite qui contient le trésor d'Euclion. Remarquons ce trait de naturel par lequel il signale son larcin
" 0 Bonne Foi! s'écrie-t-il, si je découvre cet or, je t'offrirai une cruche de vin d'un conge entier oui, je n'y manquerai pas; mais je boirai ensuite l'offrande."
Les Bacchis nous offrent deux figures d'esclaves plus fortement accusées, Chrysale, serviteur de l'amoureux Mnésiloque, et Lydus, pédagogue de Pystoclère, l'autre amoureux. Ici, l'étude de l'esclavage en famille, ou plutôt de la condition intérieure des esclaves s'éclaire par un vif contraste et nous révèle quelles profondes différences séparaient certaines classes d'esclaves les unes des autres. L'éducation des enfants était confiée, comme un meuble sans valeur; à la portion la moins estimée de la société, à un esclave nommé Pédagogue. C'était l'instituteur de la maison, le pédant de la famille, se substituant au père pour tout ce qui concernait l'enseignement et les bons préceptes. C'était une fonction différente de celle du praeceptor, qui était le maître d'école, ayant classe ouverte en ville, comme nous l'apprenons par Pline. On peut, de nos jours, trouver au moins étrange ce fatal partage qui laissait aux mains d'un subordonné, de condition vile, la meilleure, la plus difficile et la plus noble tâche, l'éducation du fils de famille. En condamnant cet usage, nous jugeons avec des considérations modernes, nourries de christianisme, la philosophie domine notre critique èt nous ne séparons plus la morale de l'instruction qu'on doit à l'enfant. Mais il faut dépouiller ces vues en face de l'antiquité, et l'excuser, la justifier même en reconnaissant que ses motifs étaient bien différents. L'instruction se bornait alors à la science du droit, de la chicane plutôt, du calcul et à la connaissance des XII Tables.
Le peu de philosophie qui, de la Grèce, avait insensiblement pénétré dans quelques rares maisons, se composait de dialectique et d'habiles sophismes, mais ne s'occupait guère de morale proprement dite. L'obéissance passive du fils envers le père, qui était la règle morale souveraine imposée aux enfants, s'effaçait chaque jour davantage par le rapprochement que la communauté de débauche amenait entre le pater familias et son fils. On n'obéit guère à ceux qu'on peut condamner, et l'on perd le respect pour qui se dégrade à plaisir. Il fallait donc, à côté des pères débauchés, une sorte de substitut qui les représentât auprès de leurs fils mais avec le caractère sérieux que la loi conférait à la paternité, avec la gravité des moeurs et du ton, la sagesse des maximes, l'austérité du devoir partout. C'était le pédagogue qui était chargé de cette sorte de paternité intellectuelle et morale.
Mais comme un homme libre n'eût pas accepté volontiers cette situation secondaire destinée à maintenir le lien fort relaché déjà de la discipline des fils de familles et à représenter, après tout, un autre que lui-même, comme d'ailleurs il eût été dangereux pour un père de voir cet auxiliaire de sa souverainetéle supplanter au lieu de le soutenir, le rabaisser au lieu de le faire valoir, et rompre au lieu de raffermir le frein qui retenait encore quelque peu la soumission filiale, il fallait de toute nécessité choisir ce représentant parmi les esclaves. On était sûr d'être servi et non effacé, et avec plus de chances de n'être pas trahi, on avait le droit de punir, quand on l'était. Les inconvénients de ce choix sont palpables ils ont été montrés partout. La bassesse de la condition entraîne ordinairement celle des sentiments, et on ne devait rien apprendre de bon d'un homme qu'on méprisait le plus ordinairement. (1)
(1) Plutarque, Cato maj., XX, nous donne l'opinion du vieux Caton sur cet emploi d'un esclave pédagogue. Sur ce point de l'éducation, Plaute et Térence diffèrent encore d'une façon digne de remarque.
Mais la science et la bonne conduite sont de puissants correctifs Livius Andronicus, Térence nous montrent où le savoir. et le talent mènent l'homme le plus obscur, et témoignent des affections qui peuvent être la rançon de son humilité première. Les esclaves savants, qui étaient estimés et achetés à si haut prix dans la suite, devaient nécessairement paraître insupportables à la plupart de leurs jeunes maîtres insouciants et inexpérimentés; et lorsqu'au savoir ils ajoutaient, ce qui était le plus commun, le pédantisme et le ton grondeur, ils devenaient d'excellentes figures de comédie. Plaute qui, nous le savons, ne glisse jamais la morale que sous
le couvert de la gaîté, ne devait pas manquer de représenter le pédagogue avec son rôle d'intérieur, tout-à-la fois grave et ridicule. C'est un personnage curieux pour nous, c'est presque de l'histoire, parce qu'il nous indique le point juste où était arrivée l'éducation d'alors; ce qu'elle était, et combien elle s'éloignait déjà de celle d'autrefois.
Il y a dans Aristophane une comédie qui traite aussi de l'éducation. Les Nuées qui sont une satire du sophisme et dont le but est de substituer l'idéal : dans Térence, Simon, parlant de son fils, Andr.; 54, dit
"Car, jusqu'alors, je n'avais pu connaître et juger son caractère. Son âge, sa timidité, son maître, tout le tenait dans une sorte de contrainte." du passé aux fausses doctrines du moment, nous offrent une sorte de parallèle entre la nouvelle et la vieille discipline que Plaute semble avoir mis à profit. Aristophane introduit sur la scène les deux doctrines dans la personnification du Juste et de l'Injuste. Il est assez facile de comprendre que le premier représente le passé. Voici ses paroles
",Je vais dire quelle était l'ancienne éducation aux jours florissants où j'enseignais la justice et où la modestie régnait dans les moeurs. D'abord il n'eût pas fallu qu'un enfant fît entendre sa voix. Les jeunes gens d'un même quartier, allant chez le maître de musique marchaient ensemble dans les rues, nus et en bon ordre, la neige tombat-elle comme la farine d'un tamis. Là ils s'asseyaient en silence et on leur apprenait à chanter des hymnes; ils conservaient la grave harmonie des airs transmis par leurs aïeux. Si quelqu'un d'eux s'avisait de chanter d'une manière bouffonne ou avec les inflexions molles et recherchées introduites par Phrynis, il était frappé et châtié comme ennemi des muses. Au gymnase chacun, en se levant, devait balayer l'arène à sa place. C'est cette éducation qui forma les guerriers de Marathon. En me suivant pour guide, tu apprendras à haïr les procès, à ne pas fréquenter les bains, à rougir des choses déshonnêtes, à t'indigner si l'on rit de ta pudeur, à te lever devant les vieillards, à ne donner aucun chagrin à tes parents, à ne faire rien de honteux, car tu dois être l'image de la.pudeur. Tu ne contrediras pas ton père tu ne riras pas de son. grand âge; tu oublieras les défauts de celui qui t'a élevé. Tu iras à l'académie te promener, sous l'ombrage des oliviers sacrés, une couronne de joncs en fleur sur la tête, avec un sage ami de ton âge." Plaute, moins rempli de ces riantes images, de ces leçons respectueuses et nobles inspirées par Homère et par le ciel transparent et poétique de l'Attique, a rappelé comme Aristophane, et, mieux que lui, a fait vivre sur le théâtre cet oubli du respect filial, ses causes, ses effets avec une vérité profonde, mais plus brutale, plus romaine, si je puis dire. Lydus quand il reproche à son élève et au père de son élève leur coupable relâchement, parle surtout de la sévérité des châtiments qu'encourait autrefois la moindre infraction à la discipline du labeur. L'hippodrome, la palestre, le gymnase, la tunique du travail, et à la première faute, la peau tachetée comme le manteau d'une nourrice, voilà quelles étaient à Rome la règle et la rigueur primitives.
Orbilius, le sévère maître d'Horace, dont Lydus semble être un précurseur, avait sans doute fait revivre plus tard cette bienheureuse méthode, seulement il l'appliquait plus vigoureusement. Les reproches adressés ici à Philoxène père de Pistoclère, prouvent bien que le goût de la sciencé, le sentiment élevé de leur mission échappaient le plus ordinairement aux chefs de famille. Philoxène,je le sais bien, essaie de guérir le précepteur de ces excès de sévérité qui sont le travers des pédagogues, et qui manquent leur effet, parce qu'on ne corrige les hommes que par la modération. Ce contraste entre un père indulgent avec mesure à son fils et. un maître impitoyable ne manquerait pas d'intérêt s'il eût été développé..Mais Plaute passe bien vite la vraie cause de cette mansuétude.
Au sein du sensualisme.organisé qui les entourait, les citoyens préféraient s'occuper des ressources matérielles à tirer de la servitude plutôt que des devoirs moraux qu'ils s'étaient imposés envers quelques-uns de leurs esclaves. Varron, dans ses Satires, disait encore de son temps "Le soin que tu as pris pour que ton esclave boulanger su faire du bon pain, si tu en avais donné la douzième partie à l'étude de la philosophie, tu serais depuis longtemps bon toi-même. Maintenant ceux qui connaissent cet esclave veulent l'acheter pour cent mille sesterces. Mais personne qui te connaît, ne t'achèterait au prix d'un liard"
On comprend maintenant pourquoi les esclaves pédagogues eurent, en général, une autorité sitôt méconnue. Quand on cherchait à faire valoir ses serviteurs comme des terres productives, à la manière de Caton et de Crassus quand on tirait bénéfice même de la barbe qu'on leur faisait couper solennellement on ne devait guère se préoccuper à la longue de ceux qui n'avaient qu'un emploi intellectuel et à peu près stérile. Cet usage, nous le savons, n'offrait que de rares exceptions alors. C'est lorsque la littérature fut quelque chose dans l'État, quand par goût des lettres grecques ou par vanité, on voulut s'attacher des serviteurs savants c'est alors seulement que ce qui était l'exception devint la règle.
Otez à Lydus son pédantisme gourmé, vous aurez un esclave complaisant et familier, vous aurez Chrysale. C'est le même dévoûment, mais compris et pratiqué d'une autre manière. Chrysale est aussi aimé que Lydus est importun, parce que les vicieux aiment mieux les services que les leçons, et que la bonne humeur est déjà à. elle seule une marque d'indulgence dont ils ont besoin. Mascarille de l'Etourdi, Scapin des Fourberies de Scapin, La Branche de Crispin rival de son maître, sont des copies de Chrysale et de quelques autres valets de la même famille qui figurent dans les comédies de Plaute. Mais j'ai moins de confiance dans l'imitation que dans le modèle, parce que l'esclavage n'est pas de notre temps. On est pauvre et on loue ses services et sa personne on est riche et l'on paie un peu de soumission d'un prix trop faible encore, mais le contrat ne lie le pauvre au riche que pour un temps limité et volontaire. Voilà la servitude moderne elle a ses vicissitudes ses ruses et ses grandeurs comme l'esclavage antique; mais elle ne lui ressemble pas assez cependant pour que je loue Molière et Regnard d'avoir calqué servilement leurs valets chrétiens sur les esclaves du paganisme.
Chrysale, comme tous les esclaves dévoués à leurs jeunes maîtres, obtient du sien, en retour de ses services, un peu de cet attachement que les grands seigneurs du dix-septième siècle n'auraient jamais songé à accorder à leurs laquais, de peur de déroger. Un Rohan, par exemple, n'aurait jamais dit comme l'amoureux Mnésiloque " J'obtiendrai comme une grâce de mon père qu'il ne fasse point de mal à Chrysale et ne lui garde pas rancune d'avoir été dupé à cause de moi. Il est juste aussi que je défende ce pauvre garçon qui n'a menti que pour m'être utile" (1)
(1) Bacchsi, 488 sqq.
Cette bienveillance reconnaissante s'explique par des motifs que nous connaissons et par d'autres que Chrysale nous apprend. Sa morale diffère déjà de celle de Strobile. Il est dévoué, lui aussi, mais avec calcul. Il veut la réciprocité partout; il est partisan du talion, le bien pour le bien, le mal pour le mal. Il prend le temps comme il vient, et se contente de toute chose. Son programme est une curieuse profession de foi :
"Qu'on ne me parle pas des Parmenons, des Syrus, qui procurent à leurs maîtres deux ou trois mines! Rien de plus misérable qu'un esclave qui n'a point de cela (se frappant le front). Il lui faut un esprit fertile qui fournisse à tout besoin des ressources. Un homme n'a de valeur qu'autant qu'il sait faire le bien ou le mal fourbe avec les fourbes, voleur avec les voleurs, qu'il rapine alors tant qu'il pourra. Il faut savoir prendre toutes sortes de faces, pour peu qu'on ait de sens et d'esprit; bien agir avec les bons, mal avec les méchants, s'accommoder aux circonstances.""
Ce rappel dédaigneux des esclaves d'origine grecque, comme les Parmenons et les Syrus, serait à lui seul une preuve que Plaute n'a pas voulu emprunter ces caractères au théâtre grec, et que là comme ailleurs, il a été Romain. Térence, qui nous a donné un Syrus et un Parmenon, sera moins scrupuleux, moins original dans le choix de ses esclaves. La théorie de Chrysale, fort nouvelle pour nous, a quelques rapports avec celle des valets de notre théâtre elle rappelle la bonne humeur, l'esprit et l'insouciance de Figaro. S'accommoder aux circonstances, ce sera la philosophie des maîtres sous les empereurs, de Pollion, d'Horace sous Auguste au sixième siècle, c'est celle de certains esclaves seulement, comme Chrysale.
Là aussi le jeune maître est plein de compassion pour le serviteur, je l'ai dit mais n'y mêle-t-il pas souvent un peu d'intérêt personnel? Que deviendraient Mnésiloque et Pistoclère sans les ressources d'esprit de Chrysale! Il est aussi aimé que les Frontin, les Lafleur, les Mascarille, les Scapin le seront, dans la comédie moderne, par de jeunes écervelés dont la familiarité avec leurs valets est composée de bonhomie, de faiblesse et d'égoïsme et qui, une fois satisfaits rejetteront sans doute dans l'obscurité l'instrument qui leur avait été utile. Cette bonté intéressée est parfaitement évidente ici " Point du tout, dit-Mnésiloque, mon père ne te fera pas de mal. J'ai eu de la peine à le vaincre. A présent il faut que tu me rendes un service, Chrysale." Mnésiloque n'y met pas de dissimulation, comme
on voit. Il demande de suite et sans détour le salaire de sa commisération. C'est un de ces traits de caractère comme Plaute en a tracé beaucoup, avec une vérité rapide et un peu brutale.
L'esclave, qui est un fin matois, emploie, pour rendre ce nouveau service à son maître, ses ressources accoutumées de supercheries et de mensonges, comme le Mascarille de l'Etourdi. Je remarque ici encore un de ces traits d'observation qui sont si habituels aux esclaves de Plaute. Chrysale parle de sa discrétion, ou moment où il l'oublie " Je sais, dit-il, que je suis esclave je dois ignorer même ce que je sais" On ne dit pas avec plus de franchise maligne qu'on viole son devoir et qu'on le connaît. Les Captifs sont la pièce où Plaute a montré l'esclave sous le jour le plus favorable. C'est, comme on l'a dit, une exception dans tout le répertoire comique des Grecs et des Latins. C'est l'idéal de l'esclave.: il faut être doué d'un dévoûment peu ordinaire, comme cet écuyer de Flaminius, qui se fit tuer au lac Trasimène pour son maître, ou, comme ce jeune esclave qui subit, nous dit Val. Maxime, les plus cruelles tortures plutôt que de dénoncer l'orateur Antoine; il faut porter dans la servitude ces nobles sentiments de l'homme libre que Plaute déploya peut-être dans la sienne, pour imaginer de faire, comme il l'a tenté ici, de l'exception qui est l'élément de la tragédie, une vérité presque générale qui est l'essence de la comédie, .et d'un remarquable accident une pièce touchante. Aristote, qui a écrit quelque part " le boeuf tient lieu d'esclave au pauvre"a dit dans sa Poétique que les esclaves ont toujours l'âme vile. Mais il ajoute qu'il faut toujours, malgré ce défaut de leur état" les représenter en beau." On dirait que quelque auteur grec que Plaute n'a pas nommé a voulu mettre le précepte en oeuvre, ou plutôt je crois que là, comme ailleurs, le poète latin est resté indigène et a tenté de nous donner l'histoire plus développée d'un sentiment qu'il a maintes fois indiqué ailleurs, la peinture du dévoûment dans l'oppression.
Jusqu'ici nous avions déjà vu ce que pouvait l'attachement du serf pour le patron. Ailleurs, dans les Ménechme par exemple, l'esclave Messénion, qui pratique par calcul cette vertu que plus tard le Digeste érigera en obligation pour l'esclave, Messénion, en se voyant enlever son maître s'écrie " Non, je ne te laisserai pas périr, il est juste que je périsse plutôt moi-même". Les Captifs sont le développement dramatique de cette généreuse pensée. Il s'agit d'un de ces fils de famille qui, enlevé dans son bas âge par un esclave fugitif, la pire espèce des esclaves, revient à son insu dans la maison de son père, et là, montrant sous sa livrée servile les sentiments généreux de sa primitive condition se dévoue pour sauver les jours et faciliter la fuite de Philocrate, son maître. Il y a donc, plus qu'on ne l'a dit, une vraisemblance habilement ménagée dans cette fable. Tyndare qui comme Plaute lui-même, est tombé par un accident inattendu de la liberté dans la servitude, ressemble tout-à-fait à ces femmes d'origine libre que la captivité et les malheurs ont faites courtisanes, sans leur ôter cette pureté native et cette noblesse du sang qui, chez les Romains ne pouvait jamais mentir. Ainsi, à cet égard, la donnée n'est pas sans précédents dans ce théâtre. Tyndare n'est pas dans le passé un captif de guerre, ni un serviteur né dans la famille, verna; c'est un enfant enlevé, ses vertus s'expliquent mieux par là. Plaute n'a pas manqué de faire contraster cette figure avec celle de l'esclave vil. Stalagme, qui a ravi autrefois Tyndare à ses parents, revient à la fin de la pièce, comme l'étranger dans l'Oedipe de Sophocle, pour reconnaître la faute et comme pour marquer mieux, par sa fourberie, la distance qui sépare l'esclave d'origine de l'esclave né libre. Une autre objection a été faite et elle a son importance. Tyndare complote longuement avec Philocrate son jeune maître, captif comme lui, pour seconder, au moyen d'un changement de nom, son retour en Élide. On s'est demandé pourquoi ces longs détours pour tromper un homme d'un aussi bon naturel que le vieil Hégion, le possesseur des deux esclaves. Mais on n'a pas assez remarqué que ce bon naturel se montre surtout dans l'extrême tendresse qu'Hégion garde au fils qu'il a perdu, mais qu'il ne va pas jusqu'à permettre que les deux esclaves qu'il a en .a possession le quittent avant le retour de cet enfant chéri.
Oui, Hégion les renverra tous deux, mais non pas avant qu'on lui ait rendu son Philopolème, et c'est pour arriver à un échange sûr sans bourse délier, sans laisser plus longtemps Philocrate loin de son .pays et sans exciter les défiances du bon Hégion, que Tyndare l'esclave se dévoue. Le poète, qui n'oublie jamais de faire ressortir une .vérité par son contraire, a soin de semer ici les contrastes. Le correcteur parle aux deux captifs de fuir il'se montre compatissant pour eux. Il
dil ailleurs:" Par ma foi tous les hommes préfèrent la liberté à la servitude" paroles hardies, sympathiques, dignes d'émouvoir la cavea et bien faites pour donner plus de prix à l'abnégation de Tyndare. Il est regrettable que celui-ci dans sa générosité s'érige, comme la plupart des personnages de Plaute, en appréciateur de sa propre conduite et la fasse valoir auprès de celui qu'il sert et qu'il juge aussi tout à la fois " Tu vois, dit-il, que pour sauver ta chère personne j'expose ma personne qui m'est chère aussi et que j'en fais bon marché. La plupart des hommes sont ainsi faits; tant qu'ils veulent obtenir, ils sont excellents; une fois leurs souhaits accomplis, leur vertu se changé en perfidie, en déloyauté, etc."
Cette franchise un peu égoïste est bien romaine cette fois encore. Elle ne connaît pas les ménagements, les allusions de la politesse moderne et même de celle qui va venir, qui existe déjà, de la politesse de Térence et des Scipions; elle va droit au but, elle n'exagère pas sa valeur, ne se fait ni plus grande, ni plus humble qu'elle n'est. Le dévoûment de l'esclave ici ne s'augmente pas de celui de sa réserve; il attend fièrement qu'on lui tienne compte de ce qu'il est; cela peut paraître hardi, incorrect pour nous, mais c'est plus naturel. D'ailleurs, nous.le savons, Plaute aime à entrer en conversation avec son auditoire, à lui faire juger d'avance, plutôt que lui laisser éprouver lentement la conduite de ses personnages. Dans son dégoût pour l'illusion, il touche à chaque instant à la réalité, et il se complaît à la découvrir aux autres . Il dit au début: pour rappeler à la cavea que cette fiction a un fond sérieux. Tyndare est donc touchant malgré ces échappées hors de son rôle; ou plutôt il y a là encore une vérité de caractère qui mérite d'être louée. Ainsi, lorsque Hégion l'a fait garrotter pour l'avoir trompé, et le réprimande en lui disant
" bon semeur bon sarcleur" Tyndare répond insolemment " Pourquoi n'as-tu pas dit d'abord bon herseur? la herse précède toujours le sarcloir dans le labourage".
Cela peut paraître d'abord une de ces facéties bouffonnes si familières à Plaute. Quand on y réfléchit, c'est une réponse juste et parfaitement vraisemblable. Tyndare a été esclave, il a conservé quelque chose de ce cynisme servile qui brave, en riant, le mépris ou la douleur. Dans cet instant éclate le sentiment de son dévoûment méconnu et en même temps, à son insu, la révolte d'un sang libre contre un châtiment immérité " La hardiesse, ajoute-t-il, sied bien à un esclave innocent et sans reproche, surtout devant son maître." Toute cette scène cinquième du troisième acte est d'une beauté peu commune. L'esclave qui, sous le 'coup des tortures les plus cruelles, sous la menace de la mort, se fortifie par la pensée que du moins son maître son maître qu'il aime, est sauf, et qui s'écrie dans un moment de généreuse exaltation: " Qui périt pour la vertu ne meurt pas!" le serviteur qui s'énorgueillit du mensonge parce que ce mensonge a délivré son jeune patron Philocrate, auprès de qui il remplaçait presque son père; qui, pour résister à Hégion, se fait un point d'appui de son attachement consacré, fortifié par un long commerce et qui enfin dans ce moment ému où la vérité des sentiments se révèle dans toute sa force, ne doute pas de la réciprocité d'affection que lui a vouée Philocrate, ce serviteur là était pour les Romains, pour les esclaves qui pouvaient se glisser par surprise dans quelque coin de l'amphithéâtre, un séduisant exemple et un encouragement.
D'autre part, la conduite du jeune maître envers Tyndare est une leçon non moins belle. Philocrate témoigne pour l'esclave qui dans son enfance lui a été donné en pécule et qui va le sauver, une reconnaissance bien autrement élevée que celle du Mnésiloque des Bacchis et dont les spectateurs devaient être surpris et sans doute charmés. C'était chose nouvelle pour la plupart d'entendre un patron dire à son serviteur "Je t'appellerais mon père si je l'osais. Car, après mon père, tu es mon père le plus proche". Caton malgré sa familiarité avec ses esclaves, n'avait pas accoutumé ses contemporains à voir dans un serviteur autre chose qu'un instrument méprisable. Caton avait enseigné. lui-même les lettres, l'équitation, le droit à son fils, ne voulant pas des soins de l'esclave Chilon, quoiqu'il fût honnête et savant, et "ne pouvant souffrir que son fils dût à un esclave l'insigne faveur de l'avoir élevé (1)."
(1) Plutarch. Cato. maj.XX.
Le langage de Philocrate devait donc frapper l'auditoire. Plaute ne s'était pas borné là; il voulait à tout prix corriger, améliorer les spectateurs, il voulait tirer de sa comédie tout le fruit.qu'il s'en promettait lorsqu'il annonçait, en terminant, que les bons y apprenaient à devenir meilleurs. C'était sans doute pour cela qu'il faisait dire à Hégion " Quand on fait du bien aux bons, le bienfait est fécond pour le bienfaiteur," et qu'il avertissait, qu'il inquiétait les mauvais patrons par cette haute et sévère pensée qu'on n'eût point attendue de Plaute, où domine le sentiment divin qu'on retrouvera encore dans le Rudens. "Il y un Dieu qui voit, et entend toutes nos actions selon que tu me traiteras ici, ce Dieu veillera sur lui dans l'Élide. Le bienfait aura sa récompense et le mal suivra le mal." Ce langage élevé, cette philosophie inattendue seraient presque dignes des Pères de l'Église si, là encore, l'idée du talion païen ne prédominait pas (1).
(1) Il est bon de remarquer que si Tyndare n'est pas aussi partisan de la loi du talion quand il s'agit de répondre' aux menaces d'Hégion, vers 675 sqq., c'est que l'auteur a voulu le rendre respectueux, comme par un vague pressentiment de tendresse filiale, envers celui qu'il doit reconnaître plus tard pour son père. Tyndare, dans la pensée de Plaute, doit avoir toutes les vertus.
La charité est un sentiment que Plaute et ses contemporains ne connaissaient point. Ce qui devait toucher principalement les spectateurs et ce qui jetait sur le généreux Tyndare un intérêt plus voisin de la tragédie que de la comédie, c'est le récit des tourments qu'on lui inflige pour avoir trompé Hégion. Il est conduit à une
carrière il lui faut traîner péniblement des pierres chaque jour. La nuit on l'enchaîne. Le jour il est occupé dans des demeures souterraines à fendre le roc avec un pic pour toute arme sous les ordres d'un affranchi. Tyndare ou plutôt le poète, quand il fait le récit de ces travaux, n'insiste pas longuement et il a bien soin, quand il sent monter l'émotion, de faire diversion par un détail joyeux
"A peine fus-je arrivé dans la carrière, on me traita comme les enfauts des patriciens auxquels on donne, pour jouer, des merles, des cannetons ou des cailles; on me mit en main ce pic pour m'amuser." Mais, comme, je l'ai dit déjà, les comiques latins n'insistaient pas trop sur cette partie de la vie.servile, c'était sans importance ou pouvait exciter les larmes. Cette pièce, s'il faut en croire la remarque de Lessing réalise, le but. de la meilleure comédie, qui est de corriger les moeurs du spectateur de rendre le vice, odieux et la vertu aimable. Mais comme les moeurs, ajoute-t-il, sont trop corrompues pour employer ce,moyen direct, elle.peut arriver à son but :par d'autres voies, en rendant la vertu heureuse et le vice malheureux. L'esclave honnête Tyndare, Hégion, Philocrate; retrouvant tous une patrie, une famille, une récompense, représentent la vertu heureuse.Stalagme, l'esclave fourbe et, sans pudeur, puni définitivement de son crime, personnifie le vice malheureux. Ce but qu'on ne peut méconnaître ici peut être la fin dernière de quelques comédies d'exception écrites pour une société naissante où entièrement pervertie.
Mais, il faut l'avouer à notre honte, si toutes les comédies n'avaient pas d'autre objet, ou si elles ne tendaient à le réaliser que par des moyens analogues, elles risqueraient, de ne pas nous intéresser longtemps ou de nous faire courir; de préférence, aux jeux d'un bateleur ou d'un ours. Plaute l'avait bien senti lui-même dans cet essai, qu'il ne fit qu'une fois; de la comédie vertueuse. A un auditoire blasé comme le sien il fallait autre chose encore que de la morale et bien que, de son propre aveu, il n'ait montré ici à dessein ni prostitueur, ni courtisane, ni amour perfide, il n'a pu s'empêcher de corriger la monotonie des sentiments honnêtes de sa comédie par les saillies d'un parasite, et les nobles pensées de Tyndare l'esclave par les révélations du captif Aristophonte ou les effronteries de l'esclave Stalagme.
Quoiqu'en dise Lessing, ce qui plaisait dans le rôle de celui-ci, c'était moins son châtiment que son imperturbable bonne humeur; et la plèbe corrompue qui l'écoutait devait mieux goûter le récit insolent de ses. friponneries que s'inquiéter s'il devait aller ou non à la potence, ou s'il la méritait. La curiosité maligne est le plus vif sentiment que le spectateur apporte au théâtre. C'est elle que le poète habile cherche à surprendre, à intéresser avant la morale. Les hasards de l'ordre alphabétique ont mis à la suite de la comédie des Captifs l'épisode cynique de la Casine. Un père qui veut faire épouser une esclave par son fermier, afin.d'en jouir lui-même, un fils qui la lui dispute au moyen d'un de ses serviteurs qui la recherche en mariage pour la livrer à son jeune maître, voilà des moeurs qui ne ressemblent en rien à,celles des Captifs, et qui par là même, il faut bienle dire, sont plus près de la réalité ou de la vérité générale.
Dans un prologue, qui a été écrit bien longtemps après la première représentation de la pièce, l'objection d'un mariage entre esclaves a été prévue et combattue par des plaisanteries. C'est qu'il n'y avait pas de mariage entre esclaves. Le Contubernum et non le Connubium était le seul lien qui les unissait. Ils vivaient dans une case commune, homme et femme, donnant le jour à des enfants qui devenaient à leur tour les esclaves du même maître. Ces sortes d'unions n'imposaient guères une rigoureuse fidélïte, et bien que Caton n'eût permis ces relations và chacun de ses esclaves qu'avec la même femme, pour en tirer un profit pécuniaire et par des motifs d'activité et d'ordre, cette mesure même suffirait à prouver que d'ordinaire ce genre d'unions n'excluait pas une sorte de polygamies La scène qui s'ouvre par une dispute entre les deux poursuivants de la main de Casine, entre Chalinus l'esclave du jeune homme, et Olympion le fermier du vieux Stalinon, nous fait habilement connaître le sujet. Olympion, parmi les invectives qu'il lance à son rival, le menace de l'humilier en lui faisant porter le flambeau de noce devant la nouvelle mariée. Cette fonction, qui en toute autre occasion était un honneur, n'est regardée comme un affront ici que parce que ce rôle de porte-flambeau des noces d'un rival devait être blessant pour celui qui avait aspiré à être le marié. Chalinus, l'écuyer du fils de Stalinon, quand il se trouve en face du vieillard, se souvient, mais un instant seulement, de la règle qu'Horace recommandera si souvent à ses amis qui veulent se pousser à la cour "c'est folie de faire le fâcheux avec un plus puissant que soi" (1).
(1) Casin. 475.
Mais devant les prétentions amoureuses de Stalinon, la retenue lui échappe et il brave le vieux maître. Ses préférences et ses respects sont pour d'autres. Olympion, de son côté, qui s'est fait le champion de ces amours surannées, n'est pas beaucoup plus respectueux pour celui qu'il défend. Il protège Stalinon en se raillant de sa vieillesse, en tremblant qu'elle ne lui fasse défaut au moment décisif. Caractère d'esclave, sceptique et goguenard, il ne se fie pas trop en ceux qu'il soutient, il se moque de la matrone, et il ne croit guères aux dieux.. Il ne faut pas oublier qu'il est fermier, habitué à vivre loin de ses maîtres, et qu'il doute comme tous les ignorants, c'est par ce ton narquois qu'il diffère de Chalinus l'esclave de la ville qui, attaché aux intérêts les plus touchants, ceux de la mère et de son jeune fils, se montre pour eux plus sincèrement dévoué. La scène des sorts qu'on doit tirer pour savoir à qui appartiendra définitivement Casine, met en présence avec une vérité piquante ces deux caractères d'esclaves et, avec eux, les deux époux si diversement curieux pour nous. C'est une parodie des comices où se tiraient au sort plusieurs fonctions publiques et les provinces qu'on allait gouverner, et. je ne doute pas qu'avec les détails qu'il y a mêlés Plaute n'ait fait rire tous ses auditeurs. Il n'a pas manqué de livrer là, comme ailleurs, à leur risée le nom d'esclave fugitif, d'y ajouter même le stigmate de sa faute que le fuyard portait sur le front, et de tourner en ridicule les'personnages peu révérés désormais de Jupiter et de Junon.
D'autres traits risibles on ignominieux sont encore désignés ailleurs. Dans la scène qui suit celle du désespoir de Chalinus vaincu Olympion promet de lui faire porter au cou la fourche des esclaves coupables. On sait que c'était là une marque honteuse, un châtiment d'esclave, c'est-tout dire. Mais Olympion lui-même oubliait qu'il prêtait à rire, comme son camarade, en se montrant sur le théâtre avec sa robe blanche. " Le voilà tout vêtu de blanc, ce maraud, ce trésor d'étrivières" s'écrie Chalinus signalant ainsi à la foule un esclave qui prend des airs d'homme libre et se couvre des insignes d'un mariage qu'il n'a pu contracter. Toute cette scène huitième du second acte est une plaisanterie divertissante. Le maître lui-même va jusqu'à embrasser son fermier, et Chalinus prétend qu'un beau jour, lui aussi, il a été l'objet des faveurs de son vieux patron. Il y a là des réminiscences licencieuses de la comédie d'Aristophane C'est une débauche d'esprit dont l'intention de ridiculiser la vieillesse amoureuse est tout ensemble le fond et l'excuse.
Les serviteurs de la maison ne sont pas les seuls que l'auteur a mis en regard du vieillard pour le railler; les servantes sont aussi de la partie. Pardalisque simule un désespoir affreux causé, dit-elle, par la folie furieuse de Gasine elle feint avec esprit la terreur, pour mieux jouer le benin Stalinon, et elle va jusqu'à se faire promettre par lui des mules à la place dé ses gros souliers, et un anneau d'or au lieu de son anneau de fer pour apaiser ce délire de Casine, qui n'existe pas. Il y a, comme on l'a dit, une certaine analogie entre ce rôle d'une suivante, qui se rit d'un vieillard par toutes sortes de mensonges, et le personnage de Lisette dans les Folies amoureuses de Regnard. Lisette parle d'Agathe à son vieux tuteur, comme Pardalisque de Casine à l'amoureux Statinon. J'y remarque cependant ces légères nuances qui viennent des moeurs de deux sociétés différentes et qui distinguent les deux scènes. Agathe, dans sa folie, mêle avec désordre les goûts d'un monde policé
Elle court, elle grimpe, elle chante, elle danse;
Elle prend un habit,puis le change soudain
Avec ce qu'elle peut rencontrer sous sa main
Tout-à-l'heure elle a mis dans votre garde-robe
Votre large culotte et votre grande robe;
Chanté différents airs en différent jargon. (1)
(1) Regnard, les Folies amoureuses, act. II. sc. 6.
Son plus grand effort de furie, c'est de battre les murs avec sa tête. Elle reste femme et française jusque dans son égarement. Casine, au dire de Pardalisque, est moins douce,elle poursuit tout le monde une épée deux épées à la main, elle veut tuer son nouvel époux, le fermier, le vieux Stalinon, et s'égorger ensuite. C'est un foudre de guerre, ou plutôt c'est une esclave, c'est une Romaine du vie siècle qui parle. Le caractère et la condition des femmes esclaves sont indiqués ailleurs encore dans cette comédie. Il ne faut pas oublier que c'étaient leurs maîtresses qui avaient seules à s'en occuper. Cléostrate a soin de le rappeler à son vieux mari lorsqu'il se préoccupe du sort de l'esclave Casine " Je m'étonne, par Castor, qu'à ton âge tu ignores ce qui est du devoir. Si tu avais égard à la justice, aux bienséances, tu me laisserais pourvoir au sort de mes esclaves (ancillas) c'est mon affaire."
On trouve dans la Correspondance des femmes grecques quelques préceptes de conduite à suivre avec les femmes esclaves. Avant d'être mariée, la fille de condition libre n'avait pas le droit de leur commander. Après le mariage, elle avait plus particulièrement à veiller sur elles. De la douceur, une sévérité modérée asseyaient mieux l'autorité des matrones qu'une rigueur sans relâche. La femme du vieux Caton nourrissait de son lait les enfants de ses esclaves afin de leur inoculer de l'affection pour son jeune fils qu'elle nourrissait en même temps. Tous, ces soins ne trouvaient pas toujours des esclaves reconnaissantes, et les maîtresses faisaient souvent des ingrates, Voyez comme Pardalisque se laisse àller à ce goût de la médisance si dominant surtout dans la classe servile,quand elle veut caractériser les menées de sa matrone. A l'en croire, sa maîtresse n'est qu'une gourmande qui aime, les régals et qui veut éconduire son mari pour mieux.
festoyer. Je remarque là un témoignage de grande familiarité entre les matrones et leurs valets.
" Cléostrate, dit-elle, enfermée avec son mari dans son appartement, habille l'écuyer en nouvelle mariée pour le donner à Olympion en place de Casine Assurément Chalinus est un esclave né dans la maison, verna, et il faut qu'il ait pris bien vivement à coeur les intérêts de la matrone pour mériter et justifier ces privautés.
Tout d'ailleurs ici conspire pour donner à la femme la supériorité sur son époux. Les conseils des esclaves à la fausse Casine au moment où elle marche à la cérémonie nuptiale, afin qu'elle domine dans le gynécée, les humbles permissions que le vieux Statinon demande à Cléostrate dans tout le cours de la pièce, la hardiesse des questions que fait l'épouse au fermier, dans cette scène licencieuse où celui-ci raconte tout haut ses mécomptes de mari dès la première nuit des noces, le désappointement piteux du vieux patron quand il revient, lui aussi, de cette nuit bouffonne, et tombe au milieu des railleries de sa servante, de sa femme, de sa voisine, tout est destiné à nous donner ici un double échantillon de la débauche coupable des époux et de l'audace croissante de leurs femmes. Il ne faut donc pas trop nous étonner que Cecilius, dans son Plocium, nous ait montré un vieillard se plaignant de ses chagrins d'intérieur et de la tyrannie intolérable de sa femme qui à chassé de la maison une esclave sur le seul soupçon qu'elle paraissait plaire à son mari. Les impudicités des maîtres et les droits de la femme redonnaient plus que jamais à celle-ci l'insolence du premier rang et tendaient peu à peu à lui en inspirer les penchants. Quant à la pièce de Casine, c'est une spirituelle folie dont la
donnée quoiqu' invraisemblable, puisque le Connubium n'était pas permis aux esclaves, fait, au moyen de ceux-ci, saisir au vif les travers des vieux maris et l'audace, légitime encore, de leurs vertueuses matrones.
Le rôle d'esclave tient une fort petite place dans la Cistellaria. Lampadion, le serviteur de la famille (1) n'a pas osé faire mourir autrefois le fils que sa maîtresse
l'avait chargé de tuer. Il l'a exposé et l'a vu enlever par une courtisane.
(1) Paternus servus, dit le Dieu Secours. vers 167, en nous donnant une sorte de second prologue de la pièce. C'est un esclave qui s'est transmis du père à la fille et qui a suivi le sort et les intérêts de celle-ci, bien qu'il ne fût pas servus dotatis. Du moins on ne lui donne pas ce nom dans la pièce.
C'est à retrouver cet enfant, par tous les moyens, par toutes les recherches imaginables, qu'il s'évertue en bon et dévoué serviteur. II y parvient après de courageux efforts. Nous avons déjà rencontré ce personnage d'esclave. Les intérêts de sa maîtresse sont les siens. Il n'a pas besoin d'être stimulé le toit sous lequel il vit c'est son toit, l'enfant qu'il veut ietrouver, c'est comme un parent pour lui. Halisca, l'esclave de la courtisane, celle qui recherche la cassette qui doit faire reconnaître Silenie, Halisca n'occupe la scène qu'un instant elle ne se fait remarquer que par cette pensée " II faut qu'un secret confié de bonne foi soit gardé de même, pour qu'à l'auteur d'un bon office ne tourne pas à mal son envie de bien faire." (1)
(1) Cistellaria. 487.
Les esclaves de Caton le Censeur connaissaient bien cette maxime, lorqu'ils répondaient sans cesse " Je ne sais pas" à ceux qui voulaient savoir d'eux ce que faisait leur maître.
Il n'ya rien de sérieux dans la plus grande partie du rôle de l'esclave Palinure de Charançon. L'importance du rôle secondaire est laissée ici au Parasite qui donne son nom à la pièce et qui. est allé chercher en pays étranger la somme nécessaire aux amours de Phédrome. Cependant quelques unes des libertés, des facéties de Palinure méritent d'être remarquées. Aux confidences de son maître sur ses amours, l'esclave se récrie tout d'abord, et craint que Phédrome ne se permette quelque fredaine indigne de lui ou de sa famille, il tremble qu'il n'envahisse le gynecée de quelque matrone honnête ou gui doit l'être. A part cette épigramme qui est tout-à- fait dans le goût de Plaute, on croirait que c'est un serviteur de Térence qui parle. Térence ne fera qu'étendre par l'entremise de ses esclaves ces belles maximes de respect pour les matrones que Caton; nous dit Horace; prêchait à la jeunesse de son temps. Dans Plaute, ce n'est qu'un éclair de cette morale, qu'on peut appeler judiciaire. Il ne veut pas qu'un homme libre soit exposé, par un adultère, à être frappé d'incapacité au premier chef ais c'est tout. La plaisanterie viendra bien vite se jouer à la suite de ces leçons sérieuses. Palinure se raille avec une audace qu'il est bon de noter, des airs épris, de toutes les banalités sentimentales de son patron, et cela en sa présence même. Quand il mêle à ses plaintes ces proverbes habituels à la vie Romaine " Qui veut manger la noix, commence par casseur la coquille" ou celui-ci " Prends-y garde la flamme suit de près la fumée"qu'Horace, dans sa Lettre aux Pisons se rappellera aussi en définissant le procédé d'Homère, il semble entendre Sancho Pança sermonnant Don Quichotte et appuyant chacun de ses arguments de force sentences et adages. Ce n'est pas tout: Palinure qui aime le vin et qui envie à la vieille servante de l'amoureuse celui qu'elle reçoit ne se gêne pas pour insulter l'amante de son jeune patron " Vraiment 'effrontée? avec tes yeux de chouette il te va bien de dire que je suis ennuyeux! Le beau masque aviné! sotte!" (1)
(1) Curculio, 299.
Tant de libertés reçoivent enfin leur digne prix. Phédrome, en voyant insulter celle qu'il aime, rappelle l'esclave au sentiment de sa condition subalterne "Un esclave, régal des ëtrivières, prendre la parole devant son maître"
Voilà l'équilibre romain rétabli. Mnésiloque des Bacchis ne disait pas autrement au pédant Lydus, son précepteur. Le badinage a cessé pour faire place à la réalité; l'esclave est battu sur la scène par celui qu'il traitait d'égal tout-à-1'heure. Cette comédies nous apprend encore, mais en passant et comme par hasard, certains usages habituels aux esclaves, tels que la divination ou plutôt l'interprétation des songes. Il est aisé de comprendre que beaucoup d'entre eux, victimes de la guerre, du commerce ou de cette piraterie exercée sur eux, dans les parages de la Cilicie, dans la Thrace, le Pont, ou l'Asie Mineure, aient essayé quelquefois de se faire un pécule ou d'imposer à leurs maîtres par l'usage de certaines prédictions auxquelles on croyait encore généralement. Comment, d'ailleurs, dans un temps où le Télamon d'Ennius faisait entendre sur la scène des sentences hardies sur l'indifférence des dieux, quand certains êtres naissaient dans une dégradation héréditaire, à côté d'autres involontairement privilégiés et libres, comment le sentiment de la fatalité n'eût-il pas été une croyance chez la plupart et, pour les plus malheureux, l'objet d'une science ou d'une industrie? Ne soyons donc pas surpris de voir Palinure répondre, en riant, au prostitueur qui le consulte " Tu vois en moi un devin unique, un inspiré! Les autres interprètes des songes viennent me consulter mes réponses sont pour eux des oracles." Chez Plaute, c'était la mention d'un usage et en même temps peut-être une épigramme détournée contre ces divinateurs de profession dont la scène s'est souvent moquée, ou contre ces songes pompeux de la tragédie qui ont été parodiés aussi dans le Fanfaron et le Marchand. Il y a une Atellane de Pomponius qui porte le nom d'Augur et une autre celui d'Aruspex. Nous savons que Dossennus faisait métier de tireur d'horoscopes, ou plutôt de philosophe, comme il disait dans son langage prétentieux, et qu'il ne rendait pas ses oracles gratuitement.. Avant cette époque, le poète Naevius avait choisi le moment de sa captivité pour écrire une comédie, intitulée Hariolus, où cette classe curieuse avait sa place, et Ennius protestait déjà dans ses vers expressifs contre le charlatanisme de ces savants de carrefours. II était donc permis aux esclaves de Plaute de les imiter ou d'en rire.
Ailleurs, le parasite, au retour de son voyage en Carie, en parlant de ceux qui peuvent faire obstacle à sa course empressée, cite parmi ceux qui obstruent les rues ces Grecs qui se promènent en longs manteaux, esclaves vagabonds, drapetae, qu'on rencontre partout, et ces valets des bouffons, servi scurrarum, qui jouent à la balle dans les carrefours. Je crois qu'il faut entendre ici, par scuraoe, les plaisants de profession qui avaient, comme beaucoup d'autres, un nombreux domestique, et qu'il ne s'agit pas, comme on l'a pensé, des habitants de la ville, en opposition avec les citoyens des tribus urbaines. Le chanteur Tigellius, cet homme si aimé des musiciennes, des mendiants, des charlatans des parasites des comédiens, n'était-il pas le plus somptueux et le plus frugal des maîtres, n'avait-il pas son service tantôt deux cents esclaves, tantôt dix ? C'est de ces maîtres destinés par état à amuser les autres que Plaute a décrit ici les esclaves. Ils étaient, ils devaient être aussi paresseux et aussi joueurs que leurs patrons. Mais cette fois, voici un esclave, de la famille de Chrysale, qui doit donner son nom à la pièce, et y figurer avec la plupart des attributs ordinaires aux serviteurs fripons. est chargé, dans la comédie de ce nom, de sauver deux fois les folies de son jeune maitre Stratippoclès et de lui procurer de l'argent. La donnée n'est pas neuve c'est un rôle de plus d'esclave attaché à un jeune amoureux; le génie du serviteur et de l'auteu- ne doit briller que par la variété des moyens et la différence des tours.
L'exposition de la pièce est faite par l'écuyer de Stratippoclès et Epidique, contrairement à ce qui se pratiquait pour les autres comédies, où le prologue nous annonce le sujet. Cet écuyer, armiger, nommé Thesprion, qui disparaît après cette première scène, était aussi un esclave, comme Epidique. Seulement l'armiger était un esclave du dehors, employé aux expéditions lointaines, comme Automédon, l'écuyer d'Achille ou comme ce Spendophorus, l'écuyer de Domitien, dont Martial vante les exploits amoureux (1).
(1) Martial. Epigr.II. 57. Cf. Virgil. Aeneid, ix. 647.
C'était ordinairement l'auxiliaire du guerrier plutôt que du citadin. Pline nous a dit à peu près quel prix on les achetait à l'origine. "Ainsi donc, dit-il des rossignols, on vend ces oiseaux le prix d'un esclave et même plus cher que ne coûtait jadis un écuyer; je sais qu'un rossignol blanc s'est vendu 6,000 sesterces (environ 1,500.francs) (1)."
(1) Plin. Hist. nat, x. 43.
Mais je doute que Stratippoclès ait acheté cet écuyer. S'il avait eu de l'argent il l'eût gardé pour ses maîtresses plutôt que pour ses esclaves. Thesprion est sans doute né dans la maison de son jeune maître, et ce n'est pas un bien grand guerrier que Stratippoclès. Les vérités qui échappent aux deux esclaves dans ce premier et piquant dialogue sont précieuses à recueillir. Epidique promet à l'écuyer qui arrive qu'on lui donnera le souper d'usage. C'était en effet une coutume consacrée, et, dans le Stichus, le parasite Gelasime lui-même invitera son patron à souper chez lui à l'occasion de son heureuse arrivée. Les deux camarades s'avouent tout haut
qu'ils volent. Thesprion vante à ce sujet sa main gauche celle qui, chez les anciens passait pour servir à dérober.. Cependant, au milieu des insultes qu'ils se prodiguent mutuellement, comme c'est l'usage entre valets fripons, Epidique n'oublie pas que la discrétion est le premier devoir d'un esclave.
Ce n'est pas la première fois que nous surprenons cette réserve chez les esclaves babillards de Plaute. Epidique, qui est en correspondance épistolaire avec son maître et qui l'a chargé de lui amener quelque esclave appétissante se laisse toucher de compassion en le voyant menacer .de se tuer si son valet ne lui trouve 40 mines. Évidemment la vérité dramatique a été outrée en cet endroit, pour amuser les spectateurs mais ici, comme ailleurs l'exagération même du vrai ne sert qu'à le mieux confirmer. Un maître qui se met ainsi à la merci d'un serviteur, et qui provoque sa sensibilité, ne pouvant rien obtenir de sa soumission cela n'est pas tout-à-fait nouveau pour nous l'Asinaire nous l'a déjà appris. Nous pouvons entrevoir déjà les progrès de l'ascendant que les esclaves prendront, leur indépendance hautaine. Leur tour ne peut manquer de venir : commerçants, ils feront un jour concurrence à leurs patrons; patrons parvenus, ils auront leurs maîtres pour courtisans ou pour égaux. Le temps où la République sera menacée d'être livrée aux serfs n'est pas loin et l'on verra plus tard les fils de patriciens servir de cortége à un esclave enrichi. Epidique, chargé d'extorquer 40 mines au vieux Périphane, se met en frais de ruses, et celle qu'il ourdit est assez ingénieuse. L'esclave aimée et ramenée par Stratippoclès sera rachetée par son vieux père pour que Stratippoclès ne l'affranchisse pas et n'aille pas l'épouser, comme le bruit en court. Epidique, en fin matois, quand il donne cet avis au vieillard, prend le ton radouci d'un esclavé timide " Si je pouvais me permettre d'avoir plus d'esprit que vous, j'ouvrirais un avis des meilleurs."
Et plus loin
" Ce n'est pas pour mon compte ici qu'on sème et qu'on moissonne Je ne désire que ta satisfaction,"
C'était tout à la fois habile et vrai l'esclave devait nécessairement, dans la constitution romaine, avoir moins d'esprit que son maître et ne travaillait que pour le compte d'autrui. Mais Epidique est ici plus fin que tous les autres, car il fait acheter à Péripliane deux joueuses de lyre au lieu d'une, lui soutire tout l'argent qu'il veut, en un mot, il se joue du vieillard au point de l'amener à dire" C'est bien toi d'avoir mouché le nez d'un vieux roupilleur d'un imbécile comme moi". Enfin il donne encore un curieux échantillon de sa fourberie audacieuse dans la scène dernière où il enjoint au vieux père de le garrotter et de lui obéir. Un instant la peur d'un cruel châtiment lui avait inspiré la pensée de fuir et il. avait prié Stratippoclès de lui fournir l'équipeinent nécessaire à cet effe. Mais, quand il a découvert que la captive aimée par son jeune maître n'est autre qne la fille de la maison, celle à qui Epidique avait apporté autrefois un croissant d'or et un anneau d'or, pour l'anniversaire de sa naissance, et qui, par son retour, va combler de joie sa famille, il se décide à rester et à narguer ceux qu'il redoutait tout-à-1'heure. Il faut le reconnaître, Plaute a donné ici, comme ailleurs, une faiblesse, une bonhomie ridicule à la vieillesse qu'il n'aimait guère; il fallait toute la bénignité du rôle de Periphane pour faire accepter l'audace de celui d'Epidiqûe de même que dans les Fourberies de Scapin, où Molière s'est quelquefois souvenu d'Epidique, Scapin serait trop effronté si Géronte n'était si ridicule.
Messénion, l'esclave de l'un des Ménechmes, remplit dans cette pièce un personnage d'une importance différente. Ce n'est pas qu'il ne soit un esclave de distinction. On dirait au contraire ou qu'il est lettré, ou qu'il l'est devenu à la suite de ses nombreux voyages dans les pays qu'il a parcourues avec son maître. Il parle en riant, d'écrire l'histoire, pour justifier, à la manière des historiens antiques, ses longues pérégrinations. Mais un autre désir le sollicite davantage il veut retourner dans la terre natale et rentrer au logis commun, comme un. serviteur rangé et sédentaire. Son rôle offre au premier abord quelqu'analogie avec celui du pédagogue Lydus des Bacchis. C'est Messénion qui est chargé de garder la bourse de son maître et de pourvoir aux dépenses, c'est lui qui l'avertit des dangers qu'il court dans une ville nouvelle, lui enfin qui, en homme expérimenté, s'évertue à le tenir en éveil contre les manèges et l'astuce des courtisanes. Vain effort! comme Lydus, il est rappelé sans cesse par celui qu'il sermonne au souvenir de sa misère et de sa condition servile. Il n'est pas écouté et sa morale reçoit maint affront, comme toute morale qui vient de trop bas: Messénion le constate lui-même. "Mais tu es un impertinent, se dit-il de prétendre régler la conduite de ton maître. Il t'a acheté pour lui obéir et non pour lui commander."(1)
(1) Menechm. 352 168 et 946. Voir les fccucs 1 et 2 dn 2° acte.
Une fois rentré dans la vérité de sa situation il n'a plus d'autre règle qu'une conduite soumise, exemplaire. Dans un monologue remarquable parce qu'il exalte l'instinct de la conservation personnelle et fait du dévoûment un moyen intéressé plutôt qu'un devoir ou un attrait, Messénion nous donne le programme de beaucoup de bons serviteurs romains. Penser à son dos plutôt qu'à sa bouche comme il dit; être un instrument passif et docile, instrumentum vocale comme eût dit Varron craindre le châtiment si l'on s'enhardit, espérer l'affranchissement si l'on obéit morale de la misère et par conséquent de l'égoïsme,.morale bien digne des maîtres romains et la seule possible pour se mettre à l'abri 'de leurs rigueurs au sein des envahissements de l'épicurismc et de l'abâtardissement des classes inférieures! Que nous sommes loin déjà de l'Epidique ! Ce n'est pas Méssenion qui lèverait un front insolent contre celui qui lui commande s'il n'y avait que des Messénions parmi les esclaves, l'émancipation ne serait pas si prochaine, Tyndare, dans les Captifs, était une exception unique c'était l'idéal de l'esclave mais ce qui le rendait vraisemblable c'est qu'il servait un maître excellent. Messénion, c'est une exception aussi, mais plus commune parce qu'elle est en regard d'un patron indifférent. Il courbe trop sa tête pour la pouvoir relever jamais il s'accommode trop facilement de sa chaîne pour l'oser rompre un jour. Si Ménechme, son maître, ne la brise pas, Messénion la gardera paisiblement jusqu'à sa mort. Epidique au contraire, comme Liban, comme Stalagme et Léonidas c'est la vérité courante, c'est l'emblème de la servitude en général; c'est de là, c'est de leur ergastule qu'un jour sortira la liberté. Une fois cette théorie de Messénion acceptée on est moins touché de la vivacité qu'il met à empêcher l'enlèvement de Ménechme au cinquième acte. Il a beau crier on reconnaît dans ce défenseur l'homme qui" Je ne t'abandonnerai pas je te défendrai, je te secourrai fidèlemént, je ne souffrirai pas que tu périsses. Plutôt périr moi-même! je le dois" défend son propre dos et qui songe à son affranchissement.
En effet, à peine le service est-il rendu, Messénion demande sa libération. Il est puni tout d'abord de sa réclamation trop hâtive par son véritable maître qui n'est pas le Ménechme qu'a délivré l'esclave. Il devait y avoir là au moment de ce désappointement inattendu un rire général dans l'auditoire. On n'est pas fâché que le mécompte soit le prix d'une générositési égoïste. Mais sa bonne conduite devait finir par l'emporter, parce que ceux qui commandent récompensent la docilité de leurs subordonnés, sans s'inquiéter des motifs; la pièce finit par la reconnaissance des deux frères et par l'affranchissement de Messénion.
Rien de particulier dans les rôles serviles du Mercator. La belle Pasicompsa, la seule esclave intéressante de la pièce, n'y a qu'une scène elle n'y montre que de l'ingénuité et de l'amour. Charin, le fils de famille, a ramené d'un long voyage cette captive, qui lui est disputée par son père Démiphon au moyen d'un stratagème qui fait le fond de la comédie. Les amours de Charin l'emportent, grâce au zèle d'un ami et de l'esclave Acanthion qui lui est dévoué.
Là encore il y a des souvenirs de pédagogie dans le rôle de l'esclave. Acanthion avait commencé par être le gouverneur de son jeune maître et fini par être chargé de le garder et de l'accompagner(1). Une seule fois, dans tout le cours de la pièce Acanthion semble rappeler sa condition première lorsqu'il parle des maux et des biens de cette vie à son jeune maître qui lui répond qu'il n'entend rien à la philosophie. (2)
(1) Mercator. 89.
(2) Allusion maligne à ces philosophes grecs, à ces sophistes charlatans, nouveaux venus à Rome, que Plaute a bafoués souvent et que Térence estimait davantage.
Partout ailleurs il rentre dans la catégorie des esclaves dévoués à la jeunesse, et ses plaisanteries ressemblent à toutes les plaisanteries d'esclave. Il n'en est pas de même de la belle Pasicompsa. Le vieux Démiphon qui l'avue la trouve, dit-il, trop belle pour être, comme l'avait annoncé Acanthion, la suivante d'une matrone. Ce qu'il fallait à une servante c'était savoir tirer la navette, moudre, fendre du bois, filer sa toile balayer la maison, faire la cuisine pour tous et supporter les coups. Les servantes grecques d'Andromaque et de Pénélope les esclaves des tragédies d'Euripide n'avaient pas d'autre tâche. Est-ce à une esclave de cette sorte que Lucilius parlait d'appliquer mille coups de fouets en un jour? Je n'ose le croire.
Mais Titinius dans sa Gemina semble s'adresser à ses pareilles quand il leur prescrit de balayer la maison et d'enlever les toiles d'araignées. Selon Démiphon Pasicompsa est trop belle pour ces rudes fonctions dans la rue, lorsqu'elle accompagnera sa maîtresse, elle attirera les oeillades des passants, leurs tendres déclarations; le dur métier de servante ne convient qu'à quelque Syrienne grossière et laide qui ne peut compromettre personne. L'enchère qui termine la troisième scène de ce second acte est un tableau animé des luttes suscitées par la mise à l'encan des esclaves et en même temps un témoignage des atteintes que recevait l'autorité du pater familias quand il devenait le rival amoureux de son fils.
Nous savons par le Charançon que le prix moyen d'une esclave de cette sorte était de trente mines. Ici par galanterie pour Pasicompsa et par l'acharnement réciproque de Démiphon et de Charin, l'enchère s'élève jusqu'à trente-sept mines. Dans l'Epidique nous avons vu payer jusqu'à cinquante et soixante mines pour une belle esclave; mais c'est l'exception.
,La vieille Syra, la servante de Dorippe, est une de ces esclaves accoutumées à la grosse besogne du logis. Elle se plaint de ses fatigues et de son grand âge épuisé par la servitude. Mais elle n'en est pas moins restée fidèle à sa maîtresse. Elle s'émeut pour elle des infidélités de son vieux mari. Elle fait à ce sujet un retour sévère sur les rigueurs de la loi envers les femmes, sur la sujétion que leur ont imposée les maris " Qu'un mari entretienne secrètement une courtisane, si sa femme vient à l'apprendre, l'impunité lui est assurée. Qu'tune femme sorte de la maison, aille en ville.secrètement, le mari lui fait son procès, elle est répudiée."
Nous avons vu ailleurs jusqu'où pouvaient aller cette liberté du mari et sa sévérité envers sa femme. La condition subalterne des femmes a été l'objet de plaintes qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours. Dans le Mariage de Figaro on est frappé d'entendre Marceline s'écrier, au moment où elle reconnaît son fils "Hommes plus qu'ingrats, qui flétrissez par le mépris les jouets de vos passions, vos victimes, c'est vous qu'il faut punir des erreurs de notre jeunesse. Dans les rangs même les plus élevés les femmes n'obtiennent de vous qu'une considération dérisoire. Leurrées de respects apparents, dans une servitude réelle; traitées en mineures pour nos biens, punies en majeures pour nos fautes ah sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur ou pitié" (1)
(1) Le Mariage de Figaro,act. III, scèn. 16. Ce passage est supprimé dans quelques éditions.
Ici du moins la plainte directe état permise. C'était d'ailleurs de la condition des femmes en général, épouses ou filles, que Marceline, la mère non mariée de Figaro, parlait; elle remontait jusqu'au législateur lui-même pour lui reprocher sa rigueur et ses préférences la loi elle-même était mise en cause. C'est de la liberté telle qu'on la pratiquait au xviii" siècle. Après avoir violé la règle, on osait la discuter. II n'en était pas de même au vie siècle de Rome. La femme, à moins d'être dotée, accepte son infériorité. Dans une pièce d'Afranius, l'une d'elles dit hautement qu'elle se soumet à la loi qui ne lui permet qu'un seul mari.
Le moment de l'enfreindre ouvertement n'est pas venu encore. Syra, qui avait eu quelque droit de parler comme Marceline, mais pour réclamer contre sa servitude, l'honore au contraire, comme on voit, par son attachement pour sa maîtresse. Cette affection s'étend jusque sur le fils de la maison, qu'elle a nourri, et qu'elle veut éclairer sur les déportements apparents de son père. Son rôle se borne là il n'est qu'indiqué et n'offre rien de complet.
Palestrion, du Miles Gloriosus, a toutes les qualités des serviteurs d'amoureux. Il est tout entier voué à la fortune du jeune Pleuside et, quoiqu'il soit passé au service du Fanfaron, c'est Pleuside, son premier maître, qu'il aime et veut faire réussir. Il a cependant, comme tout le monde excepté l'amant, une fort mauvaise opinion de la maîtresse de son premier patron. " Elle est en fonds de mensonges, de flux serments, d'impostures, en fonds de ruses, de prestiges et de tromperies ". Il ne pense pas mieux des femmes en général. Qu'importe Pleuside l'aime, elle est au pouvoir du Fanfaron, Pleuside l'aura. Un camarade de Palestrion a malheureusement découvert un tête-à-tête entre les deux amants c'en est fait de leurs amours si le Fanfaron l'apprend. C'est ici que Palestrion
doit montrer son habileté, ici que son rôle commence véritablement. Peut-être sa jalousie contre son compagnon, qui a vu les amoureux, n'est-elle pas complètement étrangère à ses calculs. Il y a d'ordinaire, entre camarades de cette sorte, plus d'envie que de bon-vouloir. C'est là, pendant qu'il songe à quelque tour nouveau, qu'il est comparé par Plaute au poète Nsevius, captif comme lui. J'ait dit ailleurs combien cette comparaison me paraît blamable et combien l'écrivain s'était avili en prenant parti contre le poète. Mais, si l'on ne veut voir ici que la similitude de situations, il y avait en effet quelque analogie entre Palestrion, forcé d'inventer sous le regard d'un esclave malveillant et d'un maître exigeant, et l'écrivain qui, ayant deux gardiens à ses côtés, médite péniblement sur son
châtiment et sur deux comédies nouvelles. Cette scène où Périplectomène, l'hôte de Pleuside, a recours aux talents de Palestrion et l'oblige à trouver quelque expédient inattendu, est animée et pittoresque par les détails. Il y a une description des différentes attitudes de l'esclave en méditation qui a toute la vivacité du récit de l'esclave qui, dans les premières scènes du Rudens, décrit l'arrivée et le naufrage de deux jeunes filles. Il semble qu'on assiste à toutes les anxiétés de Palestrion, et qu'on doive partager avec lui les tourments de l'invention. Le tableau n'est pas moins vif quand Périplectomène excite l'inventeur et cherche par tous les moyens, par la peur des houssines, par l'imminence du péril, par l'attrait du renom, à provoquer, à échauffer, à aiguillonner son imagination. Palestrion, il faut bien le dire, a encore un autre motif de réussir par une combinaison nouvelle c'est son intérêt propre. Car il est l'esclave favori, Scéledrus son camarade en fait l'aveu dans un moment de jalousie. C'est Palestrion qu'on appelle le premier à la pitance; c'est lui qu'on donne les meilleurs morceaux. Il y a tout au plus trois ans qu'il est dans la maison et il n'y a pas de serviteur qui y ait un service plus doux (1).
(1) Peut-être Scéledrus parle-t-il avec l'exagération de la jalousie. Car, plus tard, Palestrion dira à son maitre que d'autres esclaves ont toujours joui de sa confiance plus que lui-même. Qui faut-il croire ici? Palestrion ne se rabaisse-t-il pas trop pour mieux faire valoir sa feinte reconnaissance? et Scéledrus n'est-il pas trop jaloux pour être complétement véridique ?
Est.il besoin d'ajouter que Pleuside, comme le Philocrate des Captifs, se montrera reconnaissant envers son esclave de prédilectio ? Toutes ses batteries sont habilement dressées contre Scéledrus, l'esclave trop clairvoyant qui se laisse tromper par le jeu d'une porte dérobée ou effrayer par les menaces de l'hôte de Pleuside et contre le Fanfaron, sot et ridicule personnage; qui se laisse enlever sa maîtresse dans l'espoir d'être l'amant heureux d'une femme mariée. Palestrion occupe toujours la scène et fait mouvoir tous ces fils, avec une activité sans égale. Il imagine de soudoyer une courtisane et sa suivante, afin de les faire passer pour la femme et l'esclave d'un homme libre et de captiver le Fanfaron jusqu'à ce qu'il se soit attiré les mécomptes de l'adultère. En outre, Palestrion fait déguiser son jeune maître en marin pour venir enlever celle qu'il aime au Fanfaron et dénouer la pièce par la satisfaction des deux amants et par la punition du ridicule. Mais ce, n'est pas là tout ce qu'il déguise. Ses ruses redoublées ne sont que la répétition variée de celles que d'autres esclaves nous ont déjà apprises. Elles n'en diffèrent que par le nombre et l'objet. Ce qui fait l'originalité du rôle de Palestrion, c'est qu'il feint avec complaisance les sentiments qu'il n'a pas et nous donne ainsi des mensonges intéressés de la servitude un échantillon que nous n'avions pas trouvé jusqu'ici. Écoutez-le, dans son ardeur de connaître ce qu'a vu et ce que dira le camarade dont il est jaloux, il compte beaucoup sur l'indiscrétion de celui-ci "Je sais par moi-même, ajoute-t-il, ce qui en est; est-ce que je peux me taire quand j'ai seul un secret?" et ailleurs s'il se trouve avec ce compagnon de servitude, il lui recommandera, en esclave discret, de ne pas tout dire.
Apprend-il qu'il a été fait don de sa personne à la maîtresse de Pleuside, il feint un vif chagrin de quitter le Fanfaron. Il pousse des sanglots, il verse des pleurs; il va, dans sa fausse douleur, jusqu'à exhorter les esclaves, ses camarades, à vivre en paix, en concorde et à ne plus médire, même de lui . Ce seraient une tendresse et une morale touchantes si nous n'étions édifiés sur le goût de Palestrion pour ses égaux; ce seraient des lamentations à fendre le coeur, si elles ne devaient plutôt faire éclater un fou rire. C'est par là que cet esclave diffère des autres. Plaute a changé ici de procédé.
Ce n'est plus par quelque vérité insolente, qu'il contredit la convention scénique et montre l'homme sous le masque; c'est par l'exagération même de cette convention poussée jusqu'à l'hyperbole, qu'il atteint au comique. Dans d'autres pièces, les vieillards, les sots étaient attaqués en face par des vérités cruelles et blessantes, par le cynisme du mépris. Ici le Fanfaron est combattu par des voies moins ouvertes. C'est en exaltant ses faiblesses que Palestrion ajoute à leur ridicule, c'est en paraissant leur céder qu'il les châtie. Son dévoûment pour Pleuside justifie tout.
Il est à peine besoin de mentionner le personnage de Scéledrus, son camarade. Celui-ci c'est l'esclave méchant et poltron tout ensemble. Il doit finir par la croix, il le sait; son père, son aïeul, son bisaïeul, son trisaïeul, ne sont pas morts autrement. Il a de qui tenir, et les vices n'ont rien qui l'effraye. C'est lui qui du haut de l'impluvium a épié, a vu dans la maison voisine la maîtresse du Fanfaron donner des baisers à un autre, c'est lui qui se plaint des préférences accordées à Palestrion, lui qui tremble quand Périplectomène menace, et qui,comme.Sosie et Scapin; se gorge de vin qu'il dérobe, avec d'autres, dans la cave dont il est malheureusement le cellérier. On le voit, Scéledrus ne vaut pas Palestrion, son confrère; il est placé à côté de lui pour le mieux faire valoir. Il n'a ni esprit ni dévouaient. Il a les défauts de Palestrion sans avoir ses qualités.
Le rôle du fermier dans les pièces latines offre une particularité curieuse. Le fermier est toujours du côté des intérêts du vieux maître, tandis que l'esclave de la ville urbanus, leur est le plus ordinairement hostile. Dans Casine, celui qui doit épouser la servante pour la livrer au vieux Stalinon, c'est Olympion, le fermier; celui qui rivalise avec lui en faveur du fils de famille, c'est Chalinus, l'esclave de la maison. Cette préférence du fermier s'explique par son intérêt celui qui le paie, qu'il connaît plus familièrement qu'il représente aux champs (1), c'est le Paterfamilias.
Le fermier ne doit soutenir que lui. Le prologue de Casine nous a dépeint avec vivacité les luttes et la haine qui divisaient le valet de ville et le campagnard. C'est qu'ils n'étaient pas choisis dans la même classe. Columelle, dans ses prescriptions agricoles, a bien soin de défendre qu'on choisisse le villicus parmi les serviteurs citadins. Ils sont trop joueurs, trop paresseux, trop ivrognes, trop amis du cirque et du Champ-de-Mars pour être de bons fermiers.
Caton avait bien soin de ne pas prendre pour les soins des champs des serfs délicats et efféminés, mais des hommes robustes et sobres. Il n'eût point choisi, comme Horace, un de ces esclaves du dernier rang, mediastini, sans emploi déterminé habitué aux plaisirs de la ville et dégoûté trop facilement des travaux champêtres.
Il ne faut donc pas s'étonner des épigrammes nombreuses que se renvoient tour-à-tour dans plusieurs comédies les métayers et les serviteurs de ville. Leurs intérêts et leurs situations différaient comme leurs moeurs.
La première scène de la Mostellaria met en présence le verna et le villicus et reproduit les récriminations et les animosités dont il s'agit. Ici le fermier n'est qu'un personnage protatique, c'est-'à-dire qu'il est destiné à ouvrir la pièce et à en faire l'exposition pour disparaître ensuite. Il nous apprend à combien de méfaits l'esclave Tranion a entraîné son jeune maître, et il se promet bien d'ouvrir les yeux au vieux Theuropide, son père.
" Passez, lui dit-il, passez les nuits et les jours à boire, menez la vie des Grecs, achetez des filles pour les affranchir, nourrissez des parasites, épuisez le marché par vos festins ."
Mais Tranion ne s'émeut pas pour si peu. Que lui font à lui ces reproches d'un mangeur d'ail, comme il appelle le villicus? Tranion n'est-il pas placé au haut bout de la table, n'est-il pas couvert de parfums, nourri des plus friands morceaux (1) de pigeons, de gibier, de poissons qu'il va acheter lui-même, comme font les maîtres.
(1) Mostell.41-47. Il semble que, dans ces détails de la vie servile, on parle plutôt du chef que du serviteur. C'est une des mille preuves de la familiarité des esclaves favoris avec leurs jeunes maîtres. Est-il diflicile, après cela, d'expliquer l'intérêt que les esclaves prenaient ordinairement à leurs patrons jeunes et amoureux?
Cependant cet air trop hautain change un moment quand, au. milieu des orgies et de l'insouciance, il voit arriver le vieux Theuropide, le père de notre jeune libertin c'est la donnée ordinaire de toutes les comédies. L'arrivée de la vieillesse, c'est-à-dire de la sévérité, met dans un émoi inattendu la jeunesse, c'est-à-dire les dissipateurs et leurs esclaves; comme si ce moment n'avait pas dû être prévu ,par les calculs de l'un ou de l'autre. Acanthion du Mercator, nous l'avons vu, ne fait pas autrement quand survient le père de Charin. Cette imprévoyance n'a. pour but que de donner plus de prix encore aux talents de l'esclave. On se préserve
mieux du péril qu'on attendait que de celui qui nous surprend; et l'esprit qui improvise le salut vaut mieux que celui qui le prépare. Tranion en est donc aux expédients pour sauver les apparences de la conduite de Philolachès aux yeux de Theuropide. Dans les premiers moments de son anxiété, il voudrait trouver à se faire remplacer au gibet par un de ces soldats romains qui courent à l'assaut pour trois as mais il se ravise et va faire face au danger avec un sang froid remarquable.
Cette présence d'esprit, ce talent d'invention qui le rendent maître de la place et subordonnent à l'esclave tous ceux qui l'entourent, il en est tout de suite fier, si fier même, qu'il prend en pitié les petites gens, les faibles auxquels il commande. Chrysale aussi, dans les Bacchis, s'était rengorgé à l'occasion de ses mérites. " Qu'on ne me parle pas, s'était-il écrié, des Parmenons, des Syrus, qui procurent à leurs maîtres deux ou trois mines! Rien de plus misérable qu'un esclave qui n'a point de cela, ajoutait-il, en se frappant le front il lui faut un esprit fertile qui fournisse à tout besoin des ressources, " prenant en pitié ses confrères au lieu de ses maîtres, et se targuant, comme ici, de la fécondité de son génie. On sait ce que Tranion invente pour tromper le vieillard. Regnard, dans le Retour Imprévu, a imité cette fable. Merlin imagine d'arrêter Géronte à sa porte en lui faisant peur des lutins. Tranion, le modèle de Merlin, fait croire au vieux Theuropide que la maison a été possédée par un propriétaire qui a tué son hôte. Celui-ci, n'ayant pas été enseveli, se plaint toutes les nuits, et épouvante les habitants c'est une maison maudite qu'il faut fuir.
Ce premier mensonge est suivi d'un autre. Quand l'usurier qui a fourni aux prodigalités de Philolachès vient; devant le vieillard, réclamer ses avances, Tranion lui fait croire qu'ils ont emprunté sur nantissement pour acheter une maison. Quand Theuropide a fini par réconnaître qu'il a été leurré et trompé, il se fàche tout d'abord; mais il ne tarde pâs à s'apaiser, comme la plupart des pères trop benins de Plaute. Cécilius, son contemporain, entendait par ce mot de sots vieillards de comédie les vieillards crédules, oublieux et inconséquents défauts, ajoute Cicéron, moins propres à la vieillesse qu'aux vieillards, dont la vie n'est plus qu'engourdissement
et sommeil.
C'est ce genre de vieillards qu'on retrouve le plus souvent chez Plaute, Theuropide est de leur famille. Il n'y a pas de trait particulier qui mérite d'être cité dans le rôle de Tranion. Epidique et Chrysale me paraissent supérieurs en ressources, et bien que cette idée de fantôme soit ingénieuse, et ait dû amuser, inquiéter, surprendre les spectateurs, elle n'est pas sans analogie avec cette soudaine invention de Tyndare dans les Captifs, lorsqu'il fait croire au bonhomme Hégion qu'Aristophonte, son dénonciateur, est frappé du ciel, qu'il est fou, et qu'il faut s'en préserver. Ce qui devait faire rire les auditeurs, c'était le cynisme et l'insolence que montrait l'esclave, à l'égard du vieillard, en lui faisant remarquer au plafond une peinture représentant une corneille qui se joue de deux buses, et en le ridiculisant pendant toute la première scène du cinquième acte.
Quelquefois, au milieu de toutes ces hardiesses, le sentiment de sa mauvaise conscience vient le tourmenter; mais ce n'est qu'un nuage, que l'effronterie et la ruse ont bientôt chassé. " Il n'y a rien de plus peureux qu'un homme dont la coinscience n'est pas plus tranquille que la mienne mais, quoiqu'il en soit, je n'en continuerai pas moins à tout brouiller (1). "
(1) Mostell.535-38.
D'autres détails nous parlent d'esclaves qu'un maître livrait au moment d'une enquête, et qui n'évitaient les tortures qu'en se réfugiant dans un temple ou vers un autel: asiles qui; dans tous les temps, ont protégé le malheur, et où Pausanias, l'homme libre, s'abrita en vain contre la mort, cormme Syrus, l'esclave de l' Héautontimerumenos contre la colère de Chrêmes. Voilà, avec le passage où il est dit que les esclaves fabriquaient aussi des monnaies de plomb, les seuls renseignements nouveaux que nous trouvons ici (1).
(1) MostelL 913. Nous avons déjà un renseignement analogue dans Casine, prolog. 10. Il n'y est question, il est vrai, que de monnaie nouvelle, fabriquée pendant les guerres puniques. Mais il est permis de supposer que ces monnaies nouvelles favorisaient la fraude des monnaies fausses, et que les esclaves en profitaient. Plus loin vers 15, il est question de monnaie de plomb, et de même dans le Trinum. 918. Dans les Grenouilles d'Aristophane, v. 718, le choeur compare les mauvais citoyens, les esclaves, à de méchantes pièces de cuivre, de mauvais aloi, frappées sous l'archonte Antigène, au v, siècle avant notre ère; et dans le Querolus, comédie imitée de Plaute, écrite au iv° siècle après J.-C., l'esclave Pantomalus, au milieu d'un long monologue sur les habitudes de la servitude, dira: "Quant aux pièces d'or, il y a mille moyens de les altérer. Nous les changeons et rechangeons c'est un usage qu'on ne peut changer. "
Fidèle, cette fois comme ailleurs, à la loi des contrastes, Plaute a eu soin de placer, à côté de Tranion qui brave les supplices, le personnage de l'esclave Phaniscus, qui se conduit bien par crainte des étrivières. C'est un caractère que nous avons déjà rencontré. Seulement, contrairement au Messénion des Ménechme, Phaniscus n'a qu'un rôle épisodique et ne paraît qu'à la un de cette pièce. Elle se termine par une leçon donnée la vieillesse, celle contre qui la comédie semble plus particulièrement dirigée: " Theuropidé Tout le reste est peu de chose en comparaison de l'effronterie avec laquelle Tranion s'est joué de moi.
Tranion C'est bien fait, par Hercule, et je m'applaudis de l'avoir fait. On doit être avisé à cet âge, avec une tête blanche." (1)
(1) Mostell.1120.
Le Stichus est. une comédie qui porte encore le nom d'un esclave. Cependant le rôle important de la pièce n'est pas pour lui. Les deux femmes, Panégyris et Pinacie, je l'ai dit ailleurs, qui attendent le retour de leurs maris plutôt que d'en prendre de nouveaux, sont les personnages principaux ici. L'auteur a peut-être voulu détourner, par ce titre, l'attention loin des deux femmes libres qu'il se proposait de peindre avec ce mélange de facéties bouffonnes qui sont le condiment habituel de sa morale; de même que dans l'orgie de la scène finale il semble avoir voulu noyer les pensées sérieuses des scènes précédentes. Au reste, nous verrons ailleurs, dans le Trinumus, par exemple, que Plaute emprunte quelquefois son titre au personnage ou à l'incident le plus futile de la pièce, pour mieux dissimule son but, ou piquer davantage la curiosité. Antiphon, le père de Panégyris et de Pinacie, se plaint de la négligence de ses serviteurs, qui ne nettoyent, ne rangent rien dans la maison, et ne sont exactes qu'à venir demander leur ration périodique. Cette ration, qu'ils recevaient le plus ordinairement en blé gâté, en orge, en lupins, était donnée, comme ici, à une époque fixe, aux calendes par exemple (1), et s'appelait demensum, ou chaque jour, et s'appelait diarium.
(1) Plin. Hist. natur. xviii, 10, 14, 36, sur les emplois divers du blé et des lupins. Horac. Sat.ii. 3. 182. Séneq. Epist. 80, dit qu'ils recevaient ordinairement cinq modii de blé par mois. Chez les Grecs, c'était au dernier jour de chaque mois.
Mais ce n'est pas de Stichus qu'Antiphon veut parler ici. Celui-ci ne paraît qu'au troisième acte, au retour de son jeune maître Epignome, qui a ramené plusieurs captives avec lui, joueuses de flûte et de lyre, qui seront données plus tard à son beau-père. La première demande de Stichus à Epignome, c'est de lui permettre de se livrer à la joie pendant tout un jour, et de fêter les Eleuthéries. Stichus a une maîtresse, c'est l'esclave du frère d'Epignome; il en partage la possession avec son camarade de servitude, Sagarinus. C'est avec elle et avec lui qu'il va se livrer à une orgie sur la scène.
"Ne vous étonnez pas, dit-il aux spectateurs, de ce que de pauvres esclaves s'amusent à boire, font l'amour et s'invitent à souper."
C'était chose inusitée que tout cet attirail des voluptés de la servitude étalées sur le théâtre, et il fallait les justifier auprès du spectateur. Cette possession à deux de la même esclave était en usage chez les maîtres eux-mêmes. Agyrippe de l'Asinaire cède son amie pendant un jour à son père, et nous trouverons, dans l'Eunuqu de Térence, Thaïs partagée définitivement entre Phedria son amant, et Thrason son soupirant. Stichus demande pardon aux spectateurs de faire comme les maîtres; patrons et serviteurs se permettaient ce genre de débauches; mais le théâtre ne rendait publiques que celles des maîtres. Singulier privilège!
C'est aussi à l'imitation de leurs maîtres qu'ils inaugurent le festin d'esclave qui termine la comédie. Ils se distribuent les rôles de caenae pater ou strategus convivii et de servant; ils boivent dans les vases Samiens, les plus grossiers de tous, le vin que le maître a donné à Stichus ils dansent avec leur commune maîtresse ils amusent l'auditoire en offrant à boire au joueur de flûte, ils se placent non pas sur des sièges à la manière des cyniques, mais sur des lits à la façon des chefs de la maison, et ils entonnent de gaies chansons à boire.
Je n'ai point parlé de Dinacion, petit esclave aux ordres des filles d'Antiphon, et curieux par son babil et son attachement pour celles qu'il sert c'est un verna sans doute employé, comme Pegnion du Persan, à des travaux accessoires. On en rencontrait beaucoup dans les maisons romaines, et on leur apprenait, en les élevant, à être moqueurs, hardis et insolents. Suétone en nous racontant les premières années d'Auguste, dit que, quand il voulait donner quelque relâche à son esprit, il jouait avec de petits esclaves, dont la figure et le babil lui plaisaient, et qu'on lui cherchait de tous côtés c'étaient surtout des Maures et des Syriens.. Dinacion appartenait sans doute à cette classe. Toxile, l'esclave de la pièce du Persan, a quelque analogie avec Stichus il termine comme lui par une orgie. Il vise à imiter son maître; il a un valet, un pa.rasite, une amante il ne lui manque, pour être maître son tour, que d'être né libre. Seulement, ce qui était dans la précédente pièce une débauche inutile à la fin, devient ici un dénoûment presque nécessaire, et l'amour, qui était l'accessoire de Stichus, forme l'élément principal du Persan. Mais des
amours d'esclave cela était-il vu jamais, au théâtre du moins? Sagaristion, l'esclave ami de Toxile, fait l'objection, et son camarade y répond comme il peut. Les maîtres sont en voyage, et les libertés de la servitude, si elles se donnent ici plus de carrière que dans le Stichus, se justifient mieux par cette absence. C'est la fable des souris et du chat. Toxile aime une esclave comme lui, qui est au pouvoir de Dordalus le prostitueur. Il pousse celu-ici à acheter, en échange de sa captive, la fille, du parasite Satnrion qu'il fait passer pour une étrangère. Une fois Dordalus mystifié, et Toxile en possession de celle qu'il aime, la pièce se termine par les fêtes joyeuses qu'il donne à sa maîtresse, et par les désappointements du prostitueur. Pour arriver à arracher à Dordalus la belle Lemnisélène qu'il possède, l'argent a été nécessaire. Chose remarquable! les esclaves, du moins ceux-ci, trouvaient à emprunter mais ce ne devait être qu'à un autre esclave de leur espèce. Sagaristion, qui s'est mis en quête d'argent/détourne une somme ronde que son maître vient de lui confier pour acheter des boeufs elle servira tout à la fois à affranchir les
amours de Toxile et à jouer un bon tour à a ces vieux ladres de maîtres, avides et livides, qui tiennent le sel sous le scellé dans la salière, de peur qu'un esclave n'y touche (1),
(1) C'était ordinairement avec un anneau qu'on scellait.
Le temps des serviteurs réservés et des maîtres confiants était déjà bien loin, et ceux-ci pourront bientôt répondre, pour leur justification, par ces vérités dont nous
avons montré la preuve partout
"Maintenant on est obligé de sceller les aliments et la boisson pour les soustraire aux rapines domestiques. C'est à quoi nous ont réduits ces légions de serviteurs, cette foule d'étrangers qui peuplent nos maisons, et nous forcent d'employer un nomenclateur, même pour nos esclaves. Il en était autrement chez les vieux Romains. Un Marcipor et un Lucipor, compatriotes de leurs maîtres, mangeaient à leurs tables, avaient tous les. vivres à leur disposition et le père de famille' n'avait pas .besoin de se garder contre ses domestiques." (1).
(1) Plin. Hist. nat. xxxiii. 6. Tout ce chapitre de Pline est curieux par le contraste du luxe de son temps avec les moeurs d'autrefois. Il y est surtout fait mention de l'usane des anneaux.
Une fois que Toxile a recouvré le prix de la rançon de Lemnisélène et qu'ainsi il a affranchi son amante sans dépenser rien il reprend plus que jamais cette importance de maître, si habituelle aux valets quand leurs patrons sont absents. Il régale ses bons compagnons de servitude. Il fait dresser des lits devant le logis et y fait placer tous ceux qui l'ont servi. Lui-même y prend place à côté de sa Lemnisélène qui est nommée la reine du festin. Tous tes coups, toutes les insultes sont pour Dordalus, le prostitueur mystifié; les injures pieuvent sur lui de toutes parts. Un seul personnage cependant essaie de ne pas prendre part à cette distribution
de mauvais traitements. Lemnisélène se souvient qu'elle a appartenu à Dordalus, et n'ose le frapper; mais Toxile lui rappelle que c'est lui, Toxile, qui l'a affranchie, et qu'elle lui doit tout, même l'obéissance. Il faut donc qu'elle insulte son ancien maître comme le font les autres. Les réflexions de Toxile sur ce goût d'indépendance que veulent prendre les affranchis suffiraient pour nous montrer dans quel asservissement restaient encore ceux qui croyaient avoir échappé à toute servitude par l'affranchissement (1).
(1) Voir dans le Poenulus, 380 les menaces méprisantes faites par Agorastoclès à des affranchis appelés en témoignage. Comparer avec la réponse hardie des affranchis du Poenulus le curieux dialogue d'un affranchi avec un chevalier romain, dans Pétrone, Satyric, c. 57.
Les amantes d'esclaves sont par leur rang, au-dessus des prostituées. C'est ce que Stichus disait déjà en embrassant sa Stéphanie. Toxile de même déclare que Lemnisélène serait devenue une prostituée de Dordalus si elle n'avait été délivrée par son ami l'esclave. Une dernière analogie peut faire rapprocher cette pièce du Stichus. C'est le rôle de Pegnion le petit esclave. Lui aussi,comme Dinacion et plus que lui, se distingue par ses malices et ses réparties: Plus que personne, il accable à la fin de la pièce, le pauvre Dordalus de railleries, de horions et de mépris. C'est lui aussi, qui tout entier aux ordres de Toxile, verse le vin au milieu du repas joyeux, lorsque d'autres esclaves ont lavé les mains aux convives, et que Toxile a couronné de fleurs la reine du festin. Tout son rôle peut se résumer par
cette pensée qu'il exprime " Dans ma carrière, dit-il, c'est la hardiesse qui fait le succès" Les hardiesses de toutes sortes sont le fond de cette comédie Un prostitueur battu en plein théâtre, une fille de condition libre se déguisant pour servir les intérêts d'un esclave, un parasite aux ordres d'un valet une orgie d'esclaves sur la scène tout cela est plein de toutes les hardiesses. Il en est une cependant que Plaute n'a point osée, parce qu'il aurait dépassé les bornes d'une licence vraisemblable, c'était de mettre au nombre des convives de Toxile l'homme libre qui l'avait servi, le parasite Saturion.
L'esclave dans l'amphithéâtre, c'est-à-dire en un lieu où il ne devait pas être, figure un instant dans le prologue du Poenulus, " Arrivent les esclaves qui envahissent les gradins! qu'ils laissent la place aux hommes libres ou qu'ils paient pour devenir citoyens" (1).
(1) Poenulus, prolog. 23.
On ne dit pas plus brutalement à des intrus de quitter la place. Nous savons par là que les esclaves se permettaient, à cette époque déjà, d'envahir, contre leur droit, les places des hommes libres au théâtre. Dans la comédie grecque, les esclaves de la scène, jetaient aux spectateurs des noix de leurs corbeilles pour allécher leur appétit en même temps que leur gaîté. Xanthias dans les Guêpesd'Aristophane, Trygée dans la Paix, et Plutus dans la pièce de ce nom blâment ou mentionnent cette coutume des poètes comiques de la Grèce mais il n'y a qu'à Rome que les esclaves se montrent aussi envahissants, non plus sur la scène, mais dans l'amphithéâtre.
Au VII° siècle nous en avons un frappant témoignage dans le discours sur la Réponse des aruspices que Cicéron opposa aux menées de Clodius: "une troupe innombrable d'esclaves ramassés dans toutes les rues, déchaînés à un signal donné, se précipita tout-à-coup dans le théâtre par toutes les voûtes et toutes les portes". C'était aux fêtes de Cybèle. Nulle Romain n'avait osé y assister, à cause des excès et de la multitude des esclaves. Pendant la
représentation,quelques-uns, les pedisequi, ceux que nous appellerions aujourd'hui valets de pied, couraient au cabaret et se gorgeaient de tartes et de vin. Ce n'est pas contre ceux-ci que Plaute, dans son prologue prémunit les maîtres; ce n'est pas eux sans doute que Clodius avait lancés au théâtre pendant la célébration des fêtes Mégalésiennes.
Milphion, l'esclave de Poenulus, s'est chargé là, comme dans les autres pièces que nous,avons parcourues, de faire triompher les amours du jeune Agorastoclès.
Ce n'est pas cette fois l'argent qui manque pour gagner le prostitueur, maître de la belle convoitée, c'est l'esprit nécessaire pour la lui enlever et, avec elle, sa rançon. L'esclave propose un moyen judiciaire, une querelle de citoyen à recéleur, qu'on soulèvera entre l'amoureux et le prostitueur qui garde son amie. Le fermier Collybiscus ira chercher, sous le costume d'un étranger, une femme et du plaisir dans le repaire du prostitueur. Des témoins achetés d'avance par Agorastoclès l'y amèneront. Plus tard Agorastoclès viendra réclamer le fermier son esclave et l'or que le prostitueur en aura reçu. Celui-ci niera qu'il ait l'un ou l'autre en ses mains les témoins attesteront le contraire et, la loi condamnant à l'amende du double le receleur d'un esclave et de son or, le prostitueur sera obligé de livrer toute sa maison pour libérer sa dette. On le voit, c'est sur une chicane juridique que repose l'originalité de cette intrigue que Plaute a cherché à relever par l'étrangeté du costume, du langage et des esclaves carthaginois, introduits dans la pièce.
Malgré cet ornement accessoire le Poenulus n'est pas moins une ébauche où l'auteur n'a rien suivi et complété, pas même son plan primitif de contestation judiciaire, car il ne tarde pas à substituer à la revendication d'un esclave et de son or, celle de la liberté pour les deux captives qui sont au pouvoir du prostitueur. Celui-ci les livre à la fin sans combat, sans même chercher à reconnaître la sincérité du parent qui les réclame, et la pièce se termine par deux dénoûments différents, comme pour attester que l'auteur ou ses successeurs n'étaient pas satisfaits de la conclusion de cette fable. Le génie de Milphion n'a pas l'occasion de s'exercer
largement, puisque c'est l'arrivée inattendue du Carthaginois Hannon qui sert à dénouer la pièce sans le secours de l'esclave. Il se rejettera sur dss saillies sans valeur, sur quelques réponses équivoques ou insolentes pour justifier son rôle de rusé serviteur et, comme tous les esclaves, il rougirait de donner à son maître des préceptes d'amour platonique. La beauté pudique n'a pas d'attrait pour lui à l'imitation de ses égaux, il ne croit qu'au vice chez les femmes. Il le prouve bien par ce
ton langoureusement railleur dont il aborde la belle Adelphasie lui prodiguant d'abord avec une tendre ironie les noms les plus doux, ensuite, insultant la jeune captive, celle qui était restée pure dans sa misère, qui n'était pas encore allée chiezl 'édile pour y changer son nom ingénu contre un nom de courtisane, et qui s'énorgueillissait de sa noblesse. Enfin, la nourrice Gidennemé ne se montre qu'un instant et la suivante d'Adelphasie nous apprend que les servantes ne recevaien
quelquefois du maître qu'un salut de rebut. Syncérastus, de son côté, l'esclave du prostitueur; ne sert qu'a dénoncer avec mépris tous les vices de
l'engeance des lenones et l'enlèvement des filles du Carthaginois. Le fermier Collybiscus n'apparaît qu'un instant et ne remplit qu'un rôle d'utilité fort secondaire. Je ne trouve à remarquer que quelques détails sur les amours des esclaves qui choisissaient "des prostituées de la rue des bonnes amies des gardes moulins, sentant la boue et le chenil, des filles à deux oboles" (1).
(1) Poenul.134.
Ces deux oboles même, les esclaves des prostitueurs n'avaient pas toujours à les payer car Syncérastus, grâce à sa place, trouvait des amies gratuites. Ce serviteur, trahissant le marchand de courtisanes, son maître, en faveur de la jeunesse de la beauté, du malheur, des bonnes moeurs, nous avait donné l'idée d'un esclave de prostitueur, digne dans le mal et trompeur par honnêteté. Dans le Pseudolus, Ballion, le leno de la pièce, veut nous donner de ses esclaves une opinion différente. Il les maltraite les accable des noms les plus méprisables et justifie presque par ses brutalités ce que disait tout-à-1'heure Syncérastus de cette classe ignoble des prostitueurs. Le monologue par lequel Ballion débute est curieux pour nous il détaille les attributions de chacun des serviteurs du leno. L'un est chargé de porter l'eau, l'autre de fendre le bois celui-ci doit approprier la maison celui-là a l'intendance de la salle à manger, de l'argenterie. L'esclave marmiton préparera, pour
l'anniversaire de la naissance de son, maître, un jambon, une tétine, un filet. Un autre plus jeune, portera devant son maître sa bourse bien garnie. C'est toute une administration sans compter les ordres multipliés donnés aux courtisanes qui doivent rapporter de si gros bénéfices au maître. Ces marques de domination et de rapacité ne lui concilient point, on le pense l'affection de ses serviteurs. Au troisième acte, l'un d'entre eux vient, comme Syncérastus, se plaindre de sa dure
condition chez un pareil homme, à qui, par surcroit d'infortune, tous ses esclaves sont obligés de faire un présent au jour de sa fête. On le voit, c'est le personnage du prostitueur qui est le plus important de la pièce du Pseudolus. C'est celui dans lequel excellait l'acteur Roscius. L'esclave qui donne son nom à cette comédie y a
un rôle secondaire et ne se distingue en rien de tous les valets qui ont pour mission de trouver de l'argent pour leurs maîtres amoureux. Et cependant, selon Cicéron, c'était là une des pièces dont Plaute s'enorgueillissaitle plus. A quels mérites doit-elle cette prédilection du maître? A l'enjouement toujours facétieux de Pseudolus, plutôt qu'à son habileté, puisque c'est le hasard, l'arrivée d'Harpax qui le tirent d'embarras; à l'importance et aux mécomptes du prostitueur, personnage méprisé tout ensemble et recherché des Romains, et aux mystificateurs qui remplissent cette pièce d'un bout à l'autre, depuis le cuisinier qui déploie une insolence et une rapacité sans égales jusqu'à, l'esclave Singe qui se montre encore plus madré que le joyeux Pseudolus. Quelques bonnes pensées viennent cependant çà et là jeter un jour moins douteux sur ce rôle de serviteur et expliquer les préférences du poète. Contre l'ordinaire des esclaves de son espèce, Pseudolus s'irrite de la proposition faite à Calidore de voler son père (1) ailleurs; il dit en riant qu'il ne veut pas donner le mauvais exemple d'un esclave dénonçant son jeune patron à son vieux maître et, dans toute la scène qui ouvre la pièce, à travers vingt badinages destinés à égayer le petit peuple gourmand de pois chiches et de gros mots, on reconnaît un esclave vivement ému des inquiétudes du jeune Calidore et décidé à le délivrer à tout prix.
(1) Ces sentiments de respect paternel auquel Calidore s'associe sont rares chez les amoureux de Plaute et chez leurs dignes valets.Philolachès, Mostellar. 233, voudrait qu'on lui annonçât la mort de son père. Strabax, Trucul. 613, demande la ruine de son père et de sa mère pour enrichir sa maitresse. Voir Aristoph. Oiseaux, 1335-40, ce qu'il dit des écoles où l'on apprenait à battre et à étrangler son père pour en hériter plus vite
Il ne tarde pas à, le prouver par cette prière qu'il adresse au misérable Ballion et où lui, le pauvre esclave, se porte garant de son maître " Rends-toi à nos prières, Ballion. Je suis son garant, si tu as peur de l'avoir pour débiteur. Avant trois jours, je tirerai n'importe d'où, de la terre ou de la mer, l'argent qu'il te faut." Il y a donc quelques traits du caractère de Pseudolus qui sont en rapport avec ces maximes d'affection servile que l'esclave Harpax développera tout-à-1'heure. Messénion des Ménechmes, Phaniscus de la Mostcllaria sont de même souche que cet Harpax, esclave pédant qui psalmodie de belles sentences sur les devoirs de sa classe et qui, dans sa fidélité rigide, songe plus à sa peau qu'à son maître. Harpax, s'il eût été au service de Tartufe, aurait comme Laurent serré religieusement la haire et la discipline de son maître, sans sourciller jamais, sans y faire le moindre pli. Pseudolus au contraire, comme le Crispin du Legataire, mêle
tous les tons, gronde son vieux maître au besoin, pour sauver le plus jeune, et, à certains instants, montre plus de coeur, au milieu de ses folies et malgré ses écarts sans nombre, que ces serviteurs qui ne mettent le dévoûment que dans leurs sentences et érigent la fidélité en une étroite arithmétique.
Ces folies de Pseudolus ressemblent quelque peu à celles des esclaves de l'Asinaire comme la.ruse par laquelle il se fait passer pour l'homme d'affaires de Ballion est imitée de celle où Léonidas simule le personnage de l'intendant Saurea (1). La familiarité de Liban et de son collègue avec leur maître, leurs orgies faites en commun justifiaient leur audace. Ici aussi Pseudolus partage avec Calidore jusqu'à sa table et ses maîtresses (2).
(1) Voir toute la scène IV, act.II de l'Asinaire
(2) Psceud. 1248.-Cf. 928, les régals de toutes sortes qu'il promet à un confrère pour prix de ses fructueuses fourberies. Tout le monologue, scèn. 1, act. v, est rempli de détails curieux sur le cynisme des moeurs, les folies des maîtres et des valets, et fait réfléchir au goût singulier de l'auditoire pour ces sortes de tableaux.
Il est donc facile de reconnaître ce masque d'esclave, et d'en expliquer les traits divers mais il manque d'originalité pour nous.
Un autre, personnage, plus original peut-être devait égayer cette comédie. C'est le cuisinier, rôle épisodique ici mais curieux par ses indiscrétions. Dans la vie débauchée des Romains, au milieu de ces scènes licencieuses qui plaisaient à la foule parce qu'elle s'y reconnaissait dans chaque personnage, dans chaque passion, la gourmandise, je l'ai dit ailleurs, devait figurer à côté de tous les autres excès du sensualisme. Le cuisinier avait donc sa place marquée sur le théâtre de Plaute. Ici le luxe n'a point encore atteint tous les cuisiniers la plupart d'entre eux ne sont pas achetés à des prix fabuleux et ne font pas partie encore d'une maison de maître, y envahissant la place de toutes les autres classes subalternes, comme Pline s'en plaindra plus tard.
Les citoyens dans Plaute vont retenir leurs cuisiniers au marché, pauvres esclaves qui ne trouvaient souvent à louer leurs services qu'à vil prix (1), et qui se rejetaient sur le vol pour augmenter leurs ressources.
(1) Il en était de même aux premiers temps de Rome, dit Pline, Hist, nat. xviii. 28.
Ce sont les moeurs primitives, c'est la misère ou l'économie des maîtres qui mettent une distance entre eux et l'esclave de la cuisine. Le maître y gagne sans doute en bonne santé et surtout en revenus sa maison dépense moins, et sa sobriété le fait vivre plus longtemps. Mais l'esclave cuisinier abandonné sur le marché comme une denrée, y perd en bien-être, en talent, en éducation quelque peu morale, parce que le manque de bien être avilit le coeur et abrutit l'esprit, et je ne serai pas tenté de me plaindre comme Pline, le jour ou le cuisinier fera partie de la maison de ceux dont il délecte l'estomac, et sera acheté à des prix exorbitants comme un objet
inestimable. Oui, les citoyens y perdrontleur santé, leurs biens, leur opulence, le goût de la vie peut être, comme cet Apicius qui s'empoisonna de douleur parcequ'il ne lui restait plus que dix millions de sesterces pour satisfaire son appétit de gastronome; mais le plus malheureux des deux, l'esclave cuisinier y gagnera, il aura un gîte et la fortune et c'est du plus misérable que je suis préoccupé.
Dans l'Aululaire, Congrion et Anthrax, les deux cuisiniers de louage, trouvent le moyen de médire de l'avarice d'Euclion qui les a engagés, parce que leur goût de rapine est contrarié dans cette maison par la parcimoniedu maître. La déesse qu'ils implorent le plus ordinairement, c'est Laverna, la protectrice des voleurs, elle que le malheureux Anthrax prie sans,doute tout bas de lui faire trouver de la besogne plus fréquemment qu'aux seuls jours de marché car un cuisinier nondinaire, comme il s'appelle, est un pauve cuisinier. Ailleurs, dans le Charançon, le cocus se mêle de divination avec l'esclave Palinure. Celui du Mercator, personnage épisodique comme les autres, ne reçoit comme eux qu'une drachme de salaire et se félicite, mais en vain, de manger avec ses aides le dîner qu'il va préparer, parce que, dit-il, c'est un festin d'amoureux et que les amoureux se repaissent plus ordinairement de baisers, de propos, et de doux regards.
Mais aucun d'eux n'est plus spirituellement impudent que le cuisinier du Pseudolus. C'est un cuisinier de distinction, s'il faut l'écouter. Il se fait payer un didrachme au lieu d'une drachme. Il a des recettes merveilleuses pour ses préparations on vit deux cents ans quand on mange de ses plats. Les noms de ses ingrédients sont extraordinaires, inconnus il vante leurs qualités et les siennes avec autant de forfanterie qu'en met sans doute Ballion, qui l'écoute, à faire valoir ses courtisanes et ses
propres mérites. Mais le prostitueur ne se laisse guère séduire à ce beau programme. Il charge un esclave de surveiller tous les mouvements, les gestes, les regards du cuisinier et se croit trop heureux d'avoir échappé à ses griffes par la perte d'un cyathe et d'une coupe.
J'ai dit plus haut qu'une classe à peu près pareille, les pêcheurs, avaient avec beaucoup d'autres artisans, tels que les foulons, par exemple, tenu une grande place dans le répertoire perdu de la comédie latine. Le Rudens nous offre à cet égard, dans une scène épisodique, un coin curieux de cette vie de misère et d'insouciance qui caractérise le théâtre des Atellanes où figuraient le plus ordinairement, nous le savons, ces classes infimes et laborieuses. Vignerons, pêcheurs, charpentiers, tous les métiers avaient là, leur expression dramatique et leur public d'artisans. C'est pour ceux-ci sans doute, auxquels Plaute tenait à plaire comme à tous les autres, qu'il a glissé dans sa comédie du Rudens, comme un tableau ou un souvenir de la vérité, cet intermède où apparaît une troupe de pêcheurs. Leurs hameçons, leurs lignes sont toute leur existence, c'est la mer qui leur donne à manger.
" S'il n'arrive pas bonne chance et si nous n'avons pas pris de poisson, nous revenons, salés et baignés, purs et nets à la maison, et nous nous couchons sans souper". A côté de ces hommes du peuple, pauvres mais libres et, pour compléter, on le dirait, le tableau de cette vie des pêcheurs, l'auteur a mis un esclave
pêcheur attaché à la maison du vieux Demonès, le père de cette comédie. Gripus, c'est le nom de l'esclave est l'instrument du dénoûment il trouve une valise ou sont contenus les objets qui doivent faire reconnaître Demonès la fille qu'il a perdue et rendre à celle ci Pleusidippe qu'elle aime. Ici les caractères de cette classe ressortent avec une vérité frappante. Le pêcheur se lève et travaille bravement il n'attend pas que le maître vienne dire debout à l'ouvrage! Il est rapace et défiant
il sait se défendre avec finesse et lutter de sophismes avec ses camarades d'esclavage. Son esprit de chicane aiguisé par la crainte de perdre sa capture, finit par le rendre tracassier et menteur.
Cette fois les deux parties, Gripus et Trachalion, avaient accepté un arbitre pour vider le différend. Ce juge, c'est Demonès, le maître du pêcheur. Mais celui-ci, sur le point de perdre sa cause, change d'avis et de tactique et, quand Demonès a annoncé que son esclave remettrait les objets qui appartiennent à la jeune Palestra, il ose riposter:
"Non, par Hercule je ne veux rien lui donner". Toutes ces scènes de luttes et d'arguties, évidemment destinées à parodier les plaidoiries du Forum, mettent en évidence, à côté de la duplicité du serviteur, l'autorité finalement respectée du patron. Demonès qui est resté pauvre parce que, dit Gripus, il a trop de scrupules et de délicatesse, s'était vu un instant bravé dans sa loyauté de maître parce qu'il réclamait, en cette qualité, un talent promis à son esclave. Gripus, que la misère rend avide, acharné, et qui dispute en désespéré la proie qu'il voit lui échapper, reproche à son patron de ne prendre les intérêts de son serviteur que par une feinte indigne et de ne songer après tout qu'à lui-même. "Tue-moi, ajoute-t-il avec une audace où éclate toute sa basse cupidité, tue-moi si tu veux, par Hercule; mais je ne me tairai pas, ci moins d'un talent pour ma soumission." Les autres personnages serviles, Trachalion l'esclave de Palestra, et Sceparnion l'esclave de Demonès, n'offrent aucune particularité nouvelle. Le premier, à part quelques bouffonneries qui déparent son caractère n'est remarquable que par le
dévouement persévérant et actif qu'il témoigne pour sa maîtresse (1).
(1) Voir les passages principaux de son rôle qui peuvent servir à le faire distinguer, Rudens, 277. 318. 523. 535-614. 750. 1082.
Stasime, l'esclave de Lesbonicus, dans le Trinumus, me semble un des esclaves les plus intéressants de tout ce théâtre. Flavius, dans le Timon d'Athènes de Shakspeare offrirait quelque analogie avec lui, s'il n'était trop sérieux dans son attachement et s'il mêlait quelques traits de la gaîté d'un serviteur à la gravité un peu septentrionale d'un intendant moraliste. Le Caleb de Walter Scott, plein de bonne humeur au milieu des ruines de la fortune de sir Edgard de Rawensvood, Caleb dévoué par l'action, enjoué par les paroles, avare de sentences, mais non de saillies, déployant toute sa finesse d'intendant à dissimuler aux autres la misère qui règne dans sa maison, et toute son affection à garder la distance qui le sépare de son maître, ou à cacher même à sir Edgard l'abîme qu'il côtoie, Caleb est bien plus
près de ressembler à Stasime. Ce qui les distingue c'est la différence des époques, c'est que Stasime, met quelquefois la morale à la suite de ses joyeusetés, tandis que Caleb ne la montre que dans sa conduite. Stasime n'ose pas dire tout haut dès l'abord à son maître, qui ne se croit pas encore ruiné, à quel degré de misère il est descendu. C'est à part qu'il gémit. Flavius dit aussi de Timon
"Quelle sera la fin de tout ceci? Il nous ordonne de faire des provisions, de rendre de riches présents, et tout cela avec un coffre vide, et il ne veut pas sonder la bourse ni m'accorder un moment pour lui démontrer à quelle indigence est réduit son coeur qui n'a plus les moyens d'effectuer ses voeux. Ses promesses excèdent si prodigieusement sa fortune, que tout ce qu'il promet est une dette nouvelle qu'il contracte chaque parole lui donne un créancier de plus il est assez bon pour payer encore les iutérêts. Ses terres sont toutes couchées sur leurs livres. Oh que je voudrais bien être plus doucement congédié de mon office avant que la nécessité me force à le quitter. Plus heureux 'l'homme qui n'a point d'amis que l'homme entouré d'amis plus funestes que les ennemis mêmes! Le coeur me saigne de douleur pour mon maître (1)."
(1) Timon d'Athènes, de Shakspeare, act. i, scèn. 2.
Cependant les allusions directes de l'esclave ne tardent pas à ouvrir les yeux du maître. Lesbonicus, qui s'oublie sans cesse pour autrui, force Stasime à lui dire " Tu as pitié des autres tu n'as ni pitié ni honte pour toi-même". Et quand le serviteur fidèle voit que la dernière terre de Lesbonicus va lui échapper, il imagine, comme Tyndare des Captifs quand il veut se préserver des révélations d'Aristophonte, ou comme Tranion de la Mostellaria quand il cherche à soustraire les débauches d'un fils aux regards de son père, il invente un stratagème, il fait croire à celui qui doit posséder cette terre qu'elle est maudite des Dieux et frappée d'anathème. On dirait entendre Caleb faisant le récit menteur d'un incendie qui dévore le château de son maître au moment où une societé choisie et nombreuse y attend un festin que le pauvre intendant ne peut lui octroyer. Mais Caleb garde, jusque dans la coulisse, la distinction d'un valet de bonne maison, la noblesse d'âme d'un bon Écossais. Stasime, au contraire, se ressent quelquefois de la grossièreté de l'ergastule, et son gosier s'humecte bien souvent aux dépens de sa raison, en compagnie de quelques misérables esclaves, tous décorés de meurtrissures aux yeux et aux jambes, frotteurs d'entraves, essayeurs d'étrivières. C'est par là le dirai-je? que son personnage est naturel et intéressant. Son affection pour son maître y gagrre en vérité et ces détails, qui nous rappellent la servilité du rôle, l'empêchant
de sortir de ses limites et de s'agrandir au-delà du possible corrigent en même temps l'invraisemblance des maximes un peu trop fréquentes qu'on y rencontre. Maîtres et valets., quand la fortune leur était définitivement contraire, s'enrolaient alors déjà comme cela arriva plus tard. Dans le Marchand, Charin, au désespoir de n'avoir pu garder en sa possession celle qu'il aime, part pour un long voyage et, en le voyant substituer la chlamyde au pallium, on est tenté de croire qu'il va prendre du service en pays étranger. Stasime prévoit le même sort pour son maître. Pour lui-même, il pense faire une fin pareille, il va courir le monde portant bouclier et bagage, servir quelque soldat, tenir l'arc et le carquois au bras, le casque en tête,devenir enfin comes, calo , lixa ou cacula.
Mais le sort, ou plutôt l'auteur recompense mieux son zèle. Lesbonicus est tiré de la misère son fidèle esclave finira ses jours auprès de lui. Parmi ces hommes des champs qui venaient aux jours de fête se mêler, nous dit Horace, aux citadins pour prendre part à tous les plaisirs de la ville, il y en avait sans doute plus d'un qui,retenu dans les rêts de quelqu'une de ces courtisanes plus nombreuses à Rome que les mouches au plus fort de l'été, restait à la ville au-delà des fêtes qui l'y
avaient amené et finissait par y perdre son argent et ses moeurs. Tel est le portrait que Plaute a voulu dépeindre dans la personne de Strabax du Truculentus. Son esclave qui a donné son nom la pièce parce qu'il traite les gens avec une brutalité rustique, Stratilax, n'a que deux scènes. Son rôle n'est donc qu'a peine esquissé; il offre deux contrastes marqués, mais il manque de nuances. Dans la première, scène, Astaphie, la servante d'une courtisane, vient l'entretenir il l'accueille avec une brutalité qui rappelle ce vers d'une Atellane.
" Moi dit-il en des vers dont le désordre ou la grossièreté étudiés sentent bien leur campagnard, moi, te toucher! que mon sarcloir m'abandonne si je n'aimerais pas mieux m'atteler avec un boeuf à longues cornes et coucher la nuit durant, à ses côtés, sur la litière, que d'obtenir cent de tes nuits, même précédées de soupers. Tu me reproches ma vie rustique; tu as trouvé ton homme, ma foi pour lui faire honte avec cette injure Qu'as-tu à demander chez nous, femme? pourquoi viens-tu te jeter à notre tête toutes les fois que nous venons en ville? "
C'est une sorte de villicus, un paysan qui parle, mais un paysan qui en même temps surveille les moeurs du jeune homme qu'il accompagne à la ville. Ce n'est point un pédadogue, mais une espèce de gardien, comme l'Acanthion dé Charin dans le Mercator.
Seulement Acanthion est devenu l'aide le familier de son maître, et Stratilax n'est qu'un espion, bourru. Dans sa deuxième scène chose frappante Stratilax est tout-à-fait converti. Ce n'est plus le rustre de tout-à-l'heure. " J'ai tout-à-fait les nouvelles façons je me suis défait des anciennes (1) " et, en effet, à la manière des fils de famille, des plaisants et des débauchés de la ville, il fait le dame-ret auprès d'Astaphie il prend le beau parler au lieu du parler campagnard, il emploie dans ses expressions cette corruption élégante des mots, qui en emporte coquettement la moitié et qui est de meilleur ton que la prononciation minutieusement correcte
des ignorants.
(1) Faut-il admettre l'opinion qui s'appuie d'un passage de Donat pour supposer qu'il manque des scènes intermédiaires qui devaient compléter le caractère de Stratilax ?
Cette transformation de manières et de langage ce contraste de la ville et des champs pouvaient faire sourire un instant la foule mais cette apparence de caractère ne devait pas intéresser longuement parce qu'il n'y a là ni développement ni gradations. Un autre spectacle aurait dû frapper davantage les galeries ce sont les aveux de deux esclaves qui viennent d'être mises à la torture. Aucune autre comédie de Plaute ne nous avait offert cette situation de la vie servile et nous savons que les tourments de l'esclave n'étaient pas chose importante, intéressante pour le poète. C'est donc plutôt pour les aveux qui les suivent que pour les tortures elles-mêmes que Plaute met en scène, cette fois, la coiffeuse d'une courtisane et une autre esclave.
Pour nous, au contraire, ce qui nous importe c'est l'accessoire, le spectacle de deux femmes qui viennent d'être mises au gibet dans la coulisse et qui portent encore sur la scène les liens, la trace et l'émotion de leurs douleurs. Dans les Grenouilles d'Aristophane, Xantias demande qu'on inflige à Bacchus toutes les tortures employées ordinairement contre les esclaves.
"Attache-le sur le chevalet pends-le; donne-lui les étrivières écorche-le; torture-le; verse-lui du vinaigre dans les narines charge-le de briques; emploie tous les moyens excepté de le fouetter avec des poireaux et de l'ail nouveau" Cette exception dernière, qui exclut le châtiment plus doux ordinairement appliqué aux enfants, est une preuve nouvelle de la minutieuse rigueur déployée contre les esclaves et de la crainte, passée en usage, de se montrer trop indulgent pour eux.
Dans le Truculentus, la peine est moins cruelle, il est vrai parce que les aveux ont été prompts et complets, mais les esclaves sont menacées du chevalet et des hommes qui font craquer les os, si elles ne répètent pas leurs déclarations au public. C'est toujours ici on le voit, une atténuation de la vérité, qui, laissant à la comédie tout son enjouement, n'y vient point inquiéter la gaîté des spectateurs et a été choisie par Plaute, non pas comme une plaie sociale à découvrir, mais seulement comme une variété nouvelle de ses nombreux et intéressants personnages serviles (1).
(1) Je n'ai pas parlé de Geta, l'esclave, qui ne paraît qu'un instant. Ce n'est encore ici qu'une ébauche qu'il est regrettable de ne pas voir s'achever. Geta, 516, sqq., est un esclave à la façon de Pasquin, du Dissipnteur de Destouches. L'un et l'autre, voyant leurs maîtres dévorer tout leur bien, ont fait comme ce chien "Qui portait à son cou le diner de son maître, Et trouvant d'autres chiens qui voulaient s'en repaître, Quand il crut ne pouvoir se sauver du hasard, Leur livra le dîner pour en avoir sa part."
Dissipateur, act. i. se. 1.
Je n'ai rien à dire non plus du caractère de la coiffeuse Syra, esclave d'une courtisane, demeurant vis-à-vis sa maison, exerçant dans une boutique le métier de coitïeuse au profit de sa maîtresse. C'est cette esclave qui est mise à la potence et forcée d'avouer une partie de sa conduite. Voir de même dans les Macci de Novius, Munk, p. 172, un esclave qui a vendu en Sardaigne du fromage pour son naître. Voir Trinum. 222, sqq., la liste de toutes les femmes esclaves attachées au service ou à la toilette d'une courtisane en renom.
Il est temps de résumer nos observations sur les esclaves de Plaute. Malgré la conformité d'un grand nombre d'entre eux, j'ai voulu mettre toutes les pièces du procès sous les yeux autant parce que chacune d'elles diffèrait par quelques points curieux ou originaux que pour préparer plus sûrement le jugement de l'ensemble. Il me semble que les serviteurs du grand comique ont à peu près tous un rapport commun c'est qu'ils sont au théàtre pour sauvegarder les passions de leurs jeunes maîtres et, ne doivent avoir d'esprit que pour faire triompher leurs amours. C'est là, si je puis dire, la nécessité littéraire du personnage de l'esclave. Mais qu'on suppose que la jeunesse romaine, au temps de Plaute,. fatiguée de l'amour, lui eût préféré la bonne chère, studiosa culinae, comme Horace le remarquait plus tard l'intervention de l'esclave eût elle été aussi active, eût-elle fait briller de si vives étincelles d'esprit et amené de si piquantes intrigues, eût-elle eu la même importance sur la scène de Plaute? Rien ne le fait penser c'est l'amour des enfants, en lutte avec l'autorité du père et la parcimonie du chef de la maison qui a donné tant de
valeur dramatique aux masques serviles. Voilà leur point de conformité presque partout. Si l'on veut en étudier les différences, on pourra ramener à trois classes principales les esclaves des vingt comédies qui nous restent de Plaute 1° Les esclaves obligeants par position ou par une sorte de confraternité avec leurs patrons 2° les indifférents ou les haineux; 3° les dévoués avec ou sans pédantisme. Sous ces trois chefs divers le poète a réuni, nous l'avons vu mille variétés de détails, d'esprit,
d'épisodes et de traits remarquables, et, malgré leur étiquette grecque, les a montrés vraiment romains.
Les considérations qui se rattachent à chacun d'eux ont été développées ailleurs. Ce qu'il y a de plus curieux dans l'étude attentive de ces personnages, c'est la persistance que met Plaute à préconiser par leur bouche, ou à inculquer par leurs exemples, le goût des vieilles moeurs de Rome, l'antique brutalité du langage,
l'abandon cynique, l'audace et la bassesse au sein même du dévouement, la résistance à tous les envahissements de la civilisation grecque ou orientale. Tout ce qui se ressent de l'élégance raffinée de son et de manières qui veulent tout usurper, il le repousse par les mépris de ses esclaves. Non pas qu'il ne donne à ceux-ci une sorte d'urbanité qui se pique d'avoir aussi ses grâces et son orgueil, comme celle de Tranion dans la Mostelluria. Mais cette civilisation n'est que relative dans Plaute, elle n'y fait jamais contraste qu'avec la grossièreté des esclaves de campagne. Tranion se parfume et se pavane, mais c'est pour mieux différer du fermier Grùmion. Stratilax du Truculentus est transformé dans sa dernière scène, mais c'est pour marquer plus profondement la différence qui sépare l'homme des
champs du citadin. Tout-à-l'heure c'était un bourru assez honnête désormais ce sera un mauvais sujet plus civilisé. Hors de là, tous les esclaves de Plaute sont plus près de la nature que de la politesse, et l'on n'est point étonné qu'on lui ait attribué longtemps le Querolus, cette pièce du iv° siècle dont le théâtre du grand comique a été bien certainement le modèle. Le rôle de l'esclave y suffirait à lui seul pour confirmer ce que nous avons dit de tous ses pareils que Plaute à dépeints. Il faut avoir connu Chrysale, Epidique Pseudolus et tant d'autres avoir parlé leur langue et rongé leur frein, il faut avoir passé à travers toute cette corruption croissante pendant six siècles et s'être imprégné de tous ses miasmes nuisibles, il faut avoir été vingt fois le maître des vices, des passions, que dis–je ? de la vie de ses propres maîtres pour arriver, comme Pantomalus, l'esclave de Querolus à ce degré d'avilissement tout ensemble et de dédain qui fait que l'esclave finit par regarder ses crimes comme des droits et se venge de ses humiliations du jour par les plus honteuses libertés de la nuit. Assurément ce ne sont pas les esclaves de Térence qui auraient fini ainsi. Varron, dans une de ses Satyres où il a représenté ,un cuisinier se perçant le coeur, comme Vatel, d'un couteau de cuisine, paraît aussi étonné de voir des esclaves en armes contre leurs maîtres. Térence, qui ne vit pas les guerres d'esclaves, eût été bien plus surpris encore si on lui avait parlé de révoltes armées des serviteurs contre leurs maîtres. Le goût choisi et policé du commensal des Scipions, cette aristocratie de famille au sein de laquelle il vivait et qui, depuis que des philosophes grecs étaient venus à Rome, s'augmentait encore d'une aristocratie nouvelle, l'aristocratie des intelligences, tout tendrait dès l'abord à rendre plus profond l'abime qui séparait l'homme libre de l'esclave tout jusqu'au caractère froid et réservé du talent de Térence, conspirait à repousser, dans ses comédies, le personnage de l'esclave au second plan. Mais en même temps qu'il lui donnait une action moindre, Térence devait le relever de son abaissement intellectuel.
Outre qu'il était lui-même un modèle et une preuve brillante de la réhabilitation de l'esclave, l'auteur avait besoin de mettre le caractère servile au niveau des caractères d'élite qui l'entouraient et du ton généralement moral qu'il mettait dans ses fables.
L' Andrienne s'ouvre par une sorte d'exposition des théories pacifiques de l'auteur. Simon le père du jeune Pamphile, choisit pour confident Sosie, esclave qu'il a affranchi pour ses bons et loyaux services. Sosie à la discrétion et la fidélité que son maître loue en lui joint une politesse, que les affranchis du Carthaginois étaient bien loin de connaître
" Je suis heureux d'avoir fait et de faire encore quelque chose qui vous soit agréable, Simon; et puisque vous êtes satisfait de mes services, je n'en demande pas davantage. Mais vos paroles me chagrinent. Me rappeler ainsi des bienfaits, c'est presque me reprocher d'en avoir perdu la mémoire".
Susceptibilité délicate qui n'a rien de commun avec cette rébellion du pauvre contre: la richesse que Plaute prête ses plébéiens, émancipés d'hier.
Le langage de Sosie ici, Plaute l'eût prêté peut-être à son Périplectomène du Fanfaron, le seul homme de bon ton, la seule personnification du monde nouveau que Plaute a essayée. Là même il manque encore cette fine fleur de Ménandre, cette urbanité athénienne, ce rien de trop, nihil nimis, qui sont le cachet de Térence et la devise même de l'affranchi Sosie.
Sosie, dans sa familiarité soumise, n'a pas oublié que, malgré son affranchissement, il reste encore à la merci du patron qui le traite si bénévolement (1).
(1) In memoria habeo, avait-il répondu lorsque Simon lui avait rappelé qu'il l'avait affranch. L'affranchi n'était pas hors de la puissance de celui qui était resté
son patron. Voir Tacite, Ann. xiii. 26.
Cela peut expliquer sa doctrine, un peu sentencieuse Obsequium amicos, veritas odium parit, mais cela n'ôte rien à l'invraisemblance de ce personnage. Sosie était presque inutile ici, car après cette première scène, il ne reparaît plus dans la pièce. Il n'a fait que servir de confident au vieux Simon et n'a aidé qu'à préparer une exposition assez heureuse. Le serviteur le plus important del'Andrienne, c'est Dave, l'esclave du fils de la maison, celui qui, " mettra tout en oeuvre, dit Simon, pour le chagriner bien plus que pour obliger Pamphile, son fils (1)."
(1) Andr. 162.
Je doute cependant que Simon ait bien apprécié Dave. L'esclave de Pamphile, quand il se consulte pour tirer celui-ci d'embarras, est partagé entre la crainte des dangers qu'il va faire courir à son jeune maître et celle de déplaire à Simon, son père. Au moment où il trace un plan de conduite à l'amoureux éperdu, celui-ci s'écrie qu'il souffrira tout plutôt que d'épouser la femme qu'on lui destine, et Dave de s'écrier à son tour " C'est votre père, Phamphile." Belle exclamation! respect filial, soumission de l'esclave, sentiment soudain du devoir, influence de l'autorité paternelle, ce mot contient tout, il rachète la mauvaise opinion que Simon
voulait nous donner tout-à-l'lieure du coeurde l'esclave. Mala mens, malus animus, avait dit de lui le père de Pamphile, dans un de ces moments de dépit ou l'on n'est jamais juste, et la suite va nous montrer que le coeur de l'esclave vaut mieux que sa tête. Pamphile, d'après son conseil, doit paraître prêt à accepter la main de Philumène qu'on lui offrait, bien qu'il aime en secret Glycère l'étrangère, et qu'il soit père de l'enfant qu'elle va mettre au monde. Dave, en conseillant cette conduite
à son jeune maître, veut sauver la dignité 'paternelle et la déférence filiale. Il sait que le père de Philumène instruit des amours secretes de l'homme qu'il destinait à sa fille, ne songe plus à la lui donner, et que Simon ne parle encore de ce mariage à son fils que pour éprouver ses sentiments fable ingénieuse, il est vrai, qui croisera les circonstances et l'intrigue de façon à faire naître de piquants contrastes et à serrer adroitement le noeud. Mais, la base de cette invention est-elle bien solide? un mot, un seul mot du père ou de son fils ne peut-il la renverser? Simon n'a donc pas le droit de parler à Pamphile de sa liaison avec l'aimable Glycère ? Il louvoie autour de ce fils qui lui doit et lui témoigne toutes sortes de respects, il prend des précautions oratoires, des faux-fuyants,un masque enfin comme si les rôles étaient changés et que l'autorité fût passée du côté de Pamphile. Et notre amoureux qui était décidé à tout supporter plutôt que d'épouser Pbilumène que n'allait-il au lieu
de se laisser duper et de croire qu'elle lui était toujours destinée, que n'allait-il, dans l'excès de son désespoir, auprès du père de celle-ci, confier à sa discrétion sa passion pour une autre, sa prochaine paternité, est fortifier dans ses hésitations ou son refus le vieillard déjà scandalisé des amours du fils de Simon ? Nous n'avions pas vu encore jusqu'ici ces détours d'un père qui veut gouverner et épargner tout à la fois la conduite de son fils, ce respect pour des relations de jeunesse, et cette morale dont la singularité et le mérite reposent dans la réserve et la convenance. Les pères de Plaute prennent moins de ménagements ils vont.droit au but, ils frappent sans hésitation à la porte de la maison où retentit l'orgie, .ils connaissent celles qui entretiennent un commerce d'amour avec leurs fils, ils partagent avec ceux-ci, comme Déménéte de l'Asinaire, les servent ouvertement comme Philton du Trinumus, ou les ramènent du toit de leur amie au logis, comme un Scipion
l'avait fait autrefois pour son fils .
Quoi qu'il en soit, c'est sur cette discrétion de Simon que spécule l'habileté de Dave. Il sait qu'une réponse respectueuse de Pamphile suffira pour lui faire gagner du temps, et que jamais Simon ne s'ouvrira franchement, hardiment de ses griefs à son fils. La politesse, élément nouveau, épargnera tout, les rencontres, les récriminations, la vivacité de la lutte, et cette prudente retenue soutiendra un instant l'intrigue. Mais Dave a mal compté. Le père de Philumène, sur les instances de Simon son ami, a consenti de nouveau au mariage, et les cris de la maternité de Glycère, qu'on entend sur la scène, ne paraissent qu'une supercherie de l'amante pour empêcher le mariage de son cher Pamphile. De la sorte, ce qui était tout-à-l'heure une réponse sans conséquences probables du. fils de famille devient un assentiment, un engagement qui lie le maître de Dave et renverse les combinaisons de l'esclave.
Tout s'arrange cependant le hasard, plus habile cette fois que les ruses de Dave, fait découvrir au père de Philumène l'enfant de Glycère, le fruit des amours de Pamphile. Le mariage renoué est rompu définitivement. Glycère, reconnue libre de naissance, sera unie à celui qu'elle aime.
Il faut bien le reconnaître, Térence n'a point donné un profond génie à l'esclave de l'Andrienne. Ses inventions sont puériles, ses ressources d'esprit mesquines et le hasard, ou l'auteur, est obligé d'intervenir pour le tirer d'embarras. C'est là, à mes yeux, un trait de naturel, le seul peut-être de tout ce personnage. Le serviteur ne devait pas toujours être armé d'esprit et sûr de succès bien que, par sa situation, il fût le plus souvent exercé à tous les manèges de la perfidie et habile à toutes sortes d'escrimes hardies, inattendues, victorieuses, il était plus naturel de le faire échouer ou faiblir quelquefois et de donner aux événements plus de force qu'à
lui. Sous ce rapport Térence a été vraisemblable. Mais il ne nous a pas fait pénétrer, comme Plaute, dans un de ces caractères à part, mêlés d'insouciance et d'audace, narquois et bons, arrogants dans leur bassesse ou méprisants pour leurs maîtres, types singuliers ou charmants qui se distinguaient si complètement de la société environnante. Dave trace honnêtement à son maître leurs devoirs réciproques.
L'esclave doit tout à son chef, son esprit, ses efforts, ses talents celui-ci lui doit en retour de se montrer indulgent ou sinon de le renvoyer. C'est de la morale puérile, qu'on ne s'attendait pas à trouver là. et qu'ailleurs encore Dave pratique en chargeant un autre de mentir à sa place, pour ne point faire un parjure si son maître lui demande un serment," Afin que pour nier, en cas de quelque enquête, J'eusse d'un faux-fuyant la faveur toute prête, Par où ma conscience eût pleine sûreté A faire des serments contre la vérité" (1).
(1) C'est un conseil que Tartufe avait donné à Orgon au sujet.d'une précieuse cassette. Tartufe, act., v., sc. 1., 17.
morale de:la pusillanimité, qui donne tout aux apparences, et qui m'intéresse moins qu'une robuste effronterie. C'est l'esclave abstrait et sans relief, ce n'est point
l'esclave idéal des Captifs de Plaute. Pamphile, dans l'Andrienne, un instant troublé de l'insuccès des conseils de Dave, s'était irrité, et repenti d'avoir mis sa fortune à la merci d'un vil esclave, servus futilis. Plus tard, dans sa joie d'avoir enfin réussi, il s'écriait que personne n'en serait plus heureux que son cher Dave. Dans l' Eunuque, Chéréa poussait plus loin l'attachement pour son esclave, il allait jusqu'à lui porter en cachette toutes sortes de provisions dans sa loge. Parmenon, l'esclave important de la comédie, méritait bien cette faveur. Ses conseils sont d'un homme expérimenté qui a étudié le coeur humain, celui de la
jeunesse surtout, qui en sait les retours et les contradictions. Parmenon personnifie ici l'esclave moraliste. Ses conseils et ses prévisions à l'égard de Phedria, son maître amoureux, sont d'une gravité qu'on n'eût attendue que d'un vieillard. Mais je m'étonne qu'il garde moins de mesure avec Chéréa, le fougueux amant de la belle esclave qu'on vient de donner à Thaïs, l'amoureux Romain dont la passion impétueuse avait besoin d'un frein plus fort. Parmenon en le voyant venir, se dit
"Bon voici l'autre à présent qui parle aussi d'amour, je crois 0 malheureux père si celui-là s'en mêle, tu pourrais bien dire que ce n'était qu'un jeu avec l'autre, au prix des scènes que cet enragé nous donnera"
On s'imagine que le prudent moraliste de tout-à-l'heure, l'ami de ses jeunes maîtres, va continuer son rôle et calmer ce sang trop bouillant par quelque
topique salutaire. Nullement. C'est Parmenon qui d'un ton badin propose à Chéréa de l'inttoduire sous des vêtements d'eunuque auprès de son amante comme si l'esclave expérimenté ignorait qu'on ne joue point avec de pareilles plaisanteries devant un amant éperdu et qu'il n'y a qu'un pas pour celui-ci du possible au réel.
Cette contradiction dans la conduite de l'esclave n'est pas la seule ici. Parmenon se félicitera tout-à-l'heure d'avoir introduit son jeune maître dans une maison de courtisanes. Il fait leur portrait avec un art délicat qui rappelle, en les embellissant, les peintures analogues laissées par Plaute. Il fallait, dans l'intérêt de Chéréa, le familiariser avec cette gent corrompue et séduisante " c'est la sauvegarde d'un jeune homme de connaître tout cela". Mais cette description n'est-elle pas un hors-d'oeuvre ici, et ces intentions vertueuses de l'esclave ne sont-elles pas une contradiction nouvelle ? Dans l'origine Parmenon, après sa plaisanterie, avait reculé, il avait craint les châtiments pour lui et, l'infamie pour Chéréa. C'est celui-ci qui, pour l'encourager avait dit " Est-ce un mal de m'introduire chez des courtisanes, de rendre la pareille à des friponnes qui se moquent de nous de notre jeunesse, et qui nous font enrager de toutes les façons? Est-ce un. vilain tour de les jouer une fois comme elles nous jouent? Tout le monde trouvera que j'ai bien fait de me moquer d'elles."
Chéréa n'avait donc pas besoin de cette salutaire leçon dont s'enorgueillira Parmenon. Chëréa connaît parfaitement les turpitudes des prostituées, il n'a rien à apprendre de ce côté, et d'ailleurs ce n'est pas Parmenon qui définitivement l'y a poussé. L'esclave qui s'applaudit, comme, d'un trait d'e génie, d'avoir proposé à Chéréa une substitution de personnes et de costumes, ne brille pas davantage lorsqu'il écoute la rusée Pythias qui lui fait croire que son jeune maître vient d'être surpris en flagrant délit d'adultère près de celle qu'il croyait une esclave, et qu'on l'a garrotté pour lui infliger la punition usitée en pareille cas. Parmenon, qui devrait
savoir que l'esclave de ces courtisanes, dont il a retracé l'astuce, peut ne pas être sincère, se laisse prendre à ces faux-semblants, s'en va tout droit, dans sa terreur, dénoncer Chéréa à son vieux père et tombe, comme le plus simple des vieillards, dans un piége grossier.
En vérité, ce n'est pas là non plus un caractère tranché et conséquent d'esclave. Point de ces mots qui marquent au vif le personnage, rien qui ne puisse s'appliquer à tout autre qu'à un personnage servile. Ce n'est ni tout-à-fait un pédagogue, comme Lydus ni un fripon comme Chrysale c'est une utilité, comme tant d'autres, qui concourt à former le noeud et à le dénouer; figure ternie dans ce demi jour où Térence laisse la plupart de ses masques, en auteur qui préfère les teintes uniformes aux touches vives et les nuances de sentiment aux caractères. Que dire de Syrus de l'Héautontimorumenos que je n'aie déjà dit de ses deux autres confrères ? C'est toujours sa ruse qui doit sauver deux amants, et rien de plus. L'art de Térence ne cherche pas la variété: c'est encore par une substitution de personnes que 1'esclave signalera son génie. Syrus, dont le nom étranger nous a déjà frappés et qui fera souche d'esclaves choisis, et même de riches parvenus, parmi les gens de la bonne société Romaine (1), fera passer l'amie d'un de ses maîtres pour l'amie de l'autre, escroquera dix mines à l'un des deux pères, et aidera à terminer la pièce par une double union:
(1) Voir Horac. Sat. I. 6. 38. Avec les Damas, les Denys, anciens noms d'esclaves étrangers, ils briguaient les suffrages populaires et arrivaient aux honneurs, au détriment des honnêtes familles
Je n'ai pas à parler des autres caractères de la comédie pour montrer leur insignifiance. Qu'il me suffse de rappeler que là aussi je ne trouve rien qui désigne plus spécialement la livrée servile et que la couleur local fait défaut comme ailleurs (1).
(1) J'en excepte un seul passage, 983, où il répond à son maître qu'ils auront bon appétit s'ils ne meurent pas de faim.
Syrus est encore une sorte de pédagogue à part, surveillant complaisant, qui s'occupe plus de batteries à dresser que de coeurs à former. Il semble d'ailleurs que l'auteur justifie ses moyens par la moralité du but. Je remarque un trait de bonté â noter dans ce rôle. Quand il a servi les amours de Clinias l'ami de son maître Syrus trouve quelques mots dégards affectueux pour rappeler à Clinias qu'il faut désormais songer à Clitiphon. Cette précaution ces marques d'attachement
Térence les prête dans la même pièce à d'autres esclaves encore. Ménédème le père de Clinias, quand il a appris le départ de son fils rentre chez lui triste, abattu. Ses esclaves accourent le déchaussent d'autres se hâtent de dresser la table, de servir le dîner, chacun fait de son mieux pour adoucir la peine du veillard. Mais il ne veut plus de tous ces valets attentifs et inutiles, de ces femmes qui tissaient ses habits; il les met à l'encan, s'en défait, et ne garde que les esclaves de la campagne, ceux qui peuvent lui donner quelque revenu par leur travail. Il y a plus de vie et de mouvement dans les Adelphes. Ce n'est pas une comédie paisible, une stalaria,
comme l'avait dit le prologue de l'Hêautontimorumenos. Térence, dans les Adelphes a mis en regard de la vieille discipline romaine les adoucissements et les progrès de l'éducation nouvelle. Par une de ces transpositions qui lui sont familières, il a croisé et fait contraster entre eux ses principaux
personnages. Deméa, qui personnifie le passé, est
colère, sans pitié, brutal comme la vieille sévérité
romaine, il protège Ctésiphon son fils qui, à son
école, n'a gagné qu'une douceur hypocrite, qu'une
apparence de sagesse et de calme. Micion qui représente
le présent, est doux et conciliant. Comme
le Philinte du Misanthrope, il s'accommode des
imperfections de la jeunesse, des infirmités humaines
il protège Eschine caractère bouillant,
emporté dans ses passions, pétulant comme un jeune Romain d'autrefois, et bon tout ensemble comme
un élève de Térence et de Ménandre. Les désordres
d'Eschine donnent naturellement lieu à des
scènes plus vives que celles que nous avions vues
et sont destinés à contraster avec les moeurs environnantes.
Les esclaves devaient par suite y avoir
leur part d'action et de mouvement.
Plaute, à la fin du Persan, nous avait donné le
spectacle d'un prostitueur, battu, raillé, bafoué
assailli de coups et d'affronts en plein théâtre par
l'esclave Pegnion (1).
(1) Cette scène finale du Persan a été imitée par lui dans le Miles gtorioaus, dont le dernier tableau représente aussi l'esclave Carion frappant, menaçant bafouant le Fanfaron.
On dirait que Térence a voulu
renouveler la même scène au début du second acte
des Adelphes. Le prostitueur Sannion est battu là aussi; Eschine, aidé de l'esclave Parmenon et d'autres
lui enlève une jeune fille de naissance libre
et tous font pleuvoir sur lui une grèle de horions
dont les spectateurs de ce paisible théâtre devaient
être fort surpris. Une telle situation devait nécessairement
amener quelque coup de tête remarquable
de l'esclave en titre et lui donner l'occasion
de se faire valoir et remarquer.Mais Térence, là encore,
n'a pas osé, il n'a été qu'à moitié comique,
,il est resté un demi-Ménandre.
Syrus, le vieil esclave des deux frères qui les
avait portés dans ses bras, n'a montré de l'astuce
que dans la coulisse. Ce n'est qu'à la fin de la pièce
que Demée reconnaît qu'il a contribué à l'achat de la chanteuse et qu'il a donné des soins à cette affaire. Mais pendant tout le cours de la comédie,
à part deux scènes où il raille et éconduit Démée,
il ne montre ni invention, ni activité,.et ne nous
donne que quelques jolis vers sur sa gourmandise
d'esclave et sur le plaisir de festoyer. Son personnage
est à peine un peu plus important que celui
de Geta, l'esclave des femmes, qui est un composé
fort peu naturel de sentiments tendres et de sagesse
pédantesque.
La femme de Syrus, dans cette comédie où les instincts
affectueux sont abondamment développés
reçoit la liberté avec son mari, parce qu'elle a la
première présenté le sein à l'enfant d'Eschine, et
Micion pousse finalement la bonté jusqu'à prêter
de l'argent au nouvel affranchi, dont il demeure
le patron et dans la prospérité duquel il aura encore
sa part. C'est le cas de demander avec Micion "Qu'a-t-il fait pour ce!a !" L'Hecyre me paraît être la meilleure pièce de Térence parce que le sujet en est simple, intéressant
et ne se complique pas de ces transpositions de
personnages et d'intrigues qui sont une bien faible
ressource dramatique, parce qu'elles déplacent les
rapports naturels, nécessaires et égarent l'intérêt.
Mais je n'ai pas à y noter un caractère saillant d'esclave.
Parmenon, qui ouvre la comédie par une exposition
du sujet faite assez maladroitement à une
courtisane est un serviteur sans consistance. Ce
n'est pas un personnage. Tantôt il soutient Pamphile
par des paroles encourageantes et se montre
plein de coeur pour la famille de ses maîtres
tantôt il fait le moraliste et débite des sentences;
tantôt enfin il se laisse aller à tous les défauts de
l'ergastule ou s'en va courir par la ville comme
un petit valet sans importance. Il termine par
ces mots, qui définissent bien son intervention secondaire
et sa stérile activité dans toute cette fable: " En vérité, j'ai fait plus de bien aujourd'hui sans le savoir
que je n'en ai jamais fait de dessein prémédité".
On a dit que Geta du Phormion avait été imité par
Molière dans les Fourberies de Scapin. Il faut le reconnaître,
de tous les esclaves de Térence, Geta
est le plus vif, le plus alerte le plus esclave en un
mot. Mais qu'il est loin encore de la bonne humeur
et de l'esprit de Scapin . Dans la première partie du
Phormion, c'est le parasite qui a tiré d'rembarras
un des amoureux. Geta a laissé tout le mal se faire
et c'est le parasite Phormion qui a trouvé le remède.
L'esclave, qu'on avait chargé des fonctions de gouverneur
pendant l'absence des pères, de ses deux
jeunes maîtres, a laissé flotter les rênes au gré des
passions de ceux qu'il devait diriger, et n'a plus à
leur service que ce dévouement passif que Térence
a décrit partout. Il y a des traits assez heureux
de familiarité servile de Geta et de Dave dans les deux premières scènes de la pièce. Des esclaves qui
se prêtent de l'argent, qui se confient un secret
non sans avoir hésité d'abord les petits cadeaux
qu'ils doivent à leurs maîtres au jour de leur noce,
ceux qu'ils devront à l'anniversaire de leur naissance,
à la venue du premier-né; voilà bien les
réflexions ou les confidences des esclaves et sans
le soin extrême de l'auteur à châtier son style,
le langage serait presque en rapport avec les caractères.
Térencc a ingénieusement rappelé Plaute par
la terreur qu'il attribue à l'esclave au moment de
l'arrivée du vieillard redouté: c'est le même
effroi, mêlé de marques d'attachement pour son
jeune maître le même aplomb pour conjurer
l'orage et récapituler sans sourciller tous les supplices
qui attendent le serviteur coupable. Je
remarque seulement çà et là cette tendance aux
maximes proverbiales habituelles à l'auteur, qui
semblent annoncer déjà celles de Publius Syrus. Mais ce n'est qu'au début du quatrième acte que
Geta prend une part active à la fable. Dans cette
pièce à doubles compartiments comme les aime
Térence, où il y a deux pères, deux fils deux
amantes, deux entremetteurs, la première moitié
avait pour moteur Phormion la seconde marchera
sous l'action de Geta l'esclave. Tout-à-l'heure
il fallait servir Antiphon: le parasite a
trouvé pour lui la femme qu'il convoitait. Maintenant
c'est Phédria qu'il faut satisfaire l'esclave va
s'ingénier à lui faire gagner les trente mines dont
il a besoin pour acheter la chanteuse qu'il aime.
Le moyen sera facile, il ne prouve même ni beaucoup
d'invention ni beaucoup de suite chez celui
qui l'a imaginé. Geta réclame trente mines pour
faire casser le mariage du jeune Antiphon son maître,
que son père voit avec regret uni à une orpheline
sans fortune. Au fond, ces trente mines seront
le prix de la chanteuse convoitée en secret par Phédria,
le cousin l'ami d'Antiphon. Mais il y a là un
dilemme dont le maladroit inventeur ne peut guère
sortir. S'il fait casser ce mariage, que devient le bonheur d'Antiphon qui, par les mains du parasite,
avait si heureusement réussi à le contracter? Si les
trente mines sont refusées, que deviendront Phédria
et le génie de Geta? Heureusement le sort se charge
ici, comme précédemment, d'avoir l'esprit qui manque
à l'esclave. L'orpheline retrouve un père une
famille; personne ne veut plus voir casser le mariage
d'Antiphon, tandis que les trente mines sont
dépensées depuis longtemps à la plus grande satisfaction
de Phédria et de celle qu'il aime.
Voilà, avec l'idée qu'a eue Geta d'aller écouter
aux portes l'histoire secrète de l'orpheline, voilà
l'esprit et les exploits de l'esclave du Phormion. En
les étudiant de près, il est facile de reconnaître qu'ils
annoncent moins de talents et de ressources que
.de bonne volonté, plus de finesse dans le langage
que dans la conduite (1).
(1) Le Phormion nous donne encore une indication sur la vie des esclaves, qu'il est utile de remarquer. Geta, 292, répond que la loi défend à l'esclave de plaider. On est étonné que, pour ce passage, Donat ne trouve à citer qu'une phrase de Salluste, où il est dit que Hiempsal se cacha dans le réduit d'une esclave. Il vaut mieux comparer avec cette indication celle de Charançon, 628-30.
Dave, le camarade de Geta est roux c'est Geta
qui le dit, et le commentateur ajoute qu'il est
question de plusieurs esclaves roux dans les comédies,
sans autre indication. Essayons de donner quelques renseignements plus précis sur l'extérieur
scénique de l'esclave et de terminer par là notre
étude sur ce personnage.
II faut chercher, sur le théâtre même,et voir si d'autres signes
ne distinguaient pas cette classe particulière. Plaute
a fait plus d'une fois mention du manteau des
esclaves. Dans l'Epidïque Périphane promet à,
l'esclave des brodequins, une tunique, un manteau. Sagaristion du Persan, en voyant venir
son camarade Toxile, s'avance les coudes en l'air
et s'enveloppe fièrement de son petit manteau.
Pseudolus au milieu de l'ivresse d'une orgie s'effraie
d'avoir sali le sien, il se fait prêter,par Charin une chlamyde, un coutelas un chapeau de
voyage (1).
(1) Peut-être c'était là aussi le costume des esclaves qui s'équipaient pour la fuite, voir Epidiq. 589.
Les esclaves se prêtaient quelquefois leurs vêtements, si toutefois c'est de l'un d'eux qu'il est parlé dans un des Maccus de Novius. Comme le Dave du Phormion, Pseudolus est un rousseau. Son ventre est gros, ses jambes fortes, il a la peau brune, la tête grosse, l'oeil vif, le teint enluminé, les pieds très grands (1).
(1) Pseudol. 1196. On a cru reconnaître Plaute dans ce portrait.
Dans les Milites Pometinenses de Novius il y a un vers qui peint à peu près un personnage pareil: " Valgus, veterinosus, genibus magnis, talis turgidis."(1)
(1) Ce signe de genibus magnis est la traduction qui se retrouve dans le signalement de l'esclave Bion des deux papyrus du Musée royal, expliqués par M. Letronne. Voyez l'Aristophane de M. Didot, fin du volume. Bion et son camarade, fugitif comme lui, ont aussi un petit manteau une chlamyde et tunique,
Peut-être les esclaves étaient-ils quelquefois chauves, comme le pêcheur dont il est question dans les Piscatores. Les fermiers, villici, avaient ordinairement une longue barbe. D'autres esclaves se parfumaient à la manière de Tranion de la Mostellaria. En voyage ils portaient souvent la bourse ou la brosse du maître (1).
(1) Je pourrais y ajoute la fiole d'huile, l'étrille,anapulla, strigilis, que les parasites portaient aussi, ustensiles propres aux esclaves qui suivaient leurs maîtres au bain, l'anneau, la ceinture, mentionnés aussi dans le savant Mémoire de M. Letronne, et quelques autres rapportés dans le Discours sur la constitution de l'esclavage, par M. de Saint-Paul. Mais il n'en est pas question dans les pièces que j'ai analysées, et je n'en ai pas vu d'exemple dans le théâtre latin.
Il y avait aussi, nous l'avons dit, des esclaves noirs, comme ceux qui servaient au Cirque ;mais ce n'étaient pas là les serviteurs habituels c'était une sorte de manoeuvres étrangers. Les femmes esclaves avaient sur la scène des anneaux de fer, des brodequins (1) elles balayaient, nettoyaient, ne devaient pas être belles, si toutefois le père de Charin du Mercator n'exagérait pas leur laideur obligée mais celles qui étaient attachées aux courtisanes se fardaient comme celles-ci de vermillon et de blanc
(1) Cf. Pline.Hist. natur. xxxiii. 4. Les hommes en portaient de même, comme Stasime, Trinum. ,970,- 978. Il y a dans les fragments de Plaute une pièce intitulée Condalium, l'anneau d'esclave.
. Je ne saurais déterminer avec
précision si le supparus dont il est parlé dans les Nautae de
Naevius était le vêtement d'une fille de pêcheur
ou de toute autre. Enfin, les nourrices portaient
des manteaux rayés ou tachetés. Ces détails, on le
voit, sont empruntés à peu près tous à Plaute et à la vieille
comédie indigène. Térence est plus réservé
sur ce point. Ses sujets sont mêlés de souvenirs de
la Grèce, et les moeurs qu'il représente ne comportaient
pas de fréquentes allusions de ce genre. Il n'est pas besoin de remarquer que chez lui les
esclaves diffèrent complètement de ceux de Plaute.
Celui-ci qui a peint la petite bourgeoisie, les gens
du commun comme nous disons aujourd'hui, a
du donner plus de saillie à ses figures serviles. Celui-là, qui a été l'écrivain du monde choisi, a du reléguer
la livrée dans un rang plus accessoire, plus
indifférent. Je n'ai pas pu m'étendre sur les esclaves
de Térence autant que sur les premiers, parce que
lui-même leur a moins accordé dans son théâtre.
J'y ai cherché plutôt la valeur scénique du personnage,
le jeu que lui a donné l'auteur, que sa vie
réelle, parce que Térence est plutôt un homme de
lettres un reproducteur d'idées générales que le
poète des vérités particulières. Je n'ajouterai pas
cet autre motif que ses fables sont grecques d'origine,
parce que je ne crois pas qu'un auteur, malgré
les protestations de ses prologues, puisse être
si entièrement rebelle ou étranger aux idées de son
moment, de son temps, qu'il oublie la vérité locale,
les préférences du plus grand nombre, et
ne courtise plus le succès qui ne vient que de là.
Oui Térence a copié Ménandre, les preuves et
les passages en sont cités partout, mais on a
facilement reconnu en même temps chez lui les traces de la vie romaine. Déjà en 1795, Boettiger
revenant sur l'opinion contraire qu'il avait exprimée
neuf ans auparavant dans son discours
sur l'Explication de Térence, reconnaissait avec Lessing
et Schmieder des traits de moeurs exclusivement
latines dans les deux dernières scènes des
Adelphes et ailleurs. Ce n'est pas ici le lieu
d'analyser, dans les oeuvres de l'ingénieux poète, les
inspirations qu'il dut à sa terre d'adoption et celles
qu'il imita des Grecs. Qu'il me suffise de rappeler, à
ce sujet, ce passage d'une préface (intitulée Praemium
verum) sur sa vie, dont quelques-uns ont tenu trop
peu de compte et qui fait de beaucoup de Romains,
ses contemporains, les complices de notre opinion.
Ou plutôt, pour nous borner à l'objet de cette Étude,
regrettons que Térence, qui a donné aux esclaves de ses comédies des moeurs généralement honnêtes
moins de méchanceté que de saillies, et leur a fait
commettre plus de péchés d'intention que de fait, soit mort;.s'il en faut croire Porcius Licinius, sans
avoir reçu de ses protecteurs une modeste maison
à loger où un pauvre esclave pût au moins apporter
la nouvelle que son maître n'était plus (1).
(1) Voir les vers de Porcius Licinius dans la Vie de Térence, attribuée à Suétone.
FIN DE L'OUVRAGE
