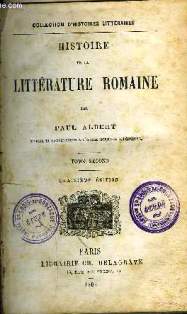
Histoire de la littérature romaine
par
Paul Albert
tome II
1870
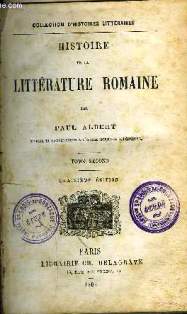
LIVRE TROISIÈME
Le siècle d'Auguste. — Politique, religion, moeurs. — Le prince.
— Le théâtre, les mimes. — Labérius et Publius Syrus. — Les
Pantomimes.— Fin de la tragédie.
Virgile.
Horace.
CHAPITRE IV
Les contemporains de Virgile et d'Horace. — Gallus, Tibulle,
Properce, Ovide, Varius, Valgius, Albinovanus.— Les didactiques.
— Manilius, Cornelius Severus, Phèdre.
Les prosateurs du siècle d'Auguste. — Ruine de l'éloquence. — L'histoire. — Les contemporains de Tite-Live. — Tite-Live.
LIVRE QUATRIÈME
Ce qu'on appelle la décadence. — La famille des Sénèque. — Sénèque le Rhéteur. — Sénèque le Philosophe. —Lucain. -Perse. — Pétrone.
Juvénal. — Martial. — Stace. — Silius Italicus.— Valerius Flaccus.
CHAPITRE III
Quintilien. — Pline l'Ancien. — Pline le Jeune.
L'histoire sous les empereurs. Velléius Paterculus. — Valère Maxime. — Quinte-Curcc.— Florus. — Tacile. — Suétone.
LIVRE CINQUIÈME
État général des lettres depuis le principat d'Hadrien jusqu'à la fin
de l'empire d'Occident. — Les rhéteurs. — Fronton. — Aulu-
Gelle.- Apulée.
Les Panégyriques et les Historiens. — Les écrivains de l'Histoire
Auguste. — Aurelius Victor. — Eutrope. — Sextus Rufus. —
Ammien Marcellin. — Symmaque.
Les derniers poëtes.- Les petits poëtes.- Claudien.- Rutilius Numatianus.
LIVRE TROISIÈME
§1.
Le siècle d'Auguste. — Politique. — Religion. — Moeurs. — Le prince. Le théâtre. — Les Mimes.— Labérius etPublius Syrus. —Les Pantomimes. — Fin de la tragédie.
La période de l'histoire littéraire qu'on est convenu
d'appeler le Siècle d'Auguste est renfermée dans d'assez
étroites limites. Certains critiques rejettent même parmi
les écrivains de la décadence le poëte Ovide, né sous le
principat d'Auguste, et qui ne lui survécut que de quelques
années. C'est pousser un peu loin le purisme. Il est certain
néanmoins que les qualités propres aux auteurs de
cette époque, ne se retrouvent pas au même degré chez
aucun de leurs successeurs. Quelles étaient ces qualités?
La pureté du langage, l'élégance sobre, la mesure ; ajoutez-
y un esprit nouveau, mais qui ne se perdra plus, l'esprit
monarchique. Les poëtes en particulier en sont de bonne heure profondément imprégnés : les Alexandrins
qu'ils étudient, les façonnent bien vite à l'admiration sans
bornes du prince; il devient un Dieu, le seul vrai Dieu,
car il est vivant, présent et payant. Grâce à lui, plus de
troubles, plus de révolutions, le loisir accordé à tous.
Les dernières convulsions de la vie républicaine ont
cessé. Brutus et Cassius n'ont survécu que d'un an à
Cicéron (712). Après la défaite de Sextus Pompée et la
mort d'Antoine, Octave César accepte le monde épuisé
de discordes civiles (Tacite). Le temple de Janus est fermé
pour la seconde fois depuis Numa; il y a un apaisement
universel, et une sorte de recueillement qui ne laisse plus
apercevoir que l'imposante grandeur de Rome. Un seul
homme dirige les destinées du monde, la servitude commence.
Mais elle n'a rien d'amer ou de blessant. Le prince,
c'est le titre dont il se contente, est un homme simple dans
sa vie et dans ses moeurs. Il habite une maison modeste sur
le Palatin; seulement il a réuni l'un après l'autre entre
ses mains tous les pouvoirs de la république : il est consul,
impérator, tribun, grand pontife, il sera même censeur;
mais rien ne semble changé dans la constitution de l'État :
c'est l'élection qui lui confère toutes ces dignités. Le
Sénat semble gouverner; le prince n'a pris pour lui que
l'administration de certaines provinces. Il a des collègues
dans le consulat, et il affecte de les prendre parmi ceux
qui sembleraient devoir être ses plus implacables ennemis,
le fils de Cicéron par exemple, puis les Pollion, les
Pison, les Varron, les Lépidus, les Lentulus, les noms les
plus illustres de la république. Ainsi, son usurpation est
comme consacrée par l'adhésion de ceux-là mêmes qui devaient
y être les plus hostiles. La douceur et l'habileté du
prince, cet art qu'il a de faire accepter à tous un pouvoir qui est la ruine réelle de toute liberté, triomphent
sans peine des dernières résistances. Quelques vieux républicains
restent bien à l'écart, insensibles à toutes les
cajoleries de l'empereur : tel Valérius Messala Corvinus
qui, nommé par lui préfet de la ville, refuse, parce que,
dit-il, "cette dignité n'est pas faite pour un citoyen," mais<
c'est un exemple qui n'a rien de contagieux. Octave est
bientôt salué du nom d'Auguste, un décret du Sénat le
met au-dessus des lois. Encore un pas, et il est Dieu. Les
poëtes chantent déjà son apothéose. Il incarne en lui la
majesté et la divinité même de Rome. Ce qui frappe tous
les regards, ce qui ravit toutes les imaginations, c'est la
grandeur de Rome dominatrice du monde, et les doux
loisirs de la paix dus à un prince qui est le bienfaiteur de
l'univers. Voilà les sources d'inspiration pour les poëtes
et les historiens : il en est de plus hautes.
On a vu par Cicéron et Varron ce qu'étaient devenues
les croyances religieuses des Romains, je n'y reviendrai
pas. Il n'y avait pas dans tout l'empire un seul homme
éclairé qui admît encore les fables du polythéisme. Mais
tous reconnaissaient en même temps la nécessité d'une
religion officielle, placée dans les mains du Sénat, ou d'un
collége d'augures, pris parmi les plus illustres citoyens.
Auguste voulut restaurer le culte national et l'épurer en
bannissant les superstitions étrangères, particulièrement
celles de l'Orient qui avaient envahi Rome. Mécène lui
conseilla d'employer jusqu'aux supplices pour arrêter
les progrès menaçants des cultes asiatiques. Mais tous
ses efforts échouèrent. Ces superstitions et ces pratiques
bizarres et monstrueuses étaient au nombre de ces choses
dont parle Tacite, qu'on défend toujours et qu'on n'empêche
jamais. Il fit relever les temples détruits et en construisit de nouveaux; il affecta le plus grand zèle pour
l'accomplissement de toutes les cérémonies de la religion
nationale; il fit célébrer par ses poëtes les anciens
dieux du Latium, les fêtes instituées en leur honneur; il
essaya de donner la vie et le mouvement à ces abstractions
froides, à ces allégories grossières qui pâlissaient
devant les splendides divinités de la Grèce et de l'Orient;
il entoura d'un éclat inaccoutumé les Jeux séculaires que
chanta froidement Horace : mais toute cette pompe extérieure
ne réussit pas à galvaniser le cadavre du polythéisme
romain. On savait d'ailleurs qu'Auguste lui-même,
dans une orgie, avait parodié avec des compagnons
de débauche les festins des douze grandes divinités de
l'Olympe. Et Horace, son ami, ne craignait pas de dire :
« Que le juif Apella croie cela, je le veux bien, mais je sais moi ce que c'est que les dieux. » Aussi tous ces nouveaux
collèges de prêtres qu'il créa, tous les priviléges
qu'il leur accorda, toutes les splendeurs antiques qu'il
rétablit, rien ne put ramener à des croyances mortes un
peuple qu'attiraient de plus en plus les mystérieuses
pratiques des cultes de l'Orient. Auguste ne put même
trouver une vestale pour remplacer celle qui venait
de mourir. Mais en revanche Mithra, Cybèle,
Isis et Sérapis ont des adorateurs sans nombre, et les lois
les plus sévères ne les peuvent décourager. Le prince
lui-même, s'il poursuit ces cultes étrangers, sacrifie aux
superstitions populaires. Il craint la foudre, se couvre
d'une peau de veau marin pour s'en préserver, et va se
cacher dans une cave bien close. Il redoute le vol d'un
aigle, qui apparaît au moment où il va clore le lustre;
pour rien au monde il ne chausserait son pied gauche le
premier. Le nouveau dieu se défie de ses collègues. Même hypocrisie dans les moeurs. Les désordres que
j 'ai signalés au début du siècle précédent, subsistent,
avec cette aggravation, qu'ils sont acceptés de tous,
qu'ils sont devenus la coutume régnante. La famille, cette
base de l 'État, n'existe plus. La facilité du divorce devenue
extrême, l'adultère reçu en usage, l'ont sapée à
la base. Mécène, l'ami particulier de l'empereur, divorce
huit ou dix fois avec sa femme dont il ne peut se
passer et avec laquelle il ne peut vivre. Auguste a enlevé
Livie enceinte à son époux. Mais il n'en publie pas
moins les lois les plus sévères contre l'adultère et la séduction.
Les deux Julie, sa fille et sa petite-fille, font
scandale dans une société qui était cependant fort indulgente;
l'empereur est forcé de les exiler. Ses lois sur la
pudicité sont violées par ceux qui l'approchent de plus
près. Il a pour consolation les vers d'Horace, l'amant des
Néère et de tant d'autres, qui s'écrie: Aucun adultère ne souille plus la chasteté de la maison ; les moeurs et les lois ont vaincu cette honte : les femmes mettent au monde des enfants qui ressemblent à leur père, le châtiment suit le crime et l'écrase. Et ailleurs : Il a mis un frein à la licence qui se précipitait en désordonnée, il a fait disparaître le crime, il a fait refleurir les anciennes moeurs. Toutes ces lois, toutes ces assertions
poétiques sont vaines et mensongères. Symptôme
plus grave, la plaie du célibat s'étend tous les jours.
Les encouragements honorifiques et pécuniaires de l'empereur
ne peuvent décider les Romains au mariage, même
au mariage tel qu'il est alors, si voisin du divorce. Horace
célèbre le bonheur et la pureté des chastes et fécondes
unions, mais ni lui ni Virgile ne se marient. Attendons
les dernières années du règne, et nous verrons Ovide rédiger le code qui régit alors les rapports entre les
deux sexes, c'est celui de la séduction et de la galanterie.
La suppression de la vie publique, et l'oisiveté qui en
est la conséquence, achèvent de démoraliser les Romains.
Ils se plongent avec une sorte de fureur dans toutes les
folies du luxe et de la débauche. Les lois somptuaires
sont impuissantes à les contenir. L'épicurisme fait chaque
jour de nouvelles conquêtes : c'est bien la philosophie
qui convient à des hommes à qui les nobles occupations
de la vie publique sont interdites. Les jeux du cirque et
du théâtre remplissent une partie de l'année; l'autre se
passe en voyages, ou dans les villas splendides de la Campanie.
Quant au peuple, il est nourri par l'État, ou plutôt
par César ; il ne fait rien, il assiste aux représentations
scéniques, aux tueries de l'amphithéâtre,mendiant,
sale, déguenillé. Auguste les voit fourmiller au forum
dans leurs haillons, et il déclame avec une emphase ironique
le vers majestueux de Virgile :
Romanos rerum dominos gentemque togatam.
De toges ils n'en ont plus, Horace dira bientôt « la
populace en tunique », (tunicatus popellus). Où est le
client d'Ennius? où est « ce citoyen avec qui le patron s'entretenait des grandes affaires du forum et du Sénat » ? Le client, c'est le mendiant attitré, qui suit son
patron pour lui faire un beau cortège et ne lui parle que
pour demander l'aumône.
Voilà ce que l'on trouve dans Rome. Mais Rome elle-même,
c'est la création d'Auguste,
c'est la vraie et l'unique
splendeur du nouveau règne. Le prince se vante
de l'avoir reçue de briques et de la laisser de marbre. Un forum nouveau, des temples éclatants de marbre et
d'or, des portiques immenses, où les oisifs se promènent
en causant, des basiliques, toute une ville monumentale
bâtie au milieu de l'ancienne, voilà l'oeuvre d'Auguste.
Il sollicite la collaboration des riches citoyens, obtient de
Marcius Philippus la construction d'un temple à Hercule,
de Corniticius, celle d'un temple à Diane, d'Asinius
Pollion, celle d'un temple à la Liberté. Cornélius Balbus,
Statilius Taurus et surtout Agrippa construisent à l'envi
théâtres, temples, portiques, bains, aqueducs. Le
nombre et la magnificence des jeux publics donnés par
l'empereur, sont incroyables; il en donnait en son nom
et au nom des principaux magistrats, c'était un moyen
de gouvernement. On y voyait des histrions de tous les
pays et de toutes les langues, car toutes les nations de la
terre avaient leurs représentants à Rome. Chasses, luttes
d'athlètes, combats navals, courses de chars, combats de
bêtes et de gladiateurs : il convoque dans des cirques immenses
Rome tout entière, sauf quelques soldats destinés
à protéger contre les voleurs les maisons sans habitants.
Il renouvelle les Jeux Troyens, où la brillante jeunesse
romaine étale ses grâces et fait l'essai de son adresse. Il
montre aux députés des peuples étrangers cette magnificence.
Il s'épuise en inventions bizarres pour amuser son
peuple,
exhibant tantôt un rhinocéros ou un serpent de
cinquante coudées. Il règle avec un soin minutieux la
place que chacun doit occuper : ici les sénateurs, là les
chevaliers, plus loin les soldats, puis les hommes mariés;
les femmes ne peuvent assister aux combats de gladiateurs
qu'à une certaine distance; les vestales seules
ont une place réservée et tout près de la scène. Il fait
aussi la police parmi les histrions, fait fouetter celui-ci, récompense celui-là. Il est évident qu'il attachait à cette
partie de sa tâche la plus grande importance, et avec
raison. Néron, qui l'imita en cela, fut toujours populaire.
Tel est le milieu où vivent les écrivains du siècle d'Auguste.
Après Cicéron, Varron, Lucrèce, Catulle, les lettres
étaient devenues une des puissances de la république. Il
fallait compter avec elles, Auguste le comprit. Il fut le
protecteur déclaré et voulut être l'ami des grands écrivains
de son temps. Il séduit le républicain Varron en le chargeant
d'acheter et d'organiser de vastes bibliothèques publiques ;
il recueille le poëte Horace, naufragé de Philippes, et qui
s'était cru l'âme d'un républicain ; il encourage le doux
Virgile, le comble de bienfaits, lui donne de nobles sujets
de poëmes, la glorification de l'antique agriculture du
Latium, les légendes héroïques du berceau de Rome. Il a
les plus douces flatteries pour Tite-Live, qui commence à
écrire sa grande histoire de Rome ; il lui fait doucement
la guerre sur son attachement à l'ancienne république et
l'appelle Pompéien. Lui-même affecte le plus profond
respect pour les grands citoyens qui l'ont combattu; il
salue la statue de Brutus à Milan, il supporte l'humeur
hautaine et dénigrante de l'historien Timagène, et la prétendue
opposition d'Asinius'Pollion. Il encourage le goût
des lectures publiques, des petits comités littéraires, et il
les honore volontiers de sa présence. Ces gens qui liment
des vers ou des périodes avec tant de soin, qui méprisent
le vulgaire et se piquent de ne plaire qu'aux délicats,
il les aime, il voit en eux des collaborateurs. Ils ne
soulèveront point de tempêtes au forum ni au sénat;
leurs vers ne voleront point sur les bouches enflammées
des hommes, et ne verseront point dans leurs coeurs jusqu'à la moelle des traits de feu, comme ceux du vieil
Ennius. Ils berceront et charmeront les oisifs et les érudits.
Cependant, quand la mort a emporté l'un après
l'autre tous ceux qui avaient vu les derniers orages de la
république et de la liberté, l'empereur est d'humeur
moins facile envers ceux qui sont nés ses sujets. Il
chasse Timagène, il exile Ovide en Scythie, il tire
du fourreau la loi de majesté qui deviendra l'épée de
chevet de Tibère, et l'étend aux écrits satiriques. Il fait
brûler l'histoire de Labiénus, et exiler Cornélius Sévérus,
le seul poëtequi se fût indigné du meurtre de Cicéron. Pour
éviter l'exil, Albutius Silon, coupable d'avoir regretté
trop haut la république, se tua. C'est le revers de la médaille.
Les littérateurs sont avertis ; ils savent ce qu'il
leur est permis d'approuver ou de blâmer. Les splendeurs
de la Rome impériale s'imposent à eux. Poëtes, historiens,
orateurs, érudits, il faut que tous ne songent au
passé que pour le faire servir à la glorification du présent.
§ II.
LE THÉÂTRE.
L'influence de l'esprit nouveau pesa tout d'abord sur
le théâtre et sur l'éloquence. L'éloquence fut pacifiée,
c'est-à-dire qu'elle n'exista plus, car la parole est une
arme, et tout orateur est un combattant. Le théâtre ne
pouvait, lui, cesser d'être; car si les Romains d'alors
étaient las des orages du forum et des tribunaux, ils
n'en étaient que plus avides de divertissements. La ruine de la vie publique les avait rendus nécessaires ;
seulement le théâtre se transforma comme tout le
reste.
A la fin du septième siècle, le peuple applaudissait les
comédies de Plante et de Térence, les tragédies de Pacuvius
et d'Attius. De grands acteurs, amis des plus illustres
personnages de la république, Ésopus, Roscius,
avaient porté l'art de la déclamation et du geste au plus
haut degré de perfection. De plus, bien que le nombre
des pièces empruntées à l'histoire nationale fût très restreint,
les spectateurs portant au théâtre les passions de
la vie publique, saisissaient avidement ou créaient dans
les oeuvres des poètes une foule d'allusions qui enflammaient
l'attention. Enfin des pièces purement nationales
par le choix des sujets et des personnages, les Atellanes,
offraient une satisfaction à ce besoin de raillerie et
de satire si vif chez la race italique. Dès le milieu du
principat d'Auguste, tout cela a disparu, ou du moins
on n'en découvre plus aucune trace. L'Atellane, qui ne
doit pas périr cependant, car nous la retrouvons sous
Caligula et Néron, a cédé momentanément la place à un
genre nouveau, à la fois étranger d'origine et national de
caractère, c'est le mime. Je n'en dirai qu'un mot, aussi
bien les représentants du mime sont perdus pour nous;
leurs noms, quelques indications de titres de pièces, un
prologue et des vers-sentences, voilà tout ce qui en a été
conservé. Rien de tout cela ne peut nous donner une
idée bien nette de ce qu'était dans sa composition et son
esprit ce genre qui semble par son nom se rattacher à la
Grèce, et par son caractère demeurer tout à fait italique.
Ce qui dominait en effet dans le mime, c'était le côté satirique,
si cher aux Italiens. Les personnages étaient plus varies que dans l'Atellane, mais au fond il y avait
une grande analogie dans l'esprit général des rôles. Le
plus ordinairement, le poëte mettait en scène moins un
individu qu'une profession; nous avons déjà signalé ce
caractère dans l'Atellane. Les foulons, les fileuses, le
cordier, le marchand de sel, le teinturier, le pécheur,
la courtisane, l'augure, voilà les titres de quelques-uns
des mimes de Labérius; c'était une peinture des
moeurs de l'Italie, des villes municipales sans doute. Il
paraît que les plaisanteries des mimes étaient extrêmement
salées, les situations scabreuses, pour ne pas dire pis. Le
patito de ces pièces était le plus souvent un honnête mari
trompé, bafoué, battu. C'était le commentaire populaire
des lois d'Auguste sur l'adultère et la pudicité. Écoutons
Ovide, sacrifié, disait-on, à la morale publique. "Que
serait-ce donc, si j'avais écrit des mimes aux plaisanteries
obscènes, peintures d'amours criminelles? c'est là qu'on
voit paraître un amant brillant et paré; c'est là qu'une
femme rusée trompe son mari. Voilà les spectacles auxquels
assistent la vierge, la matrone, l'homme fait et
l'enfant, et le sénat presque tout entier. Ce n'est pas
assez que l'oreille y soit souillée de mots impudiques, les
yeux s'y accoutument à supporter toutes les obscénités.
Une femme a-t-elle imaginé un tour nouveau pour tromper
son mari, on applaudit, on lui décerne la palme.
Plus la pièce est éhontée, plus elle rapporte au poëte,
plus le préteur la paye cher. Compte, Auguste, ce que
coûtent ces jeux placés sous ton nom, tu verras à cornbien te reviennent de telles turpitudes. Et tu as assisté
toi-même à de tels spectacles, tu les as commandés toi-même,
car partout et toujours douce et familière est ta
majesté! Oui, de tes yeux, de ces yeux qui veillent sur le monde, tu as contemplé tranquille ces peintures de l'adultère (1)."
(1) Ovid. Trist. lib. II, v. 495. — Je recommande la lecture de l'élégie tout entière, peinture fort curieuse des moeurs et de la littérature légère du temps.
Par une inconséquence qui ne doit pas nous surprendre,
ces pièces graveleuses étaient semées de sentences
morales admirables. Les Romains ont toujours aimé ce
mélange du bouffon et du sérieux, du lascif et de l'austère.
Dans l'âge suivant, quand les commentaires commencèrent
à fleurir sur les ruines de la littérature originale,
on tira des mimes de Publius Syrus une sorte de
code moral en vers. Sénèque admirait fort ces maximes
qui se détachaient comme une perle pure de la fange du
mime. Il se plait à citer Publius Syrus, il le commente
avec son enthousiasme ordinaire.
Le mime eut trois représentants illustres, Cn. Mattius,
le seul ami désintéressé qu'ait eu le dictateur César; il
fut le créateur des mimiambes ; Décimus Labérius et Publius
Syrus. Les autres, contemporains d'Ovide, ne sont
pas même nommés par lui. Décimus Labérius était
chevalier romain, et appartenait au parti populaire. Il était
hostile au dictateur César. Celui-ci l'invita à représenter
lui-même les mimes qu'il composait, et lui offrit pour
cela 500,000 sesterces. Une telle invitation était un
ordre. Labérius parut sur la scène, et, dans le prologue
suivant, il expliqua la violence qui lui était faite. Les hyperboles
laudatives à l'adresse du dictateur ne sont pas
autre chose qu'une ironie sanglante. «Nécessité au cours
oblique, dont beaucoup ont voulu et dont peu ont pu
éviter le choc, où m'as-tu réduit, presque au terme de ma vie? Moi que ni l'ambition, ni la faveur, ni la crainte,
ni la puissance n'ébranlèrent jamais au temps de ma jeunesse,
voici que dans ma vieillesse je glisse de mon rang
pour obéir à la prière humble, douce et caressante sortie
de l'âme clémente d'un homme illustre ! Simple mortel,
puis-je rien refuser à celui à qui les dieux eux-mêmes
n'ont rien pu refuser! Ainsi, après soixante ans d'une vie
sans tache, sorti de ma maison chevalier romain, j'y
rentrerai mime! Ah! j'ai trop vécu d'un jour. 0 fortune,
toujours excessive dans le bien comme dans le mal, si tel
était ton caprice que mon génie dans les lettres fût l'écueil
où se brisât ma réputation, pourquoi n'est-ce pas
au temps où mes membres étaient pleins de vigueur et
de séve, au temps où j'aurais pu complaire au peuple
romain et à un tel homme, que tu m'as saisi pour me
courber sous ton étreinte? Où me jettes-tu aujourd'hui ?
Qu'apporté-je sur la scène ? Le charme de la beauté, la
grâce du corps, l'énergie de l'âme, le doux son de la
voix? Non. Comme le lierre rampant étouffe l'arbre vigoureux,
ainsi l'âge m'étrangle par l'étreinte des ans ; véritable
sépulcre, je ne conserve que mon nom. » Tel n'était
pas le ton ordinaire des mimes, comme on peut le
penser. Ceci est de la fière et virulente ironie. Labérius,
dégradé pour avoir paru sur la scène, redevint chevalier
romain, grâce aux 500,000 sesterces que lui donna
César ; mais quand il voulut aller prendre sa place parmi
ses égaux, ils s'arrangèrent de façon à ce qu'il ne pût s'asseoir
: « Je l'offrirais bien une place, lui cria Cicéron, si
je n'étais si serré. Tu n'as pas trop de deux sièges, »
répliqua le mime, par une allusion sanglante à la conduite
équivoque de Cicéron allant toujours de Pompée à
César. Ce même Labérius, dans la pièce même qu'il dut jouer, prit le costume d'un esclave syrien, qui, meurtri
de coups et cherchant à fuir, criait : « 0 Romains,
c'en est fait de notre liberté! » Et il ajoutait, sombre
menace : « Il doit craindre tout le monde celui que
tout le monde craint. » « A ce vers, dit Macrobe,
le
peuple, se tournant en foule vers César, montra qu'il
comprenait le soufflet insolent donné à sa tyrannie. » Le
dictateur se vengea en refusant le prix à Labérius, pour
le donner à l'esclave affranchi Publius Syrus. Celui-ci
était fort admiré des anciens, moins pour son génie comique
dont ils ne parlent guère, que pour les maximes
morales semées dans ses mimes. On en fit un recueil dans
le siècle suivant, vraisemblablement après la mort de Sénèque.
Ce recueil nous le possédons encore. Il se compose
de 860 vers sentences, rangés par ordre alphabétique.
Il est certain que ce recueil, qui porte le nom de
Publius Syrus, est formé d'extraits empruntés à plusieurs
auteurs différents, à Labérius, à Matlius, et probablement
à Sénèque lui-même. Ce qui semble le prouver,
c'est que le vers de Labérius, cité plus haut : « Il doit
craindre tout le monde celui que tout le monde craint, »
fait partie de ce recueil. Ces maximes parfois ingénieuses
et profondes, sont écrites dans le style de Sénèque : brèves,
antithétiques, elles frappent l'esprit, sans le satisfaire
toujours. Peu ou point d'images, ni même d'expressions
poétiques; cependant je ne sais quoi de condensé, de
grave, de triste, qui n'est pas sans charmes. Voici un vers
tout grec par la grâce et le sérieux : « L'amour, comme
les larmes, naît des yeux et tombe sur le coeur. » On plaçait
ces sentences morales entre les mains des enfants
dans les écoles au temps de saint Jérôme.
Le mime était encore un poëme dramatique, si inférieur qu'il fût à la comédie; mais que dire des Pantomimes,
qui bientôt le rejetèrent au second rang? De tout
temps, les Romains préférèrent les spectacles qui frappaient
les sens aux représentations idéales de la vie
humaine. On se rappelle comment ils dispensèrent Livius
Andronicus de déclamer ses rôles, pourvu qu'il les jouât
par le geste. Cette tendance du génie italique prédomina
de plus en plus. Bientôt les paroles devinrent l'accessoire,
l'insignifiant, le geste fut tout. De là, le Pantomime,
de là, la suppression du poëte remplacé par l'histrion.
Au moyen de la danse, de la gesticulation, de mouvements
harmonieux du corps, l'acteur des Pantomimes
exprimait tous les actes, toutes les sensations, toutes les
passions. Ces danses expressives ne furent plus un intermède
comme les ballets de notre opéra, ce fut la
partie importante du spectacle. Les choeurs étaient comme
un repos ménagé au Pantomime. C'est sous Auguste que
ce genre nouveau fut créé, et du premier coup il parvint
à la perfection. Deux acteurs célèbres, Pylade et Bathylle, passionnèrent les sujets du prince. Bathylle, affranchi et
mignon de Mécène, excellait dans la danse comique et
gracieuse, Pylade, dans la danse grave et pathétique. Il
y eut des factions, des luttes, des émeutes dont les deux
histrions étaient les héros. Pylade fut banni par Auguste,
puis rappelé. « Tu n'exciteras plus de cabales contre
Balhylle, lui dit l'empereur. » «Mais, César, répond
l'autre, il vous est utile que le peuple s'occupe de Bathylle et de moi. » Pylade avait de l'esprit et comprenait
son temps. Voilà en effet les seuls orages intérieurs que
Rome ait connus sous Auguste. La révolution est accomplie.
Le Pantomime détruisit la comédie; il tua aussi la tragédie. Il y avait en effet des acteurs de Pantomimes tragiques,
qui dansaient une tragédie (saltare tragoediam).
Jusqu'où cet art fut porté, on peut à peine se l'imaginer
d'après les témoignages des auteurs anciens. Les situations
les plus délicates, les plus impossibles à rendre par
le geste, sans le secours de la parole, étaient figurées
avec une vérité saisissante. Par une conséquence toute
naturelle, le poëte devint un être inutile. Je ne sais en
effet s'il y eut des tragédies proprement dites représentées
sous le règne d'Auguste. Il y. eut des poëtes tragiques, on
n'en peut douter, mais leurs oeuvres furent-elles jamais
interprétées sur le théâtre ? Elles étaient lues, déclamées
si l'on veut, en petit comité, devant des amis prompts à
applaudir, à titre de revanche. Tels furent probablement
le Thyeste de Varius, l'Atalante de Gracchus, l'Adraste
de Julius César Strabon, la Médée d'Ovide, et les tragédies
de Cassius de Parme et d'Asinius Pollion.
Écoutons Horace : voici ce qui se passait au théâtre sous
ce règne d'Auguste, l'âge d'or des lettres latines.Voici ce qui épouvante et met en fuite le poëte le
plus audacieux. Cette partie du public, qui est la plus
nombreuse, mais non pas la meilleure, cette foule ignorante
et stupide, toute prête à en venir aux mains pour
peu que les chevaliers ne soient pas de son avis, s'avise
parfois au milieu de la pièce de demander un ours ou
des lutteurs, car tel est le goût de la populace, que dis-je
? des chevaliers eux-mêmes. Déjà le plaisir a fui de
leurs oreilies pour passer à leurs yeux errants et amusés
de vains spectacles. Quatre heures et plus, la toile demeure
baissée, tandis que défileront sur la scène cavaliers
et fantassins, escadrons et bataillons. Puis vient, menée
en triomphe et les mains liées derrière le dos, la fortune des rois vaincus; puis des chars qui se hâtent, des litières,
des fourgons, des vaisseaux, nos conquêtes figurées
en ivoire, Corinthe elle-même captive. Oh ! combien
rirait Démocrite, s'il était encore de ce monde, de voir
l'animal à double nature, panthère et chameau tout ensemble
(la giraffe), ou bien l'éléphant blanc, fixer seuls
les regards de la foule ! Les spectateurs l'attacheraient
plus que le spectacle, et mieux que les comédiens lui
donneraient la comédie. Pour nos poëtes, il lui semblerait
qu'ils font des contes à un âne sourd. Quelle voix en
effet assez puissante pour surmonter le bruit dont retentissent
nos théâtres? Non, les bois du mont Gargan, les
flots de la mer de Toscane ne mugissent pas avec plus de
fureur que le public de nos jeux, devant ces richesses
lointaines, ces produits d'un art étranger dont l'acteur se
montre paré, et qui dès son entrée sur la scène, font de
toutes parts battre des mains. « Quoi ? qu'a-t-il dit? —
Rien encore.—Et qu'applaudit-on ? Sa robe teinte, aux
fabriques de Tarente, de la couleur des violettes. »
VIRGILE
§1.
L'HOMME.
Les biographes, les commentateurs et la légende ont chargé de détails puérils ou merveilleux la vie de Virgile. Elle présente peu d'incidents, c'est une véritable vie de poëte. Il est né dans la haute Italie, à Andes, près de Mantoue, l'an 684 (70 avant J.-C.). Son père, petit propriétaire ou potier; s'appelait Majus ou Magus; c'est peut-être sur ce frêle fondement que l'imagination populaire fit de Virgilè un magicien. Ses connaissances très variées et très étendues, les maîtres dont il suivit les leçons (le grammairien Parthénius, et le philosophe Epicurien Syron) permettent de supposer qu'il jouissait d'une certaine aisance. Peut-être fût-il demeuré inconnu, s'il n'avait été victime des misères du temps. Son patrimoine lui fut enlevé en 713, à la suite de la distribution de terres que les triumvirs firent à leurs soldats.(Voir la première Bucolique.) Asinius Pollion et Mécène obtinrent d'Auguste la réparation de cette injustice. Dès ce jour, Virgile est recherché par les plus grands personnages de Rome. Il publie de 713 à 717, les Bucoliques; de 717 à 724, les Géorgiques ; les dernières années de sa vie, de 724 à 735, sont consacrées à l'Ênéide, qu'il laissa inachevée. La douceur de son caractère exerçait un charme infini sur tous ceux qui l'approchaient ; mais il était d'une timidité extrême, peu fait pour l'existence de citadin et de courtisan. Aussi habitait-il d'ordinaire Naples ou Tarente, livré à l'étude et à la contemplation sereine de la nature. La faiblesse de sa santé, une sensibilité vive et profonde, un besoin continuel de recueillement et de paix, lui firent souvent préférer à Rome, où l'appelaient d'illustres amitiés, le séjour des champs. La dernière année de sa vie, il voulut voir la Grèce et l'Asie Mineure, demander aux lieux chantés par Homère une dernière inspiration. Il ne put achever ce voyage, revint précipitamment et mourut en débarquant à Brindes. Il avait institué pour ses héritiers Auguste, Mécène, Varius et Plotius Tucca, et exprimé le désir que son Énéide fût livrée aux flammes. Ses amis la publièrent sans y rien changer. Elle renferme des vers inachevés et quelques contradictions. Il fut enseveli à Naples, ainsi qu'il l'avait souhaité. On montre encore aujourd'hui son prétendu tombeau. Il n'est pas plus authentique que les bustes nombreux du poëte. Peut-être la petite miniature qui se trouve dans un manuscrit du Vatican, est-elle une reproduction d'un buste ancien.
§ II.
Virgile avait vingt-six ans quand César fut assassiné.
Il vit et détesta toutes les horreurs de la guerre civile et les excès de la victoire plus cruels encore. Provincial,
étranger à tous les partis, il fut de bonne heure indifférent
à leurs succès ou à leurs revers. La paix, l'ordre, la stabilité,
voilà les premiers biens qu'il souhaita pour sa
patrie et pour lui-même. L'empire les lui donna, il aima
l'empire, et salua dans Auguste le bienfaiteur du monde.
Horace fut d'abord un ardent
républicain ; toutes les sympathies de Virgile étaient
pour la monarchie. Elles se conciliaient heureusement
avec le goût particulier qui le porta toujours vers la philosophie
d'Épicure : on sait de reste qu'elle est peu
propre à faire des citoyens. Aussi bien une société
nouvelle se fonde, animée d'un tout autre esprit que
celui de Rome républicaine. Il y a un assoupissement
général de la vie politique. La paix est imposée au monde,
le repos aux particuliers. Détournée de son objet ordinaire,
l'activité des patriciens se porte vers les études
littéraires. Il y avait du temps de Cicéron un reste du
vieux préjugé romain contre les hommes qui aimaient
mieux écrire qu'agir : aujourd'hui tout le monde rêve la
gloire d'auteur. Des collèges de poëtes se forment,
les lectures publiques sont instituées ; Auguste, Mécène,
Pollion, se plaisent à y assister. Libraires, rhéteurs, grammairiens,
philosophes, une foule d'industries et de professions
jusqu'alors peu connues ou peu estimées,
s'établissent
à Rome ; c'est une véritable invasion de la Grèce
savante, lettrée, artistique. «Feuilletez nuit et jour, dit
Horace, les modèles grecs. » Une nouvelle école littéraire
se fonde, Virgile en est le chef, Horace en est le
champion. L'un crée les modèles achevés de l'imitation
savante ; l'autre bat en brèche la gloire des vieux auteurs nationaux, pose les principes de l'art nouveau, et le
défend contre les amateurs obstinés de l'antiquité.
Faibles d'invention et d'élan, les poëtes novateurs sont des
artistes consommés de beau langage et de versification.
Leur travail est celui de l'abeille, à laquelle se compare
Horace ; il est lent, mais exquis. Épopée, poésie lyrique,
didactique, élégiaque, pastorale, ils laissent dans
chaque genre un spécimen accompli de leur art. Les
calamités des guerres civiles d'une part, de l'autre, la
paix glorieuse de l'empire, et la splendeur de Rome souveraine
du monde, voilà l'inspiration générale des oeuvres
de cette époque. L'héroïsme et l'amour de la liberté
ne les échauffent plus.
Virgile et Horace sont les deux hommes de génie de
cette école. Tous deux furent vivement attaqués et
critiqués par les admirateurs du passé, un Bavius, un
Mévius, un Cornificius, et quelques autres, qui cachaient
sous une guerre littéraire une opposition politique.
Tous deux ont créé des genres nouveaux dans la
littérature romaine, ou donné à des genres anciens une
empreinte toute nouvelle : voyons quelle fut la part de
Virgile dans cette oeuvre de transformation.
§ III.
Les Bucoliques. (Bucolica). Les grammairiens ont
donné aux dix petits poëmes qui composent les Bucoliques,
le nom d'Églogues, ou extraits choisis; mais leur
véritable titre est Bucolica. Les pâtres de
boeufs, étaient les plus anciens et les premiers des bergers;
de là, le nom général de pouxoXixa donné à des poëmes destinés
à retracer des scènes de la vie pastorale. Les bergers des temps primitifs n'étaient pas les mercenaires ou les
esclaves qui conduisaient au pâturage les troupeaux d'un
maître. Les populations antiques de l'Arcadie, les Pélasges
qui s'étaient établis dans toutes les parties de la
Grèce et de l'Italie, furent, les premiers bergers et les
premiers poëtes bucoliques. Le culte de la nature adorée
et célébrée dans toutes ses manifestations, était alors la
seule religion et la seule source de poésie. Chants de
joie ou de deuil, chants en l'honneur du printemps qui
renouvelle la nature, chants de tristesse sur les longues
nuits d'hiver et la mort de toutes choses : voilà les premières
expansions de l'âme humaine chez des peuples
dont la vie était intimement unie à celle de la terre.
Un érudit, un Alexandrin, Théocrite, essaya de reproduire
dans une galerie de petits tableaux les petits
faits et les sentiments qui composaient la vie des bergers
de Sicile de son temps. Il est le créateur de la
poésie pastorale artificielle, aussi éloignée de la poésie
des pâtres anciens, que de la vérité contemporaine.
Ce fut le modèle qu'imita Virgile. Dans un genre faux
ou impossible, il ne réussit pas à créer des personnages
réels, ni un intérêt tiré du sujet même. Ses bergers n'ont
jamais existé ; jamais bergers n'ont eu les idées et les
sentiments que leur prête le poète; jamais ils n'ont
chanté les sujets imaginés. par lui. Les combats de
chant, ces improvisations dialoguées, d'un tour sarcastique,
étaient, comme nous l'avons vu, chères aux anciens
habitants du Latium. C'est le seul trait du caractère
national reproduit par le poëte, et singulièrement atténué. (Églogues, IIIe, Ve, VIle, VIIIe.) Le cadre même de ces petits
poèmes dramatiques est plutôt indiqué que reproduit.
Des allégories souvent obscures, des allusions à des événements
politiques ou à des détails sans importance de
la vie de quelque courtisan (Églogues Ire, IVe, IXe); un luxe
d'érudition pédantesque, importée d'Alexandrie, des subtilités
de raisonnement; voilà les défauts les plus saillants
de cette première oeuvre du poëte. Il doit les uns à son
modèle ; son goût, si délicat plus tard, ne lui avait pas
encore fait rejeter les autres. Mais si l'inspiration générale
est médiocre, et l'invention presque nulle, dans
l'exécution on sent déjà le vrai poëte. Bien qu'il n'ait pas
à son service la langue harmonieuse et le dialecte flexible
de Théocrite, son style a déjà l'aisance, la noblesse et la
grâce dont les Géorgigues seront le plus parfait modèle :
Molle atque facetum,
Virgilio annuerunt gaudentes rure Camænæ,
dit Horace, et il est permis de croire qu'en s'exprimant
ainsi, il avait en vue les Bucoliques aussi bien que les Géorgiques.
Mais ne bornons point l'originalité du poëte à d'heureux
procédés de style et de versification. Virgile est déjà
tout entier dans les Bucoliques. Telle description en quelques
vers est un chef-d'oeuvre de vérité et de grâce ; tel
fragment a déjà la majesté de l'épopée, mais surtout on sent
déjà vibrer ce profond sentiment de la nature qui fut sa
plus constante inspiration ; enfin la passion a trouvé son
véritable langage. La deuxième Bucolique (Corydon), la
huitième (Damon et Alphesiboeus), la dixième (Gallus), sont
brûlantes. Choix des détails, simplicité et force de l'expression,
et par-dessus tout, mouvement rapide et naturel
de l'âme, intime et hardie association de la nature entière aux troubles d'un coeur malade; tout ce que nous retrouverons
dans les Géorgiques et dans l'Énéide, est déjà là.
Malgré le factice du genre et la tyrannie du modèle,
l'originalité éclate par la vie. L'annonce mystérieuse
d'une ère nouvelle saluée par le poëte dans la quatrième
Bucolique (Pollion), la remarquable élévation du langage,
frappèrent les écrivains chrétiens du quatrième siècle : ils
y virent une prédiction de la naissance de Jésus-Christ,
et Virgile fut considéré comme une sorte de révélateur
païen. Ce petit poëme est de l'année 714. Virgile y célèbre
la naissance du petit-fils d'Auguste, ce jeune Marcellus
dont il déplora plus tard la mort prématurée (1).
(1) Suivant quelques commentateurs, le poëte salue la naissance de l'enfant que Scribonia, femme d'Auguste, allait mettre au monde. Ce fut la fameuse Julie.
L'ordre dans lequel sont rangées les Bucoliques n'est pas l'ordre chronologique. On peut les ranger ainsi : an 713, deuxième, troisième, cinquième, première, neuvième, huitième Églogues, an 714, sixième et quatrième, an 715, septième et dixième. Ce n'est pas tout à fait l'ordre adopté par Otto Ribbeck.
§IV.
LES GÉORGIQUES.
Les Georgiques (Georgica), poëme didactique en quatre
livres sur les travaux des champs. Ce fut, dit-on, sur
la prière de Mécène et d'Auguste que Virgile composa les
Géorgiques. Les guerres civiles, l'instabilité de la propriété,
la démoralisation qui suit toutes les grandes catastrophes,
avaient éloigné de l'agriculture, cette forte éducatrice des anciens Romains, les peuples de l'Italie.
Le poëme de Virgile ne lit pas renaitre le goût de ces occupations
d'un autre âge : la race laborieuse, sobre et
vaillante des petits propriétaires avait disparu ; quelques
familles aristocratiques possédaient toutes les terres de
l'Italie, les faisaient cultiver par des esclaves ou les mettaient
en pâturages. C'est de la Sicile et de l'Egypte que
Rome tirait ses approvisionnements de blé. Les vers de
Virgile n'eurent donc aucune influence sur les contemporains.
Ils les charmèrent, voilà tout. Dans un poëme
de ce genre, le premier mérite était l'exactitude du savoir.
Virgile possédait sur l'agriculture les connaissances
les plus étendues et les plus sûres. Dans l'âge suivant,
Pline et Columelle invoquent son autorité. Lui-même
avait étudié et imita Hésiode, Théophraste, Aristote,
Nicander, Aratus (Prognostica), Xénophon (Aeconomica),
Caton et Varron (de Re rustica), Ératosthènes et Parthénius.
Il a emprunté à Aratus toute la partie du premier
livre relative aux phénomènes célestes ; Thucydide et
Lucrèce lui ont fourni plus d'un trait pour sa description
de la peste des animaux ; un poëte alexandrin resté inconnu
lui a donné le modèle de l'épisode d'Aristée ; de
plus une foule de détails techniques sont tirés de Caton,
de Varron et de Xénophon. C'est cependant l'oeuvre la
plus originale et la plus forte du poëte. Bien que dans
chaque livre il traite un sujet spécial (dans le premier,
culture du blé ; dans le deuxième, culture des arbres,
dans le troisième, élève du bétail ; dans le quatrième,
(éducation des abeilles), le poëme a son unité, non cette
unité artificielle et vaine des compositions de ce genre,
mais celle qui naît d'une idée générale féconde. La nature
apparaît à Virgile dans sa vaste harmonie et dans sa variété infinie : une âme immense la meut et la soutient,
et tous les êtres, à quelque degré qu'ils soient placés,
sont des manifestations de la substance universelle.
La tige du froment née d'un grain de blé, le jeune
rejeton du chêne, sorti d'un gland, occupent les derniers
degrés dans l'immense échelle des êtres. L'animal vient
ensuite, organisme plus savant, mû par une intelligence
et pourvu de sensibilité. Enfin, à un degré supérieur encore,
d'après les idées anciennes, l'abeille qui participe
presque à la raison. Le poëte semble avoir exposé lui-même
l'idée de son livre dans ces vers :
His quidam signis atque lisec exempla secuti
Esse apibus partem divinae mentis et haustus
Aetherios dixere ; deum namque ire per omnes
Terrasque tractusque maris coelumque profundum;
Hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum
Quemque sibi tenues nascentem arcessere vitas;
Scilicet huc reddi deinde ac resoluta referri
Omnia; nec morti esse locum, sed viva volare
Sideris in numerum, atque alto succedere caelo (1).
(1) Georg. IV, 219, sqq.
Ainsi s'expliquent l'intérêt et la vie qui circulent dans
le poëme. L'âme de la nature anime jusqu'aux brins
d'herbes parasites qui se mêlent aux riches épis ; un sentiment
profond de cette universelle réunion des êtres dans
un foyer commun soutient et inspire Virgile. Les champs,
les bois, les animaux, sont comme les associés inférieurs
de l'homme ; il les groupe autour de lui. A mesure qu'il
les connaît mieux, il apprend à les aimer, à les respecter
en se servant d'eux, en les pliant à ses besoins. Souvent
le poëte, par une illusion charmante, transforme en
êtres sensibles les plantes et les arbres ; il leur prête des
préférences, des aversions, des désirs : le laurier faible encore se tient à l'abri sous la grande ombre de sa mère.
« L'arbre greffé admire son nouveau feuillage et des
fruits qui ne viennent pas de lui. » — « Le chêne immobile
voit passer les générations des hommes et demeure
debout et vainqueur. » — « Au printemps, la terre se
gonfle ; elle attend la semence féconde. Alors le père
tout-puissant, l'éther, descend en pluies fécondes dans le
sein de son épouse réjouie, et mêlé à son corps immense,
immense lui-même, il nourrit tous les germes. » C'est
en présence de cette infinie variété de phénomènes d'un
intérêt éternel, que le poëte, comme enivré de sa contemplation,
s'écrie :
Felix qui potuit rerum cognoscere causas !
Vivre parmi ces merveilles, les comprendre et en jouir,
lui semble la plus grande des félicités.
0 fortunatos nimium sua si bona norint
Agricolas !
Flumina amem sylvasque inglorius....
Voilà où réside le charme infini des Géorgiques: c'est une
oeuvre de science et une oeuvre de sentiment. Le poëte
connaît, comprend et aime ce qu'il chante. Il y croit
surtout, et comment n'y croirait-il pas? Ne voit-il pas
éclater sous ses yeux le mouvement et la vie universels ?
Là, est la vive et impérissable originalité de I'oeuvre ;
elle réside dans l'union intime de l'homme avec la nature
extérieure, union que la loi du travail impose, mais que
l'amour rend légère et douce. Point de vue tout nouveau.
L'auteur du de Re rustica, Caton, exploite sans pitié et la
terre, et les germes qui sortent de son sein fécond, et les
animaux qu'il courbe sur les sillons fumants, et les esclaves
qu'il traite plus durement encore : c'est un calculateur. Sa vie est une lutte contre la terre nourricière ; il faut lui
arracher un à un les trésors qu'elle renferme. Point de
pitié pour elle, encore moins d'amour : il semble qu'elle
ne rappelle au rude laboureur que cette pesante loi du
travail sous laquelle il succombe. Virgile salue dans
la terre l'inépuisable bienfaitrice de l'homme,
celle qui
le nourrit et le rend meilleur. Elle est la richesse, la
force, la sérénité ; d'elle émane un charme mystérieux,
l'apaisement des soucis et des poursuites insensées.
Il convie à cette union fortifiante les hommes de violences
et de rapines que les guerres civiles ont laissés sanglants
et oisifs. Appel inutile ! Seul alors le poëte comprenait
et sentait les pures et saines voluptés de la vie des
champs. Les pauvres gens fuyaient à la ville pour être
nourris par César, les gens riches allaient à la campagne
pour échapper à la ville.
§V.
L'ÉNÉIDE.
Virgile n'a pas mis la dernière main à son oeuvre,
mais il ne l'eût point modifiée dans la composition
générale et les grandes parties. Nous avons donc
réellement dans l'Enéide l'épopée telle qu'il l'imagina et
l'exécuta. Longtemps attendue par les contemporains
saluée d'avance comme supérieure à l'Iliade, admirée,
imitée, commentée dans les siècles suivants et dans toute
la durée du moyen âge, préconisée par les faiseurs de
traités et les critiques de tous les temps comme le modèle
achevé et le type du poëme épique, l'Enéide a été reléguée
depuis le commencement de ce siècle à un rang bien inférieur. La fameuse théorie de Wolti sur les épopées
populaires, fruit d'une inspiration collective et libre,
a singulièrement exalté les poëmes homériques et rabaissé
l'oeuvre de Virgile. C'est une production artificielle,
a-t-on dit, une composition d'érudit, admirablement
versifiée, mais il faut aller chercher ailleurs le
grand souffle épique. On est un peu revenu aujourd'hui
de ces appréciations excessives, qui séduisent l'imagination,
mais ne supportent pas un examen sévère. Il
n'y a pas une oeuvre poétique quelconque où l'art n'apparaisse
; dans quelle mesure et par quels moyens l'art
a-t-il atteint la beauté et la vérité ? voilà la vraie
question.
Lorsque Virgile composa l'Enéide, Rome n'avait pas
d'épopée ; on ne peut en effet donner ce nom aux récits
historiques en vers de Naevius ou d'Ennius, mais de nombreuses
tentatives en ce genre venaient de se produire et
se produisaient encore chaque jour. Un secret instinct
avertissait les uns que toute épopée vraiment digne de
ce nom, devait avant tout être nationale. Cicéron chantait
Marius et son propre consulat; Varron d'Atace célébrait
la guerre de César contre les Séquanes (de Bello sequanico).
Hostius racontait en vers la guerre d'Istrie
(Bellum histricum). Alpinus prenait pour sujet de ses
chants les exploits de Pompée. Parmi les amis de Virgile,
Valgius, Rufus, Rabirius, et enfin Varius, chantaient les
grands événements dont le monde était encore ébranlé,
la mort de César, la bataille d'Actium. D'autres au
contraire, se reportant aux traditions de l'âge héroïque,
refaisaient d'après les cycliques telle ou telle partie des
épopées anciennes, les Chants Cypriaques, une Diomédéenne,
des Argonauttiques, une Ethiopide, un Retour de Ménélas et d Hélène. Mais ni les uns ni les autres ne découvrirent
un sujet d'un intérêt vraiment national, vaste
dans ses proportions, touchant à la fois à l'âge héroïque,
cet inépuisable foyer de grande poésie, et à l'âge
contemporain. Virgile trouva ce sujet dans l'Enéide.
Enée joue un rôle important dans Homère. Fils de Vénus,
allié à Priam, présenté déjà dans l'IIliade et dans
l'hymne homérique à Aphrodite comme appelé à de
mystérieuses et glorieuses destinées, il était de plus, suivant
les traditions populaires de l'Italie, considéré comme
l'ancêtre des fondateurs de Rome. Epargné par les Grecs
après la prise de Troie, il avait successivement abordé en
Thrace, en Arcadie, en Sicile et s'était enfin fixé en Italie.
Denys d'Halicarnasse, Tite-Live, les anciens poètes Naevius
et Ennius adoptèrent celte croyance générale. Jules
César déclarait hautement dans l'Eloge funèbre de sa tante
Julia, que sa famille remontait aux Dieux par Iule, Enée
et Vénus. Virgile n'a donc été que l'interprète du sentiment de tous, en choisissant pour sujet de son poëme le
récit des aventures d'Enée, son arrivée en Italie, les
guerres qu'il eut à soutenir, la victoire qu'il remporta.
De plus, ce sujet éminemment national était admirablement
propre à la composition d'une épopée. De ce côté
donc on ne peut refuser au poëte le mérite de l'invention,
et la convenance parfaite du choix.
Mais, dira-t-on, dans l'exécution, il se montra beaucoup
moins original ; on retrouve à chaque page la trace
d'emprunts manifestes ; Homère, Apollonius de Rhodes,
les Tragiques, sont imités, traduits même sans
scrupule. Disons de plus que nous avons perdu un grand nombre
des sources auxquelles puisa Virgile, Arctinos,
Leschès,
Panyasis, Antimaque, et d'autres poëtes cycliques,
plusieurs poëtes alexandrins, des tragédies dont nous ne
connaissons que les titres, et enfin Naevius, Ennius, et
tous ses devanciers latins. Mais qu'importent toutes ces
imitations de détail dans une oeuvre aussi vaste, si la
conception première est originale, si l'inspiration est forte
et vraiment nationale? Or, on ne peut le nier. Ce n'est
ni dans Homère, ni dans les Cycliques que Virgile a
trouvé cette grande idée de Rome, que les destins suscitent
pour être la reine du monde, idée qui est l'unité et
la vie de son poëme. Il faut aller plus loin. Homère avait
représenté dans ses deux poëmes, d'une part l'enthousiasme
guerrier, les grandes batailles livrées loin de la
patrie par les héros aventureux, de l'autre, les tribulations
et les épreuves infinies du retour. Les poëtes cycliques,
soit par imitation, soit en obéissant à un instinct naturel,
avaient aussi suivi dans leurs compositions cette
double division, les uns s'attachant à tel épisode de la
guerre de Troie, les autres ramenant dans ses foyers tel
héros. Virgile a réuni dans l'Énéide ce double courant
épique. Les six premiers livres procèdent d'une évidente
inspiration de l' Odyssée, les six derniers se rapprochent
de l'Iliade. Mais l'oeuvre conserve dans son ensemble
une unité de ton et de couleur qu'aucune imitation de
détail n'a pu altérer. La grande image de Rome domine
et absorbe tout. Le poëte n'a pu se représenter sa
patrie dominatrice des nations, sans incarner pour ainsi
dire son génie et sa gloire en un homme. Cet homme fut
Auguste, le pacificateur du monde, l'héritier de César,
le descendant d'Iule et des Dieux. C'est par ce côté que l'épopée virgilienne, rameau détaché de la vieille souche
épique, fut réellement nationale, contemporaine et vivante.
Le peuple lui-même accepta cette identification
de la patrie souveraine des peuples avec Auguste, etl'Enéide si impatiemment désirée de tous, érudits, beaux
esprits, peuple illettré, fut par tous accueillie comme le
grand,
l'impérissable monument de la grandeur romaine.
Quant aux imitations,
quelques esprits chagrins
et envieux les signalèrent, il est vrai ; mais qu'importait
aux contemporains? L'originalité majestueuse de
l'ensemble emportait tout. Et d'ailleurs, Virgile ne prétendit
jamais dissimuler ses emprunts : l'imitation était
comme une loi de la littérature latine, et Sénèque le rhéteur
a parfaitement raison quand il dit : « Non surripiendi
causa, sed palam imitandi, hoc animo ut vellet
agnosci. »
Il faut cependant le reconnaître, une lecture suivie
de l'Énéide laisse souvent froid et indifférent. L'idée de
Rome, la perspective des destinées du peuple-roi, qui
agissait si puissamment sur l'imagination des contemporains,
se réduit souvent pour les modernes à une pure
abstraction. Le patriotisme virgilien ne satisfait pas l'esprit
d'un moderne ; nous avons un idéal plus haut, et la
cité reine du monde par la conquête, n'est pas à nos yeux
la cité universelle. La conception générale qui a présidé
à l'oeuvre, si élevée qu'elle soit, ne suffit donc pas à vivifier
toutes les parties du poème : il faudrait que les personnages
eussent une existence propre ; que par leurs
actes, leurs passions, leurs souffrances, ils apparussent
véritables contemporains et frères des héros d'Homère, et
de plus marqués de ce caractère idéal qui, à travers les
différences des lieux et des temps, fait partout reconnaître l'homme à l'homme. Or l'âme de Virgile était plutôt tendre
qu'héroïque. Son imagination ne put jamais reproduire la
vive couleur de ces âges violents où la force était le seul
droit reconnu, où la guerre et le pillage étaient les seules
occupations des héros, de ces hommes que Jupiter, dit Homère
« avait formé spour vivre de l'adolescence à la vieillesse
an sein des mêlées sanglantes, jusquà ce que chacun
y pérît. » Ages de fer et d'airain, sans justice et sans
pitié, mais d'une poésie incomparable, comme tout ce
qui est sincère et fort. Homère en avait retracé une
peinture énergique et sobre, et avait à peine adouci
çà et là quelques traits du tableau. Virgile n'était
point fait pour ces scènes de carnage. Cet horrible
droit de la guerre et de la force, il le détestait. Le souvenir
des désolations de l'Italie fermait à son imagination
tout retour vers des horreurs analogues, même dans les
fantastiques régions du passé. De là, la pâle et froide
figure d'Enée. Il est jeté dans un monde qui n'est pas
fait pour lui. C'est malgré lui, et pour obéir aux destins,
qu'il vient prendre possession de ce sol de l'Italie ; c'est malgré lui qu'il veut arracher à Turnus qu'elle
aime, Lavinie qui lui est indifférente. C'est malgré lui
qu'il combat ses ennemis, qu'il les renverse ; il voudrait
leur tendre la main, les relever, cesser cette guerre horrible. Il semble un instrument inerte dans les mains du Destin. Mélancolique et résigné, il se laisse aimer par Didon, et la quitte à la première injonction des Dieux.
Un sentiment profond de piété, de la gravité, toutes les qualités sérieuses du Romain, chef d'un vaste empire; mais pas d'élan, pas d'énergie, rien de violent et d'implacable dans
la haine, rien enfin de ce qui caractérise un aventurier
vaincu, qui cherche fortune, et que de longues souffrances
ont fait sans pitié et sans justice. La majesté froide d'Auguste
est descendue sur les traits du héros troyen ; et Virgile
a de plus versé dans son âme sa propre sensibilité et cette
vague mélancolie qui était en lui. En outre, Énée est isolé
dans le poëme comme Auguste sur le trône du monde.
Le vaillant Gyas, le vaillant Cloanthe, le fidède Achate,
ne sont pas des êtres vivants. Où est la variété, où est le
mouvement de l'Iliade, cette vaste arène où chaque
héros parait à son tour et frappe ses grands coups? Le
seul personnage intéressant de l'épopée virgilienne, c'est
Turnus, évident ressouvenir de l'Achille homérique,
dans lequel un commentateur moderne a cru retrouver
le triumvir Antoine !
Telle est la principale imperfection de l'Énéide. La vérité
historique qui touche de si près à la vérité poétique,
y fait défaut. Vainement on y chercherait ce que nous
appelons aujourd'hui couleur locale; même dans les descriptions
si savantes de l'Italie ancienne, c'est Rome, toujours
Rome qui est au fond du tableau. C'est ce qui conserve
à la littérature latine, si faible par l'invention, une
originalité remarquable. Plaute et les tragiques de la république
habillaient à la romaine leurs personnages
grecs; Virgile est resté fidèle à la tradition littéraire de
ses devanciers, dont il s'éloigne sous tant d'autres rapports.
C'est ainsi que Racine a conçu et exécuté ses tragédies,
si vraies au point de vue humain et général, si contraires
à l'histoire et si peu antiques.
Les dieux de l'Énéide n'ont pas une personnalité plus
forte que ses héros, Le génie romain, dépourvu d'invention, n'a pas su créer de mythes poétiques. Virgile a dû
emprunter aux Grecs le caractère, le rôle et les passions
qu 'il prête à ses divinités. Son Jupiter, sa Junon, sa Vénus
sont tout homériques, avec plus de majesté, comme il
sied à des Romains. Quant aux divinités indigènes, tout
son génie n'a pu leur donner la vie qui leur manquait.
Mais s'il n'a pu reproduire les grands côtés de l'épopée
primitive, il a créé le modèle de l'épopée moderne,
moins naïve et moins forte, mais plus profonde et plus
humaine. Il n'y a rien dans Homère qui approche du
IVe et du VIe livre de l'Énéide. Ces admirables analyses
de la passion, cette éloquence et cette flamme, tant de
grâce, de force et de vérité, voilà l'impérissable triomphe
de l'originalité de Virgile. Le VIe livre tout entier est d'une magnificence incomparable. Légendes populaires,
conceptions philosophiques sublimes, tableaux éclatants
des merveilles que réserve l'avenir aux descendants
d'Enée : toutes les splendeurs sont réunies dans cette
peinture hardie des mystères du monde des enfers. C'est
par ce côté nouveau que Virgile frappa surtout les imaginations
du moyen âge si préoccupées des choses de
l'autre vie. Dante le prit pour guide dans son voyage à
travers les mondes surnaturels.
On trouve à la suite des oeuvres de Virgile plusieurs
petits poëmes qui lui furent attribués de bonne heure,
et qui, s'ils ne sont pas de lui, appartiennent cependant
à ce qu'on est convenu d'appeler le siècle d'Auguste.
Ces poëmes sont Culex en 413 vers hexamètres, Ciris en 541, Copa en 38 vers élégiaques, Moretum en 123 vers hexamètres; enfin différentes petites
pièces, épigrammes pour la plupart, rangées sous le nom général de Catalecta. Il y a dans le Culex une
quarantaine de vers qui semblent comme un premier
prélude du fameux épisode : 0 fortunatos nimium ...
§ VI.
LE STYLE.
Pour bien apprécier l'originalité et la suprême beauté
du style de Virgile, il faut lire Lucrèce qui écrivit à
peine une génération avant lui. Dans Virgile tous les
archaïsmes, toutes les aspérités, toutes les consonances
barbares, tous les défauts d'une versification souvent
abrupte ont disparu. Rien de comparable à la souplesse,
à l'harmonie facile de cette nouvelle poésie. Elle se développe
doucement par un mouvement aisé et gracieux ;
l'expression est élégante sans affectation, les ornements
exquis et sobres. La langue rompue par une laborieuse
discipline, a le tour naturel et la suavité de l'idiome grec.
Les commentateurs nous ont appris avec quelle lenteur
Virgile écrivait, avec quelle sévérité il revoyait et corrigeait
sans cesse ses vers. Ce fut là le signe distinctif de la
nouvelle école. Les anciens méprisaient la rature, dit
Horace ; les écrivains du siècle d'Auguste poursuivent
obstinément une perfection de langage qui leur a été rarement
refusée. Dans la composition de la phrase règnent
une égale distribution d'ombre et de lumière, une mesure
et une proportion exquises, de la noblesse sans emphase,
de la simplicité sans bassesse: cura, diligentia,
aequalitas, disait Quintilien, exactitude, élégance scrupuleuse,
unité de couleur et mélange savant de nuances.
Mais cette préoccupation minutieuse de la forme ne nuit en rien à l'expansion du sentiment, au mouvement
animé du style. Les nobles idées, les impressions
rapides ou profondes de la passion se traduisent en un
beau et naturel langage ; le lecteur suit sans effort l'impulsion
donnée à son esprit ; l'art est achevé, il ne paraît
pas.
Il n'y a pas dans toute l'antiquité d'écrivain qui ait
exercé sur l'imagination des hommes une influence aussi
profonde et aussi durable que Virgile. L'Énéide, dès son
apparition, fut proclamée le chef-d'oeuvre de la poésie. Les
grammairiens et les rhéteurs en font la matière de leur
enseignement. Expressions, tours de phrases, sentences
morales, thèmes de déclamation, c'est l'Énéide qui devient
l'arsenal universel. On en fait des centons, des
floriléges; les Grecs eux-mêmes traduisent l'épopée romaine.
Le christianisme veut transformer en croyant le
grand poëte. Les nobles et mystérieuses aspirations de cette
âme élevée, qui semble flotter entre l'Olympe et le ciel
chrétien, sont considérées comme des révélations prophétiques.
Virgile reçoit un véritable culte : c'est un magicien,
un devin. Ses vers deviennent autant d'oracles. La ruine de l'empire romain, loin
d'arrêter le développement de la légende pieuse, lui
donne une énergie nouvelle. Tout le moyen âge se prosterne
avec adoration devant cet enchanteur, qui est à la
fois le prophète et le savant universel. La Renaissance ne
lui enlève ce caractère surnaturel que pour en faire la
première et la plus haute autorité. C'est sur le modèle de l'Ênéide que se font les traités de l'épopée et les épopées.
Jamais gloire ne fut plus éclatante et plus pure, jamais
la postérité ne confondit aussi intimement dans son
admiration et son amour l'homme et son oeuvre. Aussi
possédons-nous dans une pureté parfaite le texte de ses
poëmes, conservé avec un pieux respect, reproduit à
l'infini. Le plus ancien manuscrit, celui de Médicis, remonte au IVe siècle, et un des premiers monuments de
l'imprimerie est l'édition prtnceps de Virgile. Quant
aux commentateurs de ces oeuvres si admirées, ils furent
innombrables. Dès le milieu du premier siècle, on cite
Valérius Probus; puis le stoïcien Annaeus Cornutus, puis Emilius Asper, Apronianus, Arruntius Celsus, Hyginus,
cité déjà par Aulu-Gelle, Velius Longus, cité par Servius
et par Macrobe ; Terentius Scaurus, grammairien célèbre
du temps d'Adrien. Nous possédons une vie de
Virgile par Donatus, qu'il ne faut pas confondre avec
Mlius Douatus, commentateur de Térence. Le commentaire
de Servius Afaurus Bonoralus nous est parvenu
dans son intégrité; c'était, d'après Macrobe, un grammairien
et un rhéteur fort estimé de la fin du quatrième
siècle. Ce commentaire est probablement un résumé des
travaux antérieurs ; il offre des renseignements curieux
sur l'histoire, l'archéologie et la mythologie. Celui qui
porte le nom de Junius Philargyrius est beaucoup moins
important; et d'ailleurs sa conservation laisse fort à désirer.
Les Scholies de Venise, découvertes sur un palimpsestc, par Angelo Maï, ne sont qu'une compilation des
anciens commentateurs.
HORACE.
On aime à se représenter Virgile dans les hauteurs sereines,
entre le ciel et la terre, ombre à la fois légère et
majestueuse, pure surtout, et ayant quelque chose de
virginal. Tel le voyait Dante, quand il le prenait pour
guide à travers les mondes surnaturels. Eût-il trouvé dans
toute l'antiquité une âme plus élevée, plus naturellement
religieuse, pour ainsi dire, et plus voisine de la lumière
du ciel chrétien? Les Pères de l'Eglise eux-mêmes ont
subi ce charme, eux et tout le moyen âge. C'est qu'en effet
Virgile a quelque chose d'éthéré et de mystérieux. De sa
vie nous ne savons rien que des détails touchants et poétiques
: la spoliation du champ paternel, la lecture des
vers divins sur le jeune Marcellus, et ce voyage au doux
pays de la Troade, et cette mort en touchant le rivage.
Tout le reste, c'est-à-dire le côté matériel et vulgaire,
nous échappe. Les sots biographes postérieurs ont eu
beau faire, ils n'ont pu le créer; dans leurs plates inventions
le mystérieux, le divin apparaît toujours : il domine cette vie, il est comme le caractère même de cette
figure.
Tout autre est Horace. Il ne s'est pas fié aux biographes
du soin de le faire connaître ; il s'est chargé lui-même
de son portrait, et il l'a fait et refait avec complaisauce et sincérité. Poëte lyrique, il devrait, ce semble, se
plaire sur les hautes cimes, et de son aile légère s'élever
au-dessus de la fange humide
; mais il est mieux sur terre que parmi les
astres ; il nous dit bien qu'il va frapper les étoiles de son
front sublime, mais il n'est
pas dupe, il ne veut pas que nous soyons dupes de cette
ambitieuse métaphore. Il monte rarement vers les hauteurs
et difficilement, il en descend vite et avec plaisir.
Rien de mystérieux et de voilé dans sa vie. Il nous apprend
sans fatuité comme sans mauvaise honte qu'il est
petit, gros, replet même, qu'il a mal aux yeux et les soigne
avec du collyre, que son estomac n'est pas excellent,
qu'il a parfois la pituite. Il nous dit à quelle heure il se
lève, ce qu'il fait tout le long du jour. Écoutons-le :
« En quelque lieu que me mène ma fantaisie, j'y puis
aller seul. Je m'arrête à demander le prix des légumes,
du froment. J'erre jusqu'à la nuit close dans la foule du
cirque et du forum, m'amusant de leurs charlatans, écoutant
leurs devins ; je reviens ensuite à la maison trouver
mon plat de légumes, de pois chiches et de petits gâteaux.
Trois esclaves font le service. Un buffet de marbre blanc
porte deux coupes et un cyathus ; auprès est un hérisson
de peu de valeur, un vase à libations avec sa patère, le
tout en terre de Campanie. Enfin, je m'en vais dormir,
sans affaire dans la tête qui m'oblige à me lever le lendemain
de bonne heure, à me rendre avec le jour auprès
de Marsyas, dont le geste témoigne qu'il ne peut souffrir la
figure du plus jeune des Novicius. Je reste au lit jusqu'à
la quatrième heure (dix heures du matin). Ensuite je me
promène, ou bien encore, après avoir occupé mon esprit
de quelque lecture, m'être amusé à écrire, je me fais frotter d'huile, mais non comme le sale Natta, aux dépens
de la lampe. Quand la fatigue et l'ardeur du soleil m'avertissent
qn'il est temps d'aller au bain, je quitte le
champ de Mars et ses jeux, puis je mange ce qu'il faut
seulement pour ne pas rester jusqu'au soir l'estomac vide,
et jouis à la maison comme je l'entends de mon loisir.
Voilà comment vivent les hommes exempts des misères
de l'ambition, qui n'en portent point les lourdes chaînes ;
ainsi je me console de ma médiocrité, plus heureux par
elle que si j'avais eu, comme d'autres, un aïeul, un père,
un oncle questeurs. »
Va-t-il à la campagne, il nous décrit les lieux qu'il habite,
son genre de vie, les heures où il dort, boit, mange,
travaille, ce qu'il pense, ce qu'il sent, ce qu'il aime, ce
qu'il hait. Il nous entretient de ses maîtresses, de ses
amis, des amis de ses amis. Tout lui est matière à confidence.
Jamais poésie ne fut plus personnelle que la
sienne ; Montaigne lui-même n'a pas un moi plus expansif.
Avec cela, aucune fatuité et beaucoup d'esprit ;
on l'écoute avec plaisir, et on le croit, car volontiers il dit
du mal des autres et de lui-même.
Les événements qui composent sa vie sont peu de
chose, mais ils font bien connaître l'homme et le poëte.
Il n'a jamais été marié, il n'a jamais exercé la moindre
charge publique, il n'a jamais plaidé au forum. Il est
en effet, comme il le répète si souvent, exempt d'ambition.
Une fois, une seule fois, il s'est jeté en aveugle au
milieu des orages de la guerre civile. Il avait alors quelque
vingt ans. Brutus, tout chaud encore du meurtre de
César, était venu à Athènes et avait enflammé les jeunes
Romains qui y étudiaient la philosophie, en faisant sonner
les grands mots de patrie et de liberté. Horace, simple fils d'un affranchi, collecteur pour les ventes à l'enchère,
vivait familièrement parmi ces jeunes gens des plus
grandes familles de Rome, grâce à la libéralité éclairée
d'un père excellent qui consacra tout son bien à l'éducation
de son fils. Ardent et enthousiaste, il suivit Brutus,
fut nommé par lui tribun commandant une légion, et se
battit à Philippes. Mais cet héroïsme ne se soutint
guères. Il fut des premiers à jeter son bouclier, il fut le
seul qui s'en vantât plus tard. « Pendant que Brutus
se plongeait son épée dans le corps, dit M. de Lamartine,
Horace jeta la sienne, ainsi que son bouclier, pour fuir
plus légèrement. » Notre grand poëte est sévère pour ce
pauvre Horace, presque autant que pour La Fontaine. Il
voit de trop haut les choses et les hommes, le niveau de
la réalité ne saurait être le sien. Sans accepter ses jugements
dans toute leur rigueur, souhaitons qu'il y ait toujours
parmi nous de ces âmes incapables de comprendre
et de justifier ce qui est le contraire de l'héroïsme (1).
(1) L'abbé Galiani, qui avait tant d'esprit, ne le prenait pas de si haut avec Horace. « La bataille de Philippes le guérit de la maladie qu'on appelle bravoure, et il redevint pour toujours poëte, et, comme de raison, poltron. »
Après Philippes (710, il avait vingt et un ans, étant né en 689), il revint en Italie, « humble et déplumé», nous dit-il (decisis humilem pennis) ; ses biens avaient sans doute été confisqués. Il se fit scribe du questeur, et tint les registres du trésor public, sans amour, on le conçoit, pour cette besogne. C'est alors que l'audacieuse pauvreté le poussa à faire des vers. Quels vers? De passion? d'enthousiasme, comme il sied à cet âge? Non, des vers satiriques de différents mètres (épodes et premières satires). Quelques traits acérés allaient jusqu'à Mécène, le favori du vainqueur. Virgile et Varius vont le trouver et lui offrent de le présenter à Mécène, c'est-à-dire de le débarrasser enfin de ce rôle de républicain et d'opposant auquel il est impropre. Il accepte. Il a lui-même raconté l'entrevue (1) qui n'aboutit qu'au bout de près d'une année.
(1) Sat. I, Il, 25.
Le voilà reçu dans l'amitié de Mécène, et par lui
comblé de biens et de faveurs, approché d'Auguste, et
faisant déjà des jaloux. On n'a pas épargné au poëte
les gros mots sur cette brusque et si complète conversion.
L'ode à Pompéius Grosphus (Carm.,II, vii), qui semble
avoir été écrite vers cette époque (715), et dans laquelle
il a le malheur de plaisanter sur ces noms lugubres de
Brutus et de Philippes, et ces braves qui « touchent du
menton le sol fangeux », et ce bouclier jeté, a servi de
point de départ à bien des accusations. Sans accepter
entièrement l'ingénieuse et indulgente explication de
M. Patin, je dirais volontiers avec lui que le poëte
ne pouvait guère agir autrement, non parce que bien
d'autres faisaient de même, mais parce que entre tous
Horace était préparé à cette évolution. Elle était conforme
à sa nature intime, à tous ses goûts : il était essentiellement
monarchique de coeur. Ce n'est donc pas sa conversion
qui est difficile à expliquer, c'est son court accès
de républicanisme. « Il faut mesurer chacun à sa mesure,
» dit-il quelque part ; sa mesure à lui, c'était un
tempérament ingénieux entre tous les extrêmes. Le gouvernement
d'Auguste, dont il ne vit que la plus belle partie,
lui convenait sous tous les rapports. Il aimait la paix,
les loisirs que faisait le prince aux ci-devant citoyens,
les formes adroites dont il masquait son autorité, les délicates attentions qu'il déployait envers les gens de lettres.
Il se rendit sans combat à tous ces agréments, et
sans renoncer à aucune conviction, car il n'en avait pas.
Ceci bien établi, il faut ajouter que son attitude sous le
règne d'Auguste fut de tout point celle d'un galant homme;
qu'il ne montra jamais l'âme d'un valet, qu'il sut conserver
une honnête indépendance individuelle. L'empereur
voulut en faire son secrétaire, il refusa : il semble
même avoir plus d'une fois fait comprendre à César et à
Mécène qu'il voulait bien les aimer, célébrer leurs bienfaits,
mais non se faire leur amuseur en titre. Mécène,
retenu à la ville où il s'ennuie, veut forcer Horace à
quitter la campagne où il se trouve bien. Le poëte refuse
et se dégage de la manière la plus polie et la plus
ferme à la fois. En acceptant les présents de son bienfaiteur,
il n'a pas entendu vendre sa liberté que si Mécène
insiste, réclame un droit, Horace rendra tout pour rester
indépendant. Ceci n'altéra en rien leur amitié. Il avait
juré en poëte qu'il ne survivrait pas à Mécène ; sa mort,
qui arriva vingt jours après celle de son bienfaiteur, lui
donna raison. Quand il mourut, il jouissait encore de
cette médiorité dorée qu'il a tant célébrée : il n'avait pas
voulu de l'opulence, ni des honneurs, ni du fracas d'une
grande existence. Il resta toute sa vie simple et modéré.
C'est le plus bel éloge qu'on puisse faire de lui. Si l'adversité
l'avait abattu, ce qui n'est pas certain, la prospérité
ne le gâta point.
Tel fut l'homme : voyons le poëte. Il a laissé des
vers lyriques, des satires, des épîtres. Ses vers lyriques se composent de quatre livres d'odes,
un livre d'épodes, et le Chant séculaire.
Il parle lui-même et en termes magnifiques de cette
partie de son oeuvre. « Je l'ai achevé, ce monument
plus durable que l'airain, plus haut que les royales pyramides, pour la ruine duquel ne pourront rien, ni la
pluie qui pénètre et qui ronge, ni l'aquilon déchaîné, ni la
suite sans nombre des années, ni la fuite du temps. Non,
je ne mourrai pas tout entier; une grande part de mon être échappera à la déesse des funérailles. Toujours je
grandirai dans l'estime de la postérité, rajeuni par ses louanges... «On dira que... mélevant au-dessus de mon humble fortune, le premier, je fis passer les chants de
la muse d'Éolie dans la poésie italienne. Conçois un juste
orgueil, ô ma Melpomène, et viens toi-même ceindre
mon front du laurier de Delphes. »
Et ailleurs : « Je suis le premier qui ai fait vibrer les
cordes de la lyre latine. » Il oublie Catulle, dont il ne
prononce le nom qu'une fois et avec un dédain mal déguisé,
Catulle qui lui dispute sérieusement l'honneur
d'avoir été le premier poète lyrique en date et en génie.
Les odes d'Horaçe sont la partie la plus éclatante de son
oeuvre et la moins originale. Le temps, qui nous a envié
presque tous les poëtes lyriques de la Grèce, a cependant
laissé de leurs vers subsister assez de fragments pour mettre à nu les procédés artificiels de la poésie d'Horace.
Il n est peut-êlre pas une seule de ses odes qui ne soit
une traduction ou une imitation partielle. J'ai déjà eu plus d'une fois l'occasion d'indiquer ce caractère général
de la littérature romaine. Les Romains étaient fort
peu sensibles à ce que nous appelons aujourd'hui l'invention,
l'originalité. Ils ne se piquaient guère d'invention que dans la rhétorique. Dans la littérature proprement
dite, et particulièrement en poésie, ils mettaient
leur gloire à lutter contre un texte grec. Les plus forts
d'entre eux marquaient leur oeuvre de l'empreinte du génie
national, qui a toujours je ne sais quoi de plus énergique
et de plus sobre. Horace n'échappa point à cette
loi générale, et d'ailleurs où aurait-il pris l'inspiration
libre et féconde? C'est un galant homme, mais sans
enthousiasme. Il ne chantera point la liberté ; il l'a réduite
de bonne heure à l'indépendance individuelle, et il
ne voudrait point d'un nouveau Philippes. Cette partie
de l'oeuvre d'Alcée, un de ses modèles, il la laisse prudemment
dans l'ombre. Chanter a-t-il la patrie ? Oui,
il ne peut s'en dispenser, mais la patrie incarnée en
Auguste, ses amis, sa famille. La gloire guerrière du
prince, il s'épuise en vain à la célébrer en Pindare : la
matière est ingrate, et l'élan lui manque. Il s'y essaye
cependant, et fait au nouveau César un cortège de toutes
les splendeurs du passé ; mais ces grands noms qu'il
évoque font pâlir celui d'Auguste, et les exploits de l'empereur
languissent auprès de ceux des Scipions et des
Fabricius. Sera-t-il plus heureux, lorsqu'il chantera
les gloires pacifiques du nouveau règne, ces lois
admirables et impuissantes contre les désordres des
moeurs, la prodigalité et tous les vices qui minaient le
colosse romain? On sent bien qu'il manque d'autorité
pour entreprendre une telle tâche, et qu'il se moque lui-même
de ses sermons rhythmiques. Il reste les dieux,
la religion, les temples rebâtis ou multipliés par Auguste,
les vieilles cérémonies remises en honneur. Le poète
aborde aussi ce sujet, et consciencieusement s'efforce de
chanter en croyant les belles choses dont il se moque à table avec ses amis et Auguste lui-même. Il reste
froid et ne fait admirer que l'habileté de son langage et
la riche harmonie de ses vers. Le souffle l'abandonne dès les premières strophes ; et il lui arrive parfois de
terminer par une plaisanterie une ode religieuse ou
morale. Quoi de plus faible que le chant séculaire ?
Sous la pompe des images, on sent le vide et la sécheresse.
Le poëte est érudit, ingénieux, moral, mais il ne
croit à rien de ce qu'il chante.
Il y a cependant dans les odes d'Horace des pièces
charmantes et vraies. Si le vol d'aigle de Pindare lui
est interdit, il peut mouvoir avec grâce ses ailes dans
une région moyenne, plus près de la terre que du soleil.
Sceptique et indifférent aux grandes choses, il est sensible
aux joies et aux tristesses de la vie intime. Il était
tendrement attaché à ses amis Mécène, Virgile, Varius,
Varus ; il eut des maîtresses, il fut aimé, trahi, repris
et quitté. Il aimait les champs et les loisirs et les agréables
conversations après boire. C'est dans les odes où il
s'est chanté lui-même, qu'il faut chercher la vibration de
la fibre poétique. Elle y est. Mais n'attendez point des
effusions puissantes et désordonnées, cris d'une âme profondément
atteinte et qui ne se maîtrise plus. L'homme
est ému, l'artiste reste impasssible : les troubles intérieurs
n'arrivent jusqu'à lui que pour mettre en mouvement
ses facultés : dès qu'il écrit, le souci de la forme
contient tout tumulte ; il faut que joie ou douleur, tous les
sentiments se plient aux règles sévères de la beauté. C'est
ainsi, ce n'est pas autrement que se produisent les oeuvres
parfaites. Plus impétueux s'élancent Eschyle, Pindare,
Shakespeare, Dante, mais dans ces torrents d'or il y a
des scories. Virgile, Horace, Racine, plus maîtres d'eux-mêmes, sont faibles parfois, jamais mauvais. Au moment
où Horace composait avec un art si achevé ses petits
poëmes lyriques, l'idiome latin était parvenu à toute la
souplesse, à toute l'harmonie dont, il est susceptible. La
langue poétique était, je ne dis pas fixée, jamais elle ne
le sera dans aucun pays où il naîtra des poëtes, mais
elle possédait un riche trésor de tours et d'expressions
distincts de la prose. Elle ne les avait acquis que par un
travail pénible et une lutte de tous les instants avec les
modèles grecs. De richesses intimes et tout à fait personnelles
elle n'en possédait guère, et elles étaient
frustes, sorte de diamants non taillés : tels les vers d'Ennius,
de Lucilius et même de Lucrèce. Horace ne trouva
en son propre génie que des perfectionnements artificiels,
des richesses conquises par l'étude. Il ne fut pas
une source nouvelle, jaillissant des sept collines ; ce qu'il
ajouta au trésor commun, il le dut à d'habiles et souvent
audacieux emprunts. Il traça lui-même les règles de cette
imitation du grec, fondée sur l'analogie. Ses néologismes, car il en a et
beaucoup, ont un air national, et sont pourtant étrangers.
Aussi composait-il lentement, péniblement, toujours
arrêté par quelque scrupule, ou ambitieux de condenser
en peu de mots expressifs une idée ou un sentiment.
Mais, bien mieux que nous, il dira ce que c'est que la
grande inspiration auprès de son travail difficile.
« Une aile puissante soutient dans les airs le cygne thébain,
quand il s'élance vers la région des nuages. Mais
moi, comme l'abeille de Matine, qui se fatigue à recueillir
les sucs embaumés du thym, je ne compose pas sans
peine sous les ombrages, près des eaux. du frais Tibur,
mes vers laborieux. »
Combien il est plus aisé et plus naturel dans les Satires
et les Épîtres ! Ce sont à vrai dire des conversations (sermones), soit avec le public, soit avec un particulier ; et
il était plus facile à Horace de prendre ce ton que la fière
allure de la poésie lyrique. Les satires furent composées
de l'an 713 à l'an 726, entre la vingt-quatrième et la
trente-septième année d'Horace ; l'une d'elles cependant
(la 7e du Ier livre) remonte jusqu'au temps où il servait
dans l'armée de Brutus. Elles correspondent donc pour
la date à la jeunesse et à la première maturité du poëte,
et l'on serait en droit de chercher dans une oeuvre de ce
genre la verve et la flamme de la jeunesse. Quoi que
nous en ayons en effet, ce mot de satire éveille aussitôt
en nous le souvenir de Juvénal : Juvénal est pour nous
comme le modèle suprême, l'idéal même de la satire, et
c'est d'après lui que nous sommes enclins à juger tous
ceux qui ont osé marcher dans la même voie. Horace ne
ressemble en rien à ce roi de l'hyperbole. Ce n'est pas
assez de dire qu'il n'a point en lui ces haines vigoureuses
que doit donner le vice aux âmes vertueuses, il faut ajouter que tout ce qui est excessif lui demeure naturellement étranger. « Le sage, dit-il quelque part, mériterait
le nom de fou, le juste celui d'injuste, s'il recherchait
la vertu au delà de ce qui suffit. » Il faut en tout de la
mesure, dans les plaisirs, dans les chagrins, dans la sagesse,
dans la folie, et, si vous écrivez, dans l'expression
Une âme ainsi faite, si raisonnable, si maîtresse d'elle-même,
n'aura point de ces indignations tonnantes à la Juvénal. Horace, sceptique et doucement railleur, ne se
met point en colère ; le ridicule, dit-il quelque part, fait
mieux que la violence. Il voit, observe, prend ses notes,
décoche ses traits malins sur celui-ci, sur celui-là; ne
s'oublie pas lui-même et se fait agréablement son procès.
Ses plus grandes hardiesses ne vont pas au delà d'une
raillerie spirituelle, délicate, comme il convient à
un homme trop sensé pour se mettre en colère à propos
des vices des autres. Ces emportements de langage
d'ailleurs ne sont pas d'un homme bien élevé, et qui
sait vivre. Or, la société familière de Mécène et d'Auguste
se distingue surtout par l'urbanité, qui n'est autre
chose que la mesure parfaite et le respect des convenances.
Dans un tel milieu un déclamateur virulent eût
été ridicule et souverainement incommode. Cette aimable
société d'épicuriens a pour devise notre vers charmant :
Les sots sont ici-bas pour nos menus plaisirs.
La satire d'Horace prendra donc la forme d'une conversation
enjouée et piquante, et ses plus grandes hardiesses
n'iront guère au delà de ce que se permettent en causant
familièrement des hommes d'un esprit aiguisé. Quelques
crudités par-ci par-là, comme il en échappe en petit comité
; nul ne s'en scandalisait à Rome ; on en voyait, on
en entendait bien d'autres au théâtre.
Voilà pour le ton général de l'oeuvre. L'esprit naturellement
modéré d'Horace et le cercle littéraire dans lequel
il vivait ne permettaient pas qu'il fût autre, plus
haut et plus passionné. Quant au fond, il porte plus
marquée encore l'empreinte des circonstances extérieures.
La position prise par le poëte dans la société romaine le condamnait nécessairement à une extrême
réserve. N'était-il pas l'ami et le confident d'Auguste et de
Mécène? N'avait-il pas chanté, ne chantait-il pas tous les
jours dans ses odes les bienfaits du nouveau règne, la religion
remise en honneur, la paix assurée au monde, les
vieilles moeurs restaurées, la chasteté des mariages, la virile
éducation donnée à la jeunesse? Si tout était bien sous
le principat d'Auguste, quelle pouvait être la matière des
satires? Nous touchons ici le point délicat, le desideratum de cette oeuvre trop vantée. On a voulu y voir un tableau
complet et exact de la société romaine d'alors. Rien
de moins fondé. Horace n'était pas de taille à tracer ce
tableau, qui eût demandé un pinceau bien autrement
énergique que le sien. Était-il dupe de l'hypocrisie
officielle? Voyait-il sous les couleurs brillantes dont
Auguste masquait son administration, les vices sans
nombre de l'oeuvre nouvelle? CroyaiL-il sincèrement à ce
replâtrage de la vieille Rome républicaine par un maître
absolu ? Il avait, j'imagine, trop d'esprit pour prendre au
pied de la lettre ces menteuses restaurations du passé.
Mais il n'avait ni le courage de les dévoiler, ce qui eût été
à proprement parler l'oeuvre d'un vrai poëte satirique, ni
l'idée de s'en scandaliser. Que la chose publique aille
comme il plaira aux dieux et à l'empereur que cela regarde
pour nous, jouissons de la vie et moquons-nous
des sots. Les sots, voilà en effet les victimes d'Horace.
Il y en a bien des espèces : les bavards importuns, les
beaux esprits, les difficiles, les inconséquents, ici un
mauvais poëte, là un chanteur, un stoïcien renfrogné,
un gourmand. Il esquisse d'une main légère ces divers
personnages, et en dessine d'assez agréables caricatures.
Mais est-ce au nom de la morale outragée qu'il accable ces malheureux de ses traits acérés ? Nullement.
Encore une fois ce point de vue élevé lui est absolument
étranger. Voici l'idée qu'Horace s'est faite de l'humanité
; on y retrouvera un évident ressouvenir de ses
études de philosophie morale à Athènes. Tous les
hommes sont à un degré quelconque atteints de folie;
folie ou passion, c'est tout un, le mot stultus a les deux
sens. Tous sont poussés par la passion à des actes
mauvais et surtout absurdes. Prenons un exemple, la satire
IIe du premier livre. Le poëte démontre, car c'est une
thèse qu'il soutient, que l'adultère est une folie, un fort
mauvais calcul, si l'on veut. Il ne peut avoir pour excuse
que la passion ; or, n'y a-t-il qu'une femme mariée qui
puisse satisfaire les emportements de la passion? Elle
n'est pas plus belle que toute autre, et, de plus, un commerce
avec elle expose aux plus cruels dangers, à la
perte de l'honneur, de la fortune, souvent même de la
vie. Donc, libertins, respectez les femmes mariées et
; contentez-vous des affranchies et des courtisanes.
Voilà la morale d'Horace, c'est celle que lui enseignait
son père : il lui montrait un débauché connu, déshonoré,
et lui disait : Veux-tu être comme lui ? Les dernières
conséquences de cette théorie sont faciles à déduire : d'un
côté, identité du vice et de la folie ; de l'autre, identité de
la vertu et de la prudence. Il est dans la nature de l'homme
de céder à l'attrait du plaisir : seulement l'insensé compromettra
sa fortune, son honneur, sa vie ; le sage saura
jouir sans se compromettre en rien. L'avare et le
prodigue, le gourmand et l'ambitieux, sont aussi des insensés.
Ils veulent être heureux, et ils ont raison; mais
les moyens qu'ils emploient sont mauvais. Voilà le
fond moral des satires d'Horace ; elles peuvent toutes, sauf celles qui sont un récit (comme le voyage de
Brindes, le souper ridicule, la présentation à Mécène,
l'éloge de la campagne), se réduire à ce principe. Par là
elles sont à la portée du plus grand nombre, et elles
plairont toujours aux esprits modérés. Le poëte d'ailleurs
s'applique souvent à lui-même les critiques qu'il
adresse aux autres : il le fait avec un agrément et une
sincérité parfaite, c'est un charme de plus. Au lieu
d'un auteur, on trouve un homme.
Les Épîtres sont des dernières années de la vie d'Horace.
Je les appellerais volontiers son testament moral
et littéraire. Arrivé à l'âge où l'on est devenu tout ce
qu'on doit être, il se montre tel que l'ont fait les années,
l'expérience des hommes et des choses et le travail de la
pensée. Il y a deux parties bien distinctes dans cette
oeuvre : l'une qui comprend les théories morales, ou, si
l'on aime mieux, la philosophie d'Horace, c'est le premier
livre ; l'autre, qui renferme ses théories littéraires,
c'est le second livre. On sait que l'épître aux Pisons,
vulgairement appelée Art poétique, en fait partie.
Voyons d'abord le moraliste.
Comme tous les Romains éclairés de son temps, Horace
connaissait parfaitement les principaux systèmes
philosophiques de la Grèce, et il avait extrait de chacun
d'eux, en les combinant, en les corrigeant, un ensemble
de règles pour la conduite de la vie. Écoutons-le.
— « Je dis adieu pour toujours et aux vers et aux
autres frivolités. Qu'est-ce que le vrai, l'honnête ? voilà
ce qui m'inquiète, ce que je cherche, ce qui m'occupe tout entier. J'amasse désormais pour les besoins de
l'avenir. Ne me demande pas sous quels drapeaux je
marche, à quelle maison je m'attache ; je n'ai point
de maître à qui je me sois donné, à qui j'ai juré obéissance
; hôte passager, je m'arrête où me jette la tempête.
Tantôt j'embrasse la vie active, je me hasarde
sur la mer orageuse du monde; je suis le partisan
sévère, le sectateur rigide de la vertu véritable. Tantôt
je me laisse doucement retomber dans la morale d'Aristippe,
et je me soumets les choses du dehors au
lieu de me soumettre à elles. » Il ne nomme point
Epicure, mais c'est bien son vrai maître. Le stoïcisme
n'était pas fait pour lui. Il se moque, lorsqu'il dit qu'il
songe à se hasarder sur la mer orageuse du monde, et
à embrasser la vie active du citoyen. Le stoïcisme
ordonnait en effet à ses disciples de se mêler à la vie
publique ; mais Horace en fut-il jamais tenté, et songeat-il jamais à conseiller à d'autres ce que lui-même
regardait avec raison comme impossible? Qu'on lise
les épîtres 17e et 18e du premier livre, adressées l'une
à Scéva, l'autre à Lollius, on aura le vrai code de la
morale politique du jour. « Gouverner, commander, offrir à ses concitoyens le spectacle d'ennemis captifs, voilà ce qui touche au trône de Jupiter, qui aspire aux honneurs du ciel. Mais plaire aux premiers de la terre, ce n'est pas non plus un honneur si médiocre. » Nous voilà bien prévenus, les grandeurs
de la vie publique sont réservées aux dieux, c'est-à-dire à Auguste et à sa famille : pour les autres, la
gloire de bien faire leur cour. C'est un art difficile,
une Corinthe où tous n'abordent pas. Il faut être
discret, réservé, regarder sans voir, écouter sans entendre, ne pas importuner surtout par des phrases de
mendiant. « J'ai une soeur sans dot, une mère dans la pauvreté, un bien dont on ne peut se défaire, et qui ne suffit point à nourrir son maître. Parler ainsi, c'est crier : donnez-moi à manger. Ne soyez
point non plus vil flatteur et bouffon, ni rude et renfrogné
pour vous donner l'air d'un indépendant, d'un
Caton, ni complaisant outré et fastidieux, ni contradicteur
opiniâtre. « La vertu est un sage milieu entre
deux excès opposés. » Il faut sacrifier ses goûts à
ceux du maître, aller à la chasse de bon coeur s'il le
désire, bien qu'on ait envie de rester chez soi à faire
des vers. Surtout ayons grand soin de ne jamais recommander
les gens dont nous ne sommes pas sûrs. Leurs
fautes retomberaient sur nous. Soyons gai avec le
maître quand il est gai, triste quand il est triste, grand
buveur, quand il aime à boire. Que si toutes ces sujétions
te semblent trop dures, étudie les philosophes et
apprends d'eux la résignation, ou, ce qui vaut mieux
encore, la modération dans les désirs, qui assure
à l'homme ce bien inestimable, la liberté. A défaut
du citoyen, nous avons l'homme. La morale devient
personnelle, bornée exclusivement au moi. Que nous
sommes loin du Traité des devoirs de Cicéron ! La suppression
de la vie publique, en enlevant au Romain son
plus haut intérêt, le condamne à se concentrer en lui-même.
Il cherchera encore le souverain bien, mais il
ne le trouvera plus dans l'action et le dévouement. Il a
entendu les clairons qui sonnaient la retraite ; il quitte
le forum, rentre chez lui. Qu'y fera-t-il? Il combattra
l'oisiveté qui lui est imposée, par l'étude, les voyages,
le jeu, les festins, les amours faciles. Ses amis ne sont plus des amis politiques, mais des compagnons de plaisirs.
Quelques-uns, âmes plus fortes, ne pouvant se consoler de n'être plus citoyens, restent dédaigneusement
à l'écart, sacrifiant en secret à la vieille divinité, la
république : hommes chagrins, austères, trouble-fêtes,
qui ont toujours à la bouche les noms des Caton,
des Brutus et des Cassius. Ce sont les stoïciens. Horace
se moquera de ces gens attardés. D'autres se jettent
en désespérés dans toutes les fureurs du luxe et de la volupté ; ils consument dans un seul festin une fortune
royale, ils engraissent leurs murènes de sang humain, comme Apicius, comme Védius Pollion : ce sont les Épicuriens poussant jusqu'aux dernières monstruosités le précepte du maître. Les sages demandent à la vie tous les biens qu'elle offre à ceux qui
savent les découvrir et en jouir. Point de regrets inutiles pour ce qui n'est plus et ne saurait revenir ; point d'ambitions démesurées ; le jour qui nous éclaire
peut être le dernier, jouissons-en. Aimons, rions, buvons,
chantons ; vivent les douces causeries, et le
sommeil et la précieuse oisiveté ! Se porter bien, avoir de bons amis, des livres, un domaine aux champs, une
: maison à la ville, que faut-il de plus pour être heureux?
Et le bonheur n'est-il pas la fin de l'homme ? Voilà
la philosophie d'Horace : elle est peu héroïque, comme
dit fort bien M. Patin ; mais elle n'en est que plus raisonnable,
et plus à la portée du commun des hommes.
Je serais étonné cependant qu'elle pût satisfaire des
âmes jeunes. C'est un vin vieux, dit Voltaire, soit, mais
il ajoute qui rajeunit les sens. Je croirais plutôt qu'il
les engourdit. Mais c'était comprendre excellemment
son époque que de présenter la vie sous cet aspect.
Théories littéraires.
Tout se tient dans Horace. L'homme et le poëte
ne font qu'un. De même que tous les héros des anciens
âges pâlissent devant Auguste, ainsi les poëtes modernes ;
effacent la gloire de leurs devanciers. Cette guerre
contre les poëtes de la république, il la commença de
bonne heure, à peine rallié au nouveau règne, et il la
poussa jusqu'à son dernier jour. C'est qu'il ne s'agissait
plus seulement d'Auguste, de Mécène, du principat : il
y allait de l'honneur de l'école moderne,
Horace combattait
pour son propre foyer. Il faut bien le reconnaître,
c'est la partie la plus faible de son oeuvre. On
ne comprend pas qu'un homme de tant d'esprit se soit
obstiné à une plaidoirie si malheureuse. Ici évidemment
ce sage, toujours maître de lui-même, a été
égaré par la passion. L'amour-propre est le plus dangereux
des guides.
Au temps où la nouvelle école représentée par Horace,
Virgile, Varius, tous courtisans ou amis d'Auguste,
mettait au jour des oeuvres qui portaient si vive
l'empreinte de leur temps, il y eut surprise, indignation,
et retour passionné vers les poëtes de la république.
L'opposition politique devenue impossible se transforma
en opposition littéraire. On ne pouvait attaquer
Auguste, on attaqua Virgile et Horace. On se plut à
opposer à leurs vers laborieux, la franche et vive allure
d'Ennius, de Lucilius; à leur délicate plaisanterie, la
verve puissante de Plaute : on affecta surtout une admiration
passionnée pour les poëtes tragiques de la
république, Pacuvius, Attius ; on remonta même jusqu'au
cinquième siècle, et on remit au jour les Saturnins abrupts de ce fougueux Névius, l'opiniâtre adversaire
des grands. Certains archéologues plus fanatiques encore
s'éprirent tout à coup des lois des Douze Tables,
du chant des Saliens, des livres des Pontifes, des vieux
oracles des devins. Enfin on évoqua toute la vieille
Rome littéraire pour la dresser comme un rempart
contre les novateurs de l'empire. Le doux Virgile ne
fut point troublé de ces clameurs : comme notre Racine
il se borna à laisser tomber de sa plume une épigramme
rapide et cruelle, qui perçait de part en part deux des
plus ardents détracteurs, Bavius et Mévius. Horace
était plus irascible. Il harcela d'abord ces ennemis littéraires,
les Pentilius, les Démétrius, les Fannius, et bien
d'autres; mais cela ne lui suffit pas : battus, ils se
retranchaient derrière Ennius, Lucilius,
toute l'antiquité.
Horace fit leur procès aux anciens. Il s'indigne
qu'on réclame pour eux autre chose que de l'indulgence.
Ceux qui admirèrent les plaisanteries et le
nombre de Plaule furent des sots. Quant aux antiquaires
qui vantent les lois de Numa et les chants des
Saliens, ils ne les comprennent pas plus que moi. Ils
crient à l'impudence quand je me permets de critiquer
la marche des pièces d'Atta. Quoi! s'écrient-ils, des
pièces que jouaient le grave Aesopus, le docte Roscius !
(traduisez, des pièces républicaines, pleines d'allusions à la liberté menacée et perdue.) Sous cette admiraration
obstinée il y a autre chose, il y a la malveillance
et l'envie contre les poètes modernes. Mais enfin
que pense-t-il des anciens ? Il pense que leurs vers
sont durs, lâches et souvent languissants ; qu'ils écrivaient
sans soin, à la hâte, plus désireux de faire
beaucoup que de faire bien ; que Lucilius est un fleuve bourbeux, qu'Ennius est ridicule avec ses prétentions
à être le continuateur d'Homère. Toutes ces critiques,
on le voit, se réduisent à ceci. Les anciens sont grossiers
dans leur langage et dans la facture de leurs vers
qui le niait ? Mais on parlait ainsi de leur temps.
Avaient-ils du moins, ces barbares, l'inspiration forte,
l'élan, la verve, la foi ? S'ils dédaignaient la rature, n'était-ce pas que leurs vers jaillissaient impétueux de
leur âme de feu ? Il y a du fumier dans Ennius ; soit,
c mais il y a aussi des perles ; et Virgile en faisait son
profit.. Horace lui-même, lorsqu'il était plus jeune et
plus équitable, retrouvait dans la phrase brisée d'Ennius
les membres dispersés du poëte.
Une nouvelle poétique se forme, Horace en donne les
règles. La première, c'est l'étude incessante des modèles
de la Grèce: «Feuilletez-les nuit et jour. » La seconde,
c'est le soin scrupuleux de la forme, de la minutieuse exactitude.
Le poëte sera avant tout un être raisonnable ; il étudiera
Socrate et ses disciples pour apprendre à bien penser.
Il mettra chaque chose en sa vraie place, observera la distinction
des genres, polira et repolira sans cesse son ouvrage.
Précepte judicieux que notre Boileau développera
complaisamment, et dont on ne s'avise que le jour
où le vide des idées et la froideur de l'inspiration cherchent
à se dissimuler sous la perfection de la forme. A
quoi sert de le dissimuler, en effet ? Les nouveaux poëtes
sont infiniment supérieurs à leurs devanciers sous tous les
rapports, un seul excepté : l'élévation de la pensée et le
sérieux de l'inspiration. La liberté soutenait et animait les
premiers ; ils étaient citoyens avant d'être auteurs. Dans
Catulle lui-même, on sent vibrer la fibre nationale.
Horace et ses amis rappellent trop les poëtes d'Alexandrie, qu'ils imitèrent avec tant de complaisance. Je ne les appellerai
point des courtisans, si l'on veut, mais à coup sûr
ce ne sont point des républicains; ils ont l'âme monarchique.
Ils aiment la paix, ils célèbrent Auguste qui en
est l'auteur : c'est un dieu pour eux.
Ces loisirs, ils les consacrent à la lente et patiente
composition de leurs oeuvres, leur vie s'y consume.
Nul Romain n'avait encore été homme de lettres à
ce point et si absolument. Ce soin passionné d'écrire
et de bien écrire est un nouveau signe du temps. Les
grands sujets d'intérêt général et populaire ne se présentent
plus à des esprits absorbés dans les recherches de
l'élégance et du poli : aussi ces grands artistes sont-ils à
peu près inconnus au peuple; ils le dédaignent d'ailleurs;
ils écrivent pour un petit nombre de gens délicats. Les
réunions littéraires commencent à se former à Rome ;
Horace se fait prier pour lire ses vers devant ce petit aréopage,
mais de plus en plus la mode en prévaudra; de plus
en plus les auteurs se tiendront en dehors du courant populaire,
et formeront dans l'État une caste à part. Ce
fut une des conséquences de l'établissement de la monarchie,
et une des plus fâcheuses. Horace lui-même n'y
échappa point. Voici le petit nombre de personnes pour
lesquelles il écrit et à qui il veut plaire :
« Que Sestius et Varius, que Mécène et Virgile, que
Valgius, que l'excellent Octavius, que Fuscus accordent à
ce que j'écris leur estime ; que j'aie aussi l'approbation
des deux Viscus : voilà ce que je souhaite. Je puis, sans
vouloir te flatter, te nommer avec eux, Pollion, toi aussi,
Messala, ainsi que ton frère ; vous Bibulus, Servius, sincère
Furnius, d'autres encore, hommes doctes et mes amis,
que je m'abstiens de nommer, à qui je voudrais plaire, dont je regretterais fort le suffrage s'il trompait mes
espérances. »
Les contemporains de Virgile et d'Horace. — Gallus. — Tibulle. Properce. — Ovide. — Varius. — Valgius. — AIbinovanus. Les didactiques.- Manilius. — Cornélius Severus. — Phèdre.
La plupart de ces personnages, cités par Horace,
étaient poètes ou du moins faisaient des vers. Tout le
monde en fait, dit Horace, docte ou ignorant. Rien n'est plus
facile en effet. C'était alors une mode, à peu près comme
chez nous vers le milieu du XVlIe siècle : poésies légères,
rimées avec soin, lues devant quelques amis indulgents, et
toujours applaudies. Je ne rechercherai pas curieusement
dans les auteurs anciens le nom de ces poëtes mondains
et les titres de leurs oeuvres perdues pour la plupart ;
ce qui importe, c'est de bien en marquer le caractère ;
celles qui ont survécu nous y aideront.
Horace et Virgile, Virgile surtout, ne remplissent pas
leurs vers de leur seule personnalité : Virgile cherche la
vieille Rome, Horace essaye de la peindre dans plus
d'une ode. Leurs contemporains de quelques années plus
jeunes et plus profondément pénétrés de l'esprit nouveau,
indifférence à la vie publique et égoïsme, ne voient plus
qu'eux-mêmes. Tels sont Gallus, Tibulle, Properce,
Ovide, ce dernier avec un caractère plus particulier. De là. la préférence accordée en poésie à un genre
tout nouveau, où Catulle seul s'était encore essayé, l'élégie.
L'élégie, qui avait été en Grèce tour à tour héroïque
et morale avec Callinos, Tyrtée, Solon et Théognis,
fut presque exclusivement voluptueuse chez les
Alexandrins. Le vrai modèle des Romains, ce ne fut ni
Callimaque, ni Philétas, mais Euphorion, le plus rapproché
d'eux par les années, le plus célèbre peintre des
tourments et des joies de l'amour. L'amour, voilà la
passion qui a hérité de toutes les autres ; voilà la principale
occupation de la génération nouvelle à qui le prince
a fait des loisirs.
Cornelius Gallus.
C'est l'amour que chantait ce Cornélius Gallus, ami
de Virgile, qui lui a dédié une de ses plus belles bucoliques
(la 10e). Gallus, chevalier romain, né en 685,
comme Virgile, à Fréjus, fut nommé, par Auguste, préfet
d'Egypte, tomba en disgrâce, fut accusé de haute trahison,
et prévint l'exil par une mort volontaire. Remarquons
en passant que sous le nouveau régime il y a
des condamnés, et pas de procès. Nous ne savons quel
était le crime de Gallus ; nous ne saurons pas non plus
quel était celui d'Ovide. Gallus se tua à quarante ans.
Il laissait quatre livres d'élégies, dans lesquelles il
chantait sa passion pour Lycoris. Cette Lycoris était, dit-on,
une joueuse de mime célèbre, appelée Cythérea, et
qui avait été la maîtresse du triumvir Antoine. Ces élégies
ont péri. Sous le nom de Gallus nous en possédons six,
qui sont évidemment d'un autre poëte et d'une époque bien postérieure : on les attribue à un certain Maximianus.
On sait seulement que Gallus avait pris pour modèle
l'Alexandrin Euphorion de Chalcis, le père de toute
cette littérature érotique.
Tibulle (Albius Tibullus).
Nous possédons les Élégies de Tibulle (1), et c'est un
bonheur pour nous, elles sont charmantes.
(1) Les oeuvres et la personne de Tibulle donnent lieu à plus d'un doute.
La date de sa naissance n'est pas fixée. Parmi les quatre livres d'Élégies
publiées sous son nom, il y en a deux, le 3e et le 4e, qui sont rejetés
comme apocryphes par un certain nombre de commentateurs. M. de
Golbéry, le dernier éditeur français (Collection Lemaire, tome CVII) nous
semble trop facile à admettre l'authencité de ces deux livres. Peut-être
les érudits allemands s'étaient-ils montrés trop difficiles. J'avoue cependant
que ces deux livres me semblent bien peu dignes des deux premiers.
Quant au panégyrique de Messala, en vers hexamètres, je
l'accepterais comme authentique, en le reportant aux premières années de Tibulle. Le nom et la condition des maîtresses de Tibulle ont aussi
été l'objet de dissertations savantes, qui ont leur intérêt. Je ne puis les
exposer ici.
Quelques
mots d'abord sur ce poëte. Il appartenait à l'ordre
équestre, s'appelait Albius Tibullus, et était originaire
de Pédum, (aujourd'hui Zagarola), ville située entre Tibur
et Préneste. Lui aussi, comme Virgile et sans doute
Horace, fut victime des guerres civiles : son patrimoine
lui fut enlevé en partie du moins, et passa entre les
mains des vétérans. Cependant il put sauver du naufrage
quelques débris, ou son puissant protecteur Corvinus
lui fit restituer ses biens, puisque Horace lui écrivait :
« Les dieux t'ont donné la richesse et l'art d'en jouir. »
Il fit partie de la cohorte qui suivit Messala en Gaule et
en Asie. Étant tombé malade à Corcyre, il ne put
achever le voyage et revint en Italie où il mourut
vers 735.
Il était l'ami d'Horace qui lui adressa une ode et une épître. L'épître n'est qu'un billet, d'une grâce charmante.
Horace y appelle Tibulle « juge bienveillant de
ses satires ». Il me semble difficile d'admettre après
cela que Tibulle n'est né qu'en 710, c'est-à-dire vingt et
ans un après Horace. Quelle apparence qu'Horace érige
en juge de ses écrits un enfant de 17 ans? Car cette
épître remonte à l'an 727. Pour moi je croirais volontiers
que Tibulle est né vers 695, et qu'il avait alors
environ trente-deux ans. Il mourut sept ou huit ans après,
vers quarante ans. Mais laissons ces questions de chronologie.
Voyons l'oeuvre du poête.
Tibulle n'a vécu que pour l'amour. Il a d'abord été
dupe de l'hypocrisie générale de son temps, de ces faux
semblants de vie publique qui suffisaient aux contemporains
d'Auguste ; et lui aussi il a songé à entrer dans
la carrière des honneurs. Il s'attacha donc à Messala
Corvinus, fit avec lui une campagne en Gaule et s'embarqua
avec lui pour l'Asie. Mais ni les temps, ni
l'humeur de Tibulle n'en firent un vrai citoyen. Il veut
célébrer son patron, chose assez facile après tout. Il suffit
d'évoquer les vieux souvenirs de Rome républicaine et
de peindre son héros en pensant à Scipion ou à Camille.
Mais de tels éloges n'étaient sans doute plus à
la mode, c'étaient des vieilleries sans grâce. Aussi Tibulle
compare-t-il Messala à Ulysse, à Nestor, aux héros de
l'épopée homérique ; il fait une érudite analyse de l'Odyssée,
et immole à son patron les rois de Pylos et d'Ithaque.
Nous voguons en pleine mythologie; le faux déborde. Aussi bien l'esprit du poëte est ailleurs. Il se soucie aussi
peu de la gloire de Messala que de la sienne propre. Il
est amoureux et chante ses amours. Il n'a plus que du
mépris pour les vaines agitations des mortels, comme s'il
y avait autre chose au monde qu'aimer et être aimé !
Qu'est-ce que la fortune, mère des succès et des alarmes
? C'est dans une douce médiocrité qu'est le bonheur.
Vivre dans son petit domaine, voir grandir et jaunir ses
moissons, entendre dans son lit le rugissement des vents
et serrer sa maîtresse sur son coeur : voilà la vraie félicité.
Que Messala aille faire la guerre, qu'il rapporte
les dépouilles des ennemis et les attache à sa maison :
pour Tibulle il est dans les fers d'une belle fille, et
fait le siége de sa maison. Il en est le portier. Quelle
folie que d'aller braver la mort sur les champs de bataille
! Elle est toujours là près de nous, on ne l'entend
pas venir, et la voilà ! Qu'elle vienne donc, quand il
plaira aux dieux. Il mourra dans les bras de sa maîtresse,
elle le pleurera ; mais, tant que l'âge sourit, il faut aimer,
il faut se livrer aux douces luttes. C'est là que Tibulle est
bon général et bon soldat.
Celle qu'il aime porte différents noms, c'est d'abord
Délia, puis Néaera, puis Némésis, peut-être Sulpicia,
et Glycéra. Qu'est-ce que ces femmes ou cette femme ?
Il paraît que sous Délia se cachait Plania, descendante
d'une des plus nobles familles de Rome, comme Sulpicia.
Mais qui pourrait se flatter de retrouver la chronique
scandaleuse d'une telle société ? Ce qui importe ici,
c'est de découvrir un côté des moeurs du temps. Il y
avait alors trois classes de femmes à Rome : les filles de
parents libres à quelque classe qu'ils appartinssent, les
affranchies, les courtisanes. Le costume les distinguait, c'était à peu près tout. Tibulle aima des matrones, des courtisanes et des affranchies, peut-être pis encore.
Mais, de quelque rang qu'elles fussent, il semble bien
facile de les confondre. Délia était de noble famille.
Elle trompait à la fois son mari et ses amants. Que d'infidélités
lui reproche Tibulle, et que d'audace ! Mais
ce que déplore surtout le poëte, c'est l'avidité de ses
maîtresses. « Hélas! hélas! s'écrie-t-il, je vois que
les femmes n'aiment plus que l'argent ! » — «A quoi servent
les élégies, et les vers inspirés par Apollon? Elle
tend la main et demande un autre salaire. » Que fera
donc le malheureux poëte? « Plutôt que de rester
plaintif étendu sur ce seuil insensible qui le repousse,
il commettra un meurtre, il ira dépouiller les temples,
surtout celui de Vénus. » On voit que son désespoir
ne lui ôte point l'esprit. De tous les élégiaques latins,
Tibulle est le plus touchant, le plus vrai, et il ne l'est pas
encore assez. Une strophe de Sapho a plus de flamme
que ses deux livres d'élégies. Ame faible, même en
amour, Tibulle est languissant, mélancolique sans élévation.
Il avait de prompts désespoirs qu'il aimait à faire
connaître ; toujours près de mourir et revenant vite à
la vie. Ces esprits passionnés, faibles et légers, font
mieux comprendre la vigueur originale d'Horace. Lui
aussi a connu les Délia, les Néæra, et tant d'autres ;
lui aussi a été trompé, a maudit les dieux et sa maîtresse,
mais pendant une heure ou deux. Quoi de plus noble
et de plus élevé dans sa tristesse que le début de cette
ode? « C'était la nuit, dans le ciel serein brillait la lune parmi les étoiles moindres : c'est alors que, prête à offenser par un parjure la majesté des grands dieux, tu répétais après moi les paroles du serment. Et tu me serrais dans tes bras plus étroitement que le lierre ne s'attache au chêne puissant. » Quoi de plus dégagé
que les derniers mots : « Ah ! tu pleureras aussi la
fuite de tes amours, et moi à mon tour j'en rirai ! »
C'était un conseil de ce genre qu'Horace donnait à Tibulle,
victime de la perfidie de Glycère : « Albius, cesse
donc de gémir, et d'invoquer toujours le souvenir de la
cruelle Glycère ; cesse de te répandre en élégies plaintives,
parce qu'un amant plus jeune sourit plus au goût
de l'infidèle. » Et il se citait en exemple, lui qui eût
pu aimer et être aimé en meilleur lieu et qui restait dans
les fers de l'affranchie Myrtalè.
Tibulle a donc l'âme plus sensible, si l'on veut, qu'Horace
; ou plutôt il n'a pas ce ressort énergique de son
ami. Il ne voit rien au monde que les Délie, les Némésis,
les Néaera et se montra digne de vivre sous le principat.
Ses élégies, envisagées sous ce point de vue, sont curieuses
à étudier, et laissent dans l'esprit une vraie tristesse.
Voilà donc, se dit-on, ce qu'étaient devenus les
fils de ceux qui combattaient Mithridate, Sertorius, Jugurtha
! Voilà les inspirations de la poésie nouvelle !
PROPERCE.
(Sextus Aurelius Propertius. )
Le nom de Tibulle appelle celui de Properce. Les deux
poëtes étaient du même âge, ils sont morts à peu près en même temps; ils ont chanté les mêmes sujets. Properce ne fut même pas tenté d'aborder la vie publique; il ne s'attacha point à un patron illustre ; il ne songea point à servir dans les armées ; et de bonne heure « Apollon lui interdit de faire entendre sa voix au forum. » . C'était un épicurien peu délicat. Son père avait été victime des proscriptions qui suivirent la guerre de Pérouse;
Properce n'en célébra pas moins les exploits et les vertus
d'Auguste. Il faisait partie du groupe de lettrés qui
étaient bien vus de Mécène et de l'empereur. Je croirais
volontiers cependant que Virgile, Horace et Tibulle goutaient
peu son caractère, sa conversation et son esprit.
Properce est d'une vanité exubérante : il félicite l'Ombrie
de lui avoir donné le jour ; « qu'elle s'enfle, qu'elle
s'enorgueillisse à jamais de sa gloire : elle est la patrie
du Callimaque romain. » Et, ailleurs : «Je suis le premier
prêtre qui de la source pure ai transporté dans les
cérémonies italiques les danses sacrées de la Grèce. »
Il oubliait volontiers que Catulle avait eu cet honneur
avant lui, que Gallus et Tibulle le valaient bien, et que
la modestie est l'apanage du vrai mérite. Mais c'était un
Ombrien, que Rome et la société polie avaient bien pu
décrasser, mais qui conservait encore je ne sais quoi de
l'âpre saveur du terroir. Aussi nul de ses contemporains
ne chanta ses louanges; on trouva sans doute qu'il
s'acquittait trop bien de ce soin. Voilà, si je ne me
trompe, sa physionomie dans le cercle des poëtes du
temps. Il parait moins effacé que Tibulle, moins intéressant.
Tibulle était beau, délicat et comme paré d'une
douce mélancolie ; Properce a plus de relief et d'énergie,
mais souvent la grâce lui manque et la mollesse.
Et d 'abord, s'il n'a composé que des élégies, plusieurs
d'entre elles ont une tendance héroïque. Je ne parle pas
seulement de celles où il célèbre la gloire d'Auguste
et celle de Mécène. Il a essayé de tracer un tableau assez terne des lieux où devait s'élever un jour Rome.
Je n hésite pas à croire qu'il a eu connaissance de l'Énéide
; on sait que c'est lui qui annonça l'oeuvre dans ce distique fameux : Retirez-vous, poètes romains, retirez-vous, poëtes grecs : il va naître je ne sais quoi de
plus grand que l'Iliade. On retrouve donc en lui
quelque chose qui ressemble à une inspiration patriotique.
Bien qu'il déclare sans cesse que sa faible muse ne saurait aborder ces grands sujets, il s'y essaye cependant,
et monte à une certaine hauteur. Il retombe vite, parce
que Callimaque et Philétas, ses modèles chéris, le rappellent
à eux, c'est-à-dire sur terre. Mais c'est là une partie
de son originalité : l'ombrien se ressouvient du vieil Ennius,
et y fait penser : « Il a, en effet, comme il le dit
lui-même, approché sa lèvre faible des sources puissantes
où le grand Ennius, altéré, avait bu. » Et, ailleurs
: « Qu'Ennius couronne ses vers de la rude feuille
du laurier, pour moi, ô Bacchus, présente-moi la modeste feuille du lierre. » Je signale d'autant plus volontiers
ce côté de son oeuvre, que nous sommes au seuil
même du néant politique.
Restent les élégies amoureuses. La maîtresse de
Properce, c'est Cynthia. Suivant quelques commentateurs,
son vrai nom était Hostia, elle était petite-fille du
poëte Hostius. Suivant toute probabilité, c'était une affranchie et des plus légères. Properce ne cesse de gémir
sur les nombreuses infidélités de Cynthia ; mais il préfère
encore ces petits désagréments aux ennuis et aux
dangers d'un commerce avec une matrone ; en cela, on le
sait, il était de l'avis d'Horace et pouvait passer pour un
homme de moeurs réglées. Mais peut-être était-ce là une
concession faite à Auguste, prince moral, qui tenait beaucoup à ce que les apparences fussent sauvées. Il n'était
pas riche, on le doit supposer, ou Cynthia aimait fort
l'argent; car il se voit à chaque instant évincé par un
rival plus opulent. Aussi regrette-t-il naïvement les anciennes
moeurs, simples et frugales. Combien les premiers
humains savaient mieux aimer au sein des forêts! Cynthia
guettait à leur retour des provinces les préteurs enrichis,
et n'en faisait qu'une bouchée. Properce en était bien
quelque peu affligé, mais cela ne l'empêchait pas de
donner à sa maîtresse des conseils assez étranges. «Si
tu as de l'esprit, ne laisse pas échapper cette bonne
aubaine, enlève à ce sot animal toute sa toison. » Ici
encore se retrouve l'Ombrien, peu délicat et parfois grossier.
Tibulle n'eût jamais parlé de ce ton. Deux détails
encore, et je finis sur ce sujet. Properce se lamente
souvent sur la corruption des femmes de son
temps, et il en cherche les causes : c'est l'amour du luxe
d'une part, et, de l'autre, les peintures légères que l'on
met sous les yeux des jeunes filles. Les appartements
en sont remplis. Quelles étaient ces peintures? On en
a découvert de bien monstrueuses à Herculanum. Y
en avait-il de semblables à Rome ? Properce ajoute à ces
causes de démoralisation précoce les fameux bains de Baïes,
déjà signalés par Cicéron comme une école de corruption.
Il nous semble que Cynthia eût trouvé Baies partout. Je
signale en passant une autre élégie, la 7e du lIe livre.
Cynthia et Properce se réjouissent ensemble de la suppression
de la loi Julia de Maritandis ordinibus. Auguste
avait voulu imposer le mariage aux célibataires; des
protestations s'élevèrent de tous côtés; il fallut rapporter
la loi. La joie de Properce est entière. Il ne sera pas
forcé de se marier! Lui, père de famille! et pourquoi cela? Est-il chargé de procréer des soldats à l'empereur
pour orner son triomphe? L'amour de Cynthia lui suffit.
Il faut lire cette élégie malheureureusement incomplète.
L'ironie et le mépris des devoirs du citoyen et de
l'homme y percent à chaque vers. Voilà un commentaire éloquent des réformes morales opérées par Auguste !
Tel est l'homme, tel est l'esprit de l'oeuvre. Quant à la forme, elle est évidemment fort inférieure à celle de
Tibulle. Properce est un pur disciple des Alexandrins,
comme il s'en vante. C'est un érudit. De là une froideur
réelle dans un genre où la passion seule doit parler. A
propos des trahisons de Cynthia, il raconte l'histoire de
la chaste Pénélope ; s'il veut peindre son désespoir, il
rappelle que Hémon, ayant perdu Antigone, se donna la
mort; qu'Achille, privé de Briséis, laissa massacrer les
Grecs. Il accuse Romulus d'avoir donné un fort mauvais
exemple en enlevant les Sabines : on sent que tous
ces souvenirs mythologiques sont pour lui non une broderie,
mais le tableau même. Là encore nous retrouvons
le provincial, qui étale avec complaisance toute
sa richesse. La mesure et la distinction sont absentes. L'auteur
veut paraître, et on oublie l'homme. Cependant
l'expression est plus forte que chez Tibulle, et souvent
aussi moins naturelle. La versification est régulière,
mais non sans quelque hardiesse.
OVIDE (PUBLIUS OVIDIUS NASO.)
L'homme.
Ovide, le plus jeune des poëtes de la nouvelle école,
en est le roi. Nul ne la représente plus exactement.
Jamais homme ne fut plus de son temps que celui-là. Il est le type de ces esprits faciles et aimables qui s'ouvrent
à toutes les influences du moment, et rendent immédiatement
ce qu'ils ont reçu, à peu près comme ils l'ont
reçu. On se figure volontiers le poëte isolé et cherchant
les hautes cimes, voisin du ciel et loin des hommes. Si
on eût transporté Ovide sur ces hauteurs, il s'y fût consumé
d'ennui. A l'air vif des sommets il préférait la
tiède atmosphère des salons, aux splendeurs du soleil levant,
les douces lueurs des lampes éclairant les festins et
les conversations mondaines. Voilà ce qu'il faut bien
se dire avant de le juger. La sévérité ici serait injuste
et toucherait au ridicule. Il faut mesurer les gens à leur
mesure, et ne pas demander aux oiseaux gracieux de nos
volières l'oeil de feu et l'aile puissante de l'aigle.
S'il n'avait été exilé, l'histoire de sa vie pourrait s'écrire
en deux mots : il fut amoureux et fit des vers. Si nous
en savons un peu plus, c'est à lui que nous le devons. Il était
d'un naturel expansif, et tout lui était matière à poésie. Il
nous apprend donc (1) qu'il est né à Sulmone, ville des
Péligniens, l'année où « moururent d'une même mort les
deux consuls » (Hirtius et Pansa, en 711), que sa famille
était riche et appartenait à l'ordre équestre.
(1) Tristium lib, IV. Eleg. X.
De bonne
heure amené à Rome, il y suivit les leçons des grammairiens
et des rhéteurs à la mode, et, pour complaire à son
père, se prépara à aborder la vie publique. Il fut, en effet,
triumvir, centumvir et décemvir, noms anciens, fonctions
nouvelles ; mais son respect filial et son courage ne
purent aller plus loin. Le Sénat allait s'ouvrir pour le
recevoir, mais il fuyait l'ambition et ses soucis. « Les
filles d'Aonie le sollicitaient à rechercher les loisirs et la sécurité, biens préférables à tous les autres. » Le voilà
donc qui abandonne le forum, les tribunaux, les jurisconsultes,
et recherche la société des poëtes. « Autant
j'en voyais, dit-il, autant je croyais voir de dieux. » Il
ne fit qu'apercevoir Virgile, connut quelque peu Horace,
fut lié avec Properce ; Tibulle mourut trop tôt pour qu'il
pût devenir son ami. A peine âgé de vingt ans, il est
; déjà connu et recherché. En vain son père lui représente
« que les Muses n'ont jamais enrichi leurs adorateurs,
qu'Homère est mort sans laisser aucune fortune », Ovide
ne put l'écouter. Il ne pouvait écrire en prose, les vers
naissaient sous sa plume, se pliant d'eux-mêmes à la mesure
: « tout ce qu'il essayait de dire se transformait en
vers. » Il disait vrai. Il n'y a pas d'exemple d'une pareille
facilité, elle devint une véritable tyrannie, et dès lors
il fut impropre à toute autre chose qu'au métier de poëte.
Sénèque, le Rhéteur qui le connut dans le temps où il suivait
les leçons d'Arellius Fuscus et de Porcius Latro, nous
apprend que déjà alors son langage n'était autre chose que
vers brisés. « Il déclama une controverse avec beaucoup
d'esprit, seulement il n'y avait aucun ordre dans ce
qu'il disait, il courait cà et là; toute argumentation lui
déplaisait. »
Il vécut vingt-cinq ans de cette vie mondaine qui lui
était si chère, goûté, recherché, lisant ses vers dans
des réunions où il était applaudi, savourant les plaisirs
qu'offrait alors la société romaine, dont il était le plus
brillant et le plus spirituel représentant, lorsqu'il fut
tout à coup relégué par Auguste à Tomes, chez les Gètes,
aux extrémités de l'empire. Quelle fut la cause de ce châtiment ? il est fâcheux pour Auguste qu'on la cherche
encore. Le poëte protesta jusqu'à la mort contre la rigueur
de la peine et ne se reconnut jamais coupable que d'imprudence,
il ajoute même d'imprudence involontaire.
« Mes yeux, dit-il, ont vu involontairement un crime :
voilà pourquoi je suis puni ; ma faute, c'est d'avoir eu
des yeux. » Et ailleurs : « Pourquoi ai-je vu quelque
chose ? Pourquoi mes yeux ont-ils été coupables?
Pourquoi, sans le vouloir, ai-je eu connaissance d'un
crime ! » Qu'a-t-il donc vu ? Il fut probablement témoin
et peut-être complice des désordres de Julie, petite-fille
d'Auguste qui, cette même année, fut convaincue
d'adultère et exilée. Il reconnaît d'ailleurs qu'Auguste
punit lui-même une offense personnelle comme il en avait
le droit. Peut-être
à ces scandales de la maison impériale se mêlèrent
des intrigues d'ambition. Livie et son fils Tibère étaient
capables de tout : ils avaient déjà fait exiler Agrippa Postumus,
petit fils de l'empereur, et le firent bientôt égorger.
Ovide eût été enveloppé dans un coup d'État de famille.
Quoi qu'il en soit, pour mieux dissimuler les motifs réels
du châtiment, Auguste fit retirer des bibliothèques publiques
les oeuvres du poête, qu'elles eussent déshonorées
apparemment, hypocrisie dont nul ne fut dupe. Que n'y
avait-il pas dans ces bibliothèques ? Qu'on voie ce qu'en
disait Ovide.
On pense bien qu'il ne supporta pas fort courageusement
une telle disgrâce. Un homme comme lui ne pouvait vivre
qu'à Rome. Il fatigua de ses plaintes et de ses supplications
Auguste et ses amis : l'empereur mourut sans pardonner. L'avènement de Tibère enleva à Ovide toute espérance,
il se borna dès lors à demander un lieu d'exil
moins rigoureux, et il ne put l'obtenir. Après huit ans de
souffrances et de vaine attente, il mourut à Tomes, âgé
de 59 ans (770). Les barbares, parmi lesquels il vivait,
étaient devenus ses amis et ses admirateurs. Il avait appris
la langue du pays et écrivait en langue gétique des
vers qui ravissaient les indigènes.
L'OEUVRE.
Bien que tous les poëmes d'Ovide portent l'empreinte
évidente d'un même esprit, je les diviserai en deux
classes les uns que j'appellerai poëmes légers, badins,
ce sont les Élégies amoureuses, l' Art d'aimer, les Remèdes
contre l'amour, les Cosmétiques du visage, les Héroïdes ; les autres, ayant évidemment des prétentions au sérieux,
sont les Métamorphoses, les Fastes, les Tristes, les Pontiques. Quant à Ibis et aux Halieutiques, ce ne sont que
des fragments sans importance ; et de la tragédie de
Mëdée nous ne possédons qu'un vers.
Les élégies amoureuses, publiées d'abord en cinq
livres, puis en trois, sont le début du poête. Il avait
27 ou 28 ans. Comme ses prédécesseurs, Catulle, Gallus,
Tibulle, et Properce, il chanta les menus événements de
sa passion pour Corinne, c'est le nom qu'il donna à sa
sa maîtresse. Était-ce une affranchie, une courtisane ?
Un reste de pudeur publique interdisait aux poètes de
prendre des matrones pour héroïnes de leurs vers : il
est bien difficile cependant de ne pas voir dans la
Corinne de l'élégie ive du leI livre une femme mariée, placée entre son amant et' son mari. Ailleurs, Corinne
sera une affranchie, pis que cela même, mais qu'importe
au poête ? Ses élégies ne jaillissent point de son coeur ;
c'est un jeu d'imagination et d'esprit. Il met à la suite
l'une de l'autre les petites scènes d'intérieur galant dont
il a été le témoin ou le héros, peu soucieux de l'unité de
ton et de couleur. Si la passion profonde et vibrante
lui fait défaut, l'imagination saura bien y suppléer. Elle éclate déjà dans cette première oeuvre avec une richesse
merveilleuse. La situation la plus simple fournit au
poëte des développements ingénieux qui ne tarissent pas.
Le dernier mot du vers éveille une idée ; il la saisit,
l'expose, la reprend, la présente sous une nouvelle
forme, la met en lumière par un rapprochement mythologique,
par une comparaison, puis passe à une autre,
et y applique les mêmes procédés. Ovide est déjà tout
entier dans cette première oeuvre, c'est un peintre d'esprit
qui ne sait pas composer un tableau, mais qui en
réunira cinq ou six dans le même cadre. L'ensemble est
choquant d'invraisemblance. Regardez de plus près ;
chaque esquisse, prise à part, est délicieuse. Ajoutez
à cela la fluidité d'un style que rien n'arrête, qui sait
tout dire, qui ose beaucoup sans en avoir l'air; l'extrême
liberté des images, sans grossièreté crue, l'art de ne
supprimer aucun détail et de les voiler suffisamment.
La poésie érotique mondaine est créée. Le ton du badinage
graveleux est trouvé. Ovide est le gentil Bernard
et le Parny du siècle d'Auguste vieillissant. Il ne
chante pas l'amour, mais le plaisir : il ignore la passion,
mais il a la grâce, la légèreté, l'esprit. C'est l'idéal de la
littérature de boudoir, qui ne peut naître qu'à de certaines
époques. Il dresse lui-même quelque part un catalogue des ouvrages qu'il faut mettre dans les mains d'une
femme qu'on veut préparer à l'amour, et il n'a garde
d'oublier ses élégies et son poëme sur l'Art d'aimer
Qu'on me permette de dire que celui-ci est un chef-d'oeuvre, le genre une fois admis. Ovide est ici dans
son élément ; il traite un sujet fait pour lui, il a trouvé
sa vraie voie. Aussi je ne sais s'il y a dans toute la littérature
latine beaucoup d'oeuvres aussi originales que celle-là.
De modèles, je ne lui en connais point, il n'a que
faire des Grecs en pareille matière. Les éléments de son
poëme il les a sous les yeux ; la science qu'il enseigne, il
l'a pratiquée depuis vingt ans et y est passé maître. Enfin
son style léger, brillant, spirituel est le seul qui convienne.
Tout se réunit pour produire une oeuvre accomplie,
mais quelle oeuvre ! Ce n'est pas au fond autre
chose que le code de la séduction et de la galanterie à
Rome, au milieu du huitième siècle. Peu d'ouvrages
plus instructifs que celui-là et moins édifiants. Nous voilà
d'emblée introduits au coeur même de la corruption
romaine, non par un déclamateur passionné, comme
Juvénal, mais par un poëte à bonnes fortunes qui, au
lieu d'écrire ses mémoires galants, résume en préceptes
légers l'expérience de sa vie amoureuse. J'ai dit que
jamais homme ne fut plus de son temps que celui-là.
Ëcoutez-le
«Que d'autres soient charmés de l'antiquité ; pour moi je me réjouis d'être né de nos jours : voilà bien le siècle qui convenait à mon caractère. Non parce qu'on arrache aujourd'hui à la terre l'or qu'elle
recèle, parce qu'on rapporte de tous les rivages les coquillages précieux, parce qu'on fouille les monts
pour en arracher le marbre, ou que la mer se retire devant nos maisons de plaisance. Non. Mais aujourd'hui fleurit la politesse, il ne reste plus rien de l'ancienne rusticité que l'on a laissée à nos vieux aïeux. »
Voltaire disait aussi :
"Regrettera qui veut le bon vieux temps :
Ce temps profane est tout fait pour mes moeurs.
Ah ! le bon temps que ce siècle de fer !"
Cette politesse moderne a bien son mauvais côté cependant.
«Nous vivons vraiment dans l'âge d'or, s'écrie-t-il, ailleurs : c'est l'or qu'on honore avant tout, c'est
l'or qui fait aimer. » Il faut à un amant pauvre du
mérite pour plaire. Ovide lui enseignera l'art de suppléer
à la fortune par l'esprit, et de se faire aimer presque
gratis. On comprend que je ne puis analyser ce
poëme : un trait ou deux suffiront pour en marquer le
caractère. Ovide n'enseignera point l'art de se faire
aimer des matrones: «loin d'ici, légères bandelettes, parure
de la pudeur, loin d'ici la longue stole qui couvre
les pieds de la matrone : je ne chante que les amours
permises, les galanteries autorisées (par les lois), il n'y
aura dans mes vers rien de criminel. » Après cet
hommage rendu en passant aux lois d'Auguste, simple
formalité, il entre dans son sujet. « On trouvera à Rome,
dit-il, autant de belles femmes que dans tout le reste du
monde ; il y en a autant que d'étoiles au ciel, de poissons
dans la mer. On voit bien que Vénus habite la ville
de son fils Énée. Sortez de chez vous et faites votre
choix. — Allez sous les portiques, dans les théâtres,
au cirque, dans les temples, surtout ceux de Vénus et,
d'Isis, assistez aux sacrifices en l'honneur d'Adonis, mais
c'est aux spectacles surtout que le choix est plus
facile : là elles viennent moins pour voir que pour être vues. Vous les rencontrerez aussi à Baies, dans les
festins et les réunions. Vous vous assoirez près d'elles
au théâtre, au cirque, vous mettrez un petit banc sous
leurs pieds, vous parierez pour le cheval qu'elles préfèrent.
Voilà les moeurs de la Rome impériale ; voilà
ce qui charmait Ovide et ses contemporains ; voilà ce
qu'il a chanté. Je m'arrête au moment où la connaissance
est faite entre les deux amants, connaissance
bientôt suivie de la conquête de l'un des deux, on ne
sait lequel, par l'autre. Ovide, enchanté de cette première
partie de son oeuvre, s'écrie : « Que dans sa joie
l'amant couronne mes vers d'une verte palme ; que je
sois préféré au vieillard d'Ascrée, au vieillard de Méonie
(Homère et Hésiode). » On est tenté de crier à la profanation.
Mais ces grands noms n'effrayent point Ovide :
il se regarde naïvement comme le successeur de ces
hommes divins ; il en diffère seulement par le choix des
sujets. Ici nous touchons un des côtés les plus curieux
de l'oeuvre du poëte, et il me semble qu'il n'a pas été
assez remarqué jusqu'ici. Il n'y a point de poëme didactique,
et l'Art d'aimer en est un, qui soit une
simple exposition de préceptes : épisodes, digressions,
tableaux, récits, tout ce qui peut jeter de la variété dans
l'oeuvre en fait naturellement partie. Ovide en cela a
imité ses devanciers; on peut même dire que chez lui les
ornements l'emportent sur le fonds. Mais où va-t-il les
prendre ? Il semblerait tout d'abord qu'il dût les emprunter
à la chronique scandaleuse de son temps. Il n'en est
rien; c'est l'antiquité héroïque et mythologique qu'il met
à contribution. Il sait quel était le genre de beauté de
toutes les héroïnes des âges primitifs, ce que leurs époux
et leurs amants admiraient en elles ; il a pénétré dans l'alcôve d'Hector et d'Andromaque; il sait ce qui se passait
sous la tente d'Achille, quand Briséis le recevait couvert
du sang des Troyens. Il raille ce vieil Homère qui a fait respecter
Briséis par Agamemnon; il déclare que cela n'est pas,
et que pour lui il n'eût pas été si sot. Il raille Ménélas et félicite
l'heureux Pâris. S'il abandonne les antiques légendes
de la Grèce, c'est pour se rabattre sur celles du Latium.
L'enlèvement des Sabines pendant les jeux le charme ;
il convie les Romains de son temps à imiter les compagnons
de Romulus. Figurez-vous la Bible mise en madrigaux
folâtres par un Hébreu, voilà ce que deviennent
sous les mains d'Ovide les traditions religieuses et héroïques
de la Grèce et de Rome. Le contraste entre les
moeurs du jour et celles des anciens âges donnait plus de
piquant à son oeuvre, il faisait preuve d'esprit et d'érudition
à la fois. Le moyen pour lui de résister à cette double
tentation !
Supposez maintenant une série de petits poëmes
dans lesquels ces brillants hors-d'oeuvre, au lieu d'être
l'accessoire, soient le sujet même, et vous aurez les Héroïdes : il ne se péut rien imaginer de plus faux et de
plus spirituel que ces poëmes. Il se glorifie d'en être
l'inventeur, et il eut bientôt des imitateurs. En effet, sur
les 21 héroïdes qui portent son nom, il y en a plus de
la moitié qui ne sont pas de lui, mais d'un certain Sabinus,
son disciple. Ces héroïdes sont des lettres en
vers élégiaques écrites à leur amant ou à leur époux
par les héroïnes célèbres de l'antiquité : Pénélope à
Ulysse, Phyllis à Démophon, Oenone à Pâris, Canacé
à Macareus, Hypsipyle à Jason, Ariane à Thésée, Phèdre à Hippolyte, Didon à Énée, Sapho à Phaon. Sabinus
avait imaginé de faire les réponses des héros. C'est
un ouvrage de la première jeunesse d'Ovide. Il sortait
des écoles de déclamation ; il déclama en vers,
puisqu'il ne le pouvait en prose, et sur des questions
d'amour, puisqu'il n'en pouvait traiter d'autres. Les
héroïdes ne sont pas autre chose en effet que des Suasoriae.
Nous savons par Sénèque qu'Ovide préférait de
beaucoup les Suasoriae aux Controversiae, parce que
toute argumentation lui déplaisait. Il fit parler des
femmes, au lieu de faire parler Sylla, Cicéron, Annibal.
Il leur donna beaucoup d'esprit, il en avait de reste, et
se préoccupa fort peu de la vérité historique ou héroïque.
Il n'emprunte aux anciens âges que les noms et
la situation des personnages ; il se charge de leur fournir
les sentiments et les idées qu'avaient les Corinnes de
son temps. 0 nobles et pures figures des siècles primitifs,
vous doutiez-vous jamais qu'on dût un jour vous
farder ainsi!
Les Remèdes d'amour, en un livre, parurent deux
ans après l'Art d'aimer. C'est ce qu'on pourrait appeler,
en style judiciaire, une récidive. Ovide cherche d'abord
de bonne foi et sérieusement les moyens de se guérir d'une
passion qui fait le tourment de la vie. Les philtres et les
incantations magiques étaient alors fort à la mode. Il
n'y croit pas et les condamne. Que reste-t-il donc?
Il reste le travail, l'action. Est-ce bien Ovide qui parle?
N'en doutez pas, aux grands maux les grands remèdes.
Il envoie notre amant malade au forum, il le condamne
à l'étude des lois, aux plaidoiries ; il va même jusqu'à lui ordonner d'aller faire la guerre contre les Parthes !
C'est l'oisiveté qui a causé tous les maux. Pourquoi
Egisthe a-t-il été adultère ? Parce qu'il est resté oisif à
Argos, au lieu de suivre les Grecs au siège de Troie.
« Il a fait ce qu'il a pu ; il a aimé pour ne pas rester à
rien faire. » A défaut des travaux du forum et de la
guerre, faites-vous chasseur, faites-vous laboureur. Voilà
de bien durs préceptes, avoue- t-il, mais c'est le seul
moyen de se guérir. Est-ce vraiment le seul? Ovide,
qui a tant d'esprit, n'en saurait-il trouver d'autre? N'en
doutez pas. Le naturel revient au galop. Le meilleur et
le plus sûr moyen de combattre l'amour, c'est d'aimer,
d'aimer ailleurs, s'entend. Voilà l'homoeopathie appliquée
aux blessures du coeur, et Ovide redevenu chantre
de la volupté, seul rôle qui lui convienne.
Au moment où Ovide fut condamné à l'exil, il se préparait
à publier un grand poëme qu'il croyait sérieux.
Ce sont les quinze livres des Métamorphoses. Il voulut,
dit-il, les jeter au feu, comme Virgile son Énéide, mais
il les épargna. Il demande grâce pour les fautes de
l'ouvrage que ses malheurs ne lui ont pas permis de
corriger. On ne se représente guère Ovide corrigeant
ses vers ; et il ne faut pas prendre trop au sérieux ses
doléances. Il m'est difficile, je l'avoue, de partager l'admiration
des critiques pour cette vaste composition. Il
leur a semblé qu'ils avaient enfin mis la main sur un
Ovide sérieux, épique, digne émule d'Homère et de Virgile.
N'auraient-ils pas dû se demander d'abord si le poëte
des Élégies et de l'Art d'aimer pouvait être à la hauteur
d une telle oeuvre ? Il en était absolument incapable.
Pourquoi ne pas le reconnaître? Il ne faut pas que l'hexamètre héroïque nous fasse illusion. Si l'extérieur de l'oeuvre a une apparence
de gravité, le fond reste ce qu'il est, un exercice
d 'esprit, un recueil d'anecdotes joliment racontées.
Est-ce un poëme épique ? Non, car l'unité de sujet
manque absolument. J'en dirai autant de l'unité d'action,
à moins que l'on ne prétende que les transformations
infligées à chacun des personnages mis en scène constituent
l'unité du sujet. C'en est l'uniformité et le vice
radical. Quel est le ressort du poëme ? Procède-t-il d'une
inspiration héroïque ou religieuse? En aucune façon.
De quelque côté que l'on se tourne, on ne peut rien
découvrir qui donne l'idée d'une oeuvre fortement conçue.
On est réduit à admirer l'art avec lequel le poëte
a su lier les uns aux autres des épisodes détachés pour
en former un semblant de tout. Mais ces soudures sont
puériles et inadmissibles : elles ne font que mieux ressortir
le caractère profondément artificiel et faux de
l'oeuvre. Ovide se propose de raconter les métamorphoses
subies par des personnages de l'antiquité, depuis le
Chaos jusqu'à Jules César. La première transformation
est celle de Lycaon changé en loup par Jupiter ; la
dernière est celle du père adoptif d'Auguste, changé en
astre. Il y a quinze livres. Chacun d'eux raconte trois ou
quatre métamorphoses, et chaque récit se termine
naturellement par une métamorphose. Tantôt c'est l'analogie
de la transformation qui amène le récit suivant,
tantôt c'est la différence. Parfois l'action se passe sous
nos yeux, le plus souvent un des personnages mis en
scène la raconte. Idée bizarre, sujet étrange et souvent
absurde. Ovide n'a pas même eu le mérite de l'invention.
Il avait parmi ses devanciers jusqu'à six modèles,
appartenant tous, cela va sans dire, à l'école d'Alexandrie : Corinna, qui avait écrit des livres de Transformations ; Callisthènes, qui avait écrit des
Métamorphoses ; Antigone de Caryste,
qui avait composé des Mutations ; Nicandre,
auteur d'un poëme du même genre,
et enfin Parthénius, le maître de Virgile, qui avait écrit
des Métamorphoses. Le genre fut bientôt
à la mode : il y eut des divisions et des subdivisions de
métamorphoses. Tel poëte chanta les hommes changés
en quadrupèdes ; tel autre les hommes changés en arbres
; celui-ci les hommes changés en oiseaux. Un certain
Boëus avait démontré dans un poëme de ce genre
que tous les oiseaux avaient été jadis des hommes.
Voilà les prédécesseurs et les modèles d'Ovide. Qu'il ait
été supérieur à chacun d'eux, je le crois aisément.
Mais que penser du choix d'un tel sujet? Qu'y a-t-il en
effet au fond de ces métamorphoses d'hommes en bêtes
ou en objets inanimés ? Un sens symbolique profond
ou naïf, une allégorie morale ou plus fréquemment encore
une conception naturaliste. Que la signification
primitive de ces mythes se soit perdue ou du moins
altérée par suite des progrès de l'anthropomorphisme
hellénique, cela est incontestable, et au point de vue de
l'art nous ne devons point le regretter ; mais qu'à cette
transformation nécessaire soit venue s'ajouter encore
cette suprême parodie des vieilles croyances religieuses,
que la nature tout entière, cet immense théâtre des
phénomènes et de l'activité humaine, ne soit plus
qu'une sorte de panorama fantastique, où l'homme n'apparaît
que pour se transformer en bête, en arbre, en
oiseau, il faut avouer qu'il n'est guère possible de pousser
plus loin l'inintelligence des grandes choses et la passion du joli quand même. Le joli, l'ingénieux, si
l'on veut, voilà en effet le caractère de l'oeuvre. C'est une
galerie de tableaux rangés par analogie de sujets. Le
dénoûment est toujours le même, mais les descriptions
varient. Ovide se plaît à montrer un homme devenant
par degrés loup, une femme devenant araignée ou laurier.
Il y a là une sorte d'anatomie spirituelle qui l'amuse.
Au fond il ne cherche pas autre chose. Vainement vous
attendriez-vous à trouver dans ces vers quelques-uns de
ces frémissements d'horreur religieuse, que Virgile a
connus : le sceptique et spirituel poëte ne songe qu'à
divertir. Il donne un spectacle avec de riches décors, il
parle aux yeux, il les éblouit. Que si parfois il met
l'homme en scène, avec ses passions et ses douleurs,
c'est le déclamateur de l'école de Porcius Latro, qui
parle : de beaux discours, comme ceux d'Ajax et d'Ullysse,
de belles dissertations pythagoriciennes contre
l'usage de manger la viande des animaux, quelques élégies par ci, par là, et l'oeuvre est terminée, la parodie
est complète.
Le poëme des Fastes est un peu plus sérieux, ce qui
n'est pas beaucoup dire. Il devait avoir douze livres correspondant
aux douze mois de l'année. Quelques critiques
ont supposé que les six derniers livres s'étaient perdus,
mais à tort; ils ne furent jamais écrits. Ovide avait
composé la première partie de son ouvrage au moment
où il fut envoyé en exil, et il déclare formellement que
sa triste destinée l'interrompit. On le comprendra sans
peine pour peu qu'on se rende compte de la nature du
poëme. C'est un travail d'érudition, d'archéologie. A Rome, Ovide trouvait tous les documents nécessaires pour
mener à bonne fin son entreprise. A Tomes, ils lui firent
défaut ; il se trouva réduit à ses propres ressources; et,
malgré tout son esprit, il ne pouvait improviser la science.
Comment fut-il amené à un travail de ce genre ? On sait quelle était pour la vie civile et religieuse des Romains l'importance du calendrier. Pendant plusieurs siècles, l'aristocratie s'en était réservé exclusivement la
connaissance, et s'en faisait un de ses plus puissants moyens de gouvernement. La réforme opérée par Jules
César fut poursuivie et achevée par Auguste en 755. Des
travaux considérables avaient déjà paru à cette époque
sur les antiquités nationales et religieuses de l'Italie.
Clodius Tuscus, L. Cincius, Cornélius Labeo, et enfin
le savant Varron, avaient publié sur ce sujet des livres de
vaste érudition. L'étude des Fastes de Rome touchait à
toute l'histoire romaine ; plus que chez aucun autre peuple,
la religion était intimement unie chez les Romains
aux moindres événements de la politique. Les anciens
annalistes en fournissaient des preuves à chaque page.
Avec Varron, la critique commença à essayer de relier
les usages de la vie civile et les cérémonies de la vie religieuse
aux traditions antiques du Latium et de l'Italie.
Voilà le sujet qu'Ovide songea à traiter à son tour.
Son érudition est évidemment de seconde main, mais elle
est précieuse pour nous qui avons perdu les originaux
consultés par lui. Est-il besoin de dire que le poëte se
proposa surtout d'égayer l'aridité du sujet par l'élégance
et la variété des ornements? Ici donc se retrouve toujours
le même esprit. Les légendes héroïques ou religieuses,
empreintes dans Virgile d'un caractère auguste et mystérieux,
sont par Ovide habillées à la moderne. L'énergie et la foi lui manquent. Qu'on lise, pour s'en convaincre,
dans le premier livre, tout ce qu'il dit des Carmentales,
d'Évandre, d'Hercule et de Cacus, et qu'on rapproche
ces cent vingt vers de ceux de Virgile. On ne comprend
guère qu'il ait employé dans un tel sujet le mètre élégiaque,
et lui-même s'en excuse à plusieurs reprises.
La meilleure raison qu'il donne de cette préférence, c'est
que l'hexamètre était trop pesant pour lui.
Pendant ses huit années d'exil à Tomes, il écrivit neuf
livres d'Élégies, les Tristes et les Lettres du Pont. Les
Tristes sont une espèce de mélodie plaintive que le poëte
se chante à lui-même : il ne les adresse à personne en
particulier, mais il les envoie à Rome. Sa femme, ses
amis, les liront ; peut-être les mettra-t-on sous les yeux
d'Auguste; et le tableau des souffrances du pauvre exilé
fera naître un peu de pitié dans le coeur du prince.
Les Épîtres du Pont sont adressées à des amis : ce sont des prières, des remercîments, des effusions de tristesse
et de désespoir. Il y a peu de lectures plus affligeantes
que celle de ces neuf livres d'élégies. Mais il s'en faut
que la misérable destinée du poëte cause seule la tristesse
qu'on ressent. Il y a toujours en nous une affliction réelle,
quand nous sommes témoins d'un malheur immérité ; à
cette affliction se mêle un autre sentiment, quand la victime
de l'injustice s'abaisse devant celui qui en est l'auteur.
Nous plaignons le malheur, nous regrettons qu'il
ne soit pas plus courageux. Nous nous sentons comme
atteints en notre dignité d'homme ; il nous semble
que, frappés comme Ovide, nous aurions eu du moins
la force de nous taire, que nous aurions su opposer à la force brutale du despotisme, cette suprême et certaine
vengeance, le mépris. Mais ce que nous appelons aujourd'hui
l'honneur était peu connu des anciens. Ils ne
rougissaient pas d'avouer ce qu'ils éprouvaient, dût
l'orgueil en souffrir, et d'implorer grâce. Cependant
Ovide est allé plus loin qu'aucun autre dans cet oubli de
la dignité personnelle. Cicéron était bien faible, bien
abattu pendant son exil ; mais il ne lui vint jamais à l'idée
de s'humilier devant Clodius. Il était à peu près certain
d'être victime de la cruauté d'Antoine, s'il ne rétractait
les Philippiques et n'implorait son pardon : cependant
nul parmi ses amis n'eût osé lui donner ce lâche conseil.
C'est que Cicéron avait l'âme d'un citoyen. Ovide a
l'âme d'un courtisan. Je n'ai pas encore montré le
Romain en lui ; peu de mots suffiront pour cela. Il est
romain, quand il chante l'art d'aimer; il est romain
quand il clôt la série des métamorphoses par celle de
Jules César en astre ; il est romain, quand il compose les
Fastes, commentaire poétique du calendrier réformé par
César et par Auguste ; il est romain, enfin, quand il célèbre
l'un après l'autre les portiques, les théâtres, les
cirques, les temples de Rome, construits ou embellis par
Auguste et les siens. Voilà son patriotisme : c'est justement
celui du courtisan, qui absorbe la patrie dans le
maître qu'elle s'est donné ou qu'elle subit. Mais peu de
poëtes, race légère, ont porté si loin l'adulation. Tous
les membres de la famille impériale sont pour lui autant
de dieux. Exilé, misérable, mourant, il n'ose se révolter
contre l'iniquité de son châtiment; il est juste, puisque
César l'a ordonné. Il se borne à demander quelques adoucissements
à sa peine. Le croira-t-on ? il implore un rapprochement
de Rome, pour être plus près des exploits et des vertus de César, et pouvoir les célébrer plus dignement
; car, à. cette grande distance, l'inspiration s'affaiblit,
il risque de ne pas se tenir à la hauteur du sujet :
voilà sa dernière et constante préoccupation. Je me
trompe, il faut y ajouter cette secrète inquiétude qui le
tourmente au sujet de ses vers. Il craint qu'ils ne se
ressentent de la barbarie des lieux qu'il habite. Peut-on
bien écrire loin de Rome, ce centre de la politesse et du
beau langage ? Tels sont les derniers soucis qui assiégèrent
cette pauvre âme : plaire à l'empereur et faire de
beaux vers. Tout Ovide est là.
Il ne sut pas même s'indigner et haïr. Calomnié, insulté
dans son exil par un domestique de l'empereur, faiseur
de vers, qui se permet même d'outrager la femme du
poëte, Ovide écrivit, sous le titre d'Ibis, 644 vers en réponse
au misérable. L'occasion était belle d'allonger au
dos de l'esclave les coups qu'on eût voulu pouvoir donner
au maître. Comment rester froid et spirituel devant
une si lâche agression? Ovide y a cependant réussi. Il
ne nomme pas ce persécuteur d'une femme et d'un exilé ;
et il va emprunter à ses chers alexandrins les injures
qu'il lui adresse. Callimaque avait composé sous le nom
d'Ibis un poëme contre Apollonius, l'auteur des Argonautiques;
Ovide s'en empare et le traduit. Il se venge
par imitation ! De vraie colère, il n'y en a trace dans ces
644 vers. Il ose évoquer le souvenir d'Archiloque et de
Lycambé sa victime ; mais de telles fureurs sont bien
loin de son coeur. Ici encore il n'a que de l'esprit et beaucoup
de mythologie à son service. Il dévoue Ibis à la colère
de tous les dieux du ciel, de la terre, de la mer et des
enfers. Vengeance d'érudit, inoffensive et puérile, comme
le coeur même du poëte! Parlerai-je des autres poëtes, contemporains d'Ovide?
Il y en eut beaucoup, et de toute sorte. On sait assez que
les Romains étaient peu sensibles au mérite de l'originalité. Traduire ou imiter agréablement un poëme grec,
suffisait à leur ambition. Les modèles ne manquaient pas.
Les Alexandrins seuls en offraient un nombre considérable, et que leur médiocrité facile mettait à la portée des
imitateurs. Ajoutez à cela la nécessité d'employer à quelque
occupation les loisirs que le nouveau gouvernement faisait aux citoyens, les commodités qu'offre la versification latine, la certitude d'être applaudi par les petites sociétés
littéraires qui composaient alors le public. C'est là ce qui fit éclore une foule de productions, sans mérite réel
,pour la plupart, mais dont les titres et des fragments ont
survécu, parce que les poëtes contemporains en ont fait
mention, et les ont louées pour être loués à leur tour.
De ces poëtes des lectures publiques, on pourrait dire ce
que saint Augustin dit de ceux qui vont recherché qu'à
faire du bruit dans le monde. Je me bornerai à rappeler
les noms et les ouvrages de quelques-uns d'entre eux.
Varius, ami de Virgile et d'Horace, était, suivant le
témoignage de ce dernier, un poète épique, comparable
à Homère. Disons que c'était surtout un poëte de cour.
Il avait chanté la Mort de César, la Gloire d'Auguste,
les Exploits Agrippa. Le louer, c'était louer les maîtres
du jour. Tel était encore Valgius Rufus, que Tibulle
place aussi à côté d'Homère. La poésie officielle est
dans une cour la plus belle de toutes les poésies. PedoAlbinovanus, qui célébra le voyage de Drusus Germanicus dans l'Océan septentrional, est singulièrement vanté
par Ovide. Il écrivit aussi une Thébaïde. Titius Septimius, qui faisait partie du cortége de celui qui fut Tibère,
est assuré de l'immortalité par Horace ; il faisait à la fois
des vers lyriques et des tragédies. Voilà ceux que célébrèrent
à l'envi leurs contemporains : on en voit la
raison.
Ce ne sont pas les seuls. Après la poésie officielle,
vient la poésie artificielle. Les Géorgiques, qui le croirait!
eurent une déplorable influence sur la littérature
de cette époque. Le poëme didactique est chose si commode
! Des descriptions, des préceptes, quelques digressions
par-ci, par-là, des récits mythologiques, et l'oeuvre
est complète. Elle n'exige à vrai dire ni invention, ni chaleur,
ni mouvement. L'exactitude, l'élégance, la grâce,
suffisent, qualités rares, mais sur lesquelles, à la rigueur,
on peut se faire illusion, pour peu qu'on ait quelque présomption.
C'est le genre qui inaugure et signale la décadence.
Il faut n'avoir rien dans le coeur et dans l'imagination
pour se faire pédagogue en vers. Stérilité et
dogmatisme : voilà les marques du néant poétique. Où
ne va-t-on pas prendre alors des sujets de poëme? Un certain
Emilius Macer chante les oiseaux (Ornithogonia) et
les poisons ( Theriaca); mais sa science de fraîche date,
il l'emprunte à l'Alexandrin Nicander. Plus tard, un
autre Macer chantera les plantes (De virtutibus herbarum).
Un autre met en vers les préceptes de la rhétorique
relatifs à l'élocution. Les plus distingués de ces versificateurs
choisissent des sujets un peu moins éloignés
des moeurs et des habitudes romaines; Gratius Faliscus chante la chasse (Cynegeticon). Il décrit les filets, les
chiens, les chevaux, les armes que doit préférer un habile
chasseur. Il imite Xénophon. Un autre chante la pêche
(Halieuticon) Est-ce Ovide dans son exil? on l'a supposé. Mais la voie dans laquelle on se précipite à l'envi, c'est
celle de l'astronomie, ou de l'astrologie, que les Romains
ne distinguaient pas l'une de l'autre. Le grand initiateur
fut Aratus l'Alexandrin. C'est lui que Cicéron imita.
Après Cicéron, Germanicus reproduisit sous le titre de
Phenomena Aratea, de Diosemeia, Prognostica, les leçons
du premier maître. Le plus illustre de ces versificateurs
astronomes est Manilius.
On ne sait rien de précis sur le lieu et la date de sa
naissance : mais, suivant l'opinion la plus commune,
il appartient aux dernières années du règne d'Auguste et
à l'époque de la saine et pure latinité. D'ailleurs tous
les poëtes que nous venons de citer sont remarquables
par la correction du langage et le mérite de la versification.
Il ne leur manque que des idées et de la verve. Manilius
a parfois l'une et l'autre. D'où cela vient-il? Ce
n'est pas un servile imitateur des Grecs. Il a pensé par lui-même.
La plupart de ses contemporains et de ses successeurs
n'avaient d'autre but que de versifier d'élégantes
descriptions des signes célestes, et d'y joindre les légendes
mythologiques les plus remarquables par leur éclat
ou leur bizarrerie. Manilius ne s'interdira pas non plus
ces ornements ; mais une idée générale préside à l'ordonnance
de son poëme et lui donne une couleur particulière.
Manilius n'est pas un astronome seulement,
c'est avant tout un moraliste. Supposez à cet esprit,
plus de force, à cette âme une conviction plus ardente,
et vous aurez dans le poëme des Astronomiques le pendant
du fameux de Natura rerum de Lucrèce. Manilius
est stoïcien par sa physique. Son Dieu n'est autre chose que l'âme du monde; le monde lui-même est dieu.
Conception pleine de grandeur et éminemment favorable
à la poésie, pourvu que l'esprit qui l'a reçue soit en
même temps une imagination forte et féconde. Voilà
le cadre de l'oeuvre, malheureusement il est à peine
dessiné dans Manilius. On voit bien que son esprit se
tournait d'un autre côté, que d'autres préoccupations obsédaient
sa pensée. Il s'est demandé, après tant d'autres,
quelle était la cause suprême des événements dont le
monde est le théâtre, dont l'homme est tour à tour le héros
ou la victime. Il n'en a découvert d'autre explication
que la fatalité. C'est cette puissance aveugle qui règle tout
ici-bas, l'heure de notre naissance et celle de notre mort,
les faits heureux ou malheureux dont se composera le
tissu de notre vie. Mais lui ne recule pas même devant
les dernières et les plus douloureuses conséquences de ce
principe. C'est à la fatalité qu'il attribue les vices et les
vertus de l'homme, ses belles actions et ses crimes.
C'est par là que ce poëme étrange mérite quelque attention.
Il porte bien l'empreinte de son temps. Les Virgile,
les Horace, les Ovide ne voyaient que les splendeurs de
la cour impériale, et se plaisaient à présenter à Auguste,
comme le tribut de la reconnaissance du monde pacifié,
les remerciments et les adulations sans fin. Il semble que
Manilius, esprit plus sombre, poëte caché dans l'obscurité
et la solitude, loin de la cour et des pompes du principat,
ait surtout été frappé des misères infligées à l'humanité
et des vains efforts que fait l'homme pour s'y soustraire.
Il rappelle quelque part les meurtres hideux dont ce
triste temps fut témoin : les fils assassinés par les pères, les pères par les fils, les frères armés contre les frères.
Et il s'écrie : « Ces crimes ne sont point l'oeuvre des hommes; un mouvement étranger les y pousse de
force. » Il en dit autant des vertus. Elles ne sont point
le propre de l'homme ; elles lui viennent du dehors aussi
bien que la configuration de ses traits, ses dispositions
naturelles pour tel ou tel art, etc. Il n'y a pas loin
de cette conception désolée à l'idée fondamentale des
Pensées de Pascal. La théorie impitoyable du péché originel
et de la grâce n'a-t-elle pas quelque-uns des caractères
du fatalisme antique ? Mais Pascal enferme sa solution
dans sa théorie. Il se plaît à exposer toutes les
misères sans nombre qui affligent l'homme, ce roi déchu,
parce qu'il sait comment il le relèvera ensuite. C'est là
ce que l'on chercherait vainement chez Manilius. La fatalité
: voilà pour lui toute l'explication. Il ne se met pas
en peine de concilier l'influence qu'il attribue aux astres
sur notre destinée, avec celle qu'exerce le destin. Il les
admet l'une et l'autre. On dirait qu'il cherche à appesantir
le poids des chaînes que nous portons. Qui ne
s'attendrait à trouver dans une oeuvre ainsi conçue les
àpres accents du désespoir, des cris de révolte, ou de terribles
arguments tirés du fond d'une âme désolée en
faveur de ce tyran des choses humaines, la fatalité ? Il
n'en est rien. Manilius a porté le-fardeau d'un tel système
sans protester et sans se plaindre. L'âme de Lucrèce,
qui a supprimé les dieux, est profondément triste ; Manilius
est calme, indifférent ; peu lui importe l'organisation
du monde. Il ne la voudrait point autre qu'elle est. Aussi
bien il a les yeux sans cesse fixés sur les signes célestes,
par qui sont réglées nos destinées. Il expose, il explique
les causes et les effets. Que d'autres s'indignent ou se lamentent, pour lui, il n'est que rapporteur. Cette indifférence
est encore, si je ne me trompe, un signe du
temps. Il faut être bien ayant dans la mort pour ne pas
sentir qu'on va cesser de vivre.
Faut-il pousser plus loin cette stérile énumération de
versificateurs inconnus, d'oeuvres incomplètes ou perdues
pour nous? Wernsdorff a dépensé beaucoup de science et
de sagacité pour recueillir, distribuer, cataloguer les productions
misérables des petits poëtes latins. Quand
on a feuilleté ces sept gros volumes, on se demande avec
tristesse ce qu'on a trouvé. Toutes ces oeuvres, il faut
bien le reconnaître, sont mortes et vides. Le choix des
sujets seul suffit pour montrer l'incroyable stérilité des
esprits sous le régime impérial. Qu'est-ce qu'un Romain
qui a perdu l'aiguillon de la vie publique? Un sec
et froid contrefacteur de la mauvaise poésie des Alexandrins.
Chanter les oiseaux, les plantes, les astres, la
pêche, quels sujets pour des poëtes ! Ce qui étonne, c'est
qu'ils aient pu se résigner si absolument à la suppression de
la liberté et de ses féconds orages. Comment ne se glisset-elle pas dans leurs vers, ne fût-ce que furtivement et
embellie par les regrets ? Se peut-il qu'ils soient devenus à ce point faiseurs de vers, indifférents à tout ce
qui avait passionné leurs pères? Je ne trouve dans
toutes ces oeuvres d'érudits qu'un seul écho des souvenirs
de la Rome républicaine. Ce n'est pas l'imprécation
artificielle de Valérius Caton contre les soldats à
qui on avait donné son domaine ; c'est le cri d'indignation
qui s'échappe des lèvres de Cornélius Sévérus, à la
pensée des indignes traitements infligés à Cicéron mort.
D'où est tiré ce fragment, quelque peu déclamatoire, mais
passionné? Est-ce d'un poëme historico-épique, intitulé : la Guerre de Sicile? On l'a supposé. On a supposé aussi
que ce Cornélius Sévérus était l'auteur d'un poëme sur
l'Etna, oeuvre sèche, pédante, niaise, d'un écolier qui
vient de suivre un cours de physique et se croit bien
savant parce qu'il est un peu moins ignorant que la
veille. Quoi qu'il en soit, voici les vers de Cornélius
Sévérus ; ils nous ont été conservés par Sénèque le Rhéteur.
« On vit encore vivantes les têtes de ces hommes magnanimes,
attachées à la tribune où ils avaient régné; mais
elles pâlissent toutes devant l'image de Cicéron, comme
s'il était seul. On se rappelle alors les grandes actions du
consul, les serments des conjurés, le complot criminel
par lui découvert, l'attentat des patriciens qu'il étouffa,
Céthégus puni et Catilina renversé par lui de ses espérances
sacriléges. Que lui ont servi la faveur du peuple,
ces concours d'hommes, ces années comblées d'honneurs
? Un seul jour a éteint la gloire de toute sa vie, et,
frappée du même coup, l'éloquence latine se tait. Il était
jadis le soutien et le salut des accusés, la noble tête de la
patrie; il était. le défenseur du Sénat, du Forum, des lois,
de la religion, il était la voix publique de la paix : la
voilà muette à jamais, éteinte par le fer cruel. Ce visage
défiguré, ces cheveux blancs, souillés de sang, ces
mains saintes, ouvrières de si grands travaux, c'est un
citoyen, qui les a foulés sous ses pieds orgueilleux, oubliant
et les retours de la fortune et les dieux. Non, jamais les
siècles n'emporteront dans leur course le crime d'Antoine.
»
Cornélius Sévérus est, je crois, le seul poëte du règne
d'Auguste, qui ait osé prononcer le nom de Cicéron.
Je terminerai cette énumération incomplète, je le sais, quoique trop longue, par Phèdre. D'après l'opinion des
critiques les plus autorisés, Phèdre, bien que postérieur
aux écrivains précédents, appartient encore à cette période
littéraire, qu'on est convenu d'appeler le siècle
d'Auguste. On sait comment elle se termine et ce qu'il
faut penser de ces contemporains de Virgile et d'Horace.
Admirons, je le veux bien, la pureté de leur langage ; mais reconnaissons en même temps l'extrême stérilité de leur esprit et la sécheresse de leur imagination. Oserai-je avouer que Phèdre, écrivain si remarquable, ne me semble pas mériter l'admiration dont il est aujourd'hui l'objet? Les anciens semblent en avoir jugé
ainsi. Le premier, le seul auteur qui mentionne le nom de Phèdre (Phedrus ou Pheder) est le fabuliste Avienus, qui vivait plus de cent cinquante ans après son modèle. Le vers de Martial, sur lequel on prétendrait fonder la notoriété de Phèdre, ne lui semble point applicable. Où trouver dans cet auteur d'apologues secs rien qui ressemble aux joci improbi, à la malignité dont
parle Martial ? Quintilien ne le nomme pas, Sénèque
ignore son existence. Lui, son contemporain, il déclare
même que l'apologue n'existe pas à Rome. Je n'irai pas, comme certains érudits du
dix-septième et du dix-neuvième siècle, jusqu'à contester
l'authenticité du recueil des fables de Phèdre.
Après la publication textuelle du manuscrit faite en 1830
par M. Berger de Xivrey, le scepticisme n'est plus possible.
Ce manuscrit, découvert et publié sans avoir été
communiqué à personne par Pierre Pithou en 1596, remonte
au dixième siècle. Transmis aux descendants de
Pithou qui en ignoraient l'existence et l'importance, ce
n'est qu'en i830 que le dernier propriétaire, le marquis Lepelletier de Rosanbo, voulut bien autoriser M. Berger
de Xivrey à en prendre copie. Jusqu'alors on n'avait que
le texte publié par Pierre Pithou, et qui, il faut le reconnaître,
est bien supérieur en correction et en clarté au
manuscrit original.
Non seulement Phèdre est resté longtemps inconnu,
mais il a été pillé, défiguré avant d'être publié. Son
oeuvre peu goûtée apparemment et peu lue a été remaniée,
délayée par des plagiaires des derniers temps de
l'empire et du moyen âge, notamment par l'archevêque
Perotto. C'est ce qui rendait encore plus insoluble la
question d'authenticité. Regardons-la aujourd'hui comme
tranchée, grâce à la découverte et à la publication textuelle du manuscrit original. Aussi bien elle l'était déjà
par le caractère même de l'oeuvre et surtout par le style.
Quelques mots sur le personnage. Les conjectures
les plus ingénieuses des commentateurs n'ont pas
réussi à nous donner une histoire de Phèdre. C'est
dans les prologues ou les épilogues de ses cinq livres de
fables (quatre suivant le manuscrit Pithou) qu'il faut glaner
à grand peine de vagues renseignements. Il était
Thrace ou Macédonien, né dans la région qui s'étend aux
pieds du mont Pierus, et fier de sa patrie qui fut le berceau
des anciens aëdes Linus et Orphée. On pense que
dès l'âge le plus tendre il fut amené à Rome comme prisonnier
de guerre, puis, qu'il fut affranchi par Auguste. Il
vit les règnes de Tibère, celui de Caligula et une partie
de celui de Claude. Le dernier livre de ses fables est dédié à Particulon, affranchi de l'empereur ; le quatrième
à Eutychus, affranchi de Caligula. Il commença à publier
ses fables sous Tibère ; et il tomba, on ne sait pourquoi,
dans la haine de Séjan et par suite du prince lui-même.
Condamné à la perte de ses biens sans doute, il vécut
tristement jusqu'àun âge assez avancé. On suppose que des
allusions sanglantes aux moeurs de Tibère, aux desseins
cachés de Séjan, furent les causes de sa disgrâce. On sait
en effet combien était soupçonneuse et ombrageuse la tyrannie
de Tibère dans les dernières années de sa vie, et
quel terrible usage il faisait de la loi de Majesté. Mais
si nous ne pouvons douter de la condamnation de Phèdre,
nous sommes réduits à des conjectures sur le crime qui
lui fut reproché. Tel est l'homme. Sa vie, on le voit,
nous fournit bien peu de lumières sur son oeuvre.
Voyons l'oeuvre elle-même.
Quelle part faut-il faire à l'invention originale dans
Phèdre? Il avoue lui-même qu'il n'a fait que mettre
en vers la matière créée par Ésope. Mais il dit ailleurs,
en réponse à des détracteurs qui lui reprochaient de
n'être qu'un plagiaire, qu'un bon nombre de ses apologues
lui appartient en propre. On ne peut en douter. Plusieurs
fables en effet semblent n'être autre chose que des
récits empruntés à la vie commune des Romains de son
temps. Le poëte en dégage une leçon morale quelconque,
le plus souvent vulgaire et peu éloignée de ces réflexions
banales que fait le passant témoin d'un accident ou d'un
crime. Ce qui lui appartient en propre, c'est l'idée d'écrire
en latin des apologues à la façon d'Ésope.
Il est donc le créateur du genre à Rome, car les apologues
semés par Horace dans ses Épîtres et dans ses Satires ne sont que d'agréables hors-d'oeuvre. Mais il ne réussit pas à lui donner le droit de cité. Pourquoi?
L'apologue n'est pas fait pour plaire à des siècles de haute
corruption et de culture intellectuelle raffinée. C'est la
forme ingénieuse, et presque enfantine que revêt la sagesse
balbutiante des âges primitifs. Envelopper une
leçon dans un récit, éveiller la curiosité pour parler à la
raison, insinuer un conseil en flattant l'imagination, telle
fut l'oeuvre de ces anciens sages, qu'on retrouve au berceau
de toutes les civilisations antiques. Ils sont les auxiliaires
des poëtes inspirés et des grands législateurs.
Ils mettent à la portée de tous les enseignements divins
des Muses et les prescriptions austères de la loi. Ce sont
des vulgarisateurs, des commentateurs. Mêlés à la foule,
le plus souvent pauvres, esclaves, infirmes ou contrefaits,
victimes de la dureté d'un maître, l'intelligence et l'esprit
les affranchissent et les relèvent. Observateurs patients
et sagaces, ils prévoient et prédisent les conséquences
d'un fait ; on les croit volontiers divins, tant
l'expérience et la réflexion sont alors choses nouvelles
et admirables! Mais transporter un Ésope, un Pilpay,
un Lockman dans un monde déjà vieux, fatigué et blasé,
parmi des hommes qu'il serait impossible d'amuser avec
des contes enfantins, et qui savent à quoi s'en tenir sur
ce qu'il est utile de faire ou de ne pas faire, qui
prêtera l'oreille à cette sagesse usée, déplacée, vieillie?
Les fables de Phèdre ont ce grave défaut : elles sont
vieilles. C'est un bon vin, mais à qui les ans ont enlevé
toute sa saveur et tout son feu. Cette morale élémentaire,
sans élévation et sans vigueur, elle a fait son temps. On
est alors épicurien ou stoïcien. Voilà des doctrines bien
autrement fortes et complètes que le recueil des apologues
d'Ésope. On lit Phèdre, on sourit, on passe. C'est un homme qui n 'a pas su être de son temps : les sentences
sèches et nues de P. Syrus plaisaient davantage. Mais
l'oeuvre de Phèdre était pleine d'allusions. Séjan était comparé au soleil et à une hydre, Tibère au soliveau que Jupiter donne pour roi aux grenouilles. Je le veux bien.
Qu 'est-ce que cela? Voilà les seuls traits que les commentateurs les plus ingénieux aient pu recueillir pour expliquer les malheurs présumés de Phèdre. Ce côté satirique
de l'oeuvre nous échappe tout à fait. S'il eût été plus
nettement accusé, soyez assuré que Phèdre eût été connu, glorifié ou maudit par ses contemporains et la
postérité immédiate. Mais le moyen de faire de lui un
peintre énergique et obstiné des turpitudes impériales?
Tout en lui répugne à un tel rôle. Il est froid, compassé,
discret, mesuré. Son style, d'une limpidité merveilleuse,
ne laisse pas une ombre à sa pensée. Celle-ci, nette,
commune, médiocre, s'expose nue à tous les regards. Le
poëte se travaille pour économiser les mots ; ce n'est pas
un homme qui écrit, c'est un oracle qui parle. Il a le
ton didactique et dogmatique. Il met en scène des animaux,
des arbres, des hommes ; mais nul ne vit chez
lui ; il ne s'imagine pas un seul instant qu'il doive peindre
ses personnages, les animer sous nos yeux, les montrer
agissants. Chacun d'eux est une abstraction, non
un être. On dirait les propositions d'un syllogisme qui
s'alignent dans l'ordre voulu pour opérer la démonstration
annoncée. Qu'il y a loin de lui à notre La Fontaine !
Chez le bonhomme, chaque fable est un drame, qui a
ses personnages, son exposition, son noeud, son dénoûment.
Chaque personnage a son caractère. Le lieu de la
scène est décrit. Après cela vient la morale, comme elle
peut, un peu bien au hasard. On ne voit que trop qu'elle est bien l'accessoire. Chez Phèdre, elle est tout. Les
personnages et le récit sont imaginés pour la maxime qui
est en tête ou à la fin. Celle-ci est d'ordinaire assez
plate et vulgaire. Le lecteur attend toujours quelque
chose, et arrive, à la fin, toujours déçu. C'est alors qu'il
s'avise des rares qualités de style qu'il n'avait pas remarquées
d'abord. Il reconnaît qu'il est impossible d'être
plus bref, plus clair, plus élégant, et il ajoute aussi, plus
froid.
Les prosateurs du siècle d'Auguste. — Ruine de l'éloquence. — L'histoire.
— Les contemporains de Tite-Live. — Tite-Live.
§ I.
Les écrivains postérieurs au siècle d'Auguste, historiens,
rhéteurs, érudits s'obstinent à parler toujours de
l'éloquence et des orateurs, comme si tout cela existait
encore. Il n'en restait plus que l'ombre. La vie publique
ayant cessé, c'est dans l'étroite enceinte du sénat que
l'éloquence est claquemurée. Les orateurs prennent le
mot d'ordre de César. Sous Auguste, ils s'ingénient à
devancer ses désirs ; sous Tibère, ils commencent à se
regarder avec une sombre défiance ; sous Caligula et les
autres, les plus ardents et les plus vils se font délateurs.
Ils ont des colères et des violences qui seraient burlesques,
si elles n'étaient odieuses ; ils prononcent des réquisitoires
contre Cremutius Cordus, Thraseas, Soranus.
L'empereur semble en dehors de ces débats ; mais, l'accusé
une fois condamné, César enrichit l'accusateur.
Tacite et Pline nous ont conservé les noms de quelques-uns
de ces misérables. Ils s'appelaient Eprius Marcellus,
Regulus quelle dérision !, Capito Cossutianus. Quant
aux autres orateurs que les critiques se sont donné la
peine de juger, nous sommes réduits à nous demander
quelle pouvait être la matière de leur éloquence. C'étaient sans doute des rapporteurs officiels, clairs, exacts,
précis. Il ne semble pas en effet que leur éloquence ait
eu de grandes batailles à livrer. Les contradictions
étaient rares, très mesurées, et aussi peu propres à
faire jaillir la passion que la vérité. Restait le barreau.
C'était toujours une des grandes routes qui conduisaient
aux honneurs. Mais, sous l'ancienne république,
les procès avaient toujours un caractère politique, donc
plus élevé ; les avocats qui s'en chargeaient plaidaient
la cause de leur parti aussi bien que celle de leur client.
De là ces grands mouvements d'éloquence, cette passion
débordante. Sous la monarchie, il n'y eut plus que
des avocats. La cause fut sans doute plaidée plus à fond,
mais elle n'intéressa personne. De tout cela rien ne
nous est parvenu, rien que l'obstination des Romains à
cultiver avec amour un art devenu à peu près inutile.
Ils y restèrent fidèles jusqu'au dernier jour. Par une
cruelle ironie du sort, nous ne possédons des monuments
de cette éloquence que des panégyriques, celui de Pline
et ceux qu'on appelle Anciens Panégyriques.
On touche ici une des conséquences les plus immédiates
de l'établissement de la monarchie. Quel vide que
celui de la suppression de l'éloquence ! Là, était la séve
du génie romain ; là, son originalité. Ce peuple n'est ni
savant ni poëte : il avait le tempérament oratoire ; il
aimait la prose, et il avait fait de sa langue l'organe
même de l'éloquence. Quand la source en fut tarie, quel
néant ! l'âme même de Rome sembla languir. Elle
ne s éteignit pas cependant : les esprits médiocres et
sans portée continuèrent à plaider ou à parler au sénat ; les esprits puissants et tourmentés du génie national se
jetèrent dans l'histoire et dans la philosophie. Tels furent Tite-Live, Sénèque, Tacite. Voilà certainement
les trois esprits les plus élevés et les plus forts de
la Rome impériale. Ils suffiraient au besoin pour prouver
que le vrai génie de leur race n'est pas le génie de
la poésie, qui fut toujours plus ou moins artificielle,
mais celui de la prose, qui se renouvela, se transforma
et maintint en dépit de tout sa vive originalité.
§ II.
Lorsque parut Tite-Live, les Romains ne possédaient
pas encore une histoire nationale, vraiment digne de ce
nom. César et Salluste s'étaient bornés à des épisodes ;
les écrivains antérieurs étaient plus complets, mais ils
s'arrêtaient au septième siècle, c'est-à-dire à l'époque
la plus intéressante. Parmi les contemporains de Tite-Live il ne s'en rencontra pas un seul qui songeât à embrasser
dans son magnifique développement l'oeuvre de
la grandeur romaine. Je vais les énumérer rapidement ;
puis j'introduirai celui qui seul fut à la hauteur d'une
si belle tâche.
Cornélius Nepos. — Il y a peu d'écrivains dont la vie
et les ouvrages nous soient moins connus. Ami de Cicéron,
d'Atticus et de Catulle qui lui dédia ses vers, il vécut
probablement à Rome, mais il était originaire de la haute
Italie. Catulle l'appelle Italus, Pline, Padi Accola, Ausone,
Gallus. S'il est né à Vérone, comme on le suppose, ces diverses
appellations peuvent lui convenir : Vérone appartenait
à cette partie de l'Italie appelée aussi Gallia togata. Il ne joua aucun rôle dans la république, à l'exemple
de son ami Atticus. On sait seulement qu'il lui survécut,
et mourut sous Auguste. Quant à ses ouvrages, les anciens en possédaient un certain nombre que nous
n'avons plus; et le seul qui nous soit parvenu était inconnu
des anciens. Aussi la sagacité des critiques s'est
laborieusement exercée sur ces problèmes ; et, bien
qu'aucune opinion n'ait encore rallié tous les suffrages,
voici cependant celle qui paraît la plus vraisemblable.
Cornélius Népos avait composé : 1° des Chroniques, en
trois livres (Chronica), qui étaient comme un résumé
d'histoire universelle. 2° des livres d'exemples (Libriexemplorum), c'est-à-dire une sorte de morale en action. 3° des livres sur les hommes illustres (Libri virorum
illustrium). 4° un ouvrage sur les historiens (De historicis). 5° des lettres adressées à Cicéron. Suivant
Pline, il s'était aussi exercé dans la poésie. Des critiques
modernes supposent qu'il avait écrit des ouvrages de
géographie et d'archéologie. Or de tous ces livres il ne
nous reste rien. Ce n'est qu'au milieu du seizième siècle
(1568) que Lambin, averti par Gifanius, revendiqua
pour Cornélius Népos l'ouvrage intitulé Vitae excellentium
imperatorum, dédié à Atticus, et renfermant vingt
biographies de personnages athéniens, spartiates, thébains,
syracusains, macédoniens, plus un catalogue des
rois de Perse et de Grèce, la vie d'Hamilcar et celle d'Annibal,
celles de M. Portius Caton et d'Atticus. Ce recueil
avait passé jusqu'alors pour l'oeuvre d'un certain, Emilius
Probus, qui vivait sous Théodose, à la fin du quatrième
siècle. Le manuscrit portait une dédicace en mauvais
vers, adressée à Théodose, et dans laquelle ce Probus
se déclarait l'auteur du livre. On supposa non sans raison que ce Probus et les siens
étaient, de leur métier éditeurs ou copistes. La latinité
d'ailleurs était trop pure pour appartenir à une telle
époque. Aemilius Probus fut donc dépossédé et Cornélius
Népos rétabli dans la propriété de l'oeuvre. Mais
avons-nous réellement dans ce petit volume l'ouvrage
authentique de Cornélius Népos? Il est permis d'en
douter. Si le style est en général élégant et correct,
certains tours bizarres, des irrégularités graves, des erreurs
historiques parfois grossières, et, par-dessus tout,
je ne sais quoi de puéril et de niais, font supposer que
Probus et d'autres peut-être n'ont pas été étrangers à la
composition et à la rédaction de ce recueil. Les livres de
Cornélius Népos, historien moraliste, se prêtaient parfaitement
à ces modifications. Des abréviateurs ineptes
auront fait un choix dans ses biographies, empruntant à
tel ouvrage un personnage, à tel autre un autre, sans se
préoccuper de l'unité de caractère qui était la base de
chacune de ces compositions. Quant aux interpolations
qui se glissèrent dans le texte, elles doivent être peu
nombreuses, car le style a conservé une couleur uniforme,
et la diction est généralement pure. Mais il est
fort probable qu'à défaut d'additions, Cornélius Népos a
subi des retranchements considérables. Un ami de Cicéron
et d'Atticus, un homme qui a vécu dans un temps si
fécond en enseignements, et dont ses contemporains vantaient l'intelligence, aurait donné à ses livres une plus
forte empreinte. La vie de Caton et celle d'Atticus ont évidemment été moins mutilées ; on y retrouve l'écrivain
d'une grande époque. La vie de Cicéron qu'il avait composée
n'a pas été conservée par ces abréviateurs ; peut-être ont-ils jugé qu'elle eût déplu à Théodose.
On a attribué à Cornélius Népos le recueil intitulé :
De viris illustribus, qui appartient à Aurélius Victor, et
une histoire de la prise de Troie (Historia excidii Trojae),
espèce d'extrait de l'ouvrage grec de Darès le Phrygien
qui fut la source où puisa tout le moyen âge. Quant lettres aux de Cornélia, mère des Gracques, qui se trouvent à
la suite des oeuvres de Cornélius Népos, il est permis de
douter qu'elles soient authentiques.
Il est difficile de porter un jugement sur un auteur dont
les oeuvres ne nous sont parvenues qu'incomplètes et
modifiées ; cependant Cornélius Népos paraît avoir conçu l'histoire à la façon de Plutarque. Il dit formellement en effet dans sa vie d'Annibal qu'il comparera les hommes
de guerre de Rome à ceux des autres pays, afin que l'on
puisse juger ceux qu'il convient de placer au premier
rang. C est ce que fait aussi Plutarque, qui invoque
souvent son témoignage. Ce point de vue est étroit et
puéril ; ces parallèles souvent forcés faussent l'histoire en la réduisant à des antithèses, le plus souvent sans fondement
sérieux. Il est regrettable que de tels auteurs
soient la maigre pâture offerte aux enfants qui commencent
le latin. Ils n'y prennent que des idées fausses
ou niaises. Plus stérile et plus puéril encore est Valère
Maxime, le grand pourvoyeur de versions. C'est à dégoûter
de la belle antiquité.
De Cornélius Népos à Tite Live nous ne possédons guère que des indications et de rares fragments d'auteurs. On
ne saurait trop regretter la perte de la plupart de ces
documents. De ces écrivains, en effet, les uns comme
Asinius Pollion et Auguste, avaient pris la part la plus
importante aux événements qu'ils racontaient ; les autres,
comme Tiron, Bibulus et Volumnius avaient vécu dans
l'intimité des grands hommes dont ils avaient écrit la
biographie. La vie de Brutus par les deux derniers, celle
de Cicéron par son affranchi, éclaireraient sans doute
pour nous d'une lumière inattendue cette époque si intéressante
qui est le passage de la forme républicaine à
la forme monarchique. Asinius Pollion avait été mêlé
à toutes les péripéties des guerres civiles, tantôt avec
Antoine, tantôt avec Octave, ne demeurant neutre que
jusqu'à la victoire, tout prêt, comme il le disait lui-même,
à être la proie du vainqueur. Fort admiré de ses contemporains,
comme orateur, comme poëte et comme historien,
chéri des poëtes dont il fut le protecteur, fondateur
de la première bibliothèque publique qui ait existé à
Rome, ce personnage remarquable, qui sut si habilement juger les hommes et pressentir les événements, avait
composé en seize livres une histoire de Rome, qui commençait
à la guerre civile entre César et Pompée, et se
terminait à l'établissement de la domination d'Auguste.
Courtisan habile et peu genéreux, il traitait Cicéron, ce
remords incessant d'Auguste, avec la plus extrême injustice.
C'est la seule impression que les contemporains
aient léguée à la postérité. Après la mort de Salluste,
Asinius Pollion avait attaché à sa personne le savant
grec Atéius dont la collaboration, si utile à l'historien de
Catilina, ne le fut pas moins à son nouveau maître.
Les oeuvres de l'empereur Auguste sont plus regrettables encore que celles de Pollion. Il avait en effet écrit
une histoire de sa propre vie en treize livres, depuis ses
premières années jusqu'à la guerre contre les Cantabres
(26 ans av. J.-C. âge d'Auguste, 37 ans). Un autre
ouvrage de lui, qui serait pour la connaissance de
cette époque d'une importance encore plus grande, est
désigné par Suétone sous le titre de Breviarium ou Rationarium totius imperii. C'était une sorte de tableau sommaire de l'État général de l'empire. C'était une statistique universelle rédigée par
un grand administrateur. Quant à un autre livre, qui renfermait
un résumé de tout ce qu'il avait fait, et qu'il avait
ordonné de faire graver sur des tables d'airain placées
devant son mausolée, c'est ce que l'on a appelé depuis
le Monument d'Ancyre. Le
voyageur érudit Busbecq en découvrit au seizième siècle
des fragments en Galatie, à Ancyre. D'autres continuèrent
ces recherches, Cosson, Paul Lucas, Tournefort, André
Schott, Chishul. Enfin en 1861, à la suite d'une exploration
archéologique en Galatie, en Bithynie, faite par
MM. G. Perrot, Guillaume et Delbet, ce monument,
connu sous le nom de Testament politique d'Auguste, a
été complété et publié. L'empereur l'avait écrit à l'âge de
soixante-seize ans. C'est un résumé officiel plutôt que sincère
des actes de sa vie. Il y rappelle les honneurs dont
il a été comblé, les pouvoirs qui lui ont été confiés, ses victoires sur les citoyens et sur les peuples étrangers, ses
largesses au peuple, qui montèrent à des sommes incroyables,
les jeux, les fêtes qu'il donna, la restauration et la
construction des temples, les réformes qu'il crut avoir
opérées dans les moeurs. « J'ai fait, dit-il, des lois nouvelles, j'ai remis en honneur les exemples de nos aïeux, qui disparaissaient de nos mains, et j'ai laissé moi-même des exemples dignes d'être suivis par nos descendants. »
Ses successeurs n'en profitèrent point. De toute son oeuvre
il ne resta debout que le pouvoir absolu, qui de sa nature se déprave sans cesse et déprave.
Un autre contemporain de Tite-Live semble avoir
conçu l'histoire d'une manière plus philosophique. C'est
Trogue Pompée (Trogus Pompeius), gaulois d'origine, attaché
au parti de Pompée et qui reçut de lui le droit de
cité. C'est à peu près tout ce que nous savons sur cet auteur.
Son ouvrage même a péri ; et l'on doit le regretter
d'autant plus que cet étranger a eu le premier l'idée d'une
histoire universelle. Mais ce n'est pas Rome qu'il avait
choisie comme le centre où devaient aboutir les autres
peuples ; c'était la Macédoine, telle que l'avaient faite les
conquêtes d'Alexandre. Le titre de cette vaste composition
était : Historiae Philippicae et totius mundi origines
et terrae situs. Elle comprenait quarante-quatre livres.
Dans une introduction rapide, il traçait l'histoire des
Asiatiques et des Grecs, dès les temps les plus reculés ;
il passait ensuite à la Macédoine et aux royaumes d'Asie
sortis de la conquête d'Alexandre. L'ethnographie et l'histoire
naturelle tenaient une place importante dans ce grand
ouvrage. L'auteur avait consulté les historiens grecs,
Ctésias, Théopompe, et résumé dans un ensemble, habilement
composé, la science et l'érudition de ses devanciers. Pline l'appelait auctor severissimus; son style avait
la simplicité et la précision qui conviennent au genre historique.
Trogue Pompée ne craignait pas de blâmer les
longues harangues de Tite-Live et de Salluste. Cet écrivain
si original est devenu la victime de l'abréviateur
Justin. M. Junianus Justinus (suivant d'autres Justinus Fontinus), qui vivait vers le milieu du deuxième
siècle de notre ère, réduisit en extraits l'oeuvre de Trogue
Pompée. Il retrancha tout ce qui n'était pas agréable à
connaître, ou nécessaire comme exemple, c'est-à-dire qu'il supprima à peu près
toute la partie géographique, négligea la chronologie,
remplaça un livre plein de science et de philosophie, par
un résumé dépourvu de toute valeur. Il fut cher aux
écrivains ecclésiastiques, Jérôme, Augustin, Orose, qui
le citent avec respect comme une grande autorité. Il
n'a survécu de Trogue Pompée que des phrases reproduites
et souvent écourtées par Justin. La latinité est
correcte, simple, mais on sent ça et là la main de l'abréviateur.
Les historiens de la littérature latine mentionnent
parmi les écrivains du siècle d'Auguste un certain nombre
d'auteurs, dont les ouvrages ont péri. Je me borne à
donner ici leurs noms.L. Fenestella écrivit des annales,
dont rien n'a survécu. On lui attribua longtemps un
traité en deux livres, De sacerdotiis et magistratibus
Romanorutn, qui est d'un florentin Frocchi qui vivait
vers 1450. C. Julius Hyginus, le commentateur de Virgile,
affranchi d'Auguste, grand érudit, grand archéologue,
qui avait écrit comme Cornélius Népos De vita
rebusque virorum illustrium, un livre d'exemples (Exempla), des traités sur les Dieux, les Pénates les
familles Troyennes, etc. — Julius Marathus, autre
affranchi d'Auguste, qui écrivit l'histoire de ce prince ; Verrius Flaccus, qui fut chargé de l'éducation des petits-fils
d 'Auguste, composa sous le titre de Rerum memoria dignarum libri un ouvrage historique assez étendu.
Q. Vitellius Eulogius, affranchi de ViteIlius, avait écrit
une généalogie de la famille de son maître. Le plus
remarquable de ces écrivains était sans doute Titus
Labienus, que l'on appelait aussi Rabienus (le rageur).
Sénèque le Rhéteur parle avec admiration de ses histoires,
dont on ignore le titre. Il les lisait en public, mais en
supprimant des passages considérables, qui, disait-il, «ne seront lus qu'après ma mort ». L'indépendance et la
hardiesse de Labienus étaient excessives. Tibère fit rendre
un sénatus-consulte qui ordonnait la destruction de ses
ouvrages par le feu. Labienus se fit porter aussitôt dans
le tombeau de sa famille, et le fit fermer sur lui. Une
ère nouvelle commence. Le gouvernement absolu va
rendre l'histoire impossible. Le siècle d'Auguste est
fini.
III
Tite-Live (Titus-Livius) vécut soixante-seize ans, de
695 à 771. Il put, tout jeune homme, connaitre Cicéron
; la plus grande partie de sa vie se passa sous le
principal d'Auguste ; il assista aux premières années de
celui de Tibère, mais il avait quitté Rome dès son avénement
et s'était retiré dans sa ville natale, à Padoue. C'était
un honnête homme, que sa première éducation avait
préparé au rôle de citoyen, que son éloquence eût sans doute élevé aux premières dignités d'un État libre, et qui
ne voulut rien être par la grâce du prince. La vie publique
lui échappa juste au moment où il pouvait y entrer. Il
voulut cependant être et rester romain. Il y réussit,
d'abord en acceptant les charges qu'impose la qualité
d'époux et de père (il se maria deux fois, et éleva six
enfants) ; ensuite, en consacrant toute sa vie et les rares
facultés qui étaient en lui, à la composition de l'histoire
de son pays. Auguste, ne pouvant en faire un courtisan,
voulut paraître son ami. On rapporte qu'il lui avait donné
le surnom de Pompéien, et qu'il essayait de le plaisanter
sur sa fidélité à la cause du droit et de la légalité. On dit
même qu'il le chargea de l'éducation de son petit-fils, qui
fut plus tard l'empereur Claude. Il y a dans la vie de ce
prince plus d'un acte inspiré par de généreux sentiments :
il est permis de croire que l'influence du maître, bien
qu'étouffée depuis par les vices du despotisme, n'y fut pas
étrangère. Tite-Live en effet est avant tout une âme
droite, sincère, prompte à l'enthousiasme. Le long commerce
qu'il entretint avec les grands hommes de Rome
républicaine le maintint dans une région pure à une certaine
hauteur, loin des bassesses qu'il avait sous les yeux.
Rien d'étonnant qu'il ait souvent embelli, idéalisé les
hommes et les choses du passé. Il n'était pas de ceux qui
immolaient aux pieds d'Auguste toutes les gloires de la
patrie. Combien il est regrettable que les débris seuls du
vaste monument élevé par Tite-Live soient parvenus
jusqu'à nous!
Il avait lui-même désigné son ouvrage sous le nom
d'Annales, sans doute par un pieux souvenir des
premiers écrivains nationaux qui avaient adopté et
comme consacré cette forme. Cet ouvrage embrassait une période de 744 années, depuis la fondation de Rome jusqu'à
la mort de Drusus, frère de Tibère. Il était divisé
en cent quarante-deux livres. Les copistes le distribuèrent
de bonne heure en décades, et c'est probablement
une des causes qui contribuèrent le plus à la perte d'une
partie considérable de l'ouvrage. En effet, sur ces cent quarante-deux livres nous n'en possédons que trente-cinq
dans leur intégrité : savoir, les dix premiers, qui renferment
l'histoire de Rome jusqu'à l'année 460 ; les vingt cinq
livres de vingt et un à quarante-cinq, qui vont
de l'année 536, commencement de la seconde guerre
punique, jusqu 'à l 'anné 586, date de la soumission de
la Macédoine. Des autres livres il ne reste que des
fragments ou des sommaires composés probablement par
Florus. On sait qu'un savant Allemand, Freinshemius, a
essayé de combler les lacunes si considérables du texte.
Il paraît qu'au seizième siècle il existait encore un
manuscrit complet de Tite-Live, mais toutes les recherches
faites n'ont abouti qu'à la découverte de quelques
fragments. C'est Sénèque le Rhéteur qui nous a conservé
le récit de la mort de Cicéron. Les hommes se sont
associés aux ravages du temps. Caligula, qui trouvait
Tite-Live verbeux et plein de négligences, détruisit plus
d'un exemplaire du grand écrivain ; le pape Grégoire
le Grand en fit brûler un très grand nombre, parce
qu'il s'y trouvait une foule de superstitions païennes.
Ainsi l'ensemble et les proportions de ce grand ouvrage
nous échappent. De plus nous ne possédons rien ou
presque rien de toute cette partie si importante qui renfermait
l'histoire des guerres civiles, la fin de la république,
la première moitié du règne d'Auguste, c'est-à-dire ce qu'il y avait évidemment de plus original et de plus
dramatique dans l'ouvrage. Dans la première partie en
effet l'auteur, rapportant des événements accomplis depuis
plus de deux cents ans, n'était qu'un simple narrateur;
dans la seconde il parlait en témoin oculaire. Il était
impossible qu'il n'eût pas pris parti dans la grande mêlée
où périt la liberté ; autrement que signifierait ce surnom
de Pompéien ? Voilà quelles étaient les dimensions de
l'ouvrage. Quand il apparut, il frappa de respect les
contemporains et les étrangers eux-mêmes. On rapporte
que des Gaulois et des Espagnols vinrent du fond de leurs
provinces pour voir Tite-Live et repartirent aussitôt après
l'avoir vu : ils avaient cherché dans Rome autre chose
que Rome elle-même, son historien. Tite-Live est,
en effet, le premier et le seul qui ait conçu et exécuté
le vaste projet d'une histoire nationale complète. Avant
lui, des extraits, après lui, des résumés. Il se met à
l'oeuvre après la bataille d'Actium, à ce moment solennel
où, le monde étant pacifié, la grande unité de l'empire
apparaît dans toute sa majesté. Les splendeurs du triple
triomphe d'Auguste, cette procession de peuples et de rois
vaincus, les fêtes, les jeux, les supplications et les sacrifices
dans tous les temples, la souveraineté de Rome rendue
pour ainsi dire visible, les antiques prédictions des oracles
si manifestement accomplies ; toute cette gloire et toute
cette puissance qui avaient éveillé dans Virgile l'idée de son
épopée et inspiré à Horace quelques-uns de ses plus beaux
vers, frappèrent l'imagination de Tite-Live ; et il voulut
lui aussi élever son monument à sa patrie, la dominatrice
du monde. Seulement les poëtes ne voyaient qu'Auguste
et rapportaient tout à Auguste; Tite-Live ne vit que
Rome et ne sacrifia qu'à cette divinité. Tel est l'esprit, disons mieux, telle est l'inspiration de l'ouvrage.
Voyons quels sont les principes de critique.
On pourrait croire que le patriotisme a aveuglé l'historien
et faussé l'oeuvre. Il est certain que Tite-Live
n'échappe pas toujours à ce reproche ; mais ses erreurs
sont pour ainsi dire involontaires, je dirais presque
inconscientes, et d'ailleurs ne portent que sur
des détails. Il est toujours appuyé sur des autorités,
mais il ne les contrôle pas toujours avec assez de
rigueur, et souvent se détermine par des raisons qui sont
étrangères au véritable esprit historique. M. Taine,
dans son bel essai sur Tite-Live, a parfaitement mis en
lumière ce point intéressant ; peut-être a-t-il un peu trop
accordé à l'orateur au détriment de l'historien.
On sait quels étaient les matériaux réunis. L'histoire
de Rome jusqu'à la prise de la ville par les Gaulois, racontée
par une foule d'annalistes, par les poëtes Naevius
et Ennius, ne supporte pas l'examen d'une critique
sévère. Tite-Live lui-même reconnaît que bien des
fables sont mêlées à un petit nombre de vérités ; cependant
il accepte les traditions, il raconte les légendes. Il
n'y a pas d'autre histoire des commencements de Rome
que celle-là ; ce n'est pas à lui de la créer ; il est un
rapporteur éloquent de ce qui a été dit et écrit, non un
chercheur de la vérité. Il ne choisit pas toujours entre
les divers récits d'un événement le plus probable et le
plus authentique, mais celui qui frappe le plus l'imagination,
prête aux plus beaux développements et satisfait
la vanité nationale. C'est ainsi qu'il avait raconté, si
l'on en croit les sommaires attribués à Florus, l'histoire
de Régulus, mise en vers plus tard par le plagiaire Silius Italicus. Il emprunte à Polybe la plus grande partie de
son histoire des guerres puniques, et se borne à dire de
son modèle qu'il est haudquaquam spernendus auctor.
Quand il s'écarte de ce guide si sûr, c'est pour donner
la préférence à tel écrivain national, dépourvu d'autorité,
mais plus admiratif. Il réunit souvent des documents de
provenance différente, et d'autorité fort inégale, et en
compose un ensemble qu'une judicieuse critique ne
saurait accepter et cependant les sources auxquelles il puise sont
rarement contrôlées avec soin. De là des erreurs nombreuses
dans la description des lieux, dans celle des batailles
et des opérations militaires, et même dans la
peinture des institutions politiques. On pourrait en
donner d'après Lachmann une foule de preuves. Il vaut
mieux en expliquer l'origine et la cause.
Tite-Live n'est pas un politique ; il n'a jamais été ni
chef d'armée, ni homme d'État, ni administrateur. Il ne
s' est point préparé à sa tàche d'historien par une participation
directe au gouvernement des affaires. Il sort de
l'école, non de la vie pratique. L'éducation politique
lui fait défaut; mais il a beaucoup lu, et il a été de bonne
heure exercé par les rhéteurs et les philosophes à revêtir
d'un beau langage, à décorer d'une certaine philosophie
tous les sujets. Voilà la méthode qu'il applique à l'histoire.
Par là il est le véritable héritier de Cicéron, qui ne
l'eût pas écrite autrement. Les détails techniques, les
recherches sur tel point spécial de politique, de tactique,
d 'apdministratiori, il s'en soucie médiocrement : rien dans
son éducation antérieure ne lui a donné le goût du savoir nécessaire à l'historien. Il y supplée par l'imagination;
non qu'il substitue aux faits ses inventions personnelles c'est i une âme droite et élevée ; mais il se fait, comme il
le dit lui-même, « un esprit antique », c'est-à-dire
qu'il voit les siècles primitifs de Rome comme on les
voyait de son temps, et les raconte comme lui seul pouvait les raconter. Il a l'enthousiasme du patriotisme, Rome est réellement pour lui, comme pour Virgile, la
plus belle des choses.
De là une partialité naïve : c'est l'entraînement de la
passion qui le rend injuste contre Carthage et Annibal,
contre presque tous les ennemis de Rome, y compris ces
pauvresGrecs, adversaires bien peu dangereux cependant,
et auxiliaires littéraires bien précieux. Mais ce patriotisme
est souvent aveugle. S'il échauffe l'imagination
de l'écrivain, il lui borne son horizon ; l'histoire n'est
plus une science, elle devient une province de l'art oratoire.
Tite-Live admire; il loue, mais souvent sans comprendre
et à tort. Rien de plus remarquable que cette
habile, patiente et opiniâtre politique du sénat, si bien analysée par Montesquieu, ce plan lentement développé
de conquête universelle : Tite-Live mesure aux règles de
la morale les combinaisons d'une politique froide et profonde.
Il croit avec Denys d'Halicarnasse que la domination
du monde a été accordée à Rome en récompense de
ses vertus. Institutions, discipline, calculs, intérêts,
ces ressorts et ces mobiles puissants, tout cela est à peine
indiqué : nous avons en échange une galerie de portraits,
des peintures de caractères, un panorama de vertus,
l'histoire dramatisée. Il se demande ce qui serait arrivé
si Alexandre fût venu en Italie. Il imagine une lutte
terrible du conquérant macédonien contre Rome. Alexandre eût été vaincu, dit-il ; n'était-il pas ivrogne,
orgueilleux, colère, débauché ? Les Romains étaient des
modèles de tempérance et d'égalité d'âme (1).
(1) IX, t6, et sqq.
Quand il
n'est pas injuste envers les peuples étrangers, il est méprisant.
«C'est un fardeau assez lourd, dit-il, de raconter les exploits de Rome, sans m'embarrasser des guerres
que se font entre eux les autres peuples. » Tout ce
qui touche Rome, au contraire, l'émeut et le passionne.
Auguste essayait de rendre la vie aux institutions et aux
croyances religieuses que le temps et le scepticisme
avaient minées : Tite-Live raconte avec un soin minutieux
tous les prodiges, tous les oracles anciens. Ses contemporains
n'y croient plus, et il le sait bien; mais les
grands hommes d'autrefois y ont cru, ils ont consacré par
des cérémonies publiques ces signes de l'intervention
céleste ; l'historien est obligé par un pieux scrupule à les
consigner dans son ouvrage (1).
(1) XLIII, 13.
C'est ainsi qu'il reproduit
la physionomie vivante des temps anciens, tels que se les
représentaient ses contemporains, c'est-à-dire sous
des couleurs fausses, mais éclatantes. Il a le sentiment
profond de la dignité de son oeuvre ; il la croit aussi sincèrement
utile. L'histoire de sa patrie lui semble le meilleur
et le plus éloquent cours de morale. On y trouvera,
dit-il, des exemples de toute sorte à imiter ou a fuir. Pour
lui, ce long ouvrage a été une consolation des misères
présentes ; dans la société des nobles âmes de l'antiquité,
il a pu oublier ce qui se passait à côté de lui. Ce grand
travail a été la nourriture de son coeur tourmenté.
C est cet esprit qui vivifie toutes les parties de l'oeuvre.
Qu 'on lise une narration, un discours, un portrait on sent l'homme dans l'historien, le citoyen ému, tour à tour plein d'orgueil ou de tristesse. Tite-Live a revécu pour ainsi dire les sept siècles qu'il raconte. Chacun des événements a produit sur lui son impression ; il le rapporte
non tel qu'il s'est passé réellement, mais d'après
l'émotion qu'il a ressentie lui-même. Il a revu ce forum
où retentissaient les véhémentes revendications des
tribuns ; il refait leurs discours, mais tels qu'il les prononcerait
lui-même si la vie publique l'appelait à ses
orages. Récits, discours, tout porte l'empreinte de la
personnalité même de l'auteur. Comme il connaît les
conséquences des événements qu'il rapporte, conséquences
ignorées des acteurs, il se sert de sa science pour
donner une couleur plus éclatante à ses narrations et
à ses discours. Par là il introduit dans l'histoire un élément
de plus, que j'appellerais le pathétique d'intuition,
et dont l'effet est tout-puissant. Qu'était-ce d'ailleurs que
ces prodiges, ces réponses d'augures ou d'aruspices
qu'il a consignés avec tant de soin dans son livre, sinon
un élément dramatique merveilleux, qui donne aux
hommes et aux événements je ne sais quoi de plus imposant?
Tite-Live a exercé une influence considérable sur la
plupart des historiens des temps modernes, comme Virgile
sur les faiseurs d'épopée. La critique de nos jours
n'admet plus un tel modèle. Le style, l'éloquence, la mise
en scène ne sont plus les premières qualités d'un historien.
Après les travaux des Niebhur, des Michelet et des
Mommsen, l'oeuvre de Tite-Live apparaît comme une
succession de scènes dramatiques admirablement traitées.
C'est ainsi que les contemporains d'Auguste comprenaient
l'histoire. Les dix premiers livres n'ont donc guère plus d'autorité que n'en auraient les Annales d'Ennius, si nous
les possédions. Le récit des guerres puniques est fait
d'après Polybe. Mais nous avons perdu les cent livres
qui étaient évidemment la partie la plus sérieuse et la
plus originale de l'histoire. Il reste du moins le style.
Quintilien compare Tite-Live à Hérodote, avec lequel
il n'a pas la moindre analogie. L'historien latin n'a pas
ce naturel exquis et ce pittoresque naïf; mais sa diction
est plus imposante, plus variée, plus animée. Il a moins
de transparence que Cicéron ; mais souvent plus de relief, mais il serait injuste de
ne pas y ajouter l'énergie. C'est une des formes de l'éloquence.
Il y a bien peu de discours de Tite-Live
dans lesquels la passion ne crée des expressions rapides,
pleines de sens et de portée. Quant à l'accusation de
patavinité dirigée contre lui par Asinius Pollion, on
se demande encore aujourd'hui ce qu'elle signifie. Suivant
les uns, elle faisait allusion à la partialité de Tite-Live pour les Padouans, ou bien à son pompéianisme ; suivant d'autres, ce serait un défaut de style, des taches
de provincialisme. Avouons humblement que la patavinité de Tite-Live nous échappe, ou ayons le courage
de déclarer avec M. Daunou qu'Asinius Pollion n'a dit
qu'une sottise : on sait d'ailleurs, ajoute-t-il, qu'il en a débité beaucoup d'autres.
LIVRE QUATRIÈME
Ce qu'on appelle la décadence. — La famille des Sénèque. — Sénèque le Rhéteur. — Sénèque le Philosophe. —Le poëte Lucain. — Perse. — Pétrone.
§ I.
On donne généralement le nom d'écrivains de la décadence
à ceux qui vécurent après le règne d'Auguste. On
établit, il est vrai, une certaine différence entre eux et
ceux qui les suivirent. Les premiers ne sont que des
demi-barbares, les autres ne méritent guère qu'on s'y
arrête. Tous appartiennent à la décadence, c'est-à-dire
à cette période fort étendue qui commence au règne de
Tibère et finit à celui d'Augustule ; et la valeur de chacun
d'eux est en raison directe de sa proximité ou de son
éloignement de l'un des deux termes. Ce n'est pas là
une critique sérieuse. Acceptons, je le veux bien, ce mot
de décadence, mais essayons d'en bien déterminer le
sens et la portée.
Il est incontestable que des écrivains comme Perse,
Sénèque, Juvénal, Tacite, sont inférieurs à Horace, à
Cicéron, à Tite-Live, sous le rapport de la composition
et de la langue. Vous chercheriez en vain chez eux cette
proportion exacte dans toutes les parties de l'oeuvre, cette unité, cette mesure, cette exquise propriété des
termes d'où résulte la clarté lumineuse ; j'ajoute même
qu'ils n'ont ni la simplicité ni la grâce de leurs devanciers.
Mais quoi? si ces qualités sont moindres chez
eux, ils en possèdent d'autres. La première, celle qui les
renferme toutes, c'est l'originalité.
En quoi consiste-t-elle? Ils sont les hommes de leur
temps. Époque misérable et désastreuse, je le veux bien,
mais il n'en est pas des productions de l'esprit comme
des fruits de la terre que la sécheresse ou les pluies détruisent
dans leur germe : les âmes fortes réagissent
contre les misères qui les entourent, souvent elles s'en
inspirent; elles en tracent des peintures ineffaçables, ou,
d'un vol puissant s'élevant au-dessus des calamités et des
turpitudes, se créent à elles-mêmes un asile sublime.
Otez à Tacite et à Juvénal les Césars et leur tourbe,
vous supprimez Tacite et Juvénal. Sans les règnes de
Caligula, de Claude, de Néron, le stoïcisme romain, ce
dernier rayon de la vertu antique, n'eût point existé tel
que nous le connaissons Eh bien ! pour peindre une
société dont rien dans le passé ne pouvait donner une
idée, il fallait une éloquence et une poésie nouvelles. Les
belles et sereines descriptions de Tite-Live, les harangues
majestueuses écoutées avec recueillement, les narrations
savamment conduites, le développement des faits
accomplis pour la gloire de Rome, dans la pleine lumière
de la liberté, sous les yeux de tous : tout cela est interdit
à l historien des Césars. D'autres couleurs, un autre
style, une autre langue même, sont nécessaires. Tacite
a créé l'instrument qu'il lui fallait. C'est un génie
original. J 'en dirai autant de Juvénal. Ne lui demandez
pas la grâce, l'urbanité, la mesure d'Horace. Horace ne connaît ni Séjan, ni Messaline, ni Domitien : les
saturnales des Césars veulent un autre style. Les écrivains
qui l'ont trouvé, ce style, et qui l'ont marqué à
jamais de leur forte empreinte, je ne puis voir en eux
des hommes de décadence.
Il faut réserver cette désignation pour les auteurs fort
nombreux alors qui furent des imitateurs. Ceux-là n'ont
pas d'idées qui leur soient propres, ils n'ont pas de style ;
ce sont des empreintes effacées. Les poëtes s'essayent
péniblement à refaire l'Énéides, ou les Bucoliques : ils
copient les personnages de Virgile, les épisodes, les descriptions,
et jusqu'aux épithètes. On sentait déjà dans le
modèle le factice, la convention ; chez ses imitateurs, on
ne sent plus que cela. Voilà la véritable décadence ;
la décadence incurable ; car elle est avant tout stérilité.
Gardons-nous donc de confondre dans une même catégorie
des écrivains qui ont su rester originaux, et de
froids plagiaires. Je ne fais qu'indiquer ici cette distinction
que je crois capitale : les études qui suivront la
rendront plus sensible.
§ II.
Sénèque (Lucius Annaeus Seneca) est né en Espagne,
à Cordoue, colonie patricienne riche et florissante,
l'an 3 de l'ère chrétienne. Il appartenait à une famille
équestre. Sa mère, Elbia ou Elvia,!était d'origine espagnole,
mais romaine par le coeur et l'énergie. Son père
vint à Rome sous le principat d'Auguste, s'y fixa, y fut
très considéré et acquit une assez grande fortune. Il était
rhéteur. Avant Cicéron et du temps même de Cicéron,
les jeunes Romains allaient chercher en Grèce les leçons d'un art indispensable pour quiconque se consacrait à la
vie publique. Il y avait alors fort peu de rhéteurs latins,
et leur enseignement pâlissait auprès de celui des héritiers
d'Aristote, de Démétrius de Phalère et de tant de
maîtres illustres. Quand Auguste eut pacifié l'éloquence,
c'est-à-dire l'eut renfermée dans l'étroite enceinte du
barreau, il n'y eut plus d'orateurs proprement dits, il y
eut des plaideurs de causes (causidici). Sénèque le père
fut un des professeurs les plus habiles d'un art qui
mourait pour ainsi dire d'inanition. « Ce sont les grands
sujets qui nourrissent l'éloquence, » dit Tacite : or dans
ce complet apaisement de la vie publique, l'art de bien
dire dut se renfermer dans les limites des débats judiciaires.
Cependant si l'on ne trouve dans l'histoire du temps
aucun vestige sérieux de l'ancienne éloquence politique,
il en subsistait encore comme une ombre dans les écoles
des rhéteurs. Leur enseignement comprenait deux exercices
bien distincts : les controverses, ou plaidoyers d'une
cause fictive, imaginée le plus souvent pour mettre en
opposition deux textes de lois contradictoires. Des
élèves, deux avocats stagiaires, étaient mis aux prises, ils
se préparaient, en plaidant des causes impossibles à n'apporter
dans des causes réelles que paradoxes ou jeux
d'esprit. Voilà ce qu'était devenu le genre judiciaire.
Quant au genre délibératif, les jeunes gens s'y exerçaient
au moyen des suasoriae. On appelait ainsi des discours
ou plutôt des consultations oratoires sur des sujets donnée
par le maître. Quelques-uns de ces sujets étaient de pures
fantaisies historiques, comme la délibération d'Alexandre
pour savoir s'il s'embarquera sur l'Océan, s'il entrer
dans Babylone. D'autres avaient un caractère moins
vague et exigeaient autre chose que de l'esprit, par exemple, la délibération des Spartiates aux Thermopylos
en présence de l'immense armée des Perses. D'autres
enfin étaient empruntés à des événements récents encore,
et qui pouvaient raviver ou entretenir bien des
souvenirs et bien des haines : tel le discours que se
faisait à lui-même Cicéron pour s'encourager à braver
Antoine en face plutôt que de s'humilier et de lui demander
la vie. Il y a de belles phrases, éloquentes, généreuses
dans les amplifications que Sénèque le père nous a conservées
sur ce sujet. Mais on sent bien que c'est là un
héroïsme de parade, j'allais dire de commande. L'imaginalion
en fait presque tous les frais. La génération qui
grandit sous Auguste sait bien qu'elle ne sera jamais mise
en demeure de braver un triumvir, et de mourir pour la
défense de la liberté et des lois. Où sont les orages du
Forum, les Clodius, les Cicéron, les Antoine ? Le prince
a donné à la patrie des loisirs : rien ne semble changé
dans la constitution de l'État; plus imposante même
apparaît la majesté de ce grand corps. Il ne manque que
le mouvement.
On donnait à ces exercices divers le nom de déclamalions.
Cicéron nous apprend qu'en Grèce et à Rome
il déclamait des causes
active, aux luttes du Forum ou du Sénat. Sous
les empereurs, la déclamation ne préparait guère qu'à la
déclamation : elle avait été un moyen, elle devint un but.
Bientôt ce fut comme le ton général de toute la littéral
ture. Ce qui la distingue en effet, c'est une disproportion
choquante entre le fond du sujet et le style : la déclamation
n'est pas autre chose. On sort du réel et de la vérité
pour se guinder au-dessus, et on tombe à côté ou au-dessous. Quand la vie publique existait encore, l'expérience
de chaque jour, les événements eux-mêmes
avaient bientôt corrigé et redressé ce que ces exercices
avaient de conventionnel et de faux; mais, ce salutaire enseignement venant à manquer, le vide et le factice
subsistèrent seuls.
Telle fut la première école de Sénèque. Par là s'expliquent
un grand nombre de ses défauts comme écrivain;
je suis même convaincu que l'habitude de la déclamation
n'a pas été sans influence sur la conduite de sa vie. Cette
disproportion choquante entre ce que l'on a à dire et la
manière dont on le dit, se traduit toujours quelque peu
dans les actes. Quand on est si riche en belles paroles, on
s'habitue plus aisément à une certaine pauvreté dans les
actions, et l'esprit supplée trop souvent aux défaillances
de la conscience.
Sénèque le père fut le précepteur de ses fils, et tous
trois se distinguèrent dans l'éloquence. L'aîné Annaeus
Novatus, appelé plus tard Gallion, parce que
l'adoption l'avait fait entrer dans une famille de ce nom,
suivit la carrière des honneurs, et fut proconsul à
Corinthe où il eut à juger saint Paul. Le dernier des
frères de Sénèque fut Lucius Annaeus Mela, qui fut
le père de Lucai
. Seul des trois, il eut pour l'éloquence un culte désintéressé : il ne lui demanda ni les honneurs ni
la réputation. Cette sage réserve lui valut la préférence
de son père. « Tu avais, dit-il à son fils, l'esprit plus
vaste que tes frères, et ouvert à tout ce qui est bien. Ce
qui prouve son excellence, c'est que ses qualités ne l'ont
point corrompu, et que tu n'as jamais eu la tentation
d'en mal user. Tes frères, emportés par des pensées ambitieuses, se préparent au Forum et aux honneurs;
carrière où l'on doit redouter même ce que l'on espère.
J'ai peut-être souhaité qu'ils y fissent leur chemin ; j'ai
peut-être approuvé le choix d'une carrière dangereuse,
pourvu toutefois qu'on s'y conduisît avec honnêteté ;
mais aujourd'hui que tes deux frères sont lancés en
pleine mer, souffre que je te retienne au port. »
Voilà le milieu dans lequel Sénèque fut élevé ;
moeurs pures, vie studieuse et honnête, bons exemples
et sages conseils. Il en subit longtemps la salutaire influence.
Mais une imagination très vive, la soif du nouveau,
de l'imprévu, le livrèrent bientôt à tous les
hasards de la vie, sans qu'il fût suffisamment préparé
par une forte gymnastique morale. A dix-sept ans, l'activité
de son esprit le porte de tous les côtés à la fois.
Disciple de son père dans l'école, bientôt avocat, déjà
célèbre, brusquement il abandonne cette carrière, déserte
les rhéteurs et passe aux philosophes. Il se
passionne pour la mâle discipline de Sotion, d'Attale, de
Démétrius ; le voilà qui renonce à tous les plaisirs, à
tous les agréments de la vie. Son vêtement est pauvre, il
couche sur la dure, il s'abstient de manger de la viande :
c'est un ascète. Son corps naturellement chétif dépérit ;
son père s'inquiète, lui montre Tibère qui surveille d'un
oeil inquiet ces prédicateurs d'une morale nouvelle et
qui va les chasser de Rome. Sénèque consent à modérer
ses austérités, mais il lui en resta toujours quelque
chose: «A partir de ce jour, dit-il, je renonçai pour
toujours aux huîtres, aux champignons, aux parfums,
je cessai de boire du vin. » Cette première réforme, on
le voit, laissa en lui des traces profondes. Il faut donc
renoncer à faire de Sénèque un épicurien viveur, qui vante les charmes de la pauvreté au sein du luxe et de la
mollesse. Je passe plus rapidement sur les autres événements de sa vie. Nous le voyons tour à tour avocat illustre, honoré de la questure, puis abandonnant la vie publique et suivant un de ses oncles en Égypte. Là,
il se plonge dans les études archéologiques, il compose
un ouvrage sur l'Inde, un autre sur les moeurs et la
religion des Egyptiens, un troisième sur les tremblements de terre. Il mêle à ces travaux la distraction des vers ;
il semble avoir oublié Rome, le barreau, les dignités publiques. Puis il retourne à tout cela ; il plaide de
nouveau et devant Caligula, dont il excite la jalousie, et
qui songe à le faire périr ; sa mauvaise mine le sauva.
« Il va mourir de phthisie, dit une courtisane à l'empereur, à quoi bon le tuer ? » Claude succède à Caligula, et Sénèque est condamné à l'exil. Il est accusé de complicité dans les désordres de Julie, fille de Germanicus,
et c'est Messaline qui l'accuse. Le crime et
l'accusateur semblent bien singuliers; et il m'est bien
difficile d'y ajouter foi. Je hasarderai une conjecture. Ce
fut la coutume des Césars, imités en cela par les sultans,
d'éloigner ou de faire périr à leur avénement les parents
ou les personnages illustres qui pouvaient être
un danger. Tibère tue Agrippa Posthumus et trois
sénateurs auxquels Auguste avait songé à laisser l'empire.
Claude fait périr Vinicius, mari d'une fille de Germanicus,
nom cher aux Romains. Caligula fait égorger
son beau-père Silanus, puis le jeune Tibère. Néron fera
mourir Britannicus, puis Rubellius Plautus, dernier
descendant d'Auguste. Sénèque fut probablement enveloppé
dans la disgrâce de Vinicius et de sa femme; et
l'on transforma en intrigue d'amour une intrigue politique qui n'existait peut-être pas. Ce qui donne à
cette hypothèse quelque fondement, c'est le rappel immédiat
de Sénèque, dès qu'Agrippine, autre fille de
Germanicus, devient la femme de Claude. Il est certain
d'ailleurs que cet exil ne nuisit en rien à la considération
de Sénèque. Il osait dire à sa mère : « On n'est pas malheureux
dans un exil, où l'on est suivi de l'estime de tous
les citoyens vertueux. » Joignons à son témoignage celui
de l'inflexible Tacite. « Cependant Agrippine, afin de ne
pas se signaler uniquement par le mal, obtint pour Sénèque le rappel de l'exil et la dignité de préteur, persuadée que cet acte serait généralement applaudi, à cause de l'éclat de ses talents, et bien aise aussi que l'enfance de Domitius grandît sous un tel maître, dont les conseils pouvaient d'ailleurs leur être utiles à tous deux pour arriver à la domination. Car on croyait Sénèque dévoué à Agrippine par le souvenir du bienfait, ennemi de Claude par le ressentiment de l'injure. »
Je ne suivrai pas Sénèque dans tous les détails de sa vie à la cour de Claude et de Néron. Qu'il ait été animé
des meilleures intentions, qu'il ait conçu les plus belles
espérances de son élève, on ne peut le contester. Mais
les difficultés qu'il devait rencontrer étaient au-dessus de
ses forces et de son énergie morale. Agrippine comptait
trouver en Sénèque un instrument docile ; elle se
trompa. Sénèque l'aida à préparer le règne de Néron ;
mais il n'alla pas au delà. II combattit même son influence,
quand elle voulut en user pour se venger de tous
ceux qui lui faisaient ombrage, et quand elle réclama impérieusement
la première place dans le gouvernement.
Il faut bien se rendre compte de la situation déplorable
faite à Sénèque. Il voulait arracher Néron à la direction funeste de sa mère, .et en faire un empereur
accompli : mais il était l'obligé d'Agrippine, et comme
tel condamné à certains ménagements. De là je ne sais
quoi d'équivoque et de louche dans sa conduite. Pendant
cinq années, il triompha d'Agrippine; il triompha même
du naturel féroce et lâche de son élève ; il fit de Néron le
modèle des empereurs, un Auguste adolescent. Il composait
pour lui et lui faisait débiter au Sénat des discours
admirables, qui promettaient à Rome le retour de l'âge
d'or ; il lui soufflait des mots heureux que l'on avait soin
de faire courir (Je voudrais ne pas savoir écrire !) ; bref,
il lui créait, pour ainsi dire, des antécédents de vertu,
pensant par là enchaîner cette âme faible et violente.
Mais de tous les côtés on ruinait son oeuvre : Agrippine
détournait son fils de la philosophie : « Elle ne vaut rien
pour un empereur, » lui disait-elle ; elle lui voulait des
vices afin de le tenir par là ; puis venait la tourbe des
affranchis et des jeunes amis de César, qui ne pouvaient
subsister si César restait honnête. Il échappa insensiblement
à Sénèque. Celui-ci voulut ressaisir son influence,
disputer à d'indignes concurrents l'âme du prince. De là
des concessions toujours nouvelles, toujours impuissantes;
delà enfin une sorte de complicité dans les actes
monstrueux du règne de Néron. Il est absolument
étranger à l'empoisonnement de Britannicus; mais, le
crime accompli, il devait se retirer, et ne plus rentrer
chez César par la porte d'où sortait Locuste. Il ne s'est
pas opposé au meurtre d'Agrippine, devenue son ennemie,
d'Agrippine qui rêvait l'inceste, et dont il ne pouvait
considérer la mort comme un malheur public ; mais on
ne peut douter qu'il n'ait écrit lui-même la lettre justificative
du meurtre que le prince adressa au Sénat. Il croyait sans doute que Néron, débarrassé enfin de cette
funeste conseillère, reviendrait aux sentiments honnêtes.
L'illusion fut de courte durée. « Il se précipita, dit Tacite,
dans toutes les débauches, dès qu'il ne fut plus retenu
par le respect quelconque qu'il gardait encore à sa
mère. » Il passe de Poppée à Sporus, à Pythagoras ;
il se donne en spectacle aux Romains, répudie et fait
exécuter Octavie, incendie Rome, se débarrasse de
Burrhus par le poison. Alors Sénèque, associé à
l'ignoble Tigellinus, veut quitter la cour, rendre à César
tous les biens qu'il en a reçus. Il était trop tard. Néron
cherche à l'empoisonner d'abord, puis l'implique dans la
conjuration de Pison et lui ordonne de mourir. On
peut voir le récit de ses derniers instants dans Tacite (1).
Deux traits à relever : Sénèque dit à ses amis : « Je vous laisse ce que j'ai de plus beau, l'image de ma vie : conservez-en le souvenir, et vous emporterez la réputation d'hommes de bien et d'amis fidèles. » Et celu-ici
: « Les conjurés avaient résolu, si leur entreprise réussissait, de se débarrasser de Pison, et de donner l'empire à Sénèque, comme à un homme sans reproche et que l'éclat de ses vertus appelait au premier rang. »
Tel fut l'homme. Il aimait la vertu, je dirai même qu'il
avait pour elle une sorte de passion ; il en était « enivré»,
comme Rousseau, mais cela ne suffit pas. L'enthousiasme
est un état violent qui transporte l'àme à des
hauteurs sublimes, où elle ne peut se maintenir : la pratique
des devoirs de la vie réelle exige au contraire une
succession d'efforts persévérants, et surtout le calme
d'un esprit maître de lui-même. Chez Sénèque, l'énergie de la volonté ne fut pas en rapport avec la puissance
de l'imagination. Il ne semble pas non plus avoir eu une
notion très nette de la réalité : de là les illusions étranges
? qu'il conserva si longtemps et l'attitude compromettante
qu'il se laissa imposer. Il a parfois l'air d'un complice ;
il est plutôt dupe en attendant qu'il devienne victime.
Cette indécision, ces aspirations généreuses suivies de
chutes lourdes, cette élévation admirable dans la théorie avec je ne sais quoi de vague et d'incertain sur tous les ? points fondamentaux, beaucoup d'esprit et peu de clairvoyance, tout cela nous le retrouverons dans ses écrits.
§ III.
Nous n'en possédons guère que la moitié. En voici la
liste ; on verra que cet esprit curieux s'était porté dans
toutes les directions.
Sur la colère (De ira libri tres), ouvrage dédié à son
frère Novatus, et écrit sous Caligula. Il est probablement
incomplet, car Lactance en cite des définitions qui ne se
trouvent pas dans le texte que nous possédons.
De consolatione ad Helviam matrem. — Consolation
à sa mère Helvia. Ouvrage composé pendant son exil en
Corse. Juste Lipse y joint neuf épigrammes sur son exil.
Consolation à Polybe. De consolatione ad Polybium.
— Polybe était un affranchi de Claude qui avait
perdu son frère, Sénèque exilé l'accable de flatteries
misérables. Quelques critiques se refusent à admettre
l'authenticité de cet ouvrage, et je me rangerais volontiers
à leur avis.
Consolation à Marcia. De consolatione ad Marciam. —
Marcia, tille de Crémutius Cordus, venait de perdre son fils. Sur la Providence. De providentia. — Incomplet vers la fin.
Sur la paix de l'âme. De animi tranquillitate. —
Ouvrage dédié au préfet des gardes de Néron, Annaeus
Serenus.
Sur la constance du sage. De constantia sapientis.—
Au même.
De la clémence. De clementia libri tres ad Neronem.
— Des trois livres qui formaient cet ouvrage, il ne
reste plus que le premier et une partie du second. Calvin
écrivit un commentaire sur ce traité.
De la brièveté de la vie. De brevitate vitae. — Ouvrage
dédié à Paulinus, et composé peu de temps après la
mort de Caligula.
De la vie heureuse. De vita beata. — Dédié à son frère
Gallion. Saint Ambroise a traité le même sujet en
chrétien, et Descartes en a écrit un commentaire.
Sur le loisir du sage. De otio sapientis. — Ce n'est
guère qu'un fragment.
Sur les bienfaits. De beneficiis libri septem.— Ouvrage
considérable, dédié à Ébutius Liberalis. Appartient à
la dernière époque dela vie de Sénèque.
Lettres à Lucilius. Epistolae ad Lucilium. — Sont au
nombre de cent vingt-quatre.
Questions naturelles. Naturalium quaestionum libri septem. — Ouvrage de physique et de morale à la fois.
L'apocoloquintose sive Ludusin Claudium. — Pamphlet bouffon où Sénèque raconte ce qui
se passa dans l'Olympe après la mort de Claude, et la
métamorphose de cet empereur en citrouille.
Les ouvrages perdus sont des vers et des poëmes, des
harangues et des plaidoyers, des traités de morale sur différents sujets ; un livre sur la superstition, souvent
mentionné par saint Augustin ; des exhortations ; des
écrits sur l'Inde, l'Égypte, les tremblements de terre, la
forme du monde. On lui en attribua dans la suite
beaucoup d'autres encore, lorsque l'on s'avisa d'en vouloir
faire un chrétien : telles sont les fameuses lettres à
saint Paul dont nous parlerons plus loin. Quant aux
poëmes, disons dès à présent que nous regardons Sénèque
comme l'auteur des tragédies qui portent ce nom, sauf,
bien entendu, celle d'Octavie.
Une analyse de chacun des ouvrages de Sénèque est
impossible, ou demanderait des développements qui ne
peuvent trouver place ici. Je me bornerai donc à exposer
les idées qu'ils renferment, les problèmes dont il donne
la solution, voilà pour le fond ; puis la composition et le
style de ses écrits.
§ IV.
Sénèque est pour nous le représentant le plus complet de la grande doctrine stoïcienne, mais il n'en est pas le plus exact. Ce n'est pas un simple interprète. Sur plus d'un point il s'émancipe et substitue à l'autorité des maîtres de la Grèce sa propre réflexion. En cela il est bien un Romain, et c'est avec raison qu'il dit : « Je ne me suis fait l'esclave de personne, je ne porte le nom de personne. » Mais s'il a conservé sa propre originalité, il n'a pu produire une oeuvre d'une assez forte unité pour qu'elle mérite le nom de système. J'indiquerai autant que possible les points sur lesquels il innove, et le caractère de ses innovations.
PHILOSOPHIE RELIGIEUSE.
On sait ce qu'était devenue la religion ancienne ; longtemps
avant Sénèque, la vie s'en était retirée. Il n'y avait
pas à Rome un esprit éclairé qui acceptât les fables du
polythéisme ou les pratiques de superstition empruntées
aux cultes de l'Orient. Sénèque méprise profondément
toutes ces puérilités. Je ne suis pas assez sot, dit-il,
pour croire à de telles fadaises. Il est fort regrettable
que nous ayons perdu son ouvrage sur la superstition,
dont Lactance et saint Augustin ont tiré tant d'arguments
contre le polythéisme ; mais il suffit d'indiquer ce point
en passant. La théologie des poëtes lui paraît absurde et
irrévérencieuse. Quant aux pratiques superstitieuses, il
les condamne en deux mots : elles substituent à l'amour la crainte ; au lieu d'être un culte, elles sont un outrage.
Mais la religion est
une institution de l'État, institution nécessaire, et que
maintenaient avec énergie des hommes comme Cicéron
et Varron. Sénèque s'occupe peu du polythéisme officiel,
et cela se conçoit : de son temps la religion comme tout le
reste était dans la main d'un seul, et elle avait perdu
beaucoup de son importance comme instrument politique.
Cependant il approuve que le sage se soumette aux
prescriptions de la cité, non qu'il les regarde comme
agréables aux dieux, mais parce qu'elles sont ordonnées
par la loi. « Quant à la tourbe des dieux qu 'a accumulés
une longue superstition, si nous les adorons, nous n 'oublierons
point qu'un tel culte n'a d'autre fondement que
l'a coutume. » Reste la théologie naturelle, c 'est-à-dire
la religion du philosophe : en quoi consiste-t-elle ?
Sénèque emploie indifféremment, en parlant de la puissance divine, le singulier et le pluriel, Dieu et les
dieux : c'est par un reste de respect pour la croyance
populaire. Car pour lui, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce
Dieu se présente pour ainsi dire à l'esprit sous une foule
d'aspects différents : de là les noms divers qu'il a reçus
et cette espèce de fractionnement de la puissance divine
en une foule d'êtres divers. « Tous les noms qui renferment
une indication de sa puissance lui conviennent : autant il prodigue de bienfaits, autant d'appellations il
peut recevoir. » Ainsi se justifient ces noms de Jupiter, de
Liber, d'Hercule, de Mercure, etc. Mais il ne s'arrête
pas là, il consent encore à ce qu'on donne à Dieu des
noms plus larges. « Voulez-vous l'appeler nature? Vous
ne vous tromperiez point; car c'est de lui que tout est né,
lui dont le souffle nous fait vivre. Voulez-vous l'appeler
monde? Vous en avez le droit. Car i! est le grand tout
que vous voyez ; il est tout entier dans ses parties, il se
sout ient par sa .propre force, » On peut encore l'appeler
destin. « Car le destin n'est pas autre chose que la série
des causes qui s'enchaînent, et il est la première de toutes
les causes, celle dont dépendent toutes les autres. »
« Qu'est-ce que Dieu ? dit-il ailleurs. L'âme de l'univers. Il
échappe aux yeux, c'est la pensée seule qui peu l'atteindre. »
Toutes ces définitions sont plus ou moins empruntées
au stoïcisme scientifique. Mais Sénèque, par une inconséquence
qui n'est pas rare chez lui, va bien au delà. Ce
dieu, destin, nature, monde, est pour ainsi dire séparé
de l'univers ; il le domine, il le gouverne, il le conserve,
il a souci de l'homme, parfois même de tel ou tel homme
en particulier. Il a
prodigué au genre humain d'innombrables bienfaits, et
l'ingratitude ne peut en borner le cours. Du reste Dieu est forcé par sa nature d'être bienfaisant : la bienfaisance
est comme la condition de son être.
Quel culte réclament les dieux? «Le premier culte à
leur rendre, c'est de croire à leur existence, puis de reconnaître
leur majesté, leur bonté, sans laquelle il n'y a
pas de majesté, de savoir que ce sont eux qui président
au monde, qui gouvernent l'univers par leur puissance,
qui sont les protecteurs du genre humain. » « Ils ne peuvent
ni faire ni recevoir une injustice. » Donc ne cherchez
pas à vous les rendre favorables par des prières, des
offrandes, des sacrifices. « Celui-là rend un culte à Dieu
qui le connaît. » (Deum coluit qui novit.)
Il serait difficile de tirer de toutes ces définitions une
théodicée logique. Sénèque ne l'a jamais essayé. Il a des
aspirations très hautes, et comme le sentiment du divin
en lui; mais jamais sur ce point ses idées n'ont eu cette
précision rigoureuse qu'exige la science. Je veux citer un
des plus beaux passages que lui ait inspirés cette sorte
d'enthousiasme religieux.
« En vain élèverez-vous les mains vers le ciel ; en
vain obtiendrez-vous du gardien des autels qu'il vous
approche de l'oreille du simulacre, pour être mieux
entendu : ce Dieu que vous implorez est près de vous ;
il est avec vous, il est en vous. Oui, Lucilius, un esprit
saint réside dans nos âmes ; il observe nos vices, il surveille
nos vertus, et il nous traite comme nous le traitons.
Point d'homme de bien qui n'ait au dedans de lui un
Dieu. Sans son assistance, quel mortel s'élèverait au-dessus
de la fortune ? De lui nous viennent les résolutions
grandes et fortes. Dans le sein de tout homme vertueux,
j'ignore quel Dieu, mais il habite un Dieu. S'il s'offre à
vos regards une forêt peuplée d'arbres antiques dont les cimes montent jusqu'aux nues, et dont les rameaux
pressés vous cachent l'aspect du ciel ; cette hauteur démesurée,
ce silence profond, ces masses d'ombre qui de
loin forment continuité, tant de signes ne vous annoncent-ils pas la présence d'un Dieu? Sur un antre formé
dans le roc, s'il s'élève une haute montagne, cette immense
cavité, creusée par la nature, et non par la main
des hommes, ne frappera-t-elle pas votre âme d'une
terreur religieuse ? On vénère les sources des grandes rivières,
l'éruption soudaine d'un fleuve souterrain fait
dresser des autels ; les fontaines des eaux thermales ont
un culte, et l'opacité, la profondeur de certains lacs les
a rendus sacrés : et si vous rencontrez un homme intrépide
dans le péril, inaccessible aux désirs, heureux dans
l'adversité, tranquille au sein des orages, qui voit les autres
hommes sous ses pieds, et les dieux sur sa ligne,
votre âme ne serait-elle pas pénétrée de vénération ?
Ne direz-vous pas qu'il se trouve en lui quelque chose de
trop grand, de trop élevé, pour ressembler à ce corps chétif
qui lui sert d'enveloppe? Ici le souffle divin se manifeste. »
Si nous ajoutons à cette belle page quelques mots
échappés au philosophe ici ou là, nous saurons quel est
son Dieu. C'est l'homme, non l'homme vulgaire, mais
celui qu'il appelle le sage. Celui-là en effet est non-seulement
placé sur la même ligne que les dieux, mais il
leur est supérieur. En quoi ? Le voici : « Le sage ne
diffère de Dieu que par la durée. » Mais, dira-t-on, Dieu est exempt de
toute crainte. Le sage aussi, et il a cet avantage sur Dieu,
que Dieu est affranchi de la crainte par le bienfait de sa
nature, le sage, par lui-même. Que de fois il revient sur
cette pensée ! « Supportez courageusement ; c'est par là que vous surpassez Dieu. Dieu est placé hors de l'atteinte
des maux, vous, au-dessus d'eux. » Je ne doute pas que
ce ne soit là le point par lequel la philosophie religieuse
de Sénèque se noue pour ainsi dire à sa philosophie morale.
La métaphysique chez lui tient fort peu de place;
il raille ceux qui s'occupent de ces chimères. A-t-on le
loisir de poursuivre la solution de ces questions oiseuses ?
Les malheureux nous appellent. C'est de l'homme qu'il faut s'occuper; c'est lui qu'il
faut affermir, consoler, encourager. Que de misères pesaient
alors sur lui! que de dangers l'environnaient! Il
fallait tremper fortement les âmes, les armer contre
toutes les terreurs ; et puisque les dieux semblaient morts
ou indifférents aux choses humaines, puisqu'ils toléraient
les épouvantables désordres qui s'étalaient alors, et que
de ce côté l'innocence et la vertu ne pouvaient espérer un
appui, il fallait élever l'homme lui-même à une telle hauteur,
qu'il pût braver ou mépriser toutes les misères,
tous les périls, tous les ennemis, tous les Césars, tous les
bourreaux. Voilà l'âme du stoïcisme romain sous les empereurs.
Les cieux sont vides, les dieux sont partis, ou
ils sont favorables aux scélérats; l'homme de coeur se
fera Dieu. Il rêvera une vertu parfaite, une âme inaccessible
à toute passion, sévère, grave, inébranlable. C'est
l'idéal qui hante alors toutes les imaginations. Rappelez-vous le
vers célèbre de Lucain :
Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni.
Que veut-il dire, sinon que Caton est supérieur aux dieux?
Conception démesurée, étrange, rêve d'un orgueil colossal!
Soit; mais quelle force pour une âme noble, qui est
soutenue par une telle vénération d'elle-même!
PHILOSOPHIE MORALE. — LES PASSIONS.
Cet être parfait n'existe pas, il est vrai. « C'est un
phénix qui ne naît que tous les cinq cents ans. » Mais le but que tout homme doit se proposer, c'est de s'approcher
de plus en plus de cet idéal. Si l'on ne peut être le sage ?
arrivé à la perfection (perfectus), on peut être le sage en
marche pour y arriver (proficiens). Bien des obstacles sur
la route. Au premier rang Sénèque, fidèle à la doctrine
stoïcienne, place les passions. Les péripatéticiens se bornaient
à les régler, les stoïciens les supprimaient. (Nostri
expellunt, Peripatetici temperant.) L'âme jouissait alors
de cet heureux état qu'ils appelaient insensibilité, sérénité. Les passions sont donc un mal? Oui,
car la vertu aussi bien que la raison (choses identiques
pour les stoïciens), c'est la ligne droite ; les passions au
contraire sont l'écart ; la joie et la douleur élèvent ou
abaissent l'âme à l'excès, la font sortir de cette tension qui est l'invariable état de la raison. Le sage ne
doit donc ressentir ni la joie, ni le désir, ni la crainte. Il
remplace ces mouvements excessifs, désordonnés, par la
sérénité, la volonté, la
circonspection. Cependant, comment
bannir entièrement ces mouvements involontaires qui
surprennent l'âme? Sénèque ne nie point ces impressions
fatales : comment se défendre d'un mouvement
d'effroi, si l'on est transporté au sommet d'une tour et
suspendu au-dessus d'un abîme? Comment empêcher
les larmes de couler quand la mort ravit à nos côtés un
être cher? « Dans ces assauts subits, la partie raisonnable
de nous-mêmes ressentira un léger mouvement. Elle éprouvera comme une ombre, un soupçon de passions; mais elle en restera exempte. » En vain les péripatéticiens prétendent que les passions ont leur raison d'être, qu'elles
sont naturelles et doivent aider à la vertu.
Sénèque ne veut point de ces dangeireux
auxiliaires; c'est déjà bien assez qu'elles troublent
parfois la raison d'un choc imprévu. Mais, lui dit-on, ces mouvements nous déterminent souvent au bien.
Ainsi la colère peut produire la valeur, la crainte peut former la prudence, etc. ; il suffit de contenir et de diriger l'impulsion première. Une âme sans passions, dit Diderot, est un roi sans sujets. Sénèque les repousse comme des
maladies : une fois admises, elles envahiraient tout
l'être ; leur élan est celui d'un cheval emporté, d'un
corps entraîné sur une pente rapide : dès lors plus de repos pour le sage. Il bannit même la pitié. C'est un sentiment
douloureux qui trouble l'âme. Mais, lui dit-on, ce
sentiment nous pousse à soulager le malheureux. Le
sage n'a pas besoin d'y être poussé par une impression
pénible : il sait ce qu'il doit à ses semblables ; il viendra
à leur aide, mais il n'éprouvera point la pitié.
Ainsi armé, le sage descend dans l'arène. Il ne s'attache
à aucun des prétendus biens où les hommes font
consister leur félicité, il ne redoute aucun des maux qui
les effrayent. Il n'y a d'autre bien et d'autre mal que le
bien moral et le mal moral. Nul ne peut nuire à celui qui
ne se nuit pas à lui-même. On redoute l'exil, la pauvreté,
la mort : il faut prouver à ces poltrons que ces objets de
leur épouvante ne sont que de vains fantômes. Qu'importe
le lieu assigné pour demeure à l'homme de bien ?
Ne peut-il partout être vertueux? La paix de son âme dépend-elle du climat? Qu'est-ce que la pauvreté? le
manque de choses superflues, absolument inutiles ; il
faut si peu de chose pour vivre. Qu'est-ce enfin que la
mort? une nécessité de la nature. Qu'importe l'heure à
laquelle il faudra payer la dette ? Quoi ! une femme qui
accouche, un gladiateur dans l'arène, braveront la mort,
et le sage s'en effrayerait ! Je n'insiste pas sur les arguments
répétés à satiété par Sénèque et qui ne lui appartiennent
pas en propre. Mais il est un point sur lequel
il importe de fixer l'attention. Pourquoi Sénèque ne
cesse-t-il de présenter à nos yeux ce triple épouvantail,
l'exil, la pauvreté, la mort? Pourquoi ce luxe de démonstrations
éloquentes, passionnées, fiévreuses souvent?
Montaigne en a été frappé et le lui a reproché. « A voir les efforts que Sénèque se donne pour se préparer contre la mort, à le voir suer d'ahan pour se roidir et pour s'assurer et se débattre si longtemps en cette perche, j'eusse ébranlé sa réputation, s'il ne l'eût en mourant très vaillamment maintenue. » Rappelons-nous
le temps où écrit Sénèque. Nul n'était sûr du lendemain
: le caprice de César, la haine d'un affranchi, la
rancune d'une femme pouvaient être chaque jour un arrêt
d'exil, de confiscation, de mort. Un danger incessant
menaçait tout homme qui était, avait été ou pouvait être
quelque chose. Il fallait donc s'attendre à tout, se préparer
à tout. On voyait des riches qui s'exerçaient de
temps en temps à vivre misérablement ; ils quittaient
leurs palais, allaient s'installer dans des galetas, couchaient
sur un grabat, se nourrissaient des plus vils aliments,
se préparaient enfin à ne plus posséder cette
opulence qui pouvait chaque jour leur être ravie. Quelle
éloquence dans ces mots de Sénèque ! « Ah ! que ne peuvent-ils consulter les riches, ceux qui désirent la richesse ! » N'avait-il pas essayé lui-même, de se dépouiller
de ces biens que lui avait imposés Néron, sentant
bien qu'ils seraient plus tard une des causes de sa perte ?
Quant à la mort, il suffit de rappeler les continuelles et
sommaires exécutions qui se faisaient chaque jour. Il
fallait donc être toujours prêt, se fortifier, s'encourager
les uns les autres. On rappelait lés beaux exemples
de courage, les trépas héroïques ; et ce n'était point
pour exercer son esprit, comme dit Sénèque, Non in
hoc exempla nunc congero ut ingenium exerceam, mais pour fortifier l'âme. Quand on avait peu à peu accoutumé
sa pensée à cet objet, on éprouvait un véritable
mépris pour les tyrans et les bourreaux et les instruments
de torture. Sénèque se plaît à les braver, il les
met au défi de rien imaginer qui puisse déconcerter
son coeur. Derrière tout cela, représentez-vous toujours
Néron délibérant avec Tigellinus ou Locuste sur le sort
des premiers citoyens de Rome, le centurion à la porte,
attendant la sentence, et le Romain chez lui écrivant son
testament.
Il fallait s'aguerrir contre ce péril toujours suspendu.
Mais les stoïciens de ce temps avaient en mains la délivrance
: ils étaient tous décidés à ne pas attendre l'ordre
de mourir. Le suicide, voilà leur dernière arme et la
plus sûre de toutes. On est effrayé de la facilité avec laquelle
les meilleurs et les plus purs s'empressaient de
quitter la vie. Sénèque combat parfois, mais faiblement
ce qu'il appelle « la fantaisie de mourir »
« Le sage, dit-il, ne doit point fuir de la vie,
mais en sortir. » Soit, mais dans quelles circonstances?
On se donnait souvent la mort pour échapper aux ennuis et aux incommodités de la vieillesse. Il faut les supporter,
dit Sénèque, tant que l'âme n'en sera point diminuée
ou l'intelligence menacée. Mais si les supplices, si l'ignominie
nous menacent, nous redevenons libres d'y échapper
par la mort, car nous avons le droit de nous soustraire
à tout ce qui trouble notre repos. Il va même
jusqu'à accorder ce droit le jour « où la fortune commencera à être suspecte. » C'est qu'en effet là réside
pour lui la véritable liberté. « Méditer la mort, c'est méditer le liberté ; celui qui sait mourir, ne sait plus être esclave. » Et ailleurs, « le sage vit autant qu'il le doit, non autant qu'il le peut. »
Et enfin : « Ce que la vie a de
meilleur, c'est qu'elle ne force personne à la subir. » Doctrine
désolée, qui revient à chaque page, comme un pressentiment!
Ne condamnons pas trop rigoureusement ceux
qui l'embrassaient avec cette ardeur sombre : c'était le
seul refuge que leur eût laissé la misère des temps.
Dans cette universelle dégradation de tout et de tous,
cette certitude d'échapper à l'infamie, au supplice,
gardait les âmes de toute souillure. Quand on est toujours
prêt à quitter la vie, on ne fait aucune bassesse pour la
conserver.
Ce serait donc une erreur et une injustice que de traiter
de déclamations vaines les incessantes exhortations
de Sénèque. C'était la question à l'ordre du jour. La
théorie pure tient peu de place dans Sénèque. C'est un
moraliste pratique. Les Lettres à Lucilius ont au plus
haut point ce caractère. Il serait peut-être excessif de
faire de lui un directeur de conscience. Le suicide tient
trop de place dans son code de morale ; il est toujours
prêt à recourir à cette extrémité, il enseigne plutôt le mépris que l'usage de la vie. Dans une de ses premières lettres à Lucilius, il le presse de renoncer aux dignités,
aux emplois, à toutes les préoccupations étrangères à la sagesse, ou tout simplement de renoncer à la vie elle-même.
MORALE SOCIALE.
La morale a un caractère plus élevé, quand il envisage l'homme non plus isolé, mais dans ses rapports avec les autres hommes.
C'est un des principaux titres de gloire du stoïcisme que d'avoir établi les grands principes sur lesquels repose encore de nos jours l'édifice des institutions sociales. La plupart des jurisconsultes illustres appartiennent à la secte de Zénon ; et sous les plus détestables empereurs le noble travail de l'introduction du droit naturel dans la législation s'est poursuivi et n'a jamais été interrompu. Je ne puis que renvoyer sur cette question aux nombreuses histoires du droit romain qui ont été écrites soit en Allemagne, soit en France, et aux monographies qui jettent encore plus de lumière sur ce point. Sénèque, en sa qualité de stoïcien, et grâce à l'élévation naturelle de son âme, a été un des plus éloquents propagateurs de ces belles idées. Bien avant que ces vérités eussent reçu la
sanction de la loi, il en avait été l'apôtre convaincu, l'interprète passionné. Je ne puis ici, à mon grand regret, marquer d'une ligne sûre la limite qui le sépare de l'âge qui précède et de celui qui suit, seule manière de bien apprécier l'importance de ses opinions personnelles.
On sait que la division était comme la loi du monde antique. Des barrières infranchissables séparaient les
peuples étranger ou ennemi, même chose, même nom.
Dans la cité même, division en familles, et enfin division
en hommes libres et en esclaves. Le principe de tout
droit est la force. C'est sur la force que repose le droit
de conquête, de spoliation, d'asservissement ; c'est sur la
force que repose la domination que l'homme comme
époux et comme père s'attribue sur la femme et sur
l'enfant ; c'est sur la force que repose la possession de
l'homme par l'homme.
Le stoïcisme ébranla la base même des institutions politiques et sociales. Il conçut et proclama l'unité du genre
humain, fondée sur l'égalité de nature. L'ensemble des
êtres créés lui apparut sous la forme d'une cité universelle,
dans laquelle étaient compris tous les êtres doués de
raison. Partout où éclatait cet attribut supérieur, commun
à l'homme et à Dieu, les stoïciens reconnaissaient
un membre de leur république, quelles que fussent son
origine et sa condition. Le beau vers de Térence, traduit
probablement de Ménandre :
Homo sum, humani nihil a me alienum puto,
est comme la formule anticipée de la doctrine des stoïciens
romains.
Les conséquences pratiques de cette doctrine étaient :
la ruine de la cité étroite, conquérante, jalouse; l'admission de tous aux mêmes droits, aux mêmes avantages ;
la suppression de tous les privilèges, nés de la force ou
de l'orgueil; et enfin la suppression de l'esclavage : c'était
une révolution radicale. On sait combien il fallut de
temps et d'épreuves à l'humanité pour qu'elle fut accomplie.
Voyons quelle est sur ces divers points du problème la solution ou plutôt l'opinion de Sénèque.
La cité romaine était entamée : l'étranger y affluait et
y obtenait les droits réservés jadis au seul Romain de naissance
(1).
(1) Sous César il y eut 450,000 nouveaux citoyens romains.
Sous Auguste 4,140,000
Sous Claude 6.,944,000
Cependant les empereurs, le sénat et un certain
nombre d'esprits remarquables, comme Tacite, Pline et bien d'autres, s'indignaient encore de cette espèce
d'avilissement de la majesté romaine, et souhaitaient
le maintien de l'ancienne constitution étroite et jalouse.
On ne trouvera pas trace dans Sénèque du vieux patriotisme
romain. Tacite se réjouit de voir deux peuples ennemis se déchirer et s'écrie : « Ah ! puisse durer chez les peuples étrangers, sinon l'amour de Rome, au moins la haine d'eux-mêmes ! » Sénèque ne connaît pas de tels
sentiments. Pour lui Rome n'a pas d'ennemis : elle peut être appelée la patrie de tous. Or, si l'étranger, celui qu'on appelait
ïi jadis l'ennemi, n'est pas exclu de la cité, que deviennent dans la cité elle-même les exclusions injurieuses déguisées sous la division en castes? « Qu'est-ce qu'un chevalier romain? un affranchi? un esclave? Ce ne sont que
des noms, des inventions de l'orgueil ou de l'injustice. »
Il faut apprécier chaque homme non d'après son habit ou sa condition, mais d'après son âme. Et de même qu'ils sont tous unis par l'attribut commun de la raison,
ainsi ils sont nés pour l'association, c'est-à-dire pour être
utiles les uns aux autres.
Il y a même entre eux une étroite solidarité,
sans laquelle ils ne pourraient subsister. (Voir De benef.,IV, 18.) Enfin c'est l'amour, la charité si l'on
veut, qui est la loi même de leur nature. Il faut citer ce
beau passage.
« Est-ce assez de s'abstenir de verser le sang humain? Le grand effort de vertu de ne point nuire à des êtres auxquels nous sommes obligés d'être utiles! La belle gloire pour un homme de n'être point féroce envers un homme ! Recommandons-leur donc de tendre la main à celui qui fait naufrage, de montrer la route à celui qui s'est égaré, de partager son pain avec celui qui a faim. Mais à quoi bon entrer dans le détail de ce qu'il faut faire ou éviter, quand je puis rédiger en deux mots la formule des devoirs de l'homme? Cet univers que vous voyez, qui comprend le ciel et la terre, n'est qu'un tout, un vaste corps dont nous sommes les membres. La nature, en nous formant des mêmes principes et pour la même fin, nous a rendus frères ; c'est elle qui nous a inspiré une bienveillance mutuelle, et qui nous a rendus sociables. C'est elle qui a établi la justice et l'équité ; c'est en vertu de ses lois qu'il est plus malheureux de faire du mal que d'en recevoir. C'est elle qui nous a donné deux bras pour aider nos semblables. Ayons toujours dans le coeur et dans la bouche ce vers de Térence : Je suis homme, et rien de ce qui touche l'homme ne m'est indifférent. Nous avons une naissance commune, notre société ressemble aux pierres des voûtes dont l'obstacle mutuel fait le support (1). »
(1) Epist. 95.
Voilà la grande cité, la cité universelle, éternelle, qui
renferme à la fois les dieux et les hommes, qui n'est
pas bornée par telle ou telle limite. Il y en a une autre cependant, celle où nous naissons. Quels devoirs impose-t-elle à ses enfants? En d'autres termes, quelle est
la morale politique de Sénèque ? Ici nous nous retrouvons
en face de la triste réalité. Les stoïciens disaient
: « Le sage s'occupera des affaires publiques, à
moins d'en être empêché. » C'est un des côtés par lesquels
cette virile doctrine avait plu aux Romains de la
république. Les épicuriens disaient au contraire : le
sage ne s'occupera point des affaires publiques, à moins
d'y être forcé. Maxime lâche et basse que Cicéron flétrit
à tout instant. Sénèque démontre que les deux doctrines,
grâce à la restriction qui les accompagne, conduisent
au même terme. Lequel? La retraite, l'éloignement,
le loisir, ce que l'on appelait otium, c'est-à-dire le
contraire de l'action. Il énumère avec complaisance tous
les empêchements qui doivent retenir le sage dans la
solitude : la corruption des hommes, les caprices de la
multitude, le triomphe assuré des méchants et bien
d'autres encore. Cependant il sent bien qu'il y a là un
devoir à remplir, et que les obstacles ne peuvent que le
rendre plus impérieux pour un grand coeur. Que le sage
essaye donc de servir l'État ; qu'il se heurte à toutes les
difficultés avant de renoncer à cette tâche ingrate. «Il n'est
plus permis de servir dans les armées? Eh bien ! qu'il
se tourne vers les emplois publics. Il est forcé de rester
simple particulier ? Qu'il soit orateur. On lui impose
silence? Qu'il soit l'avocat muet de ses concitoyens.
L'entrée du Forum est un péril? Eh bien, que chez lui,
au spectacle, dans les festins il se montre concitoyen
dévoué, ami fidèle, convive tempérant. S'il ne peut plus
remplir les devoirs du citoyen, qu'il remplisse ceux de
l'homme. » Belle parole, mais qu'elle est triste ! C'est sans doute
vers la fin de sa vie que Sénèque prêchait à ses amis
l'éloignement de la vie politique : il savait mieux que
tout autre les amertumes et les périls qu'elle offrait
alors. II essayait de trouver enfin cet otium que lui refusait
impitoyablement Néron ; et sa position à la cour ne lui
permettait pas de tenir au sénat, aux tribunaux ou dans
les camps la fière attitude des Crémutius Cordus, des
Barea Soranus, des Rubellius, des Thraseas, des Corbulon.
Il n'avait pas en lui l'énergie de l'homme politique
attaché invinciblement à son opinion, aimant et
voulant servir la patrie, ne rougissant point d'avouer
qu'il a de l'ambition, c'est-à-dire, qu'il désire participer
activement à la haute direction des affaires de son pays,
et enfin passionné pour la liberté.
Pour Sénèque, la patrie, c'est le monde entier ; l'exil,
le plus cruel des supplices pour un vrai Romain, ce
n'est qu'un vain mot; les honneurs et les dignités, des
pièges ; la liberté, chose indifférente. Quel que soit le
gouvernement, on peut être libre, se faire libre soi-même
: c'est là un bien inestimable. En résumé, il vaut
mieux traiter ses propres infirmités que celles des autres.
Caton fut
un insensé de se jeter au milieu des tempêtes de la
chose publique. Voilà un de ces mots qui éclairent toute
une époque. Quel chemin parcouru depuis moins d'un
siècle ! Rome, cette vieille terre du patriotisme, de l'action,
du dévouement, Sénèque en veut faire la patrie
du genre humain, et il convie à la retraite, à l'indifférence,
à l'abstention les descendants de ces grands citoyens
qui avaient donné les derniers combats de la
liberté ! On ne le voit que trop : il n'a pas l'âme républicaine. C'est lui qui le premier a rédigé, dans son traité
de la Clémence, le programme du despotisme modéré.
Il montre à Néron qu'il peut tout, que la vie et les biens
de ses sujets lui appartiennent, et il lui conseille de les
épargner, non parce que ce serait violer en eux le' droit, mais parce que ce sera pratiquer cette belle vertu
royale, la clémence. Plus tard, il laisse là Néron qui ne
l'écoute plus, et, se tournant vers ses amis, il leur dit :
Rentrez dans l'intérieur de vos maisons, ne songez plus
aux affaires publiques. La grande affaire, c'est de se
tenir prêt à quitter cette vie, de n'avoir pas d'attaches trop puissantes, de n'aimer point ce qui passe, de ne point redouter les maux qui peuvent chaque jour fondre sur nous. Vertu lâche et monacale ! s'écrie avec indignation Diderot. Soit; mais elle était encore une force ; elle préservait de toute souillure ceux qui l'embrassaient;
et, puisqu'il ne pouvait plus y avoir de citoyens, il
s était bon qu'il y eût encore des hommes.
§v.
LES TRAGÉDIES DE SÉNÈQUE.
Je ne dirai qu'un mot des tragédies de Sénèque. On ne peut douter en effet qu'il n'en soit l'auteur ; Sénèque le Tragique
et Sénèque le Philosophe ne sont évidemment qu'un
seul et même personnage. Quel serait en effet cet autre Sénèque? Et comment expliquer l'étrange ressemblance du
style entre le poëte et le prosateur, si ce sont deux auteurs
différents ? Ces tragédies sont au nombre de dix,
voici leurs titres : Médée, Hippolyte, OEdipe, les Troyennes,
Agamemnon, Hercule furieux, Thyeste, la Thébaïde, Hercule sur le mont Oeta, Octavie. Toutes, sauf la dernière, sont empruntées aux légendes dramatiques de la
Grèce. Octavie, sorte de déclamation sur la mort déplorable
de cette jeune femme, épouse de Néron, n'est pas
l'oeuvre de Sénèque, et il est difficile de déterminer le
nom de l'auteur et l'époque où elle fut écrite.
A quel moment de la vie de Sénèque faut-il rapporter
la composition de ses tragédies? Il dit lui-même à sa
mère Helvia que, pour adoucir l'ennui de son exil en
Corse, il se livrait au charme d'études plus légères
; de plus il fut accusé dans
les dernières années de sa vie de composer plus souvent
des vers depuis que Néron s'était engoué de poésie,
comme s'il eût songé à éclipser le génie de son royal
élève. Je croirais donc volontiers que Sénèque a fait des
tragédies et pendant son exil et peu de temps avant sa
mort. Mais qu'est-ce que ces tragédies?
J'ai déjà indiqué la profonde décadence dans laquelle
était tombé le théâtre même sous le principat d'Auguste :
il semble, d'après Horace lui-même, que le peuple ne
peut plus supporter la représentation d'une tragédie;
les spectacles qu'il réclame doivent charmer ses yeux : Migravit ab aure voluptas
Omnis ad incertos oculos et gaudia vana. Or le théâtre ne peut subsister longtemps quand il n'y a
plus de public. Il est fort problable qu'à partir des règnes
de Claude et de ses successeurs les représentations de
tragédies furent excessivement rares, peut-être même
cessèrent tout à fait. Cependant les poëtes ne laissèrent
pas d'en composer, on ne peut en douter ; les titres de
quelques-unes nous ont été conservés, et le Dialogue des
orateurs indique clairement que cet art ne cessa pas d'être cultivé. Seulement, au lieu d'être représentées, ces
tragédies étaient lues ; et le public se composait des amis
ou des connaissances de l'auteur réunis par lui dans une
salle louée pour la circonstance. Les tragédies de Sénèque
furent écrites pour un auditoire de ce genre. Il ne
faut donc pas leur demander cette qualité fondamentale
du poëme dramatique, l'action, puisqu'elles sont faites
pour la lecture et non pour la représentation. Le dialogue
y est presque nul; le dialogue est l'action elle-même.
L'oeuvre tout entière se compose d'un fort petit nombre
de scènes. Elle n'a ni gradation, ni intérèt, ni péripéties.
Le héros expose ses ressentiments ou ses misères, puis
son dessein. Le choeur développe en vers lyriques un lieu
commun de philosophie morale qui se rattache plus ou
moins heureusement à la situation. Un second personnage
exhorte ou dissuade le premier, puis vient le dénoûment
qui se passe souvent sur la scène, si horrible
qu'il soit, mais que l'on supporte aisément, quand on ne
le voit pas. Les qualités que recherchaient les lecteurs de
tragédies étaient l'éclat du style et la vigueur des pensées
: de longues tirades, qui étaient de véritables déclamations,
des fragments d'épopées tenant lieu de récits,
des morceaux lyriques, hors de toute proportion
avec l'ensemble ; aucun souci de la vraisemblance: voilà
les caractères généraux de ces oeuvresétranges. Quant
aux sujets choisis par Sénèque, les titres seuls indiquent
un goût prononcé pour les choses horribles. Mais l'horreur
n'est que dans les mots ; tout le monde reste froid
et indifférent. L'auteur joue avec ces épouvantables légendes;
elles lui sont une occasion de montrer son
esprit. De plus, les malheureux qu'il met en scène sont
tous profondément pénétrés de la maxime stoïcienne, que « nul ne peut nuire à celui qui ne se nuit pas à
lui-même. » Ils restent donc parfaitement calmes et indifférents
à toutes les tortures qu'on leur inflige. Comme
le sage de Sénèque, ils sont exempts de passions. Les
bourreaux font rage, crient, menacenf, irappent; les
victimes sourient. Elles ont une intrépidité d'âme et une
hauteur de dédain qui ne se démentent pas un seul
instant. Sénèque seul pouvait présenter sous cet aspect
les persécuteurs et les persécutés. Ses tragédies sont
encore une prédication ; le mépris de la mort et de ceux
qui l'infligent en est l'âme. Aussi quelle triomphante
ironie dans les réponses de ceux que le bourreau croit
effrayer par l'appareil des supplices ! Que d'insolence
pour ces rois tyrans ! et que l'on voit bien Claude et
Néron derrière Atrée ou Thyeste !
Voilà cependant le modèle sur lequel se forma la tragédie
moderne. Les hommes de la Renaissance furent
ravis de la lecture de Sénèque : il leur sembla le premier
des poëtes dramatiques, et pendant longtemps on
mit toute sa gloire à l'imiter. La méprise était étrange,
mais on la comprend quand on se rappelle l'espèce de
culte que l'on vouait alors à l'antiquité retrouvée. Et
d'ailleurs, ces tragédies de salon renferment de très grandes
beautés de détail. Si la peinture des caractères
est défectueuse, souvent toute une situation est résumée
dans un de ces mots profonds, si fréquents chez Sénèque.
On se rappelle, dans Corneille, la belle réponse
de Médée :
Contre tant d'ennemis que vous reste-t-il ?
Moi.
Elle est traduite de Sénèque. Le mot de Thyeste à Atrée : « Je reconnais mon frère, » est aussi de Sénèque.
§ VI.
LETTRES DE SÉNÈQUE ET DE SAINT PAUL.
Je ne dirai qu'un mot des lettres de Sénèque à saint
Paul et de saint Paul à Sénèque. Au nombre de quatorze,
elles sont un spécimen assez curieux des plates
fraudes pieuses auxquelles les chrétiens du troisième et
du quatrième siècle ont eu trop souvent recours. Tertullien
avait dit de Sénèque, saepe noster, c'est-à-dire se
rencontrant souvent avec les chrétiens : c'est peut-être
sur ce maigre fondement que s'établit la correspondance
supposée entre l'apôtre et le philosophe. Comme ils
étaient morts tous deux à Rome à deux années de distance
; comme, de plus, Gallion, frère de Sénèque, avait
été juge de saint Paul à Corinthe, lorsque celui-ci fut
déféré à son tribunal par les Juifs, il n'en fallut pas
davantage pour imaginer le christianisme de Sénèque.
Saint Jérôme, dans son catalogue des saints, saint Augustin,
dans sa lettre 153e, nous montrent que cette bizarre
opinion avait déjà cours de leur temps, et que les
lettres supposées étaient acceptées comme authentiques ;
mais ils ne semblent pas partager la croyance populaire,
bien qu'ils la laissent debout. Pendant tout le moyen
âge, Sénèque fut considéré comme un des Pères de l'Église.
A la Renaissance, des critiques et des érudits,
comme Vivès, Juste Lipse, Érasme, Baronius, Tillemont,
firent justice de cette grossière supercherie. Au commencement
de ce siècle, M. de Maistre, le plus faux et le
plus insolent des esprits violents, voulut ressusciter la
vieille légende ; mais on sait assez le succès des théories de M. de Maistre. Depuis on s'est borné à soutenir que, si
les fameuses lettres sont apocryphes, il y a néanmoins
dans Sénèque une foule d'idées, de sentiments, d'expressions
où l'on doit reconnaître l'influence du christianisme.
C'est la thèse soutenue par M. de Champagny et surtout
par M. Fleury, qui a écrit deux volumes sur la matière.
Même dans ces limites, la thèse est inadmissible. J'ai
esquissé les dogmes principaux de la philosophie de Sénèque;
j'ai montré combien elle se préoccupait d'armer
l'homme pour la lutte, d'aviver en lui le sentiment de
l'orgueil, de le rendre invulnérable ou de le pousser libre
dans la mort volontaire ; rien de plus opposé à la morale
chrétienne qui prêche l'humilité. Même désaccord sur
un autre point essentiel, la vertu. « Non est res beneficiaria, » dit Sénèque, c'est-à-dire, ce n'est pas une
grâce d'en haut qui nous la donnera, mais bien l'effort
de notre propre volonté. Quant aux préceptes de charité,
de douceur, répandus dans les oeuvres de Sénèque, il
serait fort étrange de vouloir en dépouiller la philosophie
antique qui depuis Socrate avait fait ses preuves sur ce
point. J'ajoute même que saint Paul se résigne plus aisément
à l'esclavage que Sénèque : celui-ci proclame l'égalité
de tous les hommes et invite les maîtres à la douceur.
L'Apôtre recommande l'obéissance aux maîtres
selon la chair, et accepte le fait de l'inégalité. Mais c'est
trop insister sur une question que n'ont pu obscurcir la
passion et la mauvaise foi.
§ VII.
STYLE DE SÉNÈQUE.
Quintilien a consacré à Sénèque une grande page assez diffuse, où les réticences abondent, où la sévérité semble
mal à son aise. Il parait en effet que Quintilien passait
pour un détracteur de Sénèque : delà, un certain embarras
pour le juger magistralement. Cependant la part de
l'éloge est bien maigre auprès de celle qui est faite au
blâme. En résumé, Sénèque doit se résigner à ne plaire
qu'aux jeunes gens ; les esprits sérieux et cultivés ne peuvent
lui accorder leur approbation. Quintilien essaye de
restaurer les traditions littéraires classiques de la fin de
la république, c'est un cicéronien passionné, Sénèque devait
lui déplaire. Avec Sénèque, en effet, se manifeste un
esprit nouveau, qui crée une forme nouvelle. Jusqu'alors
tous les écrivains romains avaient scrupuleusement observé
la division des genres, les lois qui régissent chaque
genre : ils avaient été orateurs, rhéteurs, historiens, philosophes,
et s'étaient renfermés exactement dans le sujet
choisi par eux ; de plus, ils s'étaient appliqués à donner
à leurs écrits le style propre au genre qu'ils traitaient ;
ils s'étaient astreints aux lois d'une composition savante
et méthodique. Ils développaient lentement, à loisir,
leurs idées, sans impatience, et sans s'écarter un seul
instant du but proposé. Rien de tel chez Sénèque. Quelque
sujet qu'il traite, il est à la fois philosophe, orateur,
homme du monde. De là, la faiblesse de composition qu'on
remarque dans la plupart de ses ouvrages. La forme didactique,
l'appareil scientifique, il n'en veut pas, il n'en
peut pas supporter la rigueur monotone. Peu de définitions,
et souvent peu exactes, peu d'ordre ; de subites
digressions sous forme oratoire, c'est l'avocat qui prend
la place du philosophe; des anecdotes finement racontées,
c'est l'homme du monde qui intervient ; des analyses
extrêmement délicates et subtiles au lieu d'une étude plus large et plus générale; une incroyable profusion
d'idées nouvelles, piquantes, ingénieuses, qui charment,
éblouissent, mais fatiguent l'esprit sans l'attacher
solidement : telle est en général sa composition. Quant au
style, c'est assurément un des plus brillants qui existent en aucune langue. Il est injuste de dire avec Quintilien
: « qu'il abonde en vices agréables. » Ce serait ériger
la platitude en génie. Nul auteur n'a eu plus d'idées,
et ne leur a donné une forme plus vive. A chaque page,
à chaque phrase, se détache quelqu'une de ces expressions
créées, qui jaillissent spontanément d'un sentiment
profond, d'une idée vraie : il a des alliances de mots
d'un bonheur merveilleux, et des antithèses d'une énergie
et d'un éclat qui dépassent tout. Il tourne et retourne
son idée, lui cherchant le vêtement le meilleur et le plus
beau. Là est l'écueil de son style : il ne choisit pas toujours
entre les diverses formes qui se présentent; il les
jette l'une après l'autre dans le tissu de l'oeuvre. De là, un
certain embarras : la phrase a l'allure vive, rapide ; on
craint de ne pouvoir suivre cette pensée qui vole si légère,
mais elle revient deux fois, trois fois, plus souvent
encore, toujours la même sous un autre costume. Il y a
illusion ; on sent la stérilité où l'on croyait trouver l'abondance,
plusieurs vêtements, un seul corps. Il y a tel paragraphe
de Sénèque qui paraît à première lecture rapide
et piquant ; il tiendrait en deux lignes, si l'on supprimait
le superflu. Mais que d'idées profondes! quelles fouilles
poursuivies dans les moindres replis de l'âme ! Quelle
élévation ! Avec un penchant réel à la déclamation, il
n 'y a rien en lui de vulgaire ; les longues périodes sonores
et vides, si faciles à arrondir, il les répudie avec dégoût.
On sent l'homme du monde qui ne pérore jamais, mais ouvre à peine la bouche, et lance un trait rapide, spirituel.
Quoi qu'en dise Quintilien, on ne voit pas qu'il ait
fait école : c'est qu'il n'est pas facile d'imiter tant de
qualités d'un ordre supérieur. L'éloquence cicéronienne
qui s'étale avec complaisance, sûre d'elle-même, sans
être gênée par aucune entrave, elle n'était plus possible : les improvisations rapides, la forme antithétique qui
donne plus de relief à la pensée, l'éclat de l'expression,
l'originalité du tour, voilà ce que Sénèque introduit dans
la langue. Nous avons vu que bien des idées nouvelles
lui doivent naissance : c'est un des plus grands noms de
la littérature romaine. Je ne sais même s'il y eut jamais
un esprit plus ouvert et plus richement doué.
Je ne sais si j'ai réussi à mettre en lumière dans Sénèque
l'homme et l'écrivain, ce mélange continuel d'élévation
et de défaillance, de pensées sublimes et d'actions
médiocres, cette aspiration incessante vers des régions
plus pures, et cette rechute dans les misères de la cour
impériale, je ne sais quoi de nouveau, de plus profond
dans les sentiments et dans le style, avec une certaine
indécision, comme si les forces ne répondaient pas à
l'effort. La situation équivoque et trop prolongée de
Sénèque, à la cour de Néron, explique ces inégalités dans
sa vie et dans ses écrits. J'en dirai autant à propos de son
jeune parent, le poëte Lucain.
§ VIII.
LUCAIN.
M. Annæus Lucanus, fils d'Annaeus Méla, le seul des
fils de Sénèque le Rhéteur, qui se tint en dehors de la vie
publique et ne songea qu'à faire fortune, naquit en Espagne,
à Corduba, l'an 792 de Rome (39 ap. J.-C.). Bien
qu'il fût élevé à Rome dès la plus tendre enfance, il y eut
toujours en lui ce fonds de jactance et d'exubérance sonore
propre aux gens de son pays. Ces défauts originels,
qui sont aussi bien du coeur que de l'esprit, auraient pu
disparaître ou s'atténuer, si le jeune homme eût rencontré
un milieu sobre et sévère, s'il n'eût eu sous les yeux
que des exemples droits et purs. Mais il fut pour ainsi
dire élevé avec Néron, qui n'avait que deux ans de plus
que lui ; il vécut à la cour, choyé, caressé, gâté dès son
enfance par l'adulation qui, du futur César, rejaillissait
jusque sur le compagnon de ses études. Il eut, outre son
oncle Sénèque, les mêmes maîtres que tous les jeunes
gens distingués d'alors, le sot et vantard grammairien
Réminius Palémon, Virginius Flavus, l'éloquent et honnête
rhéteur, et enfin l'austère Cornutus. Que de contrastes,
que d'influences contraires dans cette éducation !
Lucain à la fois l'ami de Néron et de Perse, le disciple
de Sénèque et de Cornutus ! Ce n'est pas tout, lui qui voyait les moeurs de la cour impériale, Agrippine,
Pallas, Acté, toutes les turpitudes déclarées ou se cachant
à peine, il était admis dans la pure et chaste société
des Thraséas, des Musonius Rufus, des Helvidins
Priscus ; il assistait à ces entretiens nobles, à ces retours
mélancoliques vers les beaux temps de Rome libre ; puis,
l'âme échauffée par de grands souvenirs et de généreuses
leçons, il retournait respirer l'atmosphère empoisonnée
de la cour. A peine âgé de dix-huit ans, le voilà qui écrit
des tragédies, des fragments d'épopée, des cantica pour
les pantomimes ; ce qui ne l'empêche pas de plaider en
latin et en grec avec le plus grand succès. Favori de
César, dont il célèbre les vertus dans un concours poétique,
à peine a-t-il déposé la prétexte qu'il est nommé
questeur du prince, puis augure. Il semble appelé aux
plus brillantes destinées, lorsqu'un caprice de Néron
renverse l'édifice de cette fortune. Néron, jaloux des succès
littéraires de Lucain, quitte la salle où le poëte lit
ses vers, et fait manquer le succès. Lucain, blessé dans
son amour-propre, ose disputer le prix de poésie à l'empereur
; des juges osent se prononcer en sa faveur. Néron
lui interdit la scène et les tribunaux, et le condamne à
l'obscurité. On sait le reste, Lucain, exaspéré, se répandit
en invectives et en insultes grossières contre César; puis
il entra dans la conspiration de Pison. Il s'y comporta
avec une jactance et une témérité sans égales, ne cessant
de déclamer contre les tyrans et de glorifier le tyrannicide,
jusqu'au jour où, la conspiration étant découverte,
il tomba aux pieds de Néron, s'abaissa aux plus
viles prières, et, pour obtenir la vie sauve, alla jusqu'à
dénoncer sa propre mère, espérant toucher parla un prince
parricide. Il n'obtint rien que le choix du genre de mort, et il mourut en déclamant ses propres vers. Il n'avait que
vingt-six ans.
Tel est le personnage. Voyons l'oeuvre. Elle est inachevée.
Le dixième livre, qui est le dernier, est incomplet
; et il est bien difficile de suppléer ce qui manque.
Jusqu'où Lucain avait-il poussé le récit des événements
qui font le sujet de son poëme, on ne sait ; et à vrai dire,
c'est là le principal défaut de l'oeuvre. Elle manque d'unité
: le but ne se dessine point dès les premiers vers.
Mais je reviendrai sur ce point.
Je voudrais laisser de côté toutes les critiques purement
littéraires qui ont été faites de la Pharsale : c'est
d'un intérêt bien médiocre pour nous que d'examiner
jusqu'à quel point cet ouvrage est conforme aux lois de
l'épopée, si c'est une épopée, s'il est permis de choisir un
sujet purement historique, de supprimer le merveilleux,
etc., etc. Voyons, non ce que Lucain eût dû faire
pour se conformer aux règles de la poétique, mais ce qu'il
a voulu faire.
Il s'est proposé d'écrire en vers le récit des événements
qui donnèrent à César la première place dans Rome : son
poëme a pour titre la Pharsale, mais il embrasse l'histoire
de tous les faits importants qui ptécédèrent et
suivirent cette bataille mémorable. Après avoir présenté
les deux adversaires, il montre César franchissant le Rubicon
et donnant le premier le signal de la guerre civile.
Dans le tumulte qui suit cette première violation des lois,
Brutus et Caton restent seuls inébranlables, et se rangent
sans hésiter du côté des lois. La guerre éclate ; le poëte
en suit les diverses péripéties en Italie, à Brindes, à Dyrrachium,
à Marseille, en Espagne, en Afrique, et enfin
en Epire, où se livre le combat suprême. Pompée vaincu
va demander un asile au roi d'Égypte qui l'égorge lâchement.
César arrive à Alexandrie : une révolte éclate contre
lui. Ici s'arrête le poëme. Ainsi que je le disais,
on ne voit point où l'auteur se fût arrêté : il semblait que la
mort de Pompée fût la fin naturelle de l'ouvrage.Mais peut-être
Lucain l'aurait-il mené jusqu'à la mort de Caton à
Utique, c'est-à-dire jusqu'à la défaite du parti républicain.
Cette sèche et incomplète analyse suffit cependant à
indiquer le caractère général de la Pharsale. Quoi qu'on
en ait dit, ce n'est pas une tentative inouïe et téméraire
que d'avoir choisi pour sujet d'un poëme des événements
et des personnages presque contemporains. Sans parler
de Naevius et d'Ennius qui dans les Puniques et les Annales avaient donné l'exemple, nous voyons que parmi les
contemporains de Cicéron et de Virgile plusieurs poëtes
avaient fait choix de tel ou tel événement considérable
de l'histoire de Rome pour le célébrer en vers. Cette
question préjudicielle écartée, voyons quelle est l'exécution
de l'oeuvre.
C'est surtout dans les trois ou quatre dernières années de
sa vie que Lucain se renferma dans la composition de la
Pharsale. On le comprend sans peine : les tribunaux, le
théâtre, les concours littéraires et jusqu'à un certain
point les lectures publiques devant un nombreux auditoire
lui étaient interdits. Il revint alors à son grand ouvrage,
et il y jeta à flots ardents les sentiments nouveaux ou
ravivés qui bouillonnaient dans son âme. Dans le premier
livre il avait inséré un éloge de Néron qu'il ne pouvait effacer,
car tout le monde le connaissait, mais le reste de
l'oeuvre eut un accent si différent qu'on ne s'explique pas
une telle disparate, si l'on ne songe à cette rupture
éclatante qui survint entre César et le poëte. Elle eut évidemment pour résultat de rejeter violemment Lucain
du côté de ses amis les Stoïciens, et de ranimer en lui cet
enthousiasme patriotique que la corruption de la cour eût
bientôt étouffé. Si nous nous plaçons à ce point de
vue, l'oeuvre s'éclaire d'une lumière nouvelle, nous en
comprenons l'inspiration violente, et nous secouons
enfin cette équivoque pénible d'un poëte de cour célébrant
Brutus et Caton.
Lucain, on se le rappelle, obtint de grands succès dans
les écoles des rhéteurs et des déclamateurs et au barreau.
Il connut et admira le cénacle où se réunissaient
les derniers citoyens de Rome, Thraséas, Helvidius Priscus,
Arulénus Rusticus. Enfin, il fut par son oncle et
surtout par Cornutus et ses amis élevé et maintenu dans
l'admiration de la doctrine stoïcienne. De cette triple inspiration
découle son oeuvre.
Quintilien a dit avec beaucoup de raison que Lucain
devait être rangé plutôt parmi les orateurs que parmi les
poëtes ; non que les facultés poétiques lui manquent, mais
elles sont évidemment inférieures chez lui aux qualités
oratoires. Il a peu d'invention, mais il se représente vivement
les faits ; et il se préoccupe moins de les exposer
dans une belle et calme narration, que de les plaider,
pour ainsi dire. Il a toujours en effet un adversaire et un
client : du premier il critique et condanne tout ; du second
il admire et célèbre tout. De là un manque absolu d'impartialité
: des efforts presque toujours malheureux pour
élever Pompée sur un piédestal qui n'est pas fait pour lui ;
et des réquisitoires souvent injustes contre César : mais en
revanche, que d'admirables portraits, que de belles scènes !
Qu'on ne s'y trompe pas en effet, la couleur oratoire était
plus que la couleur poétique, l'âme même de cette grande époque : les détails fictifs ne pouvaient trouver place dans
l'oeuvre qui prétendait la faire revivre : il fallait en tout
accepter, sans y ajouter rien, mais s'en pénétrer si profondément
qu'on ressuscitât pour ainsi dire ces personnages
avec leurs passions, leurs intérêts, leurs crimes et
leurs vertus également démésurés. Sur ce point donc,
je crois que le poëte était heureusement servi par sa nature,
ou, si on l'aime mieux, que son sujet était dans un
rapport exact avec ses facultés.
L'esprit du poëme est indiqué nettement dans les deux
premiers vers : Lucain chante la guerre civile qui se dénoua
à Pharsale, et, ajoute-t-il, le triomphe du crime
(jusque datum sceleri). C'est donc bien un poëme républicain,
qu'on me permette ce mot, que je vais expliquer.
Virgile raconte les origines héroïques de Rome, et absorbe
pour ainsi dire toute sa gloire dans le dernier descendant
d'Énée, César Auguste. Son poëme est à la fois
national et monarchique. Malgré un bel éloge de Caton
jeté en passant, on sent que le poëte est du parti de César
dont il célèbre l'héritier comme une divinité tutélaire.
C'est à un point de vue absolument opposé que se
place Lucain. Son héros, c'est Pompée, non qu'il absorbe
en celui-ci Rome tout entière ; il dit formellement : « La
république n'est pas du parti de Pompée, c'est Pompée
qui est du parti de la république. » (Non Magni partes,
sed Magnum in partibus esse.) Mais enfin Pompée fut
le représentant de la légalité audacieusement violée par
César, Pompée avait pour lui l'autorité du sénat, l'appui
de tous les gens de bien. Ainsi il s'imposait nécessairement
au poëte, et, par contre, César était à ses yeux le
perturbateur de la paix publique, le contempteur de la
justice et du droit. C'est ainsi évidemment que les Thraséas et les Helvidius Priscus appréciaient ces événements
: plus d'une fois Lucain les avait entendus gémir sur la grande catastrophe qui livra l'empire à César, prépara le principat d'Auguste et les règnes honteux et
sanglants d'un Tibère, d'un Caligula, d'un Claude et
d'un Néron. Cette histoire douloureuse qu'ils refaisaient
souvent, il la vit se dérouler devant lui. toute brillante
des sombres couleurs dont la revêtait l'austère douleur de ces grands citoyens ; et c'est sous leur inspiration
qu'il retrouva l'énergie de la Rome républicaine dans un
temps où la Rome monarchique blessait les regards et la
conscience de tout honnête homme.
A ces deux éléments du poëme, l'élément oratoire et l'élément républicain, il faut joindre le stoïcisme. L'inspiration
de cette noble doctrine est plus sensible encore
dans l'oeuvre que celle de l'éloquence et du patriotisme.
Les événements tout récents ne comportaient guère ce
qu'on appelle le merveilleux, c'est-à-dire l'intervention
de divinités passionnées dans les affaires des hommes ;
mais la doctrine stoïcienne rejetait absolument ces fables
des poëtes, comme indignes de la majesté souveraine.
De plus, elle n'admettait pas que l'homme eût besoin
d'une suggestion étrangère, fût-elle divine, pour se conduire
dans la vie ; il ne doit qu'à lui-même sa vertu,
seul il est responsable des moindres infractions à la loi morale.
Ainsi pas de dieux mêlés à l'action de la Pharsale.
Rien qu'un vers insolent et superbe à l'adresse de ces
dieux qu'adore le vulgaire et à qui il se plait à attribuer
les grands événements qui frappent ses yeux.
Les choses humaines sont régies par des lois naturelies ; il n'est pas de phénomène qui n'ait son explication
scientifique ou historique. Un poëte vulgaire n'eût
pas manqué de faire reparaître ici l'éternelle ennemie
des Troyens et des Romains, l'implacable Junon ; le ressentiment
de la déesse eût occasionné cette redoutable
guerre civile qui pouvait être la ruine de Rome. Lucain
explique par des causes naturelles cette lutte suprême :
l'antagonisme de deux hommes qui veulent être tous
deux à la tête de l'État ; mais surtout, ce qu'il appelle les
semences publiques de la guerre : cette corruption générale,
ce mépris des anciennes lois, des anciennes
moeurs, de l'ancienne liberté, le goût du luxe, le désir
de dominer, tous les vices enfin qui devaient être les plus
cruels ennemis de la république et les auxiliaires de la
monarchie. Les dieux disparaissant, les hommes sont plus
grands; ils occupent toute la scène et la remplissent.
Mais celui qui attire et retient les regards, celui en qui
l'âme de la Rome antique vécut, c'est Caton. Qu'on lise
les paroles qu'il prononce après la mort de Pompée : comme il assigne bien sa place à ce faux grand homme,
le plaçant bien au-dessous des citoyens d'autrefois, mais
le déclarant utile dans le triste siècle où il a vécu. C'est
en Caton que la doctrine stoïcienne porte d'elle-même
le plus beau témoignage. Il y a en elle certains côtés éminemment
favorables à la haute poésie et à la haute éloquence
: rien de plus élevé et de moins aride que cette
belle idée de l'unité du genre humain, de l'égalité des
hommes fondée sur l'identité de nature, fondement sur
lequel reposait cette cité universelle que nous avons trouvée
déjà dans Sénèque. Elle est aussi dans la Pharsale.
On se rappelle aussi la triste parole de Sénèque à Caton, lui reprochant de s'être mêlé à
ces fous furieux qui se disputent cette chose méprisable,
l'empire du monde. Quelle plus haute idée Lucain se fait
de la vertu ! L'exemple de Thraséas, qu'il a sous les yeux,
lui apprend que l'homme de bien ne peut ni ne doit rester
indifférent aux épreuves de la patrie. Aussi lorsque
Brutus vient consulter Caton sur le parti qu'il faut prendre,
Caton répond : la guerre civile, je l'avoue, ô Brutus,
est le pire de tous les crimes, mais partout où les destins
m'entraîneront, sereine suivra ma vertu Non,
je ne m'arracherai pas de toi, ô Rome ; je t'embrasserai
mourante ; je m'attacherai, ô liberté, à ton doux nom,
et jusqu'à ton ombre vaine. « Tous ces nobles sentiments,
toutes ces grandes pensées, ce n'est pas un dieu
qui les a mis en Caton, il n'a pas besoin de consulter
l'oracle pour savoir ce qu'il doit faire ; c'est en lui-même
qu'il trouve la règle de sa conduite. Ainsi le poëte stoïcien
aboutit à la même conclusion que le philosophe :
l'idéal est déplacé, c'est dans l'homme qu'il est descendu.
Lucain a eu ses admirateurs passionnés, surtout chez
les Français, qui ont le tempérament oratoire. Montaigne
en faisait grand cas, et Corneille en était ravi. C'est qu'il
est toujours porté au grand, qu'il a de l'éclat et du feu.
Ce ne sont pas des qualités si vulgaires qu'on puisse les
dédaigner. On parle de déclamation, d'emphase, de mauvais
goût ; il serait absurde de nier tout cela ; mais Lucain
est mort à vingt-six ans, et ses défauts sont surtout
des défauts de jeunesse. Son style est forcé, mais c'est un
style, et n'en a pas qui veut. Sa versification vise trop à
l'effet, mais l'effet produit est souvent admirable. Il n'a
pas de mesure, il ignore l'art délicat des nuances ; mais les esprits violents l'ont toujours ignoré. Le plus sérieux
reproche que l'on puisse lui adresser, c'est la monotonie.
Il est toujours tendu, je dirai même raide. Les figures
de femmes qui traversent son poëme n'ont pas jeté la
moindre douceur sur l'oeuvre; la note ne change point;
ces femmes deviennent aussitôt d'impassibles stoïciennes :
telles les voyait Lucain dans la maison de Thraséas, silencieuses,
tristes, énergiques et comme portant d'avance
le deuil d'un père ou d'un époux. Il a écrit en vers l'histoire
d'un temps misérable, et il l'a écrite dans un temps
plus misérable encore. Mais il ne connaît point l'attendrissement
qui est une défaillance; il donne à tous les
personnages cette inflexible rigidité du devoir, et l'attitude
du mépris pour la force qui triomphe du droit.
L'homme n'a pas cette froide impassibilité ; il peut avoir
ce qu'on appelle des principes sans être une théorie.
Mais la pitié n'existait pas pour les stoïciens. Ils ne savaient
plaindre ni les autres ni eux-mêmes.
§ IX.
PERSE.
Je veux, après Sénèque et Lucain, donner sa place à
un poëte qui mourut avant eux, mais qui était beaucoup
plus jeune que le premier et de quelques années à peine
plus âgé que le second. C'est Perse. Stoïcien, comme
eux, il représente pour nous le côté le plus intéressant
de cette grande doctrine, dont Sénèque et Lucain furent
les interprètes parfois téméraires, souvent peu dignes ;
sa vie est en rapport exact avec les principes qu'il a
adoptés ; pas une contradiction, pas une défaillance,
pas un acte équivoque. Sa poésie aussi est toute stoïcienne,
non-seulement par la pureté et l'élévation, mais
aussi par l'effort pénible, la tension douloureuse.
Perse (Aulus Persius Flaccus) est né l'an 787 (34 apv.
J.-C.), et il est mort à vingt-huit ans, l'an 815 (62 ap. J.-C.).
Il appartenait à une famille équestre distinguée, vraisemblablement
originaire d'Étrurie et de Volaterra ; c'était
dans les provinces et surtout dans ce pays grave et
religieux que les vieilles moeurs avaient encore des représentants. Elevé avec le plus grand soin par sa mère
Fulvia Sisennia, il vint à Rome à l'âge de douze ans pour
y achever ses études. Là, il eut pour maîtres le grammairien
Palémon et le rhéteur Virginius Flavus, une des
futures victimes de Néron. Parmi ses condisciples, il
compta le poëte Lucain. Mais l'enseignement qui saisit
cette âme pure et profonde, ce fut celui de la famille
d'abord, et, en dernier lieu, celui du stoïcien Cornutus.
Sa famille comptait parmi ses membres Thraséas et
Helvidius Priscus, c'est-à-dire ce qu'il y avait alors de
plus honnête et de plus courageux dans tout l'empire.
Les femmes participaient à cet héroïsme ; la fameuse
Arria leur en avait donné l'exemple sous Tibère ; la seconde
Arria allait le suivre, et la jeune Fannia, fille de
Thraséas, femme d'Helvidius Priscus, grandissait dans
les mêmes sentiments. Voilà le milieu dans lequel se
forma cette âme naturellement portée aux choses d'en
haut. Jeune, beau, riche, il ne songea pas un seul instant
à imiter la triste jeunesse d'alors, qui portait dans
les dissipations de tout genre l'ardeur qu'elle eût mieux
aimé consacrer au service de la patrie : il avait une pudeur
virginale, dit son biographe; et il était comme
nourri d'héroïsme. Thraséas, son parent, l'aimait tendrement,
et souvent même se faisait accompagner par lui
dans ses voyages. Mais il ne semble pas qu'il ait essayé
de pousser le jeune homme vers la vie publique. Thraséas
ne sentait que trop que cette délicate nature n'eût pu
se plier aux dures nécessités des temps. Enfin, dès l'âge
de seize ans, il fit choix d'un maître dont il ne se sépara
plus : ce fut l'austère Cornutus, qui devint comme son
père et le directeur de son âme. Les vers que lui adresse
le poëte sont les plus touchants, les seuls touchants qu'il ait écrits : l'âme toujours tendue s'est comme oubliée
dans une effusion de tendresse.
Telle est cette douce figure de Perse : elle attire, par
un charme mélancolique. Ce beau jeune homme qui vécut
si pur, si loin des vilenies de ce temps misérable,
dans la société des derniers grands citoyens de Rome,
entouré de ces nobles femmes prêtes à accompagner
au supplice leurs époux, et toujours suivi de ce grave
stoïcien qui brava Néron en face et mourut dans l'exil,
exerce sur l'imagination une séduction véritable. Joignez
à cela une santé délicate, un corps languissant que soutient
une âme énergique, et cette mort prématurée, qui
survient avant que son génie ait pu donner tous ses fruits ;
c'en est bien assez pour expliquer la vive sympathie dont
il a été l'objet, et l'admiration pieuse en quelque sorte
dont on a entouré sa mémoire. Mais il s'en faut que
l'oeuvre mérite les mêmes éloges.
Nous ne possédons de Perse que six satires de médiocre
étendue : elles ne parurent qu'à sa mort, après avoir
été retouchées par son maître Cornutus, et ce fut Césius
Bassus, ami de Perse, poëte lyrique estimé alors, qui
s'en fit l'éditeur. L'ouvrage n'était pas terminé, ou du
moins Perse n'y avait pas mis la dernière main. Les corrections
de Cornutus durent porter sur quelques passages
trop hardis et qui renfermaient une censure des prétentions
poétiques et politiques de Néron encore fort jeune
alors. Quoi qu'il en soit, les contemporains admirèrent
beaucoup les satires, si l'on en croit le pseudo-Suétone
qui a écrit la biographie de Perse ; cependant le nom du
poëte n'est éité qu'une fois par Quintilien et par Martial.
Le principal, l'irretriédiable défaut des satires de Perse,
c'est l'obscurité. On passerait volontiers condamnations sur certains détails peu clairs, pourvu que l'ensemble se
dessinât nettement devant les yeux: mais l'obscurité s'étend
à la composition elle-même. Il n'est pas facile de
distinguer le véritable sujet de telle ou telle satire ; l'ordre
des idées échappe ; souvent même on ne sait si l'auteur
garde la parole ou la cède à un interlocuteur : bref,
il faut payer chèrement les beautés rares mais réelles
qui éclatent dans l'oeuvre. A quoi tient cette obscurité?
Il se peut que les éditeurs Cornutus et Césius Bassus
aient cherché à voiler l'expression de quelques passages
trop hardis : mais, comme l'a fort judicieusement remarqué
Bayle, Perse est toujours obscur, même quand il
expose des maximes morales d'une incontestable évidence
et qui ne pouvaient être dangereuses à leur auteur.
L'obscurité est donc chez lui comme un vice naturel.
Ce vice est le produit de la solitude et de la doctrine.
Perse ne se mêla point aux hommes: renfermé dans le
petit cercle de parents et d'amis qui suffisaient à son
âme, il n'a pas vu cette forte lumière qui se dégage du
spectacle des hommes et des choses, et renvoie pour ainsi
dire au poëte ses propres idées et ses sentiments, revêtus
d'une couleur plus chaude. Que sait-il des passions et
des misères morales ce jeune homme qui essaye d'en
tracer un tableau? Ce que lui en ont appris les manuels
des stoïciens, les conversations chastes et réservées de
ses parents, c'est-à-dire, la face purement extérieure.
Il sait ce qui est bien, ce qui est mal, en quoi consistent
la véritable liberté, le véritable bonheur, la véritable
piété; mais le poëte n'est pas un théoricien, et le satirique
gagnera plus à la vue des turpitudes humaines qu'à la
contemplation des principes de la sagesse. Il lui manque
donc l'expérience: il n'a pas éprouvé les troubles des passions, il n'en a pas été le témoin. De là, du vague
dans ses peintures, une grande indécision. Joignez à
cela la doctrine elle-même dans laquelle il s'est comme
barricadé, rude et saine doctrine, que nul n'admire plus
que moi, mais qui ne peut se plier aux douces exigences
de la poésie. Le stoïcien est un homme dont l'âme est
toujours tendue, dont la raison est toujours droite, rigide,
inflexible, qui vit dans un effort incessant: au dedans
de lui-même il sent l'ennemi qui guette sa proie,
ce sont les passions, il prétend les anéantir. Au dehors, il
sent toutes les misères, tous les périls attachés à la condition
humaine; il se roidit contre eux d'avance, d'avance
les brave, et reste libre. Cette vie de lutte
continuelle contre le dehors et le dedans, c'est la mort
de l'imagination. Le poëte satirique est un homme indigné
qui épanche sa colère : le stoïcien est inaccessible à
la colère; il a un froid dédain pour les misères de ses
semblables, mais rien ne trouble la sérénité de son âme.
Voilà ce qui donne à l'oeuvre de Perse cette couleur
indécise, ce je ne sais quoi de roide et de heurté. Ne cherchez
point ici la verve impétueuse de Lucilius. Perse n'a
pas cette flamme qui brûle le coeur; de plus, il tourne et
retourne sans cesse sa pensée, cherchant à retrancher la
moindre superfluité, à condenser l'expression jusqu'aux
dernières limites de la concision, qu'il dépasse souvent.
Oeuvre laborieuse, où l'on sent bien l'homme qui se
ronge les ongles jusqu'à la chair, comme il le dit lui-même,
pour conserver cette sobriété rigide, cette attitude
grave du sage qui frappe sans s'émouvoir.
La première satire de Perse a pour sujet, les prétentions
des gens de lettres de son temps. C'est une critique
fort obscure pour nous qui n'avons pas les originaux sous les yeux, de certains poètes contemporains, et probablement
de Néron lui-même. On ne voit pas bien quelles
sont les théories littéraires de l'auteur. Il semble railler
les amateurs d'archaïsmes et continuer la guerre d'Horace
contre les admirateurs de la vieille littérature nationale.
Peu d'originalité et de relief. La deuxième satire
est bien supérieure. Elle a pour sujet la prière. C'est une
invective énergique contre ces dévots qui demandent aux
dieux des biens fragiles, dangereux, ou qui se flattent de
les corrompre par leurs présents. Ce sujet était presque
un lieu commun. Sénèque l'a traité avec son éloquence
éclatante, et Juvénal en a tiré l'admirable satire dixième.
Perse s'est borné à soixante-quatorze vers, dont les derniers
sont d'une belle venue et d'un souffle élevé. Je les cite « 0 coeurs penchés vers la terre, oh! que vous êtes
vides des pensées d'en haut ! Quelle idée que celle de porter
nos préjugés dans les temples, et de juger de ce qu'il
plaît aux dieux d'après les convoitises abjectes de notre
chair! La chair! oui, c'est elle qui, pour son usage, fait
dissoudre la cannelle dans le suc corrompu de l'olive, et
bouillir les toisons de la Calabre dans la pourpre profanée.
C'est pour elle que l'on détache la perle du coquillage
et que du sein vierge de la terre on extrait le
métal pour le condenser en lingots brûlants. Oui, c'est
la grande coupable : au moins ses corruptions sont pour
elle une jouissance. Mais les dieux!... prêtres, dites-le moi,
que font-ils de votre or? Ce que fait Vénus de la
poupée que lui offre une petite fille. Ne pourrions-nous
pas plutôt donner aux dieux une offrande que le descendant
chassieux du grand Messala ne leur présentera jamais
sur ses plats d'or: je veux dire une âme affermie dans
les sentiments de la justice et du droite un coeur qui ne cache en ses replis, aucune pensée mauvaise, un caractère
auquel l'honneur a donné sa généreuse trempe? Oh !
puissé-je apporter au temple pareille offrande, et avec
cela le plus simple gateau suffira à la divinité. »
La troisième traite de la paresse.
La quatrième est dirigée contre la vanité présomptueuse
de ceux qui prétendent diriger les affaires publiques.
C'est un ressouvenir du premier Alcibiade de Platon : on
suppose que le poëte avait en vue le jeune Néron. Cette
satire renferme des détails d'une crudité dégoûtante.
La cinquième traite de la véritable liberté. C'est de
beaucoup la plus parfaite, mais, à vrai dire, ce n'est pas
une satire. C'est un épanchement tendre du disciple de
Cornutus dans le sein de son maître. Dans la dernière
partie seulement le poëte met en scène ceux qu'il représente
comme les esclaves de quelque passion qui les tyrannise,
la cupidité, l'amour, l'ambition.
La sixième a pour sujet l'avarice ou plutôt contre
l'emploi qu'on fait de son argent.
Si l'on lisait les satires de Perse pour se faire une idée
exacte des moeurs des Romains au temps de Néron, on serait
déçu. Rien ne ressemble moins à Juvénal que Perse.
Le premier voit, sent et rend ce qu'il a vu et senti. En
grand poëte qu'il est, il fuit l'abstraction, et peint des
types vivants. Rarement il mêle à ses tableaux une
théorie morale ; mais ses tableaux sont un enseignement.
J'ai dit pourquoi Perse ne voyait-point ainsi : il avait rarement
les yeux braqués sur le monde extérieur. Au fond;
les vices et les ridicules qu'il censure, il ne les considère
que d'une façon abstraite, et comme une déviation à
cette fameuse ligne droite des stoïciens, à la raison pure.
De nuances, de distinctions, de gradations, il n'en faut pas chercher en lui ; pour les stoïciens toutes les fautes
sont égales. De là, le manque de souplesse, de mesure et
partant de vérité. Je ne vois dans ces satires qu'un seul
type vivant : c'est une esquisse rapidement jetée, mais le
personnage a été vu et senti. Peut-être s'attendait-on
parfois dans les conversations du soir qui réunissaient la
famille de Thraséas, à le voir entrer tout à coup, le glaive
à la main, ou porteur d'une sentence de mort. Ce personnage,
c'est l'épais centurion, le collaborateur de César, qui
au corps de garde s'essaye à railler lourdement les nobles
sénateurs stoïciens, en attendant qu'il reçoive l'ordre
de les égorger, ou leur signifie l'ordre de se tuer eux-mêmes.
Le voici.
« Ici quelqu'un m'arrête : c'est un vieux bouc de centurion. » En fait de philosophie, dit-il, j'ai ce qu'il
me faut. Je ne tiens pas à devenir un Arcésilas, un de
ces Solons moroses, toujours la tête basse, l'oeil fixé à
terre, toujours grognant entre leurs dents et rageant en
silence, ces gens qui, la lèvre en avant, ont toujours l'air
d'y peser leurs mots, ruminant sans cesse quelque radotage
de vieux malade: «Que de rien ne nait rien, que
rien ne retourne au néant. Et c'est là ce qui te rend
blême, c'est là ce qui te coupe l'appétit? A ces mots hilarité
universelle, et là-dessus nos militaires, des gaillards
bien nourris, ma foi ! partent tous d'un éclat de rire convulsif
qui leur plisse le nez (1). »
(1) Sat., III et aussi Sai., V, derniers vers.
§ X.
PÉTRONE.
Sénèque, Lucain, Perse, sont comme une protestation
contre les turpitudes de la cour de Néron, protestation éloquente souvent et amère, souvent aussi déclamatoire
et excessive, comme il arrive d'ordinaire, quand on n'a
pas été mêlé aux événements ou qu'on y a été compromis.
Que dire d'un autre écrivain, qui mourut la même année
que Lucain, sur l'ordre de Néron, comme lui, et qui
a laissé un ouvrage dont on n'est pas encore parvenu à
bien déterminer le caractère et le but ? Cet écrivain est
Pétrone. On croit généralement que l'auteur du livre intitulé
Satyricon, est le même que le personnage à qui
Tacite a consacré deux chapitres du seizième livre de ses
Annales : les voici.
« Pétrone (Publius ou Caius Petronius Arbiter) consacrait
le jour au sommeil, la nuit aux devoirs et aux
agréments de la vie. Si d'autres vont à la renommée par
le travail, il y alla par la mollesse. Et il n'avait pas la réputation
d'un homme abîmé dans la débauche comme la
plupart des dissipateurs, mais celle d'un voluptueux
qui se connaît en plaisirs. L'insouciance même et l'abandon
qui paraissaient dans ses actions et dans ses paroles,
leur donnait un air de simplicité, d'où elles tiraient une
grâce nouvelle. On le vit cependant proconsul en Bithynie
et ensuite consul, faire preuve de vigueur et de capacité.
Puis retourné aux vices ou à l'imitation calculée des vices,
il fut admis à la cour parmi les favoris de prédilection.
Là, il était l'arbitre du bon goût ; rien d'agréable, rien de
délicat pour un prince embarrassé du choix que ce qui
lui était recommandé par le suffrage de Pétrone. Tigellin
fut jaloux de cette faveur : il crut avoir un rival plus
habile que lui dans la science des voluptés. Il s'adresse
donc à la cruauté du prince contre laquelle ne tenaient
jamais les autres passions, et signale Pétrone comme ami
de Scévinus: un délateur avait été acheté parmi ses esclaves, la plus grande partie des autres jetés dans les fers,
et la défense interdite à l'accusé.
«L'empereurse trouvait alors en Campanie, et Pétrone
l'avait suivi jusques à Cumes où il eut l'ordre de rester.
Il ne soutint pas l'idée de languir entre la crainte et l'espérance,
et toutefois il ne voulut pas rejeter brusquement
la vie. Il s'ouvrit les veines, puis les referma, puis
les ouvrit de nouveau, parlant à ses amis et les écoutant
à leur tour mais dans ses propos rien de sérieux, nulle
ostentation de courage; et de leur côté point de réflexions
sur l'immortalité de l'âme et les maximes des philosophes.
II ne voulait entendre que des vers badins et des
poésies légères. Il récompensa quelques esclaves, en fit
châtier d'autres; il sortit même, il se livra au sommeil,
afin que sa mort, quoique forcée, parût naturelle. Il ne
chercha point, comme la plupart de ceux qui périssaient,
à flatter par son codicille ou Néron, ou Tigellin, ou
quelque autre des puissants du jour. Mais sous les noms
de jeunes impudiques et de femmes perdues, il traça le
récit des débauches du prince, avec leurs plus monstrueuses
recherches, et lui envoya cet écrit cacheté ;
puis il brisa son anneau, de peur qu'il ne servît plus tard
à faire des victimes. »
Tel est le personnage : c'est lui, selon toute vraisemblance,
qui est l'auteur d'un ouvrage dont aucun modèle
n'existait avant lui. Jusqu'au milieu du dix-septième siècle,
on n'en possédait que des fragments plus ou moins importants,
lorsqu'on en découvrit en 1662 un morceau
considérable qui forme l'épisode qu'on appelle le festin
de Trirnalcion. Le livre est un roman, j'ajoute, un roman
obscène et satirique. Je croirais sans peine que la
première idée du Satiricon fut inspirée à Pétrone par les romans grecs, connus sous le nom de Fables Milésiennes et dont un certain Aristides de
Milet fut l'inventeur. Ces récits, d'une rare licence à ce
qu'il paraît, obtinrent grande faveur à Rome dans les derniers
temps de la république. Crassus, dans son expédition
contre lesParthes, emportait avec lui ces singulières
productions, et les principaux officiers de son armée faisaient
comme lui. Il se trouva même un érudit romain
pour les traduire, c'est Sisenna. Mais Pétrone ne fut pas
un traducteur, ni même un imitateur ; l'oeuvre est toute
romaine: elle a un nerf et une amertume qui n'ont rien
d'attique ni d'héllénique. Les Grecs ont peut-être autant
d'esprit, mais ils n'ont pas cette vigueur de pinceau.
L'analyse du Satiricon est impossible : on ne peut
même donner une idée des aventures qui y sont rapportées,
ni des héros qui y figurent. Il y a là un mélange
de cette crudité romaine que rien ne rebute, et de cette
élégante corruption grecque qui jette des fleurs sur la
boue. C'est à Naples et à Crotone, que se passent les
principales scènes du roman: mais il n'est pas difficile de
retrouver la Rome impériale dans la peinture que fait
l'auteur de ces villes de province. Un côté des moeurs
romaines semble l'avoir surtout frappé, la poursuite des
héritages : c'était là en effet une des plaies les plus graves
de la société d'alors. Le mariage était non-seulement méprisé,
mais regardé comme la pire des spéculations. Un
père de famille ayant dans ses enfants des héritiers naturels,
nul ne faisait attention à lui ; un vieux célibataire
au contraire était choyé et caressé de tous ; chaque
jour il faisait et refaisait son testament, attirait les petits
soins, les prévenances, les cadeaux, et souvent en mourant
dupait ceux qui avaient cru s'assurer son héritage. Les trois aventuriers dont Pétrone raconte les prouesses
s'associent pour exploiter les captateurs de testaments :
un vieux poëte ruiné joue le rôle de vieillard sans enfants,
fort riche, mais gêné pour le moment; il n'a sauvé
d'un naufrage terrible que deux esclaves, ses compères.
Il attend chaque jour l'envoi de sommes considérables.
Aussitôt les offres de service pleuvent sur lui : on prodigue
au misérable les plus viles complaisances. Voici le
portrait que trace l'auteur des moeurs Crotoniates. « Si vous êtes commerçants, si vos spéculations n'ont d'autre base que la probité, renoncez à votre dessein, cherchez fortune ailleurs. Mais si vos moyens sont d'un ordre plus relevé, plus distingué, si vous avez le coeur de bien mentir, allez, vous vous enrichirez ici. Dans notre ville on ne fait nul cas des dons du génie; l'éloquence y est dédaignée, la sobriété, la pureté des moeurs n'y ont aucun succès, les gens du pays sont divisés en deux classes : des dupes et des fripons. Ici on n'élève point d'enfants; l'homme qui a des héritiers naturels, on ne l'invite ni à dîner ni au spectacle : tous les plaisirs lui sont refusés, il est réduit à cacher son ignominie. Mais quand on ne s'est jamais marié, quand on n'a pas de proches parents, on parvient aux plus brillants honneurs. Un célibataire, c'est un héros, le seul brave, le seul honnête homme. Vous allez voir une ville qui ressemble à une grande plaine en temps de peste : il n'y a que des cadavres et sur les cadavres des corbeaux. Mes amis, voilà ce que je cherche, dit Eumolpe, voilà justement la société qui me convient. »
L'épisode du festin de Trimalcion, qui forme près de la
moitié de l'ouvrage, est une des plus remarquables productions
de la littérature romaine. Quel est ce Trimalcion ? A certains traits (1) il est impossible de méconnaître
cet empereur grotesque que Sénèque avait déjà
bafoué dans L'Apocoloquintose, Claude.
(1) Claude porta un édit pour permettre à sa table les flatus ventris. Trimalcion va plus loin encore.
Mais la physionomie
du personnage a un bien autre relief : vous retrouvez
en lui la jactance et la bassesse du parvenu, un étalage
de mauvais goût, quelque chose comme Turcaret en goguette,
fier du luxe dont il éblouit ses hôtes, et plein de
mépris pour eux, ayant toujours à la bouche sa propre
histoire, c'est-à-dire le génie qui lui a valu cette opulence
; car Trimalcion ne rougit pas de sa basse extraction,
elle le remplit d'orgueil : ne lui a-t-il pas fallu déployer
des facultés extraordinaires pour parvenir à la
splendeur de sa fortune présente ? Quelles facultés ? L'auteur
nous le dit à la fin. Trimalcion a débuté dans la vie
par les plus vils et les plus déshonorants métiers. L'argent
que lui a rapporté cette industrie, il l'a appliqué au
négoce ; il a équipé des vaisseaux, il s'est enrichi par le
trafic; puis les successions sont venues, car il n'a pas
d'enfants. Il est à cette heure tellement riche qu'il ne sait
pas lui-même le chiffre de sa fortune ; il y a telle propriété
qu'il possède depuis six mois, et que son intendant
n'a pas encore eu le temps d'inscrire sur ses livres ;
parmi le peuple de ses esclaves, il n'y en a pas la dixième
partie qui le connaisse. Tel qu'il est, il n'est pas fier, il
reçoit à sa table le premier venu, nos coureurs d'aventures
par exemple. Seulement il leur dit : « Goûtez bien
ce vin qui a cent années, hier, on n'en but pas d'aussi
bon à ma table, et pourtant j'avais meilleure compagnie »
(honestiores caenabant). Le festin d'un luxe insensé et
profondément ridicule est égayé par une foule d'intermèdes. Trimalcion veut même qu'il y ait de la philologie
entre chaque service. Il a soin de faire admirer l'ordonnance
du repas, l'art de ses cuisiniers, et surtout les
coupes où l'on verse les vins délicats. A ce propos, il fait
montre d'érudition. Il raconte qu'Annibal après la prise
de Troie fit jeter au feu toutes les.statues d'airain, d'or et
d'argent, et que de leur fusion résulta le fameux bronze
de Corinthe. Seul il en est propriétaire. Le travail de ces
coupes est merveilleux : l'une d'elles représente Cassandre
égorgeant ses enfants ; l'autre Dédale enfermant
Niobé dans le cheval de Troie. Un esclave déclame des
vers de l'Iliade. Il les explique aux convives : « Diomède et Ganymède étaient frères; Hélène était leur soeur; Agamemnon l'enleva, et mit à sa place la biche de Diane. Homère raconte les combats des Troyens et des
peuples du Latium. Agamemnon fut vainqueur et consentit
qu'Achille épousât Iphigénie, ce qui mit, comme
vous l'allez voir, Ajax en fureur. » Puis au milieu de
toutes ces folies de l'orgueil et de la débauche, la pensée
de la mort qui intervient : tandis que les coupes circulent,
au milieu de l'ivresse, un esclave pose sur la table un
squelette d'argent. Malheureux! malheureux que nous sommes, s'écrie Trimalcion, tout l'homme n'est que
cc néant ! ainsi nous serons tous, quand l'Orcus nous emportera. Vivons donc, tant que nous pouvons jouir ! » Il
a du reste déjà commandé son tombeau, construit sur des
dimensions colossales avec des inscriptions dignes de lui.
Mais, en mourant, il affranchira tous les esclaves. « Les
esclaves aussi sont des hommes : ils ont bu le même lait
que nous, et si une mauvaise destinée pèse sur eux, cependant,
de mon vivant ils boiront l'eau de la liberté. Du
reste par mon testament je les affranchis tous. »
J'en aurai fini avec Pétrone lorsque j'aurai mentionné
les deux seuls passages que relèvent d'ordinaire les critiques
dans son livre : l'un est relatif aux rhéteurs, l'autre aux
poëtes. Dans le premier, Pétrone semble reprocher aux
déclamateurs la ruine de l'éloquence. En exerçant les
jeunes gens sur des sujets fictifs, ils ne les préparent en
rien aux luttes sérieuses du barreau ; de plus, ils ont
introduit le goût de cette éloquence orientale, excessive,
chargée de couleurs fausses, qui est aujourd'hui à la
mode. Rien de plus juste ; mais le rhéteur Agamemnon
répond avec une certaine raison que l'enseignement
a été vicié par le goût du jour, que les parents exigent
qu'on apprenne à leurs enfants, non ce qui est
bien, mais ce qui réussit dans le moment : de plus
ils veulent que les études ne durent pas longtemps, que
le jeune homme soit de bonne heure mis en état de
gagner sa vie, de réussir dans le monde. Tout cela est
encore vrai; donc la conclusion de Pétrone serait que le
mal est irremédiable : pour moi, j'en suis persuadé,
comme je crois aussi qu'il en prenait fort bien son parti
Épicurien, sceptique, homme d'esprit, il voyait, jugeait,
mais quant à s'indigner ou à gémir, il en était bien incapable.
Ergo vivamus, dum licet esse bene. La devise de
Trimalcion est la sienne : il y joindrait volontiers celle-ci,
non moins célèbre :
Et sinamus mundum ire quomodo vadit. (Et laissons aller le monde comme il va.)
L'autre passage semble une allusion directe à la Pharsale.
Le poète Eumolpe refait le début de l'oeuvre de Lucain. Ce qu'il reproche à celui-ci, c'est de n'avoir pas
distingué l'histoire de la poésie. Il fallait relever le récit
des faits par l'adjonction du merveilleux. Par cette critique,
Pétrone se rattache à l'École virgilienne ; c'est tout ce
qu'il a conservé des anciennes traditions, car c'est bien
un homme de son temps.
Il l'est surtout par sa langue qui est belle, pure et
forte, plus précise que celle de Sénèque, avec moins
d'éclat, mais plus de souplesse peut-être.
Juvénal. — Martial. — Stace. -Silius Italicus. — Valerius Flaccus.
§ 1.
Les règnes détestables de Claude et de Néron virent
naître un certain nombre d'écrivains doués de talents
remarquables, mais sur qui pesèrent cruellement les
misères de cette triste époque. Juvénal, Martial, Stace,
Silius Italicus, Valerius Flaccus n'étaient pas des poëtes
méprisables, bien qu'il faille mettre les deux premiers
bien au-dessus des autres; les deux Pline, Quintilien
viennent immédiatement après les plus grands; quant
à Tacite, il faut lui faire une place à part. Il est en
dehors et au-dessus de ses contemporains; peut-être
même au-dessus de Salluste et de Tite-Live. Étudions
d'abord les poëtes, et, parmi eux, ceux qui nous présenteront
un tableau fidèle de cette société romaine devenue
la proie duprincipat et des vices qu'il amenait à sa suite.
A ce point de vue, Stace n'est pas dépourvu d'intérêt,
mais qu'il est pâle et insuffisant auprès de Juvénal et de
Martial !
Suivant une biographie fort courte et parfois obscure
attribuée à Suétone, Juvénal (Decimus Junius Juvenalis)
est né l'an de Rome 795 (après J.-C. 42). Dodwell reporta sa naissance à l'an 791. De sa famille on ne sait rien : suivant Suétone son père ou celui qui l'éleva (incertum
filins an alumnus) était un riche affranchi. Il naquit à
Aquinum, ville des Volsques. Il vécut plus de quatre-vingts
ans, et assista aux règnes de Caligula, Claude, Néron,
Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus, Domitien,
Nerva, Trajan, et mourut sous Adrien. Le pouvoir absolu
donnait ses fruits ; et quelques princes honnêtes intercalés
parmi des monstres, faisaient mieux sentir encore
la dureté de ces temps, où tout dépendait du caprice
d'un seul. Juvénal étudia l'éloquence, mais par goût, et
sans ambition ; il ne se destinait ni à l'enseignement ni
à la vie publique. Jusqu'à l'âge de quarante
ans, il se livra à la déclamation. J'ai dit ce qu'il
fallait entendre par là. De tels exercices prolongés jusqu'à
un âge si avancé indiquent une passion véritable : aussi
le poète porta-t-il dans ses vers les habitudes et la couleur
oratoires. Presque tous ses contemporains reçurent la
même éducation et s'adonnèrent à cette rhétorique vide
et ampoulée, puis la portèrent dans des sujets où elle était
froide et déplacée : Juvénal (et c'est là une part de son
génie) écrivit des satires. La satire est le genre démonstratif
en vers. Delà, l'étroite convenance du sujet et du
style. Il ne cessa de déclamer que pour commencer
d'écrire, et, quand il écrivit, il déclama encore. Suivant
toute probabilité, c'est sous Domitien qu'il composa ses
premières satires, mais il se garda bien de les lire en public.
Elles ne parurent que sous Adrien. L'une d'elles, la
septième, renfermait un trait piquant à l'adresse d'un histrion,
le pantomime Pâris, une des victimes de Domitien :
des courtisans charitables y virent une allusion à un acteur chéri d'Adrien, et le prince envoya le poëte en Égypte à l'âge de quatre-vingts ans, avec le litre de préfet
d'une cohorte ; il y mourut bientôt. Que dire des commentateurs,
qui ne virent là qu'une aimable plaisanterie: du
prince? Il est vrai qu'il eût pu le faire périr à Rome même.
Tel est l'homme. Il s'est tenu en dehors des événements
de son temps, non par indifférence, mais par prudence,
je dirais même par dégoût, et il a été néanmoins
victime d'une de ces cruelles fantaisies impériales auxquelles
son obscurité eût dû le soustraire. Quant au
poëte, il a été en effet, comme le dit Boileau, « élevé dans
les cris de l'école. » A-t-il poussé jusqu'à l'excès sa mordante
hyperbole? Qu'on lise Tacite, Suétone, Martial.
Voyons l'oeuvre.
Les satires de Juvénal sont au nombre de seize (1), et
les grammairiens anciens les distribuaient en cinq livres,
division abandonnée depuis.
(1) Otto Ribbeck sur des preuves insuffisantes n'en admet que dix d'authentiques.
La seizième sur les avantages
de l'état militaire est d'une authenticité douteuse : elle
est cependant fort ancienne, car Servius et Priscien en
citent quelques expressions, et l'attribuent à Juvénal.
Je vais indiquer brièvement le sujet de chacune de ces
satires.
Dans la première, qui est une véritable préface, Juvénal
expose les motifs qui le poussent à écrire des satires.
Il ne peut contenir sa bile devant les infamies qu'il a sous
les yeux ; il faut qu'elle s'épanche. S'il n'a pas de génie,
l'indignation lui dictera des vers. « Non, dit-il, non, les siècles à venir n'ajouteront rien à nos dépravations : en fait de passions et de vices, je défie nos descendants de trouver du nouveau. Tout vice est à son comble et ne peut que baisser. Allons, toutes voiles dehors, lançons-nous! »
La deuxième, défectueuse dans sa composition, est une
peinture des hypocrites « qui font les Curius et dont la vie
est une éternelle bacchanale. » Le poëte y ajoute un tableau
des vices des grands, vices qui s'étalaient au grand jour.
La troisième, représente au vif la Rome de Domitien,
envahie par les aventuriers grecs, n'offrant aucune sécurité
à l'honnête homme pauvre.
La quatrième a pour titre le turbot. C'est le récit de la
délibération du Sénat sur la manière dont il fallait faire
cuire un magnifique turbot offert à Domitien.
La cinquième est consacrée aux parasites, vieille industrie
qui se modifiait suivant les moeurs du jour et la
bassesse de ceux qui l'exerçaient.
La sixième, qui n'a pas moins de 661 vers, a pour sujet
les femmes.
La septième énumère toutes les misères des gens de
lettres.
La huitième a pour sujet la noblesse.
La neuvième est une peinture des débauches romaines.
La dixième est intitulée : les voeux des hommes. Le
poëte montre combien ils sont insensés le plus souvent.
La onzième a pour sujet le luxe des festins.
La douzième pourrait avoir pour titre : « l'amitié désintéressée.
» Le poëte célèbre le retour de son ami Catulus
et offre aux dieux un sacrifice.
La treizième a pour sujet : le remords.
La quatorzième traite de l'exemple, de son importance
dans l'éducation des enfants. La quinzième est une peinture des superstitions, surtout
de celles de l'Égypte.
Enfin, la seizième expose les avantages de l'état militaire.
Elle est incomplète, assez froide, et l'authenticité
n'en est pas certaine.
Il serait intéressant de connaître la date de la composition
de chacune de ces satires ; mais on est réduit sur
ce sujet à des conjectures. Suivant toute vraisemblance,
; c'est dans un âge avancé que le poëte écrivit les quatre
dernières, peut-être même la huitième sur la noblesse.
Il y a en effet moins d'âpreté, une sorte de tristesse plus
douce, qui convient mieux à un vieillard. Les autres
durent être composées sous Domitien ou peu de temps
après. Le ton en est plus amer, il y a plus d'emportement,
la déclamation, proprement dite, s'y fait plus
sentir. Quoi qu'il en soit, l'histoire de la société romaine
sous les empereurs est là. Juvénal a compris et rendu
son siècle ; il l'a vu et jugé en homme vertueux, indigné,
en bon citoyen. Son témoignage est accablant pour
ses contemporains. Encore une fois, je ne puis accepter
pour lui le reproche d'exagération : la forme seule est
excessive parfois chez lui ; mais Dion-Cassius et Suétone
sont les garants de sa véracité. On leur adresserait le
même reproche, s'ils n'étaient plats. Demandons-lui donc
ce qu'il a vu ; nous examinerons ensuite comment il l'a
vu ; quelle est la matière de son livre ; quelle en est la
forme ?
§ Il.
POINT DE VUE OU SE PLACE JUVÉNAL
Ce qui constitue l'originalité du poëte satirique, c'est le point de vue auquel il se place pour railler et flétrir
les vices qu'il a sous les yeux. S'il vit dans le monde, s'il
se pique d'être ce qu'on appelle un honnête homme, de
savoir vivre, de garder dans sa mise, son langage, ses
moeurs, ce décorum qui distingue les gens bien élevés, de
fuir tout excès choquant, sans s'interdire pourtant les
voluptés permises, il sera, comme Horace, une sorte de
moraliste mondain, qui raille les infractions au code des
bonnes manières. Esprit, grâce, vivacité sans emportement
: voilà le ton du poëte, qui fuit les grands mots,
semble converser avec son lecteur, lui fait doucement
son procès, se le fait à lui-même à l'occasion. Comme il
ne sent point
Ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses,
il ne s'indigne jamais, n'éclate jamais. Tout autre est Juvénal.
Il voit les Romains de son temps comme les aurait
pu voir un Curius, un Dentatus. Il les juge et les flétrit au
nom des lois antiques abolies depuis quatre cents ans. Il
prend volontiers le ton que J.-J. Rousseau prête à Fabricius
dans sa fameuse prosopopée. Les moeurs romaines,
au temps de la première guère punique, voilà son idéal.
Par là, il se rattache à Lucilius : celui-ci a représenté
les vices de la civilisation pénétrant à Rome, le vieil
esprit de la république s'armant contre eux, disputant
vaillamment le terrain. Juvénal les représente vainqueurs,
triomphants, ayant libre carrière, ne songeant
même plus dans l'enivrement de la victoire au vieil ennemi
qui a succombé. Il réveille ce fantôme des antiques
vertus, et le dresse menaçant devant la corruption régnante.
Dans ces orgies grandioses où les descendants des Scipions et des Métellus se plongeaient, les statues des
ancêtres sur leur piédestal de marbre contemplaient
l'abaissement de leur postérité. Juvénal prête sa voix à
ces témoins muets de tant de turpitudes. Ce n'est plus un
contemporain qui parle, c'est un homme d'autrefois qui
ne peut supporter ce qu'il a sous les yeux. Quelle force
le poëte ne trouve-t-il point dans un tel point de vue !
Mais quelle prise peut-il avoir sur les âmes? Est-il juste
d'exiger des sujets de Domitien les vertus des concitoyens
de Camille? Le moraliste ne tiendra-t-il aucun compte
de toutes les révolutions survenues? La république romaine
pouvait-elle s'immobiliser et durer telle qu'elle
était au temps de Caton le Censeur? Les changements
introduits peu à peu n'étaient-ils pas nécessaires, fatals,
et quelques-uns d'entre eux ne sont-ils pas une
amélioration? Ne faut-il pas distinguer entre un luxe
modéré, utile, et les effroyables prodigalités de quelques
fous? Un vêtement chaud, moelleux, élégant même, est-il
le signe d'une réelle dépravation? Toutes ces questions
et bien d'autres, le philosophe, l'historien les pèsent,
les examinent avec soin, non le poëte. Tel n'est
point son rôle, telle n'est pas sa vocation. Ce n'est pas
un débat contradictoire qu'il ouvre, c'est un réquisitoire
qu'il prononce. Il est l'accusateur public. Rien ne trouve
grâce devant ees yeux; il repoussera même les circonstances
atténuantes. Suivons-le dans son oeuvre.
LA FAMILLE. — LA FEMME.
Ce qu'était la famille romaine dans les premiers siècles
de la république, chacun le sait. Pureté, dignité, majesté :
voilà son caractère. Que de vertus exigées et obtenues sans peine de la matrone, assise à son foyer, filant la
laine et élevant pour la républiqne l'enfant en qui elle voit
déjà un citoyen romain et qu'elle vénère dès le berceau !
Quelle gravité dans l'union des deux époux ! Le mariage,
indissoluble pendant près de cinq cents ans malgré le
droit au divorce, maintient les fortes et pures traditions,
recrute l'État d'hommes libres élevés uniquement pour l'État, et s'impose comme une obligation sacrée à tout
citoyen. La femme est dans la main du mari ; la loi ne
lui confère aucun droit ; c'est une esclave ; mais de
quelle vénération elle est entourée ! Elle a sa part dans
la majesté du peuple-roi : elle est la divinité du foyer ; elle ne quitte l'austère maison que pour accomplir les
rites religieux auxquels est attaché le salut de l'empire.
Rien d'impur ne blesse ses regards, n'approche d'elle,
ne sort d'elle.
Voyez ce qu'elle est devenue au temps où Juvénal
écrit. Il ne recherchera point comment la femme a été
peu à peu émancipée par les lois, comment le divorce
s'est introduit dans les moeurs, comment le mariage n'est
plus qu 'un contrat ou une fantaisie de quelques jours,
comment le célibat est devenu à la mode, comment les
moeurs inouïes des hommes ont avili les femmes, non ;
c'est l'historien qui marquera les étapes de cette dépravation
: Juvénal peindra ce qu'il a sous les yeux. Ce
n'est plus dans l'intérieur de la maison qu'il faut chercher
la Romaine : elle se promène sous les portiques, aux
rendez-vous de la galanterie ; elle est au théâtre, où elle
s'éprend des mimes, des chanteurs, des joueurs de lyre;
elle est au cirque, où elle applaudit le gladiateur ; elle
s'attache à lui, pour lui quitte mari, enfants, patrie, avec
lui s'embarque pour l'Égypte. D'autres se font gladiatrices : «les voilà qui se frottent d'huile comme les athlètes. Qui ne les a vues tirer au mur, creuser le
but à coups d'épée, le heurter du bouclier, observer enfin toutes les règles de l'escrime. » Heureux le
mari, quand elle n'éprouve pas la fantaisie de se donner
elle-même en spectacle dans l'arène, casque en tête,
épée au poing ! La suivrons-nous aux mystères de la bonne déesse? Ces saintes cérémonies sont devenues des
orgies monstrueuses. Dans les temples, elle invoque les
dieux, elle offre des victimes, consulte les aruspices,
pour savoir si la harpe de Pollion remportera le prix
aux jeux Capitolins. Chez elle, elle ne sait que faire, défaire
et refaire son visage, échafauder sa chevelure.
Malheur à l'esclave maladroite qui aura disposé irrégulièrement
une boucle rebelle ! « Parmi ces dames, il y en a qui ont des bourreaux à l'année : frappez! dit-elle, et, pendant ce temps, elle se pommade le visage, elle écoute les propos de ses amies, elle examine une étoffe richement brodée d'or. Frappez encore! Et elle parcourt un long journal. Frappez toujours ! Mais les bourreaux n'en peuvent plus. Sors ! crie-t-elle à la victime d'une voix tonnante. Justice est faite. » Ajoutez
à ces occupations les pratiques de dévotion, les pèlerinages
imposés par les prêtres de Bellone, les immersions
dans le Tibre glacé ; puis, les conférences avec les
vieilles femmes de Judée, ou les aruspices d'Arménie, ou
les sorciers chaldéens, et les fabricants de poisons expéditifs.
Voilà la vie de la dame romaine, voilà du moins
ce qu'on en peut dire à un lecteur français. Le reste, il ne
le devinera point; il faut le lire dans Juvénal. Demandons-lui
d'où vient cette prodigieuse dépravation. Il répond ce
qu'aurait répondu le vieux Caton : « Jadis la médiocrité des fortunes maintenait la chasteté de nos Romaines. Le vice n'osait entrer dans ces pauvres demeures ; ce qui l'en repoussait, c'était le travail, les longues
cveilles; c'étaient ces mains de femmes, mains laborieuses, durcies à filer les laines d'Étrurie; c'était Annibal aux portes de Rome, et les citoyens debout sur la porte Colline. Nous souffrons aujourd'hui des maux d'une longue paix ; plus terrible que les armes, le vice s'est abattu sur Rome et venge l'univers vaincu. Toutes les horreurs, toutes les monstruosités de la débauche nous sont devenues familières du jour où périt la pauvreté romaine. Ainsi sur nos sept monts se sont installées Sybaris, Rhodes, Milet, et cette folle Tarente, au front couronné de fleurs, aux lèvres humides de vin. C'est l'argent, l'argent immonde, qui le premier importa chez nous les moeurs étrangères ; c'est l'enivrante richesse, le luxe avec ses honteux raffinements qui a brisé notre vieille énergie. »
Sa pensée revient sans cesse à ces temps de l'heureuse
simplicité, non qu'il poursuive l'effet du contraste,
mais parce que son esprit violent ne voit et ne veut que
les extrêmes (1).
(1) Voir un très beau tableau des moeurs antiques (Sat. XI, 83-120).
LE ROMAIN.
Voyons maintenant le Romain. Ici, encore, il faudra singulièrement adoucir les traits du tableau : il y a telle satire dont on ne peut même dire le titre. Ce qui maintenait les anciennes moeurs, c'était la vie publique. Le Romain soldat, agriculteur, jurisconsulte, toujours aux armées ou dans les champs, au forum, au sénat, aux tribunaux, était absorbé par ses devoirs de citoyen ; ce que nous appelons aujourd'hui la vie privée était encore l'accomplissement d'un devoir public. Quel vide le jour où la chose de tous devint la chose d'un seul, le jour où, « le fouet à la main, César fit trotter devant lui «le docile troupeau des citoyens de Rome (1) ! »
(1) Sat., X.
L'oisiveté
imposée à ces hommes dont la vie était si pleine ! ils se
jetèrent en désespérés dans tous les vices. Juvénal a bien
entrevu la cause réelle de la dégradation dont il était
témoin, mais il était défendu, même sous les bons empereurs,
de parler de la liberté. Il sait bien cependant
qu'elle était la gardienne des anciennes moeurs. « Depuis longtemps, depuis que nous n'avons plus de suffrages à vendre, ce peuple ne s'inquiète plus de rien ; et lui qui jadis distribuait les commandements militaires, les faisceaux, les légions, tout enfin, maintenant il n'a plus de prétentions si hautes. Son ambition
a s'est réduite à ces deux choses : du pain, des jeux au cirque. » C'est Juvénal qui a trouvé la formule de
l'Empire : Panem, et circenses.
Tel est le peuple, ce qu'il appelle « la tourbe des enfants
de Rémus » . Que sont devenues les hautes
classes de la société? C'est sur elles que pèse plus lourdement
le joug. C'est parmi les héritiers des grands noms
que César choisit ses victimes (1).
(1) « C'est un phénomène de vieillir quand on porte un grand nom. » (Sat., IV.)
Condamnés à l'oisiveté,
ne sachant s'ils ne seront point égorgés demain, les
descendants des nobles familles cherchent dans le tumulte
d'une vie d'orgies à oublier ce qu'ils ont perdu et ce qu ils
peuvent perdre à tout moment. Les uns se font les courtisans de Domitien, et il les convoque pour délibérer sur
le sort d'un turbot. Ils font antichambre, tandis que le
poisson est introduit. Enfin ils entrent à leur tour sur leur face réside cette pâleur naturelle à ceux que Domitien honore de sa redoutable amitié. Car, comment s'y prendre pour ne pas irriter un tyran ombrageux avec lequel on risquait sa tête à parler du
beau temps, de la pluie ou des brouillards du printemps. » Celui-ci se sent menacé : il se déshonore pour
sauver sa vie ; il descend dans l'arène. Mais le Néron
chauve a déjà destiné sa tête au glaive. Cet autre échappera
: pour n'être point victime, il s'est fait bourreau,
mais avec douceur. Il devine les sentences de mort qui
couvent dans l'âme du maître, « et d'un mot glissé à l'oreille, il fait couper la gorge aux gens. » Mais toutes
ces bassesses, toutes ces infâmes complaisances sont souvent
perdues. Le maître préfère à ces porteurs de grands
noms les affranchis, les étrangers venus à Rome pieds
nus, qui ont exercé les plus vils métiers, et sont prêts
à tout. Il trouve en eux plus de docilité, moins de
scrupules, plus d'empressement à servir ses défiances
et sa haine contre ces patriciens qui flattent la créature
de César et la méprisent.
Juvénal n'a peut-être pas compris ce penchant du
despote à s'entourer de vils ministres, qui reçoivent de
lui tout leur éclat, à qui on peut tout demander, et qui
ne refuseront aucun office. Il s'indigne de voir ces basses
figures rangées autour de César ; il réclame cet honneur
pour les vrais Romains, les fils des Scipions et des
Métellus ; il peint en termes énergiques et désolés l'abaissement des grandes familles ; tel patricien réduit à se
faire entrepreneur de vidanges; tel autre tenant un
établissement de bain, un Corvinus faisant paître les
brebis d'autrui! Il montre les nobles, « les fils des
Troyens » disputant au peuple en tunique, à la porte
d'un insolent parvenu, la sportule qui nourrira leur
famille ; des préteurs, des tribuns, voyant passer devant
eux un misérable affranchi ; un vieux citoyen romain,
forcé de céder sa place au théâtre au fils d'un prostitueur
né dans un mauvais lieu. Tout cela le révolte, et avec
raison, mais c'était la conséquence naturelle de la révolution
accomplie dans la vie politique des Romains. Le
poëte s'indigne du pouvoir que donne l'argent; il s'étonne
qu'on n'ait pas encore élévé de temple au dieu Écu; il
attribue à ce culte de la richesse tous les vices qu'il a
sous les yeux : c'est confondre l'effet avec la cause.
L'argent ne devient une puissance énorme que dans les
sociétés où il n'y a plus rien pour lui faire contre-poids.
Donnez aux âmes une nourriture plus noble et elles
dédaigneront celle-là.
Quant aux occupations des Romains de ce temps, je
n'en dirai que peu de chose. La vie privée ne gagne point
ceux qui ont perdu la vie politique. La famille, c'était
l'État en petit; plus d'État, plus de famille. Le mariage
ruiné par l'extrême facilité du divorce est une fantaisie
ou une spéculation. Les époux se livrent chacun de leur
côté aux vices qu'ils préfèrent. Liberté réciproque absolue,
indifférence complète. Plus de foyer domestique.
Que devient l'enfant? Qu'on lise dans Tacite (Dialogue
des orateurs, §§ 28 et 29) l'éloquent parallèle entre l'éducation
d'autrefois et celle de son temps. Je le résumerai
en deux mots. Jadis on voyait dans l'enfant un citoyen : on ne voit plus en lui qu'un embarras. C'est à
Juvénal qu'il faut demander ce que devient ce pauvre
être abandonné par ses protecteurs naturels au plus vil
des esclaves de la maison. La Satire XIVe sur l'exemple,
nous montre la dépravation transmise par les pères aux
enfants. « Si ce vieillard s'abandonne aux funestes entraînements du jeu, son fils qui porte encore au cou la bulle d'or joue déjà comme lui : voilà sa petite main qui s'arme aussi d'un cornet. Et cet autre jeune garçon, sa famille peut-elle espérer de lui des sentiments plus élevés que ceux de son père, quand on le voit déjà savant dans l'art de préparer les truffes et capable de faire nager des champignons et des becfigues sur une sauce de sa façon ! Cette science lui vient de son père, un vieux polisson, un goinfre à cheveux blancs. Le pauvre enfant n'a que sept années, toutes ses dents ne sont pas encore repoussées ; mais quand tu l'entourerais des maîtres les plus graves et les plus barbus, toujours il lui faudra une table somptueuse ; sa cuisine doit soutenir l'honneur de sa maison. »
Et la jeune fille, que lui enseignera sa mère ? « Peux-tu espérer de la fille de Larga qu'elle soit une honnête femme, elle qui, pour te nommer tous les amants de sa mère, n'en pourrait expédier la liste sans reprendre haleine jusqu'à trente fois? Vierge encore, elle était déjà la confidente de sa mère, maintenant c'est sous sa dictée qu'elle écrit ses billets doux; et elle les fait porter à ses amants par les mêmes drôles dont s'est servie sa mère. »
Voilà les exemples que l'enfant a sous les yeux, l'éducation
qu'il reçoit : ainsi le vice pénètre dans son âme
appuyé d'une imposante autorité. Il n'a qu'à ouvrir les yeux pour recueillir des leçons empoisonnées. Que si le père
de famille songe à lui inculquer quelques maximes, il ne
lui recommandera qu'une seule chose : gagne de l'argent.
Que tous les moyens te soient bons pour cela. « Aie toujours à la bouche cette pensée du poëte, pensée vraiment digne des Dieux et de Jupiter même : comment vous vous êtes enrichi, c'est ce dont nul ne s'inquiète; l'essentiel, c'est de s'enrichir. Voilà ce que nos vieilles nourrices enseignent aux petits garçons, qui se traînent encore à quatre pattes, voilà ce que savent toutes les petites filles avant d'apprendre leurs lettres. » Quels fruits sortiront d'une telle éducation?
On le devine sans peine. Il dépassera son maître, ce jeune
écolier si bien formé : on le verra, la main sur l'autel
de Cérès, vendre de faux témoignages. S'il épouse une
femme riche, il l'étranglera pendant son sommeil pour
en hériter; enfin il trouvera un jour qu'il est bien fâcheux
d'attendre l'héritage paternel, et il se débarrassera de
son père trop obstiné à vivre. Ah ! tu te récrieras en vain,
en vain tu soutiendras que tu ne lui as pas enseigné cette
morale. Si, cette perversité lui vient de toi. «Celui qui par ses leçons met au coeur de son fils l'amour des grandes fortunes; celui dont les sinistres conseils ont fait de lui un homme avide; en lui laissant toute liberté de s'enrichir par la fraude, celui-là, en lui lâchant la bride, l'a engagé dans la carrière : une fois lancé, tes cris ne l'arrêteront point, il va passe la borne, et ne t'écoute plus. Nul ne croit que ce soit assez de s'en tenir aux fautes qu'on lui permet : on s'accorde toujours plus de licence. Quand tu dis à ce jeune homme que donner à un ami est une sottise, que c'en est une aussi de soulager la pauvreté d'un de ses proches, de le tirer de la misère, du même coup tu lui apprends le vol, l'escroquerie; tu lui enseignes à acquérir au prix de tous
les crimes ces richesses dont l'amour te dévore (1).
Ah ! c'était un tout autre langage que tenaient à leurs enfants
ces héroïques vieillards qui, brisés par l'âge, après
avoir traversé les batailles des guerres puniques, ou
bravé le farouche Pyrrhus et l'épée de ses Molosses, recevaient
de la république en récompense de tant blessures
un ou deux arpents de terre. Le poëte se reporte toujours par la pensée à cet âge d'héroïques vertus, si
différent du siècle où il vit. Il se plaît à les opposer l'un
à l'autre : l'antithèse est terrible, écrasante pour les contemporains. Il n'exige pas de ceux qui ne sont plus citoyens,
« qui ne sauraient tenir le langage d'une âme libre, et sacrifier leur vie à la vérité » qu'ils soient semblables
aux vieux Romains de la république. Non :
qu'ils aient leurs vices, qu'ils en soient la proie, mais
qu'ils respectent au moins cette chose sacrée, l'enfance.
« On ne saurait trop respecter l'enfance. Prêt à commettre quelque honteuse action, songe à l'innocence de ton fils, et qu'au moment de faillir, la vue de ton enfant vienne te préserver. »
LA VILLE.
Voilà la famille romaine : c'était autrefois Rome tout entière,
car l'étranger n'y pénétrait point, si ce n'est comme
esclave. Les temps sont changés : la moitié de la population
est étrangère. En vain quelques empereurs ont
essayé d'arrêter les flots de cette invasion; l'impulsion donnée par César se poursuit. Depuis longtemps les barrières
vermoulues de la cité jalouse sont tombées, et
tous les vaincus, pêle-mêle se précipitent dans son enceinte.
Nous ne sommes pas loin du temps où l'édit de
Caracalla étendra à tous les peuples le titre de citoyen
romain. Puis ce seront des empereurs sortis de tout
pays qui viendront prendre à Rome le diadème des Césars;
les uns venus du fond de la Germanie, les autres
de l'Espagne, ceux-ci apportant avec eux les moeurs de
de l'Orient, ce cortège de despotes asiatiques, ces costumes
étranges, ces pratiques et ces superstitions extraordinaires.
Un immense défilé de tous les peuples se prépare
; et tous se dirigent vers Rome, que chacun d'eux
occupera à son heure. En attendant, c'est le Grec qui
pullule dans la ville des Césars, non le Grec de l'Attique
ou du Péloponèse, mais celui de la Syrie, de l'Égypte,
des iles de l'Asie Mineure, le Grec façonné depuis longtemps
à la servitude, sans traditions nationales, sans
foyer, aventurier spirituel et hardi, qui vit des vices
d'autrui et, comme le vautour qui sent le cadavre, afflue
aux lieux où fermente la corruption.
Juvénal les a vus à l'oeuvre, ces subtils agents de corruption,
il a compris leur rôle, et senti leur force, il en
est effrayé. Il nous montre un de ses amis, Umbritius,
vieux citoyen romain, qui émigre de Rome, laisse sa patrie
en proie à cette lie grecque, se reconnaît incapable
de disputer la place à ces parasites qui ont fait main basse
sur tout. Le moyen qu'un rustique enfant de Romulus
le dispute à ces Grecs si fins, si vils, si souples ! Se ferat-il comme eux coureur de dîners? Il n'a pas l'esprit
assez vif, assez amusant; il ne sait pas comme eux flatter
impudemment ; il lui reste un fonds d'honnêteté et de pudeur qui le gêne, l'empêche de plaire et de réussir.
« Le Grec au contraire, le voilà au coeur des grandes maisons, bientôt il en sera le maître. Esprit prompt, aplomb imperturbable, parole facile, plus rapide que celle de l'orateur Isée, ils ont tout pour eux. En voici un : quelle profession lui supposes-tu? Toutes celles que tu peux désirer, c'est un homme universel. Grammairien, rhéteur, géomètre, peintre, baigneur, augure, saltimbanque, médecin, sorcier, un Grec, quand il a faim, sait tous les métiers. Tu lui dirais : Monte au ciel! il y monterait (1). »
(1) Sat. III.
Avec de telles gens point de concurrence possible pour le Romain. En vain il aura respiré dès son enfance l'air du mont Aventin, et se sera nourri des fruits de la Sabine, le patron préfère aux clients indigènes, lourds et mal appris, cet étranger aux aimables manières, au langage mielleux, qui offre ses services pour tout faire, et qui sait flatter comme personne. Les voilà donc reçus dans les riches maisons. Ils en chassent bientôt le vieux client, qui était un ami des anciens jours. « Pour cela, il suffit de laisser tomber dans l'oreille crédule du maître une goutte, une seule, du venin particulier à leur nature, à leur pays : aussitôt il me fait déguerpir. » Le Grec reste maître de la place, il corrompt la mère de famille, la fille jeune et chaste, le jeune époux adolescent. Par là, il se rend maître des secrets de la maison et se fait craindre. Belle et énergique peinture qui fait songer à Tartufe. Voilà les successeurs des Romains, les nouveaux clients qui réduisent les anciens à la misère, les forcent d'émigrer en province ou de soutenir sans espoir une lutte inégale : ainsi doit disparaître peu à peu le vieil élément romain. Quel métier faire, quand partout à l'entrée de toutes les industries on rencontre le Grec? Celui de parasite est hideux, dangereux même, et ne rapporte plus rien ; celui de ministre des débauches des grands est plus avantageux, mais il y a telles ignominies dont tout le monde n'est pas capable. Il reste celui de poëte, de rhéteur, de grammairien.
LES GENS DE LETTRES.
Les poètes, ils n'ont d'espoir que dans la munificence
de César. Quel César ? on ne sait, peut-être Adrien. Un
grand nombre, et des plus en renom, vont ouvrir des
bains à Gabies, des boulangeries à Rome, ou se font
crieurs publics. Il y avait autrefois des Mécènes, et
Martial semble croire que, s'il y en avait encore, il naîtrait
des Virgile.
Mais c'est une race disparue. Les riches aujourd'hui
font un autre usage de leur argent. Ils prêteront au
poëte qui veut faire une lecture publique quelque vieille
salle délabrée, et même quelques affranchis pour applaudir,
mais c'est le lecteur qui devra faire les frais des
banquettes, de l'estrade, des fauteuils loués pour la
circonstance. Quant au prétendu Mécène, sa bourse,
fermée au poëte, s'ouvre pour la courtisane Quintilla ;
ou bien il fait l'emplette d'un lion apprivoisé qu'il faut
gorger de viande. « Peut-être après tout cette grosse bête est-elle moins dispendieuse à nourrir qu'un poëte : un poëte, ça doit manger plus qu'un lion ! » Voyez Stace, le poëte chéri, à la mode ; quelle joie
dans la ville quand il annonce une lecture de sa Thébaïde ! On le couvre d'applaudissements : « Oui, mais il crève de faim, s'il ne réussit à vendre au comédien Paris son Agavé encore vierge de toute publicité. »
Qu'on s'étonne après cela de la stérilité des muses
latines! Il faut avoir bien dîné pour faire de beaux vers.
Mais que tirer de son cerveau, quand on a faim, quand
on a froid, quand on se demande où dînerai-je ? où
pourrai-je me procurer une couverture? Et les
avocats? « Leur faconde ronfle comme un soufflet de forge, on voit le mensonge écumer sur leurs lèvres. Et que leur en revient-il ? La fortune de cent avocats vaut juste celle du cocher Lacerna de la faction rouge. » A quels misérables expédients ils ont recours !
Les chalands vont de préférence aux avocats de grande
naissance qui ont des statues d'aïeux dans leur atrium
ou qui mènent grand train. Aussitôt de pauvres diables,
pour jeter de la poudre aux yeux et attirer la pratique,
étalent un luxe emprunté, louent des esclaves, des bijoux,
de l'argenterie, une robe de pourpre, et à la fin
font banqueroute. C'est un préjugé tout puissant. « On
« n'est guère éloquent avec un habit râpé. Est-ce qu'un pauvre hère comme Basilus oserait se permettre de jeter aux genoux des juges une mère éplorée? Il plaiderait à ravir qu'on le trouverait insupportable. »
Plus misérable encore est le rhéteur qui forme les
avocats. C'est peu d'avoir à subir les éternels refrains
de ses élèves, les vieilles déclamations qu'ils chantent
sur le même ton : on refuse de le payer. Eh ! qu'ai-je appris ? C'est cela ! on s'en prend au professeur ! Est-ce ma faute, si cet âne n'a rien qui lui batte sous la mamelle gauche ?» Ah ! l'on ne marchande pas
avec les musiciens ou les chanteurs, Chrysogonus et
Pollion, ni avec le maître d'hôtel qui dresse un festin,
ni avec le cuisinier qui le prépare. « Mais ce qui coûte
ce le moins à un père, c'est l'éducation de son fils. »
Quel respect inspirent à leurs élèves des maîtres ainsi
traités, réduits à citer en justice, pour obtenir payement,
les parents récalcitrants ? On en a vu que leurs écoliers
battaient ! « Dieu ! faites qu'aux ombres de nos ancêtres la terre soit douce et légère ; que sur leurs urnes s'épanouisse le safran parfumé : qu'elles se couronnent d'un éternel printemps : car ils voulaient que pour l'enfant le maître qui l'instruit fût aussi révéré qu'un père. »
§ III.
LE STYLE.
Telle est la matière du livre. Encore une fois, il faut
croire à la véracité de Juvénal; il n'a rien inventé. Il
aurait pu dire comme Labruyère : «Je rends à mon siècle
ce qu'il m'a prêté. » Ce qui lui appartient en propre et
constitue son génie, c'est la forme qu'il a donnée à son
oeuvre. Presque tous les critiques la jugent excessive,
et ne voient en ce poëte qu'un déclamateur. Il faudrait
pourtant s'entendre sur ce mot, qui n'avait pas autrefois
le sens qu'il a aujourd'hui. Il n'y a pas un écrivain romain
qui ne se soit livré à l'exercice de la déclamation ;
Cicéron déclama jusqu'à son dernier jour. Mais Cicéron
était un orateur, et Juvénal écrit en vers ? Eh quoi !
ignore-t-on les rapports étroits qu 'il y a entre l'éloquence
et la poésie? Qu'est-ce que les Philippiques de Cicéron, la deuxième notamment, celle que préférait
à tout Juvénal, sinon une déclamation virulente contre
Antoine? Juvénal a fait en vers ce que Cicéron avait
fait en prose. Par là il a donné à la satire une nouvelle
forme, la forme oratoire, déclamatoire si l'on veut, les
mots importent peu : ce qui importe, c'est d'examiner
si cette forme nouvelle, créée par lui, est en rapport
avec le sujet à traiter. Il est difficile de ne pas l'avouer.
En présence des monstruosités de ce temps, qui comprendrait
une satire légère, spirituelle, moqueuse ? le
ridiculum d'Horace est charmant, mais il ne serait pas
de mise ici, il faut autre chose. Juvénal l'a compris, ou
plutôt, son propre tempérament lui a révélé la forme
que réclamait l'oeuvre. C'est un génie original, le premier
des satiriques de tous les temps, de tous les pays. Plus
d'une fois on sent l'art et même l'artifice dans son style,
mais le ton général est si vrai, la couleur si exacte, que
les affectations de détail sont emportées dans le mouvement
puissant qui pousse le style. Là, en effet, est le
secret de sa vraie force : sa diction n'a rien de maigre
et de haché : elle est large, abondante : il vogue à
pleines voiles. Ne demandez pas à
des écrivains de cette trempe l'exquise mesure, la gradation
des nuances; ces qualités sont incompatibles avec
celles qu'ils possèdent. Le souci des détails, la recherche
du fini ralentiraient l'élan impétueux de la verve. Il y a
dans ce style des taches nombreuses, bien des scories
mêlées à l'or pur, mais il empoigne le lecteur, et le maîtrise.
Parfois la pensée est pauvre, vulgaire, la philosophie
dû moraliste tourne au lieu commun, mais l'expression reste forte ; les contrastes dramatiques, les
antithèses éloquentes relèvent l'idée et lui donnent un
relief saisissant. Sa qualité dominante, c'est le don de
peindre. Il est vrai qu'aucun scrupule de pudeur ne
l'arrête : mais ce n'est pas à la crudité des termes, à la
précision impudente des détails qu'il doit sa force.
Elle est dans la vigueur de la composition, dans le souffle
qui anime toutes les parties, et qui n'est autre chose
qu'une indignation généreuse. Je ne connais guère dans
aucune langue de tableau plus vigoureusement dessiné
que celui de la chute de Séjan (Sat. X). Quelle sobriété
et quel éclat dans les vers consacrés à Messaline et à
Hippia (Sat. VI) ! Et que l'on ne croie pas que le poëte ne
saurait prendre un autre ton que celui de l'invective.
Voyez (Sat. XI) l'image des anciennes moeurs romaines:
quelle vérité, et quelle éloquence triste ! De telles peintures
reposent agréablement, et font estimer le poëte;
Rarement il moralise, mais quand il le fait, c'est dans
un style élevé, grave. Il n'emprunte a aucune école sa
philosophie ; on voit même qu'il a peu d'estime pour les
représentants du stoïcisme qu'il accuse d'hypocrisie :
mais sa parole n'en a que plus d'autorité. C'est le langage
d'un honnête homme, convaincu, qui n'a point de
théorie à exposer.
§ IV.
MARTIAL.
On pourrait à l'aide de Martial compléter la peinture des moeurs romaines esquissée dans ses grands traits
par Juvénal. Mais si on lit Martial, on est embarrassé
pour en parler. Qu'il se contente donc d'une petite place
auprès de son illustre contemporain et fort au-dessous.
Martial (M. Valerius Martialis) est né en Espagne, à
Bilbilis, vers l'an 43 après Jésus-Christ, sous le règne de
Claude, et il est mort en Espagne âgé environ de soixante
ans, sous le règne de Trajan. Il vint à Rome vers l'âge
de vingt ans, pour y faire son droit, comme nous dirions
aujourd'hui ; mais la jurisprudence n'était pas son fait,
pas plus que l'éloquence : il se mit à faire des vers, des
petits vers, comme on disait au dix-huitième siècle. Il
en fit pendant trente-cinq ans, puis il retourna dans sa
patrie où il en fit encore, y épousa une femme d'une
certaine fortune, mais s'y ennuya profondément et y mourut
peu de temps après. Pourquoi abandonna-t-il Rome,
âgé de cinquante-cinq ans, pour aller s'enterrer à Bilbilis?
Parce que Domitien venait de périr, Domitien le protecteur,
le héros, le dieu de Martial, Domitien qui l'avait
fait tribun, lui avait accordé le droit de trois enfants. Le poëte s'était rabattu sur Nerva, puis sur Trajan : pour toucher le coeur de ces princes,
il avait insulté la mémoire de son dieu Domitien ; mais
ils avaient été sourds à ses éloges, ils avaient méprisé
ses palinodies injurieuses, et Martial, n'ayant plus ni
pensions ni gratifications, était allé mourir en Espagne.
On le voit, c'est un assez triste personnage. Il est difficile
de comprendre comment l'auteur anonyme du Martial
de la collection Lemaire a pu trouver tout naturel le
rôle d'un poëte adulateur de Domitien. Mais il n'a loué
dans ce prince que ce qui était digne d'éloges, les spectacles
qu'il donna, les embellissements de Rome, les lois en faveur des jeunes enfants que des infâmes mutilaient
ou prostituaient ? Si c'est là tout ce que Martial a vu de
Domitien, il avait la vue courte : Suétone a vu bien d'autres
choses, et Juvénal en a rappelé quelques-unes.
Mais on ne peut pas même lui laisser cette misérable excuse.
Qu on lise l 'Épigramme 71 du livre IX, on verra que
Martial est très heureux de vivre sous un si bon prince :
« aucune cruauté, aucune violence armée : on peut jouir
d'une paix et d'une joie assurées. » Enfin l'avènement
de Nerva et de Trajan fut salué avec des cris de joie, des
actions de grâces aux dieux par tout ce qu'il y avait encore
d'honnête à Rome ; tout le monde y gagna, Martial
seul y perdit. Il a bien d'autres traits dans sa vie qu'on
pourrait relever, et qui ne sont pas à son honneur : ce
rapprochement suffit.
C'est un poëte de cour, prêt à chanter ce que l'on
voudra, et qui l'on voudra. Il lui manque le sens moral,
il est tour a tour insolent et bas ; il se croit des envieux,
et s'enfle d'orgueil ; tournez la page, il mendie une toge,
et s'aplatit. Il célèbre les vertus et les grâces de sa
femme ; un peu plus loin il écrit telle épigramme qui les
déshonore tous deux. De l'esprit, une certaine intelligence
du faible des gens. Il tourne à Pline, dont il connaît
la vanité et l'austérité, un compliment fort habile,
le comparant à la fois à Cicéron et à Caton. Pline lui paye
son voyage pour retourner en Espagne, et lui rédige une
petite oraison funèbre très-convenable. Qui sait? se dit-il,
les vers de Martial dureront peut-être, et me voilà immortel.
En tous cas je dois lui savoir gré de l'intention.
Il écrit à presque tous les hommes illustres de ce temps là
: il ose s'adressera Juvénal ; il encense Quintilien ; il se
pâme d'admiration devant le génie puissant du pauvre Silius Italicus ; mais il n'ose aborder Tacite. En somme,
un composé d'esprit et de bassesse, d'arrogance et de
platitude. Il a vécu à Rome pendant trente-cinq ans dans
la mauvaise société, moitié parasite, moitié frondeur, et
de ce qu'il a fait, vu et entendu, il a tiré quinze cents
épigrammes. C'est beaucoup.
L'épigramme était fort à la mode depuis Catulle, le
créateur du genre. Ce petit poëme est plus ou moins à la
portée de tout le monde : il n'exige qu'une fort médiocre
culture intellectuelle, et quelque peu de piquant dans
l'esprit. Les gens du monde tournaient des épigrammes
plus ou moins malicieuses qui couraient dans les salons
sous le couvert de l'anonyme : on en gravait sur les
murs, on en répandait au théâtre contre l'empereur,
parfois même on en mettait jusque sur le socle de sa
statue. Dans tous les temps les Romains ont eu un goût
particulier pour l'épigramme, et ils y réussissent assez
bien. S'ils n'ont pas la grâce des Grecs, ils l'emportent
par le mordant. Martial est le représentant le plus complet
du genre.
Nous avons en tout de lui quinze livres d'épigrammes :
le premier et les deux derniers ont seuls un titre particulier.
Sur les Spectacles, Cadeaux, Envois (de Spectaculis,
Xenia, Apophoreta). Le poëte célèbre les moindres
détails des jeux donnés par l'empereur, sa magnificence,
sa justice, sa bonté, et toutes les vertus qu'il
n'eut jamais. Il le loue d'avoir mis sur la scène une
représentation exacte de la fable de Pasiphaé (XV) et
du supplice de Lauréolus cloué sur une croix! Les
deux livres Xénia et Apophoreta sont des devises à
joindre à de petits cadeaux. L'auteur y fait preuve de
connaissances gastronomiques assez étendues. C'est une poésie dans le genre des petits vers de Benserade ou
autres faiseurs de devises pour les bonbons de la reine.
Laissons cela, et voyons le reste.
C'est une peinture de la société dans laquelle vivait
Martial. Quelle société? Celle que vous retrouverez dans
tous les temps, la société des gens qui s'accommodent
toujours du gouvernement, quel qu'il soit, de l'état social,
quel qu'il soit, et qui songent à passer la vie le plus
agréablement possible. L'attrait du plaisir est le seul
lien qui unisse entre eux les membres de cette association
; on n'y est point exclusif, la haute noblesse y
coudoie la bourgeoisie, et celle-ci ne repousse point le
peuple. Les uns apportent leur argent, d'autres leur esprit,
d'autres leur personne, dans le sens le plus étendu
du mot. Les gens de moeurs austères en sont seuls exclus;
ou plutôt s'en excluent eux-mêmes. A Rome, cette association
tacite de gens qui se convenaient était fort
étendue. Elle renfermait des sénateurs, des chevaliers,
des affranchis, des histrions, des musiciens, des matrones,
des courtisanes, des parasites. Il se formait bientôt une
chronique scandaleuse ; chaque jour fournissait son
histoire dont le héros ou l'héroïne variait, mais le fonds
était presque toujours le même. Voilà le milieu dans
lequel a vécu Martial, voilà les originaux qu'il a eus sous
les yeux. C'est là qu'il a puisé la matière de son oeuvre. Les
cancans obscènes y tiennent une grande place : c'était la
monnaie courante de la conversation. On a prétendu qu'il
avait peu réussi dans ce genre, et l'on a voulu lui en faire
un titre d'honneur, comme s'il était digne de plus nobles
sujets ! Je croirais plutôt que c'est la partie la mieux réussie
de son livre, et j'en conclus que c'était celle qui l'attirait
le plus. Qu'un ami l'invite à laisser là ces bagatelles, à tenter quelque grand ouvrage, il s'esquive, et répond
par une demande d'argent dissimulée sous une pasquinade.
« Soyez pour moi un Mécène, et je serai un Virgile » C'est une pensée qui lui est chère. Il s'imagine
qu'il suffit de renter un écrivain pour qu'il ait du génie.
Tel qu'il est, il s'estime infiniment. On lit ses livres jusqu'à
Vienne; tout le monde s'en repait,
jeune homme, enfant, jeune femme chaste, sous l'oeil de son sévère mari». Si cela est vrai, quel jour sur
les moeurs du temps ! Tel qu'il est, on conserve encore un
peu d'indulgence pour lui : il a écrit deux ou trois fort
jolies pièces sur la campagne ; il y a là un sentiment vrai,
celui du citadin que le bruit, la boue, la fumée, la cuisine
et toutes les immondices de Rome, viennent à
écoeurer, et qui se représente les frais ombrages baignés
d'air pur, les bons paysans, les belles filles de la campagne
honnêtes et douces, et la basse-cour et la paix.
Il alla retrouver en Espagne ces biens trop méprisés,
mais il était trop tard, il ne pouvait plus vivre hors de
Rome : les palais blasés, brûlés par des mets épicés, des
boissons de feu, ne peuvent supporter autre chose. Il
ne fit que languir, peu estimé de ses compatriotes, et
mourut bientôt.
Il a dit lui-même de ses épigrammes : « Il y en a de
bonnes, il y en a de médiocres, les mauvaises sont en
plus grand nombre. » On ne peut que souscrire à ce
jugement. En général ce qui lui manque, c'est la grâce.
Les épigrammes satiriques, surtout celles qu'on ne
peut citer, ont un relief remarquable; les autres, plus innocentes, manquent de naïveté. On sent le travail, l'effort
pénible pour trouver le trait de la fin ; parfois il est
longuement préparé, amené, et arrive enfin tout froid ;
on l'avait deviné dès le premier vers. En général, la facilité
n'est pas la qualité dominante du poète : peut-être
était-il heureusement doué dans sa jeunesse, mais quel
talent résisterait à un pareil exercice continué sans interruption
pendant quarante années? Cette recherche
incessante de l'effet tue toute imagination, toute verve :
le procédé remplace l'inspiration. Je reconnais cependant
volontiers que la langue, bien que tourmentée, reste pure ;
la diction est laborieuse, mais généralement correcte.
Les tours sont vifs, variés, l'expression assez nettes".
§V.
STACE.
Stace (P.Papinius Statius) fut contemporain de Martial,
et c'est peut-être le seul personnage important dont celui-ci
ne parle pas. On a supposé avec quelque raison que
Martial en était jaloux: tous deux en effet étaient courtisans;
tous deux aspiraient à l'honneur d'être des poëtes
officiels, tous deux y réussirent en partie. Martial fut
nommé par Domitien tribun, il obtint le Jus trium liberorum et une maison de campagne. Stace de son côté
fut plusieurs fois vainqueur dans les concours de poésie
établis par Domitien, reçut de lui un domaine, et de plus
eut l'honneur d'être invité à la table du prince avec des
sénateurs et des chevaliers romains; enfin il possédait
au plus haut degré le don de l'improvisation, et l'empereur
lui commanda plus d'une fois de petites pièces de circonstance
: il n'est pas téméraire de supposer que Martial en ressentit quelque dépit. Nous voilà bien loin d'Horace et
de Virgile. Les moeurs de cour régnent ; ce n'est plus l'émulation
qui stimule les poëtes, ils se font concurrence.
Le père de Stacequi fut, dit-on, le précepteur de Domitien,
reçut du prince de grandes marques d'honneur, et
donna à son fils l'éducation la plus propre à en faire un
poëte de cour. Stace parcourut cette carrière avec succès;
mais il rêva en même temps une gloire plus haute, celle
de l'épopée. C'était une âmé douce, affectueuse, un esprit
studieux, un travailleur infatigable. Marié fort jeune et
par amour à la veuve d'un musicien, il ne se consola
point de n'avoir pas d'enfants, en adopta un et le perdit
presque aussitôt. D'une santé délicate, que l'application
continuelle ruina de bonne heure, il quitta Rome à l'âge
de trente-six ans pour retourner à Naples, respirer l'air
natal : il était trop tard, il y mourut peu de temps après
son arrivée.
Si l'on en croit le témoignage de Juvénal (Sat. VII),
Stace était pauvre. On courait en foule aux lectures qu'il
faisait de sa Thébaïde; mais on ne vit pas d'applaudissements,
et le poëte était réduit à vendre à l'histrion Paris
sa tragédie Agave encore inédite. De ces traits réunis se
dégage une figure assez intéressante : cette mort prématurée
qui suit de si près un voyage au pays natal, cette sensibilité
un peu maladive, la sympathie très vive qu'il inspira
à Dante, tout cela fait naître dans l'esprit l'idée d'un
rapprochement avec Virgile, Virgile qu'il appelait un dieu,
dont il baisait humblement la trace. Mais ce n'est là
qu'une illusion de l'imagination.
Nous possédons de Stace trois ouvrages : 1° un recueil
de pièces détachées, presque toutes en vers hexamètres,
et intitulées Silves (Sylvarum libri quinque) ; 2° la Thébaïde(Thebais), poëme épique en douze livres ; 3° l'Achilléide
(Achilleis), autre poëme épique incomplet (nous
n'en avons que deux livres).
Les Silves sont le meilleur ouvrage de Stace. Il n'est
pas difficile d'en trouver la raison. C'étaient de petits
cadres, qu'il était capable de remplir : de telles pièces
n'exigeaient guère que des détails ingénieux, de rapides
peintures; son génie pouvait aller jusque-là ; la conception
puissante d'une oeuvre de longue haleine lui était
interdite. Enfin la nécessité de produire vite ces petits
poëmes commandés servait heureusement l'auteur. Quand
il avait le temps de chercher, il cherchait trop, trouvait
rarement bien, s'épuisait et usait son oeuvre en la limant.
Est-ce un aveu que cet hémistiche où il caractérise
sa Thébaïde : Et longa cruciata lima? Les Silves le forçaient à une simplicité relative. Il s'excuse de
s'être adonné à de telles bagatelles : Virgile a fait le Moucheron,
Homère la Batrachomyomachie. D'ailleurs aucun
de ces poëmes ne lui a coûté plus de deux jours de travail;
plusieurs ont été faits en un seul jour ; un d'eux a été improvisé
pendant le souper. Il y a dans les lettres qui servent
de préface à chaque livre des Silves un mélange de modestie
et de fatuité qui fait sourire.
Stace ne s'est pas demandé une seule fois s'il était
digne d'un vrai poëte de subir des commandes avec la date
de la livraison. Et quelles commandes ! Des vers sur la
statue équestre de Domitien, sur un mariage, sur une maison
de campagne, sur une salle de bains, sur un Ganymède,
sur un perroquet, sur un lion apprivoisé qui appartenait à
l'empereur, sur une coupe de che.veux d'un affranchi, etc.
Les détails gracieux ne font pas défaut dans ces petites
compositions; mais la plupart sont manquées : le poëte s'est guindé trop haut; la simplicité, le naturel lui manquent absolument.
Il prodigue les images grandioses, épiques: on
voit qu'il rumine toujours sa Thébaïde. Il a la mémoire farcie
de personnages, d'événements, de peintures démesurées,
et il en intercale dans ces petits tableaux de genre.
Je retrouve la note vraie, l'accent ému dans les pièces où
il a bien voulu se laisser aller quelque peu à sa sensibilité.
La Consolation à Flavius Ursus, les Larmes de Claudius
Etruscus sont des morceaux réussis. Il y aute épître
à sa femme Claudia, pour la décider à le suivre en Campanie,
à quitter Rome où elle se plaisait, qui est heureusement
tournée. Ce n'est pas que les rapprochements mythologiques
n'y tiennent encore trop de place ; mais le
sentiment est vrai, touchant. J'en dirai autant des vers
dans lesquels il déplore la mort de son père et celle de
l'enfant qu'il avait adopté.
La plus curieuse de toutes ces pièces est le remercîment
adressé à l'empereur Auguste Germanicus Domitien,
qui avait invité le poëte à dîner. Il cherche dans
ses auteurs les descriptions de festins célébres, pour les
immoler au banquet impérial, le festin de Didon dans l'Énéide, celui des Phéaciens dans l'Odyssée. Mais que ces
images sont faibles ! « Il faut parler dignement: eh bien !
« j'étais dans les astres en compagnie de Jupiter. Ah! jusqu'ici stérile était ma vie! c'est de ce jour que commence mon existence ! » Il y a soixante-sept vers sur
ce ton-là.
C'est sur sa Thébaïde que Stace fondait l'espoir de sa renommée. Il y travailla pendant douze ans, avec cette
obstination consciencieuse qui voudrait être du génie. Il
en lisait en public des passages qu'on admirait beaucoup,
trop même, car il semble que le poëte n'ait guère
songé qu'à coudre s'il se pouvait, des épisodes plus ou
moins éclatants de couleur. Puis, rentré chez lui, il retravaillait
avec sa femme (détail touchant) et, probablement
sur les indications du public, l'oeuvre si longtemps préparée,
couvée, polie avec tendresse. Enfin elle est terminée
; le poëte lui dit adieu, et lui recommande de ne
chercher point à lutter avec la divine Énéide : « Suis-la,
mais de loin, et baise humblement ses traces.» Bien des
critiques ont été moins modestes pour Stace que Stace
lui-même. Scaliger déclare, avec cette impertinence qui
le caractérise, que Stace doit être placé avant Homère,
et ne le cède qu'au seul Virgile. Turnèbe, Casaubon,
Juste Lipse l'appellent excellent poëte, le dernier n'admet
pas qu'on puisse lui reprocher de l'enflure.
D'autres plus mesurés se bornent à le saluer de l'épithète
de doctus, doctissimus, poëte docte, poëte érudit,
en quoi ils ont raison.
Ce n'est pas en effet par l'originalité que brille la Thébaïde.
Stace a emprunté le sujet, et sans doute la composition
générale, au poëte grec Antimaque de Colophon,
que Quintilien juge avec une certaine sévérité. Nous savons
de plus qu'il existait chez les Grecs un nombre considérable
de poëmes sur les deux siéges de Thèbes. Stace
avait donc à sa disposition des matériaux poétiques abondants
et variés, ce qui, loin d'être un avantage, est un
embarras. Il en a tiré une oeuvre pénible, fausse de ton
et de couleur, à la fois érudite et déclamatoire. Le sujet avait un grave inconvénient, non comme le prétend
La Harpe, que deux scélérats maudits par leur père ne
puissent inspirer aucun intérêt; mais il se rattachait à
ces antiques légendes de la Grèce héroïque que les Grecs
eux-mêmes ne comprenaient plus, et que les Romains
n'avaient jamais comprises. La fatalité qui pesait sur
les Labdacides, les crimes qui en furent la conséquence,
et qui se succédèrent de génération en génération jusqu'à
l'extinction complète de la race, Eschyle, s'il ne les
a pas racontés, les a sentis : il a éprouvé cette mystérieuse
horreur qui se dégage d'un tel sujet, et il en a
pénétré cette admirable et puissante tragédie qu'on appelle
les Sept devant Thèbes. L'Oedipe roi et l'Oedipe à
Colone de Sophocle n'ont pas, il s'en faut bien, ce caractère
de sombre grandeur et d'effroi religieux. Stace ne
doit rien aux deux tragiques grecs ; il a sans doute pris
ailleurs ses modèles, et sur des épopées artificielles composé
laborieusement une épopée plus artificielle encore.
Ce qui manque en effet par-dessus tout dans ce poëme,
c'est l'inspiration. L'inspiration crée la composition de
l'oeuvre, sans effort pour ainsi dire et naturellement.
Quand l'esprit s'est fortement pénétré du sujet, l'a conçu
d'une façon toute personnelle, et comme créé, les diverses
parties s'ordonnent, un souffle puissant les anime et
les relie les unes aux autres; elles sont comme la conséquence
naturelle de l'idée première qui s'épanche et
rayonne. Telle est l'oeuvre d'Eschyle, telle ne pouvait
être celle de Stace. Dans ces douze livres il n'y a pas
une idée, il n'y a que des détails. Tout ce que sait le
poëte, il l'enchâsse dans son oeuvre. Chacun des héros
du siége de Thèbes paraît à son tour, accomplit des exploits
prodigieux et meurt. Enfin à l'avant-dernier livre, il met aux prises les deux frères. De dénoûment il
n'y en a pas, car on ne peut regarder l'arrivée de Thésée
à Thèbes comme la conclusion de cette sanglante histoire;
c'est un épisode cousu à tous ceux qui constituent
le poëme, et auquel à la rigueur on pourrait en coudre
d'autres. Voilà le défaut capital de la Thébaïde, celui qui
la relègue parmi ces oeuvres languissantes, froides, factices;
il n'y a pas de conception forte, il n'y a pas d'unité,
j'ajouterai même il n'y a pas d'action.
Restent les détails. Stace n'a rien innové dans cette
partie de l'épopée qu'on est convenu d'appeler le merveilleux.
Ses dieux sont taillés sur le modèle de ceux de
Virgile : il y a des séances dans l'Olympe, ou plutôt dans
les cieux, Jupiter préside, Junon essaye un peu d'opposition
en faveur de ses chers Argiens, comme dans Virgile
; Mercure est là pour accomplir les ordres du roi des
dieux ; il y a des furies pour enflammer le coeur des deux
frères, comme dans l'Énéide; il y a un Tartare et tout l'attirail
de la vieille mythologie catachthonienne. D'invention
personnelle on en chercherait vainement. La plus bizarre
imitation que se soit permise le poëte est, sans contredit,
celle du XXIe livre de l'IIliade,oùHomère représente Achille
allant chercher jusque dans les flots du Scamandre les
Troyens qu'il veut égorger à Patrocle ; le fleuve irrité, se
soulevant, pressant de ses ondes furieuses le flanc et les
épaules du héros, scène merveilleuse, d'une grandeur
incomparable, qui reproduit la double conception des
divinités antiques, comme éléments et comme personnes.
Stace a transporté dans son poëme (livre IX) cet épisode
splendide. Mais quelle pauvreté dans cette copie ! Cette
stérilité d'invention, ce besoin d'imiter sans cesse réduit
le poëte à l'impuissance quand il s'agit de peindre des caractères. Quelle variété et quel éclat, quelle vérité dans
l'Iliade! Ces figures de héros sont devenues des types;
chacun d'eux revit dans les Tragiques, dans Pindare, tel
que l'a représenté Homère; il a en lui la vie. Rien de
tel chez Stace. Tous sont jetés dans le même moule ; tous
accomplissent à peu près les mêmes prouesses, tiennent
le même langage, sont animés des mêmes sentiments.
Seul, peut-être, Amphiaraus le devin, se détache de ce
groupe uniforme, mais le mérite en est plutôt à la légende
qu'au poëte. Quant aux événements qui remplissent le
poëme, aucun d'eux n'est déterminé par le caractère
connu des personnages. L'Iliade tout entière naît du caractère
d'Achille ; la Thébaïde sort du caprice de Jupiter :
il veut frapper les Thébains et les Argiens; en conséquence
une Furie pousse Étéocle à refuser le trône à son
frère ; Polynice se retire à Argos, y épouse la fille du roi,
et engage dans sa querelle les chefs qui avec lui vont
assiéger Thèbes. Une fois le poëme ainsi lancé, nous avons
des combats, des jeux funèbres, un livre épisodique, racontant
l'histoire d'Hipsipyle et des Lemniennes, bref,
tous les incidents connus d'une épopée d'imitation. Quant
au style, je ne puis admettre avec Casaubon qu'il soit
sans emphase; il me semble plutôt que c'est là sa couleur
dominante. Je ne connais pas un seul passage qui
offre cette simplicité, ce naturel dans les pensées et dans
l'expression, qui sont le secret des grands poëtes. L'auteur
se travaille visiblement pour frapper l'esprit du lecteur;
il croit lui présenter de grandes images, de nobles
pensées, mais si l'on écarte la pompe du langage, le fonds
apparaît pauvre et nu. Le poëte ne dit pas : « Je chante une guerre fratricide », mais : « la flamme des Muses tombée sur mon âme me pousse à dérouler la guerre fratricide, un trône qui devait être occupé à tour de rôle, disputé avec une haine impie, et les crimes de Thèbes. » Ce défaut qui est capital est le signe de la
déclamation ; il n'y a jamais de proportion exacte entre
la forme et le fond ; au contraire, plus celui-ci est chétif,
plus celle-là cherche à éblouir. Rien de plus pompeux
que le discours adressé par Jupiter aux dieux réunis pour
l'entendre. Secouez toutes ces magnificences, vous
serez étonné de la nullité qu'elles essayent de dissimuler.
Jupiter est las d'employer la foudre. « Les Cyclopes sont fatigués de la forger; c'est pour cela qu'il avait autorisé Phaéton à brûler les humains coupables. Il veut punir en personne. » Le discours de Pluton, lorsque la terre
s'ouvre pour donner passage à Amphiaraüs, n'est pas
moins étrange. L'épisode de l'enfant Archémore tué
par un serpent est d'une diction plus sobre et ne manque
pas d'une certaine grâce. On l'a déjà remarqué, si Stace
eût mieux compris son génie, c'est dans des sujets simples,
familiers, touchants qu'il se fût exercé. Sa vie si
pure, son coeur si affectueux et si sensible, tout semblait
l'y porter ; mais c'est là une des misères de ces
époques de décadence : on veut du pompeux, de 1'extraordinaire
à quelque prix que ce soit. La réalité, la vérité, la
nature semblent choses basses, étrangères à l'art. Celui-ci
est placé sur des sommets éclatants, vers lesquels se
dirigent, haletants et poussifs, des poëtes qui s'équipent
pour l'ascension ; le divorce entre l'art et la nature devient de plus en plus profond; et, par une conséquence
bien légitime, les oeuvres deviennent de plus en plus
fausses. Voilà la tyrannie qu'exercent des époques comme celle que nous étudions, tyrannie que ne peuvent secouer
des esprits souvent très heureusement doués, mais que le
goût du jour, l'éducation littéraire, le désir de plaire aux
contemporains précipitent dans l'ornière commune, souvent
loin de leur véritable voie.
Le dernier ouvrage de Stace fut l'Achilléide. Si l'on
en juge d'après le contenu des deux premiers livres,
l'Achilléide eût été un poëme de longue haleine : le
poëte n'avait pas encore amené son héros à Troie.
Il y a en général plus de simplicité dans le style ; la
lecture en est plus facile et plus intéressante. Je l'ai
déjà dit, Stace eût mieux réussi dans la peinture des
scènes de la vie intérieure : les deux premiers livres
de l'Achilléide ne sont pas autre chose.
Si l'on en croit Stace, ces deux poëmes n'étaient qu'un
essai de ses forces. Il rêvait une épopée plus haute,
toute nationale; mais il voulait s'y préparer en traitant
de moindres sujets. Cette épopée, c'étaient les exploits
incomparables de Domitien. Qui osera regretter que la
mort n'ait pas permis au poëte d'exécuter ce noble
projet?
§ VI.
SILIUS ITALICUS.
Stace n'était pas le seul qui rêvât de s'asseoir sur le
Parnasse au-dessous de Virgile ; plusieurs de ses contemporains
ambitionnaient la même gloire, et prirent à
peu près le même chemin pour y parvenir. Je tâcherai,
en parlant de Silius Italicus et de Valerius Flaccus, d'éviter
les redites : il suffit d'avoir montré à propos de la
Thébaïde les procédés de cette triste école. C. Silius Italicus a une physionomie toute particulière.
S'il est mauvais poëte, il ne peut en accuser la
pauvreté, cette cruelle ennemie du génie, qui a étouffé
dans leur germe tant d'oeuvres sublimes. Il est riche, fort
riche ; il possède de nombreuses maisons de campagne,
en Campanie, près de Naples; c'est un personnage considérable
et considéré, qui a été honoré trois fois du consulat,
qui a vu un de ses fils obtenir la même dignité, qui
a gouverné en qualité de proconsul cette belle province
de l'Asie, si convoitée par les magistrats sortant de charge.
Il a traversé les règnes de Néron qui le nomma consul
l'année même de sa mort, de Galba, d'Othon, de
Vitellius, de Vespasien, de Titus, de Domitien, sous qui
il obtint son troisième consulat, et il est mort sous Trajan.
Sa mort fut volontaire : malade d'un abcès jugé incurable,
il refusa toute nourriture, et quitta volontairement
la vie à l'âge de soixante-quinze ans.
Par quels moyens réussit-il à se faire accepter de
tous les empereurs? Ce fut un habile politique; il poussa
même un peu loin cette habileté sous Néron, en se
faisant délateur, ce qui nuisit quelque peu à sa réputation.
Mais il effaça la honte de ce premier métier par une
honorable retraite ; c'est Pline, son aîné,
qui parle
ainsi. Il aimait les belles-lettres, particulièrement
l'éloquence et la poésie. Il avait un véritable culte pour
Cicéron et pour Virgile, pour Virgile surtout; il faisait
une collection des bustes de ce grand poëte, achetait le
lieu où s'élevait son tombeau, et célébrait le jour de sa
naissance avec plus de pompe que le sien propre. Cette
passion lui inspira l'idée d'écrire un poëme épique : il se mit à l'oeuvre étant déjà vieux, et lut plusieurs fois en
public des fragments de son travail. Les applaudissements
ne lui manquèrent pas : il était riche et personnage
consulaire. Ses confrères en poésie chantèrent
ses louanges. Martial le met tout simplement sur la
même ligne que Virgile. Mais brusquement tout ce bruit
s'éteint; le silence et l'oubli se font autour de ce nom,
l'oeuvre elle-même disparaît. Ce n'est qu'au quinzième
siècle qu'elle est exhumée de la poussière d'une bibliothèque
par un de ces hardis promoteurs de la Renaissance,
le Pogge ; et aujourd'hui même les critiques les
plus bienveillants ont de la peine à se réjouir convenablement
de cette trouvaille. C'est qu 'en effet l'oeuvre
est médiocre. Pline, qui a l'esprit fort délicat, dit de
Silius : « il faisait des vers avec plus d'application que de
génie. ».
Le poëme de Silius Italicus a pour titre Punica, et il
se compose de dix-sept livres. Le poëte s'est arrêté
quand la matière lui a manqué : c'est elle qui le menait et
non lui qui la traitait à sa guise. Le sujet est le récit en
vers de la seconde guerre punique,
qui commence,
comme on sait, à la prise de Sagonte par Annibal, et
finit à la bataille de Zama. On ne comprend pas pourquoi
le poëte n'a pas raconté la troisième guerre punique
: cela lui aurait permis d'aller jusqu'à vingt-quatre
livres, comme Homère, et la prise de Carthage avait
de quoi tenter un peintre de génie. Mais bornons-nous
à examiner non ce qu'il aurait pu faire, mais ce qu'il
a fait. A quel genre rattacher ce poëme ? Les érudits ont été
fort embarrassés. Est-ce une épopée ? On pourrait le croire, car le merveilleux y tient une certaine place. Est-ce
une composition historique versifiée ? Cette opinion
est assez vraisemblable, car les événements, les personnages,
la description des lieux, tout est réel. On considère
même Silius Italicus comme une autorité, et son témoignage
sert à contrôler ou à compléter celui des historiens.
Il faut bien le reconnaître, les Puniques n'appartiennent à aucun genre connu jusqu'alors excepté pourtant au
genre ennuyeux. On a allégué, pour défendre Silius Italicus,
l'exemple de Naevius, et d'Ennius, qui célébrèrent
en vers ces mêmes guerres puniques; mais il nous est
impossible de juger la composition de leur oeuvre, qui a
péri presque en entier, et il est hors de doute que le merveilleux n'y tenait pas la place qu'il occupe dans Silius. Rien de plus étrange que ce récit historique, exact,
scrupuleux, minutieux même, brusquement interrompu
par l'intervention bizarre d'une divinité. Nous suivons
sur la carte cette admirable campagne d'Annibal, parti
d'Afrique, débarqué en Espagne, traversant le midi de
la Gaule, franchissant les Alpes, battant l'une après
l'autre quatre armées romaines, puis forcé de s'arracher
à cette Italie devenue sa proie pour courir à la défense
de Carthage, vaincu enfin dans un dernier combat, et
fuyant pour aller dans le reste du monde susciter des
ennemis à Rome. Grande et noble histoire, dramatique
surtout, si cette figure imposante d'Annibal domine tous
les événements, s'il nous apparaît tirant de son propre
génie toutes ses ressources, créant une armée, une discipline,
une tactique, accomplissant enfin ce serment
prononcé sur les autels dès l'âge de neut ans d'être jusqu'à sa mort l'implacable ennemi de Rome. Placez
derrière un tel homme des Dieux qui le poussent, le retiennent,
lui donnent la victoire, la lui enlèvent, et Annibal
disparaît pour ne laisser au premier plan que des
machines poétiques usées que le bon sens repousse, qui
glacent l'imagination. Là, est l'incurable faiblesse de
l'oeuvre. Le fabuleux et le réel ne s'y fondent point
loin delà, ils se gênent et s'excluent. Le merveilleux de
l'Énéide nous semble parfois quelque peu factice; ici
c'est bien autre chose! Qu'on en juge par quelques-unes
des inventions de Silius en ce genre, je dis inventions;
le vrai mot serait imitations, car Silius n'inventait rien.
C'est Junon, l'éternelle ennemie des Troyens, et par
conséquent de Rome, qui suscite Annibal ; Vénus, de son
côté, supplie Jupiter de défendre les descendants d'Énée.
Le dieu y consent et il prédit les destinées glorieuses de
l'empire romain qui aura le bonheur d'être gouverné un
jour par Domitien. Cette prédiction semble insuffisante
au poëte, et il introduit Protée, qui la reprend et la développe
tout au long, en pillant sans pudeur le sixième
livre de l'Énéïde et le quatrième des Géorgiques. Ce
sujet exerçant un charme particulier sur l'imagination du
poëte, il met en scène la Sybille de Cumes, qui refait
d'après Virgile la peinture des enfers. Voilà quelques-uns
des lambeaux de pourpre que Silius coud à ses narrations
historiques, quand il lui prend fantaisie de donner plus
d'éclat à son oeuvre. L'Énéide tout entière se retrouve
là en lambeaux informes. La soeur de Didon, Anna, s'y
rencontre avec le prétendant malheureux larbas. Des
jeux funèbres sont célébrés sur le modèle du cinquième
livre de l'Énéide. Le malheureux Annibal est condamné
par le poëte à poursuivre pendant la bataille de Zama un fauxScipion, ou plutôt un fantôme fait à l'image du Romain par Junon. C'est un songe qui l'empêche d'aller
assiéger Rome après la bataille de Cannes. Silius a même
osé voler à Virgile la plus forte conception épique de
l'Énéide. Énée s'obstine à défendre Troie déjà envahie
par les Grecs; tout à coup Vénus lui apparaît, et, lui arrachant
le bandeau qui couvre sa faible vue de mortel, lui
montre les divinités ennemies de Troie qui accomplissent l'oeuvre de vengeance et de destruction. Junon dessille
aussi les yeux d'Annibal et lui découvre sur chaque
colline de Rome les dieux prêts à la défendre. On pourrait
multiplier ces rapprochements, mais à quoi bon?
Silius pille de préférence à tout autre son cher Virgile
ce qui ne l'empêche pas d'emprunter à Homère l'idée
d'un festin, où un aède, Teuthras, charme les oreilles
d'Annibal, en lui racontant les exploits des anciens
héros. Il va même jusqu'à prendre dans Prodicus ou dans
Xénophon la vieille allégorie d'Hercule placé entre le
vice et la vertu ; seulement son Hercule à lui s'appelle
Scipion. On pourrait être tenté de croire que là s'arrêtent
ses déprédations, il n'en est rien. Sa victime de prédilection,
c'est Tite-Live. On connait cette admirable partie
de l'oeuvre de l'éloquent historien, le début solennel qui
l'annonce, l'ampleur et la majesté du récit si habilement
coupé par ces portraits, véritables chefs-d'oeuvre, ces discours
qui sont le vivant commentaire des faits, et ces
épisodes dramatiques qui donnent à la couleur générale je
ne sais quoi de plus éclatant. Vous retrouverez tout cela
dans Silius Italicus ; il suit pas à pas l'historien en Afrique
d'abord, puis en Espagne, en Gaule, en Italie, il se conforme
à l'ordre suivi par son modèle, choisit pour les
raconter les mêmes épisodes. De hardis commentateurs, frappés de cette servile déférence, ont recherché sous
les vers de Silius la prose de Tite-Live dans les épisodes
qui ne nous ont pas été conservés (première guerre punique,
Régulus), et ils ont cru en découvrir des fragments,
comme d'autres ont cru retrouver parfois dans Tite-Live
des tronçons des Grandes Annales. C'est qu'en effet
Silius ne se borne pas à emprunter à l'historien la matière
et la composition, il essaye de lui prendre son style!
chose incroyable, vraie cependant. Qu'on lise et que
l'on compare par exemple dans les deux auteurs l'épisode
célèbre de Pacuvius et Pérolla : on sera confondu de ce
procédé d'imitation qui consiste à enchaîner dans les
entraves du rhytme la libre et puissante prose de Tite-Live. Tels sont les procédés de Silius Italicus. Un de ses
éditeurs, Ruperti, après avoir longuement essayé de le
faire valoir, a très ingénieusement avoué que la lecture de
ce poëte pouvait être très utile aux jeunes gens : en quoi?
En leur montrant, au moyen des rapprochements sans
nombre qu'elle amène, que Silius n'avait pas d'invention,
qu'il empruntait tout à autrui, et que son style est
bien inférieur à celui de Virgile et de Tite-Live. C'est le
réduire à n'être qu'un repoussoir. Peut-être en effet
n'est-il pas autre chose.
Deux choses cependant plaident en faveur de Silius
Italicus : le choix d'un sujet national et la pureté de la
diction. S'il n'a pu concevoir le plan d'une épopée, en
disposer toutes les parties d'après une idée générale,
conserver la variété sans sacrifier l'unité, du moins il
n'est pas allé demander aux légendes fabuleuses de la
Grèce une matière usée. Enfin, lecteur et admirateur passionné
de Cicéron et de Virgile, il a puisé dans le commerce
de ces grands écrivains des qualités qui devenaient de plus en plus rares, le respect de la langue, la propriété des termes et une simplicité relative. Ce n'eût
pas été lui faire pleine justice que de garder le silence à ce sujet.
§ VII.
VALÉRIUS FLACCUS.
On ne sait trop quel personnage était C. Valérius Flaccus Balbus Setinus, auteur d'un poëme épique incomplet, intitulé Argonautica. Quelle était sa famille? où est-il né? Les érudits sont réduits sur tous ces points à des conjectures plus ou moins ingénieuses. On trouve dans Martial un certain nombre d'épigrammes fort élogieuses adressées à un Flaccus ; mais ce Flaccus était riche, il avait une belle maison de campagne à Baies, des objets d'art, de beaux esclaves; c'était un homme qu'il pouvait être utile de flatter, tandis que notre poëte semble n'avoir rien possédé de tout cela. Martial n'eût pas manqué de vanter l'excellence d'un poëte opulent, comme il
se fût certainement abstenu de louer un poëte pauvre.
Une ligne de Quintilien, voilà, à vrai dire, le seul témoignage
que l'antiquité nous ait laissé sur Valérius Flaccus :
« Nous venons de faire une grande perte dans la personne
de Valérius Flaccus. » On peut en conclure que le poëte
était fort jeune encore quand il mourut, et que sa perte
excita les regrets des connaisseurs. Quant aux critiques
du seizième siècle, ils lui ont été généralement très favorables,
sauf Scaliger qui, dans l'Hypercritique traite le
pauvre Valérius avec une extrême sévérité, le trouvant
surtout dur et sans grâce. Presque tous les autres érudits
le placent immédiatement après Virgile, et lui immolent parmi ses prédécesseurs et ses contemporains celui qu'ils
honorent d'une particulière aversion, surtout Lucain et
Stace.
L'expédition des Argonautes à la recherche de la Toison
d'or est un des sujets les plus chers aux poëtes de l'antiquité
grecque et latine, j'entends aux poëtes de seconde
main. Que d'épisodes brillants à raconter, quelle variété!
C'était l'Iliade et l'Odyssée réunies dans le même sujet :
des combats, des voyages, des légendes de toute nature,
des prodiges extraordinaires. D'abord le récit de la disparition
d'Hylas, qui était, aux temps de Juvénal, devenu un
intolérable lieu commun
puis le fameux combat du ceste dans le pays des Bébryces
; l'histoire des femmes de Lemnos, meurtrières de
leurs époux, et qui accueillent si bien les Argonautes ;
l'amour de Médée pour Jason, les charmes, les philtres,
les sortiléges de tous genres qui assurent au héros la victoire,
et enfin le retour en Grèce avec Médée. Ajoutez à
cela la description des lieux où abordent les navigateurs,
les légendes qui leur attribuent la fondation de plusieurs
colonies, et enfin le nombre considérable des héros qui
étaient montés sur le navire Argo, et qui devaient plus
tard s'illustrer par tant d'exploits. Peu de matière plus
riche que celle-là, mais en même temps je ne sais quoi
de vague ; un élément nouveau introduit dans la légende,
la magie ; ce personnage étrange de Médée, qui
importe en Grèce les charmes, les philtres, tout l'attirail
d'une science nouvelle : tout cela marquait d'une empreinte
relativement moderne l'histoire de l'expédition.
L'Illiade n'en fait aucune mention : c'est plus tard que naît
cette légende imaginée évidemment pour expliquer sous la
forme anthropomorphique l'introduction en Grèce de certaines pratiques de la religion plus sombre de la Thrace.
Valérius Flaccus n'a point essayé de décomposer les
éléments de la légende ; il l'a reproduite fidèlement dans
toutes ses parties. Il avait sous les yeux un modèle grec,
qu'il a suivi le plus souvent avec la plus scrupuleuse
exactitude, Apollonius de Rhodes, poëte alexandrin,
auteur d'un poëme en quatre livres sur le même sujet.
Seulement il avait conçu son ouvrage sur de plus vastes
proportions, car il devait contenir au moins dix livres, si
ce n'est douze. Il s'arrête après le huitième. Quel est le
caractère de l'oeuvre? C'est une imitation originale.
Valérius appartient à cette classe d'écrivains consciencieux,
non sans talent, qui n'ont pas l'imagination créatrice,
n'inventent rien, mais, sur un sujet déjà traité,
trouvent de fort heureuses variations. Ce qui le distingue
profondément du modèle grec, c'est la gravité. Apollonius
en est complètement dépourvu : il est spirituel, ingénieux,
gracieux. Il se complaît dans les petits détails où
il excelle ; jamais une image forte, une conception élevée.
Cet amour si tragique de Médée pour Jason, amour né
dans le crime, qui vit par le crime et que dénouera un
dernier crime, le plus affreux de tous, le meurtre des
enfants par leur mère, ne lui inspire que des peintures
jolies, fades, analogues à ce que nous lisons dans Dorat
ou Bernis. Valérius Flaccus a senti le côté dramatique de
cette passion. Il a conservé les vieilles machines de Vénus
et Junon s'unissant pour troubler l'âme de Médée ; mais
la passion qui naît dans ce coeur indomptable, il en a du
premier coup senti et rendu le caractère. C' est « un
amour mêlé de haines », amour que le remords empoisonne dès sa
naissance, et qui ressemble à ces terribles maladies de l'âme qui enlèvent la liberté sans ôter la raison, qui
précipitent dans l'abîme, mais après en avoir fait mesurer
toute la profondeur. Là est l'originalité de Valerius Flaccus, et voilà ce qui justifie les regrets de Quintilien.
Il suit son modèle grec, mais où l'autre s'attarde à cueillir
des fleurs, il glisse ; où l'autre passe rapidement, il s'arrête
et donne aux personnages et aux faits un relief plus
énergique. Les commentateurs ont blâmé les vers qui
suivent, que pour moi je trouve d'une grande beauté, et
qui appartiennent en propre au poëte. Il s'agit de Médée,
qui ressent les premières atteintes de sa fatale passion.
« Elle se penche, elle regarde par la porte ouverte si son
père devenu plus doux ne rappelle point les Argonautes,
elle cherche encore le visage de l'étranger. Tantôt languissante,
désolée, elle s'enferme seule dans sa chambre,
ou bien se précipite dans le sein de sa soeur chérie,
comme dans un asile, essaye de parler et se tait. Souvent
elle s'attache plus caressante à ses parents, elle couvre
de baisers les mains de son père. Ainsi une chienne
qui vit dans la chambre, que l'on caresse à la table du
maître, dès qu'elle se sent atteinte d'un mal inconnu, de
la rage qui couve en elle, malade, se met à parcourir en
gémissant avant de prendre la fuite, toutes les parties de
la maison. »
Quintilien. — Pline l'Ancien. — Pline le Jeune.
§ I.
On ne sait rien de bien précis sur la vie de Quintilien.
Suivant l'opinion la plus généralement accréditée, Mareus
Fabius Quintilianus est d'origine espagnole; il est
né à Calagurris (Calahorra) vers l'an de Rome 796
(42 après J.-C.), et il mourut fort âgé sous le règne d'Hadrien.
Il fut amené à Rome par Galba, lorsque celui-ci
se décida enfin à accepter l'empire. A Rome, il occupa
une place brillante au barreau, ce que semble attester le
vers de Martial. « Gloria Romanae, Quintiliane, togae.»
Mais il se distingua surtout comme rhéteur, ce qu'indique
cet autre vers de Martial. «Quintiliane, vagae moderator
summe juventae. » Juvénal ne voit guère en lui autre
chose. Son enseignement eut le plus grand succès ; l'empereur
Domitien lui assigna sur le fisc un traitement de
cent mille sesterces, et de plus le choisit pour précepteur
des deux fils de sa nièce. Quelques écrivains prétendent
même qu'il fut élevé au consulat, mais le vers de Juvénal
sur lequel ils se fondent peut signifier simplement qu'on
lui accorda les ornements consulaires ; c'était une distinction
purement honorifique, de vanité pour ainsi dire,
comme savent en imaginer les princes qui veulent varier et économiser leurs faveurs. Si l'on s'en rapporte à ce passage de Juvénal, Quintilien était riche ; mais,
d'un autre côté, ce fut Pline qui dota sa fille. Peut-être
la mort de Domitien supprima-t-elle le traitement de
Quintilien; peut-être n'était-il riche que relativement
aux autres rhéteurs que Juvénal nous représente comme
mourant de faim. Quoi qu'il en soit,Quintilien, après avoir
enseigné l'éloquence pendant vingt années, prit sa retraite.
Il était à peine âgé de quarante-six ans. Il aurait
pu consacrer les loisirs de son âge mûr à composer un
ouvrage parfait de tout point; mais il nous apprend qu'il
ne donna que deux ans à son livre de l'Institution Oratoire, le seul de ses écrits qui nous soit parvenu. Sa
vie, comme on voit, nous apprend peu de chose sur
son caractère ; son livre est aussi fort sobre de renseignements.
Il perdit presque coup sur coup une femme et
deux enfants; mais il puisa des consolations dans le travail.
C'est lui qui nous l'apprend. Il nous apprend aussi
que Domitien avait toute son affection et toute son admiration.
Ce prince était aux yeux de Quintilien un grand
capitaine, un administrateur de génie et surtout un excellent
poëte. Seulement la direction des affaires du monde
lui laissa trop peu de loisir pour cultiver les Muses. Il est
utile de rappeler toujours ces basses adulations; elles sont
un signe du temps, et elles font connaître un homme.
Ajoutons encore que, dans sa préface, Quintilien traite
avec le plus grand mépris les philosophes, ces hommes
sombres et tristes, qui affectaient l'austérité sans doute
pour faire de l'opposition à César. Or César venait de les
bannir; rien donc de plus opportun et de plus courageux
que ces invectives du rhéteur salarié. Bien que Quintilien
eût été honoré des ornements consulaires, il ne fut pas un homme public ; il n'exerça aucune fonction, ne servit
point dans les armées; ce fut un rhéteur, rien qu'un
rhéteur. Son livre est le résumé complet de sa vie, de
ses idées; tout cela est absorbé dans l'étude de la rhétorique.
Ce point est important à signaler. Jusqu ici pas
de citoyen romain qui se soit enfermé dans un horizon
aussi borné. Voyons quel est le caractère de l'Institution
oratoire.
J'ai eu plus d'une fois l'occasion de montrer quelle
était l'importance, je dirai même la nécessité de l'éloquence
a Rome. Il était absolument impossible d'exercer
une influence quelconque sur la direction des affaires publiques,
si l'on ne possédait l'art de la parole. On ressemblait
à un homme sans armes jeté au milieu d'hommes
armés. Mais sous les empereurs il n'en fut plus ainsi.
Plus d'émeutes au forum, plus de grands procès, plus de
délibérations imposantes au sénat, plus d' élections libres.
Cependant l'éloquence demeura le premier des arts
pour les Romains, qui méprisaient à peu près tous les
autres comme puérils ou serviles. Quintilien est le maître
qui convient à ce temps misérable; son enseignement est
parfaitement proportionné aux besoins de ses contemporains.
Il enseigne un art qui meurt d'inanition pour ainsi
dire, et il partage toutes les illusions de ceux à qui il
l'enseigne. Vous chercheriez en vain dans Quintilien un
souvenir, un regret de la liberté perdue, de l'immense
carrière ouverte autrefois à l'éloquence ; de tout cela il
n'a aucun souci. Il est de son temps, un des heureux de
son temps, et c'est pour les hommes de son temps qu'il
écrit. Ce n'est donc pas un orateur qu'il veut former,
bien qu'il semble en avoir la prétention, c'est un avocat,
c'est un plaideur de causes (causidicus). Il a beau vouloir s'en défendre, il faut lui infliger son véritable caractère. Il est bon même d'ajouter que les seules causes possibles alors sont des procès civils, ce qui réduit encore l'importance de l'avocat ; car, sous la république, il y avait peu de causes civiles; toutes étaient plus ou moins des causes publiques. Il y eut cependant quelques procès dignes de ce nom sous les empereurs, ceux de Thraséas, d'Helvidius Priscus, d'Arulénus Rusticus, de Sénecion : ces grands citoyens furent déférés à César par des délateurs d'une éloquence incontestable; Tacite nous a conservé leurs noms. Quintilien put assister à la plupart de ces procès;il put constater lui-même l'abus déplorable que les accusateurs faisaient des plus beaux dons de la nature et de l'art. Mais il s'est tu sur les crimes de lèse-majesté, sur les victimes et sur les bourreaux. Tacite et Pline ont parlé. Il restait en eux une âme de citoyen, Quintilien est un rhéteur.
Il l'est avec passion. Il ne fit rien autre chose toute sa vie que parler et enseigner à parler. A-t-il eu une idée bien nette de l'éloquence et de sa dignité? On va en juger. Il examine ce que c'est que la rhétorique. Il voit en elle un art, le premier de tous, il y voit même une vertu. Il immole tous les autres arts à celui-là; et il va jusqu'à prétendre que l'orateur est orné de toutes les qualités du coeur et de l'esprit. En conséquence, il a le plus profond mépris pour la philosophie, et il reproche amèrement à Cicéron, son idole cependant, l'importance qu'il accorde à la philosophie dans la formation de l'orateur. Il ne veut pas admettre que ce soient des sages qui aient été les premiers législateurs des peuples. Selon lui ce sont des hommes habiles dans l'art de la parole ; comme s'il ne
fallait pas avoir des idées avant de les exprimer! Bref, à ses yeux la rhétorique se suffit à elle-même. Quand on
sait parler, on n'a pas besoin de penser; ou si l'on aime
mieux, par cela seul qu'on sait parler, on a tout le reste
par surcroît. Cicéron disait : « Si je suis orateur, je le dois moins aux officines des rhéteurs qu'aux enseignements des philosophes » Aristote appliquait à l'étude
de la rhétorique cette puissante raison qui, partant de
principes généraux, aboutit par une déduction invincible
aux applications pratiques : tout autre est le point de vue
auquel se place Quintilien. Tout ce qui est général lui
échappe; il ne sait ce que c'est qu'un principe; jamais il
ne remonte aux éléments des choses.
Quel est donc le véritable caractère de son ouvrage?
C'est un recueil de recettes propres à former un homme
qui saura bien parler, je ne dis pas bien penser : Quintilien laisse de côté ce détail.
Une rapide analyse de l'ouvrage fera mieux comprendre le but qu'il se propose et les moyens qu'il emploie.
Il veut former l'orateur complet, sinon parfait. Il le
prend au berceau, il lui donne une nourrice de moeurs
honnêtes, et surtout parlant purement ; il exige les mêmes
qualités du pédagogue qui succède à la nourrice, puis du
grammairien qui succède au pédagogue. La tâche du grammairien est plus étendue. Il enseignera l'orthographe,
les premiers éléments des sciences, y compris la philosophie
et l'astrologie (astronomie) à douze ans, puis il
exercera son élève à traiter de petits sujets, soit des fables
d'Ésope, soit ce qu'on appelle des chries. Enfin l'enfant
est confié au rhéteur. Celui-ci sera aussi de moeurs pures,
il se fera aimer, il imposera le respect. L'enseignement
sera d'abord comme divisé : il exercera les enfants sur
chacune des parties de l'oraison, narration, proposition, réfutation, etc., il les habituera à soutenir des thèses ; par
exemple, ils referont le plaidoyer de Cicéron en faveur de
la science militaire opposée à la science du jurisconsulte;
ils étudieront dans les orateurs et les historiens des modèles
qu'ils devront ensuite analyser et commenter. Puis on
leur donnera des matières de déclamations, en ayant soin
de les choisir vraisemblables, voisines de la réalité ; seulement
on leur permettra un certain luxe d'ornements.
Voilà l'enseignement préliminaire, pour ainsi dire. Le
rhéteur pénètre ensuite dans le détail de la rhétorique
proprement dite. Ici je ne le suivrai pas. Les livres qui
traitent du genre démonstratif, délibératif, judiciaire, de
l'invention, de la disposition, de l'élocution et même de
l'action, n'offrent rien d'original. Ces préceptes étaient
connus depuis longtemps, Quintilien ne fait pas difficulté
de l'avouer; mais ils n'avaient pas encore été exposés
avec des développements aussi complets. Le dixième et
le douzième livre sont plus originaux. Dans le premier,
Quintilien passe en revue la plupart des écrivains grecs et
latins dont il recommande la lecture à son orateur. Il juge
chacun d'eux brièvement, sèchement, sauf Sénèque, qu'il
a dans une aversion particulière. La plupart de ses jugements
sont d'un esprit médiocre et sans portée. C'est
toujours au point de vue de la rhétorique qu'il faut lire :
tous les grands génies d'autrefois semblent n'avoir existé
que pour grossir les provisions de l'avocat ; la forme seule
en eux attire l'attention de Quintilien.
Le douzième livre est relatif aux moeurs de l'orateur. Il
doit être, comme l'exigeait Caton, « un homme de bien qui
sait parler. » Est-ce à dire qu'un scélérat éloquent ne
mérite pas le nom d'orateur? Quintilien est de cet avis, et
il se trompe. La définition de Caton n'est pas une définition scientifique ; ce n'est pour ainsi dire qu'une opinion :
il lui semble que ce nom d'orateur est si beau, si glorieux, qu'on ne doit pas l'attribuer à des gens sans conscience,
fussent-ils doués de génie. Mais Quintilien va plus loin : il
nie qu'on puisse être orateur et malhonnête homme. Que
pensait-il donc d'Eschine, de Démade, d'Éprius Marcellus
et de Régulus ses contemporains? C'est toujours la même
faiblesse de conception, l'impossibilité de s'élever à une
idée générale. Ici, du moins, la restriction emporte avec
elle son excuse ; elle part d'un certain amour de la vertu.
Les chapitres qui traitent des causes qu'on doit accepter
ou refuser, sont aussi inspirés par de très honnêtes sentiments.
Le dernier est consacré à la retraite que doit
prendre l'orateur afin de ne pas se survivre à lui-même,
et des occupations de son loisir.
Tel est dans ses caractères généraux cet ouvrage qui
fut comme le testament de l'éloquence romaine. Il ravit
les contemporains, et fut salué avec enthousiasme par les
hommes de la Renaissance, lorsque le Pogge mit au jour
le manuscrit retrouvé au monastère de Saint-Gall. Il jouit
encore de nos jours d'une grande autorité : le dix-huitième
siècle, si irrévérencieux envers l'antiquité, a
traité Quintilien avec une indulgence et un respect peu
communs. Son livre en effet abonde en préceptes excellents
: l'auteur a du goût, de la mesure, et l'on sent qu'il
aime passionnément l'art qu'il enseigne. Il y a encore un
autre côté par où il se recommande à l'estime. Il fut le
ferme adversaire des vices à la mode, et il essaya de remonter
jusqu'aux anciens modèles de l'âge classique. De
là, sa passion pour Cicéron que l'on affectait de mépriser
sur la foi de Sénèque. En une foule de passages, il signale
avec vivacité les déplorables enseignements que reçoivent les jeunes gens des déclamateurs en renom ; il fait une
guerre opiniâtre à ces affectations de langage qui énervaient,
corrompaient le vieil idiome : il réclame en faveur
du naturel et de la simplicité, bien qu'il avoue que de son
temps Cicéron paraîtrait trop peu fleuri. Il conseille donc
aux jeunes gens de lire et d'étudier les anciens. « C'est à eux, dit-il, qu'il faut demander la pureté, l'élévation, et pour ainsi dire la virilité. » Aveu bien remarquable.
Comment n'a-t-il pas vu que ce qui faisait des hommes
autrefois, c'était la liberté? Il y avait un beau livre à
écrire sur ce sujet. Quintilien l'a peut-être écrit. Un de
ses ouvrages perdus avait pour titre : Des causes de la
corruption de l'éloquence. Mais si ce point de vue l'avait
frappé, l'Institution oratoire aurait un tout autre caractère.
Comment ne pas le regretter, quand on trouve
dans ce livre des pensées comme celle-ci? « Si les anciens nous ont surpassés, ce n'est pas tant par le génie que par le but. » Quintilien, comme Tacite et tant d'autres,
avait-il renoncé à ce but que se proposaient les anciens,
c'est-à-dire, la liberté, la vie publique, et pensait-il que
ses contemporains ne méritaient pas d'autre enseignement
que celui d'une rhétorique froide, vide, sans portée ? Protester
contre les raffinements du mauvais goût, de la déclamation,
rappeler l'antique tradition, les purs modèles
de langage sain et viril, c'est encore une belle tâche; mais
quelle oeuvre inutile, quand on ne peut combattre ni même
signaler les causes de cette incurable décadence?
§ II.
PLINE L'ANCIEN.
Pline l'Ancien (C. Plinius Secundus) est né à Novocomum ou à Vérone, car il appelle compatriote Catulle qui
est né dans cette dernière ville, la neuvième année du règne
de Tibère (année 776, 22 après Jésus-Christ), et
il est mort à cinquante-six ans (832, 79 après
Jésus-Christ). Il périt dans la fameuse éruption du Vésuve,
qui ensevelit les villes d'Herculanum, de Pompeï
et de Stabies. Il se dirigea vers le Vésuve pour explorer
de plus près le phénomène dont il était témoin, et sa
curiosité scientifique lui coûta la vie. C'était un honnête
homme que les règnes affreux de Claude et de Néron
remplirent d'une profonde tristesse. Elle ne le quitta
plus, même lorsque son ami Vespasien parvint à l'Empire,
et apporta quelque soulagement aux misères qui
avaient si longtemps pesé sur Rome. Il remplit exactement
tous ses devoirs de citoyen, fit d'abord la guerre en Germanie
où il fut préfet d'une aile; puis de retour à Rome,
il se livra à l'étude de la jurisprudence et plaida. Néron,
vers la fin de son règne, le nomma son procurateur en
Espagne, et Pline garda ces fonctions, dont on n'a pas
encore bien défini le caractère, jusqu'au règne de Vespasien.
Quelle position occupa-t-il sous ce prince,
dont il était l'ami, on ne sait. Il était, quand il mourut,
préfet de la flotte réunie au promontoire de Misène.
C'était un travailleur infatigable. Il faut lire dans les
lettres de Pline, son neveu (lib. III, 5), l'emploi qu'il faisait
de son temps. Le sommeil le surprenait sur ses livres :
à table, au bain, partout, il lisait, ou se taisait lire, et
toutes ses lectures, il les résumait dans des analyses
minutieuses. Ces extraits montaient vers le milieu de sa vie
à plus de cent soixante volumes, et il écrivait au verso de
ses pages, en caractères très fins. Un de ses amis, Licinius,
lui offrit jusqu'à quatre cent mille sesterces de cette bibliothèque. Si Pline avait eu de l'imagination, des idées
personnelles, s'il eut trouvé en son propre esprit des
ressources suffisantes, il n'eût point consumé sa vie dans
cet éternel travail de compilateur. Mais ce n'est qu'un
compilateur. Il aborda une foule de sujets, et ne semble
avoir eu de préférence pour aucun. Soldat en Germanie,
il compose un traite sur l'emploi du javelot dans la cavalerie
(de Jaculatione equestri). De retour à Rome, il perd
Pomponius Secundus, son chef, et il écrit aussitôt une
biographie de ce personnage. Dans les premières années
du règne de Néron, il consacre ses loisirs à rédiger trois
livres sur la profession d'avocat (studiosorum libri tres).
Puis, revenant aux souvenirs de sa vie militaire, il raconte
en vingt livres l'histoire des guerres de Germanie
(germaniea bella). Puis son activité se tourne d'un autre
côté, et il écrit huit livres sur des questions de grammaire
(dubii sermonis libri octoi). Enfin, après la mort de Néron,
il songea à donner une suite à l'histoire d'Aufidius
Bassus, et il raconta en trente et un livres les événements
qui s'étaient accomplis depuis le règne de Néron jusqu'à
celui de Vespasien.
Aucun de ces ouvrages ne vous est parvenu, et nous
ne pouvons juger Pline que d'après son grand travail qui
parut un an avant sa mort, et qui a pour titre Histoire
naturelle en trente sept livres. Dans le premier livre, qui est à la fois une
dédicace à Titus et une table des matières, il marque le
but qu'il s'est proposé : il veut présenter non un simple tableau
des connaissances humaines, mais une véritable
encyclopédie. Il y a peu de sciences en effet qui n'apportent
leur contingent à cette volumineuse compilation.
La physique, la botanique, la. zoologie, l'astronomie, la médecine, l'agriculture, la minéralogie y sont traitées
fort longuement. Il y est question aussi de la peinture et
de la statuaire. La philosophie n'y est point représentée.
On n'attend pas de moi que j'examine successivement
chacune des parties de ce vaste ouvrage. Tous les critiques
sont unanimes pour en reconnaître l'extrême importance.
Ce n'est pas en effet des théories personnelles que
Pline expose sur telle ou telle science : il nous fait connaître
tout ce qui avait été écrit avant lui sur chacune
d'elles,. Il remplace pour nous une quantité considérable
de documents perdus ; et, si défectueux sur bien des
points que soit son livre, il est resté et restera toujours
le point de départ de toute investigation sérieuse sur l'antiquité.
C'est à peu près tout ce qu'on peut dire à son
éloge. Les savants qui ont étudié Pline sont sortis de
cette étude avec peu de considération pour l'auteur.
Les hommes spéciaux ont trouvé en lui tant d'erreurs
et si peu de critique, des ignorances si étranges, et une
déférence si malheureuse pour des écrivains sans autorité,
qu'ils n'ont pas eu de peine à montrer la faiblesse de
cette érudition trop universelle pour ne pas être superficielle.
C'est à peu près l'opinion de Cuvier, qui s'exprime
ainsi : « Pline n'a point été un observateur tel qu'Aristote,
encore moins un homme de génie, capable, comme
ce grand philosophe, de saisir les lois et les rapports d'après
lesquels la nature a coordonné ses productions. Il
n'est en général qu'un compilateur, et même le plus souvent
un compilateur, qui n'ayant point par lui-même
d'idée des choses sur lesquelles il rassemble les témoignages
des autres, n'a pu apprécier la vérité de ces témoignages,
ni même toujours comprendre ce qu'ils avaient voulu
dire. C'est en un mot un auteur sans critique, qui, après avoir passsé beaucoup de temps à faire des extraits, les a
rangés sous certains chapitres, en y joignant des réflexions
qui ne se rapportent point à la science proprement
dite. »
Ce jugement nous dispense d'insister sur ce point ;
j'ajoute cependant que Pline souvent aime mieux se
tromper en suivant des autorités suspectes, que de décrire
tout simplement ce qu'il a vu de ses propres yeux.
Ainsi il donne de l'hippopotame la description la plus
fausse, puisqu'il va jusqu'à parler de la crinière de
l'animal, mais il l'emprunte à Hérodote et à Aristote.
Si, laissant de côté cette partie si importante de l'oeuvre
de Pline, on examine en lui non le savant, mais le
citoyen et l'homme, on est frappé de l'amertume dont
est empreint son ouvrage.
Le règne de Néron semble avoir produit sur cet honnête
homme une impression ineffaçable. C'est à partir
de ce moment qu'il s'est jeté dans ce travail absorbant
et misérable de la compilation, comme s'il voulait
s'abstraire du spectacle des choses humaines. Esprit faible
et sans portée philosophique, mais d'une rare énergie,
il a imputé aux dieux qui ne les empêchaient point les
horreurs dont il a été le témoin. « Quand Néron régnait,
dit-il, puisqu'il a plu aux dieux que Néron régnât. » « On
croit que les dieux s'occupent des choses humaines, dit-il
ailleurs, et qu'ils punissent les crimes ; cette croyance
peut être utile ». Mais elle lui semble
sans fondement sérieux. Car après tout la puissance des
dieux est bien bornée : ils ne peuvent ni rendre la vie,
ni assurer l'éternité d'un homme, ni faire que ce qui a
été n'ait pas été, ni empêcher que deux fois dix ne soient
vingt ; d'où il suit que ce que nous appelons dieu n'est pas autre chose que la nature (livre 11, ch. 5). Voilà une
véritable profession de foi d'athéisme. Demandons à Pline
ce qu'il pense de l'homme. Il a fait de ce roi de la création
une peinture d'une rare énergie et d'une amertume
poignante. Il le compare aux autres animaux envers qui
la nature a été si bonne mère, et il se plaît à énumérer
toutes les misères qui l'accablent depuis le jour où il a
été jeté nu sur la terre nue, inaugurant la vie par des larmes,
jusqu'à ce qu'il devienne la proie des passions et
des calamités dont il est lui-même l'auteur. Nul homme
n'est heureux ; celui-là seul a été traité par la fortune
en enfant gâté, dont on peut dire qu'il n'est point malheureux.
Il n'a à vrai dire ici-bas qu'un bien, un seul,
mais par là il est supérieur aux dieux, et ce bien c'est
la mort. Voilà le grand, l'inappréciable bienfait dont
l'homme est redevable à la nature. Il meurt, et il peut
mourir quand il veut. Quant à ce qu'on appelle une autre
vie, c'est une chimère ; l'âme n'est pas autre chose que
le souffle vital : après la mort le corps et l'âme n'ont pas
plus de sentiment qu'ils n'en avaient avant la naissance.
»
Telle est la philosophie de Pline, c'est celle du désespoir.
Ce regard désolé qu'il porte sur la destinée de
l'homme, ce dégoût profond de la vie, cette soif du
néant, voilà un singulier jour projeté sur ce temps misérable.
Nous retrouverons cette sombre philosophie du
découragement dans Tacite; elle est un des fruits naturels
du siècle. Il faut y joindre les vertueuses indignations
d'un honnête homme que les incroyables raffinements
du luxe et de la débauche révoltent, et qui en a
tracé des peintures d'une énergie remarquable. Chez lui,
l'expression est rarement mesurée, elle part comme un trait et dépasse le but; mais elle a un singulier relief.
La diction est heurtée, sans harmonie, tranchante ; une
foule d'ellipses l'embarrassent ; rarement elle se déroule
avec calme et régularité. On sent l'effort souvent pénible,
l'affectation, l'âpreté, défauts qui sont plus sensibles à
un époque où la langue assouplie était un instrument
facile à manier; mais il y a telles idées étranges, amères,
violentes, qui commandent pour ainsi dire un style
comme celui-là.
§ III.
PLINE LE JEUNE.
Pline (C. Plinius Cecilius Secundus) est une des
figures les plus intéressantes de cette période. Né sous
le règne de Néron (62 après J. C.), il mourut dans les
dernières années de celui de Trajan, vers l'an 112
après J. C. : il vit donc dans sa jeunesse le principat
de Domitien, et jouit du bonheur accordé à l'empire par
Nerva et Trajan. Contemporain de Tacite, il put dire
comme lui : « Si nos ancêtres connurent quelquefois
l'extrême liberté, nous avons, nous, connu l'extrême
servitude. » Il assista au retour de ce qu'il croyait être
la liberté; mais, comme il le dit lui-même, elle surprit
tout le monde à l'improviste, on n'y était pas préparé.
J'examinerai successivement en lui la vie privée, la vie
publique, la vie littéraire, et je le ferai à l'aide des deux
seuls ouvrages qu'il ait laissés, ses lettres qui se composent
de dix livres, et son Panégyrique de Trajan.
Sa vie privée est d'une remarquable pureté. Elevé par son oncle, Pline l'Ancien, qui l'adopta et lui donna
son nom, il consacra à l'étude, aux devoirs de la vie de
famille, à de nobles amitiés les belles qualités de l'esprit
et du coeur dont il était doué. C'est une âme douce sensible,
naturellement vertueuse. Marié fort jeune, il a
pour sa femme Calpurnia une tendresse délicate et profonde.
Il l'associe à tous ses travaux ; elle assiste à ses
plaidoieries, se réjouit de ses succès; Pline témoigne
à l'aïeul de Calpurnia les sentiments de la plus filiale
déférence. Il porte dans le commerce ordinaire de la vie
les mêmes besoins de bienveillance et de dévouement.
Il imagine les subterfuges les plus ingénieux pour obliger
ses amis, pour leur faire accepter un bienfait. Il
dote la fille de son maître Quintilien, et s'en excuse
avec une grâce charmante. Envers ses esclaves et ses
affranchis, c'est un maître bon et généreux : il met en
pratique le précepte de l'égalité, tant célébré par les
philosophes d'alors, mais qui semble être resté pour la
plupart purement théorique. Sa bonté n'a cependant rien
de banal ; il sait haïr et même poursuivre ouvertement
les scélérats, si puissants, si dangereux qu'ils soient. Ami
du jeune Helvidius, plein de vénération pour sa veuve
Fannia, digne descendante d'Arria, il demande en plein
sénat le châtiment de son accusateur Certus, qui venait
d'être nommé consul désigné. Il a retracé en termes
énergiques l'histoire de Régulus le délateur et le captateur
de testaments.
La vie politique de Pline est réglée sur le modèle des
hommes de l'ancienne république. Rien de plus curieux
et souvent de plus triste que les illusions rétrospectives de
cet honnête homme. Il veut à toute force s'imaginer qu'il
est le contemporain, parfois même l'émule de Cicéron. Il plaide sa première cause à dix-neuf ans ; puis va faire
r une campagne en Syrie, revient à Rome, où il débute
dans la vie publique par la charge de questeur, questeur
de l'empereur, il est vrai, mais il n'y en avait plus
d'autres. Puis il est élu tribun du peuple, et enfin à
l'âge de trente et un ans, il parvient à la préture. C'était
sous le règne de Domitien. Pline déjà célèbre, et par
conséquent suspect, ami d'Helvidius, d'Arulenus Rusticus,
de Sénecion, du philosophe Artémidore, tous
gens de bien qui furent les dernières victimes de Domitien,
ne peut dissimuler sa pitié pour ces nobles exilés,
son mépris pour les délateurs qui les ont livrés à César.
Heureusement Domitien est assassiné, et l'on trouve dans
ses cassettes une accusation contre Pline. Ici commence
l'épanouissement de cette aimable nature. Incapable de
passions violentes, Pline n'eût jamais dit comme son
ami Corellius: «Savez-vous pourquoi je me suis obstiné
à vivre si longtemps, malgré des maux insupportables? ^
C'est pour survivre au moins un jour à ce brigand ? » Il
n'aurait jamais écrit non plus l'admirable préface de la
vie d'Agricola, où se détend l'âme comprimée de Tacite;
mais il salua des jours meilleurs avec une joie réelle, et
se poussa au grand jour, puisque Nerva et Trajan faisaient
appel aux honnêtes gens. Il prit au sérieux ce retour prétendu
aux institutions de Rome républicaine : « Il est
vrai, dit-il, que tout l'empire se conduit à présent par la
volonté d'un seul homme, qui prend sur lui tous les
soins, tous les travaux dont il soulage les autres ; cependant
par une combinaison heureuse, de cette source
toute puissante il découle jusqu'à nous quelques ruisseaux,
où nous pouvons puiser nous-mêmes. » Orateur
en renom, honnête homme, il se plaît à jouer le rôle de Cicéron écrasant Verrès ; il fait condamner trois concussionnaires.
Il est vrai que c'est l'empereur qui rend la
sentence ou la mitigé; mais la justice a reçu une satisfaction
quelconque, et Pline a rempli un devoir, et il a
reçu de tous des compliments pour sa fermeté et son
éloquence. Il est ravi de joie quand un décret inaugure
le scrutin secret dans les élections; il va jusqu'à s'imaginer
que pour cela elles sont libres. Il a des indignations
rétrospectives qui font sourire. Il rend compte du fameux
décret du sénat qui glorifie la vertu, le talent, le dévouement,
le désintéressement de l'affranchi Pallas.
Rentré dans la carrière des honneurs, consul, puis propréteur
en Bithynie et dans le Pont, il s'acquitte de ses
fonctions avec une modération et une activité au-dessus
de tout éloge. Il est le bienfaiteur de ces riches contrées
qui avaient tant souffert sous les règnes précédents.
Pline consulte l'empereur sur les moindres affaires : la
Bithynie est devenue pour lui le centre du monde. Trajan
répond à toutes les questions délicates que lui pose
son propréteur ; rien de plus curieux que ce commerce
épistolaire de deux honnêtes gens qui veulent le bien, le
cherchent et le font ensemble. C'est en Bithynie que
Pline fut chargé de faire une enquête sur les chrétiens,
qu'une persécution menaçait. Son rapport à ce sujet est
le premier monument historique que nous possédions (1),
(1) On en conteste aujourd'hui l'authenticité.
c'est de plus l'acte d'un honnête homme, d'un homme
éclairé, équitable, modéré. C'est sur ce fondement que
les fabricants de légendes édifiantes ont fait de lui un
chrétien, qui sous le nom de Secundus aurait peu de
temps après subi le martyre. On peut considérer le Panégyrique de Trajan comme
une sorte de testament politique de Pline. Je vais donc
indiquer le caractère de ce singulier ouvrage, qui
devint bientôt le modèle de toutes ces compositions
inspirées par l'adulation et la platitude d'âme et de style.
Pline ayant été nommé consul, adressa à l'empereur
un remercîment qui fut trouvé fort éloquent et fort ingénieux.
Encouragé par le succès, il revit son travail, le
développa, en fit un ouvrage considérable, si l'on songe
au sujet. Il le lut pendant trois années de suite en public
et aussi dans de petites réunions où l'on se disputait
l'honneur d'être admis.Lisez le procès-verbal d'une de ces
séances : « Désirant lire cet ouvrage à mes amis, je ne les invitai point par les billets d'usage, je leur fis seulement dire de venir si cela ne les gênait en rien, s'ils avaient quelque loisir, et vous savez qu'à Rome on n'a jamais ou presque jamais le loisir ou la fantaisie d'assister à une lecture. Cependant ils sont venus deux jours de suite et par le temps le plus affreux, et quand par discrétion je voulus borner là ma lecture, ils exigèrent de moi que je donnasse une troisième séance. Est-ce à moi, est-ce aux lettres qu'ils ont rendu ces honneurs? J'aime mieux croire que c'est aux lettres, dont l'amour presque éteint se rallume aujourd'hui. »
Plus loin, cherchant d'autres causes à cet empressement,
il dit : « Ce n'est point que l'orateur soit plus éloquent,
mais son discours a été écrit avec plus de liberté
et par conséquent avec plus de plaisir. » Il faut lire toute
cette lettre pour avoir une idée des illusions où se complaisait
la naïveté de cet orateur officiel si vertueux et si
vain. Quant au Panégyrique en lui-même, c'est une oeuvre de
bonne foi. Pline parle en homme convaincu : il admire,
il aime Trajan, il est heureux d'être l'interprète de la
reconnaissance publique. Son coeur s'épanche en remerciments
sincères. Il est dans l'enivrement d'un homme
qui, après avoir échappé à une horrible tempête, toucherait
enfin le rivage de la patrie. Les misères passées, il
les rappelle pour jouir pleinement de la félicité qui a suivi.
Une âme plus sérieuse ne se fût pas laissé ainsi ravir à une
satisfaction sans mélange : elle eût compris que le règne
d'un Trajan n'était qu'un accident, que, lui mort, un
Domitien pouvait ramener les temps affreux qui finissaient
à peine. Tacitel'aeue cette sombre perspective de l'avenir.
Lui aussi a rendu grâces à Nerva et à Trajan, mais quelle
tristesse dans sa joie! « Les remèdes,dit-il, agissent plus
lentement que les maux; il est plus facile d'écraser les
caractères que de les relever. » Et de plus combien
sont morts, que la cruauté du tyran a fait périr ! Et parmi
ceux qui survivent, que de vieillards usés par une longue
attente, et ce silence forcé qui semblait être le sommeil de
la conscience humaine ! Pline n'a pas de ces regards mélancoliques
jetés sur l'avenir. Son Panégyrique n'est guère
qu'une longue antithèse : il rappelle les malheurs et les
crimes du passé, pour les opposer aux vertus et aux félicités
de l'état présent; de l'avenir, rien. Esprit léger et
sans portée, qui s'absorbe dans une félicité sans fondement,
et ne se dit même pas que ce qui a été peut être
encore !
L'énumération des bienfaits de Trajan envers le monde
tient la plus grande place dans le Panégyrique. Que n'a-t-il pas fait? Il a bien voulu se laisser adopter par Nerva,
qui probablement était déjà dieu, quand il exécuta ce beau dessein, décerna
l'apothéose à son père, non à la façon des Tibère, des Vespasien,
mais appuyé sur le suffrage unanime de l'empire.
Empereur, il relève la discipline militaire et se couvre
de gloire dans une foule d'expéditions. Son administration
intérieure n'est pas moins remarquable. Il rétablit l'ordre
dans les finances et rend compte de ses dépenses personnelles.
Il comble le peuple de ses libéralités, non à la
façon d'un Néron et d'un Domitien, pour détourner l'attention
publique des désordres de sa vie, mais par amour de
ses sujets. Il donne aux Romains des jeux splendides, non
de viles représentations de pantomimes, mais des combats
de gladiateurs, des combats de bêtes, c'est-à-dire ce qu'il
y a de plus propre à exciter le courage guerrier. Mais quel
plus beau spectacle que celui de l'exil des délateurs ?
Ces misérables sont entassés sur des vaisseaux et livrés
aux hasards de la mer furieuse. Les gens de bien se réjouissent
de leur supplice et remercient l'empereur. Lui, de
son côté, se dépouille volontairement de l'infâme secours
que la loi de lèse-majesté fournissait aux tyrans, loi monstrueuse
« qui créait des crimes à ceux qui n'en avaient
pas. » Il renonce aussi à ces successions que les condamnés
léguaient à leurs bourreaux pour les attendrir
en faveur de leurs enfants. Aussi, grâce à lui, la vertu, la
sécurité renaissent. Les gens de bien osent se montrer au
grand jour; la probité n'est plus un crime, l'indépendance
est honorée par César. Autrefois, au contraire, les
princes aimaient mieux les vices que les vertus des citoyens. Aussi
cherchait-on pour leur plaire la réputation d'homme
sans foi, sans honneur, sans scrupule. C'est qu'en effet (aveu bien remarquable) l'habitude d'une longue
soumission nous a amenés à nous conformer tous aux
moeurs d'un seul. Sous un
prince comme Trajan, la vertu est pour ainsi dire à l'ordre
du jour ; c'est le meilleur moyen de faire sa cour à César.
Aussi tout refleurit : la famille se reconstitue ; on ne craint
plus d'avoir des enfants : ils grandiront sous la direction
de maîtres éprouvés. Trajan n'a-t-il pas rappelé de
l'exil les philosophes et les rhéteurs que Domitien avait
bannis?
Mais il n'est pas utile de pousser plus loin cette
analyse : l'esprit de l'oeuvre est suffisamment indiqué. A
quoi bon rappeler les incroyables illusions de Pline qui
félicite l'empereur d'avoir refusé le consulat et le supplie
de vouloir bien l'accepter? Il ne peut contenir son admiration
quand il voit l'empereur se rendre aux comices,
comme un candidat ordinaire, prêter serment, et attendre
le dépouillement du scrutin. Ces innocentes comédies
du maître qui veut paraître l'égal des autres citoyens, il les
célèbre avec ravissement, et les prend au sérieux. Les
mots de liberté, d'égalité reviennent sans cesse sous sa
plume. De son héros il admire tout, sa justice, sa douceur,
son affabilité, son goût pour la chasse. Il n'oublie
pas non plus l'impératrice, digne compagne de ce grand
homme, ni la soeur de César, ni les amis de César. Mais
il le félicite surtout de n'abandonner point à des affranchis
la direction des affaires : « Car tu sais bien, dit-il, que rien ne montre mieux la petitesse du prince que la grandeur des affranchis. »
Aussi César faisant tout par lui-même crée des loisirs à Dieu qui n'a plus à s'occuper que du ciel !
Tel est le citoyen. Voyons le littérateur.
Son activité intellectuelle se porta de tous les côtés à
la fois. Comme Cicéron qui fut son modèle, il fit des vers,
écrivit des plaidoyers, songea à composer une histoire.
A quatorze ans il écrivit une tragédie grecque. Mais il ne
semble pas avoir eu un goût bien prononcé pour la philosophie.
Son esprit essentiellement littéraire et oratoire
ne le portait point aux spéculations élevées et profondes.
De tous ses maîtres celui qu'il eut en plus grande estime,
c'est Quintilien, un rhéteur. D'une bienveillance un peu
large, il accorde des éloges à tous ceux qui s'exercent
dans un genre quelconque. Il aime les lettres avec passion
et tous ceux qui s'y adonnent sont bien vus de lui.
On pourrait avec sa correspondance tracer un tableau
complet de ces fameuses lectures publiques si fort à la
mode alors. Pline est le plus fidèle et le plus attentif des
auditeurs ; il n'a jamais manqué une séance littéraire. Il
a des indignations dont il rit presque lui-même contre
ces négligents ou ces superbes qui craignent d'assister à
une lecture trop longue, qui se font renseigner sur ce
qu'il reste de pages à lire à l'orateur, et ne se décident à
paraître que vers la péroraison. Il aime passionnément la
gloire et voudrait que son nom ne pérît pas. Encore un
trait qui lui est commun avec Cicéron. Il voit bien que
la décadence est venue, il en comprend même les causes:
« Les anciens, dit-il, ne passaient point leur temps à
cueillir des fleurettes ; le tissu de leur style est viril. » Et
ailleurs: «Les misères qui ont pesé sur nous ont amoindri
et comme écrasé pour l'avenir notre génie. » Mais qu'importe? il veut vivre dans la mémoire des hommes. Il est
à l'affût de tout ce qui se publie ou se prépare ; un compliment
de Martial le ravit. Si les vers de Martial échappent
à l'oubli, le nom de Pline ne mourra pas. Il compte
beaucoup sur Tacite qui compose ses Annales et ses Histoires.
Bref, il a toutes les inquiétudes d'une petite vanité
naïve qui fait sourire sans offusquer. Son style a
une grâce réelle, du moins dans ses Lettres. Il n'y faut
chercher ni l'abandon de Cicéron, ni le nerf de l'expression
fraîche et forte. Écrites et limées ea vue de la publication,
elles sont un exercice purement littéraire. L'esprit
n'y manque pas, ni les détails piquants, ni les expressions
heureuses; le naturel en est trop souvent absent.
Elles donnent du personnage une bonne idée; on y sent
l'âme d'un honnête homme à qui il n'a manqué que d'avoir
un horizon plus vaste, un esprit moins préoccupé
de ses petits intérêts de vanité.
L'histoire sous les empereurs. Velléius Paterculus, Valère Maxime. Quinte-Curce, Florus.
§1.
L'HISTOIRE SOUS LES EMPEREURS.
Auguste comprenait que la littérature est une force,
qu'elle pouvait le servir ou lui nuire : il en fit l'auxiliaire
de son oeuvre. Par l'estime qu'il témoigna aux écrivains,
par les bienfaits qu'il leur prodigua, par cette noble familiarité
qu'il sut employer envers eux, par cet art qu'il
eut de paraître leur courtisan, et de les associer intimement
au nouvel état de choses, il les conquit sans leur
faire jamais sentir leur dépendance. Ses successeurs
n'eurent ni cette intelligence ni ce respect de la dignité
humaine. Ce ne furent ni le génie ni l'originalité qui
manquèrent à des écrivains comme Lucain et Sénèque :
ce fut un temps meilleur. Posséderions-nous Tacite, si
Nerva et Trajan étaient venus cinquante ans plus tard?
Un des caractères les plus hideux du despotisme, c'est
la haine et la peur de tout ce qui est noble et grand,
non-seulement dans le présent, mais même dans le passé.
C'est bien de lui qu'on peut dire avec Tacite «omne
decus alienum in diminutionem sui accipiens». Dans de
telles conditions l'histoire est impossible : elle sera puérile ou servile. Nous apprenons de Tacite que, sous Tibère,
on ne pouvait parler de Brutus et de Cassius, sans accoler
à leurs noms les épithètes de brigands et de parricides.
Sur l'ordre du prince, le sénat décrète que les
Annales de Cremutius Cordus, qui avait osé appeler
Cassius le dernier des Romains, seraient brûlées par les
édiles. L'historien fut forcé de se donner la mort.
Ainsi avait déjà été traité Labiénus. Domitien devait
aller plus loin encore. Il fit périr Hermogène de Tarse
pour quelques allusions répandues dans ses histoires, et
les libraires furent mis en croix.
C'est sous Tibère que vécut et écrivit Caius, ou Marcus
Velleius Paterculus. Il était d'une famille campanienne.
Il fut successivement tribun mililaire en Thrace
et en Macédoine, préfet de la cavalerie, questeur sous
Tibère et enfin préteur. Juste Lipse suppose qu'il a été
consul. L'an 783, la 17° année du règne de Tibère, il
publia son abrégé d'histoire en deux livres, dédié au
consul Vinicius. Comme il semble avoir été très attaché
à Séjan, et que, suivant Tacite et Dion Cassius, tous les
amis de celui-ci furent enveloppés dans sa disgrâce, il
est probable que Velléius fut tué dans ce massacre.
Du reste aucun auteur ancien ne fait mention de cet
historien. Priscien est le premier qui cite son nom ; il
l'appelle Marcus.
L'ouvrage de Velléius a pour titre : Historiae Romanae
libri duo ad M. Vinicium consulem. Le premier livre qui
nous est parvenu, fort incomplet, est consacré à une
révision rapide des peuples antérieurs aux Romains; le second va de la fondation de Rome à la mort de Livie,
mère de Tibère. On a aussi attribué à Velléius un
livre intitulé de Bello in Suevos, mais sans fondement.
Velléius nous apprend qu'il se proposait d'écrire une
histoire de Rome développée ; son ouvrage n'était donc à
ses yeux qu'une sorte d'essai. Tel qu'il est, il ne manque
pas d'intérêt. On y trouve des détails précieux sur les
personnages considérables du temps. L'auteur, qui avait
fait les guerres de Germanie, a connu Maroboduus et
Arminius dont il a tracé d'assez nobles images. Si l'on
en juge d'après les proportions et la composition de cette
histoire, Velléius Paterculus avait fait du règne de Tibère
le centre où tout devait aboutir. Il glisse fort rapidement
sur tout ce qui précède l'établissement du principat, s'arrête
avec complaisance sur certaines particularités plus
curieuses qu'utiles du règne d'Auguste, et réserve une
place considérable aux seize années du règne de son successeur.
Il qualifie lui-même son livre de artatum opus,
n'a aucun souci de la chronologie, et ne montre qu'une
portée d'esprit médiocre. Il ne voit pas le lien de dépendance
qui unit le présent au passé. Ce qui le frappe, c'est
ce qu'il a sous les yeux, l'Empereur, Séjan, les grands
personnages. Le prince est centre de tout, et la mesure
unique de la morale et de la politique. Ce n'est plus un
homme d'État, ni un érudit, ni un Romain enthousiaste
qui écrit l'histoire de sa patrie, c'est un courtisan, un
homme du monde, qui recueille les personnalités intéressantes
et les petits détails. De composition, il n'y
en a aucune : il suit librement l'ordre des temps, plus
préoccupé des personnes que des faits et de leur signification.
Il ne tarit pas d'éloges pour Séjan, cet homme laboris et fidei capacissimus, ce collaborateur indispensable aux grandes choses que faisait Tibère, « magna
negotia magnis adjutoribus egent » (1).
(1) Il ose comparer son élévation à celle des hommes nouveaux de la république, Coruncanius, Caton, Marius, Cicéron.
Politique , science du gouvernement, des institutions, esprit philosophique, impartialité, il n'a aucune des qualités fondamentales de l'historien. On l'a accusé de basse adulation, et il n'en est pas exempt. Mais c'est le courtisan qui a fait le flatteur. En dehors du prince et de ses créatures, rien ne lui semblait grand ou digne d'attention. La diction de Velléius est pure et correcte; son style, qui cherche à se modeler sur Salluste (2), manque de naturel.
(2) Il emprunte aussi à Salluste son demi-fatalisme historique.
Il est souvent guindé et obscur. Un certain piquant
dans le tour, de l'imprévu dans l'expression, des
sentences rapides, des exclamations emphatiques, des
contrastes heurtés, des antithèses forcées, tout ce qui
peut étonner, arrêter le lecteur, et lui donner une haute
idée des mérites de l'écrivain : nous retrouvons en Velléius
les défauts de l'éducation des rhéteurs, que l'âge suivant
accusera davantage encore.
Valère Maxime ( Valerius Maximus) est aussi un contemporain
et un adulateur de Tibère. De sa vie on ne
sait presque rien, si ce n'est qu'il servait en Asie sous
Sextus Pompée, qui fut consul l'année même où mourut
Auguste, qu'il a loué Tibère et insulté Séjan abattu.
Son ouvrage a pour titre : Factorum dictorumque
memorabilium libri novem ad Tiberium Caesarem Augustum.
C'est un recueil d'anecdotes composé sans jugement
et sans goût. Piété, courage, constance, amitié, pudeur, désintéressement, et leurs contraires, sous ces
titres généraux, Valère Maxime range de petites histoires
divisées en deux classes; les Romains, les étrangers.
Les curiosités de l'érudition lui fournissent aussi un
certain nombre de chapitres composés de la même manière.
Il a lu les historiens grecs et latins, et il en a extrait
les particularités les plus frappantes. Un tel recueil
ne manque pas d'intérêt et d'utilité pour nous, mais il
marque une étrange stérilité chez l'auteur. Érasme a
dit de lui « qu'il ressemblait à Cicéron comme un mulet ressemble à un homme » . « On ne croirait jamais, ajoute-t-il,
qu'il soit italien, ou qu'il ait vécu dans ce temps. »
Aussi plusieurs critiques ont-ils pensé que cet ouvrage
n'était qu'un abrégé de celui de Valère Maxime, rédigé vers
lafin du troisième siècle par un certain Julius Paris. C'est
l'opinion de Vossius. Mais on a découvert depuis le manuscrit
de l'abrégé de Julius Paris :il faut donc laisser à
Valère Maxime la propriété de son oeuvre. Julius Paris
est cependant considéré comme l'auteur du traité de
Nominibus, qui forme ordinairement l'appendice et
comme le 1O° livre de Valère Maxime. Le moyen âge
goûtait fort le recueil des Dits et faits mémorables : il
s'en fit de bonne heure des abrégés et des florilèges.
Les titres donnés aux chapitres, sinon aux livres, sont
l'oeuvre de grammairiens postérieurs. Aulu-gelle cite Valère
Maxime par livres et non par titres.
C'est un écrivain qu'il est difficile de louer. Son style
est emphatique, sa brièveté hachée et obscure; affecté
guindé, plein d'exclamations tragiques, il a le premier introduit dans l'histoire les invocations des poëtes aux
empereurs. Il ose dire à Tibère : mea parvitas en justius
ad favorem tuum decurrerit quo cætera divinitas opinione
colligitur, tua praesenti fide paterno avitoque sidere
par videtur. Deos enim reliquos accepimus, Caesares
dedimus.Cela suffit pour juger le personnage et le style.
Quinte-Curce (Quinius Curtius Rufus) est un problème.
Quel est l'auteur de l'ouvrage intitulé : De rebus
gestis Alexandri Magni libri X? Aucun écrivain de l'antiquité
ne fait mention de ce Curtius Ru fus ni de son livre.
C'est à la fin du douzième siècle qu'il est nommé pour la
première fois. Lui-même, dans un passage qui a fort exercé
la sagacité des commentateurs, parle du prince qui a fait
rentrer les glaives dans le fourreau, qui est apparu
comme un nouvel astre, dont la postérité doit assurer le
bonheur du monde. C'est le langage ordinaire des écrivains
courtisans. Ces traits peuvent s'appliquer à la plupart
des empereurs. Aussi a-t-on voulu voir dans Quinte-Curce un contemporain d'Auguste, de Vespasien, de
Trajan, d'Alexandre Sévère, de Constantin, de Théodose :
d'autres sont allés plus loin encore et ont supposé qu'un
habile latiniste de la renaissance avait placé, sous ce nom
de Curtius Rufus, un produit de sa plume : c'était l'opinion
du maître de Gui Patin. Mais que faire du témoignage
de Jean de Salisbury qui, quatre cents ans auparavant,
citait cet ouvrage ? Et d'ailleurs le style de l'auteur
porte l'empreinte d'une bonne époque. Funck incline
à croire que Quinte-Curee n'est autre que ce Curtius
Rufus dont parle Tacite, qui, fils d'un gladiateur, et
rhéteur distingué, s'était élevé par son mérite aux premières
charges de l'État sous Tibère et sous Claude.
Cette hypothèse n'est pas plus invraisemblable que les autres. Resterait à expliquer le silence des auteurs
anciens sur un personnage si considérable. La nullité
presque absolue de l'ouvrage au point de vue historique
en est peut-être la véritable cause. On possédait alors tous
les historiens grecs d'Alexandre : qu'était-ce auprès de ces
documents si nombreux que le roman de Quinte-Curce ?
Il revient à la lumière vers le douzième siècle, et peutêtre
plus tôt. Rien de plus naturel : c'est le moment où la légende
d'Alexandre va devenir la matière d'une foule d'épopées.
L'histoire de Quinte-Curce semblait plus propre
que toute autre à servir de point de départ aux clercs
qui singeaient les trouvères épiques.
Cette histoire est en effet un véritable roman. Quinte-Curce a choisi dans les auteurs grecs les fables et les puérilités
dont ils se sont plu à environner ce grand nom
d'Alexandre. Il est d'une ignorance profonde en géographie,
jusqu'à confondre le Taurus et le Caucase. Ses
récits de batailles et d'opérations militaires sont impossibles.
Mais, en revanche, il revêt des plus éclatantes couleurs
tout le côté légendaire de cette noble histoire.
Quinte-Curce est certainement un rhéteur. La gloire
du conquérant, ses victoires, ses éclatantes qualités,
sa mort prématurée, ont frappé son imagination.
Il a voulu reproduire, non la vérité, ce qui eût
demandé de longues recherches et beaucoup de savoir,
mais les grands côtés de cette vie merveilleuse. Il dit
lui-même : Equidem plura transcribo quam credo : nam
nec affirmare sustineo de quibus dubito, nec subducere,
quae accepi, ce qui est l'abdication de toute critique.
Le rhéteur se reconnaît encore plus sûrement dans les discours invraisemblables, mais composés et écrits avec
amour. C'est la partie la plus remarquable de l'oeuvre.
Quinte-Curce est un exemple assez rare de ce que peut la
perfection des procédés littéraires, unie à une intelligence
médiocre. Ce divorce entre le fond et la forme est
une des marques les plus certaines de la décadence.
L'esprit vide d'idées se passionne pour des chimères ou
de petits artifices. La réalité échappe ; l'imagination grossit
les objets; le style suit; l'histoire devient alors une
déclamation ou un roman : celle de Quinte-Curce est l'une
et l'autre.
Florus ne nous est guère mieux connu que Quinte-Curce. On l'appelle tantôt Julius, tantôt Lucius Annaeus.
Les uns croient reconnaître en lui le J. Florus Secundus,
dont parlent Quintilien et Sénèque le rhéteur : un autre
(Titze) le déclare contemporain de Tite-Live, et voit
en lui ce Julius Florus à qui Horace a adressé deux
Épîtres (I, 3; 11, 2). Mais pour appuyer sa conjecture,
Titze a dû rejeter comme interpolée la fin de la préface
de l'auteur où il parle de Trajan. Enfin, c'est à Sénèque
lui-même qu'on a attribué l'abrégé de Florus. La fameuse
division de l'histoire du peuple romain en quatre âges
appartenait, suivant Lactance, au philosophe. Mais il ne
mérite pas qu'on lui impute un tel ouvrage. Que Florus,
soit un membre de la famille Annaeus; qu'il soit comme
celle-ci originaire d'Espagne, c'est ce qui semble de beaucoup
le plus vraisemblable. Florus a en effet une certaine
affinité littéraire avec Sénèque et Lucain ; de plus il manifeste
une véritable tendresse pour son pays natal.
Sous le titre de Epitome de gestis Romanorum (ou Rerum Romanarum libri IV), il a composé une série de
petits chapitres où il est question des hauts fails du peuple romain.
Il a voulu, dit-il lui-même, embrasser dans un
petit tableau toute la physionomie du peuple romain.
D'autres font des cartes géographiques, lui a eu l'idée de
faire une carte historique. De chronologie, de géographie,
de science, pas le moindre souci. Le but de Florus
c'est de dire en aussi peu de mots que possible ce qu'il
pourra imaginer de plus éloquent sur les exploits du
peuple romain. Il commence sa revue déclamatoire à la
fondation de Rome et la termine ,à l'année 725, où
Auguste ferme le temple de Janus. C'est un hymne perpétuel
à la gloire de Rome, et dans le style que les rhéteurs
avaient mis à la mode. Je ne sais comment Juste Lipse
a pu dire que Florus écrivait composite, diserte, eleganter. Morhoff réduit cette éloquence à ses vraies proportions
: ventosact panegas loquacitas. Des exclamations
puériles, un ton emphatique, les Dieux et la fortune
mêlés à tout pour créer un grandiose artificiel, des antithèses
prodiguées à tort et à travers, aucune critique.
Tout ce qui peut frapper l'esprit est enregistré par Florus.
Il a des étonnements niais et ampoulés pour les moindres
choses. Il maudit Annibal avec une conscience qui ne
fait pas honneur à son jugement. Il fait éteindre l 'incendie
de Rome par le sang des Gaulois. César se rendant au
Sénat est une victime ornée de bandelettes pour le sacrifice.
Il tombe, et l'historien ne trouve, pour résumer cette
vie extraordinaire, que ceci : « Ainsi celui qui avait rempli
du sang des citoyens tout l'univers, remplit enfin
de son propre sang le sénat ! » Deux pages plus
loin, il appelle Brutus et Cassius des parricides ; et, à la fin
du chapitre, il leur dresse des statues : ce sont des hommes très sages. Si Sénèque et Lucain n'avaient eu que des
défauts et pas d'idées, ils eussent écrit à la façon de
Florus. Ainsi la stérilité d'esprit, la déplorable habitude
de transporter partout le ton et les colifichets de l'École
infligent à l'histoire une des plus tristes transformations
qu'elle ait subies : elle devient un prétexte à phrases.
Valère Maxime, Quinte-Curce et Florus, la pédanterie
ampoulée, le romanesque puéril, la déclamation sentencieuse,
voilà ce qui succède à la noblesse de Tite-Live.
On trouve ordinairement, à la suite de l'Épitome de
Florus, un autre abrégé qui porte le titre de Liber memorialis,
et, pour nom d'auteur, celui de Lucius Ampelius. L'auteur vivait probablement sous le règne de
Théodose. Il a réuni dans une série de petits chapitres
les curiosités de toute nature, compilation dépourvue
d'intérêt.
§ II.
TACITE ET SUÉTONE.
Parmi tous ces écrivains, il faut faire une place à part
à Tacite. Lui aussi il a subi l'influence des temps misérables où il a vécu ; mais le ressort de son âme, loin d'en
être émoussé, s'est tendu plus énergiquement. La compression
est salutaire aux esprits puissants ; elle n'étouffe
que les médiocres. Tacite disait en parlant d'AgricoIa :
« Il a montré que même sous de mauvais princes il peut
y avoir des grands liommes. » Il en est lui-même la
preuve.
On sait peu de chose de sa vie. Il s'appelait Caius Cornélius
Tacitus et appartenait à une famille de l'ordre
équestre. Il naquit à lnteramna vers 54 ap. J.-C. Comme
presque tous ses contemporains, il étudia le droit et
l'éloquence : c'était encore le seul moyen d'acquérir de
la réputation et d'entrer dans la vie publique. Au barreau,
sa parole se distinguait surtout par la gravité. Il obtint la questure sous Vespasien, fut élevé au
tribunat sous Titus et sous Domitien, il reçut la préture
en même temps qu'une place dans le collége des Quindecemviri
sacrorum. Ayant épousé la fille d'Agricola, il
suivit probablement son beau-père en Bretagne et visita
sans doute la Germanie. Nerva le fit consul en remplacement
de Virginius Rufus dont Tacite prononça l'éloge
funèbre. Il vit tout le règne de Trajan et peut-être
les premières années de celui d'Hadrien. A partir
de l'année 97, sa vie nous échappe. L'homme public
disparaît de la scène, l'historien commence son oeuvre.
Tacite en effet n'a rien écrit sous Domitien. Peut-être
avait-il publié quelques-uns de ses discours ou plaidoyers;
mais nous sommes réduits sur ce sujet à des
conjectures.
Son premier ouvrage parut sous Trajan (97) : c'est
la vie de son beau-père, Julius Agricola (Julii Agricolae
vita),le chef-d'oeuvre de la biographie chez les anciens.
Tacite n'a point écrit un panégyrique ou un éloge funèbre:
il a placé sous nos yeux le tableau sincère de la vie
d'un homme de bien telle qu'elle pouvait, telle qu'elle
devait être sous des princes comme Domitien. Agricola
n'est ni un grand politique ni un grand guerrier. Il n'a
pas assez de génie pour inquiéter l'empereur; il sert son
pays sans bassesse envers le prince, mais aussi sans affecter
une indépendance abrupte qui l'eût perdu, et n'eût
profité à personne. A ces traits reconnaissez l'historien
sincère, impartial, et surtout intelligent. Il était si facile
de transformer cette biographie en pamphlet A ce jugement
droit et sûr l'auteur joint une connaissance profonde
de toutes les parties du sujet. La vie d'Agricola se
passa presque tout entière dans les camps, et particulièrement
en Bretagne, province de création récente. Tacite
en a donné une description d'une exactitude et d'un
éclat remarquables : c'est le premier plan d'un grand
tableau. Quand il faut replacer Agricola parmi ses contemporains,
montrer les écueils où la vertu et la fortune
du plus grand nombre se brisèrent, l'historien retrouve
en son âme profonde, qui pouvait bien se taire, mais non
oublier, l'exacte physionomie de ces temps malheureux ;
il ne dissimule rien, mais se refuse la banale consolation
d'une déclamation sans noblesse et sans à-propos.
L'année suivante (98) il publia la Germanie (Germania,
sive de situ, moribus et populis Germaniae), ouvrage
d'une importance capitale pour l'histoire. Il est
divisé en trois parties : la première traite de la situation
de la Germanie, de la nature du sol, de l'origine des
habitants; la deuxième, de leurs moeurs, de leurs lois,
de leurs religions ; la troisième, la plus intéressante
au point de vue ethnographique, est une revue des
différents peuples de la Germanie. Nous croyons que
Tacite a vu de ses propres yeux le pays et ses habitants.
Il ne s'est pas bornéà en tracer une description
exacte : en étudiant la vie et les moeurs de ces tribus
barbares, il avait les yeux sur Rome. Il avait quitté une
société où la corruption était la loi du monde. Il trouvait dans les
forêts de la Germanie des moeurs pures, le respect de la
femme, une fierté indomptable. On a voulu réduire ce remarquable ouvrage aux mesquines proportions d'une
satire. Il a une portée plus haute. L'historien, par une
sorte de pressentiment qui n'est que l'intuition du génie,
comprend que de ce côté-là sont les vrais, les plus redoutables
ennemis de l'empire. Il raconte que soixante
mille de ces barbares se sont égorgés entre eux sous les
yeux mêmes des Romains, et. il ajoute : « puissent, ah ! puissent les nations, à défaut d'amour pour nous, persévérer dans celle haine d'elles-mêmes ! car au point où les destins ont amené l'empire, ce que la fortune peut faire de mieux pour nous, c'est de maintenir la discorde entre nos ennemis. » Le patriotisme dans
Tacite éclaire l'esprit, et ne l'aveugle pas. Nous lui pardonnerons
aussi d'avoir reculé devant les noms barbares
de plusieurs divinités germaniques. Les choses de la
religion avaient peu d'intérêt pour lui. Comme César, il
prétend retrouver les dieux romains dans les dieux de la
Germanie; les Alci seront pour lui Castor et Pollux.
Ainsi dès ces deux premiers ouvrages.Tacite se fait une
place à part parmi ses contemporains. Historien, il reste
sur le terrain solide de la réalité. Il ne se propose pas d 'être
spirituel ou éloquent à propos des faits : il recherche
avant tout et veut rendre la vérité. Pour lui, esprit sérieux
et grave, l'histoire est une science d'abord ; pour les autres,
elle n'était qu'une dépendance de l'éloquence. N'oublions
jamais ce point de vue. Trop de critiques ne veulent
voir dans Tacite qu'un écrivain de génie, un grand
peintre, comme on dit. Il l'est assurément, mais il ne
l'eût pas été, s'il n'avait étudié, et possédé à fond les
faits qui sont la substance première. C'est parce qu'il connaît bien et les personnages et les événements qu'il
donne à ses récils et à ses peintures cet intérêt dramatique
et ce relief puissant.
Les deux grandes compositions historiques de Tacite sont
les Histoires et les Annales. Il publia d'abord les Histoires, qui allaient de
69 à 97 (élévation de Galba à l'empire, mort de Domitien).
Il n'en reste que quatre livres et une partie du cinquième,
comprenant le récit des événements de 69 à 71. Si l'on
en juge d'après les proportions de ce qui a survécu,
c'était un ouvrage d'une étendue considérable, et qui
embrassait toute l'histoire intérieure et extérieure de
Rome, pendant trente années. Les Annales ont un caractère
tout différent. C'est plutôt un tableau rapide des
événements les plus importants, choisis et exposés il est
vrai par un maître, mais sans un dessein préconçu d'unité.
Elles allaient de l'an 14 à l'an 69. Il en reste les
six premiers livres, mais le cinquième est incomplet. Le
septième, le huitième, le neuvième et le dixième manquent;
nous possédons les six suivants de 11 à 16. Nous
avons perdu le règne de Culigula, la première partie de
celui de Claude, la fin de celui de Néron. Tibère nous reste.
Tacite est isolé parmi ses contemporains, et l'on ne
peut le rattacher directement à aucun de ses devanciers.
Il est supérieur aux uns et aux autres par la profonde
intelligence du sujet. Il a compris son temps, et il en a
souffert. Tite-Live avait sous les yeux le spectacle de la
majesté de l'empire se reposant de ses longues agitations
dans la gloire. Il a déroulé aux yeux de ses contemporains
les phases successives de l'élaboration de ce grand ouvrage ; il a l'enthousiasme et la foi. Tacite a vu ce
qu'il y avait de plus extrême dans la servitude, et il
n'a jamais espéré un gouvernement meilleur que le
principat. La fortune pourra envoyer aux Romains un
Domitien ou un Trajan, peu importe ; ils auront toujours
un maître. La victoire d'Actium a créé la monarchie
: ce serait une étrange illusion que de croire au
retour possible de la liberté. Les Romains se sont donnés
à Auguste; ce sont eux qui, par fatigue, dégoût, lâcheté
de coeur et corruption, ont établi sur une base inébranlable
le pouvoir d'un seul. Celui-ci est de sa nature
corrompu et corrupteur. Tout s'enchaîne et se fortifie
dans cette transformation d'und société épuisée : la bassesse
du peuple encourage les folies et les cruautés de
l'empereur ; le hasard des événements ne changera rien
à l'âme du temps. Tel est le point de vue philosophique
de Tacite. On a voulu faire de lui un républicain ;
c'est à tort. En théorie, il préférerait un gouvernement
à la fois monarchique, démocratique et aristocratique; mais, ajoute-t-il, « cela est plus facile à louer
qu'à établir. » Le seul gouvernement possible de son
temps, il est convaincu que c'est le principat. Seulement
il ne put s'en consoler. De là, cette mélancolie
souvent amère. Pour lui, l'avenir est vide, fermé à
tout espoir. Il sait bien qu'il ne doit pas écrire
l'histoire à la façon des auteurs républicains ; que l'horizon
est singulièrement rétréci, que la chose publique
est devenue la chose d'un seul, que la destinée des peuples et des individus ne se décide plus au Forum ou
au Sénat, mais dans le palais de César, parmi les affranchis,
les courtisanes, les intrigues de cour ; mais il sait
aussi qu'il est resté dans cette société corrompue des hommes de bien ; que la patience servile (patientia servilis)
des uns a fait briller d'un plus pur éclat la noble
intrépidité des autres ; que, si la liberté est proscrite,
elle a conservé des serviteurs fidèles jusqu'à la mort. Il
blâmera l'imprudence de ces victimes volontaires du
despotisme : « Thraséas, dit-il, sortit du sénat, et attira
ainsi le danger sur sa tête, sans donner aux autres le
signal de la liberté. » Mais son coeur e.'t avec eux.
Ces nobles témérités lui arrachent des regrets et de
l'admiration.
Tel est l'esprit général de l'oeuvre. Cette vue juste et
désolée de son temps explique sa tendance au fatalisme.
Il n'appartient à aucune école philosophique. Ses sympathies
sont pour le stoïcisme qui a produit et soutenu
les seuls grands hommes qu'ait vus l'empire,
et qui commande le suicide pour éviter l'opprobre.
« Helvidius Priscus, dit-il, embrassa la doctrine philosophique qui appelle uniquement bien ce qui est honnête, mal ce qui est honteux, et qui ne compte la puissance, la noblesse et tout ce qui est hors de l'âme, au nombre ni des biens ni des maux. » Quant à l'espérance
fortifiante d'une autre vie destinée à réparer les
iniquités de celle-ci, Tacite ne la connut point. Certains
sages, dit-il, ont pensé que les âmes ne s'éteignent pas
avec le corps; mais a-t-il embrassé cette opinion consolante?
rien ne l'indique. Son oeuvre aurait un tout
autre caractère, s'il eût vécu dans l'attente d'une réparation
divine : il eût saisi d'une étreinte moins puissante
la réalité passagère.
C'est là son génie. Il voit tout, pénètre tout, montre
tout. Rien ne lui échappe. Tite-Live nous a donné le
chef-d'oeuvre de la narration oratoire, Tacite crée la narration psychologique. Il recueille les faits, les groupe
par masses choisies, enchaîne les rapports, si bien que
le personnage apparaît en pleine lumière, non pas lui
seulement, mais tout ce qui l'entoure, tout ce qui a contribué
à faire de lui ce qu'il est. Qui comprendrait Néron
et Claude sans Agrippine, Messaline, Poppée et les affranchis?
Mais c'est peu de réunir et de grouper les personnages;
ils ne deviendront vivants que s'ils se meuvent
sous nos yeux, conformément à leur caractère, et suivant
l'impulsion donnée une fois à leurs passions. C'est ici
que l'analyse psychologique devient une véritable intuition.
Il décompose les âmes; découvre et montre en
elles le premier principe du mal, le désir coupable qui
vient de naître, qui se développe, qui ne peut plus se
contenir et veut saisir son objet : ce sera pour Néron le
meurtre de Britannicus ou celui d'Agrippine ; pour
Poppée, la répudiation et la mort d'Octavie; pour Tibère,
l'extension effrayante et fatale de la loi de lèse-majesté.
Les hypocrisies du crime sont dévoilées ; les arrière-pensées,
les sophismes sont devinés et étalés : les encouragements
venus du dehors, suggestions empoisonnées
des affranchis, complicité du Sénat, indifférence du
peuple, tout cela fortifie et arme d'audace ces grands scélérats
que le pouvoir absolu a perdus. Ajoutez, pour
compléter cette dramatique peinture de l'empire, les
protestations ou le silence désapprobateur de quelques
hommes de bien, isolés et sans influence ; la terreur devenue
un lien ; des conjurés sans énergie qui parlent de
liberté et ne songent à tuer Néron que pour ne pas être
tués par lui ; les juges condamnant leurs propres complices;
les conspirateurs se dénonçant les uns les autres;
des centurions égorgeant ceux avec lesquels ils devaient frapper le tyran ; les épargnés célébrant par des actions
de grâces la clémence du prince : partout la lâcheté, la
peur, l'abjection ; César seul osant tout, parce qu'il peut
tout.
On l'a accusé de partialité ; Tertullien a osé l'appeler
ille mendaciorum loquacissimus. Rien de moins juste.
La bonne foi de Tacite est manifeste. Il a contrôlé avec
soin tous les témoignages, il a sous les yeux les actes officiels.
Mais il est pessimiste, et il semble éprouver une
sorte de volupté amère dans la peinture de tant d'horreurs.
Le Sénat célèbre le supplice de la pure et innocente
Octavie par des offrandes publiques aux dieux.
Tacite signale ce fait, « afin, dit-il, que ceux qui connaîtront, par mes récits ou par d'autres, l'histoire de ces temps déplorables, sachent d'avance que, autant le prince ordonna d'exils ou d'assassinats, autant de fois on rendit grâces aux dieux, et que ce qui annonçait jadis nos succès, signalait alors les malheurs publics. Je ne tairai pas cependant les sénatus-consultes que distinguerait quelque adulation neuve, ou une servilité poussée au dernier terme. » Que ce soit là son
défaut, si l'on veut ; mais il faut reconnaître qu'il était
réellement comme il le dit, sine ira et studio, quorum
causas promit habeo. Absorbé par la contemplation de la
Rome des Césars, il s'est peu soucié de ce qui sortait de
son cadre ; de là son indifférence et son ignorance relativement
aux chrétiens, qu'il confond avec les juifs, et
qu'il déclare, sur la foi du préjugé populaire, dignes des
derniers supplices.
Cette concentration en soi-même, cette profondeur
d'observation et ces raffinements d'analyse, ont créé un
style nouveau, d'une hardiesse et d'un relief incomparables. Sa diction n'a rien de périodique; elle est dépourvue
de rhythme; il semble poursuivre une brièveté
idéale. Il est plein d'ellipses, de propositions absolues,
qui commandent ou expliquent toute une phrase : tel mot
jeté en passant arrête la pensée, et fait descendre à des
profondeurs inattendues. Des tours insolites, des antithèses
saisissantes, des réticences dramatiques ; et, par
suite, de l'obscurité, une tension souvent pénible, mais
rien de puéril ou de misérable. C'est un slyle tourmenté,
qui semble craindre de ne pouvoir jamais rendre toute
la pensée et toute la passion. De là, des raffinements parfois
excessifs, une couleur poétique, car la prose ne
saurait reproduire toutes les nuances de l'idée et les
orages du sentiment. Ces imperfections sont comme
fatales. Le style de Cicéron est clair, limpide, abondant :
tout est alors en pleine lumière à Rome. Tacite rencontre
à chaque pas la fausseté, l'hypocrisie, la peur, les bassesses
tramées dans l'ombre, un monde mystérieux et
terrible. Il faut reproduire tout cela. La langue qui a
suffi à Cicéron doit être remaniée, aiguisée, parfois même
violentée. A ce prix seulement, elle sera en harmonie
avec le sujet.
Par ses qualités et ses défauts Tacite n'exerça aucune
influence sur la littérature de son temps. Ses écrits peu
lus furent rarement reproduits. L'empereur Tacite voulut
en assurer la conservation déjà incertaine en ordonnant
d'en multiplier les copies; mais il mourut avant d'avoir vu exécuter ses ordres. Le pape Léon X fit chercher avec
le plus grand soin les manuscrits du grand historien;
c'est à son intelligente initiative que nous devons les cinq
premiers livres des Annales découverts en Westphalie
en 1515. On frouve dans presque toutes les édilions de Tacite à
la suite de ses oeuvres le fameux Dialogue sur les causes
de la corruption de l'éloquence (Dialogus de oratoribus,
sive de causis corruptae eloquentiae). Ce dialogue est-il
de Tacite? C'est un point sur lequel les avis sont fort
partagés. Cependant la majorité s'est prononcée pour
l'affirmative. Quintilien déclare, il est vrai, qu'il a composé
un ouvrage sur ce sujet, mais Quintilien était-il capable
d'écrire un tel livre? On a voulu l'attribuer à Pline le
jeune; mais l'âge de celui-ci s'y oppose. L'auteur déclare
qu'il était fort jeune (juvenis admodum) quand il assista
à la discussion dont il a reproduit les arguments. Tacite
pouvait alors avoir environ vingt-deux ans, mais l'ouvrage
fut écrit plus lard vers 97. De plus, Pline, dans
une de ses lettres adressée à Tacite, fait allusion à un
passage fort remarquable du dialogue, sur le silence des
bois sacrés et des forêts où va rêver le poëte. La plus
sérieuse objection soulevée est celle du style. On ne peut
méconnaître en effet qu'il ne ressemble guère à celui
des Annales. Mais Tacite traitait une question de critique littéraire : les sentences, la brièveté, l'énergie concentrée n'étaient pas encore le caractère de son style,
et le sujet ne comportait pas ce genre d'écrire. Cependant on y découvre déjà les idées et le point de vue général qui domineront dans les compositions historiques
de son âge mûr. Après une comparaison vive, élégante,
ingénieuse entre la poésie et l'éloquence, Tacite aborde
par l'arrivée d'un troisième interlocuteur, Messala, la
vraie question, c'est-à-dire le parallèle entre les orateurs
de son temps et ceux de la république. Là est
l'originalité et la force de l'ouvrage. Les causes de la
décadence de l'éloquence sont énumérées et classées avec une exactitude et une verve singulières. Elles se réduisent
à une seule, la différence des temps. Il naît aujourd'hui
d'aussi heureux génies qu'autrefois; mais il
n'y a plus de liberté, plus de vie publique, plus de grands
intérêts en jeu. De là, l'abaissement des caractères, de là,
la décadence des études. A quoi bon tant apprendre ou
tant travailler pour plaider quelques misérables causes
d'intérêt privé ? Que l'on rapproche de cette idée l'esprit
qui inspire les Annales et la Vie d'Agricola, on
reconnaîtra que Tacite n'a fait qu'appliquer à l'histoire
la critique et la règle qu'il avait déjà appliquées à une
question littéraire. Les chapitres qui renferment le parallèle
entre l'éducation d'autrefois et celle de son temps
sont admirables.
Suétone complète Tacite. Celui-ci pourrait paraître
invraisemblable, si sa bonne foi n'était attestée par le
premier.
C. Suetonius Tranquillus naquit sous Domitien vers
l'an 70. Son père, tribun de la treizième légion, combattit
sous Othon à Bébriac. Le fils fut l'ami de Pline qui
le recommanda à Trajan. C'était un érudit très honnête
homme. Quoique sans enfants,
il obtint du prince le jus trium liberorum, et plus
tard le tribunat militaire. Sous Hadrien, il fut secrétaire
de l'empereur, mais il fut
disgracié pour avoir manqué de respect à l'impératrice
Sabina. On ne sait quand il mourut.
Suétone était un archéologue. Il avait composé sur les
antiquités grecques et romaines un grand nombre de traités dont Suidas nous a conservé les titres . Il s'était aussi occupé de grammaire
et d'histoire littéraire. Nous possédons sous le
le titre : De illustribus grammaticis, un fragment important
d'un ouvrage considérable sur les hommes illustres,
dont le catalogue de saint Jérôme est probablement un
abrégé. Le livre : De claris rhetoribus est incomplet,
mais précieux. Enfin d'un autre ouvrage sur les poëtes,
De poetis, incomplet aussi, nous avons les biographies de
Térence, d'Horace, de Perse, de Lucain, de Juvénal, de
Pline l'Ancien, mais les critiques ne sont pas d'accord
sur l'authenticité de ces biographies, dont quelques-unes
sont attribuées à Probus, Le plus important ouvrage
de Suétone, ce sont les vies des XII Césars, de Jules César a Domitien. L'histoire
prend une forme nouvelle, celle de la biographie.
Suétone n'a aucune élévation dans l 'esprit, pas le moindre
sens politique ; de plus il est indiffèrent. Mais c'est un
érudit patient, obstiné, à qui rien n'échappe. Il a raconté
la vie des Césars avec autant de calme et de bonne foi
que celle des rhéteurs et des poëtes illustres. Cet archéologue,
qui recueille et étale sans ordre et sans passion
tous les éléments matériels pour ainsi dire de cette dramatique
histoire, ébranle sans s'en douter l'imagination
aussi fortement qu'un Tacite. La naissance, l'éducation,
l'extérieur, les habitudes intimes des empereurs, tout ce
qui explique et fait comprendre les actes monstrueux et
qui sembleraient impossibles, est là rassemblé, exposé
froidement, et frappe d'autant plus. Suétone n'a qu'un souci, c'est la vérité scrupuleuse. Aucune composition,
aucune gradation, rien qui ressemble à un panégyrique
ou à un pamphlet, aucune intention morale, l'exactitude
la plus libre. Ouvrage précieux entre tous
pour la postérité. Tacite a montré l'âme de la société
impériale ; on est tenté de l'accuser d'exagération et de
pessimisme; Suétone fournit les preuves à l'appui.
C'est un bon écrivain, correct, d'une concision un peu
forcée, mais qui ne manque pas de nerf. Juste Lipse et
Ange Politien l'estimaient singulièrement. Les contemporains
et l'âge suivant en firent le plus grand cas. Il est
devenu le modèle sur lequel se sont réglés les écrivains de
l'histoire d'Auguste. Après avoir été politique, oratoire
et philosophique, l'histoire allait devenir anecdotique. A
mesure que le pouvoir d'un seul devenait plus exclusif,
l'horizon se bornait d'autant plus ; la vie publique
n'existe plus ; c'est dans les recoins du palais des empereurs
que ces chétifs écrivains croiront trouver toute
l'histoire.
LIVRE CINQUIÈME
État général des lettres depuis le principat d'Hadrien jusqu'à la fin de l'empire d'Occident. — Les rhéteurs. — Fronton. — Aulu-Gelle. Apulée.
§ 1.
ÉTAT GÉNÉRAL DES LETTRES.
Avec le règne d'Hadrien commence la profonde, l'incurable
décadence : tout languit, dépérit, disparait à la
fois, les idées, les sentiments, la langue. La littérature
devient un je ne sais quoi de factice et de puéril. Les
écrivains de la période précédente étaient encore des
citoyens ; la chose publique les intéressait ; le mot de
patrie avait pour eux un sens : ceux que nous allons rencontrer
sont des sujets dans le sens le plus plat du mot ;
on écrit encore, mais on ne pense plus. Pline, Tacite,
Quintilien déploraient la décadence de l'antique éducation
nationale : on n'en trouve plus la moindre trace dans
la période actuelle. Ils conservaient encore quelques-uns
de ces vieux préjugés romains, qui après tout étaient
une passion et une force : tout cela est mort et n'a pas
été remplacé. Rome est devenue la patrie du genre humain.
Les étrangers, les provinciaux y affluent et y tiennent
le premier rôle. Trajan est espagnol; bientôt vont venir des empereurs africains, syriens, thraces. Chaque
peuple de l'immense empire sera représenté à son tour
sur le trône du monde. Des empereurs comme Hadrien,
Antonin, Marc-Aurèle, sont des esprits cultivés ; mais
la faveur qu'ils accordent aux lettrés consomme la ruine
de toute indépendance personnelle. La littérature devient
comme une fonction, en tout cas, c'est un métier ; Hadrien
réunit en une sorte d'académie les rhéteurs et les
philosophes ; il leur assigne pour théâtre de leurs exercices
l'Athenaeum, et leur fixe des salaires. Antonin et
Marc-Aurèle feront comme lui. C'est l'empereur qui donnera
le ton à la littérature. Hadrien méprise Cicéron,
Salluste et Virgile : ce sont des auteurs trop modernes
pour lui plaire ; il ne veut entendre parler que du vieux
Caton, d'Ennius, de Caelius, ce qui ne l'empêche pas d'avoir
le plus profond mépris pour Homère et Platon. Il
aime à railler les écrivains de son temps ; il les accable
d'épigrammes impertinentes,
mais il les paye, et nul ne réclame. Marc-Aurèle est plus
doux, mais, dans cette âme honnête et faible, la bienveillance
est banale, le discernement presque nul. Tous ses
maîtres, et combien n'en eut-il pas ! sont pour lui des
grands hommes. D'ailleurs toutes ses prédilections sont
pour l'idiome grec, et lui-même écrira en grec son beau
livre des Pensées.
Sous un tel régime il ne pouvait se produire d'oeuvres
fortes et originales. Aussi presque tous les monuments
de la littérature sont des traités de grammaire, de rhétorique
ou de philosophie élémentaire. Les compilateurs
apparaissent : une des formes les plus accusées de l 'impuissance
se manifeste, la recherche des archaïsmes.
C'est la grande voie du succès alors. On ne songe plus à imiter les moeurs antiques, ce qui serait ridicule, mais
on aime à enchâsser dans son style les tours, les figures,
les membres et les périodes des anciens auteurs. Des
grammairiens, passés maîtres dans ces pastiches déplorables,
sont chargés de l'éducation des princes, sont élevés
au consulat, obtiennent des statues : ils seront plus tard
empereurs. De quelque côté que l'on se tourne, on sent
le vide et le néant. Le mouvement et la vie passent chez
les chrétiens, dont les éloquentes apologies commencent
à retentir dans ce silence de mort. On voudrait aller à
eux, abandonner le vieux cadavre romain, mais il faut
réserver à ces précurseurs d'un monde nouveau une place
à part, et achever les funérailles de l'ancien monde.
Il serait cependant injuste de ne pas mentionner, ne fût ce
qu'en passant, les remarquables développements que
prit alors une science éminemment romaine, je veux dire
la jurisprudence. L'époque à laquelle nous sommes parvenus
produisit des hommes qui sont encore aujourd'hui
considérés comme les fondateurs du droit. Il y a peu de
noms plus illustres que ceux des Ulpien, des Papinien,
des Paul et des Gaïus, celui-ci découvert et publié par Niebhur
en 1816. Malheureusement nous ne possédons que des
fragments incomplets et probablement défigurés de leurs
ouvrages. La grande révision commandée par Justinien
et opérée par Tribonien donna une place considérable
aux décisions des jurisconsultes du troisième siècle, mais
Tribonien falsifia plus d'une fois leurs textes, peccadille
pour un homme qui vendait la justice. Quoi qu'il en soit,
sous les règnes d'Hadrien et de ses successeurs, le droit
fut définitivement constitué sur une base philosophique.
Au temps de Cicéron lui-même, la jurisprudence n'était
guère autre chose que la science des décisions rendues par les préteurs ou les jurisconsultes ; la science du droit
proprement dite n'exislait pas. L'étude de la philosophie,
et surtout de la philosophie stoïcienne, amena peu à peu
les jurisconsultes à rechercher les principes mêmes des
lois. C'est sous Auguste que s'annonça cette révolution
importante. Elle eut pour promoteur Antistius Labéon,
élève de Trébatius, stoïcien. Elle eut pour adversaire
Capito, courtisan et favori du prince. Les ouvrages de
Sénèque, les nobles exemples donnés par les stoïciens
sous les règnes de Néron et de ses successeurs, l'avénement
à l'empire du stoïcien Marc Aurèle, firent enfin
définitivement entrer dans le droit romain les principes
du droit naturel, c'est-à-dire, ceux de la raison et de
l'équité. Rien de plus remarquable que l'aspect offert
alors par la société romaine. Le despotisme dans la cité,
l'anéantissement de toute vie politique, une grande corruption
dans les moeurs, voilà une de ses faces ; d'un
autre côté, l'humanité et la justice pénétrant dans les
institutions et les lois; le droit paternel,si dur et si despotique,
restreint ; la femme relevée de sa déchéance ;
l'esclave reconnu et proclamé un être moral. M. Laferrière,
dans un mémoire fort intéressant, a constaté la
puissante et salutaire influence exercée par la doctrine
stoïcienne sur les jurisconsultes romains. C'est à ceux que
j'ai nommés qu'il emprunte presque toutes ses citations.
Rien de plus élevé, de plus noble, de plus nouveau que
ces fières revendications de l'équité naturelle. J'ajoute
aussi que le langage de ces interprètes du droit est d'une
remarquable pureté : concision, propriété, énergie, c'est
une langue qu'on ne soupçonne pas, quand on lit Aulu-gelle
ou Apulée.
Il serait injuste de ne pas mentionner en passant le développement que prit aussi dans cette période la grammaire.
Il s'en faut bien que les Donat, les Servius, les
Macrobe, les Priscien et tant d'autres aient un style
remarquable, qu'ils se distinguent par l'élégance de la
diction, que leur goût soit pur ; il leur arrive même assez
souvent de ne pas comprendre les beautés littéraires des
poëtes qu'ils interprètent; mais leurs commentaires, surtout
ceux de Donat et de Servius, renferment des renseignements<
archéologiques précieux. On en peut dire autant
de Macrobe, à qui nous devons la conservation du Songe
de Scipion, cet admirable couronnement du traité de la
République de Cicéron. On consulte encore avec fruit son
autre ouvrage les Saturnales, qui donne des détails
intéressants sur les usages religieux des anciens Romains.
§ II.
CORNÉLIUS FRONTON.
La découverte des fragments de Fronton faite, il y a
une cinquantaine d'années par M. Angelo Maï, nous permet
de restituer à cette époque sa physionomie. Fronton,
originaire d'Afrique, et qui florissait dans la première
moitié du second siècle, était un rhéteur latin; il fut
chargé de l'éducation de Marc-Aurèle et de Lucius Vérus.
Il eut dans ses élèves des amis pleins de déférence
et de tendresse : élevé au consulat, honoré même du
proconsulat, estimé, choyé, il donna le ton à la littérature
de son temps. Il avait composé un ouvrage de grammaire
sur les différences des termes (De differentiis vocabularum)
qui est perdu pour nous. Mais nous possédons, grâce à la découverte de M. Maï, quelques fragments assez
considérables de Fronton, et surtout un grand nombre
de lettres adressées par lui aux Antonins, avec les réponses
de ces princes. C'est de cette partie de son oeuvre
que je m'occuperai particulièrement. Je dois cependant
indiquer les titres et le caractère de ses autres ouvrages.
L'un, fort mutilé, est une espèce de relation panégyrique
de la guerre parthique. Il est probable que Fronton avait
été comme promu aux fonctions d'historiographe des
princes. L'ouvrage avait pour titre : Principes d'histoire.
A la suite se trouvent deux compositions d'une puérilité
rare, un Éloge de la fumée et de la poussière (Laudes
fumi et pulveris), sorte de déclamation paradoxale, et un<
Éloge de la négligence. Ajoutons-y encore, pour être complet,
une narration fabuleuse intitulée : Arion. Voilà le
catalogue des oeuvres de Fronton.
C'était un honnête homme, de moeurs douées ; cependant
il ne pouvait s'accommoder du caractère difficile, il
est vrai, de son collègue Hérodes Atticus, rhéteur grec.
Le pauvre empereur avait fort à faire pour maintenir la
paix entre ses deux professeurs d'éloquence. Fronton vécut
et mourut heureux; il fut pleuré par son élève, et les
contemporains s'imaginèrent ou firent semblant de croire
que l'éloquence romaine avait perdu en lui son plus
glorieux représentantnce. C'est
qu'en réalité, elle avait cessé d'exister. Lisez tout ce qui
reste de Fronton, vous ne découvrirez pas une idée.
Fronton n'en avait point, et était persuadé qu'il n'était
pas nécessaire d'en avoir. Il avait une passion sincère et
profonde pour l'éloquence, mais il ne lui arriva jamais
de se demander quelles étaient les sources de l'éloquence,
quel en était le but, et si par hasard il n'était pas utile de penser avant de parler. Sa correspondance contient
à ce sujet les plus curieuses révélations. Il s'aperçoit
à un moment que son élève Marc-Aurèle le néglige
quelque peu, qu'il recherche les maîtres de philosophie,
qu'il travaille à son âme, et que même il consacre une
partie de ses nuits à ce salutaire labeur. Fronton s'alarme
; il tremble d abord pour cette chère santé, puis il
se lamente à la pensée d'une infidélité faite à l'éloquence
en faveur de la philosophie. Platon, Chrysippe, Cléanthe,
voilà assurément de grands personnages, mais apprendre les raisonnements cératins, les sorites, les sophismes, mots cornus, intruments de torture, et né gliger la parure du discours, la gravité, la majesté, la grâce, l'éclat, cela n'indique-t-il pas que tu aimes mieux parler que de t'énoncer, murmurer et bredouiller plutôt que de faire entendre une voix d'homme? » Et
plus loin : «Aujourd'hui, tu me parais, entraîné comme tu l'es par les habitudes du siècle et le dégoût du travail, avoir déserté l'étude de l'éloquence et tourné tes regards du côté de la philosophie, où il n'y a nul préambule à décorer avec soin, nulle narration à disposer
brièvement, nettement, avec art, nulle question à diviser, nuls arguments à chercher, rien à accumuler... » Les arguments de Fronton, on le voit, ne
sont pas d'une bien haute portée. Laissons-le s'animer,
et voyons comme il plaidera pro domo sua «Quoi! les dieux immortels souffriraient que les comices, que les rostres, que la tribune, jadis retentissante à la voix de Caton, de Gracchus et de Cicéron, devint silencieuse, et de préférence à notre âge ! L'univers, que tu as reçu sous l'empire de la parole, deviendrait muet par ta volonté ! Qu'un homme arrache la langue à un autre homme, il passera pour atroce ; arracher l'éloquence au genre humain, regarderais-tu cela comme un médiocre attentat? Ne l'assimileras-tu pas à Téréus ou à Lycurgus? Et ce Lycurgus enfin, quel attentat si grave a-t-il commis que de couper des vignes ? C'eût été, certes, un bienfait pour un grand nombre de peuples que la destruction de la vigne par toute la terre, et cependant Lycurgus fut pnni d'avoir coupé les vignes. A mon sens, la destruction de l'éloquence appellerait la vengeance divine : car la vigne n'est placée que sous la protection d'un seul dieu ; l'éloquence dans le ciel est chère à bien des dieux. Minerve est la maitresse de la parole ; Mercure préside aux messages ; Apollon est l'auteur des chants agrestes, Bacchus le fondateur des dithyrambes ; les Faunes sont les inspirateurs des oracles; Calliope est la maitresse d'Homère, et Homère et le Sommeil sont les maîtres d'Ennius, etc.,etc., etc.Voila un spécimen du goût et de la
force d'invention qu'on admirait dans cet illustre rhéteur ;
telle est l'idée qu'il se fait de l'éloquence,quand il essaye
de s'en faire une idée, ce qui lui arrive rarement. Il ne
s'imagine pas un seul instant qu'elle puisse être autre
chose qu'une parure : aussi déclare-t-il que le genre démonstratif est
le genre par excellence, le sommet de
l'art où peu parviennent : encore un
renseignement assez curieux sur l'éloquence du temps,
qui ne pouvait plus guère consister qu'en discours d'apparat.
Quels sont les auteurs dont il recommande la lecture
à son élève? Cicéron vraisemblablement. Il n'en est
rien. Pourquoi? Cicéron n'est-il pas le plus grand des orateurs?
Idées, disposition des arguments, dialectique
pressante et nourrie, philosophie oratoire, mouvement passion, il réunit toutes les qualités. Fronton s'occupe
bien de tout cela ! Cicéron ne saurait être un modèle utile
à étudier, « car il a apporté un soin peu scrupuleux dans
la recherche des mots. » Peut-être l'a-t-il fait par grandeur
d 'âme, ou pour s'éviter un long travail ; mais enfin,
dans tous ses discours, « on ne rencontrera que très peu de ces mots inattendus, inopinés, qui ne se trouvent qu'à l'aide de l'étude, du travail, des veilles et d'une mémoire meublée de vers des anciens poëtes. » Quels
seront donc les modèles proposés à l'admiration et à l'imitation
du jeune prince? Ce sera avant tout M. Porcuns
Caton, puis Salluste son imitateur; parmi les poëtes,
ce sera Plaute, surtout Ennius, puis Naevius, Lucrèce,
Accius, Cécilius et Labérius. Il faudra aussi aller fouiller
les vieilles Atellanes de Pomponius et de Novius, les
contes de Sisenna et les satires de Lucilius. Voilà les procédés
littéraires de Fronton mis à nu : c'est un amateur
de vieux mots. Quant à penser, il ne s'en soucie aucunement,
et même il témoigne une aversion particulière
pour les auteurs atteints de cette infirmité. Sénèque en
particulier est l'objet de son profond mépris. Il va jusqu'à
dire que « si l'on trouve quelquefois dans ses livres des idées sérieuses, on trouve bien des paillettes d'argent dans les cloaques, ce qui n'est pas une raison suffisante pour aller remuer les cloaques. » Je n'insiste pas sur
des théories littéraires de ce genre; mais qui n'admirerait
la patience héroïque de ce grand esprit Marc-Aurèle,
traînant attaché à sa personne ce froid et pauvre rhéteur
qui réclame toujours pour son art toutes les préférences
de l'empereur? Les doléances sont parfois comiques.
« Où est cet heureux temps, s'écrie-t-il, où, ne pouvant composer tout un discours, tu t'amusais du moins à recueillir des synonymes, à rechercher des expressions remarquables, à tourner et à retourner les membres de phrases des anciens, à communiquer de l'élégance aux termes vulgaires, de la nouveauté aux mots corrompus, à ajuster une image, jeter dans le moule une figure, la parer d'un vieux mot, lui donner avec le pinceau une teinte légère d'antiquité? »
Qu'on me permette d'ajouter à cette esquisse rapide
d'un rhéteur célèbre le trait suivant. Fronton veut s'excuser
auprès de l'impératrice de ne lui avoir pas encore
écrit, mais il était occupé. Voici comment il se tire de
son épître (elle est en grec).
«Par faiblesse et par impuissance, je suis dans le même
état que cet animal appelé hyène par les Romains, et dont
le col tendu en ligne droite ne peut, dit-on, se tourner ni à
droite ni à gauche. Moi aussi, lorsque je travaille avec
ardeur à une chose, je ne puis me tourner d'aucun côté ;
je me sépare de tout ce qui n'est pas elle, et j'y suis tout
entier attaché. On dit aussi que, semblables à l'hyène,
les serpents à dard marchent en ligne droite, et ne vont
jamais autrement. Les javelots et les traits atteignent plus
sûrement le but lorsqu'ils sont lancés droit, sans être
écartés par le vent ou détournés par la main de Minerve
ou d'Appollon, comme ceux de Teucer ou des amants de
Pénélope. De ces trois images sous lesquelles je viens de
me représenter, il en est deux qui ont quelque chose de
farouche et de sauvage, l'hyène et les serpents ; la troisième,
celle des traits, a encore quelque chose d'inhumain
et de bien fait pour effrayer les Muses. Si je parlais
du souffle des vents qui pousse le vaisseau en droite ligne,
et ne l'entraîne point vers l'abîme, cette quatrième
image offrirait encore quelque chose de violent. Si, ajoutant encore une image tirée des lignes, je donnais la préférence
à la ligne droite, parce qu'elle est la plus noble,
la plus antique des lignes, j'aurais choisi là une image
non-seulement inanimée, comme celle des javelots, mais
qui serait même incorporelle. Quelle image pourrais-je
donc trouver qui fût vraisemblable, prise surtout de l'humanité,
de la musique mieux encore? Elle serait pour moi
la perfection, si on pouvait y mettre de l'amitié et de l'amour.
Orphée pleura, dit-on, pour s'être retourné en arrière
; s'il eût regardé et marché droit devant lui, il n'aurait
pas tant pleuré. Mais c'est assez d'images ; car celle
d'Orphée elle-même n'est point vraisemblable, puisqu'elle
sort des enfers, » etc., etc.
Auprès de ce galimatias, Balzac et Voiture sont des modèles
de simplicité et de naturel.
§ III.
AULU-GELLE.
J'insisterai beaucoup moins, sur un autre personnage
du même temps, Aulu-Gelle ( Aulus Gellius, et quelquefois
par corruption Agellius). Ce n'est pas qu'il semble inférieur
en esprit à Fronton, mais sa personnalité nous
échappe. Il n'a pas eu comme le premier l'honneur d'être
le précepteur des princes, il n'a pas été élevé au consulat,
il n'a pas obtenu de statues. Rien de brillant dans sa vie,
rien de prétentieux dans son oeuvre. Il n'a pas été un de
ces hommes qui exercent une influence quelconque sur
leur temps. Né à Rome, élève de Fronton dans sa première
jeunesse, il le quitta pour aller, suivant l'ancien
usage, achever son éducation à Athènes ; puis il revint à Rome, où il remplit une fonction publique, probablement
celle de centumvir ou juré dans les affaires civiles.
Il était marié, il avait des enfants, et consacrait à l'étude
et à leur éducation les loisirs que lui laissaient les tribunaux.
De là, est sorti l'ouvrage intitulé les Nuits attiques
(Noctium atticarum commentarium), en vingt livres, dont
le huitième est perdu. Aulu-Gelle choisit ce titre de préférence
à tous les titres ambitieux alors à la mode, parce
qu'il lui rappelait les longues et douces soirées d'hiver
passées dans son domaine de l'Attique à lire, à annoter,
à extraire les anciens auteurs grecs ou romains. Les
Nuits attiques ne sont pas autre chose en effet qu'une
compilation. A mesure qu'Aulu-Gelle trouvait dans ses
livres quelque particularité intéressante, il la recueillait;
et il ne suivit jamais d'autre ordre que celui de sa fantaisie
de chaque jour. Ajoutons que tous les livres lui
étaient bons, et qu'il enflait le sien de toutes les questions
qui se présentaient. Poésie, éloquence, philosophie, droit,
médecine, religion, grammaire, usages nationaux ou
étrangers, anecdotes piquantes, souvenirs personnels;
tout est entassé confusément dans le recueil ; c'était, il le
dit lui-même, comme un vaste cabinet à provisions. On
le comprend, l'analyse d'un tel livre est impossible, on
comprend aussitôt qu'il n'est pas dépourvu d'utilité pour
nous. Bien des détails précieux nous ont été conservés
par Aulu-Gelle seul, et il est juste de lui en savoir gré.
Mais ce qu'il importe surtout de remarquer en lui,
comme un des signes du goût du temps, c'est sa prédilection
bien accusée pour les anciens auteurs. En cela il
est de l'école de Fronton, c'est un archéologue. Grâce
à cette manie de la mode du jour, nous trouvons dans
Aulu-Gelle un nombre considérable de fragments qui remontent au sixième siècle de Rome. Il est un des plus
ardents admirateurs de M. Porcius Caton, qu'il cite à
chaque instant. Ennius, Nævius, Pacuvius sont ses poëtes
préférés ; il les mentionne, les commente avec amour,
non pour admirer la puissante venue de leurs vers sauvages,
mais pour relever telle expression curieuse, tel
tour, ou tel détail d'archéologie. Lui-même dans ce
commerce a contracté je ne sais quelle couleur archaïque,
parure chère à son coeur assurément. C'est un
homme qui vit dans la contemplation des vieilleries,
qu'il adore comme vieilleries, ivre de joie quand il peut
coudre à son vêtement moderne quelque lambeau de la
toge antique de M. Porcius Caton !
§ IV.
APULÉE.
Apulée (L. Appuleius) est un tout autre homme ; il ne
faut pas le confondre avec ces collectionneurs de bric-à-brac : c'est un être vivant, passionné, étrange souvent,
mais ce n'est pas une vieille médaille usée.
Il est né à Madaura, sur cette terre brûlante d'Afrique,
dans la patrie des superstitions, des prodiges, des passions
emportées. Sa naissance se place dans les dernières
années du règne d'Hadrien, et l'on ignore la date de sa
mort. C'est à Carthage qu'il alla faire son éducation.
Cette grande cité était alors plus corrompue encore que
Rome, si c'est possible, et plus éprise assurément de beau
langage. « Y a-t-il, dit Apulée, gloire plus haute et plus sûre que de bien parler à Carthage? La cité est un peuple d'érudits : c'est là que les enfants s'imprègnent de toutes les connaissances, que les jeunes gens en font
parade, que les vieillards les communiquent. Carthage, ô ma vénérable maitresse, Carthage, Muse céleste de l'Afrique, Carthage charme harmonieux de tous ceux qui portent la toge ! » De Carthage il passe à
Athènes ; mais il n'y allait point chercher cette délicatesse
et cette mesure attiques qui ne convenaient point à
sa nature. Il y étudia la philosophie, puis se mit à courir
le monde. Esprit curieux et qui se portait aux choses surnaturelles
d'un singulier élan, il profita de ses voyages
pour se faire initier à tous les mystères alors enseignés.
Enfin il arriva à Rome, la sentine du genre humain ; il s'y
perfectionna dans la langue latine, et réussit même à
plaider avec succès. Mais toute son attention se porta
bientôt sur les mystères d'Osiris et de Sérapis auxquels
il se fit initier; il obtint même une des premières dignités
dans le collége des prêtres. De là, il se rend à
Alexandrie, autre centre religieux et littéraire fort considérable,
puis nous le retrouvons dans la petite ville
d'Eea où s'accomplit un des principaux événements de
sa vie. Agé alors d'une trentaine d'années, beau, bien fait,
éloquent, spirituel, il inspire une passion très vive à
une veuve de quarante ans, fort riche, qui se décide à
l'épouser. Mais les enfants et les collatéraux de Pudentilla
défèrent Apulée aux tribunaux comme coupable
d'avoir employé le secours de la magie pour se faire
aimer et épouser. Il échappe à ce danger, perd ou abandonne
sa femme et retourne à Carthage. Son éloquence
y ravit tous les auditeurs, on lui dresse des statues. Que
devient-il ensuite?On ne sait, mais on aime à croire qu'il
n'est pas mort d'une mort vulgaire.
Tel est le personnage. Comme on le voit, ce n'est ni un Romain ni un Grec, c'est un mélange d'africain, de
grec d'Orient, et de domicilié à Rome. Ces trois caractères
se retrouveront dans son oeuvre, non point fondus
harmonieusement comme il arrive aux grandes époques
littéraires, mais juxtaposés : de là des disparates étranges,
monstrueuses parfois, mais non sans intérêt après
tout. Ce personnage encore une fois n'est pas le premier
venu.
Son premier ouvrage a pour titre : Les Métamorphoses ou l'Ane d'or en onze livres.
C'est un roman, le seul, on peut dire, que nous ait
transmis l'antiquité romaine, car le Satiricon de Pétrone
n'a pas tout à fait ce caractère. On ignore quelle
est la source à laquelle a puisé Apulée. Ce qu'il y a de
certain, c'est que la fable du roman et les principales
particularités lui sont communes ainsi qu'à Lucien. Ou il
a imité de très près ce dernier, ou tous deux ont imité le
même modèle. Celui-ci serait un certain Lucius de Patras,
personnage d'ailleurs absolument inconnu. Quoi qu'il en
soit, l'oeuvre d'Apulée est originale. Elle a des proportions,
bien plus vastes que l'Ane d'or de Lucien. Elle
renferme un plus grand nombre d'épisodes et particulièrement,
celui des amours de Psyché qui forme deux livres.
Disons en deux mots le plan du roman. Un jeune homme
de moeurs peu régulières, et passionné pour la magie, a
recours à un sortilége pour se transformer en oiseau,
mais il se trompe de fiole et le voilà changé en âne. Il
garde l'intelligence humaine, la mémoire, et racontera
plus tard les misères et les déboires de sa vie de bête.
Enfin il réussit à manger des roses, ce qui est un remède
souverain en pareil cas, il redevient homme et se fait
initier aux mystères d'Osiris et de Sérapis. Apulée était fort jeune quand il écrivit ce roman. Il
n'avait pas encore habité Rome, et il porta dans ses
récits et son style un coloris d'une singulière chaleur ;
et des élégances africaines à faire frémir les puristes;
mais que d'esprit, que de verve ! Les anecdotes de haut
goût, les détails licencieux, et pis que cela même, sont
abordés franchement ; dans un genre détestable l'auteur
du moins est original ; il sait peindre : il sait aussi raconter
avec beaucoup de charme et de grâce ; et s'il n'évite
point les polissonneries, on le voit pourtant comme
toujours porté vers des choses plus hautes. L'histoire de
Psyché et de l'Amour que notre La Fontaine, fin connaisseur,
est allé chercher dans l'Ane d'or, est unmythe d'une
pureté ravissante. Agréable repos ménagé dans le récit
un peu monotone des épreuves d'un baudet, ce mythe,
d'un symbolisme si transparent, trahit une préoccupation
réelle des destinées de l'âme, du problème
de la nature humaine, des expiations, des purifications
qu'elle doit subir avant de s'unir définitivement à
celui qui est la véritable vie et le véritable amour.
Les critiques ont été fort durs envers Apulée, faute
d'avoir essayé de le comprendre. Y a-t-il dans toute la
littérature latine un seul récit symbolique de cette valeur?
Y en a-t-il même un seul? Et qu'on ne parle pas
de magie et d'obscénité (c'est la définition qu'on impose
à Apulée). Ici rien de tel. L'épisode de Psyché a un caractère
religieux et philosophique à la fois. Je croirais volontiers
qu'il naquit à l'ombre des sanctuaires et qu'il
fut imaginé pour peindre aux initiés dans une allégorie
poétique la nécessité des pratiques purificatrices sans lesquelles
la béatitude céleste est refusée aux hommes.
Mais ce n'est pas ici le lieu de développer cette hypothèse. Je ferai seulement remarquer que le onzième
livre tout entier est consacré aux choses religieuses, et
qu'il respire une onction remarquable.
Après les Métamorphoses, l'ouvrage le plus intéressant
d'Apulée est celui qui porte indifféremment les titres
d'Apologie ou sur la Magie. Ce sont deux plaidoyers
prononcés par Apulée devant les juges pour repousser
l'accusation de magie dirigée contre lui par le fils et les
parents de sa femme. Il y a dans ces deux discours
des détails bien curieux sur les moeurs, les habitudes, les
préjugés et les superstitions d'une petite ville d'Afrique
au deuxième siècle de notre ère, mais je ne puis m'y
arrêter. Apulée gagna sa cause, et il était difficile qu'il
en fût autrement. Il plaida avec beaucoup d'esprit et
quelque peu de fatuité. « Vous prétendez que j'ai eu recours
à des sortilèges pour me faire épouser de Pudentilla :
mais, pauvres gens, que voyez-vous donc de si extraordinaire
dans l'amour qu'un jeune homme beau, bien
fait, spirituel, éloquent, inspire à une veuve sur le retour ?
Ma bonne mine et mon esprit, voilà ma magie et mes
charmes.» Vous ne trouverez plus, dans aucun orateur quel
qu'il soit, ce ton simple et naturel, ce goût des arguments
vrais. Quant au fond du débat, je renvoie les curieux
soit à Apulée, soit à Bayle, qui dans son Dictionnaire
critique s'est livré avec amour à l'examen du point en
question : c'est un chef-d'oeuvre d'analyse pénétrante,
je dirais presque sensuelle. Le style des Métamorphoses est singulièrement chargé de néologismes et d'archaïsmes ;
c'est du punique déguisé en latin ; mais l'auteur est parvenu
à l'âge de trente ans, il a passé à Rome de laborieuses
années, il plaide sa propre cause : son style est
épuré, sa diction élégante sans trop d'affectation : il ne lui manque que la mesure. C'est la qualité impossible à
acquérir dans les époques de décadence. Je ne dirai
que quelques mots des autres ouvrages d'Apulée. Ils
n'ont rien de cette originalité qui recommande les
Métamorphoses, et l'Apologie ; je les appellerais volontiers
des résidus de lectures. Les Florides sont des extraits
de morceaux oratoires destinés à produire de l'effet; on
les enchâssait dans une plaidoirie, comme on pouvait; c'était
un lambeau de pourpre pour éblouir. Les traités
philosophiques sur les Dogmes de Platon, (De dogmate
Platonis libri tres), sur le Monde (De mundo), sur Hermès
Trismégiste (De natura Deorum Dialogus), ne sont
que des traductions ou des amplifications de textes grecs.
Parmi ces fragments on trouve des vers, des discours,
des ébauches de compositions historiques. Cet esprit curieux,
fouilleur, sétait tourné de tous les côtés. Combien
il diffère par là de ses contemporains qui vivent plongés
et abêtis dans l'étude des vieilles formes du langage, incapables
de penser et croyant écrire !
Les Panégyriques et les Historiens.
§1.
LES PANÉGYRIQUES.
L'éloquence, bien que toujours enseignée et étudiée
dans toutes les parties de l'empire, mais particulièrement
dans les Gaules et dans l'Italie du nord, ne produisit
dans les trois derniers siècles de l'empire d'Occident
que des rhéteurs et des harangues officielles. Le nombre
en fut probablement considérable, car les empereurs
se succédaient, se renversaient avec une grande rapidité
: c'est à peine si les orateurs avaient le temps de
célébrer le vainqueur et d'insulter le vaincu qu'ils
avaient célébré la veille. Mais de bonne heure les amateurs
de ces sortes de monuments firent un choix : aussi
ne possédons-nous que douze panég yriques. C'est assez
pour apprécier en connaissance de cause cette branche de
la littérature impériale.
Les anciens panégyriques(panegyrici veteres) célèbrent
les vertus de Dioclétien et de Maximien, de Constance
et de Constantin, de Julien, de Gratien et de Théodose.
Quant aux auteurs, la plupart d'entre eux sont restés
parfaitement inconnus. Le nom d'Ausone seul a survécu,
parce que Ausone a fait autre chose : quant aux deux Mamertins, à Euménius, à Nazarius, à Drépanius, ils
n'ont laissé dans l'histoire et dans la littérature d'autre
trace de leur passage que ces harangues mêmes. Je serai
fort bref à ce sujet.
Si l'on envisage ces panégyriques au point de vue historique,
on ne peut les considérer comme une source
bien abondante ni bien sûre. Ils ne sont pas cependant
sans importance. On sait combien l'histoire du quatrième
siècle est obscure, à la fois par le manque de documents
et par le caractère même des documents souvent contradictoires
: la translation de la capitale à Constantinople,
la lutte de plus en plus vive entre le christianisme et
le paganisme, entre le christianisme et l'arianisme, les
pérégrinations incessantes des empereurs et les sanglantes
révolutions qui étaient comme la loi de ce temps
misérable, en un mot une anarchie universelle qui dura
plus de cent ans : voilà le tableau que présente ce siècle
si tourmenté et si fécond cependant. On essayerait en
vain d'en reconstituer la physionomie à l'aide des panégyriques.
C'est à peine si çà et là on peut recueillir un
trait significatif, un détail intéressant dans le fade écoulement
d'adulations banales. Ce qui m'a le plus frappé
au milieu de cette stérilité de mort, c'est le silence
absolu de chacun des orateurs sur le christianisme. Ainsi
l'un de ces panégyristes (l'auteur de la huitième harangue,
il n'est pas nommé) raconte dans les plus grands
détails la fameuse victoire remportée par Constantin sur
Maxence, et il ne fait pas la moindre allusion au fameux
labarum qui parut dans les airs avec l'inscription :
Hoc signo vinees. Nazarius, autre panégyriste, passe
aussi sous silence ce merveilleux incident ; et ce qui
rend plus étrange cette omission, c'est la relation d'un autre miracle qui assura aussi la victoire à Constantin : des escadrons célestes vinrent se joindre à ses troupes.
L'orateur rapproche cette intervention surprenante
de l'apparition de Castor et de Pollux, qui combattirent pour les Romains à la bataille du lac
Régille, et il ajoute : le miracle fait en faveur de Constantin
nous oblige à croire celui de l'apparition de
Castor et de Pollux. Puissamment raisonné ! Autre
détail non moins curieux : Ausone, qui était peut-être
chrétien, loue la piété de son élève Gratien, qui avait
décerné les honneurs divins à Valentinien, son père. On sait du reste que
Gratien, bien que chrétien, prenait encore le titre de
Pontifex maximus, l'administration des choses de la
religion était toujours une fonction de l'empereur.
L'auteur du panégyrique de Julien, un des deux Mamertinus,
écrivain qui n'est pas sans mérite, ne dit pas un mot
de ce que nous appellerions aujourd'hui la question religieuse.
Il semble appartenir lui-même à cette élite
de la société païenne de ce temps, qui ne voulait
point paraitre acheter la faveur du prince au prix d'une
conversion sans sincérité. Elle restait donc attachée,
au moins de nom, à la vieille religion nationale; mais
elle avait cessé depuis longtemps d'y croire. La religion
pour elle était une forme populaire et inférieure de la
philosophie. Je trouve dans Mamertinus cette phrase bien
remarquable : « J'atteste Dieu immortel, et ce qui me
tient lieu de la divinité, ma sainte conscience. » Enfin, dans le dernier de cep panégyriques,
celui de Théodose par Drépanius, l'orateur,
après avoir chanté la défaite de Maxime, s'indigne de la bassesse, de la cruauté, de la cupidité de ces évêques
qui faisaient leur cour à l'usurpateur, et l'aidaient de
leurs anathèmes contre les Priscillianistes, dans ses
extorsions et ses exécutions. Il les représente de ces
mêmes mains qui avaient manié les instruments de torture,
touchant les objets sacrés. Ici l'orateur se rencontre
avec Sulpice Sévère, qui a raconté deux fois ce
lugubre épisode.
Tous ces renseignements ne jettent pas un grand jour
sur cette époque. Il faut y joindre les détails qu'on
rencontre çà et là sur les misères et les dangers incessants
qni menaçaient l'empire. Les orateurs dont nous
parlons félicitent parfois les princes de leur humanité
envers leurs peuples. Les remises d'impôts étaient la
forme la plus agréable sous laquelle elle pût s'exercer.
Ausone raconte avec plus d'esprit que de sérieux une
scène bien curieuse dont.Gratien est le héros. Ce prince
exempta des arrérages à payer toutes les provinces de son
empire; et, se fiant peu à la générosité de ses successeurs,
il voulut les mettre dans l'impossibilité de révoquer ce
qu'il faisait : il ordonna en conséquence que tous les
registres d'impôts fussent brûlés sur les places publiques.
C'était une des plaies de l'empire ; les invasions
des barbares, la révolte des Bagaudes en Gaule,
en furent d'autres ; on en trouve de vifs souvenirs retracés
par quelques-uns de ces panégyristes, sous de
fausses couleurs, il est vrai; mais leurs aveux, si adoucis
qu'ils soient, jettent de la lumière sur les ténèbres de
ces temps malheureux.
Quant au mérite littéraire de ces compositions, il est à
peu près nul. J'ai signalé dans l'examen du panégyrique
de Trajan par Pline, les inconvénients inévitables du genre. Cependant Pline parle en homme convaincu;
c'est un bon citoyen qui célèbre les vertus
réelles du prince, une félicité relative dont l'empire lui
est redevable. Rarement les panégyristes eurent cette
bonne fortune. Les empereurs qu'ils louent ne sont pas
des Trajans; souvent la matière est fort ingrate : de là, la
nécessité de suppléer à la pauvreté du sujet par les ornements
du langage. L'antithèse et l'hyperbole sont les
grandes ressources de ces orateurs officiels. Ils opposent
les crimes ou les vices du prédécesseur aux vertus et aux
belles actions du prince régnant, et ils exagèrent dans
les deux sens ; souvent même ils évoquent les souvenirs
de la Rome républicaine pour en faire litière à leur maître.
Cette profanation est, à vrai dire, ce qu'il y a de
plus triste; car, pour le reste, tout est si vide, si plat et
si prétentieux à la fois, que l'on n'a pas le courage de s'en
indigner.
§ II.
LES HISTORIENS DE L'HISTOIRE AUGUSTE.
Nous possédons, sous le litre d'écrivains de l'histoire
Auguste, un recueil de
biographies d'empereurs, d'Hadrien à Carus et à ses fils
(117-285). L'auteur de ce recueil est inconnu. Il semble
avoir voulu, en réunissant ces vies des Césars, donner une
suite à Suétone ; mais les biographies de Nerva et de
Trajan manquent au commencement, et, dans le milieu
de l'ouvrage, celles des Philippes et des Décius, et une
partie de celle de Valérien. Telle qu'elle nous est parvenue,
cette compilation, presque nulle sous le rapport littéraire, est d'une certaine importance au point de
vue historique. Cette longue et confuse période pleine de
guerres, d'anarchie, de désordres de tout genre, ne nous
est guère connue que par l'histoire Auguste. L'auteur a
fait parmi les nombreuses biographies des empereurs un
choix quelconque, et les a rangées dans l'ordre qu'il lui
a plu. Quant aux biographies elles-mêmes, elles n'ont
pas été écrites par des témoins occulaires ou contemporains,
si l'on en excepte Vopiscus. Tous ces historiens,
personnages obscurs pour la plupart, sont de plats et
inintelligents imitateurs de Suétone. Aucune considération
élevée, aucun sens politique, rien de général ni de
romain ; le monde entier est pour eux renfermé dans
l'intérieur du palais impérial. Ce qu'ils nous apprennent,
ce sont de petits détails, des particularités de la vie intérieure
; ils ne se doutent même pas que la véritable
histoire du monde romain à cette époque se passe non
dans les appartements de ces Césars renversés l'un sur
l'autre, mais dans les provinces qui les élèvent, sur les frontières
que les barbares vont envahir, ou au sein de cette
société chrétienne que la persécution rend chaque jour
plus puissante. Heyne à dit d'eux : « Les écrivains de l'histoire Auguste sont indignes du nom d'historiens: ce sont des abréviateurs et des compilateurs d'écrivains qui eux-mêmes ne doivent pas être salués du nom d'historiens ; ils n'ont en effet farci leurs ouvrages que de vains bruits populaires. » Ainsi, d'une part, l'inintelligence
du temps, de l'autre, un manque absolu de critique
et d'exactitude, des erreurs grossières, des répétitions
parfois contradictoires, quand ils empruntent à
deux auteurs différents le récit d'un même événement,
sans se donner la peine de choisir l'une des deux versions: voilà pour nous à peu près la seule source historique
pour une période de près de 160 ans. Quant à leur
style, il est souvent incorrect et inintelligible, toujours
fort médiocre. Ils ne s'en soucient point d'ailleurs.
On ne le voit que trop.
Voici l'ordre dans lequel ils sont rangés.
Aelius Spartianus. Il vivait sous Dioclétien, à qui
son livre est adressé. Il s'est proposé d'écrire l'histoire,
d'abord pour satisfaire à sa conscience, ensuite pour soumettre à la connaissance
de la divinité du prince les empereurs. Il avait, à ce qu'il
paraît, l'intention d'écrire l'histoire de tous les empereurs;
on ne sait s'il a donné suite à ce projet. On a de
lui les vies d'Hadrien, d'Ælius Vérus, de Didius Julianus,
de Sévère, de Pescennius Niger, d'Antonin Caracalla, de Geta, cette dernière dédiée à Constantin.
Vulcatius Gallicanus vivait aussi sous Dioclétien. Il
avait comme Spartianus conçu un plan plus vaste d'historiographie,
qui ne fut pas mis à exécution. Il ne reste de lui que la vie
d'Avidius Cassius, que Fabricius lui a même enlevée
pour l'attribuer à Spartianus. Vulcatius est incorrect et
sans ordre.
Trébius ou Trébellius Pollio, contemporain de Dioclétien
et de Constantin, est quelque peu supérieur aux deux
précédents. Il reste de lui les vies de Valérien père et fils,
des deux Galliens, les Trente Tyrans et Divus Claudius.
Flavius Vopiscus, de Syracuse, vivait sous Constantin ; son père et son grand-père étaient amis de Dioclétien. Ils
furent témoins de l'entrevue du futur empereur avec la
druidesse qui prédit le meurtre d'Aper. Il a écrit les
vies d'Aurélien, de Tacite, de Florianus, de Probus, de
Firmus, de Saturninus, de Proculus, de Bonasus, de Carus,
de Numerianus et de Carin. Il s'était proposé en
outre de raconter la vie d'Apollonius de Tyane. Vopiscus est d'un degré supérieur
aux autres biographes. Plus voisin des événements
et dans une position qui lui permettait de les mieux
apprécier, il mérite plus de crédit qu'aucun d'eux.
Mlius Lampridius a écrit les vies de Commode, de
Diaduménus, d'Héliogabal, d'Alexandre Sévère.
Julius Capitolinus est auteur des biographies d'Antoninus
Pius, de Marc-Aurèle, de L. Vérus, de Pertinax,
d'Albinus, de Macrin, des deux Maximins, des Gordiens,
de Maxime et de Balbinus.
Les derniers historiens de la fin du quatrième siècle
sont Sextus Aurélius Victor, Eutrope, Sextus Rufus,
et enfin Ammien Marcellin. Le dernier seul mérite d 'être
consulté. Sextus Aurélius Victor, Africain d'origine
et d'une naissance obscure, fut élevé par Julien aux plus
hautes dignités de l'empire, et nommé par Théodose
préfet de Rome. C'était un païen fort honnête homme.
Ammien Marcellin en fait le plus grand éloge. De ses
ouvrages qui embrassaient toute l'histoire romaine jusqu'à
son temps, nous ne possédons plus que de véritables
abrégés dont il a fourni les matériaux, mais dont il
n'est peut-être pas l'auteur. Tel est le livre intitulé Origo
gentis Romanae, qui est probablement 1'oeuvre d'un
grammairien, qui a imaginé cette espèce d'introduction à l'histoire de Rome. L'ouvrage, qui porte le titre : De
viris illustribus urbis Romae, a été attribué à Cornélius
Népos, à Suétone, à Pline le jeune. Une histoire abrégée
des Césars (de Caesaribus historiae abbreviatae pars altera)
semble composée d'après des sources assez pures.
Et enfin,l'ouvrage intitulé: De vita et moribus imperatorumromanorum epitome ex libris Aurelii Victoris à Caesare Augusto ad excessum Theodosii imperatoris, est
un extrait d'Aurélius Victor, dont l'auteur est inconnu.
Une certaine indépendance s'y fait remarquer, et le
style de ces divers ouvrages est en général assez pur.
Eutrope fut un personnage considérable sous les
règnes de Constantin, de Julien et de Valens. Il fut
consul, secrétaire des empereurs, suivit Julien dans
son expédition contre les Parthes. Mais ce n'est pas un
personnage politique. Il est appelé Sophiste, par les
autres historiens. On sait qu'à cette époque, en Orient
comme en Occident, les rhéteurset les sophistes jouissaient
d'une haute considération. On a cru qu'il était chrétien
; le contraire est à peu près certain. Comme beaucoup
de bons esprits de ce temps, il était détaché du paganisme
sans avoir embrassé le christianisme. Il dit de
Julien : « religionis christianae inseetator, perinde tamen ut cruore abstineret. » C'est le jugement d'un
esprit sensé et impartial. Eutrope a écrit un abrégé de
l'histoire romaine en
dix livres, qui vont de la fondation de Rome à Valens.
Il paraît que cet empereur fort ignorant lui avait commandé
cet ouvrage pour sa propre instruction ; c'est une
sorte de manuel. Eutrope se promettait d'écrire pour la
postérité une histoire considérable de Rome;
on ne sait s'il a exécuté son dessein. L'abrégé d'Eutrope fut accueilli avec la plus grande faveur; il s'en
fit plusieurs traductions grecques ; les auteurs ecclésiastiques,
Jérôme, Prosper d'Aquitaine, Orose, et les faiseurs
de chroniques des premiers siècle du moyen âge le
copièrent et l'étudièrent comme source unique. Le style
d'Eutrope est généralement pur et simple, rare mérite
dans ce temps-là.
§ III.
AMMIEN MARCELLIN.
Avec Ammien Marcellin, nous sortons des puérilités
de la biographie anecdotique, et nous rentrons dans le
domaine de l'histoire. Nous ne savons rien de précis sur
ce personnage. Il est né probablement à Antioche ; il
appartient à une bonne famille; il passa la plus grande
partie de sa vie dans les camps, et mourut vraisemblablement
à Rome, où il s'était retiré en quittant le service
militaire. Il eût pu écrire des mémoires, car il fut témoin
oculaire des principaux événements qu'il rapporte ; mais
il ne se met jamais en scène; il ne lui arrive jamais
rien d'extraordinaire, il est vainqueur ou vaincu comme
le dernier de ses compagnons d'armes ; il n'accuse jamais
les chefs de ne pas savoir distinguer le mérite ; il
ne se vante jamais d'avoir donné au général un conseil
qui eût sauvé l'armée. En un mot, l'histoire d'Ammien
Marcellin se présente à nous avec tous les caractères de
la plus franche impartialité ; de plus l'auteur ne parle
que d'événements dont il a été le témoin, ou qu'il connaît
d'après les documents les plus authentiques.
Ammien Marcellin avait écrit l'histoire de Rome, depuis
la mort de Nerva jusqu'à celle de Valens (96-378). Mais les treize premiers livres, qui allaient de Trajan à
Constance, ont péri. Nous ne possédons que les dernières
années du règne de Constance, ceux de Julien, de Jovien,
de Valentinien Ier et de Valens, en tout une période d'environ
vingt ans, racontée en dix-sept livres, donc avec
beaucoup de détails, ce qui nous autorise à penser que la
partie perdue ne devait guère être qu'une sorte de résumé.
L'ouvrage d'Ammien Marcellin est la source la plus
précieuse que nous ayons pour étudier une des époques
les plus intéressantes de l'histoire du monde. A vrai dire,
il est le seul écrivain de ce temps dont le témoignage ait
une sérieuse autorité. Il n'est pas difficile d'en donner la
raison. Les historiens qu'on appelle ecclésiastiques,
Eusèbe, Socrate, Sozomène, Théodoret, et les autres,
sont des chrétiens plus ou moins intelligents (ils le sont
fort peu en général), et qui ne s'intéressent qu'aux événements
qui touchent directement au christianisme ; à les
lire, on croirait que les empereurs n'ont absolument agi,
parlé, pensé, commandé, que pour servir ou combattre
la religion chrétienne. Ils sont doux et partiaux
pour les orthodoxes, sottement calomniateurs envers les
hérétiques et les païens. Ils traitent Julien d'une façon
qui serait odieuse, si elle n'était ridicule : mais aujourd'hui
encore il y a des gens qui croient, ou font semblant
de croire à l'honnêteté et à l'intelligence de ces chétifs
auteurs, et se dispensent d'être équitables parce que les
contemporains ne l'ont pas été. Quant à Zosime, le seul
auteur païen de cette même période, il est suspect de
partialité contre les chrétiens, mais c'est un autre esprit
que ceux dont j'ai parlé. Reste donc notre Ammien Marcellin,
écrivain d'une intelligence suffisante, et d'une
impartialité manifeste. En effet, il n'est ni chrétien ni païen; c'est, comme on
disait au siècle dernier, un philosophe.
Ceux qui ont songé à en faire un chrétien, ne l'ont pas
lu sérieusement. Jamais un chrétien ne se fût exprimé de
la sorte sur l'empereur Julien. A vrai dire, c'est le héros
d'Ammien; il l'admire, il l'aime; c'est avec un véritable
désespoir qu'il est forcé de lui trouver quelques défauts,
mais la vérité avant tout. Il blâmera donc dans l'empereur
ce fameux décret qui interdisait l'enseignement aux
chrétiens; il blâmera ces sacrifices incessants, ces pratiques
de dévotion puérile, en un mot tout ce qui jette une
ombre fâcheuse sur cette noble figure du jeune stoïcien ;
il aime à le comparer à Marc-Aurèle, sur lequel évidemment
Julien voulut se régler. Il le représente faisant
tous ses efforts pour imposer aux chrétiens la tolérance
envers leurs dissidents, c'est-à-dire l'anarchie
dans l'Eglise, adroite politique qu'ils ne lui ont pas
pardonnée. Un chrétien eût parlé tout au long de la
fameuse question de l'Arianisme qui remplit ce siècle;
Ammien ne s'en occupe pas. Enfin un chrétien ne nous
eût pas montré Damase et Ursin se disputant l'évêché
de Rome à main armée, remplissant les rues de cadavres,
et surtout n'eût pas ajouté que la chose était toute
simple, car l'évêque de Rome recevait beaucoup de cadeaux
des matrones et vivait fort opulemment. II est inutile
de pousser plus loin cette démonstration, le fait est
trop évident.
Ce n'est pas un païen non plus, ai-je dit. Les croyances
religieuses d'Ammien Marcellin sont assez difficiles à déterminer.
Il ne croit plus aux dieux du vulgaire, ni au Tartare,
ni à toutes les vieilleries du culte national ; il s'en faut cependant que ce soit un esprit libre de préjugés. Il
ne dit plus « les dieux » ni Jupiter, Mars, Junon ;
il dit tantôt la divinité (superum numen), tantôt la justice,
tantôt la fortune (Fortuna, fatum.) Il croit à
l'action du destin, ce qui ne l'empêche pas d'admettre
l'action de la Justice souveraine. Mais ce qui domine en
lui, c'est sa croyance à la divination : c'est la grande maladie
morale du quatrième siècle. Dans la ruine des
croyances nationales, cela seul subsista, et avec une
énergie que rien ne put abattre. Tous, grands et petits,
sages et vulgaire, empereur et sujets, étaient tendus vers
l'avenir, et voulaient lui arracher ses secrets. Tout
homme qui consultait les devins était suspect au prince;
il leur demandait s'il ne serait pas bientôt empereur. De
tous côtés, en effet, s'éveillaient des ambitions, des convoitises,
des hallucinations impériales. Aussitôt des perquisitions
étaient faites ; on découvrait, ici, un manteau
de pourpre, là, des brodequins, un diadème ; les exécutions
commençaient; elles remplissaient les villes de
sang. L'empereur voulait tuer celui qui rêvait sa succession.
La prétendue conspiration de Théodoros inonda
l'Orient de carnage. Ammien croit que la puissance
supérieure, éternelle et par conséquent connaissant
l'avenir, peut communiquer à un mortel une partie de sa
connaissance. Chez lui le politique et le soldat valent mieux que le
théologien. Il porte sur les divers princes qui ont passé
sous ses yeux des jugements sérieux, bien motivés, impartiaux,
et s'applique à dire le bien et le mal, ne dissimulant
rien, et laissant au lecteur le soin de conclure. Il
ne s'est pas proposé de présenter un tableau complet de
l'empire romain au quatrième siècle, et l'on signalerait
dans son ouvrage plus d'une lacune ; cependant les traits
dominants qui caractérisent cette époque y sont fortement
dessinés. Les questions d'administration intérieure
étaient devenues secondaires pour ainsi dire : il s'agissait
en effet pour l'empire d'être ou de n'être pas. Les barbares
ne laissaient aucune trêve aux princes. En Orient,
les Arméniens, les Perses; sur le Danube les Quades,
les Marcomans, les Sarmates; sur le Rhin, les Allemands
et les Francks, les Bretons eux-mêmes; puis les Goths,
bientôt suivis des Huns, des Alains, des Suèves. Les empereurs étaient brusquement appelés de l'Orient à l'Occident,
du Nord au Sud par les provinces envahies, dépouillées,
mises à feu et à sang. Ammien Marcellin a
combattu sur le Rhin, sur le Danube, dans les plaines de
la Mésopotamie ; il a été vainqueur près d'Argentoratum,
il a assisté aux désastres d'Amida et d'Andrinople ;
Julien est mort sous ses yeux, il a vu la maison où Valens
a été brûlé ; il a échappé avec quelques soldats au glaive
des Perses maîtres d'Amida. Toutes ces campagnes sont
racontées par lui avec une grande sincérité ; le récit est
intéressant, un peu forcé de couleur et cherchant le dramatique, mais de fort beaux épisodes se détachent du
cadre général, et produisent une impression forte. Je signalerai
la mort de Julien, le traité conclu avec les Perses
par Jovien, la bataille d'Argentoratum, celle d'Andrinople,
le meurtre du roi d'Arménie, Para. Quant à la critique
des événements, elle est généralement saine et honnête. Ammien Marcellin est sévère dans ses jugements
sur les courtisans et les créatures des empereurs ; il a
tracé de quelques-uns d'entre eux des portraits d'une
rare énergie. C'est un honnête homme indigné qui flétrit
des scélérats et des fripons. Le nombre en était grand.
L'administration de Rome délaissée par les empereurs
était entre les mains de préfets tout puissants jusqu'au
jour où un caprice du prince, une délation, une
crainte superstitieuse, les renversaient. Le tableau que
trace Ammien des moeurs romaines vers 370 est fort instructif,
mais lamentable. Les nobles, la bourgeoisie (représentée
par les avocats) et le peuple sont tour à tour
mis sous nos yeux et dépeints sous les plus sombres couleurs.
Le Sénat n'a plus qu'un semblant d'existence;
c'est le délégué de l'empereur absent qui est tout, et il
règne d'après les lois du bon plaisir. L'historien n'invoque
pas l'antique liberté perdue; il se borne à exiger des
hommes en dignité un peu de désintéressement et d'honneur,
qualités fort rares alors. C'est un moraliste sans
rigorisme, ce qu'on appelle un honnête homme. Ce qui
excite son indignation, ce sont les lâchetés, les perfidies.
Plus d'une fois les généraux romains y avaient recours
dans les périls extrêmes où se trouvait placé l'empire.
Le préfet du prétoire, Trajan, invite à sa table le roi
d'Arménie, Para, et le fait assassiner sous ses yeux.
Ammien est révolté de ce guet-apens odieux ; il rappelle la générosité des anciens Romains, la belle lettre de Fabricius
à Pyrrhus pour lui dénoncer la trahison de son
médecin. Mais parfois il est plus indulgent, et semble
accepter l'axiome immoral «dolus an virtus, quis in
hoste requirat ? » il appelle «mesure sage » le massacre d'une troupe de Goths appelés sous
prétexte de recevoir leur paye.
Tel est l'esprit de l'ouvrage ; je dirai peu de chose de
la composition et du style. L'auteur a essayé de présenter
un récit fidèle des événements ; mais le théâtre est
trop vaste, la scène change trop souvent. L'unité du sujet
échappe à l'historien ; elle est réelle cependant, un mot
la résume : décadence. La confusion est partout ; il ne
reste plus rien des antiques traditions ; les empereurs
sont pris au hasard, par les armées en campagne ; l'empire
est comme un avancement. Rome n'est plus la capitale
de l'État romain; il n'y a plus de capitale, partant
plus de centre, plus de direction unique, plus de suite
dans la politique. On vit au jour le jour. Cette confusion
se trouve dans l'ouvrage d'Ammien Marcellin; Gibbon
lui-même n'y a pas échappé. Mais si l'on prend telle ou
telle partie de l'oeuvre, soit une expédition contre les
Allemands, soit une guerre contre les Perses, on ne peut
que louer l'ordonnance du récit, la proportion des diverses
parties, la gradation, l'intérêt. Les digressions
nombreuses et généralement très faibles, auxquelles se
livre l'auteur, sur les tremblements de terre, les comètes,
les avocats, sont des hors-d'oeuvre qu'il est difficile de
goûter. Il sait beaucoup, croit savoir, et n'a que des notions
vulgaires et erronées. C'est un soldat qui s'est mis
tard au travail et dont le jugement a été peu exercé.
Quant au style, c'est le traiter avec indulgence que de dire qu'il est dur ; il est affecté, emphatique, souvent barbare.
Il y a des élégances qui font frémir. Ammien ne dit
pas l'exil, mais le chagrin de l'exil (moeror exsularis) ; il ne dit pas la relégation dans une île, mais la solitude
insulaire (exsularis solitudo). Va-t-il raconter une
guerre, il dit: « cependant la roue rapide de la fortune,
a changeant toujours la prospérité en malheur, armait Bellone en lui adjoignant pour compagnes les Furies. » En général, lorsqu'il se laisse entraîner à quelque réflexion
philosophique, son langage revêt une teinte de
barbarie très prononcée ; quand il se borne à raconter,
il est plus simple, mais il écrit toujours mal.
Tel qu'il est, il est intéressant à lire, et son autorité
n'est pas médiocre.
§ IV.
SYMMAQUE.
Symmaque est le dernier orateur qu'ait produit la
société antique. On voudrait qu'en disparaissant, le génie
romain se recueillît et jetât par un dernier effort quelque
oeuvre puissante ; il n'en est rien. Après avoir longtemps
langui, il s'éteint comme un feu sans aliments. Quelle
inspiration possible pour un peuple qui n'a plus ni vie
politique ni vie religieuse?
Ce qui a sauvé le nom de Symmaque de l'oubli où sont
tombés tous ses contemporains, ce ne sont pas les nombreuses
harangues qu'il faisait admirer aux sénateurs; ce
n'est pas même le recueil de ses lettres divisées en dix
livres et publiées avec un soin pieux par son fils : c'est
une requête adressée à Théodose, et qui fut presque aussitôt
vivement réfutée par l'évêque de Milan, saint Amhroise, et par le poête chrétien Aurélius Prudentius
Clemens. Cette requête peut être considérée comme la
suprême et impuissante protestation de la Rome païenne
contre le christianisme.
Ce n'est pas un médiocre honneur pour Symmaque
d'avoir pris la défense du culte et des institutions nationales
dans un moment où il y avait plus de péril que
de profit à le faire. Mais Symmaque n'était pas une âme
vulgaire, et, de plus, il avait été comme préparé et désigné
pour cette tâche par l'éducation qu'il avait reçue et
la position qu'il occupait. J'ai montré avec quelle ardeur,
parfois puérile, Pline le Jeune refaisait dans son imagination
la vie publique qui n'était déjà plus qu'une ombre ;
quelle importance il attachait à ces séances du Sénat qui
étaient une vaine parade ; quel sérieux il apportait dans
l'accomplissement de ses fonctions exercées sous la survellance
d'un empereur ; avec quelle naïveté il établissait
des rapprochements impossibles entre son temps et
celui de Cicéron : c'est que, si tout avait changé, l'éducation
d'alors préparait toujours le jeune Romain à la vie
publique d'autrefois. Il s'en faut bien que Symmaque ait
toutes les illusions de Pline, son époque ne le permettait
pas ; mais, lui aussi, il est comme dominé par les traditions
antiques; et, malgré les cruels démentis des faits, il se
rejette sans cesse vers ce qui a été, et ne peut s'empêcher
d'en souhaiter, d'en espérer même le retour. Cicéron
était le modèle et l'idéal de Pline ; Pline est le modèle
et l'idéal de Symmaque : tous deux se repaissent d'illusions.
Symmaque a rempli les charges les plus considérables
de la république (on parlait encore ainsi) sous les règnes de
Gratien, de Valérien, deValentinienet, de Théodose; il a été préfet de Rome en 384, consul et grand pontife en 391.
Suivant Cassiodore, il aurait composé un panégyrique en
l'honneur de Maxime, l'usurpateur, et l'aurait prononcé
en plein Sénat, ce qui l'exposa à une accusation de lèse-majesté
à laquelle il n'échappa que par la clémence de
Théodose. Le fait n'est pas impossible, surtout si on se
rappelle que Maxime se présentait comme le restaurateur
de la vieille religion nationale. Quoi qu'il en soit, Symmaque
survécut. à Théodose et ne mourut probablement
que dans les premières années du 6° siècle.
Le recueil de ses lettres offre bien peu d'intérêt. On
ne s'explique guère une si absolue indigence d'idées et de
sentiments. Il est probable que son fils, qui s'en fit l'éditeur,
retrancha toutes celles où ce païen obstiné exprimait
son opinion sur les hommes et les choses de son temps.
La matière était riche ; chaque jour amenait des conversions
au christianisme, et l'on ne sait que trop ce que
valaient souvent ces conversions ; Symmaque était bien
placé pour en apprécier la sincérité : « s'éloigner des
autels, dit-il quelque part, c'est une manière de s'avancer.
» On regrette de ne pas trouver plus d'indications de
ce genre dans la correspondance qui nous est parvenue,
et qui doit avoir été modifiée. Ces détails, qui eussent été si
intéressants, sont remplacés par des pauvretés : tel livre
tout entier ne renferme que des lettres de recommandation,
des billets plus ou moins bien tournés; ailleurs, ce
sont les menus événements de sa vie privée, à Rome, en
Campanie, dans quelqu'une de ses nombreuses villas. Les
moins vides de ces lettres sont celles où il se montre
préoccupé de ses fonctions de consul ou de préfet; la tâche
était souvent bien pénible : il fallait nourrir et amuser
le peuple romain. Aussi l'annone d'une part, de l'autre, les jeux publics, tenaient sans cesse en éveil les
malheureux magistrats.
La requête adressée aux empereurs fut justement
inspirée par une circonstance de ce genre. L'an
384, il y eut une famine. Symmaque, alors préfet, et
chargé de l'approvisionnement de la ville, ne put faire
venir de l'Afrique qu'une quantité fort insuffisante de blé;
il fallut attendre quelque temps l'arrivage d'une flotte
apportant les blés de la Macédoine. Or, l'année précédente,
l'empereur Gratien avait fait enlever du Sénat
l'autel de la Victoire, ce symbole visible de la gloire de
Rome dominatrice du monde. Aussitôt et la multitude et
un grand nombre de sénateurs s'écrièrent que les malheurs
de l'empire, les disettes, les invasions des barbares
étaient un châtiment envoyé par les dieux dont on avait
abandonné le culte. Rien de plus conforme aux idées
romaines : on peut voir dans Tite-Live le discours si curieux
de Camille après la prise de Véies, discours où il
explique les succès et les revers de Rome par la scrupuleuse
observance ou par l'omission des rites consacrés.
Symmaque se fit à plusieurs reprises, sous Gratien d'abord,
puis sous Valentinien, l'interprète de la croyance
populaire: il demanda le rétablissement de l'autel de la
Victoire d'abord, puis la reprise de toutes les cérémonies
du culte national que les princes chrétiens n'osaient pas
encore proscrire, mais qu'ils laissaient tomber en désuétude.
Le sujet était beau, favorable à l'éloquence. Qu'était-ce
en effet que le christianisme d'alors, religion qui n'avait
rien de national, qui ne se rattachait par aucun lien à
l'histoire de la patrie, auprès de l'antique culte institué par Romulus, par Numa, et qui remontait même jusqu'aux
dieux par Énée, le fondateur de la cité? Ce culte,
on en retrouvait la trace vivante dans tous les souvenirs
héroïques de Rome; le premier empereur, politique,
avisé, en avait multiplié les cérémonies et accru la
splendeur, tandis que ses poètes les Horace, les Virgile,
les Ovide en célébraient l'incomparable majesté. Tant
que le peuple romain était resté fidèle aux prescriptions
de la religion antique, il avait exercé sur les nations soumises
une domination paisible. Les premiers revers essuyés
dataient justement de l'expansion du christianisme.
Voilà ce que devaient se dire les païens convaincus, voilà
ce que pensait certainement Symmaque; mais il n'osa
pas exprimer toute sa pensée. La meilleure, la seule
efficace manière de plaider pour le culte ancien, c'était,
en le glorifiant, d'attaquer ouvertement et sans scrupule
le christianisme. Encore une fois la religion nouvelle n'avait
pas de racines dans la cité ; au fond, la cité lui était
indifférente. Le temps était proche où saint Augustin
opposerait à la vieille Rome prise par Alaric, la ville céleste,
véritable et seule patrie du chrétien. Il fallait avoir
le courage de condamner hautement le christianisme
dans ses dogmes, dans sa constitution et surtout dans son
esprit; de prouver qu'il faisait des saints et non des citoyens
; que la patrie n'avait rien à attendre de lui dans
les périls qui la menaçaient; que les vainqueurs, quels qu'ils fussent, seraient toujours bien accueillis des chrétiens.
En plaidant ainsi la cause du culte national, Symmaque
eût échoué, cela est certain : mais il échoua en la
plaidant en avocat honteux, incertain, qui se tient sur la
défensive au lieu de pousser vivement son adversaire. Il
ne sut pas, il n'osa pas affronter un débat solennel, faire un dernier et éclatant appel au gouvernement d'une part,
mais surtout au Sénat et au peuple romain. Quand on
parle au nom de onze siècles de gloire, quand on est convaincu
que toute cette gloire doit remonter à la religion
comme à son principe naturel, il ne faut pas être humble
et supplier, il faut parler haut et ferme, livrer le dernier
combat et mourir. Symmaque était incapable de cet héroïsme
: c'était un fonctionnaire. Il voulait bien adresser
une requête aux empereurs, évoquer les glorieux souvenirs
de Rome républicaine, les Gaulois, Annibal, que
l'ombre du Capitole mettait en fuite ; mais la conclusion
naturelle, impérieuse, il n'osait la lancer à la face de ses
maîtres. Il se bornait donc, après avoir prouvé l'excellence
du culte antique, à réclamer, quoi? la tolérance.
C'était une abdication. Et que l'on remarque qu'il avait
pour lui non-seulement les traditions nationales, autorité
imposante, mais la légalité même. C'était en effet au mépris
des lois qu'on affectait à d'autres usages les fonds
destinés au culte ; qu'on interdisait aux vestales de recueillir
des héritages. D'où vient cette faiblesse de l'orateur?
Il était peut-être convaincu de la bonté de sa
cause, mais il avait peur de se compromettre. Les chrétiens
étaient les plus forts ; les empereurs eux-mêmes
devaient compter avec eux. Nous sommes à la veille de
la pénitence publique infligée à Théodose par saint
Ambroise ; et bientôt l'archevêque de Constantinople,
saint Jean Chrysostome tiendra en échec l'empereur Arcadius
dans sa propre capitale. Voilà pourquoi le polythéisme romain fut si faiblement défendu.
La réfutation de saint Ambroise a un tout autre ton ;
elle est triomphante et méprisante. Il n'accorde rien à
Symmaque, ni dans le présent ni dans le passé. Que parle-t-on des dieux protecteurs des Camille et des Scipions,
des dieux qui chassèrent les Gaulois et Annibal ?
C'est le courage des Romains qui a tout fait, les dieux
n'ont jamais existé. L'orateur chrétien n'examine pas si
les anciens Romains croyaient à l'existence de ces dieux,
si la foi profonde qui les animait ne les a pas conduits
cent fois à la victoire. Il condamne, il anathématise, il
annonce le Dieu des chrétiens, le seul vrai Dieu. Comme
jadis Scipion arrachait le peuple aux gradins du tribunal
pour le mener au Capitole rendre grâces aux dieux de la
république, ainsi saint Ambroise repoussait les vaines
doléances de Symmaque, en montrant d'un geste dominateur
le christianisme triomphant.
Les derniers poëtes.
§1.
LES PETITS POETES.
Nous avons montré dans la période précédente ce
qu'était devenue la poésie sous les derniers Césars de la
famille d'Auguste. A partir du règne d'Hadrien, elle n'est
plus qu'un misérable jeu d'esprit ou un moyen plus raffiné
d'adulation. La plupart des écrivains de cette période
sont inconnus; les érudits s'épuisent en recherches
pour déterminer la naissance, la patrie, la position sociale
et souvent même le nom de ces poëtes. Les curieux
trouveront dans Wernsdorff reproduit
par Lemaire, les oeuvres de ce temps, et les détails
biographiques obscurs ou peu satisfaisants, réunis
et peu digérés par cet estimable savant.
Le caractère général des poésies conservées est la stérilité
d'invention ; une des formes sous lesquelles elle le
traduit de préférence, c'est le genre didactique ou descriptif.
C'est ainsi qu'à la fin du dix-huitième siècle, et
sous l'Empire sembla près d'expirer la poésie française,
lorsque d'un brusque élan elle se replongea aux sources
vives. Dans les trois premiers siècles de l'ère chrétienne,
il se produisit un certain nombre de manuels en vers sur la chasse, la pêche, sur les phénomènes célestes, sur la
géographie. Nous possédons le poëme de Némésianus
(qui pourrait bien s'appeler plutôt Olympius), intitulé:
Cynegeticon ; il est fort inférieur à celui de Gratins
Faliscus sur le même sujet. L'astronomie, qui était déjà
fort à la mode deux cents ans auparavant, inspire à un
certain Rufus Festus Avienus, personnage consulaire à
ce que l'on croit, deux poëmes imités ou plutôt traduits
du grec, les Phénomènes et les Pronostics d'Aratus. Ce savant personnage
ne s'en tint pas là ; il emprunta encore à des originaux
grecs la matière de deux poëmes géographiques, intitulés:
Description de l'Univers, et Régions maritimes, absolument dépourvus
d'intérêt, soit au point de vue scientifique, soit
au point de vue poétique.
Un autre poëte du troisième siècle, Caius Julius Calpurnius
Siculus, se livra à la composition de Bucoliques.
Depuis Virgile nul ne s'était essayé dans ce genre ; il y
occupe donc la seconde place, mais à une distance considérable
du maître qu'il imite, disons mieux, qu'il copie
souvent sans pudeur. C'est le même cadre, les mêmes
sujets, les mêmes détails ; toujours des combats de chant
entre deux bergers, ou des plaintes adressées à une infidèle.
La seul innovation que se permette l'auteur, c'est
d'appliquer au règne fortuné de Carus et de ses fils les
descriptions de l'âge d'or qu'il emprunte à Virgile. J'y
trouve cependant quelques détails dont celui-ci ne se fût
pas avisé. Il n'aurait pas osé dire, par exemple : « Le
Sénat enchaîné, marchant au supplice dans un appareil
funèbre, ne lassera plus les bras des bourreaux, et, pendant
que les prisons regorgent, la curie infortunée ne comptera plus le petit nombre de ses membres. » Mais
les souhaits du poëte, ses supplications à l'empereur pour
qu'il veuille bien ne pas devenir dieu trop tôt, c'est la
menue monnaie des poëtes et des orateurs de cour. Combien
les Césars auraient accédé avec empressement à
leurs désirs, s'ils l'avaient pu !
Une de ces églogues se distingue des autres par le
sujet : c'est une description des spectacles de Rome par
le berger Corydon. Cette vision splendide l'a ébloui ;
combien les champs et les bois lui paraissent froids et
mornes désormais! Vous retrouvez ici l'auteur qui chante
la campagne, enfermé dans son galetas. Combien l'autre
thèse eût été plus poétique et plus intéressante !
Après ce triste disciple de Virgile, disons un mot
d'un disciple de Phèdre, Flavius Avianus, personnage
inconnu, qui composa et dédia à un certain Théodose
également inconnu un recueil de quarante deux fables.
Le but d'Avianus, c'est d'offrir à son protecteur
un ouvrage « propre à charmer son esprit, à exercer son imagination, à calmer ses soucis, à le diriger dans la conduite de la vie. » Il est douteux que ce but
ambitieux ait été atteint. Ces apologues sont froids
et secs. La forme élégiaque adoptée par Avianus est peu
propre aux récits. Cette chute monotone des vers, cette
suspension forcée du sens, souvent même de la phrase,
condamne le poëte à je ne sais quoi de heurté et d'écourté.
Ces défauts déjà sensibles dans Phèdre, qui lui
aussi voulait enseigner au moyen de l'apologue ésopique,
sont insupportables dans Avianus. Mais peut-être notre
La Fontaine, si varié, si vif, si éclatant, si pittoresque,
nous rend-il injuste pour ces fabulistes.
Il y eut aussi dans le troisième et dans le quatrième siècle un certain nombre de compositions en vers sur le
jardinage. On se rappelle que Virgile avait laissé de côté
ce sujet, faute d'espace, mais
il avait eu l'imprudence d'ajouter : «je le laisse à traiter
à d'autres ».
Plus d'un effort fut tenté pour combler cette lacune.
Un certain Palladius écrivit un traité en vers sur la
greffe des arbres (de insitionihus arborum) ; il y eut
une foule de petits poëmes sur les Roses, entre autres
une élégie assez gracieuse qu'on attribue à Ausone.
L'auteur qui annonça formellement l'intention d'être le
continuateur de Virgile, est Columelle (L. Junius Moderatus
Columella). Il appartient à l'époque précédente ;
il était contemporain de Sénèque ; et s'il n'est pas un
grand poète, sa diction du moins est assez pure. Il a
composé un grand ouvrage en prose, sans aucune originalité
sur les travaux de la campagne (de re rustica).
Un de ses amis, un certain Silvinus, l'invita à écrire
en vers le dixième livre consacré au jardinage. Columelle
ne se fit pas prier et se mit résolûment à l'oeuvre.
Il est difficile de partager l'admiration du docte Barthius
pour ce travail consciencieux, qu'il qualifie de
naturali venusiate elegans, ni pour le poëte, qu'il déclare
égal aux plus illustres, poetarum primoribus accensendum.
Columelle, comme tous les imitateurs, met
à nu les vices inhérents au poëme didactique, la sécheresse
et la monotonie. Virgile avait échappé à ce grave
inconvénient à force de génie, et surtout parce qu'il avait
le vif et profond sentiment des choses de la nature; Columelle
tombe dans le catalogue. Son jardin est un fouillis
de plantes et d'arbres inextricable ; il énumère, énumère
impitoyablement; seulement il ajoute des épithètes aux substantifs, ce qui crée à ses yeux le style poétique.
Les épisodes sont sans relief, les digressions, visiblement
imitées, n'ont aucune grâce. Il aime les détails crus, immondes;
il enregistre les vieilles recettes malpropres de
151 superstition antique (v. 85, 105-360). C'est un compilateur
et un archéologue. On se rappelle les admirables
descriptions de Lucrèce et de Virgile sur le réveil de la
fécondité au printemps; Columelle a essayé de refaire
ce tableau. Il faut le lire pour se rendre bien compte de
la différence essentielle qu'il y a entre un sec imitateur et
des génies originaux.
§ II.
CLAUDIEN.
Claudien (Claudius Claudianus) termine cette longue
et froide série des poëtes de la décadence. Avant lui
presque rien, après lui, plus rien; nous tombons dans la
pieuse et dure barbarie du Moyen âge. Dans ses vers la
Muse latine jette un dernier éclat ; on pourrait croire à
une renaissance prochaine, c'est un adieu éternel.
Claudien n'est ni un Romain, ni même un Italien,
c'est un Alexandrin; mais son père était sans doute
Romain d'origine, un de ces fonctionnaires qui accompagnaient
les empereurs dans leurs fréquentes tournées.
Il écrivit d'abord en grec, et ne composa ses poëmes en
langue latine que lorsqu'il se fut fixé soit à Rome, soit à
Milan, où résidaient souvent les empereurs d'Occident.
Stilichon, le tuteur d'Honorius, fut son protecteur, et
il s'éleva aux premières dignités de l'empire. Arcadius et
Honorius lui accordèrent une distinction plus flatteuse encore ; ils lui firent ériger une statue dans le forum de
Trajan, avec une inscription fort élogieuse : « Bien que ses vers suffisent à sa gloire immortelle, cependant les très heureux et très doctes empereurs, voulant honorer son dévouement, ont, sur la demande du Sénat, fait élever sa statue dans le forum de Trajan. » Un
distique grec ajoutait que Claudien réunissait en lui
l'esprit de Virgile et la muse d'Homère. Voilà des
princes qui payaient bien les éloges reçus.
La faveur dont jouissait Claudien dura autant que
celle de son protecteur. Quand Stilichon fut renversé
du pouvoir par une de ces révolutions de palais, si communes
alors, Claudien fut sans doute enveloppé dans sa
disgrâce. C'était en 408, il devait alors avoir environ
quarante ans; fut-il tué? fut-il exilé ?on ne sait, mais, à
partir de ce moment, il disparaît pour nous.
C'est un poëte de cour. Tous ses poëmes, sauf deux
essais très pâles d'épopée, sont des poèmes de circonstance.
Il glorifie ses maîtres et ses protecteurs, célèbre
leurs triomphes et leurs mariages, insulte à leurs ennemis
abattus. Pour lui, le monde est renfermé dans l'enceinte
du palais. Il chante Théodose le père des deux empereurs
Arcadius et Honorius,il chante Slilichon le tuteur
d'Honorius, il chante la femme de Stilichon et sa fille qui
doit épouser Honorius. Quant à Arcadius qui règne à
Constantinople, il le célèbre d'abord quand il vit en
bonne harmonie avec son frère; mais, du jour où le
faible empereur tombe sous l'autorité de Rufin et d'Eutrope,
Claudien, qui approuve Honorius de se laisser
gouverner par Stilichon, ne peut pardonner à Arcadius
d'en faire autant. Mais c'est trop insister sur ce point;
et il serait injuste d'exiger d'un courtisan qui fait des vers pour ses maîtres, de l'élévation dans les idées et de
l'indépendance dans les sentiments. Il serait plus injuste
encore de ne pas reconnaître les qualités remarquables
qui brillent dans ces vers de commande, et assurent à
Claudien une place distinguée parmi les poëtes de second ordre.
Il y a peu de variété dans l'oeuvre poétique de Claudien,
et je ne crois pas utile de donner les titres des pièces
qui forment son recueil. Essayons plutôt d'en bien
déterminer le caractère.
J'ai eu occasion de montrer, en parlant des derniers
monuments de l'éloquence latine, comment des trois
genres reconnus, le genre démonstratif était à peu près
le seul qui eût survécu. La poésie subit aussi plus ou moins cette nécessité des temps. Claudien est le représentant
accompli du genre démonstratif en vers. Il ne sait que louer ou invectiver, louer le maître et ses favoris,
invectiver ses ennemis. Mais, dans ce cercle si étroit, il a déployé des mérites fort remarquables, et je ne crois
pas qu'aucun poète de cour puisse lui être comparé.
Je prends un exemple dans les deux genres. Claudien
veut chanter le 3e et le 4e consulats d'Honorius Augustus.
Le sujet était difficile, car Honorius avait alors dix
ans et onze mois ; mais son père vivait encore, Théodosc
le Grand; c'est lui qui sera l'âme du poëme. L'enfant
royal, tout brillant des espérances qui reposent sur lui,
illustre déjà par son père, promet au monde un grand
empereur. La pourpre lui sied, il est revêtu d'une majesté
précoce ; sur son visage éclate une fierté guerrière
qui rappelle les exploits sans nombre de Théodose. Il est
né pour ainsi dire, il a grandi dans les camps: « A peine les peuples barbares ont-ils appris qu'un enfant était né au héros, sur les rives du Rhin, voici que les Germains commencent à trembler ; le Caucase effraye agite la cime de ses forêts, l'Égypte s'incline, et dépose ses flèches. Quant à l'enfant, il se traîne parmi les boucliers ; ses hochets, ce sont les dépouilles toutes fraîches des rois; c'est lui qui le premier embrasse son père, quand, tout farouche, il revient des combats. »
A peine a-t-il atteint sa dixième année, il demande
des armes. « Tel un lion qu'abritait l'antre de sa mère au poil fauve, et qui tétait sa mamelle, dès qu'il a senti croître les griffes à ses pattes, la crinière à son cou, les dents à sa gueule, il repousse cette molle nourriture, et quitte l'abri du rocher, il brûle d'accompagner son père errant aux déserts de Gétulie ; il menace déjà les étables, déjà il se couvre du sang d'un taureau superbe. »
C'est là la partie la plus originale des poëmes laudatifs
de Claudien. Cette association de la gloire du père et des
belles espérances que donne le fils, plaît à l'imagination.
Le poëte sort du lieu commun, et il rencontre de belles
images pour peindre ce qu'il y a de plus charmant ici-bas,
les premiers rayons d'une destinée illustre. Les faits
n'ont pas encore démenti ces belles promesses ; cet enfant
qui grandit sera peut-être un second Théodose.
Il convient aussi de louer les longues mais nobles recommandations
du père à son fils. Cette espèce de testament
politique est animé d'un souffle généreux. Le
début ne manque pas d'une sorte de gravité antique.
« Si la fortune t'avait assis sur le trône des Parthes, cher
enfant, si, descendant des Arsacides, tu étalais aux yeux l'éclat barbare de la tiare orientale, la noblesse de ta race pourrait suffire ; tu pourrais, satisfait de la gloire de ton nom, consumer dans le luxe et la mollesse une vie inutile. Mais d'autres lois sont imposées à ceux qui dirigent les destinées de Rome; c'est sur leur vertu et non sur leur nom qu'ils doivent s'appuyer. »
Il y a même dans ce poëte courtisan un souvenir
éloquent de la Rome républicaine.
« N'oublie pas que tu commandes aux Romains, qui pendant longtemps ont commandé au monde entier : c'est un peuple qui n'a pu tolérer l'insolence de Tarquin, ni l'autorité usurpée de César. L'histoire te racontera les crimes d'autrefois. Tu verras que la honte ne meurt point. Qui ne flétrit et ne flétrira à jamais les monstruosités de la maison des Césars? Qui pourrait ignorer les meurtres de Néron, et les rochers de Caprée où s'alla cacher l'ignoble vieillard ? »
Il serait facile de détacher de ces poëmes plus d'un
passage digne d'être admiré. Claudien, en effet, a de
l'imagination, de l'éclat et une certaine élévation dans les
sentiments. Si les princes qu'il loue ne méritent pas tous
les éloges qu'il leur décerne, il sait du moins ce que c'est
qu'un grand prince, ce que c'est que la gloire, la vertu, le
désintéressement, la clémence ; il n'adore point, il
n'encense point les viles passions des princes, il ne
célèbre point leurs vices ; il veut voir en eux les vertus
dont il a l'esprit possédé. Au fond, est-il plus excessif dans
ses louanges que Virgile et Horace? Je ne le crois pas.
Après tout, Slilichon comme homme de guerre valait bien
Auguste ; chanter, dans Honorius enfant, les espérances
qu'il donne au monde, il n'y a là rien de trop exorbitant
pour l'époque. Ce qui est insupportable, ce sont les
épithalames, l'éloge de Sérena, celui de Mallius Théodorus, d'Olybrius, de Probinus. Sur ce point, j'abandonne
Claudien.
Mais il excelle dans l'invective. Ses deux poëmes contre
Rufin et Eutrope sont des oeuvres éloquentes et d'un
singulier éclat. Je sais tout ce qu'il y a d'excessif, de faux
et même de peu généreux dans les outrages amers,
lancés à des vaincus, à des morts ; mais c'est le style du
sujet et le ton de l'époque. Ce qui n'appartient qu'à
Claudien, c'est la vigueur du pinceau et la chaleur du
langage. Un historien, un philosophe aurait recherché et
expliqué les causes de l'élévation de Rufin et d'Eutrope ;
comment ces personnages de vile extraction, dont le
dernier n'était pas même un homme, sont-ils devenus
les véritables maîtres d'un grand empire? Il serait absurde
de dire qu'ils n'ont dû leur haute fortune qu'à leurs
vices : s'ils avaient peu de vertus, ils avaient assurément
du mérite : un eunuque, vendu sur la place publique, ne
devient pas consul et premier ministre s'il ne possède
des qualités réelles: l'empereur préférerait après tout pour
favori quelque descendant d'une noble famille : s'il
accepte le joug d'un eunuque, c'est que celui-ci a su
l'imposer. De tout cela le poëte ne tient nul compte; il
ne voit que la bassesse du personnage ; il se complaît dans
les peintures les plus violentes de son abjection première
; il en fait comme le rebut de la nature entière,
un être qu'on ne peut nommer; puis il le montre revêtu
de la pourpre et de la trabée, précédé des licteurs portant
les faisceaux, donnant son nom à l'année; il évoque
le souvenir des consuls de la vieille Rome, il les convie à
la contemplation de cette infamie. C'est une joie pour lui
que d'énumérer toutes les turpitudes de cette vie étrange,
de fouiller dans les replis de cette âme souillée, et d'opposer sans cesse l'abjection de l'origine et celle de l'âme
aux splendeurs dont l'eunuque a été revêtu. Ajoutez à
cela une sorte de satisfaction, quand il nous rappelle que
c'est à la cour d'Arcadius, en Orient, que de telles hontes
s'étalent. Ce n'est pas à Rome ou à Milan qu'un Rufin ou
un Eutrope pourraient se faire jour jusqu'aux premiers
honneurs de l'État. La vieille majesté romaine vit encore
à la cour d'Honorius ; et c'est lui ou Stilichon qui purgera l'empire d'Orient de ces deux monstres qui le déshonorent.
Voilà les procédés de l'invective dans Claudien.
Malgré la diffusion et les déclamations trop ordinaires en
pareil sujet, on ne lit pas sans plaisir ces virulentes
satires. Le sentiment est sincère, honnête ; il y a
dans ce poëte de cour une indignation réelle. Les souvenirs
de l'ancienne Rome le soutiennent et l'inspirent ; si
ce n'est pas un citoyen qui parle, c'est du moins un admirateur
des temps où il y avait des citoyens.
Claudien a de l'imagination; il fait un emploi assez
heureux de la religion et des machines poétiques, surtout
quand il s'indigne; il a du coloris et de l'énergie. Il est
dépourvu de mesure. Les sujets de ses chants étaient
maigres; il leur donne un embonpoint factice au moyen
de développements et de répétitions souvent fastidieuses.
Ce qu'il y a de plus remarquable en lui, c'est la versification
; souple, variée, harmonieuse surtout, elle est
une imitation savante de Virgile et de Lucain.
§ III.
RUTILIUS NUMATIANUS.
Ce n'est pas un Romain, ni même un Italien qui ferme
la série des poëtes de cette dernière période, c'est un
gaulois, Rutilius Numatianus.
On ne sait s'il est né à Toulouse ou à Poitiers, mais il
n'y a pas de doute sur sa nationalité; lui-même nous
apprend qu'il a quitté l'Italie et s'est rendu en Gaule où
l'appelaient les malheurs de sa patrie.
C'est là un sentiment généreux. La Gaule tout entière
était alors en proie à la dévastation ; les barbares la ravageaient
périodiquement, et l'Italie, envahie à plusieurs
reprises, conquise par Alaric, ne pouvait porter secours
aux provinces. Les catastrophes se succédaient; le vieil
empire tombait en ruines, et sur ses débris commençaient
déjà à apparaître les États nouveaux d'où sortiront
les sociétés modernes.
Il y avait là une riche matière pour un poète. Quelle
révolution dans le monde que la chute de Rome ! Quelles
perspectives offertes à l'imagination dans cette longue
agonie de l'empire ! Quels seront les successeurs des
maîtres du monde? Que de peuples barbares se sont déjà
précipités sur les provinces ouvertes, ont accumulé les
ruines et ont disparu! La ville éternelle survivra-t-elle à
ce débordement des nations? Les anciens oracles seront-ils
confondus? Apparaîtra-t-il un sauveur? Et quand
même le poëte ne chercherait point à pénétrer les voiles sombres de l'avenir, ne suffirait-il pas d'égaler les lamentations
aux calamités présentes?
Mais Rutilius Numatianus a l'imagination légère et
agréable plutôt que forte. C'est bien un Gaulois, un Gaulois
romanisé; mais la solide gravité romaine n'a pu
transformer la nature primitive. C'est de plus un fonctionnaire.
Son père, Lachanius, avait été proconsul en
Toscane, et les habitants du pays, satisfaits de son administration,
lui avaient élevé une statue. Rutilius, lui aussi,
était entré dans les charges publiques. En 417, il était
préfet de Rome, dignité considérable jadis. C'est en 419
ou 420, pendant ou peu après le voyage qu'il fit en Gaule,
qu'il publia le poëme qui a sauvé son nom de l'oubli. Ce
poëme a pour titre: Itinerarium. Il ne nous en reste que le
premier livre et une soixantaine de vers du second. Nous
ne possédons point la partie de l'ouvrage où l'auteur décrîvait l'état de la Gaule, sa patrie, et les sensations qu'il
dut éprouver à la vue de cette désolation.
Le poëme est écrit en vers élégiaques, d'un tour assez
facile et non sans élégance, un peu durs cependant. Le
choix de ce mètre indique la portée de l'oeuvre. Elle ne
renfermera pas de grands tableaux ; elle n'aura point
un mouvement ample et grave: ce seront de petits détails
juxtaposés, une série de silhouettes agréablement jetées
sur un fond sombre.
Rutilius dépeint les lieux qu'il a non pas traversés,
mais vus dans son voyage, et qu'il a vus à une certaine
distance. En effet, ce haut fonctionnaire, ce préfet de la
ville, n'ose voyager par terre : les Goths sont partout, et
ces barbares seraient capables de ne pas s'incliner devant
la majesté d'un magistrat romain. Aussi Rutilius voyage
par mer ; il rase les côtes, et, de loin, il distingue les contours des régions dont il n'ose approcher. Quels rapprochements
s'offrent à l'esprit ! Un préfet de Rome forcé
de se cacher, et cela aux portes mêmes de Rome ! Cette
dure nécessité n'imposait-elle pas pour ainsi dire le ton
et la couleur du poëme? Il fallait un Jérémie pour peindre
de tels désastres ; Rutilius n'est qu'un diminutif
d'Ovide. Comme lui, il colle ses baisers aux portes qu'il
doit abandonner,
il pleure, les sanglots étouffent sa voix ; il supplie Rome
de lui pardonner cet abandon. Que pense-t-il de Rome?
C'est la reine superbe du monde qui lui appartient :
c'est la mère des hommes et des dieux
et il énumère les exploits de la cité victorieuse, et cela
après qu'elle est tombée aux mains d'Alaric ! Dans cette
invocation fastueuse et vide, deux vers se détachent : le
poëte a entrevu un des côtés sérieux de la grandeur de
Rome, l'unité des peuples accomplie par elle. Il y avait
là matière à de belles et fécondes idées, à de nobles peinturcs; mais il tombe aussitôt dans le vide de la mythologie
ou dans les souvenirs héroïques, si cruellement déplacés.
Voilà le patriotisme de Rutilius : il est sincère, mais
qu'il est borné et puéril ! Comment peut-il croire que Rome va reprendre d'une main ferme la domination du
monde, quand tout lui échappe à la fois, quand lui-même,
il n'ose toucher le sol de l'Italie? Le dernier souvenir, la
dernière impression qu'il emporte de Rome, c'est le bruit
des applaudissements qui retentissent au cirque. Est-ce
sur les gladiateurs qu'il comptait pour chasser les barbares
?
Rutilius, si plein d'illusions sur l'avenir de Rome, n'a
que le plus profond mépris pour le christianisme. Cela
devait être : pouvait-il comprendre la révolution religieuse
qui s'accomplissait, lui qui se refusait à voir la révolution
politique accomplie ? Mais il n'ose guère épancher
sa haine et son dédain. Heureusement il lui tombe un
juif sous la main. Juif, chrétien, pour lui c'est tout un ;
il en est resté à l'opinion de Tacite sur ce point. A ce
juif, il adresse les injures " dues à cette race dégoûtante".Elle a le coeur froid, comme le froid sabbat qu'elle célèbre;
elle condamne le septième jour à un honteux
repos, symbole de la fatigue de son dieu.
Il regrette enfin que Titus ait soumis la Judée. Puissamment
imaginé !
Après les juifs, les moines ont leur tour. En longeant
l'île de Capraria, il a entrevu des êtres sales qui fuient la
lumière. «Ils s'appellent moines, dit-il, d'un mot grec,
parce qu'ils veulent vivre seuls et sans témoins. Ils fuient
les faveurs de la fortune, parce qu'ils en craignent les revers. Ce sont de vils esclaves ; un fiel noir gonfle leurs
coeurs. » Que d'ignorances et de préjugés sots dans ces
quelques vers! Quelle légèreté surtout! Bientôt, en effet,
la barque de Rutilius glisse le long des rivages de Pise
et de Cyrnos, et le poëte envoie à un de ses amis, qui a
fui le monde pour se faire moine, un adieu mélancolique
d'un tout autre ton.
« Je me détourne avec douleur de ces rochers qui me
rappellent une douceur récente : c'est là que s'est enseveli
vivant un concitoyen égaré. Hier, il était des nôtres ;
jeune, d'illustre naissance, sa fortune était brillante, il
était marié à une femme digne de lui: le délire le saisit,
il abandonne les dieux et les hommes; sottement crédule,
il va s'exiler, se cacher dans une vile retraite. Malheureux
! il croit que les misères et la saleté sont chères aux
cieux ; il se torture lui-même, cent fois plus cruel que les
dieux outragés. Cette secte, je le demande, n'est-elle pas
plus funeste que les poisons de Circé? Autrefois, cétaient
les corps qu'on changeait, aujourd'hui, ce sont les âmes.
Ainsi Rutilius Numatianus assista à la plus
grande, à la plus complète révolution qui se soit acomplie dans le monde, la chute de l'empire romain et l'établissement du christianisme, sans se douter du spectacle imposant qu'il avait sous les yeux.
FIN DU TOME SECOND
![]()